06.09.2013
Septembre

Car septembre est une charnière et l’antichambre voilée des longues catacombes. Rien ne s’y passe, tout s’y annonce. Les paysages semblent au promeneur inattentif toujours habillés de l’étoffe des belles saisons, pourtant, depuis longtemps déjà le loriot a tu sa mélodie flutée et déserté à tire d’ailes, cap sur les tropiques lointains, les feuillages poussiéreux des grands bouleaux. L’hirondelle fait sa plume, fouille son aile comme pour y vérifier qu’y sont bien emmagasinées toutes les réserves nécessaires au voyage, le martinet est devenu muet, la caille et la perdrix piètent et s’agitent, inquiètes de ces grandes plaines ouvertes qu’aucune forêt d’épis ne vient plus protéger et qui les abandonnent aux cruels appétits des hommes et du faucon.
L’équilibre est fragile et silencieux. Rien n’est encore ni jaune, ni ocre, ni rougeâtre aux arbres des chemins. Il faudra pour cela attendre que la machine ronde bascule de l’autre côté de l’équinoxe, qu’elle perde totalement sa sève printanière, descende à petits pas vers l’abandon du jour, qu’elle abdique, qu’elle fasse allégeance à l’avancée des ténèbres et célèbre leur victoire dans la magnificence des camaïeux.
Cet équinoxe sonne le glas de la fête champêtre : les granges regorgent et les champs sont vidés de leurs graines. Sous les latitudes atlantiques, l’Océan bousculera tantôt ses écumes et chahutera plus nerveusement la coque des navires, des brouillards lascifs épouseront le cours des rivières et dessous leurs ouates en suspension endormiront les marais et les plaines. Sous les latitudes continentales, là où je promène mes jours, les vents prendront source plus à l’est encore, sur la morne platitude des steppes, aiguiseront là-bas leurs couteaux et viendront mordiller aux visages des hommes.
Tout cela n’est inscrit qu’en filigrane sur les jours encore bravaches de septembre, qui tente de donner le change, de résister, comme si l’été, emporté par son élan, ne trouvait plus son terme et décidait cette année de ne pas s’en laisser compter par l’éternel retour des mortes saisons.
Mais le temps tourne une à une les pages des climats, ne referme jamais le livre, passe de la dernière à la première ligne et ainsi de suite, dans une lecture en boucle du monde…
Jusqu’à ce que l’homme, qu’il soit des hautes marches ou du vulgum pecus, qu’il soit rustre ou poète, laid ou beau, arpente sa dernière saison, referme le livre et dans un dernier souffle mouche la chandelle sur la beauté des choses.
09:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.09.2013
Fuite
Je ne sais pas trop ce qui me pousse à publier cette photo que je viens de recevoir de la fille de mon frère aîné, récemment disparu… Elle date de 1972, je crois. J’ignorais jusqu’à son existence même… Un choc.
Est-ce un pied de nez au temps qui passe et nous tue que je veux publier ?
Mon frère jouait de l’harmonica, lui qui avait réalisé ma première guitare. Lui à qui je dois d’être musicien.
Quand je regarde ces deux photos que quarante ans d'une vie incertaine séparent, je me dis que, finalement, j’ai toujours vécu avec une guitare entre les bras...
Qu'elle aura été ma seule constance.
2012 :

Et...
1972 :

13:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.09.2013
Ce champ peut ne pas être renseigné
 Vous avez jusqu’à ce jour eu mille interprétations du monde, sans qu’aucune ne soit venue réellement satisfaire votre idée du monde. Votre besoin préconçu, plutôt.
Vous avez jusqu’à ce jour eu mille interprétations du monde, sans qu’aucune ne soit venue réellement satisfaire votre idée du monde. Votre besoin préconçu, plutôt.
Ne trouvez-vous pas ça curieux ? Comment peut-on voir de mille façons les choses sans trouver dans cet écheveau de considérations celle que l’on recherche ?
Qui ne trouve pas dans le vaste canevas matière à broder son propre motif porte sans doute en lui une incapacité à broder.
Certes, vivre sa vie n’est pas chose aisée dans un monde dont la survie dépend justement de la négation de cette vie. Quand tout s’applique à en servir la représentation en guise de réel. Le succédané en guise d'authentique.
Mais, sachant cela, ne savez-vous donc pas l’essentiel, c’est-à-dire n’avez-vous pas la résolution du mystère de vos insatisfactions ? Si, à un carrefour, il est vous indiqué d’un côté fausse route et de l’autre vraie route, pourquoi vous obstinez-vous donc à vous engouffrer dans la fausse ? Seriez-vous, par commodité, partisan de marcher sur le faux afin de mieux imaginer le vrai ?
Ah ! Je vois ! Vous aimez à faire mentir les contraires surtout lorsqu’ils vous sont clairement définis. Vous aimez la fiction.
Ce n’est donc pas l’énigme du monde que vous cherchez à résoudre mais votre propre énigme.
La clef ?
Ailleurs que sous les paillassons convenus.
10:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.09.2013
Pacifisme bêlant ?
 Le grand-père assis au bout de la table lapait entre ses lourdes moustaches blanches une soupe de vermicelles.
Le grand-père assis au bout de la table lapait entre ses lourdes moustaches blanches une soupe de vermicelles.
Il racontait.
Il disait l’horreur d’un massacre et la vermine de la fange, les ventres béants d’où suintaient les viscères, la mort et le sang. Il crachait dans le feu et disait encore que nous ne pouvions imaginer ça. J’ai vu des trucs que vous ne verrez jamais. Et puis, soudain, il divaguait, il évoquait un souvenir précis, plus atroce que tous les autres peut-être, en disant l’aut' jhour ou la s'maine dernière.
Plus il racontait et plus la mémoire enfouie sous plus de soixante années de retour à la normale se rapprochait de lui, envahissait son cerveau, frappait à sa porte et se muait en présent.
L’instituteur disait un nombre effroyable de cadavres, un nombre que nous ne savions pas écrire encore, montrait un autre grand-père, mais qui ne mangeait pas de soupe aux vermicelles entre sa moustache fière et neigeuse. L'instituteur disait Foch, ou Joffre ou Clémenceau. Il pointait sur la carte Compiègne, Verdun, Chalons sur Marne. Puis il regardait sa montre et commandait soudain de fermer les cahiers. Plus il racontait et plus l’horreur s’éloignait, devenait leçon, devoirs à la maison, bonne note à décrocher.
L’un avait vu, l’autre avait appris. Tous les deux disaient la même abomination, l’un avec ses tripes massacrées, l’autre avec sa tête offusquée.
Le jeune homme écoutait le premier et voyait l’horreur dégouliner sur la parole qui tremblait.
Ce soir, il noterait dans un cahier des phrases et des mots épars.
L’enfant écoutait le dernier et regardait par la fenêtre le calme automnal des vieux platanes.
Ce soir, il irait courir les bois et les champs.
Hier, dans l’immense forêt de Białowieża, je me suis rappelé l’un et l’autre de ces deux hommes, qui, chacun à leur façon, m’ont été chers. Il y avait au sol des rails étroits qui couraient sous les épicéas géants. Ces rails avaient été posés là par les méchants, ceux qui avaient fait du mal au grand-père et avaient provoqué le courroux ému de l’instituteur.
On ne m’avait pas raconté que, de l’autre côté de l’épouvante, sous la neige, dans le froid, dans la grande forêt ennemie, des hommes posaient ces rails parce que pour tuer tous les vieillards et tous les instituteurs d'un monde adverse, il leur fallait transporter du bois, beaucoup de bois, pour faire ceci, pour faire cela.
J’étais hier de l’autre côté du rideau infernal. Chez les méchants qui sont tous morts, qui n’ont laissé derrière eux que ces deux rails étroits, jetés dans la pénombre silencieuse des grands arbres.
Le vieillard aussi est mort. Et l’instituteur avec.
Et je me suis senti soudain fourbu à penser qu’un siècle après, d’honorables et bons imbéciles en étaient encore à vouloir tuer des méchants.
Que le chemin de Damas n’est pas encore trouvé sur lequel se révélerait enfin aux hommes une lueur d’intelligence primaire :
Car enfin, la Camarde est assez vigilante,
Elle n’a pas besoin qu’on lui tienne la faux !
Image : Philip Seelen
12:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.08.2013
A la française
 Quand nous avons le plaisir d’accueillir des amis polonais à notre table, nous essayons, comme ils en ont exprimé le désir, de «faire français», autant que faire se peut. Ça leur plaît beaucoup. Avec la plaisanterie récurrente cependant : à la condition qu’il n’y ait ni grenouilles ni cagouilles au menu !
Quand nous avons le plaisir d’accueillir des amis polonais à notre table, nous essayons, comme ils en ont exprimé le désir, de «faire français», autant que faire se peut. Ça leur plaît beaucoup. Avec la plaisanterie récurrente cependant : à la condition qu’il n’y ait ni grenouilles ni cagouilles au menu !
Les clichés culturels ont la vie dure, là comme partout ailleurs. Nous-mêmes en sommes bourrés.
Bref, D. cuisine français et je mets mon grain de sel, lequel grain se limite, hélas, le plus souvent, à quelques conseils de bon aloi, puisque je suis un piètre cuisinier.
Quand je m’aventure à faire un plat, j’en fais tout un plat. Qu’on déguste par courtoisie. En revanche, je suis préposé aux confitures, je suis imbattable pour faire des confitures, je suis le cordon bleu du confit et j’aime ça, ces fruits parfumés de soleil et qui se liquéfient sous le feu, que j’arrose de bon sucre, mirabelles, framboises et, surtout, prunes. C’est une de mes grandes et délectables occupations aux portes de l’automne : confiturer. Cette idée de mettre en cage des fruits que je dégusterai aux petits déjeuners, quand les matins d’hiver seront alors transis de vent et de neige, me plait beaucoup.
Je confiture donc à l’excès.
Quand j’aime, je fais tout dans l’excès.
Quand je déteste aussi, d’ailleurs. J’ai une grande admiration pour les pondérés, les modérés, les justes-milieux. Quoiqu’ils m’ennuient assez vite.
Mais revenons aux repas à la française dans ma maison polonaise.
Le premier bouleversement des habitudes autochtones consiste à servir les plats un par un. Car sur la table polonaise, comme sur la suédoise, tous les plats sont présentés à la fois. C’est une bonne idée à mon sens car cela permet aux maîtres de céans de vraiment partager le repas avec leurs convives, de discuter, d’être disponibles plutôt que d’être sans cesse levés pour offrir ceci ou cela, réchauffer, mettre en plat.
L’ordre est rigoureusement français : apéritif, hors-d’œuvre, viande, fromages, desserts, café. Pas d’entorse au protocole culinaire !
Les fromages cependant font figure de gâteries exotiques, les Polonais n’étant pas de grands amateurs de fromage, sinon en casse-croûte pris vite fait sur le pouce ou au petit déjeuner. Ils ont tort. Car ils en font d’excellents, notamment un qui accuse quelque parenté avec le Comté. Bursztyn, ce qui signifie l’ambre, dont il a peu ou prou la couleur.
Mais le clou, la cerise sur le gâteau de ces repas à la française, c’est le vin, fils sacré du soleil, végétale ambroisie ! Là, je suis l’incontestable (et incontesté) chargé de mission. Je les choisis, je les débouche quelques heures avant l'arrivée des amis, j’hume leur arôme… ça me rappelle beaucoup de souvenirs, des bons et des nettement moins bons. Mais j’aime toujours le parfum du vin, j’y vois des coteaux de soleil et des vignes alignées sous l’automne qui flamboie.
Les commensaux, toujours, goûtent du bout des lèvres. Je les exhorte gentiment à vider leur verre, pour resservir…. Je les trouve bien sobres, bien tempérés, peu enthousiastes. Hé oui, le vin, notre grande fierté, notre aristocrate des papilles gustatives, n’est guère apprécié. Les Polonais, hors quotidien, arrose leur repas de petits verres de vodka. Des repas criblés de trous normands, donc !
Alors, parfois, faisant fi de l’ambiance française, pris d’une grande compassion pour mes amis polonais, parce que je les aime bien, je sors les petits verres caractéristiques. Les yeux amicaux s’allument aussitôt, les sourires se dessinent, et je sers un petit verre de vodka… Voire deux.
Car l’amitié, c’est aussi un échange de bons procédés… culturels. Un panache et une alliance.
11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.08.2013
Brassens et l'écriture
On peut me faire, à propos de Brassens, le vaillant reproche d'être un inconditionnel. Et s'il y a au monde des gens particulièrement ennuyeux, en quelque domaine que ce soit, ce sont bien les inconditionnels.
Tant pis ! Je revendique... Je ne puis d'ailleurs que revendiquer. Ayant, comme tu le sais, lecteur, un goût prononcé pour l'écriture et, en même temps, des velléités d'écrivain, je ne puis, encore une fois, qu'être ému devant l'intelligence et la simplicité de ce que disait cet homme à propos de l'écriture, de la musique, de la vie, de l'inspiration poétique...
Et à propos d'inspiration, justement, je "connais" bon nombre de nos contemporains qui seraient bien inspirés de prendre dans ses paroles, dans sa façon de voir les choses, de saines et de profitables leçons de modestie.
Chapeau bas, donc. Encore et toujours.
09:35 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.08.2013
Enfermement - 2 -

J’avais alors pris cette habitude de marcher en sens inverse.
C’est mieux pour éviter la foule qui dit des bêtises intelligentes.
J’entamais donc ma marche sous le crépuscule des lunes naissantes et, les mains derrière le dos, je traversais des champs, des bois, de petites rivières et des halliers.
Mes plus belles balades étaient hivernales. Parce que c’est beau, l’hiver. On se sent chez soi quand les choses désemparées d’elles-mêmes sont vidées de leurs parures et dispensent le langage de l’essentiel.
C’est arrivé une nuit sans lune et froide, celle du mardi-gras.
Je venais de terminer la rédaction d’un livre et j’étais un homme apaisé.
C’est mon métier. Je suis un écrivain. Mais pas un écrivain marchand.
Je n’ai d’ailleurs jamais marché en marchand. Je n’ai toujours marché que pour moi-même. Sans méditer.
Car dès lors que j’ai franchi la frontière de la solitude quasi absolue - celle dont parlait un autre écrivain et qui disait que lorsque les rapports d’un être humain se limitent à ceux qu’il entretient avec son épicier et sa crémière, les choses commencent à devenir vraiment claires - je ne me suis plus posé les questions qui encombrent l’espace réservé au monde.
Toutes les questions sont vaniteuses, je l’ai déjà dit. La seule réponse à toutes les questions du monde se trouve derrière l’horizon flamboyant et c’est une inaccessible réponse.
Insurmontable frayeur, par tous chaque jour formulée sans jamais être dite.
Et tous ceux qui ont vu derrière cet horizon n’en ont plus jamais reparlé. Et les autres, les pieux, les philosophes, pire encore, ceux qui relèvent des deux catégories, se sont crus autorisés à parler à leur place.
Ils ont usurpé la parole des voyageurs passés de l’autre côté du couchant.
La nuit du mardi-gras, donc, il ne gelait pas très fort mais la terre était dure et noire des gels profonds des nuits précédentes. J’étais emmitouflé et j’arrivais bientôt à la fin de ma promenade, lorsque le sentier sort des bois et se glisse dans les villages, chez les gens qui dorment.
C’est là que j’abandonne. Toujours. Près du sommeil des gens.
Ce n’est pas leur sommeil que je fuis, vous l’aurez pressenti. C’est leur réveil.
C’était ma promenade Nord, de loin ma préférée, celle des bois sombres et des bruissements fauves.
Car, voyez-vous, j’avais quatre promenades bien définies par les quatre horizons de la terre.
La promenade Sud, à l’opposé, était celle des champs et des buissons courts.
Une promenade toute acquise au soleil pendant la journée, sans doute, et la nuit entièrement offerte aux souffles timides de la lune, ça c’est sûr. Une promenade sans ombre. Ouverte.
La Ouest, elle, suivait la rivière et traversait quelques taillis moussus, faits d’aulnes et de roseaux. Une promenade humide, un peu indécise et où le pas qui s’enfonce est parfois pénible.
La Est escaladait lentement un coteau et débouchait soudain, c’était à chaque fois surprenant, sur une sorte de plateau herbeux avec des arbres par-ci, par-là et du vent toujours dedans. La promenade des renouvellements de décor.
Pour l’heure, sur ma promenade Nord, la plus froide, le temps de faire demi-tour, de retraverser les bois de chênes et de châtaigniers suintant l'odeur mouillée des deux essences, d’arpenter un petit champ gibbeux, de pénétrer dans un autre bois encore par un sentier de brumes, il serait l’heure du premier aboiement des chiens et du premier soupir des loups.
Je me glisserai alors dans les draps.
Paisible.
Puis je travaillerai tout l’après-midi à mes corrections.
J’aime me corriger. C’est comme si j’étais deux hommes. Un passé et un présent. Tiens, qu’est-ce qu’il raconte là, ce gredin ? Et là, c’est bien ce qu’il dit… Je me corrige le plus souvent à voix haute.
Ça donne l’illusion des brouhahas de controverses, ce qui multiplie encore la solitude.
Ensuite, je dînerai en buvant du vin et je ressortirai à mon rendez-vous avec les ombres de la nuit.
Pour marcher.
Demain, serait la promenade Ouest.
Car mes promenades tournent en sens inverse des aiguilles de la montre. Elles tentent ainsi de remonter une idée, de conjurer une fuite. Elles cherchent à tourner le dos à l’horizon qui chute.
10:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.08.2013
Une nouvelle
NOCES D'OR

Les oreilles s’écartaient des têtes, même si ça n’était pas un Bovary que l’on mariait ce jour-là : on célébrait les noces d’or d’un couple de campagnards septuagénaires, monsieur et madame Eugène Démoisseau.
On était donc rasé de près, on s’était affublé de ses plus beaux atours, on avait même pour l’occasion astiqué l’automobile.
Les paysans, pour la plupart de la famille du couple champion de la longévité conjugale, et quelques amis, se tenaient raides, empêtrés dans leur habit du dimanche, quoiqu’ils affectassent d’offrir un visage gai et décontracté, celui qui sied au caractère convivial de ce genre de réjouissances. Ils piétinaient cependant sur l’espace herbeux tenant lieu de terrasse devant l’auberge, en attendant enfin l’heure du déjeuner, car on avait - et ça commençait à se murmurer de groupes en groupes -l’estomac dans les talons. Il était près d’une heure et demie et on baguenaudait depuis dix heures du matin !
On avait d’abord assisté à une messe, ce qui n’avait pas été du goût de tout le monde, certains hommes de conviction, de rudes gaillards, sanguins, aux bras puissants et velus, étant ostensiblement demeurés sous les tilleuls du parvis, les mains dans les poches, la cigarette au bec et en causant fort. Si fort que des femmes courroucées leur en avaient fait le reproche, parce qu’on les avait entendu, soi-disant, de l’intérieur de l’église dont le portail était resté ouvert.
Tout le monde avait ensuite été prié de venir admirer une exposition réalisée par le vieil époux. Une exposition de photos et de parchemins jaunis retraçant la vie du jeune homme, puis de l’homme marié, vaillant cultivateur, puis, finalement, la vie paisible du retraité et tout ça se terminait par un trait d’humour, ou d’angoisse, difficile à dire, les deux peut-être, l’un devant conjurer l’autre : deux points suspensifs fermés par un point d’interrogation. Le tout avait été placardé à la mairie sur les murs de la salle du conseil municipal, sous l’œil hautain de Mitterrand. L'époux était en effet conseiller et le maire - qui figurait d’ailleurs parmi les convives - lui avait gentiment octroyé ce privilège.
On s’était exclamé, on avait tapé sur l’épaule du père Démoisseau, on avait fait mine de se pencher pour mieux voir les détails des vieux clichés ou lire l’écriture emberlificotée des documents - extrait de naissance, certificat d’études, état des services militaires, actes de mariage, actes de propriété et tutti quanti - et on avait tout de même un peu brocardé l’artiste autobiographe du fait qu’on ne voyait pas beaucoup la présence de sa femme dans tout ce bel inventaire. Toute une vie s’étalait donc là et les photos, nombreuses, des deux jeunes et sémillants conjoints, debout sous l’ombre d’un chêne aux ramures abondantes, la mariée tout sourire arborant un gigantesque chignon et tenant dans ses mains fluettes un gros bouquet d’iris, accusaient cruellement la fuite lamentable du temps, quand on jetait vers le vieux couple un regard torve, comme pour vérifier l’authenticité de ce qui était montré là.
C’est ce qu’on disait, en tordant le nez, en reniflant fort et en haussant les épaules. On disait que les saisons de la vie filaient bien trop vite, qu’on était tous logés à la même enseigne et on affectait de faire le philosophe et de déplorer que ce n’est pas grand-chose de nous, si on y réfléchit bien !
Mais le clou de l’exposition, le chef-d’œuvre d’ingéniosité devant lequel pavoisait son auteur, en se dandinant et en donnant force explications, un sourire béat illuminant sa grosse figure, c’était un cadre sous verre, énorme, large de deux mètres au moins et haut d’un mètre environ, avec des cases de toutes les couleurs et des branches, et des ramifications et des brindilles : l’arbre généalogique de la famille Démoisseau. Eugène commentait qu’il avait fait des recherches obstinées pendant trois ans, que ça l’avait bien occupé et qu’il avait eu de la chance parce que depuis des siècles et des siècles, sa famille n’avait guère bougé de la contrée. Il avait en tout et pour tout fait une dizaine de communes et ça avait été parfois difficile parce qu’à la Révolution, des papiers avaient été détruits.
Ah, les révolutions, grommelait l’auditoire unanime, c’est jamais trop bon !
On sifflait cependant d’admiration, on notait avec grand respect que les premières racines de l’arbre puisaient dans les années 1670 et que les dernières ramures s’élevaient jusqu’en 1999. Oui, du bon travail, du travail de fourmi, qu’on disait en congratulant le chercheur minutieux et en pensant que ça ne servait vraiment à rien des conneries pareilles et qu’il ne fallait pas savoir quoi faire de ses dix doigts pour s’occuper à des choses de même.
Avec tout ça, donc, l’heure avait filé et on était maintenant pressé, sans en faire évidemment montre, de mettre enfin les pieds sous la table. D’autant que les deux époux avaient eu la curieuse idée d’aller dénicher une auberge au beau milieu des marais de Nuaillé – le bien nommé -, complètement retirée, qu’on avait eu mille peines à trouver, même qu’on s’était perdu, qu’on avait fait des demi-tours, et qu’on s’était un peu énervé dans l’intimité des voitures, ronchonnant que c’était de l’orgueil que de venir faire l’original là, plutôt que de manger tout simplement au café-restaurant du bourg, ou même à la salle des fêtes, où l’on aurait pu être servi par Gustave, le boucher charcutier traiteur de la commune.
Elle était effectivement fort difficile d’accès, cette auberge, et quelqu’un qui n’eût pas été prudent, aurait risqué, c’est sûr, de s’embourber dans un cul de sac fangeux, voire de tomber dans une petite conche. Au beau milieu des prairies que les mortes saisons inondaient et que séparaient entre elles des haies de frênes-têtards impeccablement alignés, des fossés, des chemins de halage ou de traverse, c’était une espèce de gargote à quatre sous, basse et longue, avec des murs d’un blanc approximatif, par endroits lépreux, surmontés d’un vieux toit moussu et passablement avachi. Elle n’avait pas de fenêtre. Juste au-dessus de l’unique et lourde porte vitrée, la tête d’un gros chef cuisinier surmontée d’une toque géante, la mine poupine, de lourdes moustaches noires qui lui dégoulinaient bien en-dessous du menton, un sourire amène en dépit de quelques dents manquantes, l’œil radieux, jouisseur et gourmand, se balançait inlassablement sous les coups de butoir des vents, en gémissant et en grinçant.
Son front était barré d’une flétrissure de rouille qu’on eût dit une affreuse estafilade.
Un menu manuscrit placardé sur la porte offrait de déguster ici des sauces aux lumas, des rôtis, des matelotes d’anguilles, des lapins en gibelotte, des coqs au sang et des huîtres farcies. Juste en-dessous de la vieille enseigne, était également disposée une planche retenue tant bien que mal par deux ficelles et qui annonçait à la peinture violette : A la tambouille tranquille.
Les convives des noces d’or, inquiets et affamés, lorgnaient sur l’aspect quelque peu délabré de l’établissement.
Pour le tranquille, certes, on ne pouvait guère mieux annoncer la couleur. Ça l’était tant que c’en était troublant pour un commerce ayant pignon sur rue. Pignon sur le silence des prairies, qu’elle avait en fait, la guinguette toute de guingois. Dans leur jargon charentais, des goguenards impatients murmuraient qu’o d’vait être ravitaillé par les grolles, y’a pas d’bon dieu ! En effet, aucune voie goudronnée ne conduisait là et pas la moindre signalétique alentour, ni sur les chemins vicinaux, ni sur la route départementale, ni sur la nationale 11, La Rochelle-Limoges via Niort, qui filait par-delà les peupleraies à quelque dix kilomètres de là, n’indiquait qu’il y eût dans les parages un restaurateur qui proposait de faire savourer les spécialités régionales : ceux qui venaient se perdre ici étaient assurément des initiés. Ils devaient, en outre, être de sacrés gourmands et la qualité de ce qu’on leur offrait répondait sans aucun doute aux exigences de cette gourmandise, pour qu’ils s’aventurent comme ça dans les marais, par des chemins boueux, mal aisés, au milieu des champs inondés.
C’est ce qui rassurait un peu les invités des noces d’or et c’est ce qu’ils se disaient entre eux, en se pourléchant les babines ou, pour certains, en se frottant même la panse, comme font les enfants quand ils disent miam miam.
Enfin, les maîtres de céans invitèrent tout le monde à pénétrer à l’intérieur de l’auberge. On s’y rua en meute, on s’y bouscula et on se chamailla quasiment pour trouver une bonne place. C’était là peine perdue : chaque couvert était nominatif et comportait une petite étiquette avec les nom et prénom de chaque commensal. Alors, on fit le tour des tables en se heurtant un peu, en se penchant pour lire, les myopes en ajustant leurs lunettes, les presbytes en les enlevant, et on se croisait, on plaisantait qu’on ne trouverait jamais où s’asseoir dans tout ce fourbi, on faisait demi-tour et on braillait, et on s’interpellait dans un inextricable brouhaha.
Enfin tout le monde se trouva installé. Un lourd silence se fit alors, avant que l’on ne serve les apéritifs, du pineau fait maison, ainsi que le claironna le patron des lieux et tout le monde en rigolant effrontément, et même en le montrant du doigt et en poussant du coude son voisin, reconnut en lui la réplique exacte de l’enseigne, la balafre de rouille en moins.
La salle à manger était étroite, démesurément longue, et ne présentait nullement l’allure négligée de l’extérieur. Bien au contraire. Deux tables rustiques, massives, épaisses, impeccablement cirées et chacune affublée de deux bancs du même tonneau, en occupaient toute la longueur. De part et d’autre de cette salle, de petits buffets, de plaisants confituriers, deux magnifiques vaisseliers en merisier et des placards astucieusement pratiqués dans l’épaisseur des murs en pierres délicatement jointées, servaient au rangement de la vaisselle. Tout respirait la propreté et la décoration de l’ensemble, rideaux de fines dentelles, quelques plantes vertes, des tableaux discrets suspendus ça et là, était sobre, de bon goût, si on arrivait tout de même à faire fi d’un goupil empaillé, le poil rêche, l’œil de verre ébloui, la dent agressive exhibée sur des gencives noirâtres, qui pontifiait sur un meuble bas, pourtant d’une très belle facture.
Pendant qu’on versait le pineau dans de petits verres de cristal, monsieur le conseiller municipal, Eugène Démoisseau, se leva et entama un discours, ce qui ne manqua pas d’inquiéter encore les plus affamés de l’assemblée. Bon dieu, c’est pas vrai, qu’ils se disaient ceux-là, on n’arrivera jamais à s’caler l’estomac ! Le vieux marié cependant, après s’être éclairci la voix par un petit raclement de la gorge, dit qu’il était heureux de réunir autour de lui et de son épouse, en ce jour mémorable, toute sa famille et ses plus chers amis. Il décrivit avec tendresse ce 25 mars 1949 où il avait convolé en justes noces avec Madeleine Dupuis - devant laquelle il fit une petite courbette en demandant qu’on l’applaudisse au passage - comme si, remarquèrent in petto quelques futés, le fait de l’avoir supporté pendant cinquante ans méritait effectivement d’être applaudi. Puis l’orateur se perdit en des considérations d’ordre météorologique sur ce 25 mars 1949 et que, à bien y réfléchir, le climat se réchauffe mais il est vrai aussi qu’à tout bien considérer si on va par là, il faudrait voir si…
Bref, personne n’écoutait plus. Il se rassit, un peu confus, on cria hip hip hip hourra, on lui fit la claque avec frénésie, on porta un toast et, sans plus d’ambages, on se jeta comme des loups enfin libérés sur les merlus froids couchés sur leur épaisse mayonnaise, leurs rondelles de tomates et leurs feuilles de salade.
On eût entendu une mouche voler à travers le cliquetis des fourchettes, des couteaux et des verres. On s’empiffrait, on buvait de l’entre deux mers, on réclamait par des signes en direction des jeunes filles déambulant entre les deux grosses tables, du pain, encore du pain, toujours du pain, pas assez de pain, du bon pain !
On s’empiffrait sans retenue. Vinrent les anguilles persillées. On les avala avec le même emportement en les accompagnant de grandes lampées de vin rosé, du vin de Loire. On se léchait les doigts, on torchait les plats avec de grandes bouchées de pain frais, on avait les commissures des lèvres et, pour certains, le menton, qui luisaient.
Les estomacs ainsi flattés, les conversations, d’abord éparses avant qu’elles ne se changent en un chahut où tout le monde parlait en même temps, purent reprendre alors, en attendant les gigots d’agneau accompagnés de leurs traditionnels flageolets. Et quand il ne resta plus bientôt que les os de ces beaux morceaux d’agneau, les trognes étaient rouges, violacées, et on s’interpellait, et on riait, et on criait, et on chantait, et on tapait sur la table en vidant des bouteilles de Côtes du Rhône.
Eugène Démoisseau se leva et hurla que madame Démoisseau allait chanter. C’était juste avant les plateaux de fromages. On se tut soudain et la mariée, petite femme toute fluette, avec un visage rieur encore fort agréable, entonna, très haut, Rossignol de mes amours, en faisant tous les trémolos et en tenant bien les longues notes, tant que des vieillards, l’émotion décuplée par les alcools, versèrent quelques larmes d’attendrissement.
On l’applaudit avec fougue, on se leva de table, parfois en renversant une chaise au passage, et on vint l’embrasser. L’exaltation était à son paroxysme. La fête, comme on dit communément, battait son plein.
Un observateur minutieux de tout ce charivari d‘ivresse eût cependant pu distinguer en son sein comme une sorte de brebis galeuse. Un homme très grand, énorme, le visage rond comme un ballon, rouge, était assis juste en face des héros de la fête, juste en face de sa sœur exactement. Il s’agissait en effet de Gaston Dupuis, de dix ans le cadet de Madeleine, vieux garçon et qui passait au village pour un original et un bougon. Alors que tous les visages étaient rieurs, hâbleurs, lumineux, le sien restait obstinément fermé et pendant les cinq heures qu’avait duré le repas, il avait dû supporter les discours de son beau-frère - comme d’ailleurs les trois ou quatre autres convives installés alentour - sur la façon dont celui-ci s’y était pris pour faire son gigantesque arbre généalogique, avec tous les détails, les maires qu’il avait rencontrés, les conversations qu’il avait eues avec eux, les archives perdues et retrouvées et tout le Saint-frusquin.
N’ayant personne à qui adresser la parole, isolé face à l’incorrigible causeur, soufflant comme un phoque, suant sang et eau, Gaston Dupuis, déjà de constitution fort sanguine, s’était réfugié dans l’excès. Il avait deux ou trois fois repris de tous les plats, il avait bu comme un chameau au terme du désert, il avait avalé un fromage de chèvre entier, avait englouti des pâtisseries, bu des tasses de café et s’était complètement anéanti avec de grandes rasades de cognac. Il n’entendait désormais plus personne. Il regardait autour de lui, l’air hébété et s’épongeait le front avec un grand mouchoir à carreaux.
Alors qu’un invité, à l’autre bout de la salle, s’était levé et racontait une histoire dont la chute se proposait d’être salace, il en avait préalablement prévenu ces dames, il fut subitement interrompu par un bruit sourd, mat, en même temps que par des éclats de verre qui se brise : Gaston Dupuis s’était soudain écroulé et avait piqué le nez dans son assiette, encore à demi remplie de larges parts de tarte Tatin.
On se précipita, on l’allongea sur le sol, on s’aggloméra autour de lui presque à lui marcher dessus et à finir de l’étouffer, un gars beugla qu’il allait passer l’arme à gauche, nom de dieu, qu’il fallait vite le saigner et déjà il brandissait un grand couteau. On eut mille peines du monde à s’interposer et à le maîtriser.
L’aubergiste était au comble de l’affolement. A une vitesse vertigineuse une foule d’emmerdements qui ne manqueraient pas d’arriver si le drame se confirmait, tournoyaient dans sa tête. Il joignit enfin le SAMU de La Rochelle, lequel SAMU se perdit dans les marais, rappela l’aubergiste, s’embourba encore dans un chemin de traverse et arriva à la Tambouille tranquille alors que le gros Gaston Dupuis était déjà étendu sur un coin de table débarrassé à la hâte et qu’autour de lui, des hommes et des femmes, atterrés, faisaient des signes de croix désordonnés.
La même assemblée, exactement, suivit le sapin quelques jours plus tard, toujours affublée de ses plus beaux atours et la mine franchement lugubre.
On murmura que si seulement on avait été au restaurant du bourg, avec le médecin tout près, là, à deux maisons exactement, hé ben, ce pauvre Gaston…
Enfin, on n’accusait pas, hein ?
On disait, on supposait. Faut bien causer.
Illustration : Albert Fourié
10:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.08.2013
Enfermement - 1 -

Avant d’être ici.
C’est un lieu commun, voire un sentier besogneux : l’homme qui veut aller au bout de son art de vivre ne peut échoir qu’ici.
L’art de vivre qui ne trouve pas ici son prolongement, son aboutissement peut-être, a composé.
Et c’est tant mieux.
Cet art aura vécu entre la chèvre et le chou. Un loup choisira toujours la chèvre. Que voudriez-vous qu’il fît d’un chou ? Je vous le demande bien. Les chiens, eux, se satisfont de tout. Le chou pour lever la patte, la chèvre pour la ramener sur les sentiers battus.
En lui lacérant les jarrets.
Et ça lui donne un métier, au chien. Une raison d’habiter parmi les hommes.
Moi, j’ai peur des chiens. J’ai toujours eu une peur bleue des chiens. Des caniches comme des molosses.
Ici, on n’est plus parmi les hommes et les chiens ne viennent donc jamais. On est entre loups débusqués du hallier.
Mornes arbres d’un morne parc. Allées balayées par des automnes liquéfiés de maussades.
Regards aux yeux morts, translucides, vidés, blanchis, par le tourment léthargique de la chimie médicamenteuse, en surface et en pyjama.
Car je marchais.
Joie initiale, et jamais égalée depuis, d’être debout dans l’espace. Aller à la rencontre du vide posé devant vous.
Marcher sous la pluie qui fait couler sa froidure dans le dos ou sous le soleil qui ronge la peau.
Marcher sans dire.
Surtout marcher seul.
Parce qu’on marche d’abord vers cet horizon courbé et qu’on ne sait pas ce qu’il y a derrière le dos rond de cet horizon. On ne le peut voir qu'en solitude.
Le soleil y plonge. C’est tout ce qu’on sait.
Encore que…
Vient un moment où l’on ne sait plus si ce soleil sort de la terre ou s’il va s’y enfouir, tant que l’on ne sait plus, non plus, à quel bout de sa promenade on en est.
Au début ou vers la fin.
A l'aube ou au crépuscule.
Initiatique ou testamentaire.
Une plaine ? Une colline ? Un fleuve ? Des bois ? Une vallée ? Un désert de sable et de vent ? Des animaux ténébreux ? Au pire d’autres hommes, qu’il y aurait derrière cette échine enluminée ?
On ne peut rien affirmer de cet horizon voûté. Ou alors des bêtises. Des plates ou des savantes. Ça dépend comme on marche. En tous cas ne pas écouter ; sinon son propre murmure.
A écouter les bêtises plates ou savantes qu’on dit de la courbe de l’horizon, forcément on dira soi-même des bêtises.
Plus affligeant : on les croira bientôt.
Comme si on avait déjà été voir là-bas alors qu’on voit à peine jusqu’au bout de ses pieds. Il n’y a pas plus présomptueux, plus répugnant même, que quelqu’un qui marche en faisant croire qu’il sait déjà le paysage de derrière la colline.
Un raseur, un imbécile, au mieux un fat, voire un philosophe.
Non. Marcher, c’est ça qu’il faut ! Marcher avec le vent qui vous pousse ou qui sort de devant, d’on ne sait où, et qui chahute les poils du visage.
J’ai marché sur la piste du loup. La plus solitaire.
Je m’y suis perdu.
Le chemin jusqu’à l’horizon semblait pourtant largement ouvert et puis il y eut ce mur.
Enfin, c’est ce que je crois, que je me suis échoué sur un mur.
Mais peut-être suis-je en fait passé de l’autre côté de la colline en feu et que c’est ça qu’il y avait derrière la colline en feu.
Simplement.
Des imbéciles errants et qui avaient perdu le sens des allégories.
10:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.08.2013
Fiction, imaginaire, littérature et réel

J’avais dans les mains un bâton d’acacia et nous partions faire une promenade.
Nous nous sommes arrêtés pour le saluer. Il y avait longtemps que je ne l’avais pas vu. Quelques mois.
Il était assis devant sa maison, sur le vieux banc de bois, à l’ombre de son tilleul. Je l’ai trouvé triste et sa voix tremblotait plus que de coutume. Il a dit qu’il faisait froid aujourd’hui et il m’a demandé où j’allais.
Il m’a demandé ça dans le pur langage du paysan polonais, c’est-à-dire à la troisième personne et en faisant l’économie du verbe :
- Où est-ce qu’il, avec son bâton ?
A notre retour, nous l‘avons retrouvé sur le même banc, avec la même tristesse dans ses vieux yeux plissés, mais il s’était déplacé au soleil, répétant que le vent était froid. Il a dit qu’il était seul, que son épouse avant eu une attaque, qu’elle était à l’hôpital, qu’il n’y avait plus d’espoir, qu’il s’en voulait terriblement parce qu’elle était tombée dans la cuisine, il y avait quelques jours de cela, alors que, lui, il était en vadrouille dans le village.
Qu’elle ne parlait plus, qu’elle était paralysée de tout un côté, et qu’il avait peur, terriblement peur.
Et que si seulement, elle pouvait revenir, même grabataire, mais là, à la maison ! Il s’en occuperait, il l’accompagnerait, il la soignerait, il lui ferait la soupe.
Sa voix tremblait, infiniment triste ; il dodelinait de la tête.
Et au crépuscule, un sinistre gyrophare arrosait de bleu le petit banc où nous l’avions vu assis quelques heures auparavant.
Cigogneau, mon voisin, celui que j’avais fait entrer dans ma littérature avec Polska B dzisiaj et dont j’avais fait le personnage principal de la dixième nouvelle du Théâtre des choses me racontant la tuerie nazie de Łomazy du 17 août 1942, était tombé dans le fossé ; dans son fossé.
Mort de chagrin. De solitude. De peur. De culpabilité.
J’en éprouve une grande tristesse.
A cet anonyme vieillard que le monde ignore, mais entré dans mon imaginaire par la porte du réel, je dédis, encore plus, ces deux passages :
« […] un vieux bonhomme de mes voisins a suivi pas à pas et chaque jour les travaux de ma maison. De la démolition à la reconstruction.
Chaque jour, il est venu fureter. Il a commenté, examiné, critiqué, montré du doigt, balbutié.
Je n’ai pourtant compris que deux choses de ses discours vacillants. Parce que, par ces deux fois, il avait été plus éloquent, utilisant les gestes, les mains et les yeux.
La première, sans rapport avec la maison, c’est qu’il avait quatre-vingt ans déjà et que le plus grand désespoir de cet âge était de ne plus pouvoir bander. Koniec, la fin, avait-il inlassablement répété en branlant du chef de dépit.
Ses yeux sont mi-clos comme si la lumière l’indisposait et sa bouche sans dents avec des gencives rouge vif est toujours ouverte et agitée d’un petit tremblement convulsif.
Il bée. Aussi l’ai-je surnommé Cigogneau sur nid, parce que ces grands oisillons sont toujours comme ça sur leur nid aux étés finissants, bec ouvert sur la chaleur tremblante, comme si leurs poumons manquaient d’air ou leur gosier d’eau.
La seconde fois où j’ai reçu le message de Cigogneau, je lui disais que j’allais peindre ma maison enfin terminée en vert. Avec le toit et les volets marron.
Il n’avait pas du tout aimé. Sa petite voix très haut perchée s’était égosillée qu’il ne fallait pas faire ça, qu’avant la guerre c’était la couleur des maisons juives. A Łomazy, le bourg de la commune, il n’y avait que des juifs et Łomazy n’était alors qu’une maison verte.
Et alors ? Alors ? Les juifs de Łomazy ont été massacrés dans la forêt, tout près de là ! Plus de deux mille la même épouvantable journée d’un mois d’août 1942. Du sang à faire vomir de dégoût tous les nuages du ciel.
Il n’y a plus une seule maison verte dans les environs. Il y a une mémoire et un monument sur le charnier où végètent des fleurs sans parfum et sautillent des oiseaux toujours muets.
(…)
Alors Cigogneau a-t-il eu peur que je me fasse massacrer à mon tour? Hait-il cette couleur qui lui rappelle les horreurs d’une boucherie ? Une couleur qui porterait malheur et dont il aurait voulu me protéger.
Ou alors, les vieux fantômes de la haine ancestrale sont-ils revenus marteler sa vieille caboche ?
Je ne sais pas. Je le regarde. Il a l’air si gentil. J’opte pour la superstition protectrice. Sans quoi je ne pourrais plus le regarder. Sa bouche tremble et écume pourtant. Mais il est vrai qu’elle tremble et écume tout le temps.
Je ne peindrai pas ma maison en vert. J’ai changé d’avis. Parce que je n’aime pas faire injure aux fantômes. Surtout ceux-là. Ils me poursuivent depuis mes premiers bancs d’école, depuis mes premiers livres d’histoire. Mais de très loin.
Maintenant, ils sont là. Chaque jour, je longe l’orée de cette forêt où les corps mitraillés du ghetto méconnu de Łomazy se sont tordus d’épouvante. »
Polska B Dzisiaj - 2008 -
« Il ne boit plus son thé, la Chesterfield s’est consumée dans le cendrier. Longtemps, longtemps, il raconte encore, avec des détails d’une précision qui me soulève le cœur. Longtemps, dit-il, les gens ont évité de traverser la forêt, longtemps ils ont cherché l’oubli. La plupart de ceux qui ont vu, sont morts à présent. Ils ont emporté avec eux l’insupportable calvaire de leur mémoire.
Je luis prends la main, sa vieille main bleuie, sèche, ridée, maigre et qui tremble, et je lui dis que les hommes sont des créatures monstrueuses, parce que je ne sais pas quoi dire, parce que je suis moi-même épouvanté par ses souvenirs. Il tourne vers moi son visage.
Des larmes, de grosses larmes, des pleurs venus des tréfonds de sa vieille âme, ruissellent sur ses joues délabrées et qui pendent.
La gorge nouée, je lui demande de m’excuser, c’est de ma faute, je n’aurais pas dû lui demander de raconter.
Du revers de sa manche de veste, luisante de crasse, Cigogneau essuie ses larmes et frottent ses paupières accablées.»
Le Théâtre des choses - La dixième nouvelle - Editions Antidata - 2011.
Image : Cigogneau, l'hiver dernier
11:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.08.2013
Là où la main de l'homme ne met plus le pied

C’’est à 140 Kilomètres de chez moi, au nord, direction Białystock.
Un enchevêtrement luxuriant, hétéroclite, bizarre, inquiétant, de la forêt d’où toute activité humaine est bannie depuis 1921 et dont elle fut même protégée bien avant cette date, en tant que territoire de chasse réservé aux tsars... C'est un lambeau de ce que fut toute la grande plaine européenne, jadis, comme les murs d'une cathédrale restés debout après le passage du séisme civilisateur, une cathédrale des choses quand elles sont livrées à elles-mêmes, un théâtre dont le décor est conçu par les seuls personnages chargés de jouer la scène, avec une architecture minutieusement organisée, dans ses formes les plus gigantesques comme dans ses moindres détails, visibles ou non à l’œil nu.
Une impression de remonter le temps d’avant avant, jusqu'au temps pénultième, jusqu'au temps hercynien, sur une pente de silence. Quand la grande forêt, celle que nous portons au fond de nous, celle qui vit en nous, qui n’existe nulle part ailleurs qu’en nous, avec nos peurs, nos angoisses et notre sentiment joyeux d’une inaliénable totalité, resurgit.
Car il y a quelque chose du retour du Grand Pan dans ce désordre dionysiaque où la vie, la mort, le petit, le grand, le faible, le fort, le parfaitement galbé et le difforme, se partagent l’ombre et les trouées de soleil. Rien ici n’est inutile : tout être qui ne réclame à la terre que de lui prodiguer la joie et qu'elle nourrisse son besoin de vivre est admis à participer à la fête. Et c'est bien la raison pour laquelle l'homme en est exclu.
Devant ce désordre aussi inextricable que s’il avait été jeté là par lassitude ; ce désordre qui ne l’est que pour l’œil aliéné du néophyte humain, pour l’œil du prédateur divorcé d'avec sa proie, aucun arbitraire pourtant n’est admis. On a là, véritablement, devant cette vie d'où jaillit l'incompréhensible liberté, le sentiment d’y appartenir fondamentalement. Le sentiment océanique d’être à la fois la goutte et la mer, le nuage et le ciel, le bout de son nez et l'horizon, l’éphémère et l’éternité.
Je n’ai évidemment pu m’empêcher de m’enquérir auprès de mon jeune guide de la présence du loup :
- Są. Il y en a.
Car ce loup va de pair avec ce qui nous est constitutif, avec cette débauche jubilatoire et puissante que les civilisations humaines n’ont pas totalement détruite ; le loup est ici chez lui, invisible, mais, moi, je le devinais derrière chaque broussaille verdoyante et mon pied, forcément, avait parfois l’impression de marcher sur ses pas. Le voulait plutôt.
Certaines envolées cependant sont à l'âme ce que la lumière trop éclatante est au papillon de nuit. Redescendu au sol, en traversant l'autre forêt polonaise, pourtant si belle, j'avais devant les yeux comme la vision de vieux lotissements désormais intégrés aux paysages.
C'est bien avec le Syndrome de Stockholm que nous lisons notre planète gâchée.
Remerciements à la Direction du Parc de Białowieza pour l'autorisation accordée de diffuser ici ces quelques images. Le site est classé UNESCO et patrimoine mondial de la biosphère.
09:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.08.2013
Seul l'amour a le goût non frelaté de la subversion
 Ça n’est pas parce que les hommes et les femmes au pouvoir n’ont d’ambitions que personnelles et misérables, qu'ils mentent, trichent, échafaudent, qu'ils ne sont que les porte-paroles frauduleusement élus d’un système qui n’a de sens que pour lui et que pour eux ; ça n’est pas parce qu’il y a des pauvres et des riches et que partout règnent une honteuse injustice et une misère surannée, que les hommes et les femmes tardent à trouver -ou à retrouver- le chemin du bonheur, mais bien parce qu'ils ont abandonné le courage de s'aimer.
Ça n’est pas parce que les hommes et les femmes au pouvoir n’ont d’ambitions que personnelles et misérables, qu'ils mentent, trichent, échafaudent, qu'ils ne sont que les porte-paroles frauduleusement élus d’un système qui n’a de sens que pour lui et que pour eux ; ça n’est pas parce qu’il y a des pauvres et des riches et que partout règnent une honteuse injustice et une misère surannée, que les hommes et les femmes tardent à trouver -ou à retrouver- le chemin du bonheur, mais bien parce qu'ils ont abandonné le courage de s'aimer.
Qu’ils s’aiment comme s’aiment les pigeons. Pas trop loin d'un nid. A hauteur d’un perchoir. Par crainte du vertige et pour ne pas quitter trop longtemps des yeux la mangeoire salutaire.
Qu’ils ne convient pas chaque matin au chevet de leurs amours la muse enchanteresse des volontés de vivre autrement.
Si les hommes retrouvaient le courage de se passionner pour l'amour, le système qui les accable et leur sert de prétexte à don-quichotter, ne serait plus à combattre : il chuterait de lui-même.
Et les fâcheux et les fâcheuses diront encore, sans doute, que je donne des leçons, parce que les fâcheux et les fâcheuses ignorent forcément qu’un homme qui ne désire rien d’autre que la vie, quand il pense tout haut ou qu'il écrit, n'a toujours de leçons à donner qu'à lui-même.
Ce dont il ne se prive jamais.
Ite missa est.
09:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.08.2013
La d'vinette littéraire de l'été
Quel écrivain fut un temps surnommé le libre Mangeur, en façon de détournement sarcastique de l'expression libre penseur ? Pourquoi et principalement par qui ?
09:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.07.2013
Célété

C’est vraiment charmant, l’été. Toujours fidèle à elle-même, c’est une saison qui nourrit grassement le chroniqueur en catastrophes. La peur et la mort, ça fait de l’audience. Beaucoup plus que le bonheur de vivre.
Je me languis donc de revoir septembre et la sérénité de ses couleurs. Je me languis de l’automne, en regardant passer l’été des villégiatures-tragédies.
Sur ce, je ferme la boutique quelques jours, pour bien faire voir que c'est la saison où l'on ferme la porte derrière soi, sans que cela ne soit un drame (!)
Je retourne à ma musique. CD sans doute terminé à la fin de ce mois. Aux premiers jours de septembre. Un mois qui chantera. Peut-être...
08:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.07.2013
Attendez-moi sous l'orme !

Il n’est pas à moi. Il n’est à personne, en fait. Il est à lui seul sans doute. Le concept n'eût-il été honteusement galvaudé, que je l'eusse volontiers baptisé "l'arbre de la liberté".
C’est un ormeau, l’arbre qu’un mal sournois a pratiquement rayé des paysages de l’ouest, l’arbre tellement à l’écoute des hommes qu’il a donné là-bas son nom à bien des villages de Charente-maritime ou de Vendée, des Lhoumeau et des Oulmes, par exemple.
Si proche des humains qu’il a même évolué de son berceau latin, ulmus, en oulme, puis carrément en homme, s’inscrivant dans les pierres de la mémoire sous le nom de lieux-dits tels que Le pas de l’homme, Le col de l’homme ou encore Les quatre hommes.
Un arbre véritablement humaniste.
Le mien – enfin, je veux dire celui qui se dresse à dix pas de ma maison dans un no man’s land d’inextricables halliers - fait honneur à la générosité de son espèce : il arrose bénévolement une partie de mon territoire de ses dernières branches qui retombent en de lascives tonnelles, jusqu’à terre bientôt, et sous lesquelles j’aime musarder.
Sous son aile protectrice, je n’attends rien. J’ai les pensées incertaines qu’on a parfois à l’ombre des grands monuments. Celui-ci a connu les démantèlements successifs de la Pologne, il a été Russe, Polonais, Allemand de l’infamie gammée, Polonais encore mais plié sous le collectivisme stalinien, puis enfin Polonais républicain, aux brises largement libérales.
Il a vu passer à ses pieds, courir, fuir et s’affronter des soldats de tout drapeau. Des casqués, des cosaques, des cavaleries échevelées, des artilleurs empêtrés dans la neige, des généraux pressés et vociférant des ordres et des contre-ordres... Peut-être a t-il même bu quelques gouttes de sang, au hasard d’une embuscade assassine.
Il surplombe les environs. De là-haut, il voit loin par-delà le Bug, en Biélorussie. Respect s'impose et, avec lui, la crainte.
Car aujourd’hui, le moindre orage prenant des allures de cyclone torrentiel fouetté par la violence des bourrasques, il me menace. L’ami, l’ancêtre, le témoin des âges anciens, dans sa fragilité majestueuse et sénile, risque de couper un sale jour ma demeure en deux, sous le poids d'une agonie précipitée par l’intempérance caractérielle des cieux.
Je l’ai vu se tordre sous la furie, résister bravement, pencher dangereusement, craquer de toutes ses fibres, gémir et hurler...Tout de même, me dis-je, si la foudre à ce jour n’a pas réussi à l’atteindre, disons depuis la fin du 18ème siècle, qu’aurait-elle la perfidie de venir aujourd’hui le terrasser sous mon nez ?
N’empêche. La prudence recommande qu’on lui fasse baisser pavillon ; Que d’habiles bûcherons, en cinq minutes et trois coups de tronçonneuse, l’amputent d’un siècle et le réduisent de moitié.
Mais les arbres en Pologne sont sous la protection bienveillante du législateur.
Un arbre de plus de cinq ans, où qu’il ait eu le caprice d'installer ses racines, où que vous ayez eu la négligence de le planter – avec cette inconscience coupable des pauvres hères qui s’affublent d’un petit animal de compagnie, serpent, chien, singe ou autre lézard sans prévoir qu’il est un être vivant qui va bientôt envahir l’espace vital – un arbre de plus de cinq ans d'âge, disais-je, ne vous appartient plus.
S’il vous prend fantaisie de vous en débarrasser, de lui jouer un sale tour de tronçonneuse, il vous faudra en faire préalablement la demande écrite et largement motivée à la mairie : préciser son essence, son âge, sa circonférence exacte à un mètre du sol et rédiger clairement les funestes raisons qui vous poussent à vouloir l’expédier soudain au royaume des cendres.
Si vous possédez un bois, une petite forêt privée, ne pensez pas qu’il vous sera loisible d’aller y puiser librement et chaque hiver votre provision de bois de chauffage. Un forestier de l’État vous accompagnera d'abord et vous indiquera nettement quels sujets vous pouvez prélever. S’il n’en juge aucun dans votre patrimoine qui soit indigne de survivre, hé bien, ma foi, il vous donnera gentiment l’adresse d’un marchand de bois ou de charbon.
Je plaisante, bien sûr, par exagération. Mais la réalité est bien telle que.
Par cette politique de l’arbre, dans un pays où le mercure descend régulièrement en-dessous de 20°, où l’électricité est hors de prix, où le fuel domestique coûte une fortune, où l’hiver s’éternise de début octobre aux premiers jours de mai, les Polonais ont bien compris que leurs amis les bois et les forêts, les haies, les bouleaux, les pins, les aulnes, les ormeaux et les vieux chênes étaient en mortel danger de convoitise permanente et qu’il valait mieux se rafraîchir à l'ombre éternelle de leur feuillage plutôt que de se réchauffer à l'éphémère de leur flamme.
Et cette clairvoyance et cette amitié instinctive, que n’ont-elles inspiré les gestionnaires prétentieux de l’ouest, aux climats pourtant timides, et fait se taire la bêtise et la folie hégémoniques des céréaliers de la Beauce, du Lauragais ou de la plaine charentaise !
Les paysages y auraient sauvegardé leur gaieté et eussent été épargnés de cette morne platitude où le regard porte de clochers en clochers, jusqu’à des villages dont on ne sait même plus dire le nom, tant ils sont accrochés aux miroirs d’autres horizons !
Mon ormeau – celui qui me prête son ombre – est un vieux guerrier. Si le vent furibond menace de jeter sa carcasse impériale en travers de mon toit, il n’en reste pas moins sous la protection des lois.
Pour services rendus à la poésie des lieux.
07:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.07.2013
Projection
 C’est sans doute parce que se profile en septembre la rentrée au collège, que cela lui semble une étape importante, un événement qui jalonnera son parcours, et qu’elle envisage qu’après il lui faudra franchir d’autres étapes encore jusqu’à un métier, qu’elle anticipe sans cesse. Qu’elle fait et refait le brouillon de ses hypothétiques aspirations, disons.
C’est sans doute parce que se profile en septembre la rentrée au collège, que cela lui semble une étape importante, un événement qui jalonnera son parcours, et qu’elle envisage qu’après il lui faudra franchir d’autres étapes encore jusqu’à un métier, qu’elle anticipe sans cesse. Qu’elle fait et refait le brouillon de ses hypothétiques aspirations, disons.
- Finalement, j’aimerais bien être gériatre, plutôt que médecin légiste.
- C’est pas gai de ne soigner que des vieux, que je dis bêtement.
- Il faut bien qu’il y en ait qui les soignent, s’indigne-t-elle à juste titre.
- Certes, certes… Mais je vois que tu remontes le temps. Des cadavres, tu es passée aux vieux… Encore quelque temps et tu voudras être pédiatre, que je rigole.
- Pédiatre ?
- Celui qui soigne les bébés et les enfants.
- Ah, non !J’préfère les vieux ! Je déteste les enfants
- Mais tu es une enfant !
- Oui, et alors ? Tu dis bien, toi, que les vieux c’est pas gai.
Je toussote.
08:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.07.2013
...Escaladant la dune sans jamais voir la mer

Je voyais donc ça comme une catastrophe humanitaire.
Et quand, pour faire plaisir à quelqu’un - car je n’ai jamais su nager et je déteste au plus haut point de la détestation, bronzer, lire, même un mauvais livre, ou dormir sur le sable - il m’arrivait, rarement, très rarement, de poser mon cul soigneusement non-dévêtu sur un emplacement à peu près libre et dont la superficie ne pouvait accueillir qu'une paire de fesses de modeste calibre, coincé entre la famille Duraton bouffant des gaufrettes chaudes dégoulinantes de confitures et les Bidochon lustrant d’une crème répugnante leur épiderme massacré par les UV, l’image s’amplifiait encore et en arrivait à me terrifier, tant que j’avais envie de hurler – que je l’aurais volontiers fait n’eût été la crainte de la camisole de force - à tous ces pauvres gens de rentrer chez eux, de ne pas obéir comme ça au cataclysme du haut et de revenir bientôt, libres, sur ces rivages engloutis par les tristes brumes de la Toussaint.
Avec des ciels gris, du froid humide qui cogne sur les rochers, des vents salés qui poussent des écumes blanches, avec des goélands inquiets peinant à regagner le large, leurs ailes fatiguées par la force des souffles et avec des solitudes ; des solitudes immenses à marcher sur le désert de l’océan. Délicieuses tristesses.
Bon dieu, que je me disais, incorrigible et impuissant pourfendeur des systèmes et des réflexes sociaux, même au repos acquis de haute lutte, même dans ce simulacre de bonheur censé les éloigner d'un quoditien morose, même là, on oblige donc les gens à être malheureux !
Enroulant prestement ma serviette sous mon bras, je m’enfuyais bien vite, - tant pis pour le copain ou l’ami qui voulait voir la mer - et je m’installais au bar le plus proche, devant un demi, voire deux, voire trois, maudissant naïvement les hommes, les femmes et leurs enfants, saccageurs de paysages et saccageurs de leur propre plaisir !
Une fois, il m’est arrivé là de descendre en enfer.
Je travaillais alors dans une usine d’ensachage de poudre de lait, j’y faisais les trois-huit et j’étais de semaine de nuit…. Comme chantait Béranger : ça vous épanouit la jeunesse, pour le monde on a d’la tendresse.
Bref. Pour faire plaisir à des amis de passage à la maison, des amis continentaux, il avait été décidé - vous noterez le vague très indéfini de la formule - qu’on filerait à la plage à 6 heures du mat, dès que j’aurai pointé la fin de mes huit heures de calvaire.
Je dormirai à la plage. D’accord ?
Ainsi fut fait. Le petit déjeuner fut au demeurant fort agréable, sur le rivage encore désert avec un petit vent de terre qui faisait frissonner le sable, avec de la viande froide et du gros Bordeaux aussi. Plus de Bordeaux que de viande froide, d’ailleurs.
C’était très agréable. Sentir en même temps s’enfuir la fatigue de la nuit besogneuse et monter l’ivresse… Et puis l'inégalable plaisir de dire de grosses conneries entre copains.
J’avais cependant très vite sombré dans un sommeil d’abruti, un sommeil obligatoire, sans plaisir, incontournable, avec le sourd ronflement encore frais de la mer dans les oreilles…. et… soudain dans ce sommeil pesant, empâté, des rugissements horribles, lointains, des présences incongrues, des voix imprécises, caverneuses, des pluies de sable, des cris et des rires étouffés comme venant d’un autre monde, des trépignements, des soubresauts, des couinements, des miaulements, des jappements, des frôlements, des gros mots et des interjections.
Je m'étais réveillé en sursaut au milieu d’une immonde marée de chair, de ventres, d'échines, de cuisses, de seins, de poils et de sueurs...
J’avais, bien injustement, fortement vilipendé tous ces gens égoïstes, en vacances, et qui ne respectaient même pas le sommeil d’un prolétaire épuisé. Un des leurs, en plus.
J'avais déguerpi, vociférant, sous l’œil protubérant, désapprobateur et méprisant du placide et compact troupeau des villégiatures estivales.
Je ne dormirai plus jamais sur une plage.
Ou alors à Noël.
Avec la Grande Ourse toute froide à mon chevet.
Titre emprunté à une chanson de Maurice Bénin : Je vis
11:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.07.2013
De la mémoire que nous lèguent les arts
 Le 10 août 1792, exacerbée par les sempiternels atermoiements des ténors de la politique dite révolutionnaire, la populace massacre aux tuileries les résidus d’une monarchie séculaire, ouvrant tout grand la porte sur la Révolution par le fait et sur la République.
Le 10 août 1792, exacerbée par les sempiternels atermoiements des ténors de la politique dite révolutionnaire, la populace massacre aux tuileries les résidus d’une monarchie séculaire, ouvrant tout grand la porte sur la Révolution par le fait et sur la République.
Robespierre est alors dans sa chambre, effrayé de ne savoir où donner du slogan jacobin. Car rien n'effraie plus un politique que de voir l'Histoire défiler et rugir sous ses fenêtres sans qu'il y soit pour grand-chose.
Danton va et vient, prend le pouls de la rue, ne conseille rien, ne dit rien de précis, ne comprend rien à ce qui se passe sous ses yeux, n’exhorte personne, attendant des événements qu’ils lui dictent l’attitude à adopter.
La nuit sanglante, il la passera finalement bien au chaud dans son lit.
Marat, L'Ami du peuple, terré dans sa cave, voue aux gémonies tous les traîtres de la terre, voit partout des gens à pendre et partout des têtes à désolidariser de leur cou, appelle au massacre et prend bien soin de ne pas s'exposer à la fureur du ruisseau.
Il ne montrera pas le bout de son museau.
Et il en ira de même des Saint-Just, des Desmoulins, des Hébert et des autres icones a posteriori.
De ces pleutres inquiets qui ont pris le train en marche dans l'unique espoir de s'installer bientôt aux commandes de la locomotive, de ces renards seulement préoccupés de leur avenir politique et rêvant de s'élever bientôt au pinacle en se targuant devant l’Histoire d’avoir été les investigateurs de la révolte et les prophètes de la Liberté, nos chanteurs, nos peintres, nos écrivains, nos sculpteurs, nos poètes, et, plus tard, nos cinéastes, ont fait des héros, des martyrs et, in fine, des légendes prédigérées pour simples d’esprit.
Sources : Michelet, Histoire de la Révolution française
12:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.07.2013
Biała Podlaska : Silence, on tourne !
 Il semblerait bien que les pouvoirs publics en Pologne souffrent d’une fâcheuse amnésie. Ils devraient pourtant avoir gardé en mémoire que le viol de la vie privée fut le lot de leur pays pendant plus de cinquante ans, que les citoyens en ont souffert et que leur lutte, couronnée de succès, pour retrouver les libertés fondamentales leur avait alors valu l’estime des peuples alentour, eux mêmes accablés sous le joug collectiviste.
Il semblerait bien que les pouvoirs publics en Pologne souffrent d’une fâcheuse amnésie. Ils devraient pourtant avoir gardé en mémoire que le viol de la vie privée fut le lot de leur pays pendant plus de cinquante ans, que les citoyens en ont souffert et que leur lutte, couronnée de succès, pour retrouver les libertés fondamentales leur avait alors valu l’estime des peuples alentour, eux mêmes accablés sous le joug collectiviste.
Mais les temps ont bien changé et la peste étant définitivement reléguée aux poubelles de l’histoire, on flirte désormais avec ses symptômes, se croyant sans doute à tout jamais immunisé.
Ayant ainsi quelques emplettes à faire au marché du centre-ville de Biała Podlaska, petite ville de 60 000 habitants où stationner son véhicule est un odieux calvaire parce que les parkings de terre battue y sont encore littéralement défoncés, que les parcmètres - impopulaires selon le maire - n’existent pas, que les gens qui travaillent dans les environs occupent donc autoritairement les quelques places disponibles pendant plus de huit heures par jour, et que, de surcroît, suivant le ratio nombre d’habitants/nombre de véhicules, elle est la ville qui possède le plus de voitures en Pologne, j’ai abandonné de guerre lasse la mienne pendant six minutes, bien rangée contre le trottoir mais à cinq mètres seulement d’un passage pour piétons.
Vous pensez bien que je n’ai pas calculé tout ça montre en main. Peinardement installés dans un bureau, sans même avoir la peine de mettre le nez à la fenêtre, les agents municipaux ont fait ça pour moi et ils m’envoient alors une amende assez salée à payer, avec l’heure et le lieu exacts de mon crime, ainsi que le temps qu’a duré mon inconvenance sociale.
Se faire verbaliser, certes, n’est jamais agréable, mais bon… Il faut bien que l’ordre règne, ici, comme partout ailleurs. En revanche, se faire verbaliser par un machin électronique qui vous voit, vous entend, vous jauge, vous enregistre à votre insu et vous dit à quelle heure et combien de temps vous avez mis pour acheter une botte de radis, ça, ça me révulse au plus haut point.
Colère, donc, et me voilà à rechercher partout aux alentours une indication qui m’aurait prévenu que j’étais filmé à mes risques et périls et qui, néanmoins, aurait échappé à mon attention, au demeurant fort peu soutenue sur ce chapitre.
En vain. De plus en plus en colère, je consulte les textes de lois et ceux-ci sont alors très clairs : toute personne filmée sur la voie publique doit en être averti par une signalétique compréhensible par tous.
Oui mais, c’est la loi française, ça. Et en Pologne ? Non, non, on a le droit de filmer les gens comme ça, sans autre forme de procès. Et le droit européen alors, que dit-il ? La Pologne, c’est bien en Europe, non ? C’est même le pays qui a raflé le gros lot des subventions pour ses infrastructures routières lors du dernier budget établi pour six ans à partir de 2014. Alors ?
Hé ben, l’Assemblée parlementaire européenne a pris une résolution le 25 janvier 2008, la résolution 1604 exactement, qui incite fortement les pays membres à mettre en place une législation sur les vidéosurveillances, laquelle législation obligerait les pouvoirs publics à porter à la connaissance des administrés, les rues, les lieux et les établissements où ils sont filmés.
C’est bien la moindre des choses… Elle ne s’est quand même pas fendue d’une grande résolution humaniste, l’Assemblée !
La Pologne fait néanmoins la sourde oreille sur un principe de liberté pourtant élémentaire, principe dont la botte stalinienne l'avait privée pendant un demi-siècle ! Mais il vaut mieux sans doute espionner les gens et, ce faisant, empocher une bonne recette mensuelle de PV plutôt que de se faire chier à construire des parkings dignes de ce nom ! En plus, avertir les citoyens de ce qu’ils sont dans le collimateur d’un fonctionnaire penché sur son écran, ce serait un peu tuer la poule aux œufs d’or, n’est-ce pas ?
Pragmatisme et mémoire courte, donc. Mémoire affligeante ! D’autant plus que les gens actuellement au pouvoir en Pologne, ne le sont, pour la plupart, que parce qu’auréolés de la lutte qu’ils ont su mener jadis contre la dictature communiste. Le premier édile de Biała Podlaska en particulier, ce qui l'honore sans ambages.
Mais il a tort de faire l’autruche pour économiser quatre sous au mépris de la liberté de circuler pour chacun des citoyens, sans être épié par sa technologie… Il a tort, parce que l’histoire, elle, elle a de la mémoire.
Le sachant, par ailleurs, cultivé et lecteur, je ne saurais dès lors que lui conseiller une relecture du fameux ouvrage de George Orwell…
Illustration : la rue où votre serviteur s'est fait filmer en flagrant délit d'incivilité.
12:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.07.2013
Vous en reprendrez bien un p'tit chouïa ? Où y'a d'la gêne, y'a pas d'plaisir...
 L’actualité du monde est bien dramatique, ma brave dame ! Hé oui, que voulez-vous qu'on y fasse, nous autres ?
L’actualité du monde est bien dramatique, ma brave dame ! Hé oui, que voulez-vous qu'on y fasse, nous autres ?
Surtout ne pas en dire un mot, au risque de ne dire que de basses âneries. Et puis, un blog est-il fait pour commenter les drames sanglants de la paranoïa humaine ?
Alors disons plutôt, tenez, l’autre versant de l’actualité, l’ubac, celui qu’on ne voit pas toujours, plongé dans l’ombre qu'il est. Celui qu’on ne veut pas voir aussi, qu’on vit pourtant tous les jours dans un endormissement digne de celui des bovins.
Vous aimez les tomates, par exemple ? Est-ce que vous aimez les tomates au saumon, avec un soupçon de crème fraîche et un brin de persil, l’été, sous les frondaisons généreuses d’un tilleul, d’un chêne ou de toute autre essence plantée en votre jardin ? Humm… Absolument délicieux, avec un verre de rosé bien frais. Elle n'est pas belle, la vie ?
Bon, ben, c’est bien joli tout ça, mais, désormais, simplifiez-vous la donc, cette vie ! N’achetez plus que les tomates. Car un bon nombre d’entre celles qui circulent dans vos assiettes où se régalent vos justes appétits, sont bourrées de gênes prélevés sur... des saumons !
Oui, expliquent, bonnards et le verbe suffisant, les scientifiques, ces gênes de saumon sont là pour la résistance du plant de la tomate au gel, car, comme chacun devrait le savoir, le saumon est un poisson qui évolue dans des eaux très froides et ses gênes sont alors de nature- oh quel vilain mot ! - à lutter contre les basses températures.
Hé, hé, on le voit : pour les géants de l'OGM et des marchés qui vont de pair, où il n'y a pas de gênes, il n'y a pas de plaisir !
Mais j'y pense : avez-vous vu le film Soleil vert, cette fiction située en 2022 ? Non ? Bon, ben, faites donc aussi, en sus du saumon, l'économie d'une séance, parce qu'on y est quasiment en 2022 et la fiction, confrontée à la réalité, risque fort de passer pour de l'imaginaire à l'eau de rose.
Bon appétit, messieurs dames !
11:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.07.2013
Une résolution humaniste
 Elle dit qu’elle fera de très longues études car elle veut être un médecin.
Elle dit qu’elle fera de très longues études car elle veut être un médecin.
Un chirurgien, plus exactement.
Je fais une moue qui se veut admirative, sinon encourageante.
Et je renchéris que c’est là un métier des plus nobles. Un métier, un art, une science qui sauve la vie des gens. Que j’admire les chirurgiens, capables qu'ils sont d'aller, avec la précision d'un horloger, extraire le mal au plus profond de la complexité du corps humain et que, de surcroît...
Oui, qu'elle interrompt mon dithyrambe, mais moi je veux être chirurgien... Comment dit-on déjà ? Chirurgien qui dissèque…
Médecin légiste ?!
Oui, c’est ça.
Je fais une moue qui se veut interloquée, sinon décourageante.
Drôle d’idée ! Et pourquoi donc ?
Parce que comme ça je ne risque pas de tuer mes patients.
Je fais une moue de je ne sais trop quoi.
Tout en admettant que l'argument est on ne peut plus imparable.
11:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.07.2013
Nouvelles réjouissantes d'un monde qui ne l'est pas moins

Vous avez un copain qui vous suit partout, qui lit votre courrier en cachette, qui fouille dans votre frigo quand vous avez le dos tourné, qui se cache sous votre lit pour voir et entendre ce qui s’y passe.
Ou ce qui ne s’y passe pas, le cas échéant.
Et vous avez soudain un autre type, un inconnu celui-là, vous ne savez pas trop d’où il sort, ce mec, qui vous aborde un beau matin, vous met la main sur l’épaule et qui vous siffle : hé, imbécile, fais gaffe, ton soi-disant copain, il surveille tout ce que tu fais et entend tout ce que tu dis… Mais le type, après avoir dit ça, bêtement, comme un âne, sans en mesurer les conséquences, vous demande, pour prix du service qu’il croit vous avoir rendu, s’il peut rester à dîner parce qu’il est tard, qu’il fait déjà nuit et qu’il est ennuyé maintenant car on lui veut des crasses terribles pour vous avoir affranchi.
Et vous, pourtant connu pour votre droit-de-l’hommisme ostensiblement affiché sur votre boîte aux lettres, vous ouvrez tout grand la porte et vous le flanquez dehors avec perte et fracas.
Solutions. Vous êtes : soit un pur salaud, soit un cinglé qui adore être écouté et vu, soit vous n’avez rien dans le pantalon et votre copain indiscret est tellement costaud que vous craignez de recevoir une dérouille si vous osez faire montre de votre indignation, soit vous lui devez beaucoup d’argent et vous ne pouvez pas vous permettre de vous fâcher avec lui, même s’il vous fait les pires saloperies dans le dos.
Bref, vous êtes une pute. Mais pas de celles qui annoncent sincèrement la couleur et en font métier. Non, non … Une de ces putes sournoises, avides de cinq à sept, de p'tits avantages et de pouvoir.
Ou alors, si la solution n’est pas dans ces quelques alternatives, elle est peut-être dans cette dernière : tout ça, c’est du pipeau pour amuser la galerie et qui poursuit d’occultes desseins. A n'en pas douter, malpropres.
______
Je crois que c’est papa Sigmund - ou un de ses fils spirituels - qui disait aux parents à propos de l’éducation de leurs enfants : faites ce que vous voulez, de toute façon, ce que vous ferez sera mal.
Remis en cause, il voulait dire.
Hé bien le corrézien fait roi, le pauvre, me fait beaucoup penser à papa Sigmund et son lapidaire conseil. Quoi qu’il fasse, sa marmaille fait la gueule. Elle dit de lui qu’il est mou comme une chique, velléitaire, qu’il ne voit pas plus loin que le bout de son appendice nasal, qu’avec lui on ne sait jamais où c’est-y qu’on va aller en vacances et même si on va y aller. Bon, bon, bon…. Mais tout d’un coup, le mou frappe du poing sur la table et ordonne à un de ses garnements d’aller se laver les mains avant de se mettre à ladite table.
Et vlan ! V’la toute la famille scandalisée qui crie au despotisme, à l’autorité malsaine, au connard, et qui lui lance des pierres et qui se mutine et tout et tout et tout.
Effrayé, le pauvre se retire dans sa chambre et se demande finalement s’il ne ferait pas mieux de confier tout ça à l’assistance publique.
______
Un gars fait sa pub en faisant payer ses affiches et ses clips vidéo aux voisins. Pris la main dans le sac et sommé de rembourser les susdits voisins, il demande à ses potes de faire la manche car, lui, il est raide comme un passe-lacet.
Aussitôt fait, aussitôt dit. Plus de 300 000 couillons sont prêts à mettre la main au porte-monnaie. Gageons que les «mancheurs» vont ramasser bien plus que prévu et se payer des gueuletons à faire pâlir d'outre-tombe Rabelais lui-même !
Pendant ce temps-là, les adversaires du gars indélicat - parce qu’il en a beaucoup - font le trottoir.
Des qui font la manche, d’autres le trottoir.
Dormez, paisibles chaumines, le monde est entre des mains sérieuses !
10:47 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.07.2013
L'anniversaire et le chien d'Emile Zola

Cette démarche liminaire m’avait alors été conseillée par un gars avec lequel je suis fortement brouillé aujourd’hui, ce qui ne signifie pas que je doive malhonnêtement taire son nom : François Bon.
Notre parcours, le mien comme le vôtre, est pavé d’amitiés et de camaraderies que les réalités sont venues démentir, mais que l’on ne doit pas - selon moi tout du moins - pour autant balayer d’un revers de la main comme si elles n’avaient jamais été, au risque de se faire apocryphe et révisionniste de sa propre histoire, autant dire passablement schizo.
Six ans déjà, donc, pour l’Exil des mots, ses 837 textes, hors ceux qui ont été plusieurs fois édités, et ses quelque 3000 visiteurs uniques mensuels, c’est-à-dire vous, quoique ce chiffre soit à prendre avec précaution dubitative, vu la façon dont «fonctionnent» les statistiques, là comme partout.
Peu importe, à dire à peu près vrai. Vous êtes là, et je suis là, en tant qu’individus et le blogueur s’adresse d’abord à un individu avant de parler pour une foule.
Pour fêter, à ma façon, ces six bougies, je vais vous poser une devinette assez cocasse. J’ignore si la solution en est sur le net, je n’ai pas vérifié ; je me suis refusé à vérifier.
La réponse, pour vous guider un peu, je la tiens directement de Maupassant :
Comment s’appelait donc le chien, le terre-neuve gigantesque, qu’Emile Zola avait toujours en sa compagnie à Médan et qui l'accompagnait partout, même dans son cabinet de travail ?
*
Image : Un gâteau avec six bougies, œuvre de D., … Mais c’était pour une circonstance toute autre !
14:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.07.2013
L'Idée

Celle qui, devant un fait, une chose, un événement, une contradiction, une rencontre, un être, s’évertue à trouver des causes, des conséquences, des tenants et des aboutissants.
Celle qui rassure et protège de la folie parce qu’elle s'alimente aux explications rationnelles, fussent-elles déshonorantes.
A Majdanek, Treblinka ou Sobibor, on est là. C'est tout. On est un être vidé de son sens. Il n’y a rien à dire. Rien à penser. Seulement on sait que l’impossible est possible. Est toujours possible. Sera toujours possible. Par-delà le bien et le mal et tant qu'il y aura des hommes.
En descendant plus loin l’escalier infernal, devant ces fours béants, ces pelles, ces instruments, ces salles, ces tuyauteries ingénieuses dont on vous dit qu’elles conduisaient l’eau chaude, chauffée par les fours où calcinaient les corps, et alimentaient ainsi, dans le coin, là-bas, la salle de bain des bourreaux afin qu’ils puissent agréablement prendre leur douche après leur service, on ressent soudain revivre son corps par une brusque nausée.
Mais la tête est toujours douloureusement vide.
On veut s’en aller. On veut voir sur la route de Zamość ces voitures qui filent et se doublent et se croisent, entendre des klaxons, sentir du présent dérisoire, saluer quelqu’un, serrer une main, embrasser une joue, marcher sur de l’herbe.
On veut fuir, ne plus faire devoir de cette mémoire qui empêcherait de vivre plus loin.
Et plus tard, quand cette géographie horrible sur laquelle s’est gravé l’indicible, n’est plus, on reprend peu à peu ses marques, on retrouve la faculté de penser et on pressent soudain, encore plus épouvanté qu’auparavant, que ce qu’on a vu, c’était le triomphe de l’idée.
On s’aperçoit que c’est cela qu’on était venu chercher dans ces enfers. Une vision raisonnée du dément. Connaître le germe qui engendra le Diable : l'idée.
L’idée. Retenue par les puissants barrages de la civilisation, de l’humanité, de la morale, de la culture, et qu’on a laissé s’échapper. Une fuite accidentelle. Une idée jaillie de cerveaux mal fermés et qui s’est répandue, tombant dans d’autres cerveaux mal étanches. Une idée qu’on a creusée jusqu’à l’atome et qui explosa, libérant toute son énergie diabolique.
La catastrophe de l’idée menée à son terme. C’est cela qu’on vient de voir. On tressaille : l'idée est encore dans les cerveaux et on tente de la juguler dans les méandres de ces cerveaux. Une idée toujours active et puissante, comme l’est toujours le réacteur de Tchernobyl, pour l’heure maîtrisé sous des tonnes de béton sans cesse renouvelées.
Le triomphe d'une idée, quelle qu'elle soit, va toujours de pair avec le triomphe des massacres, de la Saint-Bartlémy à Katyń, de l'Arménie aux plaines des Sioux et des Cheyennes, en passant par tous les lieux où l'humanité a retrouvé son originelle sauvagerie.
Et plus l'idée est fissurée profond, exploitée jusqu'à son cœur, plus elle explose dans la démesure.
Ne plus avoir d’idée. Sur rien. Les idées vaincues sont les seules innocentes de nos cerveaux...
13:43 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.06.2013
Réclame et CD
 Mon projet d’inscrire sur CD des poèmes que j’’ai mis en musique - un Baudelaire, un Villon, un Apollinaire -, trois fables de La Fontaine, deux chansons posthumes de Brassens dont j’ai eu l'immodestie de réécrire la musique parce que celle proposée par Jean Bertola n’était pas à mon goût, plus deux compositions de mon cru, est toujours à l’ordre du jour.
Mon projet d’inscrire sur CD des poèmes que j’’ai mis en musique - un Baudelaire, un Villon, un Apollinaire -, trois fables de La Fontaine, deux chansons posthumes de Brassens dont j’ai eu l'immodestie de réécrire la musique parce que celle proposée par Jean Bertola n’était pas à mon goût, plus deux compositions de mon cru, est toujours à l’ordre du jour.
Je me rends donc régulièrement au studio d’enregistrement et voilà bien qui est tout à fait nouveau pour moi !
Insouciant et trop sûr de moi, pour tout dire ne doutant pas de ma dextérité, je pensais en effet que cela serait beaucoup plus facile, que j’allais me ramener avec ma guitare, salut les gars, m’asseoir devant un micro, accorder, gratter, entonner, et hop, dix morceaux, dix heures, et l’affaire était dans le sac !
Las, las ! Chanter et jouer en public ou pour soi-même n’a rien à voir avec le studio. Je le découvre à mon grand dam. Parce que là, en séance d’enregistrement, on est en situation de laboratoire où il n’y a pas d’autre écoute statique et muette que celle de l’exigence de la technologie qui entend tout et qui ne laisse rien passer. Un doigt qui s’accroche un tout petit peu sur un accord, une corde qui vibre un millième de seconde de trop, la voix qui faiblit ou qui commet une fin de phrase un peu douteuse du point de vue de la tonalité, une mesure en trop ou bien en moins et basta, tout est à refaire…
On en sue sang et eau. Du moins mézigue. Parce que le technicien et propriétaire des lieux, lui, au demeurant fort sympathique, est d’un calme olympien, perfectionniste jusqu’à m’en hérisser le poil, sérieux comme un pape, si tant est qu’un pape soit sérieux.
Il affirme à chaque fois qu’il aime mes mélodies, mes arpèges et mes accords, que le son de ma guitare est très doux, que ma voix éraillée est particulière et qu’il faut que tout cela soit absolument parfait. Il enregistre des groupes de renommée nationale, il a fait ses preuves, alors il veut un CD sans une entorse. Pour moi et pour sa réputation. Comme je suis un parano indécrottable, je me suis dit au début qu'il me chantait la messe pour faire durer et gagner du fric. Jai cependant appris par la suite qu’il était effectivement professionnel au point de refuser de continuer d’enregistrer des musiciens qu’il ne trouvait pas bons.
J’en ai un peu bombé le torse. Jusqu’à ce qu’il me foute moi-même dehors, peut-être….
Tout ça est bien. Parce que moi, un peu laxiste, beaucoup même, je laisserais volontiers filer quelques défectuosités … Comme sur scène, comme en live.
Ce qui est gravé est gravé, dit-il. Ben oui. Rien, en revanche, n’est plus éphémère que la scène, c’est là tout le contraire.
Le gros problème, c’est que, m’appliquant trop, je ne puis y mettre le cœur que je veux. Trop concentré sur la réalisation technique et la justesse de la mesure, j’en oublierais presque la force du texte et comment il doit être chanté selon moi. Or, reprenant en cela le mot de Brassens, j’aimerais bien que la musique soit accessoire, tout en étant indispensable, comme elle l’est au cinéma : qu’elle souligne mais ne relègue pas le texte au second plan.
Toute la difficulté est là ; chanter et jouer autant avec sa tête, son savoir, qu’avec ses tripes. La synthèse n’est pas toujours facile.
Alors, je me suis donné beaucoup plus de temps qu'initialement prévu. Sur dix morceaux, seule la musique de sept d'entre eux est sauvegardée, car nous avons décidé d’enregistrer sur deux pistes, d’abord la mélodie, ensuite les paroles. Ce qui oblige à être encore plus rigoureux et à travailler avec le métronome.
On verra bien. Je n’en vois, optimiste quand même, le bout qu’à l’horizon de l’automne prochain. En tout cas, expérience intéressante et qui remet fondamentalement en cause le peu de talent dont on croyait être pourvu.
Comme en écriture. Rien de tel qu’une bonne critique négative pour remettre les pendules à l’heure et la vanité de soi au diapason. C’est le cas de le dire.
Au cas, donc, où vous seriez intéressé pour écouter un jour mes sueurs artistiques, il faudrait me le dire gentiment par mail, que je sache un peu où je vais.
Le prix ? Ah, le prix !? Hé bien, je n’en sais pour l’heure foutrement rien, ne sachant pas encore combien d’heures il va me falloir travailler et de combien d'écus sonnants et trébuchants sera donc la facture.
Mais ça ne devrait pas dépasser, frais de port compris, 17 ou 18 euros. Et puis, si ça les dépassait et que ce serait trop cher, alors je n’en tirerais qu’un ou deux exemplaires, que je mettrais dans un tiroir, histoire de me dire que j’ai fait un jour un disque.
On s’amuse comme on peut, n’est-il pas ?
14:12 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.06.2013
Quelle conscience dans la conscience des hommes ?
 Le regard du paysan était bleu très clair et miroitait avec les ombres de l'après-midi déclinant. Il nous invita à prendre place sur deux planches à l’état brut, qui faisaient corps avec une table tout à fait sommaire.
Le regard du paysan était bleu très clair et miroitait avec les ombres de l'après-midi déclinant. Il nous invita à prendre place sur deux planches à l’état brut, qui faisaient corps avec une table tout à fait sommaire.
Le tout était posé sur un plancher bancal qui se voulait une véranda.
Le paysan parlait.
Ses parents étaient venus d’Ukraine après la guerre, des environs de Lwów. Poussés vers le nord-ouest, mais pas beaucoup, quelque deux cent kilomètres seulement. Il se mit soudain à évoquer les grandes plaines de l’Ukraine et ses yeux bleus vacillaient légèrement quand le bras tendu, pour illustrer le propos, montrait l’est, derrière son dos.
Tandis qu’il racontait, je le regardais beaucoup. Moi l’étranger, j’étais venu voir un autochtone et j’étais assis devant un gars qui ne se sentait pas chez lui, là, sous sa veranda de fortune. Un gars qui parlait de son déracinement à lui, avec une voix monocorde, toute empreinte de tristesse.
Il inversait joliment les rôles et sans doute avait-il raison. Car moi j’étais tout de même ici de mon pauvre chef, tandis que lui, c’étaient les chambardements frontaliers qui l’avaient échoué dans ce village, comme les tempêtes échouent sur les plages, les algues des fonds marins et les objets qu’on jette par-dessus bord des navires. Mais tous ces rejets, ça se ramasse, ça se conditionne, ça s’élimine. Lui, soixante ans après, il était resté tel qu’aux premiers jours, planté sur le même sable.
Il dit qu’avec les communistes, il avait trois vaches, un cheval, un cochon et des poules et, par-dessus tout, une paix royale. Personne ne venait fouiner dans ses affaires. Maintenant, il avait une vingtaine de vaches, une trayeuse électrique et il vendait tout son lait à la laiterie. Le lait devait être comme ci et pas comme ça, il avait fallu faire des évacuations, des aérations, des vaccins, des prévisions et il n’entendait rien à la paperasserie qu’on lui demandait. Et puis au final, il n’avait pas plus de sous qu’avant avec des tonnes d’emmerdements en plus. Alors ? A quoi ça avait servi tout ça ?
Il posait la question en se penchant en avant.
D. balbutiait liberté, droit des gens, démocratie…Il haussait les épaules, hautement moqueur, mais sans aucune brutalité.
J’ai appris beaucoup de cet homme. J’ai découvert en quoi, peut-être, résidait la force pérenne des dictatures. Pour ce paysan, comme pour bien d’autres de par le monde, - un discours similaire m'avait été tenu une dizaine d'années auparavant, sous d'autres cieux, par un autre paysan, très loin d'ici, dans les environs de Salamanque- le communisme tel qu’appliqué à l’est, c’était le droit de faire ce qu’il voulait dans son jardin. Pourvu qu’il ne s’y enrichisse pas de façon trop ostentatoire et ne fasse montre de ses opinions, on ne lui demandait rien. Il avait un gîte, de la pitance et la course du soleil pour éclairer les jours et compter les années. Le reste, la liberté d’écrire, de parler à voix haute, d’écouter, de lire des livres et des journaux, de voyager plus loin que la rivière, c’était affaires d’intellectuels, de penseurs et de gens des villes parce que leurs maisons, leurs rues et leurs usines étaient trop étroites.
Le petit paysan, lui, il s’en fout de ces libertés-là. On ne lui a jamais appris à s’en servir, alors leur privation ne le meurtrit pas. La muselière intellectuelle ne le gêne pas. La vie est ailleurs. Elle se mesure au jour le jour, saison après saison. Elle se joue au printemps avec les labours et les semailles, l’été avec les moissons, l’automne avec le ramassage des pommes de terre et l’hiver avec la lutte obstinée contre le froid, la neige et le vent. Ce qu’il y a par delà ces rideaux quotidiens, il ne faut pas s’en mêler. C’est de la politique et la politique…La politique, ça fait des guerres et des morts.
Je pensais à la Makhnovchtchina. Que des paysans, incultes de notre point de vue, et pourtant vainqueurs de Dénikine. Et s’ils n’eussent été par la suite crapuleusement égorgés par Trotski, qu’auraient-ils fait de l’unique expérience anarchiste au monde qu’ils avaient mise en place en Ukraine ? Jusqu’où les tsars les avaient-ils volés et jusqu’où avaient-ils été violés dans leur droit à l’existence, qu’ils aient pris une part aussi cruciale, intelligente et violente à la grande déferlante de l’histoire ?
Cet homme sec aux mains raboteuses, là devant moi, ce paysan d’origine ukrainienne, s’il était né seulement quelque trente ans plus tôt, aurait-il fait partie de l’épopée et été un compagnon de Makhno ?
J’étais sûr que oui, il me plaisait d’en être sûr, et je le regardais décliner ses phrases et ses mots nostalgiques et je me disais que l’histoire, les luttes, les trahisons, les échecs, les vérités, les morts, les prisonniers, les réussites, les idéaux, les tactiques, les alliances, les buts, les systèmes, tout ça, c’était les hasards du réel, les leurres d’un prisme déformant et que les hommes n’entendaient rien, absolument rien à la mise en scène de leur propre destin. Ils étaient des ombres. Des balbutiements.
J’en éprouvai une profonde tristesse.
Extrait( modifié) de Polska B Dzisiaj
13:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.06.2013
Exception culturelle ?
 Elle a dévoré le Comte de Monte-Cristo avant de se lancer à corps perdu dans les Trois Mousquetaires, pour enchaîner aussitôt avec Vingt ans après.
Elle a dévoré le Comte de Monte-Cristo avant de se lancer à corps perdu dans les Trois Mousquetaires, pour enchaîner aussitôt avec Vingt ans après.
Elle n’en sort pas, penchée sur ses lectures, absorbée.
Ses livres ne la quittent plus d'une semelle.
Elle les a même emmenés à l’école. "Pour lire pendant les pauses", me dit-elle, et ça me rappelle vaguement quelqu'un, au collège, il y a de cela plus de quarante ans...
Un groupe de copines cependant s’approchent, intriguées.
- Qu’est-ce que tu lis ?
- Les Trois Mousquetaires.
- Ah bon ?! Parce qu’ils ont fait un livre sur le film ?
Elle hoche la tête, soupire avec ostentation et disparaît derechef dans le sillage des Trois Mousquetaires qui, finalement, étaient bien quatre.
________________
Complètement hors de ce sujet d'apparence plutôt légère, je vous invite à lire ce texte mis en ligne par Feuilly et qui renvoie à un article qui fait froid dans le dos.
Qu'au moins ne soyons jamais de ceux qui pourraient dire un jour : Nous ne savions pas !
11:42 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.06.2013
L'intelligence des absurdités
 Les grands d’un monde de plus en plus petit se sont donc retrouvés quelque part en Irlande, où ils ont sablé le champagne et dégusté la langoustine.
Les grands d’un monde de plus en plus petit se sont donc retrouvés quelque part en Irlande, où ils ont sablé le champagne et dégusté la langoustine.
Ne nous en offusquons cependant pas outre mesure ! Car un vieux cantique d’inspiration libertaire - qu’ils ignorent sans aucun doute - dit que le ventre plein, l’homme peut discuter.
Et les grands étaient justement là pour discuter le bout de gras.
Quand des grands discutent, c'est bien connu, les petits, si tant est qu’ils aient reçu une éducation convenable, la ferment, même si c’est de la sauce à laquelle on se propose de les bouffer dont il est question.
Donc, discussions, discussions, et vous, là-bas, au fond de la classe, un peu de silence, s’il vous plaît !
A l’heure qu’il est, on ignore encore si, sur la Syrie, les grands ont trouvé consensus entre la poire et le fromage. On sait juste que le grand Français n’en démord pas : il faut armer les jihadistes jusqu’aux dents ! C'est son Delenda Carthago et c’est assez curieux. On se demande pour qui il roule, parfois, ce grand-là ! De qui il est le porte-parole.
Le grand Russe, lui, qui, du haut de son mètre cinquante quatre, voit toute cette tuerie devant sa porte, est d’un avis tout à fait contraire : il faut armer le camp d’en face.
On n’y comprend goutte, nous autres, parce qu’on est des petits.
Mais il n’était pas question que de la Syrie autour du festin des grands. 80 000 morts, qu’est-ce que c’est à côté de nos autres préoccupations ? Par exemple celles qui tournent autour du libre-échange ?
Selon ce que j’ai entendu dire au café du commerce, là, on semble à peu près tous d’accord. Faut lever toutes les interdictions, les protections, les tabous financiers, les taxes douanières d’un autre âge et il faut que la marchandise circule entre nous sans autre forme de peccadilles. Il en va de la santé du petit, tout ça, et c’est primordial… Parce qu’un petit en bonne santé, ça ne braille pas, ça ne réclame pas, ça joue peinard tout seul dans son coin et ça fait pas chier le monde. Circulation plus libre des marchandises, ça veut dire aussi plus d’argent pour les gros, amis des grands, plus d’argent pour les gros, ça veut dire plus de travail à donner aux petits et plus de travail aux petits, ça veut dire, encore une fois, plus le temps pour eux de s’occuper des affaires des grands, ça veut dire des vacances, une maison, un jardin, un nain de jardin, une belle bagnole… Bref toutes les joies du bac à sable quand on peut s’acheter plein de jouets.
Je suis d’accord avec tout ça. Mais je n’en suis pas moins perplexe. Qu’est-ce qu’ils y entendent au libre-échange, ces grands ? Car figurez-vous que pas loin de chez moué, sur la frontière de l’Europe donc, il y a un parc immense de plus de 25 hectares, remplis jusqu’à la gueule d’automobiles flambant neuves. Des bagnoles par milliers et par milliers, des fortunes et des fortunes en marchandises pures ! Mais qu’est-ce qu’elles foutent-là, ces bagnoles, japonaises, allemandes, françaises, américaines ; ces bagnoles de la mondialisation ?
Hé ben, elles attendent tout bonnement d’être désossées, pièces par pièces, méticuleusement, pour passer en Russie où des ouvriers s’appliqueront à les remonter, pièces par pièces et tout aussi méticuleusement.
C’est idiot, n’est-il pas ? Oui, mais il se trouve que les droits de douane sur les pièces détachées sont peu élevés alors que ceux sur une bagnole entière sont faramineux.
Alors, on démonte tout ça, des milliers de voitures vous dis-je, et on exporte ainsi, non pas des automobiles, mais des bouts d’automobiles. Astucieux, n’est-ce pas ? Et tellement intelligent !
Ne me demandez cependant pas pourquoi les exportateurs se font chier à monter les bagnoles en usine au lieu d’expédier directement tout ça en kit, dans des cartons, parce que j’en sais foutrement rien. Peut-être pour amuser la galerie. Ou alors des règlements, des astuces légales, amphigouriques, des raisons qui échappent à la raison des petits, car les voies des seigneurs sont impénétrables !
Hé ben, me suis-je dit quand même en tournant les talons au parc gigantesque où s’entassent toutes ces rutilantes automobiles, s’ils s’y connaissent autant sur les tenants et aboutissants des tueries en Syrie qu'en matière de libre-échange, les grands escogriffes de ce monde, je crains fort que ce ne soit pas demain qu’ils trouvent leur chemin de Damas !
Allez, sur ce, bon week-end au soleil à tous ! Et si d'aventure vous fomentez le projet de changer de voiture bientôt et que vous trouvez ça un peu trop sévère pour votre budget, demandez donc à votre mécano s'il ne vous serait pas loisible d'acheter un carburateur là, une porte ici, un phare ailleurs et un pneu je ne sais où... Peut-être ferez-vous quelques économies, même si ça risque de vous prendre pas mal de temps pour recoller tout ça...
10:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : écriture, littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.06.2013
Le début de la fin
Un compatriote de passage en Pologne me disait il y a quelques jours que certains petits paysans français et des Associations revenaient au travail de la terre avec des chevaux, par souci environnemental et préservation d'une certaine biodiversité, massacrée après plus de cinquante ans d'exploitation mécanico-industrielle.
Plaisante mais drôle d'idée, me suis-je dit ! Et m'étonnerait fort que les idéologues de la croissance, poussés au cul par les lobbies financiers, ne leur tordent le cou avant longtemps !
 Quand j’étais môme - il y a de cela déjà trop longtemps - notre plus proche voisin répondait au glorieux prénom de Louis, mais sans numéro de dynastie, sinon celle des pauvres gens un à un crucifiés sur l’autel de l’agriculture à bénéfices : Louis avait en effet été un des derniers à se résoudre à motoriser sa maigre activité de petit paysan.
Quand j’étais môme - il y a de cela déjà trop longtemps - notre plus proche voisin répondait au glorieux prénom de Louis, mais sans numéro de dynastie, sinon celle des pauvres gens un à un crucifiés sur l’autel de l’agriculture à bénéfices : Louis avait en effet été un des derniers à se résoudre à motoriser sa maigre activité de petit paysan.
Il avait pourtant eu de beaux et de robustes chevaux, dont il avait été très fier. Mais, lassé peut-être d’être en butte aux lazzi du voisinage, il lui avait un jour pris fantaisie d’acheter un tracteur, avec l’argent de ses deux chevaux prestement expédiés à l’abattoir, justement, augmenté d’un bien gentil petit coup de pouce d’un monsieur du Crédit qui, le cheveu gominé et bien peigné, était spontanément venu lui proposer ses services, en serrant sous son bras une sacoche noire, en sautillant sur la pointe de ses pieds vernis de cuir et en riant qu’il faisait bien mauvais temps.
Le tracteur de Louis flamboyait tout rouge. Un tracteur allemand avec un grand nez arrondi et deux phares globuleux au bout de deux longues tiges courbées comme des antennes, qu’on eût dit un grotesque grillon. C’était un Porsche, que Louis s’empressa de baptiser Popo, parce qu’il ne concevait pas qu’on puisse tirer une charrue ou une remorque sans avoir un nom. Il lui parlait d’ailleurs amicalement et pour le conduire se servait presque autant de la voix que des différentes manettes. Il regrettait cependant très amèrement que son nouveau cheval à gasoil fût allemand, lui que les Fridolins avaient fait prisonnier pendant cinq ans et qui avait maintenant des aigreurs d’estomac tellement qu’il avait mal mangé là-bas, une vingtaine d’années auparavant. Des racines, qu’il disait qu’il avait mangées et il avait bu l’eau croupie des ornières. Il se plaignait surtout du massacre de son anatomie à la fin d’une barrique, quand le vin était devenu un peu aigrelet. A cause de ces salauds de Boches, il finirait par être obligé de ne plus en boire, de son vin ! A moins de passer à deux litres par jour, progressivement, au lieu de quatre. C’était quand même malheureux de risquer de s’étouffer comme ça ! Il espérait, devant nous les enfants, qu’il n’y aurait plus jamais de guerre. Que c’était une saloperie, la guerre !
Au moins, cet estomac rebelle lui inspirait-il de généreuses pensées humanistes.
Je me souviens aujourd’hui d’un dimanche après-midi où le village somnolait lourdement sous le soleil au zénith. A moins qu’il n’y soit contraint par une urgence, une vache qui met bas, un orage qui menace d’éclater sur les foins encore entassés dans la prairie, le paysan se plaît à imiter Dieu et à se reposer le septième jour.
Louis, ce dimanche-là, ne l’avait cependant pas entendu de cette oreille. Dans le silence surchauffé, on l’entendit soudain démarrer l’engin, le faire hurler et péter, puis on le vit qui prenait la clef des champs, ne tractant pourtant aucun outil.
Interpellé par sa femme qui levait les bras au ciel, Louis justifia en criant au travers des pétarades et des soubresauts de la machine encore mal maîtrisée, qu’il fallait bien qu’il promène Popo, comme s’il se fût agi d’un animal domestique qui devait prendre l’air par ce bel après-midi d'été.
Louis et Popo devinrent ainsi la risée de toute la communauté villageoise.
Surtout que leurs marches-arrière étaient déjà légendaires. A la fenaison, quand le père Louis était vu avec une remorque de foin pleine à craquer, on venait de tout le village pour assister à la manœuvre de Popo se hasardant à reculer le chargement sous la grange. Car Louis n’avait jamais pu intégrer cette physique mystérieuse de la flèche de sa remorque selon laquelle il fallait braquer les roues à droite si l’on voulait reculer à gauche et inversement. Il fulminait, il enrageait, il tempêtait que ces conneries le faisaient vraiment trop chier et le tracteur se retrouvait immanquablement à l’équerre. Il avançait à nouveau, lâchait l’embrayage trop tôt, le grillon allemand se cabrait alors et... calait. Opiniâtre, Louis reculait encore, le public hurlait des stops qu’il n’entendait pas et les fourragères heurtaient alors violemment les énormes portes de la grange, et ainsi de suite, tandis que s’envolaient les bordels, les noms de dieu de merde et les putains de saloperie de remorque !
Louis consacrait plus de temps à reculer son foin qu’il n’en passait hier pour étrier son cheval, le faire boire, l’harnacher et l’atteler. De plus, quand la remorque avait été enfin vidée, si c’était l’après midi, il n’avait plus l’entrain nécessaire pour refaire un autre voyage qui aurait supposé un autre supplice à reculons. Deux marches arrière par jour l’auraient assurément tué. Alors il remettait au lendemain et s’allait faire une petite sieste pour se remettre de ses émotions, ponctuant sa sage décision d’une plaisanterie plus grosse encore que ses sabots, Louis dort.
Le gain de temps au bout du compte était négatif. Sans doute comme les chiffres que lui envoya un triste matin le gars à la sacoche noire et aux souliers vernis.
Louis prit alors son plus bel habit et le bus. Il revint de la ville, la tête baissée comme jamais et on vit bientôt un autre tracteur plus gros et plus fort que l’Allemand labourer, herser et ensemencer ses champs.
Louis n’était plus aux commandes. Louis allait maintenant à la pêche, sa blessure de guerre se faisait de plus en plus cruelle, mais il n’en parlait quasiment plus. D’ailleurs, il ne parlait plus de rien. Il semblait seulement attendre quelque chose de terrible, l’air accablé et les yeux rivés sur son bouchon inutile, qui dansait sur le fil de l’eau.
Bien d’autres après lui sont revenus de chez les messieurs aux souliers vernis tête courbée et contemplant sans les voir le bout de leurs godasses, même s’ils savaient reculer une remorque de foin et même si les Boches ne leur avaient pas supplicié l’estomac. Les plus jeunes d’entre eux ont ramassé femmes, enfants, armes et bagages et sont allés goûter aux délices des samedis libres et des horaires fixes sous les tôles surchauffées d’une usine.
Les autres, trop avancés déjà dans les saisons de la vie pour bifurquer sur une autre piste, se sont assis au bord de la rivière ou alors se sont allongés sous les tilleuls et les noyers.
Et ils ont attendu là, fatigués d'exclusion et marmonnant des mots soudain d’autrefois, le grand départ.
13:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.06.2013
Le Docteur Zola
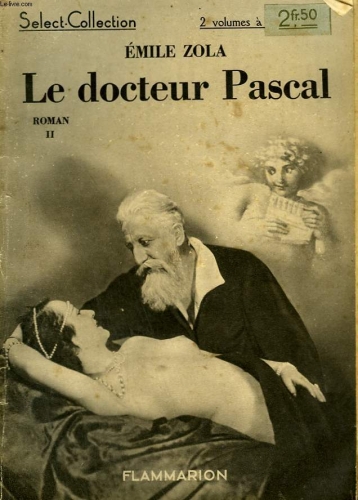 En situation d’attente, par désœuvrement, donc, beaucoup plus que par envie réelle, je lisais ce matin un texte sur la façon dont Emile Zola avait préparé son dernier roman de la série des Rougon-Macquart, le Docteur Pascal.
En situation d’attente, par désœuvrement, donc, beaucoup plus que par envie réelle, je lisais ce matin un texte sur la façon dont Emile Zola avait préparé son dernier roman de la série des Rougon-Macquart, le Docteur Pascal.
Comment faire un roman, qui par nature et tradition est une fiction, avec à l’esprit la prétention, sinon d’une démonstration, du moins d’une illustration scientifique ?
Zola consulte des amis professeurs de médecine, tous spécialistes de l’hérédité et de ses lois, relit des notes, découpe dans de vieux journaux des articles sur le sujet, compare, compile, peaufine l’arbre généalogique qui, depuis le début, lui sert de canevas, et en oublie bientôt qu’il lui faudrait quand même un semblant d’intrigue.
Il ébauche la rédaction, s’aperçoit qu’il a trop de personnages, délaye et en supprime, notamment une dénommée Marie, qui ne verra donc jamais le jour littéraire se lever sur son existence putative, supplantée par une certaine Clotilde, nièce et bientôt amante du Docteur Pascal.
Le romancier ne perd cependant pas de vue qu’il fait œuvre scientifique et la dernière note à son feuilleton fleuve doit aussi en être le point d’orgue.
L’écrivain hésite donc entre l’inspiration littéraire et la connaissance didactique qu’il prétend avoir de son sujet.
Tout cela se passe à Médan et tout cela se passe assez bien quand, tout à coup, patatras ! madame Zola découvre la liaison clandestine que monsieur Zola entretient avec Jeanne Rozerot. Un orage furieux secoue alors le couple, on s’en doute un peu si tant est qu’on ait vécu en couple et qu‘on ait voulu, furtivement, vivre un jour une liaison volée au quotidien et à l’ennui des jours. Le bon petit père Zola, on peut s’en douter aussi si l’on a bien lu son œuvre et sa biographie, choisit la fuite en avant, et, pour bien montrer qu’elle reste prioritaire, embarque sa légitime dans un long périple en Normandie, puis à Lourdes (espérait-il un miracle ?), puis à Aix-en-Provence, Marseille, Cannes, Nice, Gênes, Monte-Carlo, délaissant ainsi, ostensiblement, la maîtresse.
Voyager, c’est un peu guérir, sinon son âme, du moins les apparences de cette âme, n’est-ce pas ?
Mais le Docteur Pascal dans tout ça ? Hé bien le Docteur Pascal, lui, prisonnier dans la tête de l’amant pris la main dans le sac, tombe pendant ce temps-là amoureux de sa nièce, un amour impossible, à la limite de l’inceste, un amour de tragédie grecque.
Le romancier peut dès lors se remettre au travail, sublimer sa frustration d’avoir sacrifié son amour fautif au profit de la bienséance sociale, et découvrir le plan général de son livre.
Je dirais donc que sans l’aventure amoureuse de Zola et de Jeanne - la mésaventure plutôt - le Docteur Pascal aurait certainement suivi un destin tout à fait différent.
J’ai l’air de moquer, mais l’air seulement.
Car peu d’écrits au monde, même les plus peaufinés littérairement, peuvent en effet se targuer d’être pétris dans la pure fiction, nés, un peu comme les microbes de la génération spontanée de Claude Bernard à qui Zola emprunta la méthode et le mot "expérimental" en l'appliquant au roman, de l’imaginaire absolu.
A dire vrai, je ne me souviens plus très bien du Docteur Pascal, lu il y a quelque quarante ans. Mais, ce matin, en situation d’attente, par désœuvrement, donc, plus que par envie réelle, j’ai eu l’impression d’assister à sa véritable naissance et j'ai souri.
L’hérédité et ses lois, dans tout ça, me semblent bien n’avoir que l’importance d’un décor, voire celle d’un prétexte.
Et qu’est-ce qu’on peut ingurgiter comme fadaises, quand même, sur les bancs d’un lycée !
12:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET



















