26.05.2016
Crépuscules
 Elle est revenue, la saison sans la nuit.
Elle est revenue, la saison sans la nuit.
Du moins pour mes yeux qui s’endorment avant l’extinction des feux du ciel et s’ouvrent alors qu’ils sont déjà rétablis.
Une vie dans le jour exclusif.
Juché sur la ramure la plus haute des halliers, le merle siffle à gorge déployée, aussi zélé aux crépuscules des soirs qu’aux primes aurores. Comme s’il ne cessait jamais de célébrer ses amours, tandis que je sacrifie à Morphée.
On dira ce qu’on ne voudra pas, mais il a quelque chose de sincèrement merveilleux, ce monde avec sa logique de troubadour tournoyant. Il n’est laid que parce que nous ne le pensons le plus souvent qu’en bête sociale, qu’en animal d’un cheptel moutonnier trottinant sur une ligne de crête et s’écrasant de plus en plus souvent au fond des ravins, poussé par l'intelligence de sa bêtise et son amour du vide.
D’ailleurs, je me demande souvent ce que nous faisons là, nous les sept milliards de crétins dont la présence ne semble se justifier que par la destruction passionnée de tout ce qui constitue la beauté des choses.
L’humanité est une contradiction, on dirait. Une erreur de la création. Une fausse note qui saccage la symphonie.
Nous serions, parmi toutes les créatures du monde, les seuls à souffrir parce que nous serions les seuls à savoir que nous allons mourir. L’animal et la plante n’auraient pas cette conscience de la fatalité de leur destin. C’est peut-être pour cela que nous sommes des tueurs ataviques: nous enseignons la mort et nous la donnons à tous ceux qui l’ignorent. Par vengeance et jalousie.
Comble de l’ignominie et de la perversité dénaturée, entre nous, nous dissertons - quand nous n'espérons pas - sur l'éventualité de l’éternité.
Mon merle noir, lui, ne croit ni à la mort, ni à l’éternité. Il croit au présent et le présent - lapalissade terrible dont les hommes n’ont jamais su saisir le bon sens - ça se vit au présent.
Alors, il chante du soir au matin, mon merle.
Tandis que crèvent les hommes, qui jamais ne verront Le Temps des cerises.
10:04 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.05.2016
Reprise des reprises
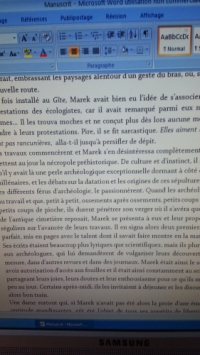 Quelque déboire, que j’espère évidemment passager, m’a conduit ces dernières semaines à cesser mon travail sur le roman que j'ai en chantier depuis plusieurs mois.
Quelque déboire, que j’espère évidemment passager, m’a conduit ces dernières semaines à cesser mon travail sur le roman que j'ai en chantier depuis plusieurs mois.
L’esprit, l’envie de poésie écrite - car la prose est avant tout une poésie - a besoin d’exclusivité.
Je l’ai souvent dit : on n’écrit pas la douleur dans la douleur, la tourmente dans la tourmente, la joie dans la joie, mais dans un second temps, dans le sillage des émotions, quand tout ça est entré dans la représentation de l’esprit.
L’écriture telle que je la pratique, est une comète, une illusion, une figuration du réel et elle ne fait briller les étoiles que lorsqu’elles se sont éteintes. Sans quoi on écrit son journal et l’expérience – notamment surréaliste – de l’écriture spontanée a montré toutes ses limites.
Donc, quelque peu rasséréné quant à l’issue de cette infortune – ou du moins l'ayant intégrée comme élément incontournable sur le cours de la vie – j’ai rouvert le manuscrit, laissé à son neuvième chapitre.
J’ai tout relu, corrigeant, biffant, rajoutant, trop de musique ici, pas assez là, phrase ou images convenues ailleurs… Content de l’ensemble et fort mécontent du détail.
Je vous en livre un passage, là où je m’étais arrêté.
Peut-être pour faire une sorte de trait d’union. Je n’en sais rien et peu importe à vrai dire:
*
« Piotr Ludwiczuk s’interrompit et regarda son visiteur droit dans les yeux.
- Monsieur Assaniuk, vous pensez que votre père faisait partie de ce commando ?
- Je ne sais pas… Mon père ne m’a jamais dit un seul mot de son combat en Pologne. Il est toujours resté muet sur le sujet. C’est d’ailleurs son silence qui m’a, pour une bonne part, poussé à faire ce voyage, à contre-courant de la mémoire. M’eût-il tout raconté, que, peut-être, je n’en aurais pas éprouvé le besoin ; j’aurais pu imaginer d’après ses témoignages.
Mais si vous aviez connu mon père, vous seriez certainement aussi interloqué que moi. Je le revois en effet nettement, là-bas, chez nous, sur la plaine charentaise, en travailleur débonnaire, avec une fourche, un râteau, un outil quelconque entre les mains ; je le revois au cul des chevaux tenant fermement les mancherons de la charrue, mais il m’est impossible de l’imaginer une seconde avec une mitraillette, une grenade, un couteau ou une arme quelconque entre les mains. Non, ça, c’est absolument impossible. Et puis…
Marek s’arrêta tout net et fixa le plancher, les yeux exorbités, l’air parfaitement ahuri. Une image venait brusquement d’enflammer son cerveau et de couper l'évocation. Une image fugace, oubliée. Non. Pas oubliée, car ce n’était même pas un souvenir. C’était un reflet onirique, extérieur, et c’était il y avait bien longtemps… Cinquante ans au moins. Le môme tenait la main de son papa et tous les deux marchaient allègrement sur les blés en herbe, tout verts, ondulant sous un impalpable souffle du vent de mer. Ils marchaient, heureux, comme quand on marche sur des nuages. Tout à coup, des oiseaux sauvages avaient déboulé de dessous leurs pieds, des perdrix sans doute, des faisans peut-être, en tout cas dans un claquement rapide et violent d’ailes effarouchées. L’enfant avait sursauté et jeté un grand cri. Le père avait aussitôt lâché sa main et mis un genou à terre. Un poing plaqué contre sa hanche, l’autre bras légèrement replié et mis en avant, comme tenant quelque chose, il avait hurlé, en polonais, « Salauds ! » et puis « tatatatatatatatata »…
Un fusil mitrailleur. L’incoercible réflexe d’un guerrier. Pas celui d’un chasseur.
Comme s’il avait oublié son interlocuteur, Marek s’entendit dire :
- Et puis, il y a eu les hommes préhistoriques, aussi. "
12:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.05.2016
Les oiseaux - 3-
 La machine est ronde sur laquelle nous allons notre chemin. Le jour, la nuit, les saisons sont les tableaux successifs de cette rondeur où s’inventent nos vies en même temps que les repères tangibles de notre voyage en boucle dans le cosmos.
La machine est ronde sur laquelle nous allons notre chemin. Le jour, la nuit, les saisons sont les tableaux successifs de cette rondeur où s’inventent nos vies en même temps que les repères tangibles de notre voyage en boucle dans le cosmos.
Mais nous n’attachons plus aucune importance à ces évidences, comme si tout cela allait de soi et ne nous concernait que de lointaine façon. Enfantillages que d’être encore sensible au grand mouvement des choses !
Mépris de l’homme pour le théâtre où se joue son destin aujourd’hui réduit à celui d’un besogneux, d’un être économique, d’un pion manipulé sur l’échiquier fictif d’une croissance qui ne l’est pas moins, d’un pauvre hère à grande misère intellectuelle le plus souvent ornée de palabres amphigouriques. Perte de l’essentiel au profit de l’apparence et du futile.
Perte du sens premier de l’existence.
Tant que je serai en vie, je serai un amoureux primitif, primaire, de l’évidence vitale, soit de ces enchaînements de la nuit et du jour, de ces aurores et de ces crépuscules, de ces paysages façonnés par un climat, de ces saisons plus ou moins marquées selon les latitudes.
En découvrant les paysages de Pologne, j’ai mesuré leurs ressemblances avec ceux de l’ouest et le plus souvent vécu leurs différences. Si j’ai reconnu dans les feuillages et les forêts des chants que je connaissais des rives océanes, vu des horizons ouverts comme ceux du littoral, j’ai aussi rencontré des habitants de la plaine enneigée et des forêts, spécifiques à l’Europe centrale.
J’aime les oiseaux. Les p’tits oiseux, comme on dit pour moquer les rêveries naïves et comme si une rêverie pouvait être naïve au regard du rêveur ! Encore une vanité à mettre sur le compte du pédantisme d’homo economicus !
Savoir lire les mœurs des oiseaux, leur chant, leurs longs périples qui ne nous sont visibles que par leurs départs et leurs retours, c’est savoir lire la planète en son voyage cosmique et c’est savoir ainsi lire notre habitat. C’est, pour moi tout du moins, beaucoup plus que de parler des p’tits oiseaux car c’est pour une bonne part parler de la beauté des choses, parmi lesquelles sont ces petits compagnons de route...
Le ciel est la terre des oiseaux. Toute bête appartient à la féerie, à la poésie élémentaire, celle qui, à la racine commune de notre être, brasse en son chaudron d’éternité les éléments qui composent notre microcosme.
Raoul Vaneigem dans "Le Chevalier, la Dame, le Diable et la mort."
Qu'on se souvienne aussi, si tant est qu'on l'ait un jour lu, du chant du rossignol écrit par Chateaubriand, et l'on comprendra, peut-être, en quoi les oiseaux que l'on sait voir et entendre sont littérature.
17:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.04.2016
La forêt qui cache les arbres

Nous nous sommes fourvoyés dans la critique globale des sociétés, les réclamant plus justes, moins amères, plus ceci, plus cela.
La belle affaire ! Car une société n’est rien, sinon un concept. Le tout réside dans ses atomes : les individus.
Tel un livre. Ce n’est pas le livre en soi qui est mauvais ou bon, mais le sens et la couleur des mots qui l’écrivent, auxquels il doit son existence même de livre. Sans les mots et leur intention, un livre n’existe pas.
Nous avons donc passé notre vie à critiquer un livre sans en comprendre les mots. Ou, mieux encore, nous avons poursuivi de nos diatribes des moulins à vent en ignorant l'existence des souffles qui font tourner leurs ailes.
Les individus ne sont ni meilleurs ni plus mauvais, selon qu’ils vivent dans tel type de société plutôt que dans tel autre.
Les individus sont une entité. C’est leur qualité ou leur perversité qui font une société telle qu’elle est et non le contraire comme veulent nous le faire croire tous les matérialistes de la sociologie, tous les avocats du crime, tous les socialistes en propagande et tous les imbéciles qui ont intérêt à l'inversion du réel.
Ainsi, dans « nos » démocraties, il en est, de ces individus, qui se conduisent de manière aussi abjecte que s’ils évoluaient au sein d’un régime totalitaire. Ces individus dénoncent, magouillent, agressent, mentent, volent, détournent le droit, ne voient le monde qu’à l’aune de leur misérable nombril et les gens qu’ils écrasent sur leur passage sont donc bien alors les victimes d’individus et non les victimes d’un modèle de société.
Et je ne parle pas là, forcément, des gens au pinacle, mais des gens de peu. Les deux catégories sont liées, certes, mais la première n’est que l’image, la projection spectaculaire, de la seconde. Les gens au pinacle sont les fruits d’un arbre dont les racines sont corrompues. Coupez les racines et il n'y aura plus de fruits !
Quand on entend ces cloportes de bas-étage prêcher pour la démocratie, les droits de l’homme, les droits au travail, le droit des femmes et tout et tout, et qu’on sait leurs agissements souterrains, on se dit avec raison que sous une dictature, ils resteraient ce qu’ils sont : des individus pourris, des délateurs n’ayant pour objectif, pour ligne de vie, que la satisfaction névrotique de leur individualité.
Pour ce faire, ils montent simplement le cheval disponible du moment.
Ce sont ces individus, partout où ils croisent notre chemin, qu’il faudrait mettre au jour et éliminer des circuits.
Ce serait ça, changer l'esprit d'une société. Et rien d'autre.
08:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture, société | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.04.2016
Se faire un ami...
 Se faire un ami.
Se faire un ami.
L’ami est celui qui vous aime et que vous aimez. Pour de multiples raisons, ou pour une seule, et pour un temps seulement.
J’eusse pourtant aimé avoir des amis éternels, l’éternité palpable commençant au premier vagissement et courant jusqu’à la première pelletée de terre jetée sur un cercueil. Après, tout est domaine du Grand Peut-être.
L’ami est celui qu’on rencontre par un hasard qui n’en est jamais vraiment un. L'amitié a d'ailleurs cette indéniable supériorité sur l’amour qu’elle comble un vide plus clair, mieux défini.
Bien évidemment, l'ami pourra être décevant ; il pourra être rétrogradé au statut de copain, de camarade, voire à celui d’ennemi, hélas ! mais le temps qu’il passera chez vous, il aura son identité bien définie, son fauteuil à lui, son propre couvert. Vous saurez exactement pourquoi il est là.
L’amour, c’est beaucoup plus délicat. Ça veut combler tous les vides, remplir toutes les missions - physiques, intellectuelles, morales - et ça veut être unique. Comme une névrose. Ça ressemble un peu à Dieu, tout ça. Et ça fait peur. Selon ce qu’en disait Nietzsche, c’est surtout de la sensualité qui passe au spirituel, et je me garderais bien de citer ici la petite phrase de Céline que tout le monde connaît - on connaît même, parfois, que ça du Voyage et on s’en sert de passeport pour faire croire qu’on l’a tout lu et bien retenu - mais j’y fais allusion quand même parce que c’est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça... Car c’est tellement puissant, l’amour, c’est tellement grand, tranchons le mot sublime, qu’on est effectivement en droit de se demander pourquoi les hommes s’en mêlent et ce qu’ils peuvent bien y comprendre.
Se faire un ami, donc.
Je sais bien que la langue française fait feu de tout bois avec ce verbe-là : faire l’âne, faire beau, faire le beau, faire froid, faire chaud, faire soleil, faire la pluie et le beau temps, faire du vélo, faire l’amour, faire croire, faire la soupe, faire une connaissance, faire une rencontre, faire semblant, faire peur, faire bouillir, faire la peau à..., se faire chier, faire pleurer, sourire, rire, faire mal, faire du thé, faire la gueule, faire la guerre, faire sa plume, faire une maison, faire pipi, voire caca, faire l’important, faire grosse impression, faire son devoir... Faire, faire et refaire !
Que ne fait-on pas avec ce faire ? Et sans ce faire, on ne ferait plus rien. Ou pas grand-chose. Sans faire, on repasserait ! On irait se faire voir chez Plumeau ! Oyez comme il est verbe d’action dans tous ses états, ce verbe-là !
Alors, se faire un ami, pourquoi pas ? Notons bien le pronominal. Déjà présent dans se faire chier, se faire mal ou se faire rouler dans la farine. Parfois de safran, d'ailleurs. Un pronominal, dont on dirait bien qu’il subit souvent l'action. Se faire tout petit, par exemple: raser les murs, admettre son erreur, en avoir honte peut-être. Se faire ce faisant.
Mais est-ce qu’on dirait «je me suis fait un amour», par exemple ? Imaginez un corniaud qui dirait, pour dire qu’il a rencontré la femme de sa vie, qu’il s’est fait un amour ! Ridicule… On froncerait du sourcil, on toussoterait, on détournerait le regard… S’il disait carrément «je me suis fait une femme», ah, là, d’accord, tout le monde comprendrait ! Et bien, même.
Donc, se faire un ami, quand on est hétérosexuel, c’est un peu bancal comme formule. Un peu con pour l’autre aussi, si tant est qu’il soit du même tonneau hétéro.
Laissons donc ce se faire se faire tout seul… Après, on verra bien… De toutes façons, ça n’est pas très raisonnable que de croire qu’on va se faire une amitié dur comme fer.
C’est se faire des illusions. Encore un abus de ce satané faire ! Car les illusions, ce sont elles qui nous font.
Dans tous les sens adoptés par le verbe et voyez comme ils sont légion !
Image : Philip Seelen
10:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.04.2016
Kopnąć w kalendarz
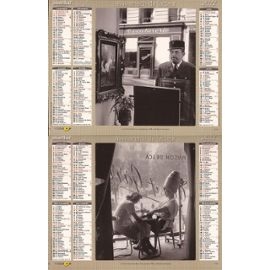 Casser sa pipe, aiguiser sa faux, - son daille, dit-on en patois saintongeais - pour dire «accomplir le dernier acte de sa destinée». Les expressions foisonnent car la mort est bien le seul absolu sur lequel aucune victoire n’est envisageable, sinon celle de l’illusion désinvolte des mots.
Casser sa pipe, aiguiser sa faux, - son daille, dit-on en patois saintongeais - pour dire «accomplir le dernier acte de sa destinée». Les expressions foisonnent car la mort est bien le seul absolu sur lequel aucune victoire n’est envisageable, sinon celle de l’illusion désinvolte des mots.
Le seul contraire non relatif qui, de par son implacable évidence, sous-tend toute la beauté de la vie et la chance qu’on a de la vivre.
La vie est belle parce qu’elle possède justement un contraire absolu. Si les choses allaient humainement en ce monde, la vie rendrait œil pour œil, dent pour dent, et s’évertuerait à être, elle aussi, un contraire absolu. Elle n’est, hélas, bien trop souvent de la mort qu'une antinomie relative.
Le nombre de vivants qui sont déjà morts parce qu’ils ont renoncé à vivre, est effrayant !
L’heure blême, dit aussi Brassens, dans une allégorie qui m’a toujours fait froid à la racine des cheveux.
Toutes les langues du monde ont leurs métaphores de la mort. Parce qu’elles sont toutes consciences parlées et que toutes ont dès lors besoin de figurer l’impensable.
Dans la langue polonaise, j’ai découvert, wyciągnąć kopyta, «retirer ses sabots», comme pour aller dormir, sans doute, et zejść w tego świata, «descendre de ce monde». Très belle pour moi qui me plais à considérer la vie tel un voyage, telle une excursion, une promenade à bord du vaisseau spatial "Terre." Forcément, à un moment donné, tintinnabule la clochette du terminus.
Mais celle qui me parle le plus, c’est Kopnąć w kalendarz, «donner un coup de pied dans le calendrier». Parce qu’en mon exil, le calendrier est une feuille de route, une indispensable représentation graphique du temps. J’ai besoin de lire ce temps qui s’écoule et nous tue, dans ma langue ; j’ai besoin de dire le nom des jours et des mois dans ma langue, et de les voir inscrits au mur.
Ainsi, dans ma cuisine, trône toujours l’almanach des PTT, que je me fais envoyer en décembre par tel ou tel ami. L'almanach me ramène là-bas, très loin, jusqu’à l’enfance. Il n’est pas un matin où je ne lui jette un coup d’œil, pour tout voir, la semaine, le jour, la saison, le prénom fêté et le quartier dans lequel navigue la lune.
C’est mon repère. Nulle nostalgie et nulle tristesse. Un besoin profond d’être à l’unisson avec la fuite du temps, unisson qu’on ne peut réaliser que dans sa seule langue. Celle qui vous est constitutive.
Alors, oui, donner un coup de pied au calendrier, envoyer valser les repères du temps, faire du temps un néant absolu où il n’y a plus de temps que l’éternité, c’est bien ça.
Kopnąć w kalendarz.
14:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.03.2016
Un bon plan ?
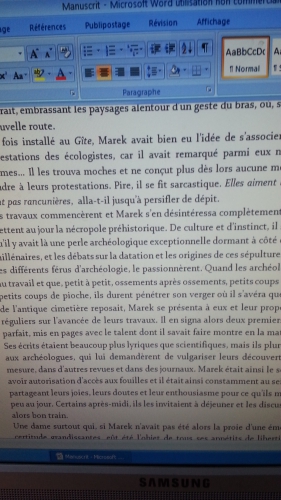 L’écrivain sérieux, ou qui se prend au sérieux - ce qui n’est pas la même chose – conçoit-il un plan lorsqu’il se met en devoir d’écrire une fiction ?
L’écrivain sérieux, ou qui se prend au sérieux - ce qui n’est pas la même chose – conçoit-il un plan lorsqu’il se met en devoir d’écrire une fiction ?
Un passage de La Carte et le territoire, de Michel Houellebecq, m’avait assez interloqué qui disait l’écrivain au travail avec des croquis pointés au mur, des noms, des flèches et des épisodes, si je me souviens bien…
Or, on peut tout dire de Houellebecq, sauf qu’il est un mauvais écrivain.
Cette méthode de travail, je ne l’ai pas. Je ne l’ai jamais eue.
Depuis plusieurs mois maintenant que je suis plongé dans mon travail d’écriture, je ne me suis constitué qu’un dossier annexe : de la documentation sur la culture Campaniforme, sur une région de l’Ukraine aussi et sur divers détails comme par exemple les outils qu’utilisent les archéologues. J’ai ouvert aussi un calendrier des dates de naissance et de décès de mes personnages, car le roman couvre une période courant de 1939 à 2015 et des incohérences peuvent dès lors se glisser, à un moment ou à un autre, relativement à l’action, aux états d’âme, à l’âge desdits personnages.
Balzac a commis deux ou trois erreurs du genre, je ne sais plus dans quels ouvrages, alors Redonnet….
Donc, des repères, de la documentation, mais pas de plan.
Au premier mot jeté sur la page, je sais pourtant où je veux aller ; je sais où j’ai envie d’aller. Mais je ne sais pas encore par quels chemins j’aimerais y parvenir.
Il y a alors une empathie avec mes personnages et c’est eux qui me guident, c’est eux qui deviennent une réalité cohérente, capable de prendre cette voie d’écriture plutôt que celle-là.
Je crois que c’est ça, ma méthode de travail : faire confiance aux personnages imaginaires, mais jamais tout à fait, que j’ai créés, leur tendre la main pour qu’ils m’emmènent où je voudrais aller.
Après intervient le travail de la langue. La poterie est modelée, il faut lisser, creuser, arrondir, donner du relief ici, en supprimer là, pour que le roman devienne un chant.
Alors, l’écrivain sérieux, ou qui se prend au sérieux - ce qui n’est pas la même chose – conçoit-il un plan lorsqu’il se met en devoir d’écrire une fiction ?
Je ne sais pas.
Ce que je sais c’est que mon roman s’écrit à multiples mains et que le plan est impossible car je ne connais pas la nature exacte de tous les artistes qui vont m’accompagner dans mon travail.
Je retourne de ce pas à mon sixième chapitre...
Bon week-end à tous !
10:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.03.2016
Amusant, avec le recul...
 A propos de Brassens, l'opinion de Jean Cau, ancien secrétaire particulier d'un certain Jean-Paul Sartre d'abord, puis, se ravisant à peine, ami intime d'un certain Alain Delon, et la réponse, toute en finesse, de Brassens.
A propos de Brassens, l'opinion de Jean Cau, ancien secrétaire particulier d'un certain Jean-Paul Sartre d'abord, puis, se ravisant à peine, ami intime d'un certain Alain Delon, et la réponse, toute en finesse, de Brassens.
« Brassens, c’est zéro. Je suis complètement allergique. Je mets mon heaume, je baisse ma visière, et je suis impénétrable. Sa voix est très monotone… Et ce côté vieille chanson française, m’est insupportable.
Dès qu’un chanteur me semble penser ses chansons, je me hérisse, je me roule en boule et je me ferme comme une huître. On ne demande pas de penser à un rossignol. On lui demande de chanter et plus son chant est pur et moins il faut qu’il soit embarrassé d’intellectualisme, d’arrière-plan, de philosophie, de leçons de vivre, ça gâte une chanson. »
Le Figaro, Décembre 1968
Jean Cau a déclaré, paraît-il que j’étais un zéro, ce qui est quand même très exagéré. Mais, enfin, c’est son opinion et chacun pense ce qu’il veut.
Après tout, Jean Cau c’est n’importe qui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même le Christ était très discuté. (Sourire)
Mais je ne lui en veux pas… D’ailleurs, j’en ai rien à foutre de Jean Cau. Je n’ai jamais lu un de ses livres. En me plaçant d’un point de vue professionnel, il m’a fait beaucoup de publicité. Peut-être qu’il s’est dit : on ne parle pas assez de Brassens.
La seule réserve que je puisse faire c’est que, si je demande à un gentleman son opinion sur quelqu’un, il ne s’exprimera pas de cette façon-là. Cela a peut-être agacé Jean Cau, qui est un littérateur, qu’un vulgaire petit troubadour soit placé sur un socle… Il n’y a qu’à lui filer un prix de l’Académie française et il sera neutralisé.
France Soir, 17 janvier 1969
11:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.02.2016
Nouvelles d'absence
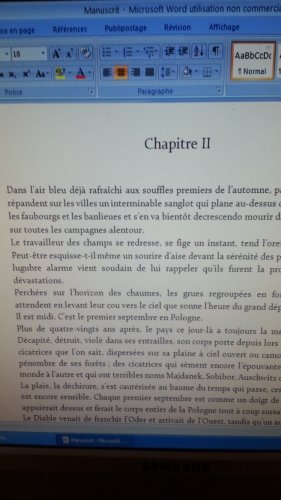 Très investi depuis quelques semaines dans l’écriture d’un roman, je n’ai ni le temps ni l’envie d’écrire sur L’Exil des mots.
Très investi depuis quelques semaines dans l’écriture d’un roman, je n’ai ni le temps ni l’envie d’écrire sur L’Exil des mots.
Quand on écrit le genre de livre que je me propose d’écrire, on ne peut qu’y plonger complètement. On y est tout le temps, même quand on n’y est pas.
J’y voudrais la langue quasiment non-perfectible et j’avance donc avec précautions et lenteur. J’ai ainsi fait une chose que je n’avais jamais faite : réécrire plus de dix fois le premier paragraphe de mon deuxième chapitre et beaucoup de choses me disent malgré tout qu’il n’a pas trouvé son chant définitif.
Comme j’ai besoin de courage, j’appelle frénésie de perfectionnisme ce qui n’est peut-être, au fond, que tarissement de l’art.
Et puis, ce roman abordant plusieurs époques historiques, voire préhistoriques, j’ai besoin de me beaucoup documenter et de prendre des notes.
Pendant ce temps, le temps s’enfuit, hivernal aux vitres de ma fenêtre.
Quand je me repose d’écrire, de tourner la phrase, de chercher le mot qui me semble le moins faux dans son rôle de représentation du réel, je m’en retourne sur les pas de Michelet avec sa longue Histoire de France.
J’ai traversé tout le Moyen-âge en sa compagnie. Plus de 2000 pages d’une écriture exquise, qui fourmillent de détails et d’envolées lyriques.
La Renaissance frappe maintenant aux portes de ma lecture.
Il n’y a bien que là qu’elle frappe, d’ailleurs.
Autour de nous, le monde - tel que le définissait brièvement Roland sur Solko il y a quelques jours - sombre inexorablement dans un obscurantisme éclairé, dont ne sont pas peu fiers les nains faits géants qui font mine de présider à sa destinée.
09:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.02.2016
Lecon d'ortografe - 2 -
Dans un texte officiel, L’Académie française s’explique sur la prétendue réforme de l’orthographe, consacrant avec juste raison la souveraineté inaliénable de l’usage et du temps et condamnant sans ambages tout autoritarisme « à la petite semaine. »
Par ailleurs, Madame Hélène Carrère d'Encausse, (merci au camarade Feuilly), secrétaire perpétuel, dément toute implication dans les récents développements de ces élucubrations de 1990.
Alors, qu’est-ce qui a bien pu péter dans le citron des éditeurs de manuels scolaires, hein, pour la rentrée 2016 ?
Depuis quelles écuries d’Augias braient les ânes qui se proposent de nettoyer ainsi notre langue de tout « son fumier historique et culturel » ?
Je me le demande bien …
11:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : écriture, littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.02.2016
Lecon d'ortografe
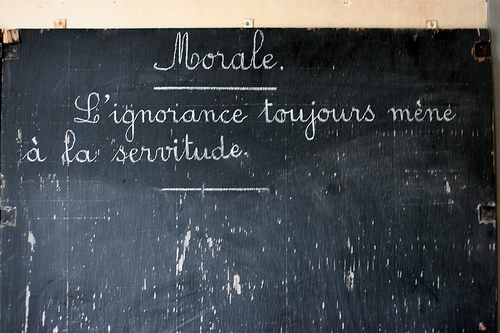 L’écrivain use, avec délectation, de la langue établie par des siècles de pratique sociale et d’histoire. Il trempe sa plume dans du jus concentré d'Histoire, stricto sensu.
L’écrivain use, avec délectation, de la langue établie par des siècles de pratique sociale et d’histoire. Il trempe sa plume dans du jus concentré d'Histoire, stricto sensu.
Mais il n’est pas pour autant un linguiste. Il sait le bon usage sans nécessairement en connaître tous les tenants et aboutissants.
Il sait aussi que sa langue vit, qu’elle évolue, se transforme, parce qu’elle est censée être la messagère d’une conscience d’époque, toujours caduque. Il lui suffit pour s'en convaincre d’ouvrir une page de Rabelais, Montesquieu ou Rousseau.
Ce qui lui répugne, par contre, c’est que sa langue soit décrétée… En tant qu’artiste et historien, il trouve nénuphar plus beau, plus éloquent que nénufar, et ce n’est pas une péronnelle, petit soldat de plomb d’un pouvoir délétère, qui va lui dicter comment il doit inscrire ses mots dans une évolution, comment il doit orthographier son art. Oui, je sais, le Ministère affirme qu’il n’y est pour rien. Ce serait là une initiative des éditeurs de manuels scolaires pour la rentrée 2016, qui auraient décidé, comme ça, tout d ‘un coup, sans pression extérieure, d’appliquer une réforme édictée en 1990. Sous un autre gouvernement socialiste, mais ce n’est sans doute là que pure coïncidence.
On se demande tout de même bien pourquoi ils ont attendu 26 ans, ces chers éditeurs !
On sait, tout le monde sait, que l’accent circonflexe est très souvent le vestige archéologique d’un « s » tombé en désuétude. C’est beau. Oui, moi, je trouve ça beau… J’ai l’impression d’écrire en communiquant avec une certaine conscience de mes ancêtres des temps reculés. D'écrire le paragraphe d'un roman éternel. La réforme se propose donc, en beaucoup de points, d’effacer la mémoire de la langue. Tiens, tiens… Effacer la mémoire. On dira ce que l’on voudra mais ça ressemble beaucoup aux préoccupations socialistes, ça, qui voudraient, par exemple, que l’Histoire de France débutât le 14 juillet 1789 et faire fi de tout ce que doit cette Histoire à l’Histoire de la chrétienté.
Mais passons. Nous tomberions très vite dans la mauvaise foi, si j’ose dire…
Parmi les arguments avancés par les partisans de ce bidouillage artistique, j’en ai lu un qui m’a bien fait sourire. Celui d’un académicien, peut-être : Il y avait des anomalies historiques, dans notre langue.
Mais ce brave monsieur oublie, ou plus sûrement a toujours ignoré, que l’histoire fourmille d’un nombre incalculable d’anomalies, consacrées par la mémoire. Partout.
Par exemple et par hasard, François Hollande est une anomalie en tant que président de la république de France. On ne le sait que trop : sans la fellation volée par Strauss-Kahn, son camp n’en aurait pas même voulu comme candidat!
Est-ce à dire que les manuels d’Histoire du futur rayeront son nom de la liste des présidents ? J’en doute fort. Et en dépit du peu de sympathie que m’inspire le bonhomme, j’espère bien que non.
Parce que savoir Hollande, Fabius et Belkacem, c'est savoir beaucoup l'époque.
12:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.02.2016
Fable à chute malpolie
L’ÉLECTION
Deux bons vieux camarades d’une célèbre école,
De celles qui vous promettent les plus beaux Ponts d’Arcole,
Parcourant un beau jour le même terrain de chasse,
Eurent à simuler un violent face-à-face :
Au grand jeu quinquennal de notre République,
Tous deux cherchaient victoire après débat public…
Allons, rugissait l’un, aux plus infortunés
Vous voulez distribuer un pain que vous prendrez
Au moulin des plus riches et des grands capitaines,
Dont la sage industrie est pour tous une aubaine !
Ainsi les ruinerez et vos nécessiteux
N’auront pour pleurnicher tantôt plus que leurs yeux.
Bon sang, fulminait l’autre, vos sales capitalistes
Saignent notre nation en infâmes égoïstes ;
Amassent des fortunes quand les populations
Ne savent plus comment résoudre l’équation,
Aux inconnues multiples, d’une vie de misère !
Sus aux grands financiers ! Partageons le dessert !
Tous deux dans le privé lassés de jouer leur rôle,
En faisant bonne chère se tapaient sur l’épaule…
Celui qui, gloussaient-ils, sera l’heureux élu,
A ce qu’il vient de dire devra tourner le cul.
Mais le poste majeur vaut bien ce ridicule,
Tant le peuple électeur adore qu’on l’encule !
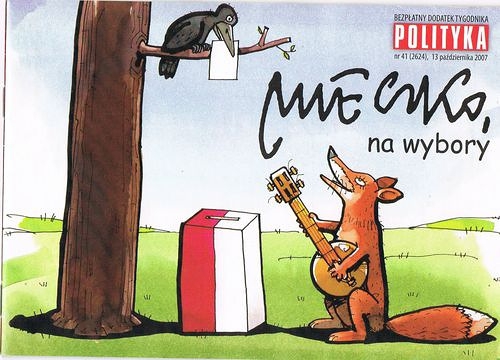
11:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, poésie, écriture, élections, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.02.2016
Nécrophagie
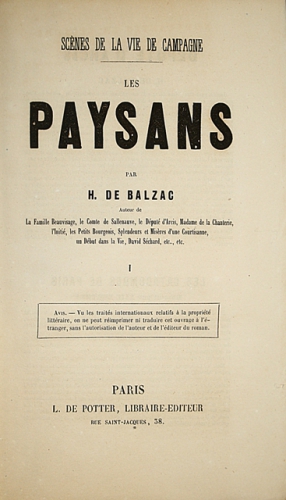 Treiweller, Juppé, Morano, Sarkozy, Lemaire, et maintenant Taubira, tous sont pris d’une frénésie de la plume et jettent en pâture au peuple imbécile - qui ne demande pas mieux que de s’en gaver - les pages d’élucubrations qu’ils ont gribouillées, ou plus sûrement fait gribouiller.
Treiweller, Juppé, Morano, Sarkozy, Lemaire, et maintenant Taubira, tous sont pris d’une frénésie de la plume et jettent en pâture au peuple imbécile - qui ne demande pas mieux que de s’en gaver - les pages d’élucubrations qu’ils ont gribouillées, ou plus sûrement fait gribouiller.
Des succès de librairie à tous les coups. Bingo ! Des milliers d’euros ! On lit soudain à tour de bras dans ce beau pays de France !
Et je lis, moi, pour Taubira, que l’éditeur se frotte les mains et déclare sans vergogne, comme un maquereau devant la plus vendable de ses putes : "on va certainement réimprimer très vite." Je lis aussi que les libraires ont bien joué le jeu, qu’ils ont pris le livre comme une friandise juteuse… Ils l’ont même pris sous X ! Tel le bébé honteux né d’une inavouable aventure d’un grand de ce monde ! Car ils ne sont pas fous, les libraires ! Au flair, ils savent reconnaître l’orphelin issu de la Cour de celui issu du caniveau et s’ils le prennent sous leur aile protectrice avec tant de commisération, c’est qu’ils devinent que ce X est assis sur une mine d’or… Un faux X.
Vous vous imaginez, vous, manants, gueux, roturiers, artistes anonymes, vous pointant chez ces pharmaciens avec votre orphelin sous le bras ?
Mais c’est qu’ils sonneraient vitement les gendarmes, oui, ces sycophantes-là !
Les libraires sont passés maîtres dans l’art de vendre leur âme au diable. C’est d’ailleurs à peu près tout ce qu’ils savent désormais vendre !
C’est risible. Oui, risible, misérable, grotesque et pathétique, cet amour du livre venu de la part de ces politiques, twitteurs de slogans à deux balles et qui, en soi, méprisent profondément le livre. Pourtant, ce n’est même pas vers eux que monte ma colère et s’agite mon dégoût. Je m’en fous de leurs lubies, de leurs tricheries, de leurs conneries, de leurs putasseries. Je m’en fous ! Après tout, ils sont là par la volonté du peuple et il y a bien longtemps que la force des baïonnettes ne les effraie plus. C’est eux qui les ont, d'ailleurs, les baïonnettes…
Ma colère, je la réserve à ces traîtres, ces renégats, ces gens sans aveu, qu’on appelle encore des "libraires".
Eux, normalement, sont censés savoir ce qu’est un livre. Ils sont censés vendre de la lecture, pas du vomi. Mais la lecture, ça ne paie plus, mon cher ! Le vomi, oui, ça, c’est des couilles en or… Les porcs ont toujours aimé lécher du vomi.
Et quand je pense que pour écouler nos livres, à nous, ces chiens galeux refusent d’en prendre ne serait-ce qu’un seul parce qu’ils sont déjà surchargés ! Pire encore : quand il leur arrive, contraints et forcés, d’en vendre un parce qu’un client obstiné insiste pour leur commander via Dilicom ou Electre, ils ne nous le payent même pas !
Ils savent que nous sommes faibles. Que nous n’avons pas les moyens d’exiger notre juste et maigre dû.
Jolie mentalité, mentalité de salopards, mentalité de hyène… C’est par eux que le livre est mort, lâchement assassiné. Et c’est par eux que le peuple se délecte de ses succédanés, lambeaux putréfiés de son cadavre.
11:34 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.01.2016
Zozo, Jean Jacques Epron et mézigue
 Tempus fugit…
Tempus fugit…
En 2009, je publiai à l’enseigne des Editions « Le Temps qu’il fait », Zozo, chômeur éperdu, texte qui me valut, ma foi ne boudons pas notre plaisir, quelque succès et dont Le Matricule des Anges s’était fait l’écho, sous la plume d’Antony Dufraisse.
En 2010, un gars du Poitou me contactait : Il se proposait de mettre en voix certaines pages du texte de Zozo et d’en faire des lectures publiques.
C’était le passeur de mots, Jean-Jacques Epron.
Je fus ainsi invité à l’accompagner dans ses premières lectures et ce sont là de ces excellents souvenirs à l’aune desquels on mesure comme file entre nos doigts le temps éphémère des amitiés.
Auparavant, Jean-Jacques m’avait envoyé un petit texte qu’il me demandait de mettre en musique. J’arrangeai à mon goût quelques rimes et collai des accords sur ses mots. La semaine que je passerais avec lui, il voulait en effet que nous chantions sa chanson à la fin de sa lecture.
Après, il a volé de ses propres ailes et lu Zozo pendant deux ans. Il est même allé jusqu’au Québec porter là-bas la gouaille épicurienne de mon personnage.
Ému, j’ai retrouvé ces jours derniers une vidéo de notre complicité du moment. C’était à Couhé, ce qui me gâte encore plus car ce fut dans ce chef-lieu de canton que je fis, quelque 40 ans auparavant, mon entrée au Collège, qu’on appelait alors Le Cours complémentaire.
Je vous invite, si vous êtes de loisir, à partager quelques minutes durant ces quelques instants de Zozo…
C’est ici.
10:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.01.2016
Villages de l'est polonais - 1 -
 Sur ces territoires de l’est polonais, tantôt calcinés par l’été, tantôt transis par l’hiver, les prairies viennent toujours s’échouer sur une lisière de forêt ou d’un morceau de forêt.
Sur ces territoires de l’est polonais, tantôt calcinés par l’été, tantôt transis par l’hiver, les prairies viennent toujours s’échouer sur une lisière de forêt ou d’un morceau de forêt.
C’est là leur horizon, flegmatique et plus ou moins proche.
C’est peut-être d’ailleurs cette proximité ou cet éloignement des limites qui, dans ma langue, distingue le pré de la prairie. Parfois, même, lorsque la forêt a disparu, lorsque, de guerre lasse, elle a rendu les armes après des siècles et des siècles d’une lutte inégale contre la charrue, on parle de plaine agricole.
Pour ne pas avoir à évoquer du désert, sans doute.
La forêt, on le sent bien, n’est ici qu’à demi résignée. Elle s’obstine à contredire la modernité des temps et des lieux ; elle retarde l’avancée du soc, rechigne et semble encore vouloir dessiner le champ au gré de sa fantaisie. Elle est à contretemps, tel le lambeau d’une mémoire égarée.
C’est ainsi que les villages sont calfeutrés dans des clairières. Rares en effet sont ceux qui sont accessibles autrement qu’en traversant une forêt de pins, de bouleaux et de quelques chênes rouges. On déboule alors entre quelques champs morcelés et, aussitôt, dans l’unique rue d’un hameau qui s’éternise en longueur, ses maisons basses et de bois séparées par des jardins, des broussailles ou de chétifs bosquets d’acacias.
Je me suis souvent demandé pourquoi les Polonais avaient construit leurs villages allongés ; pourquoi ils les avaient de la sorte couchés le long de la route, sans rues transversales, plutôt que d’avoir aggloméré leurs foyers autour d’une petite place, d’un point d’eau, d’une chapelle ou de tout autre élément communautaire, comme le sont nos villages de l’ouest européen.
Est-ce pour que le vent, quand il souffle depuis les steppes russes, s’y engouffre, prisonnier d’une voie tracée et passe ainsi son chemin plus vite au lieu de s’y attarder en tourbillons glacés ? Est-ce pour que la neige ne s’y amoncelle pas et soit balayée plus loin, à l’autre bout, sur une lisière ?
Est-ce à dire que les Polonais, du moins les ruraux, veulent bien habiter un même lieu mais ne pas vivre vraiment ensemble ?
Ce sont là supputations fantaisistes de l’étranger car les raisons, du moins celles que m’a exposées un homme du crû, semblent être tout autres.
C’est que l’est polonais est neuf au regard des civilisations gallo-romaines et germaniques. L’Empire avait déjà ses grands chemins, ses voies royales, ses aqueducs, ses cités, ses forts militaires et ses ponts gigantesques enjambant les vallées, tout cela tailladé sur le dos primaire de la forêt, qu’ici elle était encore souveraine absolue des lieux et des silences antédiluviens. La grande plaine européenne n’était dénudée que jusqu’aux limites de ces territoires, où des populations indigènes vivaient dans l’obscurité des hautes voûtes forestières.
D’ailleurs, un historien latin – que je crois être Tite-Live, je ne me souviens plus - avait décrit ces hommes comme petits et râblés car, disait-il, l’ombre dans laquelle ils évoluaient constamment était un obstacle à ce qu’ils grandissent. Je ne vois pas trop pourquoi. L’historien poète ne prêtaient-ils pas aux hommes les caractéristiques des plantes ? Et puis, les mythes liés à la forêt ne regorgent-ils pas d’hirsutes géants ?
Toujours est-il qu’il aurait fallu parer au plus pressé quand est venu, porté depuis l’ouest européen comme depuis l’est slave, l’ère de l’habitat sédentaire. On aurait alors tracé des lignes coupant tout droit dans la forêt et on aurait couché les maisons le long de ces lignes, par simple commodité pour le déplacement et pour avoir tout de suite accès à la voie principale plutôt que d’avoir à cheminer sur des voies de traverse, des sentes et des layons malaisés.
Car tout ici est difficile, enneigés et glacés que sont les lieux durant de longs mois chaque année.
Voilà donc ce que m’en a renseigné cet homme… Est-ce à dire pour autant qu’il s’agit là d’une indubitable vérité de l’histoire ? Je ne saurais évidemment le dire. Disons alors que c’est une lecture des géographies qui me convient bien et que c’est justement par là qu’elle mérite, à mon sens, d’être retenue et écrite, la mémoire des lieux, comme la toponymie, étant avant tout un terrain de jeu pour les poètes.
Illustration : Dimanche dernier, devant chez moi
11:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.01.2016
Sur quel pied danser ?
 C’est simple, pour ne point dire simplet : l’équilibre d’un couple, son bonheur, est une question de pied.
C’est simple, pour ne point dire simplet : l’équilibre d’un couple, son bonheur, est une question de pied.
Tout repose sur le pied. Ce qui semble de prime abord aller de soi, le pied, qu’il soit celui d’un buffet, d’un oiseau ou d’un homme, étant fait pour reposer sur le sol.
Donc, l’amour et le couple.
Au commencement, c’est bien connu, on trouve chaussure à son pied après s’être galamment fait du pied sous la table, sans doute !
Et on met bientôt sur pied des projets d’avenir, quelle bonne blague !
Le plus souvent on se retrouve d’ailleurs pieds et poings liés, mais bon, ça, c’est une autre histoire… Et puis, on peut très bien trouver chaussure à son pied sans pour autant signer un contrat ad vitam æternam avec un cordonnier, n’est-ce pas ?
Il faut même, à mon sens, être bête comme ses pieds pour envisager qu’une émotion, qui peut-être durable, certes, certes, puisse cependant s’avérer pérenne au point de vous agiter jusqu’au moment où, ayant déjà un pied dans la tombe, vous vous apprêtez à sortir du monde les pieds devant.
Mais bon, ceci, n’engage que moi. C’est mon pied de nez récurrent à toutes les formes conventionnelles et civiles de l’amour.
Faudrait, comme disait un texte paru récemment mais dont je ne saurais citer les auteurs, commencer à rédiger enfin une loi qui séparerait l’amour et l’état.
Mais je digresse, je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis.
Revenons à l’amour avant que je ne vous casse les pieds avec mes élucubrations sur le pied.
Donc, si quelque malotru séducteur ou quelque oie blanche aguicheuse, ne vient pas vous couper l’herbe sous le pied, l’affaire est dans le sac. En route pour l’aventure ! Ou la mésaventure. Seul l'avenir vous le dira.
La loi, je crois bien d’ailleurs, vous oblige, si vous êtes un imbécile qui tenez absolument à signer un contrat imbécile, à consulter afin que le médecin constate que vous n’avez pas les pieds nickelés ou que votre santé n’est pas de nature à faire courir à votre partenaire le risque de recevoir un coup de pied de Vénus … C’est charmant, la loi ! Et délicat, en plus !
Bref. Ces formalités étant remplies, vous voilà donc au pied du mur et c’est au pied du mur qu’on voit l’amoureux.
Car dans la phase de séduction, lors de la parade nuptiale, vous ne vous êtes pas donné de coups de pied, vous ne vous êtes pas mouché du pied, vous avez péroré, vous avez avantageusement bombé le torse, et l’heure est venue de mettre les pieds dans le plat, si je puis dire.
Si dès lors vous ne voulez pas que votre compagne (ou votre compagnon, soyons prudent !) ne se lève du pied gauche dès le premier matin de la nuit de noces ou, même, qu’elle ne lève déjà carrément le pied, va pas falloir vous débrouiller comme un pied. Va falloir vous montrer assez aimant et habile pour qu’elle prenne son pied.
Pas facile, de prendre son pied en faisant tout ça… J’imagine votre angoisse. Moi, au début, quand j’étais un jeune garçon à la barbe naissante et aux poils pubiens tout fraîchement sortis de l’épiderme intime, je croyais comme un sot que c’était là une allusion gaillarde à une position des plus acrobatiques du kamasutra et j’étais effrayé à l’idée de devoir être bientôt contraint de me livrer à de telles gymnastiques si je voulais enfin m'ouvrir les portes du Nirvana.
L’amour, ça n’est donc que du sport, que je me disais dans ma tête épouvantée !
C’est que je n’étais pas encore aguerri au cirque des mots. Car prendre son pied ne repose pas sur le pied, mais sur l’unité de mesure du même nom et désigne sa part, sa portion de plaisir. Les voleurs, d’ailleurs, vers la fin du XIXe, disaient recevoir son pied pour dire sa part du butin.
Inimaginable le nombre d’expressions chatoyantes qui nous viennent des voyous et des brigands, de la rue et du tripot ! La nuit frauduleuse, la nuit des rossignols et des pieds-de-biche, est toujours celle des poètes, n’en déplaise aux flics des ministères et aux midinettes des gouvernements, et jamais ne regretterai de l’avoir traversée, cette nuit-là !
Quand j’ai su ça - le véritable sens de prendre son pied - alors, j’y suis allé de pied ferme, vers ma première aventure. Et je ne saurais vous dire ce que je faisais de mes pieds dans les délices de cet instant !
L’’expression s’était d’ailleurs répandue comme un fleuve de plaine pour dire un tas de choses, un concert génial, une bonne soirée, une situation jouissive, ludique : le pied ! C’est le pied ! Chez les musicos, on disait ça pour une bonne répétition, un bœuf réussi.
On le disait à tout bout de champ.
Aujourd’hui je crois qu’on dit, ou qu’on écrit, lol !
Je ne sais pas ce que ça veut dire, je m’en fous et je ne cherche pas à savoir.
Car à chaque âge, chaque époque, chaque saison, ses idiomes.
Et il ne faut pas tenter de travestir la sienne, si l’on ne veut pas perdre pied.
11:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.01.2016
Kucając
 C’est le titre du nouvel opus d’Andrzej Stasiuk, Accroupi, et il me tarde qu’il soit édité en notre langue car ce que D., qui vient de le lire, m’en traduit par bribes judicieusement choisies, me fait grande impression.
C’est le titre du nouvel opus d’Andrzej Stasiuk, Accroupi, et il me tarde qu’il soit édité en notre langue car ce que D., qui vient de le lire, m’en traduit par bribes judicieusement choisies, me fait grande impression.
Stasiuk est un authentique et bel auteur ; on en est persuadé quand on a lu Sur la route de Babadag, Le Corbeau blanc ou Fado.
Un jour, il faudra que je descende 400 km au sud, dans ses belles montagnes enneigées l’hiver et torrides sous juillet, pour aller serrer la paluche de cet homme, tant je me ressens bien dans ce qu’il peut écrire.
Tout particulièrement dans sa façon de vivre son climat, sa forêt, ses chemins, "son coin de ciel."
Il fait froid, la neige craque sous le pas, les branches silencieuses de la forêt pleurent des lambeaux de glaçons.
Tout comme l’écrivain le raconte dans Kucając, je vais alors du thermomètre accroché à la bibliothèque à celui suspendu à ma fenêtre du dehors. Tout comme lui, je mesure qu’une vitre seulement sépare les moins 22 degrés des lisières forestières des plus 22 ou 23 degrés de la maison, qu’il faudrait seulement franchir cinq centimètres de matière pour atteindre une amplitude de 45 degrés ! Deux mondes se côtoient ainsi, celui de l’homme, de ses livres, de sa page d’écriture et de ses grands poêles de faïence et celui des renards furtifs, des grands corbeaux et des mésanges qui viennent, aux morceaux de lard suspendus dans les halliers, picorer les miettes de leur survie.
Stasiuk vit sur le mode affectif la terre où s'écoulent ses jours. Il la vit en poète. C’est le sens de son titre, s’accroupir, descendre de son perchoir d’homme dominateur pour la sentir, cette terre, dans le sempiternel mouvement des choses et des saisons, et pour y entendre le fourmillement discret du voisinage animal.
Aucun écolo à la noix, petite voix spectaculaire du misérabilisme politique, ne saurait dire comme le dit la littérature l'indivisible beauté de cette planète des hommes.
Par ailleurs, il me semble aussi qu’Andrzej Stasiuk vit la compagnie de ses moutons comme je vis celle de mes poules, en ami, dans cet échange à deux langages qui se pratique entre les bêtes et les humains. Complicité cacophonique des vies qui se respectent et qui, au départ, n'étaient pas faites pour se rencontrer.
Et il me semble aussi entendre, chez lui, ce que j’avais voulu exprimer dans Géographiques :
« […] occuper n’importe lequel point du globe est déjà une aventure en soi : celle d’habiter pleinement son climat. Car nous en sommes aussi le reflet, par lui façonnés.
Devenus fort prétentieux cependant, nous ne nous acclimatons, si j’ose, que très difficilement à cette idée pourtant déjà énoncée chez Montesquieu et, avant lui, chez Pascal :
« On ne voit rien de juste ou d’injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. »
Peut-être Pascal parlait-il seulement de pays, de lieux. Vérité au-deçà etc.
Mais je crois vous avoir dit que c’était la même chose, messieurs, selon que l’on marche les yeux sur les étoiles ou le regard rivé à sa chaussure. »
10:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture, livres | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.01.2016
Chansonnette
Destin contraire
Un soir d’intempérie
Les rues de La Rochelle
Étaient noires de pluie
Et pas une donzelle
Ne battait le pavé
De son talon usé.
Le vent rasait les murs
De la rue Réaumur...
Devant un p’tit bistrot
Dégueulasse, mal famé
Chantait un vieux poivrot
Sur l’mode improvisé
Une espèce de romance
Qui parlait d’son enfance.
Le vent rasait les murs
De la rue Réaumur.
Son soulier défoncé
Trainait dans le ruisseau :
« Même que j‘ai voyagé
Jadis j’étais mat’lot
Mon père a fait de moi
Le pauvre hère que voilà,
Pour m’avoir trop nourri
De sa philosophie.
Les roses de mon berceau
Étaient bardées d’épines
Il disait qu’cétait beau
De vivre de rapines,
Que de violer les lois
Écrites par les bourgeois,
C’était faire le bien
Pour les pauvres et les chiens !
J’ai suivi son chemin
De Damas en prison
Et c’est pas pour demain
Qu’jaurai plus mes haillons.
Que c’est triste de vivre
J’crois qu’jai lu tous les livres
Déférence gardée
Pour Stéphane Mallarmé. »
Mais bientôt il hurlait
Les mots de sa chanson
Plus qu’il ne les chantait,
C’était vraie déraison.
Attirés par le bruit
Du barde de l’ennui,
Surgirent des pandores
Pour le prendre à bras l'corps.
Ils furent accueillis
Par une volée d’injures.
Soudain le vieux débris
Perdant toute mesure
Planta un grand couteau
Dans le ventre du plus gros
Qui mourut aussitôt
La gueule dans l’caniveau.
Quelques années passées
J‘appris dans les journaux
Qu’on avait condamné
Sa tête à l’échafaud.
On y disait à tort
Qu’il n’eut jamais d’remords
D’avoir donné la mort
A ce pauvre pandore.
Car moi qui l’ai connu,
Je n’vous dirai pas où,
Lui qui avait tout lu
Il n’était pas voyou.
Terminant sa chanson,
Même de piètre façon,
Jamais n’aurait commis
C‘pourquoi il fut occis !
Paroles et musique mézigue
12:32 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : musique, littérature, écriture, chanson | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.01.2016
Y'a qu'à faire comme ça
 Froid sur les rivières et les étangs, neige voltigeant dans l’air au menu de cette Epiphanie, jour férié en Pologne.
Froid sur les rivières et les étangs, neige voltigeant dans l’air au menu de cette Epiphanie, jour férié en Pologne.
Et c’est bien normal dans un pays qui se veut respecter les traditions de la religion chrétienne.
On dira oui mais… On dit toujours oui mais quand on regarde chez les autres et qu’ils ne font pas exactement comme soi-même on fait.
Sans être personnellement pénétré du sens sacré de la religion, je crois que c’est de bonne franchise, là comme partout ailleurs, de ne pas faire les choses à moitié.
Ou on les respecte, ou on les fout à la poubelle, les choses de la religion, mais il n’y a guère pire que cette demi mesure instaurée en France, calquée sur les besoins de l’organisation sociale. Du temporel légèrement saupoudré de spirituel. Un peu de miel dans du vinaigre.
Ainsi quand je lis sur mon almanach français des PTT que l’Epiphanie est inscrite au dimanche 4 janvier, je vois bien que cette pauvre France, le cul entre deux chaises, hésite entre la chèvre et le chou.
Elle finira comme l’âne de Buridan, mort de soif et de faim entre une botte de foin et un seau d’eau.
Je me demande par ailleurs si, pour les besoins de la cause travailleuse, on en viendra un jour, dans cette chère France, à prier gentiment les gens de confession musulmane de ne respecter le ramadan que le samedi et le dimanche.
Que d’hypocrisie ! Je le répète pour les obtus : si les dehors de la religion partout présents en Pologne me gonflent, les singulières tergiversations de la France, pourtant construite, bâtie, solidifiée et culturellement nourrie sur le socle des traditions chrétiennes, m’énervent encore plus.
J’y vois comme une lâcheté à ne pas vouloir décliner sa véritable identité. Du louvoiement de clandestin. Du balbutiement de vierge effarouchée.
Le jour où on fera tomber forcément Noël un dimanche pour ne pas perturber les rythmes scolaires et les fluctuations financières de la bourse, on va bien rire. Les instituteurs de la gauche laïque seront tous dans la rue, poussés au cul par des syndicats indignés !
Mieux encore : le jeudi de l’Ascension un samedi. Ça, ça aurait du cachet ! Finis les longs week-ends à la plage ou chez mémé !
11:41 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : écriture, littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.12.2015
A califourchon sur deux siècles - 8 -
 La confusion explosive qui règne sur une bonne partie de la planète où les puissants affûtent leurs armes et avancent leurs pions, provient aussi, en même temps qu’elle en est la cause, de la confusion qui sévit dangereusement à l’intérieur des sociétés des pays de l’Occident et, in fine, dans la tête de chacun.
La confusion explosive qui règne sur une bonne partie de la planète où les puissants affûtent leurs armes et avancent leurs pions, provient aussi, en même temps qu’elle en est la cause, de la confusion qui sévit dangereusement à l’intérieur des sociétés des pays de l’Occident et, in fine, dans la tête de chacun.
Confusion dans les rapports sociaux falsifiés et sacrifiés à des idéologies communautaires et égalitaires que les mouvements autonomes du réel viennent chaque jour contredire, confusion dans l’énoncé à tour de bras de valeurs surannées, pas claires du tout et même historiquement louches – je reviendrai sur ce point -, confusion totale dans les buts poursuivis par les États et confusion de leurs discours politiques, confusion, en Europe surtout, sur la notion même de pays d’appartenance, confusion terrible entre des progrès technologiques de plus en plus pointus mais aux effets de moins en moins visibles sur le bien-être moral et matériel des individus, confusion d’une richesse qui s’accumule dans des proportions inversement proportionnelles à la demande de participation active des gens mais dans le même sens qu’une dette qui grossit à n’en plus finir, dont on nous rebat les oreilles, dette métaphysique, irréelle, nuage de chiffres indicibles, muets et, pour corollaires, confusion dans les conditions faites à la vie individuelle et familiale vide de désirs souverains, d’idéaux enthousiasmants, exclusivement modulée sur des joies subordonnées à la masse de marchandises aussi frelatées qu’inutiles que chacun est en mesure de se procurer, confusion enfin dans l’usage quotidien que l’on fait de sa culture tout en s’efforçant, pour faire cultivé, de la nier.
Dans de telles conditions, nées de la complexité in-humaine du libéralisme mondial, aucun politique ne sait lui-même où il met les pieds quand il accède à un mandat suprême. Il improvise, il magouille du réel, il fait avec les moyens de plus en plus limités du bord et comme bien évidemment toute cette impuissance est inavouable quand on brigue les suffrages de gens perplexes qui attendent des solutions, il ment comme un arracheur de dents.
Mitterrand qui, en plus de savoir présenter des vessies en guise de lanternes, savait pertinemment que tel serait le lot du XXIe siècle en confiant : je serai le dernier Président. Entendez par là que les Présidents du XXIe ne seraient que Présidents de leur propagande et n’auraient aucun pouvoir sur le cours mondialisé des choses. Le roué socialiste savait d’autant mieux de quoi il parlait qu’il était un des fervents idéologues et premiers artisans de cette situation naissante dont le contrôle échapperait bientôt complètement aux politiques des uns et des autres.
Ainsi, candidat à l’impuissance en actes, quand Hollande s’époumone à hurler que "l’ennemi, c’est la finance", il ne ment pas. Il traduit la vérité toute crue, complexe, en un lapidaire slogan publicitaire. Il donne un nom au mal, il nomme l’angoisse du peuple.
Mais, toute honte bue, là où il fait œuvre d’innommable escroc, c’est quand, par ce slogan, il laisse entendre qu’il va combattre et même abattre cet ennemi. Ça tombe sous le sens. Personne ne peut dire : je connais l’ennemi, mais il est plus fort que moi et, en plus, j’en ai besoin, alors...
La formule, même dans sa stricte réduction publicitaire et mensongère, était de toutes façons, vu l’état du monde, une idiotie de première classe. Imaginez un candidat de la fin du XIXe siècle qui se serait écrié : l’ennemi, ce sont les mines de charbon et les hauts fourneaux !
Car ce n’est pas la finance qui est l’ennemi et cause du malheur des gens, mais bien la façon dont le monde, qu'elle a assujetti, s’articule autour d’elle et la façon dont elle redistribue ses acquits, de même que ce n’était pas les aciéries l’ennemi des ouvriers du XIXe mais bien les misérables conditions qu’elles imposaient à leur vie.
Si mon radeau sur une rivière se met à prendre l’eau et que je risque de m’y bientôt noyer, il sera plus intelligent de revoir l’état de mon radeau et ma façon de naviguer que de vouloir supprimer la rivière.
Cet exemple vaut pour tous les autres qui pourraient être donnés en matière de mensonge. La recette est toujours la même : on dit la vérité mais on la dit en mentant, c’est-à-dire en cachant soigneusement qu’on ne fera pas de cette vérité l’usage qu’en attendent ceux à qui on la dit.
Le vrai est donc un moment essentiel du faux, l’un et l’autre s’épaulent, l’un sans l’autre n’a aucun sens.
Marine Le Pen agit de même sorte. Elle a très bien identifié le mal dont souffrent les sociétés et, partant, les gens. Elle a très bien identifié les bourbiers économiques, intellectuels, moraux et culturels dans lesquels s’est enfoncé son pays. Là où elle ment, c’est qu’elle laisse accroire qu’elle a les armes qui assainiront le terrain.
Or, sauf à remettre les gens derrière une charrue tirée par de fiers chevaux – ce qui d’un point de vue sensible et littéraire ne serait pas pour me déplaire - et au jardin pour planter des poireaux et des patates, ses visions publicitaires seront balayées par les nécessités consuméristes de ses propres électeurs et, donc, par les exigences industrielles, commerciales et financières de la mondialisation avec, pour l’Europe, le maintien des espaces sans frontières.
Penser que les marchandises et les capitaux puissent être à nouveau taxés à chaque passage de frontières entre Varsovie et Madrid est tout simplement une idiotie qui n’irait pas dans le sens d’une amélioration de la vie des individus. Ne serait-ce que d’un point de vue strictement économique.
Il faut savoir dès lors que le capitalisme financier a renversé les exigences et idéaux des peuples, qu’il les a bien compris, qu’il les a récupérés à son profit et que c’est lui qui a réalisé ce que se proposaient de réaliser ces idéaux prolétariens : l’internationalisation. Il a pris l’histoire de vitesse et, pour ne pas être coincé dans le piège d’une contestation unanime et planétaire à laquelle il n’aurait assurément pas pu faire face, il a lui-même planifié, selon ses besoins et désirs, la vie et la survie de chacun d’un pôle à l’autre du monde.
Citoyens du monde, c’est ce qui s’appelle s’acheter un bâton pour se faire battre !
Et la raclée est sans doute irréversible.
Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’il ne faut plus avoir le moindre bout de cerveau dans sa boîte crânienne pour penser encore que le salut pourrait sortir des urnes.
15:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, écriture, politique, histoire, mondialisation | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.12.2015
A califourchon sur deux siècles - 7 -
 Ce n’est pas de réelle gaité de cœur que je dois poursuivre par quelques exemples ce tableau de la falsification comme mode d’asservissement des esprits et de gouvernement des peuples.
Ce n’est pas de réelle gaité de cœur que je dois poursuivre par quelques exemples ce tableau de la falsification comme mode d’asservissement des esprits et de gouvernement des peuples.
J’en ressens même une espèce de dégoût nauséeux et je me sens de moins en moins complice avec cette espèce de bipèdes soi-disant douée de raison mais qui ne connaît, pour assurer sa pérennité, que la félonie et l’organisation des désastres criminels, et ce, pour des causes toujours présentées comme louables et justes alors qu’elles ne sont motivées que par une avidité perverse de pouvoir et de domination, que par une expression de volonté maladive de puissance et uniquement commandées par l"insatiable voracité des grands capitaux et des multinationales.
Par-delà les grandes affiches du spectacle qui prêtent leurs noms à toute cette débâcle, c’est aussi la multitude consentante qui me donne le vertige et l’envie de vomir. Tous ces gens, gens de peu, gens de la chaumière, vers lesquels allaient toujours ma sympathie et mon amitié, ont fini par me dégouter comme me dégoûte le crapaud vautré dans sa boue et s’y complaisant.
Car qui donne le pouvoir aux criminels et aux menteurs sinon cette multitude bêlante et consciencieusement votante ? La bêtise ne peut pas tout expliquer. Elle a ses limites, à moins qu’elle ne soit carrément de l’idiotie.
Car je ne suis pas un devin, ni un fin analyste, ni un génie clairvoyant. Ça se saurait. Je n’ai jamais cassé quatre pattes à un canard, je suis un être moyen, pas plus intelligent que la plupart des gens, alors ce que je dis là, forcément, tout le monde le sait peu ou prou. Seulement, nous ne sommes qu’une poignée à ne pas accepter le mensonge permanent qui régente nos vies et compromet notre avenir et nous ne sommes alors qu’une poignée de solitaires qui préférerions consacrer notre bonheur d’écrire à bien autre chose qu’à l’étalage de toute cette fange.
Donc les gens savent et se taisent, courbés sous un joug imaginaire, une représentation de joug, une idée, une condition imagée devenue, par effet d’une pensée assassinée, réelle et coercitive.
Ceux qui savent, qui devinent mais se taisent par lassitude, par individualisme, par préoccupations ou urgences autres, je peux encore leur pardonner quelque chose dans mon cœur…
Mais ceux qui sont l’objet de toute ma haine, ce sont les gens de la piétaille militante, les petits et minables salauds et salopes qui entretiennent le mensonge par veulerie et qui minaudent, courtisans aux intérêts misérables, dans les couloirs des différentes strates de l’autorité. Ceux-là sont la véritable garde prétorienne sur laquelle s’appuie toute la légitimité du pouvoir mystificateur, échelonné du hameau au village, du village au bourg, du bourg à la bourgade, de la bourgade à la ville, de la ville à la métropole et jusqu'au sommet de l’État.
Qu’ils crèvent !
Car en grande partie par la faute de cette lâche garde prétorienne, nous allons droit dans le mur. Nous allons tout droit à la guerre et aux cataclysmes. Je l’ai pressenti avec force dès le 21 février 2014, date du coup d’état de Kiev fomenté par nos dirigeants, ceux-là mêmes qui vous donnent chaque jour des leçons de citoyenneté, de républicanisme et de démocratie.
Depuis, ce pressentiment s’est changé en quasi certitude, hélas, mille fois hélas ! Avec à peu près les mêmes aux manettes, il y a eu les chaos syrien et irakien, d'où est né l’État islamique, puis les sanglants attentats partout dans le monde, puis les traitrises et duplicités de la Turquie et les grossières provocations de son protecteur, voire de son mentor, l’OTAN.
Il y eut ensuite l’intervention russe en Syrie.
Ce dernier point est certainement la cause de l’acharnement belliqueux de l’OTAN, des USA et de ses alliés européens : on se dispute déjà avec âpreté les cadavres de la Syrie et de l'Irak et, ce faisant, on se dirige tout droit vers un conflit de dimension planétaire.
Poutine a prévenu d’une de ses phrases lapidaires dont il est coutumier : « Il y a cinquante ans, j’ai appris dans les rues de Leningrad, que lorsque le combat est inévitable, il faut frapper le premier. »
La problématique est assez simple. Ce même Poutine s’étant cabré à la conférence de Munich de 2007 en refusant désormais un monde unipolaire et en n’acceptant plus que son pays continue d’être humilié par les forces économiques, financières et militaires - dont les nôtres - dirigées par les USA, un premier test fut opéré par ces forces-là en 2008 en Géorgie, histoire de voir si Poutine allierait le geste à la parole.
Ce qui fut.
Le second, plus sérieux, en Ukraine, avec un coup d’état réussi par les phalanges les plus brutales du pays – et peut-être d’Europe - nostalgiques de Bandera et du IIIème Reich. Tout ce beau monde soutenu par la blanche Bruxelles, la sainte Pologne, les Pays Baltes, les USA, l’OTAN et, bien sûr, la France droit-de-l’hommiste de monsieur Hollande, lequel s’est empressé d’applaudir au retour - même maculé de sang et de honte - de la démocratie en Ukraine et qui fut le premier grand « républicain » à accueillir sur son perron les nouveaux « démocrates » putschistes.
Retour de la démocratie ? Que je sache, Viktor Ianoukovytch avait été élu démocratiquement. Mais la démocratie, pour Hollande et ses complices, doit avoir une couleur : celle des multinationales et des grands marchés européens et c’est parce que Ianoukovytch se tournait vers Moscou plutôt que vers Bruxelles qu’il fallait le destituer, voire le tuer. Il ne trouva son salut que dans la fuite, présentée par ces putains qu’on appelle encore « les médias » comme une lâche dérobade.
Fabius était présent ce soir-là à Kiev. Fabius est de tous les coups fourrés, quand il s’agit de faire bonne mine, un poignard camouflé dans la manche. Il y avait aussi son compère polonais Sikorski, brillant diplomate qui, seulement quelques mois après, se faisait piéger dans une conversation privée au cours de laquelle il disait que l’amitié avec les États-Unis était une connerie, une boule de merde (sic), qui menait la Pologne à la catastrophe.
Ces gens-là ne disent la vérité que piégés. Chaque fois que vous les entendez, quels qu’ils soient et où que ce soit, prendre une parole publique, soyez assurés que la falsification est au rendez-vous.
Prenez vos décodeurs, sinon faites-vous leur esclave lobotomisé !
On vous a raconté que Ianoukovytch était corrompu. On ne vous a pas menti. Mais on vous a roulés dans la farine de démocrates en invoquant cette raison comme étant celle du soutien européen. La preuve : l’Europe était en train de négocier avec lui et se fût-il tourné in fine vers cette Europe, tout en restant consciencieusement corrompu, que personne n’aurait eu l'idée de lui faire la moindre remarque quant à sa moralité.
D’ailleurs, son remplaçant, Poro Porochenko, est archi-milliardaire et il est le seul capitaliste ukrainien à avoir continué à faire du profit pendant la guerre, alors que son pays est ravagé et que tous les autres capitalistes se sont écroulés. Beau Président, ma foi !
Ça n’a pas l’air de déranger ni d’interroger beaucoup Bruxelles, Merkel et le socialiste Hollande, tout ça.
Une corruption qui va dans le bon sens n’en est pas vraiment une, n’est-ce pas ?
C’est tout comme le mensonge. Il y en a de très mauvais qui peuvent même être durement réprimés - dire la vérité, par exemple - et de pieux, mentir pour raison de bonne gouvernance, par exemple itou.
N’attendez pas d’autre éthique du monde inversé.
15:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, histoire, écriture, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.12.2015
A califourchon sur deux siècles - 5 -
 Ce qui distingue fondamentalement le XXIe siècle du XXe, c’est l’insolence décomplexée du mensonge, celui-ci s’étant nourri du désordre général de la pensée autant qu’il a contribué - et continue de contribuer - à le générer, même si tout n’a évidemment pas pris forme du jour au lendemain mais s’est peu à peu glissé dans les pratiques des pouvoirs jusqu’à en devenir une exigence incontournable.
Ce qui distingue fondamentalement le XXIe siècle du XXe, c’est l’insolence décomplexée du mensonge, celui-ci s’étant nourri du désordre général de la pensée autant qu’il a contribué - et continue de contribuer - à le générer, même si tout n’a évidemment pas pris forme du jour au lendemain mais s’est peu à peu glissé dans les pratiques des pouvoirs jusqu’à en devenir une exigence incontournable.
Certes, le mensonge est inhérent à toute politique, et ce depuis la nuit des temps antiques. Il n’est cependant devenu une force véritable de conquête du pouvoir que depuis la fin du XVIIIe, quand les peuples soi-disant souverains ont eu pour devoir de donner délégation à des représentants pour écrire le droit et agir en leur nom.
Les rois n’avaient pas cette pratique constante du mensonge, non pas qu’ils fussent plus bons ou plus honnêtes, mais tout simplement parce qu’ils n’en éprouvaient pas le besoin. Ils n’avaient pas le pouvoir, ils étaient le pouvoir, tant temporel que spirituel, légitimé par le sang et les cieux, et aucune vérité, aussi laide, aussi inique ou aussi grotesque fût-elle, ne pouvait dès lors atteindre à court terme leur puissance et remettre en question une autocratie dont ils avaient à jouir jusqu’à la mort.
Il en fut tout autrement quand il a fallu non plus être le pouvoir mais le devenir, uniquement légitimé par les sautes d’humeur d’un électorat diffus, autant parsemé d’individus lucides que d’abrutis de première classe. Convaincre une telle multitude qu’on est le meilleur et le mieux placé pour défendre ses intérêts n’a pu dès lors se faire qu’en falsifiant peu à peu la vérité, sinon des millions et des millions d’individus eussent été capables d’exercer le pouvoir au lieu des quelques centaines d’apparatchiks qui le détiennent régulièrement, tous toujours issus du même tonneau depuis l’effroyable Robespierre, dont ils se réclament.
Il a donc fallu inventer une vérité de telle sorte qu’elle ne paraisse accessible qu’à certains. Et qui donc est plus compétent pour énoncer une vérité falsifiée que celui qui la falsifie ?
Les rouages, les enjeux et les structures des sociétés devenant cependant de plus en plus complexes au fur et à mesure des avancées morales, intellectuelles et techniques du monde, la falsification s’est vue dans l’obligation de peaufiner son art. Elle est devenue plus exigeante encore, elle a pris de plus en plus de place jusqu’à devenir, par l'effet d'un renversement accompli, le vrai faux.
Le grand inventeur du mensonge politique moderne, dans sa plus laide et sa plus sanguinaire expression, fut Staline. Sans cette arme redoutable maniée avec une dextérité diabolique, tout puissant qu’il ait été, il n’aurait jamais pu tenir l’immensité de l’Union Soviétique sous sa botte pendant plus de vingt ans. Sous sa dictature, la vérité était tellement blessée à mort que la soupçonner et tenter de lui donner quelque apparence apparaissait comme un crime – et était d’ailleurs puni comme tel – alors que la falsification admise du réel était le signe d’une honnêteté sans faille envers la construction du socialisme. Le citoyen russe, privé de toute vue sur la réalité, ne pouvait que baisser la tête et faire allégeance au petit père des peuples, véritable incarnation du vrai agissant. D’ailleurs, lors des grandes purges, les accusés eux-mêmes finissaient par tout confondre et toujours par s’accuser de crimes et forfaits qu’ils n’avaient jamais commis, avant d' aller crever dans les mouroirs congelés de Sibérie, en tant qu’indécrottables ennemis du socialisme.
L’odieux personnage fut un pionnier. Dans l’outrance, oui, on est bien d‘accord, mais un pionnier quand même. Aucun homme politique après lui, la démesure criminelle et psychopathe en moins, n’a en effet conquis le pouvoir et ne l’a exercé sans s’appuyer sur cette doctrine du réel inversé et dont la devise pourrait ainsi être synthétisée : si les faits me contredisent, je modifie les faits.
Dans les dernières décennies du XXe siècle, le monde était cependant moins complexe et ses objectifs et contradictions plus directement perceptibles. Chacun, en vertu de lui-même, de sa construction personnelle, ou, pour les moins fins, en s’appuyant sur ce que leur dictaient chaque soir la sacro-sainte télévision et chaque jour le journal, pouvait à peu près comprendre et, comme dans les westerns de série B, déterminer où étaient selon lui les méchants et où étaient les bons sur le vaste échiquier des tumultes de la planète.
Mais avec l’avènement des premiers aventuriers politiques du XXIe, qui n’ont appris et retenu de l’histoire des peuples, des cultures et des religions que ce qui peut être utile à l’accomplissement de leur aventure, nous sommes entrés dans l’ère du révisionnisme intégral et, par voie de conséquence, dans celle de l’ignorance savante et du désordre achevé de la pensée.
16:43 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.12.2015
A califourchon sur deux siècles - 4 -
 En 1419, les Anglais du roi Henri V assiégèrent Paris et le prirent enfin après l’avoir ruiné et affamé. Jules Michelet raconte alors deux livres témoignant de cette époque, l’un d’un gars du populo et l’autre d’un moine de Saint-Denis :
En 1419, les Anglais du roi Henri V assiégèrent Paris et le prirent enfin après l’avoir ruiné et affamé. Jules Michelet raconte alors deux livres témoignant de cette époque, l’un d’un gars du populo et l’autre d’un moine de Saint-Denis :
« Si l’on veut voir comment les longues misères abaissent et matérialisent l’esprit, il faut lire la chronique d’un Bourguignon de Paris qui écrivait jour par jour. Ce désolant petit livre fait sentir à la lecture quelque chose de la misère et de la brutalité des temps. Quand on vient de lire le placide et judicieux religieux de Saint Denis, et que de là on passe au journal de ce furieux Bourguignon, il semble qu’on change, non d’auteur seulement, mais de siècle. .. »
Ce récit prouve qu'on ne peut dire l’histoire de son époque qu’à la lumière de ce qu’on en a vécu et qu'il n’y a d’histoire que la somme des histoires individuelles vivant contradictoirement, en phase ou dans un silence résigné, une même réalité. L’homme qui a fait tourner des entreprises en distribuant des salaires de misère, qui a amassé de l’argent et roulé carrosse toute sa vie retiendra de son époque qu’elle fut florissante. L’homme qui n’aura rien amassé du tout, sinon de quoi avoir le droit de survivre et de s’endetter jusqu’au cou, retiendra de son époque, à supposer qu’il ne soit pas trop con dans sa tête, qu’elle fut une époque de chiens errants. Un écrivain qui aura rencontré le succès avec des livres médiocres, n’écrira pas que son époque fut médiocre mais qu’elle fut raffinée et copieusement cultivée. Un autre qui n’aura jamais été lu que par quelques-uns autour de lui, affirmera que ce fut une époque d’affreux béotiens et et caetera, dans tous les cas de figure, dans toutes les couches de la géologie sociale et à toutes les époques.
C’est la raison pour laquelle l’histoire ne peut être écrite que par ceux qui ne l’ont pas vécue et qu’elle ne peut être éclairée que par la trainée de poudre qu’elle laisse derrière elle.
Je dis donc la trainée de poudre laissée derrière elle par ma propre histoire et non la trainée de poudre de l’histoire.
Quelques années après le retour terrible, accablant, de l’ennui des années 80/90 dans le ventre mou de la sociale-démocratie Mitterrandienne, vint le temps d'une intégration relative et de la résignation.
La quarantaine toute proche, l’impossibilité de continuer à vivre en marge, les coups reçus, l’érosion des armes critiques avec lesquelles nous nous étions crus forts, la lassitude, ont fait de moi un être tout à fait ordinaire dans des temps ordinaires jusqu’à l’écœurante insipidité.
Toute une époque qui avait demandé, concrètement ou de façon diffuse, la fin de la politique, venait de signer des deux pattes le retour d’une espèce de front populaire à la gomme.
Des cendres de mes dernières illusions, il ne me restait rien. Que ce fond de l’être, silencieusement obstiné, car encore enclin à penser, malgré tous les dénis d’un réel courant sur près de vingt-cinq ans, que le monde devait être reconstruit de plus équitable façon.
Les erreurs d’appréciation – dont la plus grave, celle dont il est principalement question ici, c’est-à-dire de croire que les hommes s’acheminent forcément vers des sociétés plus humaines - ont la vie dure.
Jusqu’à la psychose et jusqu’à la foi du charbonnier.
On se marrait quand même bien encore en levant nos verres et en entendant – en lisant plutôt – la propagande socialiste du moment, carrément volée aux situationnistes : Changer la vie.
Il s’agissait pour les charognards de détruire l’essentiel en lui donnant un semblant d’apparence. Ces charognards-là faisaient la fête sur le cadavre décomposé de l’intelligence critique. Et même s’ils ont tour à tour changé de nom, de pelage et de plumage, ils n’ont jamais cessé, depuis, de se régaler des reliefs d’une fête humaine définitivement vaincue.
Tous ces vautours, leurs cours de chambellans et leurs piétailles repoussantes et ignares n’ont toujours eu à la bouche que le mot « réformes » ou « changement », afin de mieux décapiter les peuples en fouillant plus profondément dans ce qui leur reste de tripes.
D’ailleurs, le grotesque président que s’est offert, en France et en dernier lieu, la bêtise des urnes n’annonçait-il pas, faisant preuve en l’occurrence d’une originalité à faire se cabrer d’hilarité un cheval de bois : Le changement, c’est maintenant ?
Si être progressiste, être pour le changement qualitatif, c’est prêter le moindre crédit à ces immondices dignes des plus vilains caniveaux du Moyen-âge, alors, oui, enfin, je suis un réactionnaire !
13:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, histoire, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.12.2015
A califourchon sur deux siècles - 3 -

Les deux livres, celui de 1937 comme celui de 1980, étaient signés par Un incontrôlé.
Bien plus rares encore furent ceux qui eurent l’heur d’en débattre, au cours de longues discussions passionnées et dans des nuits sans fin, avec l’auteur quand le manuscrit était en cours d’élaboration.
Je fus une de ces trois ou quatre personnes qui eurent ce privilège.
Vingt ans après, en 2011, la fille de cet auteur, Marion, a réédité le livre de son père, qui fut donc mon ami, mon grand et irremplaçable ami.
Jean-Claude était venu me voir en Pologne à l’été 2006. En septembre de la même année, je l’avais revu en France. C'est lui qui nous avait conduits de bon matin à la gare de Surgères pour le retour… On s’était serrés dans les bras, comme de vieux frères.
Ce fut, sur ce quai de gare que la nuit brumeuse envahissait encore, la dernière fois.
Jean-Claude est mort en décembre. Nous étions amis depuis le début des années 70.
Son livre, donc, était une violente diatribe dirigée contre celui du situationniste italien Gianfranco Sanguinetti, Du terrorisme et de l’Etat, également traduit par Debord. Il précisait, point par point, avec une écriture affûtée telle une arme de précision, l’impasse dans laquelle s’étaient fourvoyés, selon lui, les théoriciens situationnistes du moment.
Pour illustration de ce que ces derniers avaient bel et bien perdu toute complicité avec ce qui se passait autour d’eux et sans eux, il fut rapporté à l’auteur - qui s’en confia à moi en rigolant comme un perdu - que Guy Debord aurait condamné ce pamphlet d’une flèche sans appel : Ce ne peut être là que l’œuvre d’un flic !
Ces oralités cependant n’ont jamais été vérifiées par qui que ce soit et ne peuvent dès lors prétendre à l’indéniable vérité. Je les cite simplement pour les avoir vécues et parce que tout ça me rappelle de grands et vrais moments d’amitié. Ce qui est absolument certain en revanche, c'est que Debord a lu le livre et l'a qualifié de "très louche".
Malgré toutes leurs indéniables qualités, les situationnistes en général et Debord en particulier avaient, eux, ça de profondément "louche" qu'ils considéraient que toute critique radicale ne pouvait émaner que de l'un d'entre eux et que ceux qui n'avaient pas encore renoncé à se battre directement étaient manipulés, voire carrément des flics !
Il faut cependant reconnaître que tout n’était pas faux dans le livre de Sanguinetti, loin de là. Il mettait au jour avec brio les implications de l’État italien, via ses services secrets, dans divers attentats sanglants attribués aux Brigades rouges, et nul n’a pensé, à l’époque - la bouche pleine d’une feinte sagesse et avec une modération de chien battu comme il est coutume de le faire aujourd’hui - à parler de « théorie du complot » ou autres gros mots destinés à empêcher toute analyse honnête et perspicace de porter atteinte à la candeur et à la virginité des appareils d’État. C’est bien pratique. Comme tout ce qui est, d’ailleurs, de nos jours, ainsi emballé dans des formules à l’emporte-pièce et fourre-tout. Les formules clouage-de-bec de ceux qui ont l'art de faire soupçonner le plus là où ils savent le moins…
Ce qui était par contre condamnable et très fâcheux chez Sanguinetti et que dénonçait avec force la critique de notre ami, c’étaient les nombreux amalgames, parfois insultants et carrément mensongers à l’égard de certains anarchistes ayant mené combat de part et d’autre des Pyrénées et, pour certains, encore en lutte. Ce qui laissait d’ailleurs fortement à penser qu’à part avec la théorie, le situationniste italien ne s’était jamais directement confronté aux forces de l’état.
Si j’en parle longuement ici c'est que, pour moi, ce fut le signe tangible d’une rupture entre les théoriciens, aussi brillants eussent-ils été, et les camarades encore engagés dans l’affrontement, quelque forme que puisse prendre cet affrontement.
Ce fut tout… Il n’y eut pas de suite, ni à l’affrontement, ni à la théorie. L’époque était morte et passait le relais à ce que les politiques appellent sans vergogne « les sociétés apaisées », même si le susdit apaisement est aujourd’hui en train de leur péter à la gueule, et par des voies dont ils n’auraient jamais soupçonné qu’elles puissent être dangereuses.
La fête promise était donc remise aux calendes grecques des illusions et le romantisme du non-travail écrivait le dernier vers de son dernier sonnet.
Les hommes de bonne volonté, un à un, se séparèrent et passèrent sous les fourches caudines du salariat. Sanguinetti se reconvertit dans les affaires immobilières, tous les copains trouvèrent un boulot et fondèrent une Rome à eux.
Je me fis dix ans durant marchand de bois avant de sombrer fonctionnaire et d’attaquer le XXIe siècle loin des préoccupations subversives.
In fine, je ramassai quelques affaires et partit en exil...
Guy Debord, lui, se suicida en novembre 1994. Ses livres sont des livres difficiles. Georges Monti, avec lequel il eut des contacts pour l'édition d'un de ses livres, me disait il y a quelques années que peu, finalement, sont ceux qui ont compris, aujourd’hui encore, La Société du spectacle. Debord, en dépit de quelques erreurs ponctuelles de jugement, n’en reste et n’en restera pas moins un des penseurs les plus clairvoyants, les plus brillants de la fin du XXe et un des plus influents, tellement que ses pires ennemis ont été contraints d'utiliser ses travaux pour les détourner à leurs propres fins, en les séparant de la totalité sociale à laquelle ils s’attaquaient.
Tout cela peut sembler scandaleux mais il n’y a pourtant là rien qui ne soit du ressort de la logique historique. Debord a été dévoré par le monstre qu’il avait si bien identifié et fait sortir de sa cage : le mensonge spectaculaire, dont le rôle est de fabriquer le monde sur un mensonge global fait d’une infinie quantité de vérités partielles. Sa récupération participe donc de cette construction parcellarisée, de cette mosaïque de contre-vérités qui forme un Tout véritable, un peu comme les touches multiples de l'impressionniste donnent, en prenant deux pas de recul, un vrai paysage. Réifié, tout comme l'environnement vital où doit s'exercer notre pensée.
L’État a ainsi racheté toutes les archives de Guy Debord et lui a consacré une exposition du meilleur genre en 2009, à lui qui avait écrit :
Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises.
C'est donc dans ce monde que nous vivons, un monde où « mentir est superflu puisque le mensonge est devenu vrai » Günther Anders - L'obsolescence de l'homme, (1956) -
Et c'est, à mon sens, ce que nous devons toujours avoir à l'esprit pour comprendre les moments chaotiques que nous avons aujourd'hui à traverser.
*
Illustration du haut : Jean-Claude, mon frangin et mézigue en Pologne en juillet 2006... Commentaire acide de J.C quand il a vu la photo : Le Politburo ! :))
16:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, politique, histoire, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.12.2015
A califourchon sur deux siècles - 2 -
 La part du comment on a été construit par rapport au comment on s’est construit, constitue un propos suranné, aussi vieux que le sont les œufs de Pâques, et, conséquemment, une bien vaine écriture.
La part du comment on a été construit par rapport au comment on s’est construit, constitue un propos suranné, aussi vieux que le sont les œufs de Pâques, et, conséquemment, une bien vaine écriture.
Certes, mais l’important n’est pas tant de dire des choses nouvelles que d’en dire d’anciennes sous un autre angle de vue et, surtout, pour de nouvelles et ponctuelles raisons.
C’est donc le désordre guerrier du monde, dont nul ne sait l’ampleur de la catastrophe qu’il nous réserve, à nous ou à nos enfants, et l’approche sensible et intellectuelle que j‘ai de ce désordre explosif, qui m’invite à m’interroger sur certaines de mes dispositions sensibles et cérébrales, si tant est qu’elles soient dissociables. Je n’en sais foutre rien et je m’en bats l’œil.
Toujours est-il que je pense et ressens aujourd’hui des choses qui n’avaient jamais encore fleuri dans mon jardin et force m’est alors de constater que ce que j’entends d’à-peu-près sain encore vient de sensibilités qui m’ont toujours été contraires. Peu importe le pourquoi et peu importe le degré de leur sincérité, dont je doute beaucoup. Pour l’heure, là n’est pas mon propos.
Alors de deux choses l’une : soit j’ai vécu la tête à l’envers, soit je ne comprends rien aux stratégies qui s’opèrent autour de la dégénérescence actuelle.
En tout cas il y a quelque chose qui ne colle pas et, à l’évidence, le XXIe siècle débutant ne peut en aucun cas se penser avec les armes intellectuelles du XXe. Beaucoup de rôles se sont inversés et ce ne sont pas les idées réactionnaires qui nous ont conduits au chaos - même si elles ne nous ont pas amené un monde plus juste et plus fraternel - , mais ce sont bien les idées progressistes, les idéologies du plus juste, les athéismes militants, les laïcités hurlées comme de derrière un étal de poissonnier, qui ont construit cet univers glauque, peu sûr, violent, inique, sans aucune culture ni poésie qui vaillent, et qui, j’en ai bien peur, nous mène tout droit à la guerre et à la mort.
J’y reviendrai dans le détail, après un rapide coup d’œil sur l’histoire de mes partis pris.
Le déterminisme n’existe pas, les déterminants si. Ce qui signifie que les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets selon les individus. Chacun, avec les moyens du bord et les circonstances particulières de sa vie, fait de son bagage telle chose ou telle autre, parfois contraires avec un même bagage. De plus, dans un bagage, il y a mille et mille effets, insignifiants, à peine perceptibles. Il n’y a donc pas de science exacte pour expliquer le pourquoi d’un individu, sinon pour les psys, les juges, les travailleurs sociaux, les flics, les politiques de basse besogne et la piétaille bêlante qui les suit aux talons.
Chez moi, fort des courroux maternels à l’encontre du corps social et comprenant que j’étais né pauvre et que sans doute je le resterai, tout de suite, la défense de la veuve et de l’orphelin m’est devenue constitutive. Je me souviens très bien de la gueule des copains de collège quand je leur ai annoncé que je me sentais communiste. Ce qui voulait simplement dire contre les riches et, les riches, chez nous, c’étaient avant tout des commerçants. Or, pour la plupart, les parents de mes petits copains de collège avaient pignon sur rue !
Au lycée tout ça s’est confirmé mais, vers la terminale, en rejetant fermement les communistes avec la prise de conscience des ravages de l’idéologie et des politiques staliniennes. Je me suis alors affiché gauchiste, ai renversé les chaises et les tables au printemps 68 et participé activement aux Comités d’Action Lycéens. Je me suis même pendant quelques mois fourvoyé chez les trotskistes de la ligue communiste révolutionnaire. Mais déjà en rigolant, pas sérieusement du tout, en voici un élément de preuve : ces corniauds m’ayant expédié à Paris pour assister à une grand’ messe à la Mutualité, voilà que je rencontre en chemin une douce égérie, que je reste avec elle les deux nuits que j’aurais dû passer à prier pour la Révolution permanente et que je reviens en disant que l’auto-stop n’avait pas marché...
Mentant, donc, comme on ment à une autorité à qui l’on a désobéi. A vingt ans, la métaphysique d’une touffe de poils est bien plus convaincante et réjouissante que celle du Grand Soir, et il devrait, d’ailleurs, en être ainsi à tout âge…
Ce fut le déclic !
Tout cela m’est apparu comme une vaste mascarade. D’ailleurs, le monde idéal auquel rêvaient ces militants des différents groupuscules férus de centralisme démocratique, me semblait aussi moche, pire peut-être même, que celui dans lequel je pataugeais. On n’y parlait en effet que d’ouvriers, que d’usines, que du travail béni comme la vertu des vertus et, moi, j’abhorrais foncièrement tout ça. Je voulais être un joyeux fainéant, je voulais vivre la vie à fond, mais pas sur l’échelle mobile des salaires.
En plus, ayant été amené quelque temps à travailler en usine, je vis avec effroi que les gars là-dedans étaient heureux comme des papes, cons comme des paniers, jouaient avec passion au tiercé, votaient Pompidou et ne demandaient aucunement à ce qu’on vînt les tirer de leur « galère » !
Le rejet de toute cette extrême gauche politicarde fut cependant assez violent. Les gars avaient de la graine de Trotski dans le cerveau et ceux qui sortaient de chez eux en claquant la porte de gauche étaient forcément considérés comme des anars, honnis de leur mentor historique, le vieux et furieux Léon, qui planta son couteau déjà maculé de sang dans le dos de Nestor Makhno et de ses camarades.
Le reste du parcours, ce furent les turbulents et incisifs situationnistes, les anarchistes gais et brouillons, les amis, les vrais, les grands, les fraternels, mais déjà nous ne nous occupions plus guère des débats publics et ne fomentions plus de projets oiseux.
D’ailleurs, le sacro-saint prolétariat était en train de disparaître des paysages, au profit des chemises blanches des financiers et des fabricants d’images de l’existence. Lentement, tout doucement, d’imperceptible façon encore, le monde se dirigeait vers le XXIe siècle et c’est ce que même le rusé Debord n’avait su entrevoir.
Il avait bien défini l’image et la représentation dévorant le réel au point de se substituer bientôt totalement à lui, mais il n’avait pas vu que « la classe ouvrière » n’aurait pas sa place dans le monde du réel inversé et de la dictature de l'apparence, mouvements qu’il avait pourtant si intelligemment théorisés.
En conciliant la critique du capitalisme héritée du mouvement ouvrier anti-bureaucratique et anti-stalinien et la critique de la vie quotidienne issue des avant-gardes de l’art, tel le lettrisme, les situationnistes faisaient encore la part trop belle au vieux concept de prolétariat, comme classe laborieuse, alors que celui-ci entonnait déjà les premières notes de son chant du cygne.
En un mot comme en cent, le XXIe siècle s’annonçait par murmures subtils et ils usaient encore des concepts du XIXe ! C’est, à mon sens, la raison pour laquelle, dès 1972, ils étaient épuisés et que nous fumes quelques-uns, quelques-années après, à nous en détourner, tout en conservant ce qui nous semblait la meilleure part de leur héritage.
18:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, histoire, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.11.2015
A califourchon sur deux siècles - 1 -
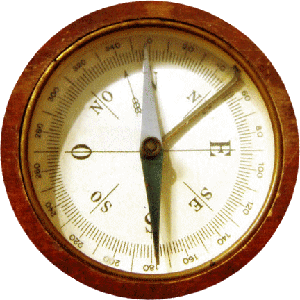 Peut-être tout a-t-il commencé par ma mère qui n’aimait pas De Gaulle.
Peut-être tout a-t-il commencé par ma mère qui n’aimait pas De Gaulle.
Dans Le Silence des chrysanthèmes, autobiographie impure, j’avais cependant forcé le trait, par goût et jeu littéraires. Car sans doute n’était-elle même pas de gauche. Elle devait se soucier d’ailleurs comme de Colin Tampon d’appartenir à tel ou tel système de pensée partisane ; de ces systèmes qui vous handicapent le cerveau au point qu’il ne peut plus faire semblant de tourner rond que soutenu par ces béquilles qu’on appelle par bêtise et orgueil, des idées.
Ma mère aimait la vie, elle aimait passionnément la vie, et cette vie ne lui donnait pas tout ce qu’elle eût désiré qu’elle lui donnât. Elle était donc, comme beaucoup en ce domaine, une amoureuse éconduite : l’argent manquait cruellement, la campagne devait lui sembler profondément ennuyeuse et habitée par des rustres qui ne connaissaient rien ni aux amours ni aux chansons, son mari avait pris la clef des champs, ses deux premiers fils étaient soldats, l’un dans l’armée de l’air, l’autre chez les fantassins, et menacés ainsi de s’aller faire tuer bientôt sur les sables maudits de l’Algérie.
Tout cela, pêle-mêle, ressenti directement et non passé au crible de la réflexion critique, suffisait amplement pour que la représentation suprême du pouvoir coercitif soit honnie.
A propos de la guerre d’Algérie, d’ailleurs, elle aurait dû, sur ce sujet majeur, en vouloir beaucoup plus à un certain Mitterrand, ministre des Affaires étrangères de la république précédente, qu’à De Gaulle. Comme quoi rien n’était clairement défini et que tout était mal ciblé.
Au même titre, en descendant dans la hiérarchie où elle était directement confrontée aux prérogatives des diverses branches de l’organigramme social, elle n’aimait pas le maire, le juge de paix, le curé, les gendarmes, le garde-champêtre, le notaire, l'huissier de justice - le plus abhorré de tous - et l’épicier. Il n’y avait guère que le facteur qui était à l’abri de ses foudres, sans doute parce qu’il apportait régulièrement dans sa sacoche de cuir les beaux billets tout neufs des allocations familiales.
L’instituteur également avait droit à son indulgence. Et ça, c’était peut-être pour deux raisons. D’abord parce qu’il n’était pas en excellents termes avec le curé et aussi parce que, elle, elle avait été reçue première du canton au certificat d’études, qu’elle aimait écrire de belles pages sans ratures, qu’elle avait une orthographe soignée et que ces différentes dispositions lui venaient pour partie d’un instituteur gardé intact dans sa mémoire. Idéalisé, à n'en pas douter.
Tout cela me tint donc lieu, en filigrane, de panneaux indicateurs posés sur la route de mes premiers pas et je me suis, je le crois aujourd’hui, dès lors retrouvé à marcher en m’appuyant sur eux comme sur les témoins d'une science exacte, alors qu’ils n’étaient que les réflexes particuliers du ressenti particulier d’un individu autre que moi-même.
Si j’ai très tôt balancé au fossé la plupart de ces panneaux, les plus simplistes, le fil directeur ne m’en est pas moins resté en profondeur et, par-dessus tout, la raison mal conceptualisée de leur raison d’être : cet amour surfait, irraisonné, naif, de la vie.
C’est avec ce genre de cadeau dans la musette qu’on marche forcément au-devant des grandes déconvenues et, donc, qu’on s’engouffre, par l’effet d’un miroir trompeur, vers une sympathie plus ou moins manifeste pour tel système de pensée et vers le rejet systématique d’un autre.
Ce sont les causes, du moins celles qui sont accessibles à mon entendement présent, de ces fourvoiements et de ces égarements - qui ne furent pas tous pénibles, loin s’en faut, beaucoup même ayant été vécus avec joie - que j’aimerais, pour ma délectation, mettre au jour.
Pour se raconter, il n’est jamais trop tard dans une vie, surtout dans un monde qui, de toute évidence, va tout droit au chaos parce que les idéologies - les idées - des uns comme des autres, qui semblaient irréconciliables, ont fini par copuler dans le lit d'une ignoble dialectique, pour concevoir un mélange dévastateur, que nos propres idées, tout à leur orgueil d’idées, n’ont nulle part su voir venir.
12:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.11.2015
Un philosophe mort bien longtemps après la philosophie
 Dans quel abominable désert de la pensée vivons-nous donc ! Dans quelle idiotie lénifiante évoluons-nous ! Dans quel vide sidéral sommes-nous contraints de chercher à nous exprimer !
Dans quel abominable désert de la pensée vivons-nous donc ! Dans quelle idiotie lénifiante évoluons-nous ! Dans quel vide sidéral sommes-nous contraints de chercher à nous exprimer !
C’en est tout simplement effrayant !
Le « philosophe » André Glucksmann est mort. Destin normal de tous les hommes en leur condition de mortel. La mort est en soi un drame. Une infinie tristesse.
Mais de grâce, qu’on se taise et qu’on n’encense pas celui-ci plus que n’importe quel quidam de mes campagnes ! En rien, il ne l’aura mérité.
Quand j’entends les éloges de Hollande, de Valls et de Macron, j’en frémis d’horreur et je mesure toute la pauvreté stéréotypée de ces gens de pouvoir ! Je vois quels étudiants besogneux et sérieux, premiers de la classe et lèche-cul pétant dans la soie, ils ont dû être, cherchant partout un modèle pour formater leur cerveau désespérément stérile de toute originalité et de toute initiative poétique.
Glucksmann anti-totalitaire ! Quelle belle affaire ! Quelle découverte et de quelle témérité il faut faire montre pour être un anti-totalitaire ! Quelle brillante et audacieuse personnalité !
Trouvez-moi un homme qui ne se dise pas contre le totalitarisme ! Si tous avaient alors la prétention d’être écrivains-philosophes et intellectuels engagés, il ne resterait plus grand monde pour faire autre chose !
Rappelons alors, en guise d’oraison funèbre, que Glucksmann tire sa première notoriété d’un livre où il dénonçait - fort tardivement car il était déjà à l’aube de la quarantaine - les crimes du Goulag et le totalitarisme des systèmes dits communistes, après avoir été pendant des décennies un maoïste pur et dur, intransigeant, partout où il avait l’occasion de le faire savoir !
La cause du peuple, ça vous dit quelque chose ?
Nous qui ne sommes pas des philosophes, nous qui n’avons pas emmené Sartre et Aron la main dans la main chez Valéry Giscard D’Estaing, nous qu’on n’a jamais invités à venir s’exprimer sur un plateau de télé ou derrière le moindre micro de radio, nous que les grands éditeurs ont toujours refusé de transmettre, nous qui mouront sans un mot gentil jeté sur notre sort, nous avons dénoncé avec force et combats tous les stalinismes, sous quelque forme qu’ils se soient manifestés, de Staline, Mao, Trotski, Kamenev, Duclos, Geismard, à Sartre en passant par Aragon, et même Glucksmann et tutti quanti, alors que nous n’avions même pas encore vingt ans !
Nous nous sommes battus dur contre tous les groupuscules dits révolutionnaires et qui ne faisaient que chanter la messe marxiste-léniniste à une époque où Glucksmann en était un grand prêtre, voire un évêque, de cette grand’messe du mensonge collectiviste !
Nous lisions Debord et Vaneigem, crachions sur la Révolution permanente et levions, dans des tavernes obscures, à Barcelone, Amsterdam, Paris ou Hambourg, nos verres à la mémoire de Nestor Makhno, quand Glucksmann avait les yeux rivés sur Pékin, brandissait encore le petit livre rouge et décortiquait Lénine !
Nous servira-t-on après ça, ce genre de salades : que nous avons mis « notre formation intellectuelle au service d’engagement public pour la liberté »(Hollande), que « nous guidions les consciences", (Valls), que « nous avons fait partie de ces philosophes courageux qui ont éclairé très tôt… et blabla blabla » (Macron) ?
Mon dieu, quelle horreur d’avoir passé sa vie dans l’erreur pour finir encensé par des menteurs aussi creux !
Nous, nous étions du côté de nous-mêmes, des vauriens, des loosers, de la racaille et des poètes enivrés…
Des anarchistes toujours trop en retard, mais arrivés partout avant tout le monde. C’est pour cela que nous ne méritons rien et que nous ne sommes pas peu fiers du mépris formulé à notre adresse par les gens du pouvoir et leurs acolytes, les penseurs à la gomme.
Un seul de leurs compliments anéantirait tout ce que nous avons pu trouver de joie et de vérité sur le chaos de notre chemin !
Glucksmann aura passé sa "carrière", tout comme son compère Lévy, à énoncer des suites interminables d’erreurs lamentables et à contretemps – les Serbes, le Kosovo, Poutine, le soutien à la guerre en Irak, le soutien à Sarkozy, etc – mais il aura réussi à faire passer ses apostasies intellectuelles successives pour autant de nouveaux chemins de Damas, soudainement ouverts sous ses pas !
Certes. Ils furent et sont encore des milliers et des milliers comme ça !
Mais quelle tristesse puante que de voir les socialistes qui vous gouvernent, ceux qui vous font cracher l’impôt, lui lécher d'aussi indécente façon le linceul !
La nullité d'esprit rendant hommage à l'esprit de nullité !
Ce monde est bien misérable et peu sont encore les hommes qui prennent la peine d’en souffrir !
14:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.11.2015
D'une langue l'autre
 La route accompagne la forêt, mais d’un côté seulement. De l’autre, s’étirent des prairies et des chaumes ravinés de pluie sur lesquels le vent bouscule des herbes folles, jusqu’aux lisières d’une autre forêt.
La route accompagne la forêt, mais d’un côté seulement. De l’autre, s’étirent des prairies et des chaumes ravinés de pluie sur lesquels le vent bouscule des herbes folles, jusqu’aux lisières d’une autre forêt.
La même, en fait.
Nous ne savons même plus quand nous traversons des clairières. Nous ne savons même plus donner leur juste nom aux paysages. C'est que nous sommes trop grands pour ça ! Nous avons d’autres soucis. Nous sommes des gens sérieux !
C’est un bel endroit pourtant et le soleil, entrecoupé de gros nuages blancs, se balade au-dessus.
Il déboule sur ma droite. Il a surgi de la profondeur des pins. Il est impressionnant. Avec une couronne royale, superbe, large, qui s'étale sur sa tête. Et il court très vite, l’autre limite de la forêt en point de mire. La clairière doit lui sembler bien immense ! Comme si l'horizon reculait sans cesse. Comme dans les mauvais rêves.
C’est un cerf. Puissant, roux, les naseaux au vent.
Je m’arrête. Nous le suivons des yeux. Il disparait bientôt dans l’ombre des sous-bois lointains. Enfin chez lui.
La lumière arrosait sa robe.
Jeleń. Le cerf. Un faux ami. Pas l’animal, mais le mot qui le désigne aux hommes. Sa prononciation, yélègne, me l’a souvent fait confondre avec l’élan, autre grand cervidé parcourant ces forêts humides de la proche vallée du Bug. L’élan, c’est łoś. Rien à voir.
Et ce jeleń, ce cerf, est un mot qui n’est pas très gentil pour les Polonais. Car il désigne aussi, appliqué aux humains, celui qu’on peut rouler facilement ou qu’on se propose de rouler dans la farine. L’ingénu. La proie facile des malfaisants.
Je cherche pourquoi. Sans résultat. Un équivalent peut-être en français ? Oui. Il faut, dans ce cas-là, traduire le cerf par pigeon.
J'illustre. Il y a quelques décennies, en virée quelque part dans le Lot avec trois copains de mon joyeux acabit, nous cherchons une auberge et nous la trouvons bientôt, douillettement ombragée par de vénérables arbres… Avec un ruisseau qui gambade en son jardin. Charmant, tout ça. Exactement ce qu’il nous faut. Oui, mais l’’enseigne, qui se balance sous la brise d’été, grince : Aux quatre pigeons… Moues dubitatives. Ça tombe mal : nous sommes quatre et l’un de mes compagnons de marmonner, au moins, ils annoncent la couleur !
Ici, c’eût donc été Aux quatre cerfs. Aucun sens détourné, aucune évasion allégorique possible. Ou alors une auberge pour des cocus. Quatre cocus en vadrouille cherchant à noyer leur chagrin dans le fond des verres.
Et oui, je suis cocu, j’ai du cerf sur la tête, chantait Brassens…
Quel écart, donc, entre les images-raccourcis d’une langue à l’autre ! Une vision différente du monde. Une imagerie de l’imaginaire sans rapport l’une avec l’autre.
Mais j’insiste :
- Pourquoi un cerf ?
- Et pourquoi donc un pigeon ? me rétorque-t-on avec juste raison.
- Je n’en sais ma foi rien. Je consulterai les dictionnaires.
Et je n’apprendrai alors que d’insipides évidences. Plumer un pigeon, vieille expression du XVIe, pour dire duper. Rideau. Ces dictionnaires ne semblent pas en savoir plus long que moi. Sinon qu’il y a aussi le dindon. De la farce, le plus souvent. On peut aussi plumer un dindon, c'est bien vrai ; surtout si on se propose de le bouffer. C’est d'ailleurs fortement conseillé.
Plumer un cerf me semble plus délicat....
Tout cela ne me construit donc aucune passerelle entre le cerf polonais et le pigeon français. Chaque langue a-t-elle ses propres transpositions anthropomorphistes ? Sans doute.
J’en conclurai donc plaisamment que dans un couple franco-polonais - je dis ça au hasard, bien sûr - si on laisse se répandre l’ennui, par exemple, alors, le pigeon serait celui auquel on planterait du cerf sur la tête.
Mariant ainsi les deux langues dans l’infortune.
14:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.11.2015
Les mouches à merde

Si les meurtres de janvier restent une abomination, ce qui s’en est suivi a toujours été pour moi, et pour beaucoup d’autres, une macabre mise en scène de comédiens dégueulasses et pourris jusqu’à la moelle.
D’ailleurs, si les bourreaux m’écœurent, les victimes, elles, me dégoûtent comme me dégoûtent toutes les mouches à merde qui s’engraissent en permanence du jus dégoulinant des cadavres.
Liberté d’expression, que de saloperies commises en ton nom par des gens fortement engagés dans une direction qui, elle, ne veut justement pas dire son nom !
Tu veux la connaître cette direction, connard ? Alors reprends toutes les insultes proférées par ces manipulateurs de la dérision depuis une trentaine d’années et trouve qui manque à l’appel ; trouve qui n’a jamais été égratigné par la moindre virgule dans leurs colonnes mercenaires !
Aujourd’hui, ces mouches à merde s’en prennent au crash de l’avion russe et rigolent comme des monstres sur plus de deux cents personnes lambda écrasées au sol !
Puisse leur rire les étouffer bientôt jusqu’au dernier !
Moscou s’insurge à juste titre et les mouches à merde d’ânonner, comme des machines bien huilées, c’est parce que vous êtes un pays totalitaire alors que nous, dans notre belle France, on a le droit de dire ce qui nous passe par la tête… Enfin, quand ils disent tête, il faut entendre, en fait, porte-monnaie…
Honte au gouvernement français, à son premier ministre, et à cet abominable président de n’avoir pas même un mot de réaction indignée et de compassion pour les victimes du crash, salies par la bave de ces crapauds !
Liberté d’expression ? Mon cul !
C’est tout de même répugnant que ce gouvernement qui vient de faire adopter une loi sur la surveillance des communications venant de ou partant vers l’étranger – donc aussi les miennes a priori - laisse ses suppôts dégueuler les pires insanités ! Salauds, va !
Un dernier mot pour rappel : lors du carnage de janvier, l’urgentiste pleurnichard, là, je ne me souviens plus de son nom d’merde, présent sur les lieux, avait téléphoné aussitôt à Hollande pour lui dire le désastre.
Vous en connaissez beaucoup, vous, qui ont le numéro de portable du président dans leur répertoire ?
Ces nécrophages rampants sont de lâches agents du pouvoir, porte parole, en autres, de la phobie anti-russe de ce gouvernement d’incapables et de sournois !
Tout comme leurs acolytes de France 2, eux œuvrant sur le registre sérieux et professionnel, qui programment un documentaire sur Staline et, aussitôt après, une émission sur Poutine.
Intérrogés, ces gens sans aveu de dire : pur hasard.
Imagine un peu un documentaire sur Hitler, immédiatement suivi d'une émission sur Angela Merkel. Quel tollé indigné de ce nid de rats qu’on appelle encore « la présidence de la république ! »
Non, je déconne, en fait. Ceci eût été impossible, la censure de la liberté d’expression aurait en amont veillé au grain…
13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture, politique, histoire, parti socialiste | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.11.2015
Aux frontières de l'absurde
- Passeport, s’il vous plaît…Hum… Voyons voir…Quelle est votre profession ?
- Poète, monsieur. Comme indiqué sur le document.
- Poète ?!? Mais c’est pas un métier ça !
- Comment ça, c’est pas un métier ? C’est comme ça en tout cas que je gagne ma vie. Donc, c'est mon métier.
- Vous vendez vos poèmes ?
- Je les chante, plus exactement..
- Ah ! Je vois. Vous êtes un chanteur ?
- Disons que je suis un poète-chanteur
- Alors pourquoi n'en est-il pas fait mention sur votre passeport ?
- Parce que c’est plus important pour moi d’écrire que de chanter. Si je n’écrivais pas, je ne pourrais pas chanter, Ça tombe sous le sens.
- Admettons. Et qu’écrivez-vous exactement ?
- Des poèmes, bien sûr.
- Mais ils disent quoi, vos poèmes ?
- Un poème ne dit jamais rien, monsieur. Il suggère.
- C’est curieux… Et ils suggèrent quoi, vos poèmes ?
- L’amour, l'égalité, la fraternité...
- Hahaha ! Ils doivent être très courts !
- Ah, monsieur a de l’humour et s’y connaît un peu !
- Non, pas du tout. Je sais simplement qu’on en a vite fait le tour, de ces balivernes. Chez nous du moins.
- Charmant pays, ma foi !
- Tout autant que le vôtre, monsieur. La preuve, vous voulez y entrer.
- Pour chanter seulement.
- Pendant huit jours, si j’en crois votre visa.
- Oui.
- Hé ben… Ça n’intéressera pas beaucoup les gens, vos poèmes chantés.
- Comment pouvez-vous le savoir ?
- Parce qu’ici on ne chante pas le superflu. On célèbre le nécessaire.
- Vous trouvez que c’est superflu, l’amour et la fraternité ?
- Superflu de le chanter, oui.
- Et pourquoi donc ?
- Parce que les gens amoureux et fraternels ne le chantent pas. Ils le vivent.
- Tiens, c’est une façon de voir les choses. Un peu bizarre, mais bon…
- Mais, dîtes-moi, monsieur le troubadour : Un poète ne chante-t-il pas ce dont il est privé et qu’il espère ?
- Heu.. Si. Enfin... Oui, ça arrive, effectivement. Il sublime, disons.
- Ben alors, vous voyez bien ! Si vous aviez tout ça à vivre, votre égalité, votre fraternité, vous n'auriez nul besoin de le chanter ! Et les gens auraient encore bien moins besoin de vous écouter !
- Parce que chez vous les gens sont fraternels, peut-être ? Hein ?
- Oui, bien sûr, qu'ils le sont. C’est la loi.
- La loi ?!!! Mais, la fraternité…
- Vous êtes un sauvage, mon brave homme. Vous rêvez à des hommes fraternels sans une loi pour les y contraindre ?
- Heu… Oui… C’est même exactement comme ça que je vois les choses.
- Hé ben ! Ils doivent être complètement idiots vos malheureux poèmes ! Chez nous, la dictature est fraternelle et solidaire.
- Je meurs ! Une dictature fraternelle !
- Votre démocratie l’est-elle plus ?
- Heureusement que oui ! Hahaha !! En tout cas, les hommes ont le droit de penser et d'écrire ce qui leur chante.
- De penser, ça, tout le monde peut le faire. Ici aussi, on a le droit de penser. Ça ne mange pas de pain, comme on dit chez vous. Mais de vivre leurs pensées, ils ont le droit, chez vous ?
- Ça dépend.
- Ça dépend de la pensée, sans doute ?
- Oui, un peu quand même.
- Et qui détermine si les pensées sont bonnes ou mauvaises à penser ? Si elles ont le droit de vivre ?
- Le bien commun, la tranquillité commune, le "vivre ensemble"...
- Et qui décide de tout ça ? Qui donne forme à vos abstractions ? Parce que ce ne sont là que des abstractions, mon brave...
- La logique humaine.
- Ah, c’est un régime philosophique ?
- Non ! Enfin...C’est la majorité qui décide.
- Et la minorité, elle fait quoi ?
- Elle…Ben… Je ne sais pas. Elle se plie aux avis de la majorité.
- Elle se plie.. Tiens, tiens...En effet, vous avez bien besoin de chanter la fraternité, poète ! Parce que la vie ne doit pas être rose pour tout le monde chez vous-autres !
- Et alors ? Bon sang de bonsoir! C’est ça, la démocratie ! Chez vous, c’est une poignée qui décide, sans doute, qui décrète, qui…
- C’est une poignée qui est la majorité, oui. Tout le reste est la minorité. Pourquoi tenez-vous absolument à ce que la majorité soit plus nombreuse que la minorité ?
- Mais c’est absurde ! Ne serait-ce que dans les termes !
- C’est absurde, oui. Vous ne saviez pas que vous veniez chanter dans un pays absurde ?
- Non.
- Alors, je ne puis autoriser votre séjour, mon cher. Ici, l’absurde fait partie de notre fraternité solidaire.
- Ah ben ça alors !
- Qu'est-ce qui vous étonne ? Comme chez vous, mon brave !
- Comment ça ?
- Si je vais chanter chez vous que la majorité doit être éliminée et que la minorité doit être au pouvoir, ne m’expulsera-t-on pas pour subversion ? Du moins ne m'interdira-t-on pas de chanter, encore que sous un prétexte fallacieux ?
- Si. Peut-être. Enfin... En tout cas, on ne vous écoutera pas.
- Hé bien là non plus, on ne vous écoutera pas. Séjour inutile, donc. Veuillez repasser par là, monsieur. Tenez, votre passeport. Bon retour en démocratie! Et apprenez au moins à écrire des choses qui ont du sens, au lieu de réciter les messes de vos chefs majoritaires ! Au suivant !
- Ah ben ça, alors !
13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET




















