04.01.2013
André Hardellet, Julien Gracq, Brassens...
 Face aux poètes et aux grands écrivains, la justice avec un j minuscule, celle des grands de ce monde, de la propriété privée, de la magouille légale justifiée et cautionnée par la morale coercitive judéo-chrétienne, s’est souvent ridiculisée.
Face aux poètes et aux grands écrivains, la justice avec un j minuscule, celle des grands de ce monde, de la propriété privée, de la magouille légale justifiée et cautionnée par la morale coercitive judéo-chrétienne, s’est souvent ridiculisée.
Deux cas d’école viennent évidemment directement à l’esprit, Les Fleurs du mal, condamné pour «offense à la morale religieuse, outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs» et Madame Bovary, également poursuivi pour «outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs».
Retenons tout de même que Flaubert fut relaxé, en grande partie grâce à ses appuis politiques. Comme quoi, du XIXe au XXIe siècle, vraiment rien de nouveau sous le soleil de la combine…
On connaît donc ces deux cas parmi d’autres, multiples, mais peut-être connaît-on moins celui d’André Hardellet, condamné aux mêmes motifs en 1973 pour son roman Lourdes, Lentes, un livre généreux et tendre sur les phantasmes sexuels d’un jeune garçon, très bien écrit, dans un cadre campagnard bien dit.
Ce fut une condamnation honteuse, sous le regard indifférent d’un Président de la République à la gomme, qui se faisait pourtant gloire d’avoir écrit, ô misère, une Anthologie de la poésie française !
Hardellet, dont Breton, Pierre Mac Orlan et son ami Julien Gracq disaient le plus grand bien, ne se remit pas de cette condamnation infâme, déplacée, injustifiable : il mourut l’année suivante. Même amnistié par l'arrivée du Président tête de noeud.
Hardellet et Georges Brassens éprouvaient l’un pour l’autre une très grande estime. Compagnon de ce dernier, Mario Poletti (que j’eus l’heur de rencontrer deux fois à Vaison-la-Romaine), raconte dans son livre très bien documenté Brassens me disait :
« […] en juin 1974, André Hardellet me rend visite aux éditions Plon. Son visage est marqué par sa condamnation. Il me demande de lui fournir le livre La Vie après la mort, en vogue à l’époque. Quelques jours plus tard il disparaissait… »
Là, la justice ne s’était donc pas seulement ridiculisée : elle avait tué par procuration. Mais il est vrai que le ministre de l’intérieur à l’origine de la procédure, un grand salaud de première catégorie, Raymond Marcellin, avait été salué par De Gaulle à son arrivée au ministère de l’intérieur en mai 68 - en remplacement de Christian Fouchet - par un retentissant : Enfin Fouché, le vrai ! En référence à l’abominable ministre de la police de Napoléon Bonaparte.
Pas toujours très fin, «l’homme providentiel», surtout dans ses conceptions de l’Etat policier.
Il est vrai aussi qu'un peu plus tard, ce Marcellin, cette ordure élevée au pinacle politique, sera pris la main dans le sac à installer des micros au Canard enchaîné. La fameuse affaire des faux plombiers de Marcellin.
A ce procès honteux, donc, d’André Hardellet, étaient venus pour lui témoigner amitié, solidarité et soutien, de nombreux amis, dont Julien Gracq et Georges Brassens.
Rien n’y fit. Pour Marcellin, père spirituel de Charles Pasqua, la poésie et la littérature n'étaient qu'affaire d'anarchistes subversifs et sans doute le fait d’être soutenu par des olibrius pareils était à ses yeux un aveu encore plus fort de culpabilité et de perversité totale de l’esprit.
Avant qu’André Hardellet ne soit appelé à la barre, un autre justiciable avait à répondre de ses actes devant les chats fourrés. Il s’agissait d’un homme qui était intervenu chez une dame en instance de divorce sous une fausse identité d’agent de police, mandaté par son ami, le mari, pour y soutirer je ne sais quoi ou y exercer je ne sais quelle contrainte.
A l’énoncé des motifs de poursuites par le juge, Brassens s’était penché sur l’épaule de Mario Poletti et lui avait murmuré : Ce n’est déjà pas glorieux d’être un flic, mais se faire passer pour tel, c’est bien pire encore !
Les flics, la justice, les poètes, les hommes de cœur et d’esprit ne faisaient pas bon ménage, en ce temps-là... Et quand je vois aujourd’hui les poètes à la ramasse, les artistes de pacotille, les philosophes à la noix, les hommes d’esprit qui ont de tout à revendre sauf de l’esprit, fricoter avec les imbéciles au pouvoir, national ou local, ça me donne envie de gerber ce que je n’ai même pas encore bu.
Ça me donne surtout envie de n'avoir jamais rien de commun ni rien à partager avec tous ces vendus au plus offrant.
Illustration : Hardellet et Brassens pour la sortie en librairie du recueil de poèmes Les Chasseurs deux
10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.01.2013
Chemineaux 52

L’entrée est libre et, si le cœur vous en dit, c’est par ici.
Ce sera un blog à durée déterminée, cette durée déterminée étant le pari que j’ai fait (et proposé à mes deux acolytes) sur sa pérennité. Il voguera pendant les douze mois de cette année avec un texte par semaine, le mercredi, avant de se saborder en décembre.
Si toutefois il ne fait pas naufrage avant. Sait-on jamais… Même quand on pose à sa promenade une limite dans le temps, il arrive qu’une tempête vienne en contrarier la route, n’est-il pas ?
Si vie me prête vie jusque là, je devrais de mon côté venir à votre rencontre encore cette année sur l’Exil des mots, un rendez-vous qui aura six ans en juillet prochain, quand le soleil sera un peu plus haut sur l’horizon du temps qui passe.
Regroupés, les textes mis en ligne en 2012 sont au nombre de 148- remises en ligne exclues - et constituent un fichier de 608 790 caractères répartis sur 211 pages.
Je ne sais pas si c’est beaucoup ou peu. C’est en tout cas ce que j’ai fait et je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être en avez-vous rien à f….
Mais bon…
Cette activité blog est toujours pour moi une source d’interrogation. Je ne sais pas exactement quel en est le but, je ne sais pas quelle est la nature réelle du plaisir que j’y trouve. Existentielle ? C'est toujours ce qu'on dit quand on ne sait pas trop quoi dire. Parce qu'il ne veut rien dire du tout, ce mot. Un raccourci d'imbécile pour faire intelligent.
Il faut pourtant bien que ce plaisir existe quelque part puisque le blog existe. Sans quoi, il y a longtemps qu’il aurait été expédié d’un savant coup de clic dans les poubelles du nul et non avenu. Dans ma vie, je n’ai jamais rien fait longtemps qui m’ait été pénible. J’ai toujours fait le tri et pris la tangente dès que quelque chose devenait un peu lourd à porter.
J’aimeraiS bien, d’ailleurs, que d’autres blogueurs me fassent part de la nature du rapport qui les lie vraiment à leur blog. Je mets évidemment un S gigantesque et conditionnel à mon verbe, car je sais très bien qu’aucun ne se livrera, en tout cas pas à moi ni en public. Et ce, non pas parce qu’ils sont comme ci et comme ça, en tant qu’hommes et femmes - que je ne connais ni des lèvres ni des dents - mais parce qu’un blogueur, c’est comme ça : ça cause mais ça ne se livre point, tout occupé que c’est à alimenter son tonneau des Danaïdes.
Un blog fonctionne comme s’il n’avait pas d’auteur réel, en fait. Pas d’auteur de chair et de sang, avec des joies, des tourments, des détresses, des espoirs, des haines et des amours. Humainement, je veux dire, de cœur, d’être en profondeur, parce que je n’appelle ni haine ni espoir ce qui se situe sur le discours déplorable de la politique ou sur la critique désincarnée, un peu pédante, de tel livre ou de telle autre production de l’art.
Un blog, c’est parfois un nom, une signature. Dans le meilleur des cas, une photo et dans le pire, un à propos aussi lapidaire que bateau, aime la littérature, la musique, la randonnée, le cinéma… Jamais les femmes, ou les hommes, par exemple. Tabou, tout ça. Un à propos, c’est comme une cuillérée de poudre balancée aux yeux pour éloigner les curieux de la vie. Regardez comme j’écris bien, mais je ne vous dirai pas qui je suis. Ça remplit la fonction exactement contraire de sa raison d’être. Et c’est bien normal dans un monde à l’envers, n’est-ce pas ?
Bref, c’est comme ça. A vrai dire, je m’en fiche un peu. Mais c’est la raison principale pour laquelle je ne lis plus que deux ou trois blogs et n’intervient plus guère que sur deux.
Car j’ai désappris à discuter avec les fantômes qui ne m’ont pas été chers de leur vivant.
13:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
31.12.2012
Un conte de noël polonais
 Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison recouverte de neige et balayée par les vents de la plaine ; une maison pauvre, avec des parents pauvres.
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison recouverte de neige et balayée par les vents de la plaine ; une maison pauvre, avec des parents pauvres.
Il croyait au père-noël. Dur comme fer. Une vraie foi du charbonnier, qu’il avait le petit garçon pauvre.
Ainsi chaque année s’appliquait-il à écrire une belle lettre au mythique barbu, une lettre bien tournée, pleine de tendresse. Il décrivait sa maison, la neige, le froid et demandait des jouets, des chocolats, des bonbons. Tout ce qui peuplait ses rêves de petit garçon.
Il partait alors par les chemins ouverts sur les grands champs tout blancs et allait, bravant les blizzards et les tourbillons de flocons, jusqu’à la poste de la ville la plus proche pour y poster sa lettre. Puis il attendait, il attendait… Rien jamais ne venait.
Alors il regardait les nuages, interrogeait le vent et, chagrin, versait des larmes de solitude.
Cependant les employées de la poste, chaque année ouvraient la lettre dont elles savaient bien qu’elle ne trouverait aucun écho. Attendries jusqu’aux larmes, elles décidèrent enfin de se cotiser et d’envoyer dans un joli colis toute la liste des friandises et des jouets auxquels rêvait le petit garçon.
Hélas, hélas ! Inhumaine misère des administrations, le colis mirifique se perdit dans un tri quelconque et ne parvint jamais à son petit destinataire.
Alors l’enfant une fois encore pleura et, l’année suivante, il prit sa plus belle plume, écrivit sa missive et, toujours bravant la neige et le froid, partit la poster :
Mon petit papa noël chéri,
Je sais bien que tu es bon, que tu m’aimes de tout ton cœur et que chaque nuit de noël tu penses à moi. Je n’ai jamais douté de Toi. Mais ce sont ces salopes de la poste qui ouvrent les colis et volent mes friandises et mes jouets. Je le sais bien…
10:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.12.2012
Edito d'une quatrième expérience
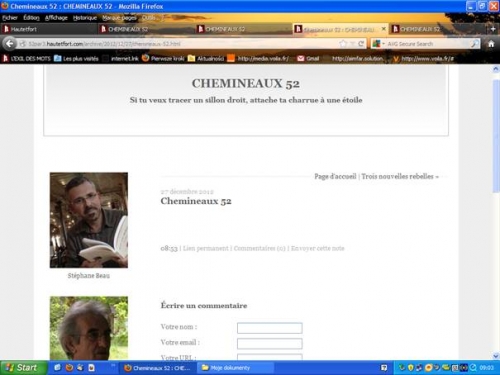 Encore un nouveau blog ! Collectif en plus ! Popopopopopo… !
Encore un nouveau blog ! Collectif en plus ! Popopopopopo… !
Il me semble t’entendre d’ici, lecteur.
Et tu as quelque part un peu raison : dans l’océan multiple, cloisonné, composite, obscur, étal, d’un blog monde où chacun surfe avec plus ou moins de délectation et de bonheur sur sa vaguelette, quelle prétention à l’existence peut bien avoir cette nouvelle goutte d’eau ?
L’ambigüité de la réponse est assez claire : nulle et immense.
Nulle parce que ce nouveau blog, comme tous les autres au demeurant, n’aura jamais l’envergure d’un acte capable d’intervenir favorablement ou défavorablement sur la marche générale des choses.
Immense parce qu’il est un blog né du bon plaisir de ses trois auteurs et que si ce plaisir est assez transparent pour t’en offrir un brin, alors il aura pleinement assumer sa raison d’être.
Les Sept mains, Tempête dans un encrier et Non de non, ont eu cela de commun : les auteurs s’y sont succédé mais deux seulement ont participé aux trois expériences, Stéphane Beau et moi-même.
Aussi avions-nous depuis longtemps l’envie de tenter une quatrième complicité. Mais laquelle ?
Dans ce genre d’entreprise, nous avons pu l’un et l’autre le constater, le prime enthousiasme fait vite place à la lassitude, les textes se font plus rares et plus courts, sont moins originaux, moins travaillés, au fur et à mesure que passe le temps. Un blog collectif meurt souvent de l’épuisement collectif des motivations individuelles.
J’ai donc soumis à Stéphane l’idée suivante : ouvrir un espace à durée déterminée et le faire vivre avec des textes aux fréquences elles-mêmes relativement espacées. J’ai ainsi proposé comme espace temps l’année 2013 et comme fréquences un texte par semaine.
De cheminer, donc, sur les 52 semaines par 52 textes. Le blog portera donc le titre de Chemineaux 52.
Stéphane a émis la réserve, avec juste raison sans doute, selon laquelle ce cheminement tout au long de cette année effectué à deux voix seulement courait le risque de la monotonie. Il m’a alors proposé que notre compère des Trois nouvelles Rebelles, récemment parues aux éditions du Petit Véhicule, Philippe Ayraud, se joignent à nous.
C’est donc les trois auteurs de ce petit recueil qui, l’un après l’autre, du jeudi 3 janvier au jeudi 26 décembre 2013, viendront ici offrir leur écriture en partage.
J’ouvrirai le bal le 2 janvier, jour de la mise en ligne, suivra Stéphane le jeudi 7, puis Philippe le jeudi 14 et ainsi de suite.
A très bientôt, donc, si cela te chante, lecteur. En tout cas, bonne année 2013 à toi, plein de vie, de désirs accomplis et de déboires évités, où que tu sois, qui que tu sois et quels que soient tes sentiments et jugements à mon égard !
Bertrand
12:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.12.2012
Le bonheur, une idée primaire
Dans un monde et une époque - indissociables- où la peur, la tristesse et le malheur des gens sont planifiés en arguments de vente de la politique, seule la volonté, affirmée, réelle et vécue, d'être heureux est subversive.
Le bonheur, c'est le vers dans la pomme.
Hélas quand je regarde en arrière - et c’est souvent - j’aperçois une foule d’incohérences, des kyrielles de non-sens, des tonnes d’absurdités qui encombrent cette recherche primaire, élémentaire, du bonheur.
Et j’en suis, conséquemment, chaque jour plus  amoureux de mon présent. Ce qui, contradictoirement, n’est ni fat ni confortable, la substantifique moelle d’un présent étant son caractère forcément éphémère.
amoureux de mon présent. Ce qui, contradictoirement, n’est ni fat ni confortable, la substantifique moelle d’un présent étant son caractère forcément éphémère.
Quand je regarde en arrière, je ratisse très large : dans ma propre vie d'abord. Dans celle de ceux que j’ai pu croiser et aimer ensuite. Puis, élargissant considérablement le champ de vision, dans ce qui se dit et écrit et s’est dit et écrit, partout depuis des lustres et des lustres quant à la marche aliénée du monde. Disons, grosso modo, au cours des deux siècles d’histoire qui viennent de s’écouler.
En zoomant, je vois le coin de monde que j’habite, la vieille Europe, exprimée dans ma langue, la langue française.
Alors j'entends un inextricable chaos de discours et de déclarations des plus belles intentions ! Je vois et j'entends des combats au corps à corps, des assemblées, des élections, des guerres, des morts, des barricades, des trahisaons, des incendies, des empoignades, des polémiques, des crimes, des attentats, et des livres, des milliers et des milliers de livres.
Tout ça pour un résultat absolument nul : mécontentement toujours aussi général quant aux conditions faites à la vie. Malheur à tous les étages ! Jérémiades à chaque coin de rue !
Il me semble parfois que le hiatus est tellement énorme qu’il ne peut pas être. Trois alternatives s'offrent ainsi à mon âme perplexe :
- soit les hommes sont des impuissants, des larves n’ayant aucune prise sur leur destin,
- soit ils ne sont que des discoureurs sans aucune volonté d’agir,
- soit la recherche du bonheur consiste à être ou à paraître malheureux.
Car comment expliquer autrement l’éternelle défaite du bonheur face au monde réifié ?
Moi, qui ne vaux pas mieux qu’un autre, loin, très loin s’en faut, si je devais ne voir ce monde que laid, qu'injuste et que vilain, si je ne devais pas y vivre pleinement des moments de bonheur intense et être heureux, heureux de vivre avec tout ça, je me suiciderais. Je me tirerais une balle de 9 mm dans la tête. Pas dans le pied, comme le font les désespérés du malheur spectaculaire. Non. Dans la tête. Ce serait une vraie défaite, sans tambour ni trompette. Une défaite courageuse que bien d'autres avant moi ont assumée.
Quelques livres parmi les plus fins de ces deux derniers siècles, l’ont dit : si on veut changer radicalement le monde - car le monde, celui dont on parle, n’est fait, jusqu’à preuve du contraire, que de nous-autres et de nos différences - il ne faut pas s’attaquer par le postillon aux murs de ce monde, il faut se transformer soi-même en combattant.
C'est-à-dire se montrer capable d’exister. Être à la hauteur, dans sa propre vie, dans sa propre chair, dans ses propres désirs, et dans ses propres instants, de l'idée qu'on a de son propre bonheur.
Détruire ainsi l'idée même du bonheur, l'idéologie du bonheur, en étant heureux. Par tout moyen à sa convenance.
Mais il faut pour ce faire être ou devenir vraiment juste avec soi-même, volontaire, désirant, passionné, pas envieux pour deux sous, ni de gloire, ni d’honneurs, ni d’argent et…courageux, le courage étant d’abord celui de refuser d’avoir pieds et poings liés par les misérables acquis de la survie, ce réservoir où sont planifiés les malheurs, la tristesse et la peur.
Le courage. C’est bien cela qui fait défaut aux hommes pour être de sincères chercheurs de bonheur. Il y en eut, des gens comme ça. Trop peu pour que la fourmilière change de sous-bois et cesse sa laborieuse industrie.
Si les hommes arrêtaient de se complaire dans les chaînes de leurs illusions et désillusions quotidiennes, les jetaient aux orties, la fourmilière s’écroulerait d’elle-même. Ils le savent, les hommes.
Mais c’est tellement confortable, des chaînes ! C'est comme des rails pour le train ! Un prisonnier n'a pas d'initiative à prendre : il y a le lever, le café, la toilette sommaire, l'attente de la promenade, le déjeuner sommaire, la promenade encadrée, la sieste, le dîner et la nuit et le lever encore... Rien ne peut arriver de fâcheux à un prisonnier puisqu'on lui a confisqué le courage d'être libre.
Et combien en connaissez-vous, de ces prisonneirs du dehors, qui, pour les seules causes justes qui vaillent et qui sous-tendent toutes les autres, le bonheur, l'abolition de l’ennui, la redécouverte de la jouissance, seraient capables de prendre un train, un avion, la route, le bus, et de foncer loin de leur misère, vers la liberté d’être soi-même, en laissant derrière eux la maison payée à crédit, le p'tit bout de jardin, la bagnole, le quartier, le pays, les amis, la famille, les habitudes, les cotisations-retraite et d’assurances sociales, le chat, le chien, le p’tit bureau peinard et le p'tit salaire qui va avec ? Combien ?
Un ? Deux ? Trois ? Ce serait déjà un miracle. Alors je demande : mais que vaudrait donc une société reconstruite par des hommes qui n'auraient même pas eu le courage d'eux-mêmes, sinon le prix que vaut une société de zombies ?
Et le monde ainsi vilipendé par les chrysalides, toujours avec les mêmes idées, toujours avec les mêmes mots, toujours avec les mêmes slogans, toujours avec la même et fatigante générosité superfétatoire, toujours avec les mêmes peurs, va son bonhomme de chemin en écrasant les bonhommes d'humains...
Qu’il aille ! Je vais le mien. Dans, avec et sans lui.
Image : Philip Seelen
09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.12.2012
L'hiver
Les autochtones eux-mêmes en conviennent, c’est dire ! Avant noël, la neige ici est rarement aussi abondante et aussi constante, quotidienne, que cette année. Mon voisin regarde le ciel toujours prometteur de nouvelles chutes blanches et dit, les mains sur les hanches, hé ben on n’est pas arrivé au mois de 
Et oui, c’est bien ça qui tarabuste l’autochtone pourtant aguerri aux rigueurs de sa latitude. Les grandes intempéries, les couches de neige sans cesse renouvelées, les mercures qui descendent tellement bas qu’on dirait que les thermomètres ont été sabotés, tout cela, quand c’est en janvier, voire en février, on a quand même l’impression que l’on a entamé sa remontée vers le soleil. On a le grand mouvement des choses et ses jeux de lumière dans la tête.
D’accord, dit-on, c’est l’hiver, mais on remonte quand même la pente à chaque aurore qui se dessine en rose au-delà du Bug.
Mais là, on n’en a pas encore terminé de la descente, qu’on a déjà presque un mois de grand hiver dans le dos. Alors, on fait montre d’un certain pessimisme pour la suite de la traversée du tunnel. On craint de n'en voir le bout qu'épuisé.
Le pays se dessine en deux couleurs, noir en haut et blanc en bas. Le vent nous vient de Russie et, sur les routes, ramène la poudre neigeuse qui se faufile entre la forêt gelée et la plaine grande ouverte. Gare aux virages où elle s’entasse, cette neige, gèle et n’est bientôt plus que glace ! Pas trop de place pour la rêverie au volant.
Autour de ma maison, c’est un peu le mythe de Sisyphe. Je creuse, comme tout le monde, chaque matin des allées pour pouvoir vaquer à mes quelques occupations du dehors, je dégage le portail pour pouvoir bien l’ouvrir et accéder à la voie publique, et, au matin, je recommence car la nuit a tenté de tout effacer à la gomme blanche. Les talus de chaque côté de mes allées et venues s’élèvent un peu plus chaque jour. Bientôt, je marcherai entre deux remparts de neige.
J’avais toujours vécu sous les cieux chargés d’embruns, d’iode et de souffle marin. Dès lors, parfois je me dis que même si mes 2500 Km d’exil ne sont pas grand chose au regard des distances planétaires, je ne pouvais pas mieux contraster les climats.
Et j’ai toujours cette impression que tant de neige partout, sur les routes, les champs, les forêts, les sentiers, les maisons, les granges, les cours, les fermes, les trottoirs, les talus, n’arrivera jamais à se dissiper. Que le monde est définitivement livide.
Je sais pourtant la fragilité de cette couverture. Je l’ai vue. En deux jours, tout peut disparaître, comme si cela n’avait été qu’une illusion et la plaine se recouvrir soudain de larges étangs.
Pour l’heure, la blancheur est maîtresse. Pour deux ou trois mois, selon les humeurs à venir des masses d’air et des anticyclones.
La plus longue période enneigée qu’il m’a été donné de vivre ici, avait couru du 28 novembre au 15 mars. Presque quatre mois. Le quart de l’année.
Hum… Même si je trouve ça beau parce que je viens des plages, des algues et des rochers, vient un moment - là comme partout ailleurs et pas seulement en parlant des paysages et des climats mais aussi des hommes, de leur art, de leurs amours et de leurs propos - que le beau qu’on ne voit plus se transforme en laid.
Illustration : photo prise à treize heures, c'est-à-dire soleil au zénith
11:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.12.2012
Du temps où auteurs et éditeurs avaient des couilles
Correspondance entre Georges Darien et les éditions Stock

Monsieur Stock,
Voici deux ans que vous vous jouez de moi.
Au mois de juin de l’année dernière, quand je vous ai vu ici, vous m’avez fait entendre que vous éditeriez L’Épaulette au printemps ; lorsque je vous ai écrit, il y a quelques mois, vous m’avez répondu pour me demander de reparler de la chose en août.
A présent, ce sont de nouvelles défaites ; en voilà assez.
Si je le pouvais, je m’adresserais à d’autres qu’à vous. Malheureusement, c’est impossible, c’est impossible à cause de l’abominable façon dont vous avez publié mes livres précédents ; aucun éditeur ne veut, naturellement, publier un livre de moi et faire la publicité nécessaire alors que vous n’avez jamais, vous, fait un sou de publicité pour mes livres ; les frais qu’il aurait à faire vous profiteraient nécessairement et seraient d’autant plus forts que vous n’avez jamais rien tenté pour me faire connaître du public.
Je suis donc forcé de m’adresser à vous, bien que je sache à l’avance quel traitement m’attend, quoique je sache que mon livre réussira non pas grâce à vous, mais en dépit de vous.
Georges Darien
Monsieur Darien...
Vous êtes un farceur, mais pas un farceur aimable, ce qui gâte tout.
Vous êtes avec cela de la plus grande mauvaise foi, ce qui complique les choses et c’est embêtant.
A la lettre que vous venez de m’adresser, on répond : merde, et c’est ce que je fais.
P.V. Stock
09:00 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.12.2012
Pêle-mêle

Son opposant principal, le nationaliste, populiste, réactionnaire Jarosław Kaczyński, déclarait hier qu’il y a certaines similitudes entre le 13 décembre 2012 et le 13 décembre 1981, jour de l’état de guerre décrété en Pologne et dont je vous parlais dans mon billet précédent.
Un journaliste demandant à Donald Tusk ce qu’il pensait de cette nouvelle extravagance mentale de son adversaire, celui-ci a répondu en substance :
- Il a raison. J'y vois une grande similitude. Le 13 décembre 1981, Kaczyński n’a été ni inquiété ni arrêté (comme le furent tous les gens engagés fermement contre l’ordre communiste, ndlr) et il ne sera pas arrêté non plus ce 13 décembre 2012.
Voilà qui devrait calmer l'orgueil patriotique du populiste, champion de la décommunisation, grand chasseur de sorcières et qui, depuis la catastrophe accidentelle de Smolensk, voit des traîtres et des agents de la Russie partout ! Jusques dessous son lit...
Un camarade polonais me disait une fois, alors que le thermomètre descendait à - 30 : Chez nous, l’hiver, c’est une guerre de tous les jours.
J’ai retenu la leçon et aujourd’hui, même s’il ne fait que -16, mon souci principal est de circuler sur la glace et la neige en prenant le minimum de risques, de chauffer la maison, faire ronronner les feux, boire du thé brûlant et, tout ça étant fait et bien fait, de me plonger dans la lecture de quelque livre en regardant, parfois, par la fenêtre, l’hiver tout blanc, tout givré et tout vaincu jusqu’à cette fenêtre, dressée devant lui comme une barricade.
Je n’attends pas le printemps. J’espère que c’est lui qui m’attend. Le grand mouvement des choses se vit dans le mouvement des jours, chacun ayant sa raison d’être, sa raison de s’enfuir et de recommencer.
J’ai lu une phrase dans un livre de l’écrivain à succès Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, qui m'a choqué. Peut-être ai-je eu le tort de la prendre au premier degré. Quoique… Je ne vois pas trop à quel degré de l'esprit elle peut être autrement prise.
En septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. On sait tout ça et on sait comment. Yashmina Khadra écrit : On s’attendait à une résistance, à des combats farouches, à une opposition forte et il n’y eut que quelques escarmouches.
Scandaleux. Cet homme, qui fut haut gradé dans l’armée algérienne avant de se tourner vers l'écriture où il glane également pas mal de médailles, ne connaît rien du déroulement de cette partie de l’histoire, des sacrifices faits par l’AK, des morts, des massacres, des crimes et de l’état de la Pologne en 1939.
De toute façon, son livre, outre cette bourde, est ennuyeux et écrit de façon fort approximative. Je ne le mènerai pas au bout. J’ai trop à faire avec d’autres livres, soit qui ont passé avec brio l'épreuve du temps, soit dont la qualité première n'est pas la recherche du succès de librairie.
Bon week-end à tous... et à toutes, ça tombe sous le sens !
Les halliers qui jouxtent ma maison
11:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.12.2012
13 décembre 1981 : la Pologne sous les couteaux
 Il y a trente et un an aujourd’hui, à six heures du matin, la voix du général Jaruzelski annonçait sur toutes les radios et à la télévision :
Il y a trente et un an aujourd’hui, à six heures du matin, la voix du général Jaruzelski annonçait sur toutes les radios et à la télévision :
"Citoyennes et citoyens, grand est le poids de la responsabilité qui m’incombe ce jour…"
La Pologne se réveillait ainsi sur un cauchemar qui allait durer deux ans : la proclamation de la loi martiale et la déclaration de l’Etat de guerre dans tout le pays.
Six mille syndicalistes et opposants actifs avaient été jetés au cachot dans la nuit, toutes les garanties légales suspendues, les lois fondamentales comme celle protégeant (officiellement) la liberté de circuler anéanties, les frontières et les aéroports fermés, le couvre-feu décrété.
Le pays était sous la botte. Exsangue.
A la vitesse historique, c’était donc hier et les Polonais aujourd’hui vaquent à leurs occupations, rient, chantent, s’aiment, souffrent comme tout le monde des maux de la mondialisation libérale.
Mais ils se souviennent. L’air pur, plus de trente ans après, semble encore, parfois, leur donner le vertige. Il y a quelque temps, alors que je garais insolemment mon automobile sur un espace normalement réservé aux piétons, un vieux monsieur, les mains dans les poches, la cigarette au bec, l’œil goguenard, qui me regardait manœuvrer et auquel je demandai si je pouvais me permettre parce que je n’en avais que pour quelques minutes, m’avait répondu - comprenant dès ma première syllabe que j’étais étranger - avec une pointe de fierté amicale allumée dans ses yeux :
- W Polsce wszystko wolno ! (En Pologne, tout est permis)
Paroles anodines qui, ici, ne le sont pas.
Tous ceux qui ont plus de quarante ans se souviennent donc aujourd’hui de ce 13 décembre.
Leur pays a été meurtri dans les profondeurs de sa chair. Pour une foule de gens de l’Ouest définitivement enfermés dans les clichés les plus crasses, il est encore le pays des longues files d’attente devant les magasins, sous la neige et le vent, le pays où il n’y a ni viande, ni produits laitiers, ni pain convenable, ni routes, ni services publics, ni vêtements décents. Que de la vodka et des militaires armés jusqu’aux dents au coin des rues. Bref, leur cervelle, à ceux-là très nombreux encore (j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte à chaque fois que je suis revenu en France) s’est scotchée sur des titres de journaux et des images télé, comme si, après, vu qu’on n’en parlait plus, ou beaucoup moins, l’histoire s’était arrêtée.
Mais que faire d’autre quand la nature vous a doté d’un cerveau d’imbécile, sinon arrêter l’histoire aux dernières informations saisissantes reçues ?
Le vieux général Wojciech Witold Jaruzelski, aujourd’hui âgé de 90 ans, a toujours assumé devant l’histoire et devant ses compatriotes la responsabilité de ce matin de décembre. Il répond présent à toutes les convocations au tribunal qui lui sont régulièrement adressées depuis trente ans. Le vieillard ne se dérobe pas, ne se cache pas : il habite un appartement connu de tous les Varsoviens.
Je ne suis pas certain du tout, du tout, qu’une telle situation serait possible à Paris.
L’état de guerre fut, si on peut dire ainsi, le dernier coup de bluff du communisme détruit sur ses bases, pour donner encore l’illusion de sa vitalité première. Jaruzelski savait très bien qu’il n’endiguerait jamais les aspirations à la démocratie du peuple polonais, que le vent de l’histoire avait définitivement tourné, que l’Union Soviétique elle-même en train de se dévorer les entrailles avec un système qui n’était plus viable et ne l’avait d’ailleurs jamais été autrement que par le mensonge, la ruse et la force, embourbée de surcroît en Afghanistan, ne pouvait se permettre, comme à Prague vingt ans plus tôt, de venir rétablir l’ordre communiste à coups de chars.
Et quand bien même en eût-elle montré quelques velléités, que Jaruzelski sauvait la face et tentait de l’en dissuader en lui montrant qu’il avait la situation en main.
Car les tensions étaient telles, les contradictions avaient atteint un tel point de non-retour, qu'il a aussi voulu éviter, par la loi martiale et la démonstration de force, l’affrontement direct et les bains de sang de la guerre civile.
Sur toutes ces questions relatives aux responsabilités du vieux chef communiste, le sentiment des Polonais est encore très contrasté. J’écoute ceux qui ont vécu les tumultes, voire qui y ont participé, et je me garde bien d’émettre un jugement qui, de ma part, serait tout à fait indécent. Ils ne sont pas d’accord entre eux, les Polonais, sur le déroulement de cette époque dramatique, mais, sinon peut-être pour les catholiques populistes du PIS (Droit et justice) menés par le dangereux conservateur Jarosław Kaczyński, il n’y a pas de haine, pas de chasse aux sorcières, pas de goût de revanche.
Qu’un immense soulagement d’être sortis du tunnel.
Rendons un honneur, mesuré car tout discours politique est fait de paroles convenues, au Président Hollande - on n’en a pas tous les jours l’occasion - qui, en visite à Varsovie le 16 novembre dernier, a su déclarer devant le parlement polonais que ce peuple avait, bien avant la chute du mur, souffert le martyr pour avoir pris l’initiative victorieuse* de soulever le joug totalitaire qui depuis cinquante ans accablait toute l’Europe centrale et de l’est.
*après les cuisantes défaites de Bucarest en 1956, de Prague en 1968 et de Varsovie elle-même en 1970.
Pour avoir une certaine idée des véritables victorieux et des vaincus oubliés - pourtant du bon côté de la barricade - de cette lutte historique, voir ici un autre témoignage.
11:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.12.2012
Ils faisaient lundi
 Lundi était jour du marché, c’est-à-dire, pour tous les paysans des environs, un jour de fête beaucoup plus joyeux que l’austère dimanche où les bicyclettes et quelques carrioles attelées s’agglutinaient sur le parvis de la vénérable église du XIIe siècle et où se faufiler au bistro faisait plutôt mauvais genre.
Lundi était jour du marché, c’est-à-dire, pour tous les paysans des environs, un jour de fête beaucoup plus joyeux que l’austère dimanche où les bicyclettes et quelques carrioles attelées s’agglutinaient sur le parvis de la vénérable église du XIIe siècle et où se faufiler au bistro faisait plutôt mauvais genre.
Mais le lundi dès potron-minet, autour des halles au sommet desquelles veillait la vieille sirène du tocsin, sur toute la Grand-Place, des camelots de toutes sortes bonimentaient sur toutes sortes de guenilles, sur leurs outils, sur leurs fruits, sur leurs broutilles. Les gens des campagnes environnantes, eux, apportaient dans des paniers grillagés tout ce qu’ils avaient espoir de vendre ou de troquer, lapins, canards, poulets, pintades, pigeons, œufs, légumes. Une forte odeur de fientes et de plumes chaudes se mêlait ainsi à celle des tissus neufs et des fruits sucrés.
Certains cependant n’amenaient rien du tout. Ils s'amenaient, ce qui n'était déjà pas si mal, pour causer de tout et de rien, comme seul savait le faire le paysan, au café du commerce, toute la matinée durant. Arrivés aux aurores, ils repartaient sous le soleil au zénith, la voix pâteuse, l’œil torve et le vélo très incertain.
C’était le cas de Gaétan, le propriétaire chez lequel ma mère avait eu l’idée lumineuse de me louer chaque été pour prix du gîte et du couvert. Il arrivait sur le coup de quatorze heures, la démarche passablement chaloupée, son indéfectible chapeau bien rabaissé sur le front, les yeux mi-clos, l’haleine inondée de vin blanc sec et, toujours, un demi-sourire suspendu à ses lèvres pincées, comme si le monde l’amusait, l’agaçait mollement ou lui semblait tout simplement hors de propos.
Tout de noir vêtue, sa vieille mère depuis longtemps revenue du marché et lassée de l’avoir attendu pour le déjeuner, levait les yeux au ciel, les poings serrés, en grinçant d’inintelligibles paroles. Des prières? J’en doute fortement. Je ne l’ai jamais surprise à genoux et au-dessus des grands lits à baldaquin, jamais je n’ai vu la divinité du Golgotha exhibé son supplice sur les murs grossièrement peints à la chaux.
Peut-être proférait-elle des colères aux mots si crus qu’elle ne voulait pas qu’on les entendît. Je subodorai, bien plus tard, qu’en ces circonstances elle vilipendait plutôt la mémoire de son mari pour avoir légué une aussi funeste passion au fils. Le bonhomme s’était en effet prématurément évaporé vers les vignes du Seigneur après avoir trop goulûment prisé celles d’ici-bas.
Le Gaétan en question ne quittait donc le foirail que le dernier. Tranquillement accoudé au comptoir, il attendait que le garde-champêtre eût débarrassé la place de la paille, des fientes, des ficelles, des papiers gras et des emballages. Ceci étant fait et bien fait, tous les deux prenaient le coup de l’étrier. Chacun le sien bien entendu : un cheval se monte avec deux étriers.
Enfin rentré, Gaétan s’asseyait devant son assiette en ricanant bêtement. Il avalait en un tour de main tout ce qui tombait sous sa dent avinée, miget, pâté, cuisses de poulet ou de canard, moutarde, cornichons, haricots, fromages, fruits, gâteau, le tout inondé de grandes lampées de vin, histoire de faire durer la fête.
Fermement occupé à engloutir, il faisait mine de ne pas entendre les sourdes vitupérations maternelles. Puis il se levait, il pétait un grand coup, énorme comme un tonnerre du ciel et comme pour signifier la fin des jérémiades, avant de s’aller coucher pour une longue sieste réparatrice à l’ombre du paillé ou du poirier du jardin.
Dès le lendemain, les choses reprenaient alors leur cours normal, la mère à ses casseroles, ses conserves, ses poules et ses cochons, le fils à ses chevaux et ses champs, moi au cul des vaches avec des livres et des casse-croûtes et la mémoire du grand-père en paix sur ses nuages.
Jusqu’au lundi suivant.
Extrait du Silence des chrysanthèmes, remanié et jamais mis en ligne
13:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.12.2012
Quatre lettres dans la nuit

L’ordre des quatre lettres est un diktat sans lequel vous n’entendriez qu’un désordre vide de sens, trom, ortm, romt, mrot, torm. Une seule émotion est admise. La suprême.
Tant que, même à les prononcer, on pourrait parfois être saisi d’effroi.
Cette nuit, quatre bougies les faisaient danser à la fenêtre minuscule d’une minuscule maison. Elles éclairaient faiblement, un peu plus loin, en face, le givre des carreaux et leur lueur timorée se répandait en tremblotant sur la neige, comme un sillon de tristesse. De la fumée sur le toit virevoltait à la rencontre des flocons tombant du noir. Il faisait froid, aussi froid que les quatre lettres sont froides.
A la chaleur d’un vieux poêle, des gens veillaient une vieille dame dans la nuit d’hiver.
Avant, elle cheminait le long des haies, un foulard enveloppant toujours ses cheveux, été comme hiver. Elle arrêtait son pas étroit, malhabile, pour dire deux ou trois mots, des mots qui signifiaient toujours que la vie était dure, seule au bout de la piste. Elle suintait très fort ce sombre désarroi des vieilles gens qui, depuis longtemps, ne sont plus réellement sur terre mais à l’intérieur des fantômes qui les habitent. Loin en eux-mêmes.
Elle avait pour la première fois, m’a-t-on dit, vu le monde en 1928 et ce reflet blême sur la neige marquait donc le point final d’une course de 84 ans à travers l’histoire. Elle avait 11 ans quand les chars de Staline avaient traversé le Bug pendant que ceux d’Hitler accouraient à tombeau ouvert, venant de Varsovie. Sans doute l’enfant avait-il entendu le grondement, au-dessus des champs de septembre et dans les profondeurs de la forêt, de la terrible tenaille qui se refermait sur son pays.
Puis une jeunesse écrasée sous le poids les crimes qui se perpétuaient plus tard dans la forêt toute proche, des crimes de sang et de fumées. Une vie de jeune femme bientôt immobilisée sous la poigne sans issue de Staline, avec une ferme bien plus que modeste, tant qu’elle n’intéressait même pas la collectivisation. Deux cochons, deux vaches, des poules, deux ou trois champs…
Survivre dans la neige et le vent, par-delà l’incendie des barbaries de l’histoire.
Elle cheminait sans doute, la vieille dame fatiguée, dans ce début du XXIe siècle comme on chemine au sortir d’une nuit d’insomnie labourée par les cauchemars.
Hier, elle a rejoint les terres où il n’y a plus d’hommes, plus d'Histoire, et inscrit au bout de son destin de femme les quatre lettres qui l’avaient, sans doute, si souvent fait frissonner, l'effleurant de leur souffle glacé.
Dans la nuit neigeuse, dans le vent qui balançait les pins et bousculait les flocons, vacillaient quatre bougies au givre des carreaux et un sillon de tristesse sur la neige tremblotait.
Tel un petit mouchoir blanc agité à la fenêtre du temps qui s’en va, en route vers l'éternité du temps.
12:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.12.2012
Quand les vieux démons reviennent, côté coulisses

Texte mis en ligne le 1er décembre 2009
Introduction:
C'est comme une histoire de fous, mais vécue par des gens censés ne pas l'être, fous.
Elle est véridique, cette histoire, et nous avons eu l'heur de la lire, passablement éberlués, dans les colonnes du numéro 48 de Polityka.
Elle s'est déroulée à Poznań.
Plus précisément, dans un grand théâtre de Poznań, et plus précisément encore, en coulisses.
Ce grand théâtre accueillait ces jours-ci le Théâtre Polonais de Danse, institution remarquable qui se produit dans différentes salles du pays et qui, depuis quelques mois, s'est adjoint le talent d'un danseur israélien émérite.
L'histoire :
Alors que le susdit danseur s'entraînait à rideau fermé avant la répétition générale, il a soudain senti sur lui peser un regard insistant, qui l'a dérangé et troublé dans sa concentration au point de s'interrompre et d'aviser effectivement dans les coulisses un employé qui le fixait, immobile, avec une mine assez sévère, et peut-être, même, qu'il le toisait, moqueur, méprisant, ce salaud d'employé !
Rien de grave, me direz-vous. Mais attendez que je vous décrive le machiniste scrutateur et soi-disant goguenard. Petit, nerveux, l'œil noir, une mèche de cheveux lui barrant le front et une petite moustache fournie, bien taillée en balais de chiottes, juste sous les narines...Vous y êtes ?
Non ? L'artiste israélien, lui, est formel : cet ouvrier ressemblait à s'y tromper à Hitler, lequel artiste a pris peur et s'en est ouvert à une responsable du Théâtre Polonais de Danse, lui demandant de dire à cet employé de déguerpir.
Las ! Las ! Les choses n'en sont point restées là. L'employé courroucé - je vous laisse deviner à quoi peut ressembler un employé qui ressemble à Hitler quand il est courroucé - a porté plainte auprès de la directrice pour.... discrimination.
C'est là que l'anecdote tourne au cauchemar et que, comme dans tous les cauchemars, elle permute les rôles du réel. Car un homme qui ressemble à Hitler à s'y méprendre et qui porte plainte contre un homme de confession juive, un artiste en plus, pour discrimination, ça fait grincer des dents dans la mémoire collective.
Et ça n'est pas tout ! Les camarades de l'employé-fantôme, outrés de la mesure prise à l'encontre de leur collègue, ont menacé de faire grève pour la Première si on ne le remettait pas à son poste.
À l'occasion d'une autre discussion orageuse avec la directrice artistique du Théâtre, pour tout autre chose que cette lamentable affaire, quelque chose ayant trait à l'organisation du spectacle, le danseur traumatisé, quant à lui, en est arrivé à évoquer une nouvelle fois l'incident : il a maintenu avec force qu'un employé-Hitler l'avait nargué et regardé de façon très agressive.
Hélas encore, trois fois hélas, la directrice était déjà mal disposée envers le danseur car, paraît-il, depuis quelque temps, le bruit courait que ce dernier se plaignait à qui voulait l'entendre que ce spectacle était une galère et qu'il était décidément impossible de travailler convenablement avec "ces connards de Polonais !"
Mal disposée, donc, au point de lâcher dans l'altercation qui ne manqua pas d'éclater : Espèce d'enculé de juif !
Aie! Aie ! Là, ça s'est vraiment gâté .
Et l'artiste aussitôt de se lever et de hurler : Espèce d'enculée de nazie !
Et voilà l'affaire portée diligemment à la connaissance de l'ambassade israélienne en Pologne et voilà la directrice artistique virée sur le champ !
Et qu'en est-il, dans tout ça, advenu du machiniste sosie ?
Des journalistes ont fini par le dénicher, tout penaud, dans les vestiaires. Lui, il dit qu'il a toujours eu la moustache et s'est toujours coiffé de la sorte, qu'il n'est pas fasciste pour un sou, que la guerre c'est du lointain passé, qu'il est embêté avec cette histoire qui fait grand bruit dans le Landerneau et que, s'il est viré de son emploi, il se demande bien ce qu'il va devenir et comment il va nourrir sa famille.
Conclusion :
Et le journaliste de Polityka de poser la question : où commence le délit de sale gueule*et l'inconvenance quand on a le malheur congénital de ressembler à Hitler en présence d'un artiste israélien ?
Au regard ? Au fait d'exister ?
Annexes :
- *NDLR Exil des mots
- Le spectacle préparé portait sur : La chute du mur et la tolérance. Hé ben, c'est raté !
Image : philip Seelen
12:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.12.2012
Décalage...

Pour être certains que notre brève apparition avait bien imprégné la réalité.
Les empreintes, larges et profondes, escaladaient le petit talus, fuyaient dans les sous-bois, hésitaient en se multipliant, et se glissaient enfin sous les broussailles. Nous les avons suivies sur une dizaine de mètres, comme si nous nous attendions à ce que le grand prédateur nous attende là, sous les halliers recouverts de neige. Mais il devait être, à ce moment là, à l’autre bout de la contrée ! Enfui vers son destin de loup.
Et le soir venu, je me suis dit que j’étais vraiment situé hors du monde. Israël assassine sous le regard complaisant d’Obama et de ses Etats valets ainsi que sous les courbettes malsaines de Hollande, la Syrie sombre dans le chaos, les hommes y meurent sous le feu nourri des armes, l’Europe ressemble de plus en plus à un sac de nœuds ficelé par des traîtres, des menteurs et des insignifiants, les gens sont à côté de leur vie, ne trouvent plus rien qui alimente en vrai leur plaisir de vivre leur vie, des milliers d’hommes et de femmes perdent leur gagne-pain parce que la banque - ses tiroirs bien remplis quoiqu’elle prétende le contraire - ne les trouve plus rentables, les intellectuels de service n’émettent plus que des vulgarités engraissées à la sève du spectacle marchand, les ministres et les présidents ne sont que les piètres gestionnaires fantoches du pouvoir occulte d’une poignée d’insatiables financiers, aucun idéal ne s’élève qui voudrait dépasser les sphères étriquées de la survie, et moi, benêt, je suis dans la forêt la piste laissée sur la neige par un loup de hasard.
Je ne sais pas si j’ai vieilli - sans doute que si - mais en tout cas, je crois une chose : je n’ai pas grandi !
Parce que je m’en fous, du malheur social des gens : Combien d’entre eux ont accordé crédit aux voix qui leur disaient, depuis si longtemps, à s'en faire mal, l’inéluctable pourriture d’un système ?
Ce monde qui les tue, c’est le leur. Celui auquel ils ont fait allégeance. Ce n'est pas le mien.
J’aimerais bien encore suivre la piste d’autres loups.
Mais l’exceptionnel est, par définition, d'abord solitaire.
11:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.12.2012
Fantastique et furtive rencontre

Dans le temps, oui, mais maintenant...
Les habitants du village, eux, avaient été moins catégoriques. Certains avaient prétendu que, parfois, l’hiver, il pouvait arriver que des individus isolés poussent leur course jusqu’ici, venant de la grande forêt de Włodawa ou d’ailleurs…
Un soir de neige et de vent, il y a un ou deux ans de cela, j’étais planté au milieu de ma cour, la forêt face à moi avec un bout de lune accrochée à ses cimes. Pour tout vous dire, j’étais planté là pour y gratifier la neige d’une miction libératrice, car que peut-on faire d’autre, la nuit, l’hiver, sous la neige et dans le vent, planté au milieu de sa cour ? Je vous le demande bien.
J’avais cru entendre, donc, au loin, dans les sombres profondeurs, la voix étouffée, rauque, caractéristique, légendaire. Comme un gémissement errant de la solitude.
On m’avait allégrement moqué. Surtout Jagoda. Un chien perdu, qu’elle avait pouffé. Tu veux tellement qu’il y en ait chez nous, que tu les entends.
Sur ce, fort possible, en tout cas fort bien dit, j’avais abdiqué. J’avais fait mine d’oublier la plainte dans la nuit gelée. Mais je suis têtu.
Et ce matin, dans la forêt, sur la route ensevelie de blanc et de glace, alors que je roulais au pas, il a surgi. La gamine, à côté de moi, babillait que c’était bien d’avoir des responsabilités, que ça obligeait à penser à autre chose qu'à ses petites affaires, car un prof l’avait déléguée pour récolter des pièces de monnaie, jaunes, qui seraient offertes aux enfants de la Maison de l’Enfance.
Je me suis fait aussitôt sarcastique. Te voilà bientôt rendue comme la mère Chirac, que j’ai rigolé. Elle s’apprêtait, sourcils froncés, l’œil vexé car subodorant que ça n'était pas forcément un compliment, à me demander plus ample explication...
Mais l’animal est sorti des fourrés, très vite, juste devant la voiture. Magnifique allure, queue droite dans le prolongement du corps, course puissante, tête tendue vers la fuite. Il a pénétré dans le sous-bois d'en face, s’est arrêté une seconde, a regardé en arrière et a repris sa course sauvage sous les broussailles alourdies de neige.
Un loup ! Nous sommes-nous écriés en même temps.
Nous étions époustouflés et nous en avons parlé pendant les trente kilomètres, oubliant le verglas et la glace. Je le reverrai longtemps bondir, là, tout près, ce redoutable inconnu que l'on dit invisible.
Et maintenant je sais que la forêt, celle qui encercle ma maison, celle que je vois tous les jours et à toutes saisons, celle où je me promène, celle des myrtilles, des chevreuils, des grands corbeaux, des élans, peut être aussi habitée par des loups.
Ce n’est peut-être rien du tout pour toi, lecteur. Pour moi, ça la fait accéder, cette forêt, au statut de grande forêt, au rang de la légende, du conte, du fantastique.
Cet après-midi, quand la nuit l’aura enveloppée de silence, de froid et de neige, je sais que je la regarderai autrement.
Avec plus de respect encore, mêlé à une peur délicieuse. Je tendrai l'oreille et je n'entendrai, sans doute, que du vent glissant entre les grands pins et les bouleaux.
Pourtant, c’est l’idole redoutée des hommes, haïe, chérie, fantasmée, tantôt diable et tantôt ange, qui, ce matin sous une aube de neige, a croisé ma route et sur mon imaginaire laissé son empreinte du réel.
10:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.12.2012
Réel imaginaire

Maisons de bois aux formes incertaines sous la blancheur de l’aube, fumées qui montent sans conviction vers un ciel sans issue, forêts qui croulent sous le poids de la blanche humidité, routes aux profils confondus avec le champ ou le talus forestier, silence comme un recueillement devant l’inéluctable retour des grands engourdissements.
Ma voisine, la mémé, toute menue, que j’ai conduite ce matin jusqu’à Łomazy en roulant au pas à travers la forêt, semble s’angoisser de toute cette neige. Pourtant, elle en a vécu, de terribles saisons ! De très dures, toute jeunette alors, sous la botte infâme de tyrans assassins. Je la regarde toujours comme je regarde toutes les vieilles gens d'ici : comme témoins anonymes et émouvants des tumultes les plus dramatiques de l'histoire du XXe siècle. J’aimerais écrire le livre que renferme leur mémoire devenue muette. Pour contredire tous les autres.
Plus on est vieux, plus l’hiver est dur, dit-elle. Elle redoute son quatre-vingt troisième hiver, on dirait. Mais il est vrai que vient une saison où l’on redoute toutes les saisons. Rien n’est sans doute plus terrifiant, pour terrifiante que soit l’histoire de ces villages, que la présomption du dernier grand froid.
Elle marche de façon fort irrésolue, ma vieille voisine. Mon escalier de bois, que j’ai pourtant dégagé trois fois depuis l’aurore, est de nouveau enseveli. Il est glissant. Je retiens la mémé par le bras. Elle descend avec une extrême prudence, trois marches, longtemps, et, cruelle, la neige, pressée de vaporiser le monde, inonde son fichu.
Je crois savoir pourquoi l’hiver en Pologne m’impressionne encore. C’est parce que, sans n’avoir jamais mis les pieds en Pologne, avant, c’est comme ça que j’imaginais ce pays. La forêt, la plaine, la forêt, la plaine et toute cette succession balayée par le vent neigeux, sous un drap gris, presque noir là-bas, à la fin, quand il vient border l’horizon mélancolique. Des chevaux en armes pourraient y apparaître, dans un brouillard de voltiges. Montés par les hommes de Nestor Makhno, leurs drapeaux noirs qui pavoiseraient au vent froid. Ephémère victoire des plaines d’Ukraine toutes proches.
Mon imagination rejoint ses images.
En juillet, quand le thermomètre suffoque par quarante degrés, je suis dans un pays plus inconnu. Presque plus lointain. Je n’y avais jamais pensé de la sorte. Je n’y avais jamais pensé en géographie, en climat ; je l’avais fait grande plaine d'une saison blanche. Et même les plus monstrueux épisodes de l’histoire dont ce pays a été le témoin, le billot, l’acteur et le théâtre, se déroulent toujours encore, dans mon imaginaire abusif, dans ma compassion qui tente de remonter le temps, sous la neige que soulèveraient des tourbillons venus des steppes et de Sibérie.
L’imagination du monde acquise par l’histoire, la lecture, l’oralité ou tout moyen autre que le voyage, donne lieu à bien des stéréotypes, même si, parfois, ils rencontrent la réalité.
Pour illustration, un metteur en scène - je ne me souviens plus lequel - de Crime et châtiment faisait ouvrir sa pièce sous la neige et le froid, alors que l’œuvre, comme on sait, débute sous la fournaise poussiéreuse d'un mois de juillet.
12:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.11.2012
Appel des 451 : réflexions - suite et fin -
 LE CHAOS VÉCU PAR LES AUTEURS : RESPONSABILITÉS ET LIMITES TANGIBLES POUR L’HABITER ENCORE
LE CHAOS VÉCU PAR LES AUTEURS : RESPONSABILITÉS ET LIMITES TANGIBLES POUR L’HABITER ENCORE
C’est en tant qu’auteur que j’ai adhéré à l’Appel des 451. Je ne parlerai donc ici que des livres qui portent la littérature et ferai abstraction, sans aucune marque de mépris, des dictionnaires, des manuels scolaires, des guides touristiques, des recettes de cuisine, des traités de pêche et de chasse et tutti quanti.
Ainsi j’ai pu lire quelques noms d’écrivains dans la liste des signataires, mais j’ai pu également constater qu’ils ne faisaient pas vraiment légions. Ce qui ne m’a, somme toute, que faiblement surpris.
S’il est pourtant des gens concernés au premier chef par le chaos, c’est bien les auteurs. Sans livres, pas d’auteurs, sans auteurs, pas plus de livres que de métiers du livre, ça tombe sous le sens. A moins qu’on ne veuille ressusciter ce livre que par l’unique réédition d’ouvrages ayant brillamment traversé l’épreuve des âges.
Pour nécessaire et louable que serait cette perspective, elle ne satisferait cependant pas à une des fonctions les plus nobles du livre, qui est celle de porter à la connaissance du public contemporain les œuvres de ceux qui écrivent leur époque, et au-delà, pour quelques élus méritoires, à la connaissance des générations à venir.
Je dis que je n’ai été que faiblement étonné par le petit nombre d’auteurs signataires, parce que je crois savoir qu’un grand nombre d’écrivains publiés- ce n’est hélas pas une tautologie - et qui ont avec leur éditeur su établir une complicité durable, (sur le prix à payer de laquelle il faudrait s’étendre) se soucient de l’avenir du livre en général comme de leur première chemise bleue à bretelles. D’ailleurs, la plupart des écrivains signataires sont en même temps éditeur et il serait intéressant de savoir qui a signé, de l’auteur ou de l’éditeur. J’aimerais bien qu’il s’agisse des deux à la fois.
C’est bien désolant, mais c’est humain. Les rédacteurs de la brochure Querelle des modernes et des modernes ne soulignent-ils pas eux-mêmes que «dans le monde du livre, tout le monde veut tirer la couverture à soi» et même si ce passage, coupé ici de son contexte, ne fait pas allusion aux auteurs mais aux autres acteurs du livre, il s’applique très bien à eux.
Je les comprends cependant, ces auteurs. Je les comprends parce que je sais la souffrance de l’écrivain qui, pour de multiples et diverses raisons, ne trouve pas cette complicité et qui par voie de conséquence toujours chemine dans les déserts de la solitude et du silence. J’en fus, et même après avoir publié cinq livres et participé à deux recueils collectifs, j’en suis encore. Je sais trop l’isolement d’une lumière qui vacille éternellement sur les pages inutiles.
Je peux dès lors comprendre que ses textes étant quasiment assurés de trouver un abri, l’auteur publié, tout à son art, ne veut pas embarrasser son esprit des affres qui tourmentent celui des sans-abri, et ce, quelles que soient la poésie, la générosité et la solidarité dont il peut faire montre dans son écriture.
Pour ma part, quand je prends la mesure de l’étendue du chaos qu’on a laissé s’installer dans un des plus beaux domaines de l’activité humaine en ce qu’il concerne l’art et les productions de l’esprit, c’est d’abord à ces sans-abri là que je pense. A ceux qui ne rencontrent jamais leur écriture dans les yeux des autres, et qui, souvent, de guerre lasse, bradent, liquident, balancent et soldent le tout sur un blog. C’est ce que je m’apprête à faire pour deux manuscrits et j’affirme haut et fort que l’explosion des blogs au point d’être devenue un véritable phénomène de société est, pour une bonne part, née du désespoir de n’être jamais entendu. Alors on s’auto-publie, on est lu directement, immédiatement, on contemple enfin son écriture sur un support public et non plus sur un écran sans écho et sans témoin. Deux ou trois commentaires tombent, on répond avec empressement, trois ou quatre lecteurs se fidélisent et l’illusion de n’être plus seul, l’illusion que la bouteille balancée à la mer a atteint aux rivages humains de la reconnaissance, est presque parfaite.
Les blogs ne sont dès lors pas à l’origine du chaos du livre : ils en sont les fils dénaturés ; ils sont les champignons d’une terre en décomposition, ils sont les jardins ouvriers de ceux à qui on interdit l’accès à l’aristocratie du livre. En plus, ils apparaissent comme des éléments achevés de la gratuité, hors du circuit marchand, personne n’ayant l’impression de payer, ni l’auteur, ni le lecteur, alors que tout le monde met chaque jour la main au portefeuille. L’auteur, en plus, lui, travaille dans le vide, s’écoute ronronner et tout le monde fait mine d’être content de tout le monde.
Ce dernier point du mensonge de la gratuité, sur laquelle picorent une foule de gens, a été assez développé dans la brochure Querelles des modernes et des modernes pour que je puisse me permettre de n’en pas dire plus.
Mais il y a encore une fausse publicité qu’il faut dénoncer : celle de la vitrine. L’auteur non publié veut faire montre de son verbe, faire miroiter des échantillons au cas où un improbable preneur viendrait à passer par là. L’auteur publié, lui, se croyant déjà plus avancé et dans une démarche plus conséquente, argumente souvent qu’il lui faut un comptoir ouvert tous les jours avec entrée libre 24 heures sur 24 et qu’ainsi un plus large public aura accès à sa bibliographie, à son travail. Et bien qu’on en juge plutôt par ce qui suit.
Je tiens un même blog depuis juillet 2007 sur lequel meurent à petit feu près de 1000 textes. Ce blog est visité (notez bien le mot visité) par près de 3000 lecteurs mensuels qui, à l’évidence, ne lisent pas mes livres, ou si peu :
- Zozo, chômeur éperdu, Le Temps qu’il fait, 2009, 1000 exemplaires vendus environ,
- Géographiques, Le Temps qu’il fait, 2010, 300 exemplaires vendus environ,
- Le Théâtre des choses, Antidata, 2011, 200 exemplaires vendus environ.
- Brassens, poète érudit, Arthémus, 1ère édition 2001, 2ème édition 2003, 2500 exemplaires vendus. Je n’avais pas de blog.
Si, sans Brassens et avec blog, j’additionne donc les trois chiffres des ventes étalées sur trois ans, j’arrive au chiffre frileux de 1500 bouquins ! La moitié des lecteurs du blog sur un mois ! Et encore faudrait-il considérer qu’il y a beaucoup de doublons et que des gens ont acheté deux, voire trois titres. Il faut aussi, j’en conviens, prendre avec une extrême prudence le chiffre des 3000 visiteurs mensuels, car ce sont peut-être toujours les mêmes et ils ne sont peut-être, allez, soyons sévères avec nous-mêmes, disons que 1000.
Quand bien même ! On mesure ici l’impact de la vitrine sur les lectures de mes livres. Nul. Du pipi de chat.
Mais revenons aux sans-abri, blogueurs ou pas, absents de partout mais bien présents dans mon esprit.
Qui donc, messieurs-dames, se soucie de leur douleur ? De leur abandon ? Qui a pensé un jour tendre une main fraternelle à cette âme dont la passion d’écrire la conduit chaque jour un peu plus dans les couloirs les plus obscurs de la plus obscure dénégation ? Qui ? Les écrivains publiés ? Les éditeurs ? Les maquettistes ? Les libraires ? Les typographes ? Les imprimeurs ? Les correcteurs ? Les bouquinistes ? Les distributeurs ?
Pujadas, peut-être ?
Le chaos, pour moi, humainement, il est d’abord là. Je conçois que pour d’autres acteurs et signataires, il puisse être tout à fait ailleurs, plus prosaïque sans doute, et je conçois même qu’ils puissent avoir raison : si on veut embarquer du monde sur le fil de l‘eau, il faut d’abord colmater les brèches du radeau en train de naufrager. Le chaos, c'est comme le midi, chacun le voit à sa porte.
Je dis donc que mon combat personnel et mes pensées vont vers les écrivains bafoués, tués dans l’œuf, et que c’est par là que ce combat rejoint, objectivement, le vôtre.
On me dira, avec juste raison, que tout n’est pas publiable et que, peut-être, les gens n’ayant jamais autant écrit qu’à l’heure actuelle, il y a forcément du déchet. Certes. Mais avant d’avancer des vérités aussi lapidaires, encore faudrait-il être à même de considérer les tas de déchets qui trouvent preneurs et se poser la question de savoir si ce tas dépasse en quantité et en qualité celui dont on n’a souvent même pas pris la peine de savoir s’il était à mettre au rebut ou non, parce qu’on n’avait pas le temps, parce qu’on n’avait pas les moyens financiers, parce qu’on était sur d’autres pistes plus sûres, parce qu’on est éditeur mais qu’on n’a pas vraiment les moyens humains de tout lire, trop petit, trop à l’étroit, et parce que… Se poser donc la question de savoir s’il n’y a pas plus de déchets sur les étagères des libraires, qu’il n’y en a dans les tiroirs des écrivains « ratés. »
Peut-être les deux quantités sont-elles équivalentes. Je n’en sais rien. Ce que je sais, et que vous savez sans aucun doute, c’est qu’il y a des déchets qui trouvent preneurs et d’autres non. Des déchets recyclables en marchandises pures et des qui ne le sont pas. Ça donne envie de faire les poubelles…
Ce que je sais également, et que vous savez encore, sans aucun doute puisque vous mettez l’accent dessus, c’est qu’il y a des livres remarquables qui trouvent preneurs et qui, au bout d’une centaine d’exemplaires péniblement vendus, essoufflés, oubliés, méprisés, fatigués bien avant d’être épuisés, en ont terminé de leur carrière. Le lecteur attentif n’y a accès que par la voie du bouche à oreilles. Ce ne sont pas des livres qui se distribuent mais qui se distillent.
Tout cela participe du chaos. Un affligeant chaos. A qui donc incombe la responsabilité de ce chaos ?
A la finance spectaculaire qui a fait du livre et des supports de la culture une marchandise exclusive obéissant aux mêmes lois de circulation que la botte de radis, que le tube de dentifrice ou que le jeu Nintendo.
Oui. Nous sommes bien d’accord. Mais quand on a dit ça, on n’a rien dit tout en ayant tout dit. On a commencé par la fin. On s’est en tout cas privé de tout moyen d’action.
Il y a autre chose à dire. Et j’en veux pour preuve que nous cherchons tous ensemble des solutions, sans pour autant fomenter l’immense et généreux projet historique d’abattre le monde de la finance spectaculaire.
En tout cas pas à coups de livres, même si publier un livre de qualité dans un monde renversé est un acte politique.
C’est donc que des solutions existent à l’intérieur de ce monde et que le livre s’est embourbé sur des chemins qu’il n’aurait jamais dû emprunter s’il avait eu le courage et l’affront de rester honnête. Des chemins suicidaires. Qu’il a été conduit sur ces chemins, mené en laisse, et ce, par personne d’autres que ceux qui en font leur métier, au premier rang desquels figurent les grands éditeurs et les distributeurs.
Mais au premier rang seulement. Or, un premier rang suppose qu’il y en ait des seconds.
Des seconds couteaux du déclin. Et quand le premier rang en arrive à bouffer les seconds, jusqu’à même remettre leur existence en question, il arrive que ces seconds rangs s’organisent en une mutinerie.
UNE PISTE : LA MISE EN COMMUN DES VOLONTÉS PRATIQUES
Il y a de cela un an et demi environ, bien avant l’Appel des 451 donc, j’avais proposé à une quinzaine de camarades, tous impliqués dans la littérature ou dans la conception et fabrication des livres, de fonder une association d’auteurs, type 1901, à seule fin d’éditer nos différents ouvrages.
J’avais même - un peu prématurément il est vrai -rédigé des statuts pour cette association. Tous les camarades contactés n’avaient pas répondu et en écoutant de plus près ces muets, je m’étais aperçu qu’ils avaient un éditeur et que, donc, un tien vaut mieux que deux tu l’auras, n’est-il pas ? Toujours ce méprisable mépris à l'égard du sans-abri. Je signale d’ailleurs qu’à l’époque j’avais moi-même deux éditeurs. Bref…
Les dix camarades qui ont répondu se sont montrés enthousiastes et tous m’ont félicité pour le boulot que j’avais fourni. Les points d’achoppement étaient principalement, bien sûr, le financement de départ et la distribution.
Pour le financement, j’avais trouvé. Un copain avec des moyens sérieux et dont le rapport à la littérature est un des plus beaux, puisqu’il est un grand passionné des livres et de la lecture.
Restait la distribution. Des pistes ont été évoquées, discutées, pesées, argumentées, des contacts avec des réseaux de distribution en rupture avec les mauvaises manières de faire du secteur devaient être pris qui n’ont jamais été pris. On a cherché dans tous les sens, sauf sans doute dans le bon. Jusqu’à ce que le poisson en ait par-dessus les nageoires des atermoiements et se noie doucement. Nous n’étions bientôt plus que huit à nous préoccuper de la chose, puis cinq, puis trois, puis deux. C’est-à-dire que mon beau projet était mort sans être né.
Pourquoi ? Parce que les volontés étaient imparfaites. Ou pas parfaites du tout d’ailleurs. Que chacun avait aussi, je m’en suis aperçu par la suite, d’autres chats à fouetter.
Je persiste néanmoins à croire et à dire que là est une des solutions. La mise en commun, pratique, réelle, des volontés, des expériences, des sous, pour faire en même temps des livres et de la littérature.
Il y a dans le Collectif des 451, des éditeurs de grand talent, des libraires qui ne sont pas des pharmaciens, des bibliothécaires, des maquettistes, des correcteurs, des auteurs, des lecteurs, bref, tout un panel de savoir-faire et de goûts qu’il serait idiot, à moins de ne pas croire soi-même à son propos, de ne pas réunir autour d’une action pratique.
L’Association, ou la SCOP, me paraissent être les pistes les plus sérieuses pour produire en toute sérénité des livres qui soient des livres et passer ainsi à travers les mailles du filet tendu par le système exclusivement marchand.
Voilà donc les réflexions que m’inspirent l’Appel des 451 et la brochure Querelle des modernes et des modernes.
Affaire à suivre ?
Na razie nie wiem.
12:42 Publié dans Appel des 451 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.11.2012
Appel des 451 : réflexions
 Pour être de très bonne qualité, la brochure Querelle des modernes et des modernes éditée par l’atelier réponse du collectif des 451, ne m’en inspire pas moins quelques réflexions critiques et commande, selon mon sentiment, qu’y soient apportés quelques éclaircissements.
Pour être de très bonne qualité, la brochure Querelle des modernes et des modernes éditée par l’atelier réponse du collectif des 451, ne m’en inspire pas moins quelques réflexions critiques et commande, selon mon sentiment, qu’y soient apportés quelques éclaircissements.
La première évidence soulignée par les auteurs est que le livre est une marchandise. Esquissant un sourire, je reconnais ici le procédé employé par Marx pour attaquer son étude sur Le Capital ; procédé détourné par Guy Debord pour attaquer lui-même sa théorie de La Société du spectacle.
La notion de marchandise est pourtant, toujours et partout, à la fois trop vaste et trop restreinte. Je demande donc toute votre indulgence pour les quelques considérations basiques – et sommairement abordées - qui suivent sur le sujet. Si je m’y attarde c’est parce que certains des termes reprécisés reviendront dans la suite de mon texte, sans qu’il me soit alors nécessaire d’éclaircir la signification précise que je leur donne.
Préétablie, ma réflexion suivra le schéma :
- La marchandise
- Le numérique et internet
- Le chaos vécu par les auteurs : responsabilités et limites tangibles pour y habiter encore
- Une piste : la mise en commun des volontés pratiques.
LA MARCHANDISE
Depuis le temps qu’il y a des hommes qui se sont mis en devoir de transformer leur environnement en vue d’assurer leur maintien, - autrement dit de travailler - et qui s’échangent les produits de leur travail, il y a des marchandises.
Le travail, lui-même marchandise en ce qu’il négocie un savoir-faire contre des émoluments destinés à assurer la survie du travailleur, est le seul et incontestable père fondateur de la marchandise. Le mauvais sort fait à cette marchandise par la critique, sa mauvaise réputation, est venu du fait que, produit d’un travail inégalement fourni, elle s’échange de façon inégale, et même inique. Ce n’est donc pas en soi que la marchandise est critiquable mais par l’organisation économico-sociale qu’elle génère et dont elle se nourrit pour assurer sa pérennité. Là où elle est, en quelque sorte, entachée d’une certaine immoralité qui ne nous convient pas et entrave notre plaisir à vivre.
Le but premier de l’échange des marchandises, reprenant en cela le jeu social du troc, est de satisfaire des besoins ; besoins qui se sont avérés être de plus en plus lourds au fur et à mesure que l’homme s’avançait dans la transformation de la nature, tant que, très tôt, il se trouva ne plus être en mesure de les satisfaire par sa seule activité et fut contraint d’avoir recours à une multitude d’activités déléguées à une multitude de gens. Le cueilleur et le chasseur disparurent, en tant que tels, sitôt la révolution néolithique accomplie, c’est-à-dire aux prémisses mêmes de l’ère de la séparation activité humaine/conservation stricto sensu de la vie.
Cette séparation s’est concrétisée par l’introduction dans les rouages sociaux de la notion de «métiers», mot au parcours édifiant. Comme pour tous les concepts de la langue, jeter un coup d’œil sur son histoire nous en apprendra plus sur sa sémantique profonde que tous les discours. Il est issu du latin ministerium, désignant « le service », « la fonction », principalement en parlant du « service divin », avant de s’appliquer, dans son sens contemporain, à la fille de joie, une femme de mestier. Ce n’est qu’au cours du XIIe siècle qu’il désigna, par déduction et extension, enfin l’exercice d’une profession ou d’un art.
CQFD.
La séparation a évolué très lentement, vous le savez tout comme moi, jusqu’à cette époque qu’on se plait encore à appeler niaisement la révolution industrielle, c'est-à-dire jusqu’à l’arrivée de la grande technologie dans la production intensive des biens et qui ne fut rien d’autre – mais c’est gigantesque - que la victoire d’un système sur toutes les autres formes et initiatives de production, celui du capital n’agissant plus que pour son propre compte au mépris total des besoins et même en les inventant afin qu’ils suivent servilement la courbe des inventions de la production, de plus en plus performante et sophistiquée.
Le besoin érigé en outil de production, tel fut le génie premier du capitalisme.
Il faudrait dès lors dire que les déboires actuels du livre ne sont pas dus au fait qu’il soit une marchandise - il l’a toujours été comme toutes les œuvres d’art pénétrant dans un circuit social et qui, ce faisant, s’acquièrent ou se laissent voir en échange d’argent - mais au fait qu’il est devenu une marchandise de notre époque, c’est-à-dire une marchandise exclusive. Comme pour toutes les autres marchandises, ceci s’est naturellement fait au détriment de son objectif premier qui était, je le rappelle au risque d’être ennuyeux, celui de satisfaire des appétits.
Or une marchandise qui n’est plus qu’une marchandise, c’est-à-dire qui n’a plus de saveur objective et se soucie comme de Colin tampon du plaisir qu’elle peut procurer à son acquéreur, ne poursuit pas d’autres buts que de générer du profit financier pour ceux qui contribuent à l’élaboration de son statut ou savent s’en satisfaire, en même temps que la ruine de ceux qui s’opposent à ce statut nouveau et, rêveurs obsolètes, tentent de lui redonner les raisons d’être, acquises au berceau.
Toutes ces considérations primaires pour dire, oui, le livre est une marchandise, la production intellectuelle, poétique, romanesque est une marchandise qui a perdu sa fierté initiale d’en être une. Ce statut de marchandise initiale n’était cependant pas son entité, mais son moyen de locomotion pour circuler dans le grand corps social.
Et c’est bien ce statut initial que nous (1) réclamons. Sinon, écrivons des manuscrits, photocopions-les à des milliers d’exemplaires, prenons notre bâton de pèlerin et déposons les dans les halls de gare, les boîtes aux lettres, sur les bancs des jardins publics et des métros, sur les tables de café, bref, écrivons des tracts.
Vouloir donner aux produits de l’intelligence humaine une dimension qui ne soit qu’humaine, c’est-à-dire vouloir les débarrasser de leur carapace marchande pour y retrouver toutes les joies de la création, toutes les fraternités du don contre don, tous les apaisements de la gratuité d’une vie faite pour être vécue et non plus gagnée, est le projet d’une révolution sociale qui n’interviendra, (si tant est qu’elle intervienne un jour, ce dont je doute très fort) alors que la poussière et la souffrance des siècles et des siècles auront déjà passé sur nos squelettes. Le monument aux morts de tous les hommes au grand cœur qui se sont éteints sans jamais n’avoir vu le moindre soupçon de la moindre prime aurore de leurs espérances est trop grand, trop encombré déjà pour que nous prétendions y ajouter encore notre nom. En un mot comme en cent, les lendemains qui chantent n’ont à offrir que des présents en larmes.
Les présents qui ont un sens sont donc à construire à contre sens du système, mais dans ce système, et c’est bien là toute l’ampleur, toute la difficulté de la problématique.
Mais ça n’est pas son ambiguïté.
(1) J'emploie le "nous" parce que signataire de l'Appel sans en être initiateur
LE NUMERIQUE ET INTERNET
Ce fut une bien intelligente initiative que celle qui fit figurer dans la brochure Querelle des modernes et des modernes le pot pourri des commentaires soulevés par l’Appel des 451.
Ceux-ci sont en effet d’une telle niaiserie, parfois empreinte d’une telle méchanceté aussi, qu’ils s’accusent eux-mêmes des inconséquences de l’enfantillage et contribuent ainsi à souligner le bien-fondé de l’Appel.
Ces commentaires sont tels que ma fille de douze ans, j’en suis absolument certain, n’aurait pas eu la bêtise de les formuler en l’état. Quand, par exemple, je lui dis que ce qu’elle écoute comme musique ne me plaît pas du tout et alors qu’elle m’entend à longueur de soirées jouer Brassens ou les vieilles gammes pentatoniques d’un blues sur ma guitare, elle ne me traite pas de vieux croulant ou de désespéré à la ramasse, elle dit simplement : mais c’est autre chose, papa !
Voilà, tout est dit : c’est autre chose. De même quand je discute avec un copain qui compose sa musique sur ordinateur avec un sax, une batterie et une guitare qui rend à s’y méprendre le son d’une Les Paul, alors que je compose les miennes sur le manche de ma Takamine, on ne se traite pas mutuellement de passéiste ou d’avant-gardiste à la noix. Nous savons dans un respect mutuel que si nous pétrissons une même farine, nous ne nous proposons pas de faire cuire le même pain.
Je trouve dès lors que c’est une perte de temps dramatique pour les hommes et les femmes du collectif et un gaspillage suicidaire d’énergie pour le projet que de vouloir opposer le désir de la sauvegarde du livre à l’explosion du numérique en tant que véhicule de l’écriture.
Un fichier numérique n’a jamais été un livre et ne le sera jamais. Un fichier numérique n’a jamais rempli les fonctions sociales que remplit un livre et ne les remplira jamais, au même titre que Le Voleur de Louis Malle ne satisfait pas les mêmes appétits, ne répond pas aux mêmes plaisirs que Le Voleur de Darien. D’ailleurs, il ne l’a jamais prétendu. Et c’est là toute la différence avec le fichier numérique qui, lui, prétend usurper un titre qui n’est pas le sien. Son émergence est donc entachée d’un vil mensonge ; mensonge que nous reconnaissons bien pour être celui propre à la marchandise exclusivement marchande.
S’il y a une chose fondamentale que les thuriféraires du fichier numérique n’ont pas comprise, c’est bien que la modernité ne commande nullement que l’on se jette corps et âme dans tout ce que la création artificielle et consumériste des besoins sait inventer, mais qu’elle exige, au contraire, que l’on garde un œil attentif sur ces inventions pour sauvegarder ce qui participe encore de la joie de vivre, et ce, même au risque d’être taxé de réactionnaire ou de je ne sais quel autre facile et brillant qualitatif moral. A l’ère de la déshumanisation des rapports des hommes avec leur existence, être «révolutionnaire», c’est aussi savoir encore opposer une résistance à ce qui déshabille la vie de sa substance vivante. S’il me plaît, à moi, de m’échiner au printemps dans la forêt polonaise pour couper mon bois, le fendre, l’entasser, puis de le rentrer à l’automne avec ma brouette dans la grange au lieu d’avoir fait installer un chauffage central avec commandes électroniques et alimentation automatique parce que j’aime voir et sentir la flamme qui me chauffe dans des poêles à l’ancienne, est-ce que je suis un passéiste ?
Oui, je veux bien, mais à contre-sens car est moderne tout ce qui alimente mon plaisir.
Dans l’est polonais où j’habite, traditionnellement (oh le vilain mot !) les maisons sont construites avec le bois directement puisé dans la forêt toute proche. Quand le vent a commencé de souffler de l’ouest, les marchands de béton, de ciment, de parpaings, d’isolation, de fosses septiques et de briques ont commencé de fleurir. Le bois est devenu la matière honteuse du pauvre, la matière du traditionnel, du vieux jeu et les Polonais, confondant liberté, modernité et démocratie retrouvée ont commencé d’écrouler leurs maisons en bois, si belles, si originales, pour construire des merdes standardisées comme on en voit partout en Europe. Pire, certains, ceux qui n’avaient pas la bourse pour tout reconstruire, ont conservé le bois mais l’on fait recouvrir d’un crépi comme on recouvre l’opprobre d’un rideau et le mort d’un linceul ! Pour être à la page en tournant la page, pour coller à leur époque ! Alors, quand je me suis installé au village dans une vieille maison en bois, que je l’ai rénovée en bois, que j’ai voulu lui garder le caractère primitif que lui avait donné son constructeur, les paysans du voisinage ont haussé les épaules et n’ont pas compris qu’un gars qui venait de l’ouest moderne– avec forcément plein de sous dans son escarcelle - s’amuse à des conneries pareilles.
Non, je ne me suis pas éloigné de mon sujet par ces quelques digressions d’ordre autobiographique : je vous ai parlé du livre et du fichier numérique.
Est-ce que j’aurais eu l’idée de perdre mon temps en argumentant sur mes gouts et mes plaisirs ? Non, j’avais trop à faire et c'est pour éviter la pénibilité d'un dialogue de sourds que je suis resté muet.
Je me permets donc de conseiller aux signataires de l’Appel des 451 d’en faire autant. Le débat sur le numérique est un débat oiseux, déjà dépassé par l’envie, le désir et le projet même du collectif.
Pour terminer, je dirais que je sais pertinemment ce dont je parle pour avoir publié en 2008 et 2009 deux fichiers de lecture dans une maison d’édition numérique, une qui se prend depuis le début pour le grand timonier de l’intelligence avant-gardiste.
Il ne faut cependant pas, à mon avis, contester au numérique son droit et son goût pour le fichier. Ce sont là deux sujets totalement différents, et le fichier numérique autoproclamé livre n’est pas plus en concurrence avec le livre que le marchand de volailles n’est en concurrence avec le charbonnier.
Car le numérique n’intervient pas pour avoir contribué à la ruine du livre, mais à la faveur de cette ruine. Il n’est pas prédateur, il est charognard. Il est donc hors-sujet, n’ayant en rien participé au massacre et ne présentant absolument aucune solution pour arrêter le massacre. Il est spectateur.
Et il n’y a, surtout, aucune contradiction à ne pas vouloir reconnaître un fichier comme un livre et à se servir quotidiennement d’internet. Là encore, le débat s’enlisant là-dessus, il court à son inutile ruine. J’écris sur un blog, je n’écris pas un blog. En revanche, j’écris un livre et non sur un livre.
De même, l’Appel des 541 et les travaux qui s’ensuivront trouveront forcément sur leur route des critiques expertes, à tel point emberlificotées qu’elles seront revêtues des habits de lumière de l’intelligence la plus exquise, mais qui émaneront de gens faisant, par manque de profession, profession de la critique. Des gens qui n’ayant jamais la moindre initiative à faire valoir n’ont à faire valoir que la critique des initiatives.
Il conviendra, à mon avis, de les ignorer gentiment.
La suite bientôt, ale nie wiem kiedy
10:44 Publié dans Appel des 451 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.11.2012
451 : " la querelle des modernes et des modernes "

Le collectif susnommé - dont je rappelle plaisamment que le nom n’indique pas le nombre de signataires (qui dépasse les 500), mais fait référence au livre de Ray Bradbury - vient de publier à 2000 exemplaires une brochure de 40 pages, laquelle est également téléchargeable ici, en version PDF.
Il s’agit d’un document de préparation aux journées des 12 et 13 janvier prochains, à la Parole errante, à Montreuil.
Cette brochure répond aux critiques qui ont été formulées depuis le lancement de l’Appel et sa publication dans le Monde du 12 septembre, avec rectificatif amusé de quelques erreurs commises et propres aux grands médias quand ils relaient un message, ne visant le plus souvent que les noms qui leur sont connus. Histoire de rester en famille peut-être...
Les grands médias ignorent la signification du mot collectif. De ce point de vue là, donc, nihil novi sub sole.
Je n’ai pas encore lu la totalité du document que j'ai reçu seulement ce matin. Je l'ai néanmoins parcouru en diagonale et j'ai eu ainsi un aperçu des commentaires - tous plus affligeants les uns que les autres - que l’Appel des 451 a pu susciter de-ci de-là et que la brochure a réunis sous le chapitre Pot pourri des commentaires.
Chers lecteurs de L’exil des mots, je vous souhaite bonne lecture de cette brochure. Je vous donnerai la totalité de mon sentiment après ma propre lecture et, le cas échéant, si les objectifs et la stratégie mise en place pour les atteindre sont à mon goût, la nature exact de mon engagement aux côtés du collectif.
Bon week-end à toutes et à tous.
09:46 Publié dans Appel des 451 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.11.2012
Rigolade à pas cher
 Je pense que Copon et Fillé ne sont pas des grands sensibles aux messages historiques : organiser un scrutin le 18 brumaire aurait dû leur inspirer la crainte d’un coup fourré.
Je pense que Copon et Fillé ne sont pas des grands sensibles aux messages historiques : organiser un scrutin le 18 brumaire aurait dû leur inspirer la crainte d’un coup fourré.
Qui ne manqua pas d’arriver.
Mais bon, moi ce que j’en dis c’est que le linge sale se lave en famille, même si là, il s’agirait plutôt d’oripeaux crasseux et qu’il faudra pour arriver au blanc, une grande famille… Au moins jusqu’au troisième degré.
Blague à part, ce qui est quand même déroutant pour l’esprit quand on prend un peu de recul, - oh, pas beaucoup, juste un ou deux millimètres ! - c’est de considérer que ce sont ces apôtres-là, à peine plus adultes que des mômes de CM1 et en tout cas beaucoup moins honnêtes que bon nombre de voyous croupissant dans des cellules, qui veulent monter au pinacle, diriger un pays, donner la leçon citoyenne et redresser le tout à coups de lois.
Qu’ils apprennent donc d’abord à redresser le peu de tête qui leur reste. Ça devrait les occuper un moment !
Et là n’est pas le spectacle exclusif des bandits situés sur ma droite ! A Reims en 2008, le champagne n’avait pas coulé à flots non plus et les mêmes tripotages malsains avaient bien eu lieu, semble-t-il, derrière le sacro-saint rideau des burnes des urnes.
Misère ! Comment ne pas en rire, vieux camarade qui fut mon ami, si nous ne voulons pas avoir à en pleurer ?
En fait, je dis ça comme ça, je semble m’en affliger comme un honnête homme que je ne suis pas forcément, mais, dans le fond, ça me réjouit fortement, toute cette dépravation. Ça me réjouit parce que c’est quand même un plaisir - je vous laisse en apprécier la qualité - que de voir des gens qui ne vous inspirent que mépris et colère, se rouler dans la boue comme des gorets dans leur lisier ! Je ne serais pas très à l’’aise avec mon sentiment du monde - un sentiment qui m’est apparu dès lors que j’eus trois poils sous le menton - si ces pourceaux s’avéraient avec le temps être des seigneurs de la probité, des magnanimes, des hommes d'esprit et de bien.
J’en ferais une bobinette ! Obligé de me remettre en cause de fond en comble et je n’ai plus trop le temps de faire ce grand ménage !
Alors, messieurs, continuez donc à vous ébrouer dans la fange et à donner joliment du groin. Pendant ce temps-là, au moins, vous ne ferez pas de grosses bêtises et ne souillerez que vos costumes !
Et puis, je le répète, c’est quand même pour le libertaire, l’alcoolique, le réprouvé, le sans foi ni lieu, un sacré cadeau.
Las ! Las ! Las ! Depuis le temps qu’il y a des hommes et qui vous regardent, peu sont venus pour en tirer la leçon qui s’impose!
12:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.11.2012
La leçon
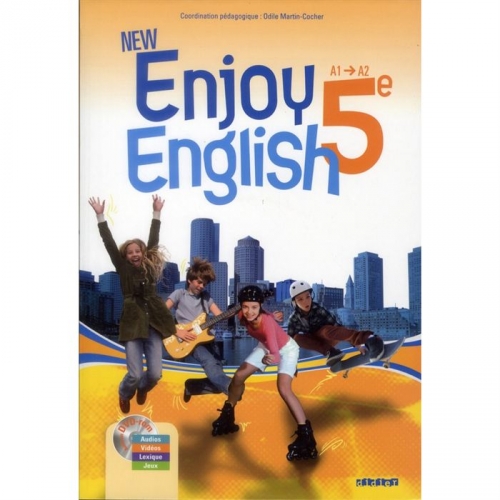 C’est la nuit. Une nuit pressée de tomber ; nuit de novembre qui baisse ses rideaux dès quinze heures. Des brouillards silencieux enveloppent le village.
C’est la nuit. Une nuit pressée de tomber ; nuit de novembre qui baisse ses rideaux dès quinze heures. Des brouillards silencieux enveloppent le village.
C’est l’heure des leçons.
- Tu me fais réciter mon anglais ?
Je pose mon livre, un peu agacé. Non pas par la gamine, mais par le livre. En mémoire de la forêt, de Charles T. Powers. Agréable à lire, certes, mais traits outrageusement forcés sur la campagne polonaise, communiste et forcément alcoolique. Presque du Zola. Quelques inepties aussi, comme ce gars arrêté près de Varsovie avec du porc clandestinement abattu dans le coffre de sa voiture. Arrêté sur l’autoroute, dit le livre. Ouais, dans un pays exsangue qui devait en compter une trentaine de kilomètres, vers Cracovie.
Mais ce n’est pas le sujet. Je vous reparlerai de ce livre que je viens de poser, agacé.
- O.K. C’est quoi au juste?
- Des bouts de phrases qu’il faut savoir traduire.
- Ah ? Curieuse pédagogie, ma foi ! Fais voir…
- Tu me les dis tout haut et je traduis. Il y aura un contrôle demain. Oral.
- Ah ? Bon. J’y vais : Have you ever played tennis ?
- Est-ce que tu as déjà joué au tennis ?
- Oui, mais faut que tu le dises en polonais.
- Pourquoi donc ?
- Parce que, demain, si tu traduis en français à ta prof, elle va faire la tête. Et je suis poli.
- Mais, à elle, je répondrai en polonais.
- Réponds-moi en polonais, donc, pour être bien dans la situation.
- D’accord.
- I’ve never eaten spinach.
- C’est bête comme tout, ces phrases, tu ne trouves pas ?
- Si, un peu. Mais ça n’est pas le problème. Alors ? I’ve never eaten spinach.
- Je n’ai jamais mangé d’épinards.
- C’est du polonais, ça ?
- Ecoute, j’y arrive pas. Je te traduis en français parce que tu es français ; la prof est polonaise, je lui traduirai en polonais et tout le monde sera content.
- Bon. Comme tu le sens…
C’est exactement ça : comme tu le sens. Sentir la langue de l’autre et s'y couler.
Et la sienne alors, de langue ? Admiratif devant ce jonglage spontané en trois langues de la part d'un enfant.
Savoir sans problème choisir la musique de l’interlocuteur, ça me sidère toujours, moi le bien médiocre linguiste.
15:43 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.11.2012
Chassé-croisé
 Le plus illustre de mes compatriotes - pour l’heure et, si j'en crois la rumeur, pour cinq ans, - est cet après-midi en visite à Varsovie.
Le plus illustre de mes compatriotes - pour l’heure et, si j'en crois la rumeur, pour cinq ans, - est cet après-midi en visite à Varsovie.
Alors, évidemment, par un vilain et coupable réflexe franchouillard, je me suis laissé aller à lire son programme. Voir, par exemple, s’il avait prévu de pousser 200 km à l’est, jusqu’à la frontière, pour venir prendre un thé à la maison. Mais non, je n’ai rien vu de tel. Son service com. est vraiment en dessous de tout !
En revanche, j’ai lu :
« Parmi eux (ceux qui l’accompagnent, NDLR) figureront les dirigeants d'EDF, Henri Proglio, et d'Areva, Luc Oursel. L'industrie française est sur les rangs pour la construction d'une centrale nucléaire dans un pays qui n'en compte encore aucune.
Il sera aussi question de la modernisation des forces armées et notamment de la marine de guerre polonaise. Le groupe de construction navale de défense français DCNS sera également du voyage.»
Hé ben, mes aïeux, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas là d’une visite de courtoisie ! Le VRP a fourré dans sa besace tout un attirail de marchandises à fourguer, et non des moindres, de l’atome, des armes et des navires !
Quand on parle de paix, le cul sur des canons *, chantait le bon poète sétois.
Questions de com-pé-ti-ti-vi-té, tout ça ! Voilà le maître mot, le passe-partout ouvrant les portes de la paix sociale. Mais à prononcer lentement, en arrondissant l'orifice buccal jusqu'à ce qu'il prenne la configuration d'un joli petit cul de poule. Si vous n'y arrivez pas, prenez modèle sur Merkel, là, en haut ; voyez comme elle le fait bien, même en allemand ! Et voyez comme François est attentif à la leçon !
Histoire, donc, de relever le niveau des entreprises françaises, de relancer l’économie, de briser la dette en endettant au passage les rusés Polacks qui ne le sont pas encore jusqu'à l'asphyxie, d’augmenter un chouilla les salaires à l’aube de 2017, de récupérer la note AAA peut-être, et, avec tout ça, de tenter une périlleuse réélection.
Et Varsovie dans tout ça ? Ben, personne n’en parle. Enfin, j’espère que le bon François ne commettra pas la bourde de l'autre excité qui, de passage lui aussi en Pologne pour vendre je ne sais quoi, avait déclaré, paraît-il : vous êtes le seul pays auquel on n’a pas réussi à faire la guerre !
Qu’en termes galants ces choses-là furent dites ! Charmant ! Il avait un sens de la dialectique apaisée, ce gars-là !
Un pays qui n’en compte aucune, qu’il dit le journaliste, en parlant des centrales nucléaires… Comme s’il s’agissait là d’une épouvantable carence qu’il faudrait pallier en vitesse. Veulent nous balancer leurs merdes, les voyous ! Je comprends mieux que François n’ait pas invité Cécile à venir faire un p’tit tour romantique sur les remparts de Varsovie. Fait pas chaud, en plus…
Bon, ceci dit, à propos de centrales nucléaires, c’est vrai qu’il n’y en a pas en Pologne. On marche au charbon ici, comme au bon vieux temps de la Révolution industrielle. Mais les Russes, tout près, dans l'enclave de Kaliningrad, en ont une et les Lituaniens aussi, un peu plus au nord. Alors… En cas de pétard, les effluves mortelles ne font certainement pas longer sagement les frontières, comme entre la France et l’Allemagne, en 1986 !
Pendant ce temps-là, tiens, je lis aussi que la môme Merkel, elle, est chez Poutine. "Pour y parler des droits de l’homme." Non ? Si ! Incroyable ! Elle enseignerait la musique à un cochon, la brave chancelière ! Elle ne recule vraiment devant rien. C’est le gars qui vient d’écoper de quatre ans de camp pour avoir manifesté dans la rue contre Poutine qui doit être béat d’admiration !
Non, tout ça, ça sent le pipeau. La rigide chancelière a sans doute, elle aussi, dans son cartable quelques prospectus alléchants à montrer à Moscou.
Un à Varsovie, l’autre à Moscou, donc. Le redressement de l’Europe est entre les mains du couple franco-allemand, citoyens !
Bon allez, je m'en vais prendre un thé chez moué, puisqu'il ne veut pas s'aventurer jusques là, ce monsieur.
A lundi !
* Le Vieux normand
13:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.11.2012
Appel des 451 : réponse partielle à monsieur Pierre Mari

Signataire de l’appel des 451, je vous engageais il y a quelque temps, ici même, à signer ce texte. En consultant la liste des signataires, j’ai d’ailleurs récemment eu le plaisir de constater que quelques camarades y avaient apposé leur nom, suite à mon invitation.
J’ai également eu l’occasion de lire une critique de cet appel, faisant écho, semble-t-il, à sa parution dans le Monde du 12 septembre dernier.
Et c’est à cette critique signée Pierre Mari et publiée sur le blog de Juan Asensio, qu’il me plaît de réagir, à titre tout à fait individuel.
Je passe rapidement sur le ton tantôt cordial et sérieux, tantôt émaillé de quelques pointes trempées au curare aussi méchantes qu’inutiles, telles que celle qui taxe les signataires de tartufferie. Monsieur Mari, ce qui l’honore, semble réclamer un élargissement et une clarification du débat. Le moins que l’on puisse dire c’est que, déjà, il ne va pas contribuer beaucoup à cette clarification en usant de tels qualificatifs, faciles, éculés, passe-partout, et, surtout, à la portée de n’importe quel imbécile faisant mine de s’opposer à n’importe quel engagement ou projet.
De même le choix de son titre : Confusion et comédie.
- Confusion, je suis prêt à cautionner. Le sujet est tellement complexe que bien malin qui l’embrasserait tout entier dans un seul texte de deux pages. Sans doute pas plus les 451 que monsieur Pierre Mari lui-même. Disons un condensé troublant des problèmes abordés. C’est peut-être, effectivement, un défaut du texte, mais ces problèmes sont tous intimement liés les uns aux autres et en aborder un pour en négliger un autre pervertirait sans doute l’approche et le raisonnement.
Et puis ce texte est une invite à la résistance, sinon à l'offensive. Il est donc d'abord d'ordre général. Nous verrons bien en quoi - les esprits s'aiguisant dans la pratique plus sûrement et plus courageusement que dans la spéculation -il deviendra plus clair et plus opérationnel.
- Comédie, voilà encore un de ces jugements moraux, un de ces jugements à l'emporte-pièce, mettant là directement en cause la bonne foi des signataires, ce qui ne participe pas non plus d’un esprit franchement tourné vers la critique sereine sur un sujet qui nous tient tous à cœur, mais du procès d'intention pur et simple. Presque de la charge ad hominem.
C’est bien dommage parce que beaucoup de traits mis par ailleurs en exergue par Pierre Mari méritent de retenir l'attention.
En substance, celui-ci, énoncé en conclusion : «Il y a des raisons d’estimer que le livre numérique est un gadget dérisoire et barbare (j’avoue que je les partage très largement); mais devant le spectacle de la gent plumitive et caqueteuse, déchaînée contre l’e-book émissaire pour mieux faire oublier sa propre impuissance, il y a d’aussi bonnes raisons, pour peu qu’on garde le sens de la farce sociale, de se laisser aller à la plus explosive hilarité. »
Nous souhaitons tout d’abord bon éclat de rire à Pierre Mari, en espérant vivement que ce rire, faisant écho aux ébrouements d’une gent plumitive et caqueteuse, ne se mue pas bientôt en un disgracieux et misérable gloussement de dindon.
Mais soyons sérieux et restons concentré : pour m’y être moi-même un moment fourvoyé avec deux ouvrages publiés chez pubis.pet en 2008 et 2009, je suis bien d’accord pour dire que le fichier numérique (et non le livre numérique, monsieur Mari, car ce fichier de bricolage néo-technique n’est pas plus un livre qu’une poule pondeuse n’est un tyrannosaurus même si elle présente avec lui, paraît-il, quelques infimes similitudes génétiques), pour dire, donc, que ce fichier est un gadget.
N’accusons cependant pas, effectivement, son effervescence et son relatif succès chez les courtisans thuriféraires de la modernité de l’objet au mépris du sujet, d’être peu ou prou responsables de la décadence du livre ; ce serait faire bien trop d’honneur aux ravaudeurs de numérique que de leur attribuer une quelconque influence sur le cours dramatique des choses.
Ces Bouvard et Pécuchet de la littérature dite dématérialisée ne sont en fait que les petits opportunistes d’une grosse décadence, dont les racines sont beaucoup plus lointaines et profondes. Ils sont mouches grouillant sur un cadavre dont ils ne sont nullement les assassins ; ils ne sont pas des prédateurs mais des charognards. En gros, le fichier numérique participe d’un abandon général (et ancien) de l'exigence de qualité dans la lecture et l’écriture, celles-ci s'étant honteusement soumises aux conditions ambiantes d’un monde exclusivement mercantile. J’insiste, monsieur Mari, sur l’adverbe exclusivement, parce qu’il sépare profondément notre présent de règne absolu de la marchandise et des rapports sociaux spectaculaires (qu’on me passe la phraséologie situ) «de la monarchie de Juillet ou le Second Empire», où cette même marchandise en était encore à l’aube de ses développements, quoique déjà fort expressifs, et non au stade de la marchandise pour la marchandise se développant et se recréant uniquement pour la pérennité de son image au détriment de son utilité.
Le livre a donc disparu - ou tend à disparaître - derrière une image du livre.
Le fichier numérique, autoproclamé livre, participe ni plus ni moins de cette chose que les spécialistes chargés de mettre le néant en action appellent l’e-économie et d’une résignation de l’esprit dans la littérature, comme dans toutes les autres formes d’art. Il n’est qu’un épiphénomène sur lequel il serait malsain de s’attarder : on risquerait de lâcher la proie pour l’ombre.
Adel Abdessemed et sa grotesque statue de Zidane ne sonnent pas le déclin de l’art sculptural : ils sont ce déclin.
Il y aurait, évidemment, bien d’autres points sur lesquels le texte - bien écrit, notons le - de monsieur Mari mériterait réponse plus exhaustive.
Je ne m’en sens pas le courage aujourd’hui et n’en ai guère le temps. L’objectif de ce billet est surtout de porter ce texte et ce débat embryonnaire à votre connaissance et, vœu pieux s’il en est, de vous engager à y participer.
14:05 Publié dans Appel des 451 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.11.2012
Le ciseleur
 Avec Les deux oncles, La tondue (1964) fut un des titres les plus contestés de Georges Brassens.
Avec Les deux oncles, La tondue (1964) fut un des titres les plus contestés de Georges Brassens.
Ce sont là deux textes qui sautillaient allègrement sur cette ligne ténue, entre tolérance, humanisme et collaboration ; cette ligne sur laquelle vous guettent toujours les croquants, les braves gens et les faux-culs, pour voir si vous n’allez pas perdre l’équilibre et franchir, pour leur délectation, les zones honnies.
Ce sont des textes à hauts risques. D’autres que Brassens, parmi lesquels de nombreux écrivains de renom, s’y sont brûlé les doigts.
La Tondue fut interdit sur les ondes radiophoniques parce que le poème rendait quelque justice, sur le ton de la dérision, aux femmes tondues à la libération, souvent par des résistants de la dernière heure, souvent par esprit de revanche malsain, souvent de façon abusive, sur des femmes dont le crime avait été d’aimer «un ennemi», ou, dans le pire des cas, d'éconduire un con patriote transi.
Censurée, donc, la chanson, car la mémoire était encore très vive sur le sujet, tant du côté des «tondeurs de chien» que de leurs victimes.
Je dis cela en gros ; il y a bien d’autres messages dans ces vers menés de façon alerte. J’en reparle car ils recèlent une des plus belles figures de style du sieur Brassens, avec une syllepse absolument savoureuse.
Le narrateur assiste donc, impuissant et silencieux, au massacre d’une belle chevelure par des bonnets phrygiens excités comme des poux. Lâchement, il laisse faire. Mais quand les exécuteurs en ont terminé de leur basse œuvre, il ramasse dans le ruisseau une mèche de cheveux et se la colle à la boutonnière. Pour rendre un hommage attendri, en quelque sorte, à la victime et, du même coup, tourner en dérision le patriotisme des justiciers à la ramasse, en s’affublant d’une décoration postiche.
Cela n’est évidemment pas du goût patriotique des coupeurs de nattes :
En me voyant partir arborant mon toupet,
Arborant mon toupet,
Tous ces coupeurs de nattes, m’ont pris pour un suspect,
M’ont pris pour un suspect.
Qu’arbore donc cet insolent ? Son culot ou, plus prosaïquement, plus visuellement, une touffe de cheveux ?
Au choix… Parce que les deux.
On ne se lasse ainsi jamais de chanter Brassens parce que, outre le plaisir de la musique - qui n’est rudimentaire que pour ceux qui n’ont jamais été musiciens -, il y a cette orfèvrerie des mots, partout présente.
Dans cette même chanson, où il est dit :
J’aurais dû prendre un peu parti pour sa toison,
Parti pour sa toison
je ne puis m’empêcher, à chaque fois, de penser aux Argonautes.
Et je ne m’inquiète pas de savoir si le poète l’a voulu ou non. Le fait est que la musique des mots est là, qui ouvre plus loin, bien plus loin, que les mots.
10:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.11.2012
Trois nouvelles rebelles
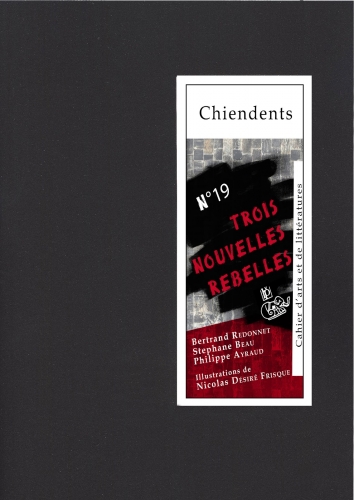
La revue Chiendents des éditions du petit véhicule vient de paraître ; c'est un joli petit livret, cousu main et illustré par Nicolas Désiré Frisque, Trois nouvelles rebelles de Philippe Ayraud, Stéphane Beau et mézigue.
Merci à eux - les éditeurs - et à Stéphane pour l'envoi dont il me gratifia d'une dizaine d'exemplaires.
Chiendent : mauvaise herbe. Au sens brassensien de l'expression.
11:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.11.2012
Passez-moi les bracelets, je vous prie…
 Je m’en veux déjà de sombrer pour la énième fois dans un commentaire de l’inactualité des actualités au lieu de vaquer joyeusement à mes propres affaires. Je sens que je vais encore m'énerver et c'est pas bon pour ma santé, ça.
Je m’en veux déjà de sombrer pour la énième fois dans un commentaire de l’inactualité des actualités au lieu de vaquer joyeusement à mes propres affaires. Je sens que je vais encore m'énerver et c'est pas bon pour ma santé, ça.
Mais c’est plus fort que mon désir de silence : quand je lis certaines choses, ne seraient-ce que des entrefilets, j’ai envie de mettre mon grain de sel dans cette soupe.
Comme si je risquais d’être enterré sous des tonnes de mutisme pour n’avoir pas levé le petit doigt.
En ces temps de vide intégral de la pensée, on débat donc à qui mieux mieux sur ce fameux sujet de société que constituerait l’institution légale du mariage homosexuel.
On a envie de dire que politiciens, législateurs et spectateurs-bouche-bée n’ont vraiment pas autre chose à foutre que d’enculer les mouches !
Car qu’est-ce qu’un homosexuel ? C’est un homme ou une femme qui vit librement ses désirs sexuels, qui assume son attirance amoureuse pour une personne du même sexe que lui ou qu’elle, et qui est donc à la recherche d’une conjugaison de son bonheur avec celui de l’être aimé.
Et je trouve qu’il faut être tombé bien bas - ou n’être jamais monté bien haut - pour ne pas considérer ça tout naturel, juste, normal et humain. Le fait même d'en parler souligne un triste état d'esprit. Nous sommes d’abord sur terre pour vivre notre vie telle que nous entendons qu’elle soit vécue, surtout du point de vue des désirs profonds, ceux qui demandent à s'exprimer par-delà le bien et le mal.
Alors qu’est-ce que le mariage vient foutre là-dedans, nom d’une pipe ?! J’ai toujours été hétéro, moi, je ne m’en porte pas trop mal, j’ai eu beaucoup de désirs, vécus ou pas, je ne suis pas mécontent des rencontres que j’ai faites au cours de ma vie et je ne suis pas marié pour autant.
Qu’est-ce qu’ils attendent donc, les homos, de ce passage devant m’sieur l’maire ? Qu’est-ce qu’ils attendent ? Que leurs amours soient plus florissantes ? Que leurs désirs soient plus épanouis ? C’est ça ? Que nenni ! C’est d’avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hétéros qui ont fourvoyé leur bel amour entre les pages du code civil ! Misère de misère ! Ils ne demandent pas à avancer, ils demandent à être rétrogradés au rang des aliénations les plus castratrices. Un droit, le mariage ? Plutôt un formulaire civil- le plus souvent parfumé par le goupillon - bourré de devoirs moraux, économiques, intellectuels, tous aux antipodes de l’amour !
Il n'y a qu’à divorcer pour s’en rendre compte et voir à quel point le sordide législateur a su mettre en œuvre toutes les bassesses de l’esprit humain quand sonnent la fin des amours et, tout naturellement, celle de l’envie de vivre ensemble !
Tellement que beaucoup choisissent les amours de l’ombre, les cinq à sept, les orgasmes volés au quotidien des jours dans les sous-bois printaniers ou les chambres d’hôtel borgne, plutôt que d’aller s’enferrer dans des procédures sordides, et surtout -pour les malades de la morale sociale - plutôt que de devoir montrer à tout le monde leur désamour et avouer devant un magistrat qui n’en a cure que leur compagne ou leur compagnon ne les fait plus bander !
La bandaison, papa, ça n'se commande pas !
Vil ! Affreux !
C’est ça, qu’ils veulent donc les homos pro-mariage ?! Aussi cons que les hétéros les plus normatifs. A la recherche d’une feuille d’impôts plus avantageuse, d’une sécurité sociale à deux têtes, d’un droit à crédit plus clément, d'une pension de réversion. Bref, que de l’amour dans tout ça !
Tenez, je suis tombé l’autre matin sur un ancien courrier, très personnel. Le courrier d’un avocat qui me disait gentiment : "le fait d’avoir vécu en union libre pendant 27 ans avec une personne ne vous donne droit à aucune indemnité ni prétention à ce que vous avez pu construire avec cette personne pendant cette période. "
C’est clair… Le législateur s’en fout de vos amours, de comment vous assumez votre bonheur. Ce qu’il veut, sous couvert de générosité et d’ouverture d’esprit, c’est vous avoir dans sa pogne en inscrivant sur son état civil votre petite cellule économico-familiale.
Le numéro de SIRET et le chiffre d'affaires de votre SARL du sexe, c'est ça qui l'intéresse.
Alors, législateur et homo, faites donc ce que bon vous semble. Toi, tends-lui les chaînes qu’il te réclame à grands cris et toi empêtre-toi à ta guise dedans, mais, de grâce, foutez-nous la paix avec vos élucubrations de faux-culs !
10:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.11.2012
Villon le facétieux
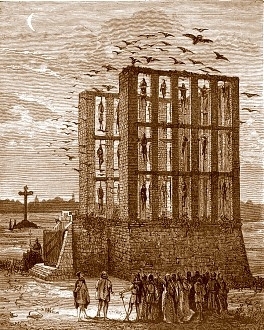 Au cours de ces petites conversations, toujours fort agréables, qui ont lieu après une soirée musicale, on m’a plusieurs fois parlé de la Ballade des pendus.
Au cours de ces petites conversations, toujours fort agréables, qui ont lieu après une soirée musicale, on m’a plusieurs fois parlé de la Ballade des pendus.
Mettre en musique un des plus célèbres poèmes du patrimoine était en effet une prise de risques. Presque une outrecuidance.
Je le savais pertinemment et j’avais collé cette musique sur Les pendus pour mon plaisir personnel, solitaire, ne pensant nullement avoir à l'offrir un jour à un public.
Bien que ma traduction ait été appréciée, j’ai donc entendu une critique que je m’étais déjà faite, celle d’avoir interprété le poème sur un ton proche du pathétique, sans accentuer le côté sardonique, le deuxième degré, des prières adressées post mortem par les pendus aux frères humains.
Critique exacte car cette ballade est avant tout une mise en scène, une raillerie même, d’où le je de François Villon est d’ailleurs totalement - et volontairement - absent.
A la différence notoire de ce quatrain que tous ceux qui ont approché de près ou de loin François Villon, connaissent sans doute :
Je suis François, dont il me poise
Ne de Paris emprès Pontoise,
Et de la corde d’une toise
Saura mon col que mon cul poise.
Ces vers font à mon sens figure originale dans l’œuvre de Villon, en ce qu’ils sont, ou du moins semblent être, purement autobiographiques, écrits qu'ils ont été juste après sa dernière condamnation de 1462 à être étranglé et pendu ; condamnation dont il fera appel et qui sera commuée en dix ans d'interdiction de paraître sous les murs de Paris.
La prudence est toujours de mise quand on aborde la vie de Villon. Les indices les plus nombreux dont nous disposons sont ceux présents dans son œuvre et c’est une œuvre à tiroirs. Une œuvre impure, qui mêle fiction et réalité avec tant d'ingéniosité et de franchise qu’il n’a jamais été aisé de dissocier réellement celle-ci de celle-là.
Le génie du poète voyou - anarchiste avant l’heure comme on se plaît parfois à le dire- fut en effet de toujours jouer entre traits autobiographiques bien distillés, extrapolations, parodies, dérisions, et contradictions. A telle enseigne, qu’il compose même une Ballade des contradictions :
Je meurs de seuf auprès de la fontaine,
Chault comme feu, et tremble dent à dent ;
En mon pays suis en terre loingtaine
Villon s’applique toujours à déconstruire le réel par la caricature, le jeu de mots et la parodie, passant du ton grave et sensible à la raillerie la plus joyeuse, mais aussi en usant d’une langue compliquée, bigarrée, mariant archaïsmes, argot des voyous, vieux français de l’époque et mots et tournures annonçant la lente évolution de la langue vers le corpus contemporain. Nous sommes à la fin du Moyen-âge.
Le Testament, rédigé au sortir de sa captivité à Meung-sur-Loire, est donc un faux testament, cruel avec ses légataires et qui brocarde avec force ironie, justice, finances et autorités religieuses, dans un langage également accessible au lettré qu'au voyou de l'époque.
Rabelais - quoique fantaisiste sur le sujet - dira au siècle suivant, que Villon était un homme de théâtre. Presque un metteur en scène.
Mais ses déboires avec la justice pour le meurtre commis sur un prêtre, Philipe Sermoise, le 5 juin 1455, le cambriolage du collège de Navarre et la rixe avec un notaire, Ferrebouc, lui valurent in fine ces fameux dix ans d’exil de la ville de Paris et sa disparition, nul n’a su dire où et quand.
Le poète disparu, sa poésie connaît la célébrité. C’est en effet à la faveur de cette disparition mystérieuse, non élucidée, que Villon entra dans la légende dès la fin du XVe siècle parce que son œuvre était profondément ancrée dans son temps et avait échafaudé une figure multiple, contradictoire et attachante :
D’ung povre petit escollier,
Qui fut nommé Françoys Villon.
On le sait, Villon sombrera dans trois siècles d’oubli, de 1533 à 1832. Il sombrera dès que sa langue acrobatique et ses mœurs de jouisseur turbulent ne seront plus comprises de l’époque nouvelle, avant d’être remis au jour par des archéologues de la langue et de la poésie.
Pour en revenir à ce fameux quatrain donc, où le cou éprouvera bientôt le poids du cul, il est indispensable de constater que Villon commence sur une ambiguïté, François désignant dans la prononciation en même temps le prénom et la nationalité.
Ce qui change tout. «Je suis Français et ça me fâche, ça m’emmerde ». En plus, Français de Paris. Ce qui est un comble.
Ce calembour est dirigé contre ceux qui l’ont condamné à Paris et surtout contre les protagonistes de l’affaire Ferrebouc dans laquelle son complice, Robin Dogis, bénéficia d’un jugement plus clément parce qu’il était savoyard.
10:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.11.2012
Petite piqûre de rappel

L’hiver dénude les formes du monde et se fait architecte de l’essentiel.
Je ne m’explique pas ce goût pour la décadence de la lumière. Je sais, aussi, que c’est pour moi la saison d'une plus forte envie d’écrire, aussi benêt que cela puisse paraître d’avoir une prédilection saisonnière pour l’écriture.
Le fait est. Le reste n’est que spéculation de type normalisant et intellectuel.
Las ! Las ! C’est un mois qui commence par une énième pantalonnade de l’église catholique dans ses nombreuses entorses faites par sa souveraineté au calendrier. La Toussaint du 1er novembre, comme la plupart des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, fait partie d’une stratégie historique chargée de frapper d’alignement les consciences, de les adapter à son dogme, par l’assassinat pur et simple des anciennes cultures païennes.
Au risque de brasser du poncif, il me plaît de rappeler quelques éléments.
Les Celtes divisaient l’année en deux saisons, l’hiver et l’été, et Samain, soit le nouvel an, était ainsi célébré dès l’affaiblissement notoire de la lumière, le 1er novembre. Cette nouvelle année était l’occasion de fêtes liturgiques immenses, de jeux, de joutes et, bien entendu, de bacchanales sans nom.
Ce jour-là, jour de la nouvelle année donc, symbolisait la fin d’un temps et la venue certaine d’un autre avec une nouvelle gestation des plantes et de toutes choses de la terre. Il était ainsi en même temps le jour de communion entre le monde des morts, ce qui fut, et celui des vivants, ce qui est et sera. Les tombes étaient ouvertes, on y allumait des chandelles et les deux mondes avaient ainsi la prétention de communier allègrement.
Ces pratiques «barbares» perdurèrent longtemps après la victoire du christianisme. Trop longtemps. Tant que, de guerre lasse, le pape Grégoire IV suggéra en 835 à l’empereur Louis Le Pieux - fils de Charlemagne dit aussi, ben voyons, parfois, Louis le Débonnaire - d’instaurer une loi qui substituerait les saints de l’église aux morts des ignorants et de déplacer subrepticement une célébration, qui avait jusqu’alors lieu le 3 mai, à ce foutu 1er novembre et ses rites désastreux de rustres et de superstitieux.
Mais dans le cœur des sauvages, l’esprit de coutume est difficile à gommer, surtout quand il est joyeux. Partout en France et en Allemagne, on fit bien allégeance aux saints chrétiens mais tout en continuant de célébrer les morts en sauvages, notamment en évidant des citrouilles ou des betteraves et en les afflublant d’une chandelle intérieure, éclairant trois cavités, les yeux et la bouche.
Deux siècles après l’instauration de tous les saints catholiques, l’Eglise, à regret, en maugréant, décida donc de sanctionner, de récupérer plutôt, les superstitions populaires et instaura la fête des morts, le 2 novembre. Une sorte de modus vivendi, du donnant-donnant qui octroyait à ces foutus païens une petite place, reculée seulement d’un jour.
Ainsi fut fait et, ma foi, fut gommée la mémoire.
Pas tout à fait quand même. Et j’en veux pour preuve ce petit texte de rappel et votre lecture, sinon approbatrice, du moins attentive.
S’agissant de cette église catholique et de mon aversion à son égard, on m’oppose souvent deux concepts qui n’ont en fait absolument rien à voir avec mon propos : la foi et la tradition.
La foi, je ne la discute pas. Jamais. Elle est une affaire d’intimité et chacun recherche son besoin de transcendance, de religiosité (et non de religion) là où s’expriment le plus profondément les dispositions de son âme. Même athée de sentiment, je n’ai pas l’envergure poétique, intellectuelle et raisonnable pour discuter de l’existence ou de l’inexistence d’un dieu. Mon propos est historique et dénonce les falsifications abominables, nombreuses, évidentes, honteuses, dont une institution s’est rendue coupable au cours des siècles.
Alors la foi, oui, respect, mais pourquoi donc aller en confier les manifestations extérieures à cette institution qui, à part pour les gens de mauvaise foi, justement, et les ignorants, n’est que commerce où la mort tient lieu d’article de luxe et la manipulation de force de vente ?
Tout cela me fait penser à quelqu’un qui serait épris d’un incommensurable et soudain besoin d’aimer et qui se jetterait tout de go dans les draps de la gourgandine la plus en vue, la plus autoritaire, la plus experte et la plus ancienne de la cité.
La tradition et les fondements de toute la société européenne ? Oui, mais que valent pour l’homme libre, une tradition et des fondements jetés sur des bases dont personne ne saurait sérieusement contester qu’ils sont d’abord mensongers et artifices d’une prise de pouvoir ?
Rien, sinon ce que valent au théâtre les trompe-l’œil quand ils ont capté l'attention du public au détriment des acteurs.
11:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
31.10.2012
Récit d'une brève incursion en terre natale - 2 -
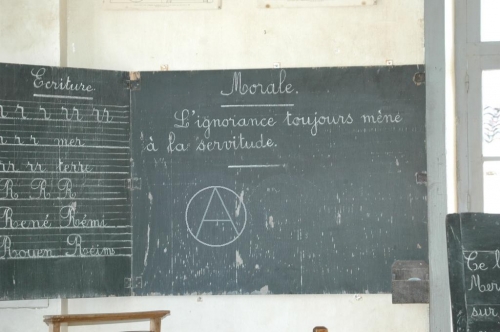 La petite route musardait entre des collines timides et des champs ceints de murets de pierres sèches. Avec elle, je traversais des noms de village qui surgissaient des brumes d’un souvenir diffus.
La petite route musardait entre des collines timides et des champs ceints de murets de pierres sèches. Avec elle, je traversais des noms de village qui surgissaient des brumes d’un souvenir diffus.
Il pleuvait. Il pleuvait à verse, sans arrêt, sur ces champs en labour et ces maisons anciennes, serrées les unes contre les autres, jaunâtres et délavées. Je remontais doucement la saison de mes enfances ; je remontais jusqu’au Silence des chrysanthèmes.
La cour de l’école m’apparut minuscule et les platanes gorgés de grisaille venteuse pas si grands qu’ils en avaient eu prétention dans ma mémoire.
Le mur du presbytère qui délimite la cour de récréation, lui, était resté fidèle à notre lointaine rencontre : austère, ne laissant apparaître qu’un bout de chevelure rousse de quelques marronniers, toujours attentif à séparer les choses qu’on apprend du ciel de celles qu’on apprend de l’instituteur. Un mur comme la statique conviction des idéologies.
J’ai regardé ce mur. Je me suis souvenu, comme jamais, que derrière lui retentissaient, en juin ou en mai, mêlés aux parfums des arbres en fleurs, les cris joyeux de tous les enfants qui se préparaient à la communion et bénéficiaient ainsi d’une semaine de bourrage de crâne intensif.
Je restais alors seul avec l’instit. Il me parlait de livres, il me parlait des poètes, il me parlait des tumultes lointains de l’histoire. Une complicité énorme s’établissait entre lui et moi et nous jetions de temps à autres des regards goguenards vers ce mur derrière lequel s’égayaient les futurs et joyeux communiants, mes copains et ses élèves.
Cette boucle qu’on appelle la vie et qui se promène du point zéro au point zéro, faisait-elle mine, soudain facétieuse, de se refermer ? Vanité que de vouloir saisir le temps ! Vanité que de vouloir dire autre chose que notre cheminement, libre, immense et tellement étroit, sur cette boucle ! Vanité que de vouloir transmettre autre chose que la désespérante, l’inéluctable, fin du voyage ! Vanité ! Vanité, tout ça !
Il m’a semblé tout à coup n’avoir rien fait, n’avoir pas bougé d’un pouce, n’avoir rien appris de précieux depuis cette cour, ces platanes et ce mur.
Je suis rentré dans la classe où m’attendaient les enfants. Vingt têtes souriantes, curieuses, adorablement attentives. Que pouvais-je leur dire qu’ils n’auraient à apprendre d’eux-mêmes ? J’ai simplement dit que j’étais né ici, qu’il y avait longtemps, très longtemps, j’étais assis là même où ils étaient assis et qu’ils ne savaient pas encore la chance sublime qu’ils avaient d'être assis là.
Ils m’ont demandé si écrire était un métier…
Pas plus que le fait d’aimer, ai-je murmuré.
J’avais apporté avec moi ce texte-ci. Pour leur lire. Je ne l’ai pas fait. Le temps passait trop vite et ils avaient mille questions à me poser. Et puis un texte, confronté au réel de sa situation, semble toujours quelque peu impudique.
Une heure durant, les enfants m’ont ramené chez moi, où je savais pourtant que je n’avais plus rien à faire.
Car s’il y a toujours un chez, vient un temps où il n’y a plus de moi.
J’ai retraversé les villages oubliés, les rideaux de pluie et les champs ceinturés de pierres sèches.
Accrochée au fond du cœur, une irrésistible envie m’est venue alors de revoir la Pologne, ma maison, ma cour, le village, la forêt, les Polonais, ma solitude, un champ de neige que traverseraient nonchalamment deux élans.
Une irrésistible envie de revenir au point où j’en suis sur la boucle ; ce point virgule qu’on appelle le présent et qui n’est en fait que l’éphémère repère posé sur une course fatale et qui ne sert à rien, sinon qu’à courir fatalement.
Ce sont les lieux d’enfance, avec leurs choses imprégnées du je primaire, qui sont de véritables exils. Parce qu’ils prennent à rebrousse-poil la boucle, refont à l’envers l’impossible voyage et mesurent ainsi l’inaccessible connexion quantique de l’être avec l’espace et le temps.
11:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.10.2012
Récit d'une brève incursion en terre natale - 1 -
 Somme toute, ce fut un voyage-aller tout ce qu’il y a de plus normal au monde : l’avion perça le plafond nuageux au-dessus de Varsovie, continua sa route légèrement chaloupée sous le bleu resplendissant de l’ozone et, en bas, le train qui devait m’emmener à Niort, via Poitiers, affichait trois heures et demie de retard parce que, quelque part en Picardie, deux personnes avaient décidé de s’infliger à quelques heures et kilomètres d’intervalle, le sort que s’infligea Anna Karénine.
Somme toute, ce fut un voyage-aller tout ce qu’il y a de plus normal au monde : l’avion perça le plafond nuageux au-dessus de Varsovie, continua sa route légèrement chaloupée sous le bleu resplendissant de l’ozone et, en bas, le train qui devait m’emmener à Niort, via Poitiers, affichait trois heures et demie de retard parce que, quelque part en Picardie, deux personnes avaient décidé de s’infliger à quelques heures et kilomètres d’intervalle, le sort que s’infligea Anna Karénine.
Le haut-parleur ânonnait son antienne avec autant d’émotion que s’il eût à annoncer le prix du pigeon sur pied : blablabla blabla accidents de personnes et blablabla… J’étais amusé, qu’on me le pardonne en ces circonstances désastreuses où des humains se jettent sous des trains ! J’étais amusé parce que la voix claironnait qu’elle nous tiendrait bien sûr au courant de l’évolution de la situation en temps réel et qu'elle claironna ces louables intentions pendant deux heures au moins, ce qui m’apparut comme l’exact contraire d’une quelconque évolution.
Je vous informe que la situation n’évolue pas d’un poil, eût été nettement plus pénétrant.
Des gens râlaient, d’autres affichaient un calme digne du plus stoïque des philosophes de l’Antiquité, d’autres, de loin les plus nombreux, baissaient la tête, suspendus à leur portable et parlaient de retard, de correspondances ratées, d'accidents graves, de galère, et de comment on fait. Un gars de Strasbourg, qui faisait le chemin (de fer) Alsace/Marne-la-Vallée deux fois par semaine, me souffla à l’oreille que c’était toujours comme ça, et que lui, ça faisait belle lurette qu’ils n’y croyaient plus à toutes ces Anna Karénine de la SNCF !
Jagoda traduisit qu’accident de personne, ça signifiait tout bonnement que personne n’avait eu d’accident et que, donc, qu’est-ce qu’on faisait là, et que mince alors, qu’est-ce qu’on allait s’ennuyer pendant plus de trois heures à Roissy, qui est moche et grouille de gens !
Arrivée, donc, fort tard dans la nuit, sous une pluie battante. Déviation labyrinthique dans la dernière petite ville, Melle, déviation aux indications contradictoires posées comme autant d'énigmes à résoudre, nombreux fourvoiements, marches arrière, demi-tours, coups de fil, repas froid, appartement humide…
Mais tout allait néanmoins pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Car j’étais venu pour chanter ma musique et les poètes et quand on vient pour chanter sa musique et les poètes dans son pays natal, ce ne sont pas ces mesquins incidents de parcours qui sont de taille à vous entamer le moral, n’est-il pas vrai ?
En m’endormant, j’ai pensé à ces deux personnes, le corps déchiqueté par des tonnes de ferraille lancées à toute vitesse et à Cesare Pavese : une bonne raison de se suicider ne manque jamais à personne. Assez de mots ! Un acte !
Le suicide m’effraie. Pas le mien. Celui des autres. Quelqu’un qui se suicide ne voit pas sa mort : il l’offre en partage à l'épouvante des autres.
Le Poitou avait cependant décidé de m’accueillir par des sanglots longs comme des jours de mitard. Six jours durant, le ciel a dégouliné ses miasmes liquides sur les labours, les chaumes, les routes et les bois. Que du gris qui, en s’écoulant des nuages, se métamorphosait en boue.
Je ne m’y attendais pas. J’avais souvenance d’un climat océanique humide, certes, mais clément par rapport à ma latitude continentale. Hé ben ! L’averse fut hystérique et opiniâtre.
Et moi, tous les soirs, qui entamais le spectacle par « Figure d’exil » :
Le vent était humide et me volait mes coiffes !
Longtemps que je n’avais eu à soutenir le regard d’une salle plongée dans le noir, où l’on ne distingue que des silhouettes de tête à travers la lumière diffuse d'un projecteur, qui vous chauffe la joue.
Ce fut, à chaque fois, de grands moments de trac en coulisses, d’émotion en rentrant sur scène et de plaisir retrouvé à chanter les poètes.
A la fin d’un de ces concerts, m’attendait une dame au bras de son mari. Elle n’était pas spécialement venue là pour m’écouter, bien qu’elle me félicitât chaleureusement pour ma Ballade des pendus de François Villon. Elle était venue pour me parler de Géographiques. Elle me confia que c’était là le meilleur livre qu’elle avait lu depuis fort longtemps, que ce livre était très intelligent et très beau. Qu‘il l’avait happée et emmenée très loin.
Je me sentais gêné, certes, mais profondément heureux. Je lui dis alors que sa lecture me faisait énormément plaisir, car cet ouvrage n’avait rencontré aucune audience et, même, avait été un fiasco du point de vue des ventes. A peine 200 exemplaires en deux ans d’existence !
Et j’ai évoqué, tristement et in petto, la critique de Marc Villemain selon laquelle «Redonnet n’avait jamais si bien écrit que dans Géographiques.»
Cette dame m’a foutu le cafard. Elle me donna néanmoins la plus enrichissante conversation que j’eus après concert au cours de ces dix jours. Non pas par l'entremise de ses compliments, mais pour le rappel impromptu de cette évidence qui nous accable tous : si nous ne rencontrons qu’une vingtaine de lecteurs sur mille exemplaires, écrire est bien plus qu’une illusion. C’est envoyer une lettre personnelle à quelques destinataires éparpillés et solitaires dans les innommables déserts de l’abandon de l’esprit.
Je ne suis pas allé, pendant ce séjour, à la rencontre de mon histoire. Je n’ai plus d’histoire à la rencontre de laquelle je pourrais me porter. Je le dis parce que je le ressens comme tel.
Je suis allé à la rencontre de ma pré-histoire. Notamment quand il me fut donné de parler devant des bambins de CM1 et de CM2, à Chaunay, dans cette même classe où j’avais été moi-même élève, il y a cinquante ans. J'ai traversé la même cour de gros goudron, vu les mêmes trois platanes qui pleuraient sous le gris de la pluie, aperçu le même préau.
La fuite du temps, quand on la saisit dans ses mains pour un court instant, c’est cette mélancolie désespérante, tangible, qui, contradictoirement, donne tant de bonheur à la tristesse.
Celle qui bat la juste mesure de l'éternité du point zéro.
11:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.10.2012
Ce fut une bien belle tournée de clochers en clochers
Le reste, la France sauce hollandaise, la parano crisiaque et ses gaietés absentes, j'en parlerai plus tard... Pour l'heure, je suis sous la neige et c'est bien beau et c'est bien loin et c'est bien tôt.
Les guirlandes de l'automne soufflées par les flocons.
L'oiseau blessé d'une flèche - La Fontaine -
Les mangeux d'terre - Gaston Couté
Les deux mulets - La Fontaine
La ballade des pendus - François Villon
Le roi boiteux - Gustave Nadaud -
Saltimbanques - Apollinaire -
Au revoir...
Crédit photographique : Gilles Vincent
13:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
























