12.10.2012
L'habitude du h
 Elle rentre de Varsovie où sa classe a passé une journée de découverte en divers lieux, dont bien évidemment l’incontournable zoo.
Elle rentre de Varsovie où sa classe a passé une journée de découverte en divers lieux, dont bien évidemment l’incontournable zoo.
Elle dit, en me montrant fièrement une espèce de peluche :
- Regarde, je me suis acheté un nibou.
- Un hibou, que je corrige.
- Un hibou, qu’elle se corrige à son tour. Il est joli, hein ?
- Oui, il est mignon… Et à part ça, t’as vu quoi au zoo ?
- Plein d’animaux. Des singes, un tigre, des vautours, un lama, un ippopotame et…
- Un nippopotame, que je l’interromps, emmerdant comme tout.
- Bon, faudrait savoir... Tout à l’heure tu m’as dit un hibou. Les deux mots commencent pareil.
- C’est vrai. Mais dans hibou, le h est aspiré. On ne fait pas la liaison.
- Aspiré ? Comme quand on aspire de l’air? Ça veut rien dire, ça, dans les mots qu’on dit.
- Admettons. En revanche, dans hippopotame, le h est muet.
- Muet ?
- Oui, on ne le prononce pas, si tu veux. On fait comme s’il n’était pas là.
- Et comment on sait, hein, dis-moi un peu, pour savoir si le h est là ou s’il n’est pas là ?
- Ben… Ben… Je sais pas trop, en fait. L’habitude. On sent ça au son, s’il faut faire la liaison ou pas.
- Ah ! Ah ! Ah ! Elle est bonne, celle-là ! L’habitude ! Et tu dis toujours : Język polski jest trudny* ! Hé ben, Język francuski nie jest bardzo łatwy*, que je te dis, moi.
Ce qui est facile, ai-je envie de dire, c’est ce qu’on a appris sans l’apprendre. Ce qu’on a appris quand on a appris la nécessité de parler. On retient de la musique. La langue, c’est ça : un cordon ombilical qui nous relie en permanence au monde dans lequel on est né. Mais, hélas, je m’entends dire et ça dérape un peu :
- L’habitude, c’est ce qu’on fait sans le savoir. Sans se poser de questions.
- Hum… Et si c’est une mauvaise habitude, comme tu dis souvent, on fait quoi ?
- On se corrige. On essaie du moins…
- Alors, là, si on fait ça, on se pose des questions et si on se pose des questions, c’est que ça n'est pas une habitude.
- Et moi je te dis que tu as la mauvaise habitude de dire un nibou, alors qu’il faut dire un hibou ! Je te corrige donc.
- Et moi je te dis qu’un nibou, c’est plus joli qu’un hibou. La mauvaise habitude, c’est peut-être toi qui l’as, après tout.
- Alors c’est que ma langue a de mauvaises habitudes. Comme le polonais avec ses pluriels compliqués qui changent à partir de cinq et ses déclinaisons et ses tas de consonnes à n’en plus finir, que ça en est imprononçable.
- Hum ! (haussement boudeur d’épaules)
- Oui ? Słucham.*
- T’as raison. Je disais des bêtises. Faut dire un hibou. Il est beau, hein ?
- Très.
- Et dans héron, il est comment ton h ?
- Il est aspiré. Sinon ça ferait un nez rond.
- Ah, là d’accord, c’est normal ! Ça a un bec long et pointu, un héron.
- Grrrrr...
* Le polonais est difficile
* Le français n'est pas très facile
* J'écoute
09:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.10.2012
Promenades

Je l’ai suivie des yeux, cette pie, et, comme souvent quand je regarde un oiseau se promener, je me suis demandé où il allait et pourquoi.
Les pensées anthropomorphistes sont des pensées d’égocentriques.
Comme toujours, je me suis interrogé si un oiseau, ou un animal quelconque, savait se bien promener ou si ses déplacements n’étaient dictés que par des exigences de survie alimentaire. Un travail.
Je crois bien que oui et ça réduit considérablement le champ poétique du regard. Tout ce qui ramène aux hommes, décidément, réduit considérablement le champ poétique du regard.
La pie a disparu où disparaissait le ciel, derrière des arbres rouge et or, et j’ai continué ma promenade jusqu’au village situé par-delà la forêt. Par un chemin de sable encombré d’ornières.
C’est tout. Je n’ai rien vu d’autre et n’ai entendu que du silence d’automne.
Dans ma tête, je répétais les poèmes que je dois chanter bientôt sur scène. Je me disais, tiens, là, ce serait peut être plus joli de faire tel ou tel accord ou d'enchaîner sur telle ou telle gamme.
Ça n’était donc pas une vraie promenade où l’âme du paysage est avec vous.
Mais est-ce que ça existe vraiment des promenades comme ça ?
Le promeneur promène toujours une valise qu’il n’arrive pas à poser à terre. C'est pour ça qu'il donne le change en s'affublant d'un sac à dos.
Par exemple, quand je vois des gens qui marchent pour avoir une activité saine, physique, soigner leur corps, pour éliminer des toxines, je me dis souvent qu’ils ont raison, que je serais bien inspiré de les imiter, mais qu’ils n’ont pas besoin de paysages pour ça.
Pourraient tout aussi bien marcher dans un tunnel, après tout.
10:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.10.2012
Histoire de dire
 Quelque cinq mois après l’avènement du sieur Hollande à la tête de la République française, il y a vraiment de quoi se fendre la pipe jusqu’aux deux oreilles en lisant (en parcourant d’un œil désinvolte plutôt) ce que braillent de-ci, de-là, ses thuriféraires d’une mauvaise foi à vous couper le souffle, comme ce que jappent ses détracteurs les plus acrimonieux, pas de meilleure foi pour un sou.
Quelque cinq mois après l’avènement du sieur Hollande à la tête de la République française, il y a vraiment de quoi se fendre la pipe jusqu’aux deux oreilles en lisant (en parcourant d’un œil désinvolte plutôt) ce que braillent de-ci, de-là, ses thuriféraires d’une mauvaise foi à vous couper le souffle, comme ce que jappent ses détracteurs les plus acrimonieux, pas de meilleure foi pour un sou.
Le pauvre homme, qui soigne pourtant avec beaucoup de précision son image poupine, glabre, d’homme débonnaire et serein, doit s’allonger tous les soirs sur ses oreillers de soie auprès de sa journaliste préférée, enfouir son nez dans la dentelle subtilement parfumée d’une épaule à moitié nue, poser sa main potelée sur un sein palpitant d’ambition d’émotion contenue et soupirer, essoufflé, une vieille réminiscence de ses années de collège :
- Mais que diable sommes-nous venus faire dans cette galère, chérie ?
Juste un mot, tiens, en passant, à propos de cette compagne qui s’évertue - avec plus ou moins de bonheur - à les faire couler, les mots. Elle déclare à qui ne sait plus entendre qu’il lui faut bien continuer à travailler parce qu’elle a des enfants à charge, elle ! Et comment ferait-elle pour les nourrir, ces enfants, hein, si elle quittait son emploi ? Benêts que vous êtes, vous n’y aviez pas pensé à ça ! Egoïstes, va ! Méchants drôles ! Anarchistes !
Comme on n’a ni le droit, ni les moyens de lui foutre des baffes, ne nous reste plus qu’à rire de consternation devant cette déclaration ahurissante de populisme. On a presque honte pour elle.
J’imagine qu’on a dû essuyer une larme dans les chaumières smicardes ! Dans celles qui ont été virées de leur gagne-pain, celles où «les enfants encore à charge» promènent leurs yeux inquiets sous la chandelle des tristes soirées, on a dû froncer le sourcil. Peut-être même serrer le poing. Enfin, espérons-le… Sans trop y croire quand même.
Bref, laissons donc la première dame papoter comme la dernière des mégères. On s’en fout après tout.
Comme on s’en fout que Hollande soit un bonhomme à la droite de la gauche qui vise le centre, coincé par la finance et le grand capital qui ne lui laissent comme champ d’exercice de sa compétence annoncée que la rubrique émotionnelle des faits divers, aussi dramatique soit-elle, comme à Grenoble.
Ou alors comme celle d’accrocher un pin’s rutilant au revers du veston de Paul McCartney. En voilà bien une affaire !
Ce qui me fait rire, donc, dans tout ça, c’est l’inintelligence crasse et fondamentale des deux camps : celui qui le soutient et celui qui le démolit. C’est l’éternel recommencement des fausses opinions, l’éternelle antienne des cervelles vidées de leur substance, l’éternelle fausse guerre des gens qui ont renoncé à la pensée.
Le camp qui le soutient y va à grands coups de déclarations chaque seconde démenties par le réel. Des professions de mauvaise foi épaisses comme des écrans de fumée. Du révisionnisme historique en temps réel. Je dirais presque : faut l’faire !
Celui qui le démolit (et qui vient de se vautrer cinq ans durant dans les palais de la République sans n’avoir fait avancer d’un pouce le schmilblick des imbranlables contradictions sociales) lui reproche tantôt d’être un homme de gauche, tantôt d’être un homme de droite. C’est-à-dire d’être tantôt un gars qui fait ce pour quoi il a été élu, tantôt un traître, un usurpateur.
Qu’on lui reproche d’être de gauche, ça, je le comprends un tout petit peu. Il n’est pas plus de gauche que mon pouce droit, mais bon, il y a plus de cinquante ans en politique que l’étiquette du pot est plus vraie que le contenu ! Je veux dire, pour ce pot de gauche là, une étiquette étriquée, malsaine, abusive.
Mais qu’on lui reproche d’être de droite quand on est à droite, là, j’y perds ma boussole.
Un ennemi qui passe à l’ennemi n’en devient-il pas un ami ? Curieux déni de dialectique, ma foi !
Bref, dans ce camp-là on reproche au bonhomme d’être là. Et c’est tout. Dans l’autre, on est content qu’il soit là, mais on ne sait pas trop pourquoi il est là.
C’est aussi con que ça.
Moi, je m’en fous. Surtout d’ici. J’étais viscéralement content, et je l’ai dit sans ambages, de voir un voyou-valet de la finance, arrogant et teigneux en plus, foutre les voiles et mon contentement a duré l’espace d’une journée peut-être. Contentement puéril, mesquin, j’en conviens, et qui me valut d’être taxé d’homme de gauche. En matière d’idées qui n’en sont pas, c’est vraiment con, les gens, quand ils ne voient que d’un œil ! On dirait qu’ils s’évertuent à regarder avec celui qui leur manque.
Tout cela donnerait presque envie de prendre tous les camps en amicale compassion, avec cette peine humaine qu’on a parfois devant les déficients, s’il ne s’agissait, en fait, du saccage systématique de la vie des gens, de leur bonheur d’exister, de leur intelligence, de leur réduction pure et simple à des objets imbéciles.
Décervelés.
Mais, je le répète, ce que j’en dis, hein, c’est histoire de dire. Tant que Mac Mahon ne reviendra pas fusiller le peuple de Paris, je n’aurai aucune émotion à voir Pierre, Paul ou Jacques s’installer un moment sur le trône de la bouffonnerie démocrate.
11:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.10.2012
L'enracinement de l'exil - Fin -
 Je ne suis pas certain d’avoir écrit tout de ce que je pourrais dire sur la Pologne, car l’écriture, moins directe et spontanée que l’oral, a ses limites dans l’expression du ressenti… Elle fouille plus que l’oral, certes, mais en décalage du directement vécu.
Je ne suis pas certain d’avoir écrit tout de ce que je pourrais dire sur la Pologne, car l’écriture, moins directe et spontanée que l’oral, a ses limites dans l’expression du ressenti… Elle fouille plus que l’oral, certes, mais en décalage du directement vécu.
J’ai donc plus décrit que je ne me suis réellement situé.
L’histoire, les gens, leurs façons, la géographie, la langue, le climat, tout cela a été dit de façon pêle-mêle et incomplète, en voulant souligner la différence d'avec ce que j'avais vécu jusqu'alors.
La culture polonaise n’est pourtant, dans ses fondements, pas très éloignée de la culture française, modelée qu’elle est, elle aussi, par le judéo-christianisme et l’histoire de l’Europe en général.
La Pologne est aujourd’hui ce qu’elle est parce qu’elle a été façonnée par l’esprit de Rome dès le Xe siècle et, plus tard - beaucoup plus que n’importe quel pays au monde - par les grands conflits et les catastrophes des XIXe et XXe siècles : anéantie par les Empires centraux, effroyable billot des crimes nazis les plus monstrueux, muselée par le communisme, libérée à la faveur de l’écroulement de l’empire soviétique et s’engouffrant aussitôt à corps perdu dans le chaos consumériste et libéral qui fait rage partout ailleurs.
Elle est, comme tous les autres pays, en train de disparaître sous les traits du visage unique des nations, visage maquillé par l’idéologie de la croissance, l’idéologie de la richesse, l’idéologie de la productivité.
Mais elle n’a guère que vingt ans d’âge dans ce tonneau-là et c’est la raison pour laquelle elle sent encore le passé, elle sent encore la racine, elle sent encore l’avant déshumanisation.
Mais par des détails que peut-être seul distingue l’exilé.
Parce qu’il n’est pas un jour où il oublie qu’il est ailleurs et que cette conscience de n'être pas chez lui le fait observer chaque chose.
Dimanche dernier, par exemple, je suis allé à Białowieza. Voir les couleurs de l’automne sur la grande forêt. Soleil frisquet, avec ce petit vent qui fait le beau temps des équinoxes et les nuages très haut, blancs dans le ciel.
Un vieux monsieur et une vieille dame, tout de noir et de blanc vêtus, sur des chemins de traverse filant sur la plaine, faisaient leur promenade dominicale. Avec la charrette du dimanche, bien peinte et propre comme un sou neuf, et le cheval à la crinière ornée de pompons. Je les ai bien regardés. Est-ce mon regard, ou est-ce la réalité ? Ils avaient l’air heureux et ils avaient l’air de s’aimer. Ils souriaient, ça, j’en suis certain, et le soleil éclairait leur sourire.
Ils n’étaient pas abîmés.
Ils attendaient tranquillement à un carrefour pour traverser la route où déboulaient les voitures lancées à toute vitesse. Personne, m’a-t-il semblé, n’a fait attention à eux. Ils venaient de trop loin, ils étaient trop loin, ils étaient cet avant dont la Pologne et les Polonais ne veulent plus entendre parler.
Pourtant, dans la vallée du Bug, les Agroturystica*, proposent fièrement des promenades en carrioles pour les touristes. Avec de petits cabriolets rutilants et des chevaux roux à la large croupe.
On veut, comme partout ailleurs dans le monde, bien jouer à l’avant, mais en le détachant bien de sa vie, par amusement, par je ne sais quoi, par…. On met partout en pratique et en évidence cette fameuse phrase de Guy Debord : tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation.
C’est cette représentation, cadavre de la vie, qu’on aime.
Et cette phrase ne s’applique pas, hélas, qu’à mon pépé et à ma mémé, les vivants, et qu'à mes touristes qui font un tour de carriole, les morts qui tentent de se rappeler un brin d''existence, mais à l’ensemble de toutes les activités humaines de la planète.
Alors, pourquoi la France me manquerait-elle ? Qu’y trouverais- je qui pourrait nourrir mieux mon envie de vivre pleinement, d’aimer, de ne pas mourir, de sentir, d’écouter le vent, de voir se lever le soleil et décliner les jours ? Y entendrais-je des voix plus fraternelles ? Seraient-elles plus fraternelles, ces voix, parce que timbrées dans ma langue ? Quelles mains amicales viendraient se poser sur mon épaule ?
Si, là-bas, d’où je viens, les hommes étaient plus heureux de vivre ensemble leur vie, ça se saurait.
Mon cœur est ici. Parce que c’est ici que j’aurais peut-être mesuré avec plus de force combien la solitude, la simplicité de vivre, est source de quiétude et combien j‘aime cette solitude, où l'on a de comptes à rendre qu'à soi-même.
C'est ici, parce qu'exilé, que j'aurais le moins éprouvé le besoin de faire partie de.
Non, la France ne me manque pas. Sans doute l'aimé-je, mais je sais qu'elle est plus belle dans ma tête que lorsque je l'avais sous mes pieds.
Et j’ai emporté avec moi ce qu’elle avait de plus beau à m’offrir : sa langue.
* Gîtes de vacances
12:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.10.2012
Appel des 451
Parce que le support séculaire de la littérature, le livre, s'est prostitué jusqu'à bientôt son agonie à la veulerie d'esprit de notre époque, à ses modes mercantiles de bas étage, aux best sellers de la médiocrité soutenus par les médias, les Amazon et autres grands trusts de l'édition et de la distribution, tout comme au numérique qui tente - avec un certain succès - d'usurper son identité et de lui voler ses titres de noblesse, je tiens à vous informer de l'existence d'une résistance qui s'organise et vous invite à y participer si votre conviction de lecteur, d'écrivain, d'ami du livre et de l'écriture, vous en dit.
Commencer, par exemple, son entrée en résistance en lisant ici.
Ca, enfin, il est plus que temps de faire entendre nos voix, en pratique, par-delà jérémiades et constatations impuissantes d'un désastre qui n'est, en fait, que l'épiphénomène du désastre de la résignation générale des esprits devant la victoire totalitaire du spectacle, où, partout, la photocopie a plus de valeur qualitative et humaine que l'original.
Me suis inscrit ce matin.

09:37 Publié dans Appel des 451 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.09.2012
René-Guy Cadou, Marc Robine
 Je fais une petite pause dans l’enracinement de l’exil - sans jeu de mots facile -, car je voudrais vous faire partager mon émotion à l'écoute de ce texte de René-Guy Cadou mis en musique, simplement mais magistralement à mon goût, par Marc Robine.
Je fais une petite pause dans l’enracinement de l’exil - sans jeu de mots facile -, car je voudrais vous faire partager mon émotion à l'écoute de ce texte de René-Guy Cadou mis en musique, simplement mais magistralement à mon goût, par Marc Robine.
Marc Robine, René-Guy Cadou, Gaston Couté et bien d’autres… Si un jour je ne suis plus feignant, si un jour j’en ai la force et le talent, j'aimerais bien écrire une anthologie de tous ces poètes de cœur, ces poètes disparates, ces poètes du partage du monde, oubliés le plus souvent de notre mercantile saison, ces étoiles filantes comme j’aime à les appeler, qui ont traversé la vie avec la gourmandise du cœur, avec passion et très vite, trop vite, trop injustement foudroyés à la fleur de l’âge.
Marc Robine, grand passeur de mots, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire ici, l’excellent hommage que lui rendit son copain Fred Hidalgo.
Quant à René-Guy Cadou, 1920-1951, le hussard en blouse, compagnon de Pierre Reverdy et de Max Jacob, vous le connaissez sans doute, poète sensible, très proche. On peut lire ici.
Ce texte-là me touche particulièrement, me donne des frissons aux cheveux, écrit par un jeune homme que la Faucheuse s'apprête à moissonner à l’âge de 31 ans, et qui le sait. Tout comme Couté, exactement quarante années auparavant :
Que voulez-vous de moi,
Maintenant que je n’ai
Pas même pour saluer,
La grâce des poneys?
Peu d’années ont suffi
Pour voiler mon regard.
Et qu’on ne me cherche chicanes de droits d’auteurs pour cette mise en ligne, car je lancerai alors le mot magnifique, généreux, de Marc Robine, inscrit sur un de ses albums :
Celui qui sera pris en flagrant délit de chanter l’une de ces chansons sans ma permission a toutes les chances de devenir l’un de mes bons copains.
Il faudra, hélas, faire fi, si possible, des fautes commises dans cette vidéo à peu d’années ont suffi, ainsi qu'à graffiti
09:47 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.09.2012
L'enracinement de l'exil - 26-

Géographie - 2 -
J’ai plus ou moins rêvé - car je ne me souviens plus si je dormais vraiment ou si j’étais dans un état de demi-sommeil - que je contemplais la géographie avec les yeux des grands migrateurs, rivés sur l'espoir de leurs quartiers d'hiver.
Des bois, des forêts, des vallées, des monts, des fleuves, des plaines et des taches urbaines telles des verrues… Je voyais ainsi la grande plaine européenne courant de l’Oural aux rivages atlantiques, en se rétrécissant au Nord où elle longe la Baltique, la Mer du Nord et la Manche.
Cette plaine était autrefois engloutie sous la forêt, la grande forêt, la forêt initiale, dont la Biélorussie et la Pologne se partagent seules aujourd’hui le dernier vestige avec la forêt dite de Białowieża.
Je me rends assez souvent sur ces lieux de mémoire de la géographie hercynienne. Les arbres géants - sapins, pins, mélèzes, tilleuls, épicéas, chênes, charmes -, la multitude des bois morts gisant sur les mousses épaisses ou alors dressés sur des troncs gigantesques, éteints mais debout, les enchevêtrements du sous-bois livré à lui-même depuis la nuit des temps, évoquent les colonnes et les ruines éparses des splendeurs antiques.
C'est là l'échantillon miraculeusement sauvegardé de ce qu’était l’Europe.
Alors, la géographie, le reste, ce qui court d’ici jusqu’à La Rochelle, c’est sans doute de l’histoire. On ne peut, à priori, aimer ces paysages que si l’on aime en filigrane l’histoire des hommes qui les ont créés, et le mot «nature» n’a dès lors aucun sens pour les dire, aussi grandioses soient-ils.
Sinon ici, dans les épaisseurs de Białowieża, repaires du loup, du lynx et des grands bisons, errant tels des troupeaux préhistoriques oubliés par l’inexorable marche des siècles.
Pourtant, quand on pénètre dans cette forêt initiale, la première sensation n’est pas celle de se trouver devant quelque chose de beau.
Car ce n’est pas, intrinsèquement, beau.
C’est par l’esprit que surgit cette beauté. Par la conscience formulée, sur laquelle on s’arrête un instant, de ce que serait la terre si les hommes n’en avaient été les conquérants victorieux. C'est par ce contraste, par cette défection ici de toute praxis humaine, que l'on mesure combien les paysages qui nous émeuvent ailleurs, que nous trouvons naturellement beaux, ne le sont que parce que les hommes ont su, en fait, y vivre et en ont tiré subsistance, qu'ils s'agissent de ceux de la plaine, de la vallée, des bois, des chemins creux, des berges du fleuve ou de la colline.
Le randonneur des hautes altitudes peut avoir les mêmes impressions. Les vallées aux formes ondoyantes, les cols, les forêts et les alpages où paissent des troupeaux et que traversent des sentiers incertains ; tous ces étages inférieurs de la montagne sont beaux. La rocaille quasiment inaccessible, elle, terne, intacte de toute transformation humaine, tout là haut, n’est pas belle en soi. Elle est même moche. La majesté des approches du sommet est une vision de l’esprit. Elle vient de la virginité. D’une solitude extraordinaire, d'une absence.
Comme ici, dans la forêt primaire, où l’animal et le végétal ont seuls force de loi.
L'expression «géographie humaine», même si l’on peut comprendre ce qu’elle veut désigner de spécifique à l’intérieur de la géographie même, participe dès lors d'une affligeante tautologie.
15:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.09.2012
L'enracinement de l'exil - 25-

Géographie - 1 -
Un dicton polonais prévient que c’est à la sainte Anne, le 26 juillet donc, que les nuits commencent à se faire plus fraîches. C’est assez dire que l’équinoxe venu, elles sont déjà froides. La lumière en déroute profite encore un moment de cet équilibre fugace du partage de la souveraineté avec les ténèbres.
Premières gelées, encore timides, premières fumées aux toits des maisons fermées. Le renversement des saisons est assez brutal.
Ce matin, l’herbe blanche déjà crissait sous les pas et le mercure s’était réconcilié avec le zéro.
Je relis Guerre et paix, pour la troisième fois en trente ans, avec toujours autant de plaisir. En voyant les premiers clins d’œil des rudes saisons, qui guettent l’heure de leur entrée en scène, blotties peut-être là-bas, derrière la vallée du Bug, dans les steppes orientales, je pense à l’histoire, au conquérant et à son soi-disant génie.
En art militaire et en façon de conduire une politique de tueries des populations, sans doute, mais en cerveau capable de comprendre la géographie et les climats, deux assesseurs pourtant indispensables à la réussite d’une invasion, certainement pas.
Rentrer en Russie en août pour essayer d'en sortir à la mi-octobre, avec plus de six cent mille hommes à pied et à cheval, ne semblent pas en effet des décisions prises par un surdoué.
Les historiens affirment qu’il y fut contraint par la politique de terre brûlée menée par les Russes et que ceux-ci, qui connaissaient bien leurs saisons et leur climat, n’avaient fait, en faisant mine de se retirer, que d’attirer leur ennemi le plus à l’est possible, sachant que derrière lui se refermait inexorablement le plus redoutable des pièges.
Le climat comme une arme.
C’est bien à cela que je pense quand je sens, en septembre, les prémisses du froid continental planer dans l’air.
L’air bleu encore. Octobre peut en effet être lumineux ou, comme je le vis il y a trois ans, déjà sous la neige. En tout cas, les avertissements sont donnés. On a déjà un pied, du moins la tête, dans l’hiver.
Ce qui me frappe chaque automne. Je me souviens des équinoxes du Poitou-Charentes, en tee-shirt, et puis de la cueillette des champignons en forêt de Benon ou de l’Hermitain. Je me souviens aussi de l’île de Ré enveloppée dans son drap bleu, encore chaud, et l’air au-dessus des jachères sablonneuses qui tremblote jusqu'au rivage.
C’est en confrontant les images de ma mémoire aux sensations directes du présent, que je mesure la largeur de trois pays, Pologne Allemagne et France, et voit clairement la distance qui me sépare de l’océan. Cette distance, les oiseaux la connaissent. Ils ont déjà fait leur valise et leurs formations en triangle traversent le grand ciel, cap résolument mis sur l’ouest. Plus fins que Napoléon…
J’imagine, il me plaît d’imaginer, que ce vol là, qui cacane sous les nuages juste au-dessus de ma cour, a le cou tendu vers l’île de Ré ou la Baie de l’aiguillon.
J’aimerais apprendre leur langage et avoir leur science exacte, sensuelle, de la terre.
Comme une géographie innée au service de la vie.
12:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.09.2012
L'enracinement de l'exil - 24-

Quelques lecteurs assidus, que je remercie de tout cœur au passage, sans s’être concertés, me font part de leur sentiment sur l’Enracinement de L’exil, disant que cette deuxième partie, même «intéressante», leur parle beaucoup moins que la première, surtout consacrée à l’histoire de la Pologne et à son climat.
J’entends bien. Il est vrai que cette deuxième partie est plus centrée sur mézigue, sur ma façon d’appréhender la langue et les diverses choses de mon pays d’accueil. Plus personnelle donc - plus anecdotique me dit une lectrice -, et je conçois fort bien qu’on préfère nettement entendre parler de la Pologne que de ma pomme ( !)
Je dirai alors que je parle de la Pologne uniquement parce que j’y fais habiter ma vie et que les deux propos ne vont évidemment pas l’un sans l’autre. Mais sans doute les deux inséparables sujets sont-ils mal liés entre eux, semblent ne pas constituer un tout et c’est, en vérité, l’énorme lacune de ce texte, mise au jour, donc, par ces lecteurs attentifs.
Un bon texte n’aurait pas eu besoin de séparer d’aussi évidente façon les deux aspects, mais les aurait traités ensemble par le choix des mots, de la phrase, du style et par d'habiles insertions de réflexions personnelles.
Parlant du présent polonais, je suis contraint aussi d'évoquer des bribes du passé français, puisque je cherche, en profondeur, des causes non tangibles à mon exil. Mais, je le répète, la forme est inachevée et ne convient pas parfaitement, j'en conviens.
Un blog, à moins qu’il ne soit consacré qu’à un seul sujet, littéraire ou autre, je l’ai toujours dit, improvise dans sa hâte de publier, cette hâte étant étroitement liée à la vie même du blog. Là, j’improvise, non pas la réalité, mais sa retranscription. Ce qui fait que… je reprends mots pour mots la juste critique d’un de ces lecteurs, une lectrice en l’occurrence, qui dit : «Je perçois les morceaux de la partie 2 comme des bouts d'études.»
Exact. C’est même inhérent au support blog, cette improvisation qui n’a pas le souci d’un tout et cela est d’autant plus apparent que l’auteur se consacre pendant toute une période au même texte. C’est la grosse différence avec l’écriture qui se propose d’être publiée à compte d’éditeur, où l’on voudrait - sans toutefois jamais y parvenir- présenter un texte non perfectible. La grosse différence avec la scène aussi. Je dois y remonter en octobre pour la mise en musique de certaines poésies de La Fontaine, Villon et autres Apollinaire, et là, c’est sûr, l’improvisation équivaut à un désastre programmé. Je dirais même que c'est donner rendez-vous à des gens pour qu'ils s'y ennuient plus que s'ils étaient restés chez eux. Un comble.
Voilà, lecteurs, là, je n’ai pas improvisé du tout et espère vous avoir un peu éclairés sur les défauts avec lesquels je conduis ma démarche.
Je reprendrai le texte sur un sujet qui m’inspire beaucoup, la géographie et les paysages. Le visage d’un pays. Toujours vu par et dans les yeux d'un homme qui s’y est exilé.
Oui, c’est un peu décousu, tout ça.
11:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.09.2012
L'enracinement de l'exil - 23-

La route - 2
Je me demande souvent d’où vient cette violence routière, chez des gens qui ne sont pas du tout violents. Car vivre parmi les Polonais, du moins ici, à l’est, sur un territoire faiblement urbanisé, c’est ressentir une espèce de sérénité. Aucune agressivité dans l’air, aucune marque de colère ou de mépris intempestif. Des gens courtois, souriants, avenants même, et toujours prêts à vous accueillir à bras ouverts.
Ce sont pourtant ces mêmes gens affables qui se conduisent comme des barbares sur la route. J’ai déjà eu l’occasion de discuter avec certains d’entre eux : ils plaisantent, rigolent de mes peurs et ne voient rien d’anormal !
Pas tous cependant. Mon voisin, le petit paysan débonnaire et replet, abonde dans mon sens et est d'avis que ce sont tous des fous furieux. Lui, sur la route, il a peur aussi. Il n’y va pas trop souvent d’ailleurs, sinon d’un de ses champs à l’autre, en tracteur… Sa gamine, à sept ans, a été heurtée par un imbécile qui traversait le village à tombeau ouvert. Un miracle, dit-il, qu’elle s’en soit sortie quasiment indemne !
Alors, est-ce que conduire une voiture fait perdre les pédales ? Quel non-sens pousse ces gens sympathiques à mettre quotidiennement en péril la vie des autres et la leur, comme ça, gratuitement ? En allant faire des courses, en allant au travail, chez des amis, voire à la messe ?
J’ai plusieurs hypothèses, toutes invérifiées, toutes plus fantaisistes, peut-être, les unes que les autres. Des hypothèses d’un étranger qui s’interroge et, surtout, qui a les foies. Mais les hypothèses, c’est fait pour ça : donner une réponse là où l’on n’en a pas vraiment.
La première qui me vient à l’esprit est le caractère plus ou moins nouveau de la voiture en Pologne. Il y a vingt cinq ans, très peu de gens étaient motorisés. Pratiquement personne, en vérité. C’est une des raisons pour laquelle les lignes de transport en commun sont encore si nombreuses en rase campagne. Des kyrielles de minibus sillonnent toute la contrée, de la ville à la campagne et de la campagne à la ville, le matin, le soir, l'après-midi, jusqu’à Varsovie, Lublin ou Białystok.
Donc, nouveauté relative de la voiture, la prise de conscience pas encore établie et griserie d’être, comme à l’ouest, le roi du déplacement. D’autant plus que le passage à l’économie de marché s’est accompagné d’une importation massive, anarchique, de véhicules allemands, puissantes Audi, Mercedes et autres Volkswagen. Une aubaine pour le capital allemand, donneur de leçons mais toujours aussi goinfre. Et une aberration que ces millions de bolides lâchés sur des routes quasiment restées à l’état d’une époque d’hyppomobilité ! Pour moi qui vis là, c'est comme si on avait vendu des pleines caisses de 357 Magnum à des adolescents.
Mais le fric n'a pas d'odeur et tant qu’à rattraper un retard, autant le faire dans la vitesse. J’imagine mal en effet les Polonais commençant leur apprentissage avec des deux-chevaux ! Inexpérience et infrastructure désastreuse, exaltation d’appartenir à un monde enfin «normal», celui des autres, après des années de privation, la consommation s’assimilant souvent, par la perversité du système, à la liberté, voilà mon hypothèse la plus grande.
Oui, mais les gendarmes ? Quels gendarmes ? Ah, vous voulez sans doute parler des gendarmes ? Ben, les gendarmes font de nombreux contrôles, bien sûr, mais ça n’est pas très difficile, à mon avis, d’y échapper : ils sont toujours aux mêmes endroits et aux mêmes heures. Il semblerait qu’ils n’aient pas très bien compris, eux non plus, l’urgence qu’il y avait à mettre un frein à la frénésie des citoyens !
Pourtant, je suis certain que les Polonais sont moins nombreux qu’en France à conduire éméchés. Tous ceux que j’ai vus, entendus, avec qui j’ai parlé, à la maison ou ailleurs, sont très vigilants sur le taux d’alcoolémie fixé à…0 !
Plus vigilants en tout cas que je ne l'étais moi-même en France !
Non, leur ivresse est ailleurs. Leur ivresse c’est la modernité, le progrès, la liberté de circuler. Ils en avaient tant soif alors que nous en avions, nous, déjà par-dessus la tête de tous ces écrans de fumée !
Une dictature, ça fait longtemps, très longtemps, du mal. Dans la tête.
12:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.09.2012
L'enracinement de l'exil - 22-
La route - 1 -
A vol d’oiseau, Wisznice est une bourgade située par-delà la forêt, à six kilomètres de ma maison. Un chemin de sable, chaotique et rongé par les ornières, pourrait y mener. Mais il n’est guère praticable. L’hiver, enfoui sous la neige, n’en parlons pas : il est complètement inexistant.
Alors, pour me rendre à Wisznice, je prends la direction complètement opposée et, par une petite route, je fais un détour de 24 kilomètres.
Si je vous raconte cela, très anecdotique, c’est qu'il s'agit d'un trait révélateur de l’aménagement du territoire en Pologne de l’est, assez curieux, où les voies de communication cherchent souvent midi à quatorze heures.
Les villages sont mal reliés entre eux, le maillage très approximatif. J’y vois une conception d’aménagement liée à la dictature communiste. Plus les gens ont de difficultés à se rencontrer de villages en villages, moins le dialogue passe, moins on a l’impression de faire partie d’une communauté et, avec tout ça, les mauvaises idées restent à la maison.
Ainsi, il arrive souvent que vous preniez une route dans un village et que, sans prévenir, cette route vous abandonne au beau milieu des champs, après s’être brusquement changée en chemin de sable ou de terre. Il n’y a plus qu’à faire demi-tour et, pour aller visiter un autre village, refaire le chemin déjà fait et bifurquer quelque part dans la campagne.
Cela m’est récemment arrivé dans un village au nom plaisant, Leniuszki, Les feignants. Complètement isolé au milieu des prairies, Les feignants !
Tout cela, bien sûr, tend à disparaître, les communes et les powiats investissant beaucoup dans l’aménagement. Cependant, la carte est encore ainsi dessinée, qu’on se promène le plus souvent en étoile et non en boucle.
Les routes en Pologne sont mauvaises. Etroites, bosselées, tavelées de nids de poule. Cela vient du retard pris par les communistes, certes, mais pas seulement. Le climat y est pour beaucoup. Les gels de l’hiver, avec la glace et la neige, défoncent régulièrement ce qui a été remis en état au printemps dernier. Là où passent les camions, sur la grand-route de Varsovie à la ville frontière,Terespol, (historiquement route de Paris à Moscou, via Berlin) des rails se creusent, véritables pièges pour conducteurs non avertis. Il faudrait mettre des barrières de dégel, me direz-vous. Oui, mais alors cela reviendrait à immobiliser le pays pendant de longs mois.
L’entretien des voies relève donc ici du véritable mythe de Sisyphe. Les budgets qu’on y engloutit sont phénoménaux.
Les hommes de l’Europe qui fait semblant d’être une, ne sont pas à égalité devant les dépenses du confort élémentaire, suivant leur latitude. Je l’ai déjà dit. Il n’y a guère que les imbéciles qui prennent les décisions pour ne pas l’avoir envisagé.
Mais, par-delà le mauvais état du réseau routier, le véritable danger vient d’ailleurs. Il vient des conducteurs. Les Polonais sont affreux au volant d'une voiture. Complètement indisciplinés, complètement à côté de la plaque, jusqu'à l'inconscience. Ils conduisent très mal et très vite. La route est alors un véritable cimetière et, moi, je conduis la peur au ventre.
Ligne blanche ? On s’en fout. Virage sans visibilité ? On est pressé, on double… Stop ? Pas le temps. Sur une route étroite que je prends tous les matins et tous les soirs, il n’est pas rare de croiser des autos lancées à plus de 140 Km à l'heure et négociant leurs virages à la dernière limite du possible.
Il n’est pas rare non plus d’apercevoir les gyrophares des flics et des ambulances et, dans le fossé ou enroulée autour d'un arbre, la ferraille déchiquetée d'un drame.
Une véritable catastrophe.
A chaque virage, je serre le plus à droite possible et je jette un bref coup d’œil sur le bas-côté, anticipant une voie de secours. Toujours l'angoisse de voir surgir un fou devant moi
C’est comme ça. Mieux vaut le savoir. Tous les étrangers qui viennent là en sont épouvantés et c’est la première chose qu’ils remarquent.
Il y a chez les Polonais une véritable irresponsabilité. Ils ne savent pas encore que l’automobile, c’est aussi une arme. Que faudra-t-il pour qu'ils l'apprennent ?
Pourtant, moqueurs d’eux-mêmes, ils appellent la route, quand elle est vraiment mauvaise, plus mauvaise qu’ailleurs, c'est dire : Autostrada do niebo, autoroute pour le ciel.
Il est impossible, au volant, donc, d’oublier un instant qu’on est dans un autre pays que le sien. Il n’y a à cet égard pas pire que la Pologne, sinon, m’a-t-on dit, la Lituanie.
Je n'en suis qu'à quatre ou cinq cents kilomètres, mais pas vraiment envie d’aller vérifier sur place !
Contradictoirement, c'est dans les conditions difficiles de l'hiver, avec verglas et neige, que je me sens le plus en sécurité : les gens font montre, sans aller jusqu'au zèle, d'une certaine prudence et les drames y sont beaucoup moins fréquents. Mais, sitôt les premiers beaux jours réapparus, ils redeviennent fous comme des chevaux soudain libérés de l'étroitesse des stalles.
Et les rares fois où je suis revenu en France, j’ai eu l’impression, moi, de conduire au paradis, au milieu de gens soucieux de ma et de leur sécurité. Un véritable plaisir.
Je vous assure.
13:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.09.2012
L'enracinement de l'exil - 19 -
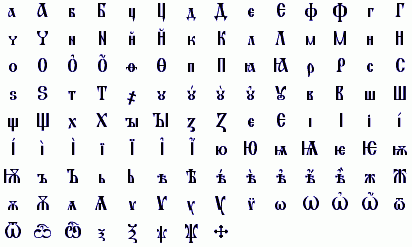
Paroles - 1-
Je me satisfais ici d’une présence uniquement codifiée par le social. Quand on me salue d’un signe de la main dans la rue, qu’il s’agisse du gars qui m’a vendu la voiture, du boucher, de la caissière du supermarché où j’ai coutume de faire des courses, de la dame qui tient un stand de fruits et légumes sur le marché, de ma coiffeuse - la pauvre, elle a de moins en moins l’occasion de faire valoir son art avec ma chevelure de plus en plus velléitaire !- ou de n’importe qui d’autre, ça me va très bien. Je me sens presque intégré. Je n’en demande pas plus. On sait, par ce salut, que jestem Francuzem et que mieszkam tutaj. On me connaît même plus que je ne connais, des gens me saluent parfois et j'ignore d'où ils me reconnaissent.
La solitude est cadrée.
En revanche, avec mon voisin, un petit paysan sanguin, replet et débonnaire, on discute souvent le bout de gras. Il me prête une échelle, une fourche, un outil quelconque et donne évidemment de judicieux conseils, comme tous les petits paysans du monde à leur voisin. Quand la conversation devient trop ardue pour ce que je veux exprimer, qu’il me manque un mot, il vole à mon secours. Las ! Las ! Son vocable secourable est souvent issu du langage vernaculaire, patois même, et je le retiens comme le mot académique, ce qui, replacé dans une autre conversation, avec un autre personnage, fait écarquiller les yeux et sourire. Exemple : wiater, le vent, pour wiatr.
L’hiver dernier, il m’a parlé des aiguilles de pin avec lesquelles il allumait son feu. Il a dit un mot difficile, long comme un jour sans pain. Je l’ai retenu un moment, je l’ai oublié aujourd’hui tant il est tordu, et je l’ai resservi aussitôt, fièrement. On m’a dit que ça n’était pas du polonais, ça. On ne connaissait pas du tout ce fichu mot !
Tout cela m’amuse beaucoup. J’imagine, je m’envole, je ris, et dis intérieurement olé pas bia en lieu et place de ce n’est pas beau à un Polonais vivant en France et s’accrochant à la langue. Ou à un Espagnol. Histoire d’ajouter à la confusion…
Et j’en sais gré à mon débonnaire voisin de faire comme si j’étais né dans son village et avais naturellement accès à son dialecte. Il m'ouvre sans ambages les portes de l'appartenance.
Parfois, la conversation prend cependant un tour plus philosophique. L’autre jour, je lui ai dit, à propos de l’église et de tout le pognon dont elle fait montre, église où il voit bien que je ne mets jamais les pieds : Nie wierzę, je ne crois pas. Je m’attendais à un froncement de sourcil réprobateur, car je venais de mêler à une critique ouverte et pragmatique, (sur laquelle nous étions très en phase) de l’institution, une profession de non foi. Mais il a levé les yeux au ciel et a dit dans un soupir un peu désespéré : Nie wiadomo, on ne sait pas.
J’ai pensé au doute cartésien et me suis encore amusé. Il y a pourtant, en apparence seulement, entre mon voisin polonais, petit paysan sans instruction scolaire, et le philosophe du Discours, des années lumière.
Car c’est ça aussi, l’exil du langage. On s’amuse de tout, on s’émerveille du plus simple de l'expression quotidienne, celle à laquelle on ne prête nullement attention quand on vit dans sa langue.
Quoique… Je me souviens fort bien m’être beaucoup régalé à parler le patois avec mes voisins charentais. J’avais déjà l’impression de revenir chez moi, après une longue digression sur les chemins de la culture didactique.
J’aime les mots, les vrais, les permis, les inscrits au dictionnaire, comme ceux issus de la pratique orale et reclus dans les limites d’une culture régionale. Dans chaque mot, il y a un bout de la conscience collective qui se promène.
Mon voisin charentais, ma vieille voisine poitevine, parlaient avec des réminiscences du latin et du vieux français.
Peut-être mon voisin polonais me parle-t-il parfois avec des empreintes du vieux slavon, semées par des siècles d’histoire, ici, aux lisières de la plaine et de la forêt, et dont il est le dépositaire.
Dans ces moments-là, je le trouve très instruit et me trouve bien ignorant.
Illustration : alphabet du vieux slavon
10:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.09.2012
L'enracinement de l'exil - 18 -
Courage, fuyons !
Certes, la raison première pour laquelle j’ai "choisi" de vivre en Pologne, je la connais fort bien. J'ai cependant toujours été persuadé du fait que la rencontre amoureuse est avant tout l’œuvre capricieuse de l’énergie des contraires qui se télescopent : on rencontre tout à fait par hasard ce que l’on voulait provoquer.
Fuir. Telle était l’idée sous-jacente de mon hasard et telle est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, un crépuscule du soir aux lisières de ma forêt, le cul dans l’herbe chaude et le soleil qui me faisait des clins d’œil entre deux lourds nuages d’été.
Non pas fuir un pays, dont je n’avais que faire d’y habiter ou non puisque je n’avais pas une conscience critique de mes lieux, de ma langue, mais fuir l’incommensurable pesanteur des habitudes.
Les bonnes comme les mauvaises. Même bonnes, les habitudes n’engendrent que de l’ennui. Et l’ennui, c’est un poison qui distille la mort à petites doses souffreteuses. Il y a tellement de gens qui s’ennuient sans vraiment le savoir, que lorsqu’ils seront morts, ils n’auront pas vraiment l’impression d’avoir changé de vie (!)
Fuir les horizons dont on sait tous les points de chute. Fuir l’alcool, les euphories du soir et les nausées de l’aurore, fuir le désordre des désirs, le travail et ses lobotomies, les jours qui s’enchaînent et veulent, tel un calendrier parallèle, extérieur à votre marche, vous conduire jusqu’au tombeau sans plus de surprises ni autres incartades.
Fuir les mots qui ne disent plus rien, toujours les mêmes ! Fuir mon identité. J’avais en effet l’impression de ne plus rien avoir à donner à quiconque, puisque, aimé là pour ça, détesté là-bas pour autre chose, méprisé ailleurs par des méprisables, des pigeons et des pigeonnes n’ayant jamais volé plus loin qu’un perchoir lustré, j’étais, comme tout le monde, prisonnier d’une image socialement bradée comme définitive.
Quoi dire et quoi faire qui soit source de surprise joyeuse, d'étonnement, face à des gens qui prétendent vous connaître à fond ? Faire semblant d’être fou, peut-être. Ou picoler comme un trou.
Casser tout ça. Faire des acquis tranquilles du bonheur, un champ de ruines. Des victoires, faire des défaites.
J’y ai d’ailleurs tellement réussi qu’un ami qui m’avait fréquenté pendant plus de vingt-cinq ans, aimé, apprécié, m’a soudainement pris en pitié et déclaré que peut-être, j’étais malade… Que peut-être tout ça, ça se soignait avec des médicaments, avec de la chimie neuroleptique… Diantre ! Que mille fois diantre !
Mais je ne lui en veux nullement, à cet ami passé. Je semblais tellement proche des gens que je fréquentais - car je suis comme ça, extraverti, démonstratif, amical, déconnant, serviable avec ceux que j’aime, détestable aussi, souvent même- que cette fuite leur a semblé totalement anormale. Une maladie. Comme une aliénation. Comme l’irruption soudaine d’une folie latente.
Je déteste, j’ai toujours détesté, je détesterai toute ma vie, cet affreux mot : normal.
Les gens normaux meurent jeunes. Dès qu’ils ont décidé d’être normaux au détriment de leur désordre intérieur. De leur chaos constitutif.
La normalité est un achèvement pour les humains qui, par essence, sont d’abord inachevés.
L’exil, même statique, donne toujours cette sensation d’être en perpétuel mouvement, en perpétuel recommencement.
Il n'est jamais un port tranquille. Jamais à l'abri d'une tempête venue de l'intérieur. D'une lame de fond.
08:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.09.2012
L'enracinement de l'exil - 17 -
Chez nous ?
Le paysan - au sens premier de pagensis désignant l’habitant du pays - est celui qui, effectivement, habite son paysage, sans forcément y être domicilié ; qui en est l’élément humain.
C’est par ce caractère de paysan, que je m’étonne parfois d’avoir quitté mon pays. Surtout si tardivement, à une saison où tout le monde, croyant avoir jeté son ancre au bon port, jouit du calme d’une mer étale et semble attendre la nuit.
D’ici, je peux dire mon pays. Cela a un sens. Une figure. Auparavant, ça n’en avait absolument aucun. Jamais, je ne m’étais senti appartenir à une communauté de langage et de culture. J’ai réalisé la réalité de cette communauté qu’une fois ma vie quotidienne plongée dans une autre. Jestem francuzem, suis-je souvent obligé de décliner. Cela me présente, m’identifie socialement. Dans ma langue, je ne me souviens pas avoir dit ça un jour. D’ailleurs, littéralement traduit, ça me paraît toujours assez idiot. Une précision réservée aux douaniers et aux flics.
Jestem francuzem ale mieszkam Polsce. Je suis Français mais j’habite en Pologne. Dans cette phrase, une phrase pour passer dans un autre pays retranché derrière des frontières, par exemple, ou plus simplement pour faire immatriculer une voiture, il y a deux réalités. Ce que je suis et ce que je fais de ma vie.
Et aujourd’hui, dans les discussions avec D., quand on confronte des points de vue, des habitudes, des tics de langage, des idiomes, des proverbes, chacun d’entre nous dit : chez nous.
Pour la Pologne, je comprends bien : nous y sommes. Mais pour la France, je me rends compte que non seulement je m’identifie à un chez moi, mais, qu’en plus, dans la définition de cet idiome, habitude, proverbe, etc., j’englobe tout un peuple, nous. Vous, quoi. C’est curieux.
D’autant plus curieux qu’il m’est arrivé plusieurs fois, expliquant à un compatriote de passage ici tel ou tel côté des choses polonaises, de dire chez nous en parlant de la Pologne. Quiproquo. L’interlocuteur un peu interloqué obligé de me demander de préciser quel pays j’entends par ce chez nous. Dans ces moments-là, spontanément puisque je développe un côté de la réalité polonaise qu’il ignore et désire savoir, je le considère comme un étranger.
J’ai le cerveau entre deux chaises. En tout cas, je me vois mal dire chez eux. Il me semblerait m’exclure et les exclure. Ce chez eux serait même empreint d’un certain dédain.
Est-ce là le début d’un enracinement ? Je l’ignore.
Mais ce chez nous me ramène cependant très loin et sonne fort dans ma cervelle de paysan. C’est comme ça qu’on disait, enfants, pour dire l’espace tout à fait restreint de notre maison et la vie, avec ses hauts et ses bas, qu’on y menait. Cette expression avait une teneur ethnologique, qui en disait long sur la façon qu’on avait d’appréhender ou d’avoir peur du vaste monde, de ses complications et de ses multiples inconnues. Elle voulait nommer un toit et elle me sert aujourd’hui pour désigner la France. Une métonymie d’un raccourci fulgurant.
Est-ce un refus, une peur de l’enracinement ? Je l’ignore.
08:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.09.2012
L'enracinement de l'exil - 16 -
DEUXIEME PARTIE

Sommes-nous les habiles artisans de notre histoire et les vaillants timoniers de notre voyage ? Est-ce que nous sommes les architectes autonomes du libre-arbitre quant à tout ce passé accumulé comme autant de choses nous appartenant en propre ?
Ces questions d’une naïveté première, je me les pose souvent et n’y trouve pas de réponse.
Oui, elles sont bien naïves, ces questions. Des questionnements d’adolescent presque. Des questions à la Sartre. Mais je me fous comme de ma première chemise d’être un naïf ou pas. Parce que je me fous du soi-disant cynisme qui aborde toute question comme résolue, vaine, ou d’un autre temps, et je me fous de cette posture des gens faisant mine d’être revenus de tout pour n’avoir jamais osé aller nulle part. Sinon tourner en rond dans la posture.
Je ne trouve pas de réponse, mais des soupçons de réponse. Et d’ailleurs peut-être devrais-je employer le je. Ce nous est abusif, qui semble généraliser un cas personnel.
Ce n’est pas très galant, ça, de faire porter sa valise par tout le monde.
Dans tous les actes importants de ma vie, ceux qui lui ont donné une direction souvent capricieuse, je crois n’avoir jamais rien fait contre ma volonté. Mon désir plus exactement. La volonté, ça n’existe pas. Elle est un épiphénomène de quelque chose de plus obscur, de plus labyrinthique que le simple je veux. La volonté s’impose comme une force décisionnaire, alors qu’elle n’est qu’une manifestation secondaire. La partie visible d’un iceberg.
Ce n’est pas lieu ici, qui n’est que page d’écriture, de confier moult détails. Je résumerai donc ainsi : j’ai maintes fois voulu ce que je n’aurais pas voulu vouloir et je n’ai parfois pas voulu ce que j’aurais bien aimé vouloir… Et c’est l’origine de ce premier degré du vouloir qui me turlupine, sans pour autant aller jusqu’au tourment.
N’est-il qu’une pulsion déguisée en détermination ? Il se présente en tout cas, à partir du moment où il se manifeste, comme une promesse de bonheur et cela suffit pour qu’il soit, selon moi, suivi sans autre tergiversation, dès lors que cette pulsion, cette envie de vivre, de faire, ne porte aucunement atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une autre personne.
La précision est hélas nécessaire tant le terme pulsion est entaché d’instincts criminels. J’ai pour ma part le bonheur de n’avoir jamais désiré tuer ou violer qui que ce soit et j’aurais pu, si j’en avais eu le talent, écrire mot pour mot, virgule pour virgule, les strophes du bon moustachu :
Je n’ai jamais tué, jamais violé non plus
Y’a déjà quelque temps que je ne vole plus.
Si l’Eternel existe, en fin de compte, il voit
Qu’je m’ conduis guère plus mal que si j’avais la foi.
Un inextricable magma préside sans doute à la naissance de ce vouloir qui, donc, en dernier ressort, ne veut rien du tout. Magma de dispositions internes d’origines très diverses, de sensibilités intimes, de morceaux d’archéologies, de hasards, de formations personnelles et didactiques, de fantasmes, de réels, de souvenirs, d’idées philosophico-sociales, originales ou reçues, et tutti quanti, chacun de ces éléments étant eux-mêmes imbriqués les uns dans les autres par d’occultes relations de causes à effets.
Si je vous barbe avec ces considérations toutes simples et d’apparence amphigourique, c’est que je suis un paysan. D’origine, de caractère, de culture et de goût. Un paysan amoureux des paysages, d’une certaine tradition, d’un langage et d’une approche directe, brute, du monde.
Un paysan, ça se définit d’abord par l’ancrage profond de ses racines, qui lui remontent jusque dans la tête.
Or, j’ai voulu vivre en exil…
A suivre...
09:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.09.2012
L'enracinement de l'exil - 15 -

L'histoire - 6 -
C’était dans une maison discrète et belle, toute de bois, aux abords immédiats de la vieille et grande forêt.
La matinée de ce début de mai était bleue et l’herbe aux talus des lisières déjà épaisse et verte. Le jardin en broussailles, aux allées effacées par la végétation en fête, était peuplé de pommiers biscornus et les premières fleurs, roses et blanches, s’égayaient déjà à leurs vieilles branches.
Notre hôtesse nous avait servi un succulent bigos, des gâteaux et du thé, sur une petite table de jardin. Elle est une dame respectée en Pologne, le nom qu’elle tient de son mari, aujourd’hui disparu, fait encore autorité chez certaines gens et évoque un homme qui espéra et fit beaucoup pour le peuple polonais.
Comme la discussion s’accélérait entre elle et D., je ne manquai pas bientôt de perdre pied. Je saisissais bien le sujet dont il était question, mais, comme toujours quand les mots s’enchaînent à vitesse naturelle, les nuances m’échappaient. Distraitement, je pris donc le journal abandonné sur la terrasse, histoire de voir ce qu’on y disait des élections en France, où le challenger Hollande s’apprêtait à affronter le champion Sarkozy, dans une semaine environ.
Je dis comme ça, désinvolte, parce que quoi dire de plus sur ces jeux du cirque que s’offrent régulièrement les démocraties, avec toujours les mêmes gladiateurs replets et satisfaits d’eux mêmes s’offrant les têtes d’affiche du spectacle et se renvoyant tous les cinq ans la même balle pour amuser la galerie ?
Notre hôtesse me demanda cependant ce que je pensais de ces élections et je fis en souriant un geste vague qui pouvait laisser à penser que je n’en pensais justement rien. Mais, pour insignifiant qu’il soit du point de vue de la marche du monde, ce scrutin présidentiel n’en déchaînait pas moins régulièrement les passions, provoquait les polémiques et fâchait des gens entre eux, estimai-je bon de préciser.
Elle nous confia alors sa sympathie pour le candidat battu Mélenchon, le seul qui avait, à son sens, un discours cohérent, du moins d’après ce qu’elle lisait de ce discours traduit dans certains journaux.
Je comprenais bien ce qu’elle voulait dire… J’étais néanmoins surpris car en Pologne, les mots même de «communisme » ou de «socialisme» ramènent à des réalités concrètes, durement vécues, et je savais évidemment qu’elle avait été avec son mari une combattante. Je déviai un peu le sujet en demandant ce qu’elle pensait de la position partout avantageuse de l’église dans son pays.
Elle but une gorgée de thé et me sourit aimablement.
- J’en pense, me dit-elle, certainement ce que tu en penses.
- Hé bien je suis d'avis que tant que l’ancienne génération de Solidarność sera au pouvoir, dans les villes, dans les Powiats*, dans les régions, dans les villages, au parlement, tout parti confondu, cette situation, un peu étouffante pour un étranger et pour certains Polonais d'une autre confession ou athées, perdurera.
- Ceux de ce Solidarność dont tu parles, oui... Mais il ne faut pas tout mélanger. Vois-tu, me lâcha-telle, ce n’est là qu’une partie du syndicat, mais bien d’autres gens qui en ont été aussi les fondateurs, des combattants de la première heure, qui ont été emprisonnés par le régime, ont été vaincus.
Et après un silence, elle ajouta :
- On peut dire que nous, nous avons perdu notre bataille et notre guerre même si l’adversaire a été terrassé.
Elle développa son idée et j’étais suspendu à ses mots. Ils s’étaient battus pour des idéaux humanistes, pour des idéaux qu’on pourrait appeler, n’ayant pas d’autre vocabulaire à ma disposition, «de gauche». Les mots résonnaient très fort dans ma tête car gauche et droite n’ont pas ici la même pointure qu’en France. L’histoire les a affûtés, confrontés au réel. Et j’appris alors que toute une frange de militants farouchement opposés au communisme soviétique, une frange d’athées, parfois même de libertaires, avait été oubliée de l’histoire, celle de Jaruzelski comme celle de Wałesa se partageant les honneurs de la postérité spectaculaire, l’un côté perdant, l’autre côté vainqueur.
J’éprouvais pour cette dame alerte, accueillante, une vive sympathie. La fratrie des vaincus, sans doute…
Le communisme était tombé et, elle et ses camarades, son mari, avaient grillé leur jeunesse dans la lutte obstinée, la noirceur des prisons, la surveillance et la pression quotidiennes sur eux et leur famille, et ils n’avaient rien gagné au change, ils n’avaient rien récolté des fruits qu’ils avaient voulu semer.
Ils étaient, comme elle le dit si fort, des perdants.
L’histoire et ses schémas m’avaient une fois de plus floué. J’avais encore une fois avalé les couleuvres de l’information et de l’image officielle du monde. Je découvrais une autre Pologne, inconnue, pas binaire du tout, et, si j’éprouvais de la peine pour notre hôtesse et ses camarades gommés par l’histoire, je me sentais contradictoirement heureux d’habiter un pays si riche en sensibilités, en espoirs et en pugnacité. Je me sentais rassuré parce que la carte établie communisme contre église catholique/ libéralisme était une carte biseautée.
La carte qui camouflait un combat volé.
L’exilé reste un exilé. Il pense à lui à travers les autres.
Nous passâmes la journée dans le jardin, à regarder le printemps faire sa plume, à entendre le chant des oiseaux sur les premiers nids et à discuter. Nous visitâmes une vieille grange que notre hôtesse, à l’autre bout du village, avait fait aménager en salle de théâtre pour des artistes de Varsovie. Emouvant.
Et nous bûmes beaucoup. Du thé, évidemment.
Elle me demanda, elle aussi, si mon pays me manquait.
Mais à elle, je ne servis pas ma métaphore habituelle du marin et de la mer. Je répondis que, aussi bizarre que cela puisse paraître, j’avais besoin de réfléchir à cette question, que je ne pouvais pas répondre honnêtement, comme ça, à brûle-pourpoint.
Elle comprit et je suis certain que si je lui avais retourné la question et demandé si son pays, sa Pologne, lui manquait, elle aurait murmuré :
- Oui. Terriblement.
Car ce sont de nos espoirs, beaucoup plus que d'un pays, dont nous sommes les exilés.
Image : Philip Seelen
08:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.09.2012
L'enracinement de l'exil - 14 -
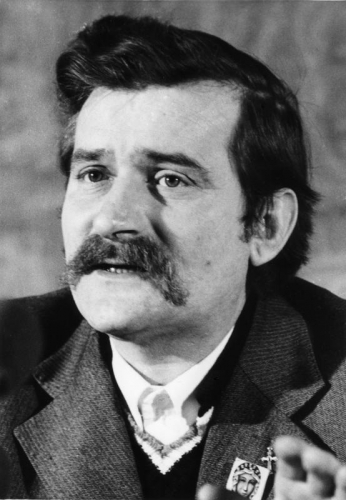
L'histoire - 5 -
Quand on décrypte les soubresauts de l’histoire via les détroits spectaculaires de l’information sans que le hasard ou la volonté de savoir nous fassent aller voir de plus près de quoi il en retourne exactement, on devine des schémas et avec ces schémas-là, qu’on considère comme choses acquises et que l’on conjugue définitivement au réellement passé, on se forge une idée, de la même couleur en général que celles que nous promenons avec nous sur tous les sujets du monde.
Nous alimentons notre moulin, en pour ou en contre. Ça dépend du sujet. Les schémas sont faits pour ça : pour que chacun y trouve son compte. Si on me dit, par exemple, que le pape a encore déclaré ex cathedra telle ou telle ineptie, je ferai d’instinct coller cette ineptie avec l’exécration que j’ai de l’idéologie de son institution et m’empresserai de la prendre pour argent comptant. Et ne me dites pas que je suis partial, sans jugement et pas sérieux : nous sommes tous pareils, même si mon exemple est un peu cousu de fil blanc et participe évidemment de l’outrance facile.
Ainsi je rappellerai la mystification célèbre de Timisoara, où le nombre de tués avait été multiplié de façon scandaleuse… On s’affligeait alors de ce que le dictateur fou de Bucarest n’allait pas lâcher prise comme ça et de ce que le bain de sang était inévitable. Je rappelle ce cas d’école en matière de manipulation du monde par les médias, car j’eus l’occasion d’être informé de cette utilisation frauduleuse de l’actualité bien avant qu’elle ne soit officiellement reconnue. Elle fait, en quelque sorte, un peu partie de mon histoire personnelle. A la faveur en effet d’un convoi humanitaire qui rejoignait Timisoara via la Yougoslavie du nord à la fin de l’année 1989, j’appris que dans cette ville l’armée avait refusé de tirer sur la foule, s’était jointe aux insurgés et que le nombre de morts était d’une quarantaine environ. Ce qui est beaucoup trop, c’est vrai, mais n’a rien à voir avec les milliers de morts annoncés. L’éclaircissement me fut confirmé dès février 1990 par de jeunes Roumains d’une troupe de théâtre de Timisoara, hôtes d’un de mes frères en Vendée.
On pourrait sans doute, en compilant les expériences personnelles de chacun d’entre nous, faire un gros cahier des témoignages contraires à ceux de l’info dont on gave les peuples.
Je me souviens aussi avoir rencontré, lors d’un salon du livre à Cannes consacré aux auteurs ayant écrit sur des poètes-chanteurs, la veuve d’un homme tué au Liban et je l’entends encore, révoltée, raconter les circonstances exactes du drame, complètement différentes, sinon contraires, de celles relatées par l’info officiellement officieuse.
Cette longue digression pour en venir à l’idée que nous avons reçue de Solidarność au cours des évènements qui se déroulèrent en Pologne dans les années 80. Etat de guerre, les files de pauvres gens dans la neige et le froid devant les magasins, l’inflexible dictateur aux lunettes noires face au non moins inflexible ouvrier électricien des chantiers navals de Gdańsk, couronné en 1983 par le prix Nobel de la paix. Puis la chute du dictateur autour de ce que l’histoire appellera la Table Ronde et les premières élections libres du bloc sous influence soviétique, le 4 juin 1989. L’ouvrier électricien sera un an plus tard élu Président de la République. Fichtre ! Réussite totale, absolue, dans le renversement d’un régime totalitaire… Mais, Napoléon pointant déjà sous Bonaparte, on verra aussitôt le susdit ouvrier-Président-prix Nobel recevant le baiser fraternel de son illustre compatriote, souverain pontife.
Là, nous avons été nombreux à déchanter et avons obscurément compris que la Pologne venait allègrement de sauter du coq à l’âne.
La suite en fut le concordat et tout ce qui va avec. Partout dans le monde, au niveau du pouvoir, si vous offrez votre pouce au clergé, il vous avale le bras.
On retiendra donc que la révolution polonaise fut la victoire de Solidarność, solidement allié à l’église catholique. On ira même jusqu’à prétendre que l’élection du pape Jean-Paul II était en 1978 un coup fourré de la CIA enfonçant un clou dans l’étau soviétique.
Et lors de la «décommunisassion» paranoïaque (cette chasse aux sorcières ouverte de 2005 à 2007 par les frères populisto-réactionnaires Kaczyński), on affirmera qu’un indicateur mentionné dans les fichiers de la police politique communiste sous le nom de Bolek n'aurait été autre qu’un certain... Lech Wałesa. Aie ! Aie ! Aie ! Levée de boucliers dans toute la Pologne : on ne touche pas aux icônes !
L’Histoire n’est pourtant qu’un défilé d’icônes placées au bon moment et au bon endroit sur la scène.
Tout cela est bien joli – enfin, joli n’est peut-être pas le bon mot – mais ça n’en reste pas moins fort schématique. La vérité est plus détaillée et il m’a été donné d’avoir témoignage de certains détails importants - passez-moi l'oxymore je vous prie - que je vous livrerai sur une page prochaine.
A suivre...
11:41 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.08.2012
L'enracinement de l'exil - 12 -

L'histoire - 3 -
Dans l’histoire, quand la violence se déchaîne, c’est souvent pour longtemps : elle se succède alors à elle-même par paliers reliés entre eux par des relations complexes de causes à effets.
Mais cette violence ne s’exprime pas toujours avec la même brutalité. Elle va crescendo, atteint son paroxysme, puis se retire decrescendo. Telle une vague atteignant aux rivages des présents successifs en perdant à chaque fois de son ampleur et de sa cruauté, elle épouse un mouvement de ressac.
Ce fut le cas pour la Révolution française : d’abord mécontentement sourd, banqueroute de l’état, puis convocation des Etats généraux, puis Assemblée constituante tentée par une monarchie constitutionnelle, puis l’exécution de Louis XVI, puis le paroxysme de la Terreur, avant les apaisements relatifs du Directoire jusqu’à la reprise de la force avec le coup d’Etat et l’Empire.
En Pologne, pour douloureuse qu’elle fût, donc, la période communiste ne s’accompagna pas de la même sauvagerie que celle dont s’évertua à faire preuve l’occupation nazie. D’ailleurs, de par le monde et de par le temps, aucune sauvagerie ne fut jamais exercée au point d’égaler celle des exécutions, crimes de masse, exterminations, génocides, tortures, qui se déroulèrent sur le territoire de la Pologne pendant la dernière guerre mondiale. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, pour ne citer que les plus sinistres, sont des lieux à jamais frappés du sceau de l’infamie et qui font frissonner d’effroi tout humain encore digne de ce nom.
La période communiste fut une période de muselage idéologique, une période d’anéantissement de la pensée, une période d’interdiction, de censure, mais pas une période de crimes organisés. Ce sont d’ailleurs les communistes qui, pierre après pierre, ont remis debout Varsovie, complètement détruite. Si vous vous promenez un jour sur les remparts, aux abords de Stare Miasto reconstruite à l’identique pendant plus de dix ans, vous ressentirez en filigrane ce charme de la vieille ville, cette architecture colorée, désuète, comme un voile tentant désespérément de recouvrir les stigmates d’un crime.
Tout le reste de la ville est neuf. On sent que la mémoire, celle des siècles qui nous ont précédés, y a été gommée, anéantie, niée par un cataclysme. Varsovie a subi le sort qu’Hitler réservait à Paris. Rasée. Imaginez dès lors Paris avec seulement le Quartier Latin reconstitué à l’identique et, partout ailleurs, une architecture de soixante dix ans d’âge seulement ! Imaginez la conscience collective évoluant dans un présent dont tout l’amont a été violé. Je vous laisse imaginer. Et si vous allez jusqu’au bout de votre imagination en marchant dans Paris, sans doute rencontrerez-vous Varsovie.
Le crime est irréparable, le crime ne trouvera jamais, quoique disent et fassent les hommes, sa compensation. Les Nazis n’ont pas été complètement vaincus car partout sur le visage de la Pologne ils ont laissé l’indélébile empreinte de leur folie.
Les communistes, rendons leur cet honneur, ont tenté de retrouver la mémoire au cœur de la vieille ville. Et ils y ont réussi. Mais c’est comme à Lascaux : c’est beau et émouvant, mais, intellectuellement, vous savez que vous êtes en présence d’une réplique.
Dans les campagnes, les paysans, tout du moins ceux avec qui je cause, ceux qui n’étaient pas en coopérative, n’ont pas ressenti durement le communisme. Ils vivotaient en autarcie sur quelques lopins, et, du moment qu’ils ne militaient pas contre le régime, qu’ils se montraient assidus au défilé du 1er mai et ne se rendaient pas trop ostensiblement à la messe, on leur foutait une paix royale, semble-t-il.
La messe… La Pologne, baptisée par les Tchèques dès 966, est férue de messes. Et si, sans Hitler et sa chute, elle n’aurait jamais été communisée par un puissant appareil d’état au mépris du peuple polonais, sans les communistes et leur chute, elle n’aurait jamais été cléricalisée comme elle peut l’être aujourd’hui.
Les époques s’enchaînent, chacune voulant nier la violence de l’autre alors qu’elle en est le produit direct. Chacune porte en elle les gênes de la violence du passé immédiat qui l’a enfantée.
Depuis la renaissance de 1918, il en est ainsi en Pologne : rien n’est fait dans la mesure.
A suivre...
07:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.08.2012
L'enracinement de l'exil - 11 -

L'histoire - 2 -
Le Reich nazi pris entre deux étaux marchant l’un à la rencontre de l’autre, celui des troupes occidentales et celui de l’Armée rouge, Churchill aura beau affirmer que d’accord, on serrerait la main des Russes, mais le plus loin à l’est possible, le rouleau compresseur soviétique en route vers le soleil couchant depuis Stalingrad, arrivera avant lui à Berlin et sera le premier à planter son drapeau rouge au sommet du Reichstag.
Que l’opiniâtreté de l'Union soviétique, son esprit combatif, son immensité, ses plaines et son insoutenable climat aient été les victorieux de l’immonde machine nazie, ne fait aucun doute, sinon pour les révisionnistes occidentaux. Car c’est bien un poncif d’affirmer que si Hitler n’avait pas violé le pacte Ribbentrop-Molotov, pacte qui comportait la clause secrète du quatrième partage de la Pologne et qui fut et restera devant l’histoire la honte de tous les communistes, le 6 juin 1944 n’aurait su avoir lieu.
Le Reich se serait forcément écroulé, mais d’une autre manière et sans doute à plus long terme, laissant derrière lui une somme encore plus effroyable de crimes et l’ampleur de l’holocauste eût été encore plus hallucinante.
Certes, tout cela est archi-connu. Ce que l’on sait peut-être moins - ou peut-être fait-on simplement mine de l’avoir oublié - c’est qu’en février 45 à Yalta, Staline et sa diplomatie arguaient du fait qu’ils avaient été agressés deux fois, en 1914 et en 1941, et que, cette fois-ci, chats échaudés n'aimant pas trop l'eau froide et puisqu’ils avaient tous les atouts en main pour imposer leurs vues ( l’Armée rouge n’était plus qu’à une centaine de kilomètres de Berlin), ils exigeaient qu’entre eux et l’Ouest, après la victoire, soit dressé un rempart de protection, c’est-à-dire, en plus clair, que les territoires qu’ils auraient libérés deviennent leurs vassaux.
Américains et Anglais n’avaient plus qu’à baisser leur pantalon et à faire le dos rond, comme ils l’avaient toujours fait - pour le sanglant Katyń notamment -devant l’ancien séminariste devenu le maître absolu du Kremlin.
Staline partageait avec Hitler, entre beaucoup d'autres choses dont un antisémitisme féroce, un sentiment commun envers les Polonais : la haine.
Pour l’un et l’autre, c’était là un sous-peuple, un peuple de dégénérés, voué à être dominé et l’esclave des puissants. Hitler avait fait de la Pologne le cimetière le plus démentiel et le plus démoniaque de l’histoire des hommes, Staline en fera sa proie de prédilection après 45, exigeant que le pays soit gouverné par des amis sûrs de l’Union soviétique et donnant à sa conquête de toute l’Europe centrale une assise militaro-juridico-politique, sous le nom glorieux de Pacte de Varsovie.
La Pologne, anéantie de 1795 à 1918, dévastée à partir de 1939, ensanglantée et torturée comme aucun autre pays ne le fut par les Nazis, se voit donc libérée par un libérateur qui la hait et qui a décidé de la saigner à blanc. Il est assez éprouvant pour la mémoire de se rappeler que les camps de concentration à peine libérés aient vu leurs baraquements aussitôt réutilisés pour qu’y soient enfermés et réduits au silence tous les résistants et patriotes polonais qui avaient combattu le nazisme et espéraient reconstruire une Pologne polonaise.
Il s’agissait pour Staline de faire le ménage avant d’installer là son gouvernement fantoche, à la tête d’une République populaire de Pologne.
Le pays ne retrouvera sa dignité que quelque cinquante ans plus tard, totalisant en tout et pour tout, 1919/1939, vingt ans de liberté depuis Louis XV ! Il sera d’ailleurs le premier, dans le bloc dit de l’est, à secouer le joug, le premier à imposer de haute lutte à son oppresseur des élections libres et des syndicats libres, bien avant la chute du mur.
Pour cette raison, cette chute ne signifie rien pour les Polonais. Elle n’est qu’un symbole, qu’une image superficielle pour consommateurs d’histoire. Ils avaient déjà fait craquer l’ogre soviétique, avaient déjà payé cette chute du mur au prix fort, emprisonnés ou tués, et subi l’Etat de guerre décrété le 13 décembre 1981, en donnant ainsi une image qui s’accroche encore au monde, celle d’un pays exsangue, affamé, privé de tout et où il fallait attendre des semaines et des semaines avant de pouvoir prétendre s’acheter le moindre morceau de viande.
1981, messieurs-dames ! C'était hier... Que dis-je ? C'était il y a une demi-heure à peine !
Si je vous raconte tout cela, - que peut-être vous savez déjà - dans un texte ayant trait à mon exil personnel, c’est parce que chaque 1er septembre, à midi pile, quand toutes les sirènes se mettent à mugir comme si elles pleuraient des larmes intarissables, comme si elles lançaient aux cieux la douleur d'une plainte qui n’en finit pas de jaillir d'une blessure qui ne se referme pas, j’ai le cœur qui tremble et je suis saisi par une émotion de forte compassion, avec, au fond, un puissant sentiment d’amitié pour cette terre et ce peuple, moi l’exilé occidental dans ce pays mis en ruines pendant des siècles et à qui les puissants d’Europe ont voulu tour à tour tranché le cou.
C’est cela, entre autres, que je voulais vous dire sur la page précédente en vous disant que je vivais mon interprétation du monde (acquise dans une conscience collective) au sein d’une conscience collective qui n’était pas la mienne.
Qui ne pouvait être la mienne.
Et je ne m’éloigne ainsi nullement de ma question initiale : est-ce que ton pays te manque ?
11:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.08.2012
L'enracinement de l'exil - 10 -
 L'histoire - 1 -
L'histoire - 1 -
Tous les pays du monde ont dans leur sillage les désordres ensanglantés de leur histoire.
Tous.
Pas un qui n’ait creusé son sillon, ensemencé son futur et récolté son présent sans avoir plongé l’épée dans les tripes de son voisin ni détruit par le feu ses villes et ses campagnes. L’histoire des hommes, dont la pensée dominante et dominatrice voudrait bien nous faire accroire qu’elle s’est apaisée dans nos contrées européennes et que le feu et le glaive appartiennent désormais à un passé barbare aboli par l’intelligence et la sagesse, cette histoire, se résume aux massacres et aux pillages des uns par les autres ou des autres par les uns. Le monde, avec ses banques, ses richesses, ses misères, ses équipements, ses frontières, ses conforts, ses morales, ses hypocrisies, ses convictions, ses religions, ses systèmes, ses loisirs, ses arts, que nous y fassions allégeance ou que nous nous en fassions les critiques résolus, n’est que l’éphémère et toujours fragile conclusion d’assassinats, de crimes et de mensonges perpétrés sur une échelle dantesque.
Les peuples d’aujourd’hui - pour nous en tenir à ce coin de monde qu’on appelle l’Europe - vivent en bonne intelligence, ont aboli la plupart des frontières gagnées pour les uns par le fer et le feu, perdues pour les autres par les larmes et le sang, et envisagent à présent leur avenir avec une sérénité désarmante. C’est le cas de le dire.
Bien sûr que c’est fort louable et bien sûr que c’est beau dans l’esprit ! Mais nous savons trop quels chemins nous avons empruntés pour parvenir à cet eldorado politico-financier courant des lisières de la vaste Russie aux plages de l’Atlantique, puis des rivages de la Méditerranée aux fjords gelés du Nord.
Les hommes de l’Europe peuvent bien avoir le même discours, s’abreuver aux mêmes sources bancaires et faire mine d’épouser les mêmes idéologies consolatrices, nous pensons, nous, que toutes les flaques de sang n’ont pas séché à la même vitesse sur tous ces chemins qui nous ont conduits jusques là et nous croyons que l’homme qui vit dans la nuit finlandaise, sous la neige et dans le vent, à deux doigts du pôle, ne voit pas de semblable façon la terre et la vie s’y organiser que celui dont les pieds baignent dans les eaux bleues de la Méditerranée, à l’ombre des oliviers, pas plus que l’homme qui a passé cinquante ans de sa vie sous la menace des chars de Moscou n’a la même vision du temps historique que celui qui n’a entendu le vacarme des chars que sur un écran de cinéma, dans ses livres d’histoire ou de littérature.
Je suis de ces derniers et je vis parmi les premiers. J’appartiens à la conscience collective de ceux qui n’ont jamais vu de chars braquer leurs canons aux portes des banlieues ni d’armée tirer sur la foule. Je suis donc le cul entre deux chaises, vivant ma conscience individuelle - les racines de mon interprétation du monde - au milieu d’une conscience collective autre… Et cette position entre deux consciences populaires résulte du choix que j’ai fait de vivre hors de chez moi.
Ce n’est donc nullement une position intellectuelle. C’est une réalité tangible, car l’histoire des sociétés laissent dans la conscience des hommes une conception durable du monde. Une conception agissante et lisible.
J’avais fait mes premières armes de contestataire du capitalisme contre un homme, De Gaulle, alors que les hommes d’ici étaient prêts à payer de leur vie pour l’avoir comme chef d’Etat. J’ai brandi le drapeau rouge et noir alors que les jeunes gens de mon âge, ici même, dans les années soixante dix, se faisaient tirer dessus ou étaient emprisonnés manu militari pour avoir voulu déchirer et passer par les flammes ce même drapeau qui ligotait leur existence. Un fossé me sépare donc de ces hommes, nous séparera toujours, même dans la fraternité la plus sincère.
Tous les chemins, en histoire, ne mènent donc pas à la même Rome. Même s’ils mènent aux mêmes mirages.
L’Europe est un mirage que seule dissipera une véritable fraternité, une fraternité sociale et non usurpée, ou, hélas, le déchaînement des contradictions reprenant du service sur les champs de bataille.
Je le sens. Je le déplore mais je le sens. J’ai appris ça de mon exil. Non point que les Polonais soient des gens belliqueux et mauvais coucheurs– bien au contraire, leur hospitalité est des plus chaudes ! – mais parce qu’ils n’habitent pas exactement, de par le sang que l’histoire leur a demandé de verser, la même Europe. Et il en va certainement de même pour tous les peuples d’Europe centrale, chacun avec leurs spécificités, longtemps réduits au silence derrière le rideau de fer, celui-ci étant, on ne le sait que trop, né d’un pacte signé par certains et accepté par tous, entre l’empire stalinien et l’occident.
Tous les discours peuvent bien dire le contraire. Ils ne serviront pour moi qu’une idéologie diplomatique dont la vision à trop court terme tente d’aliéner aux intérêts bancaires, mercantiles et immédiats du communautarisme géopolitique, la conscience chèrement acquise sur les chaos de l’histoire.
A suivre...
09:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.08.2012
L'enracinement de l'exil - 9 -
Le climat - 2 -
La valse des saisons en Pologne de l’est est une valse acrobatique, capable d’exécuter en même temps de grands écarts et des bonds prodigieux. Le mercure en effet caresse fréquemment les 40 degrés en juillet, avec si peu d’air que les arbres en tremblotent et que les cigognes, juchées sur le rebord de leurs gros nids, ouvrent tout grand leurs ailes pour tâcher de prodiguer un peu d’ombre à leurs oisillons. Les orages succèdent aux orages, les cieux se fracassent, déversent avec violence leurs trombes, s’en vont ailleurs distribuer leur colère et la marmite se remet à bouillir sur un zénith limpide. Et ainsi de suite…
En janvier, ce même mercure déprimera jusqu’à des 30 degrés de froid, parfois avec un tel vent surgi de l’est qu’on croirait bien que la contrée est soudain survolée par des escadrilles invisibles d’aiguilles lancées à toute allure.
On dirait que cette plaine est alors une demeure aux murs et au toit tellement béants que tout peut s’y engouffrer avec démesure, et ce sentiment qui fait synthèse des conditions climatiques, des sculptures de la géographie et des tumultes de l’histoire, ce sentiment qui donne envie d’écrire aussi, je crois qu'Andrzej Stasiuk le partage.
Lors d’un collectif d’écrivains se proposant de composer sur quelques grandes villes européennes, il consigne ainsi son passage à Lublin :
«Il fait froid. On est en novembre et il fait froid. Un vent glacé souffle de l’est, il faut s’emmitoufler. Pas moyen de s’abriter. La terre est toute plate depuis l’Oural. Plus plate que plate. Les phénomènes atmosphériques ne rencontrent pas le moindre obstacle. Les armées non plus. C’est ce que s’est dit Napoléon, et après lui, Hitler. Ils sont revenus la tête basse. Ils n’imaginaient pas qu’il pouvait exister quelque chose d’aussi vaste que la plaine de l’Est. On peut marcher autant qu’on veut, on n’arrive jamais au bout. On peut envoyer autant d’hommes qu’on veut, ils périront. Voilà ce qu’on se dit quand on descend par l’escalier de la rue Grodzka jusqu’à la place et qu’on prend en pleine figure ce vent venant de droite. Ce vent qui passe au-dessus des barres d’immeubles en venant du fond des ténèbres qui commencent quelque part au-delà de Khabarovsk, de Vladivostok. J’enfile tout ce que j’ai : col roulé, polaire, manteau, capuche, rien n’y fait. Il suffit que je quitte la rue Grodzka pour sentir que l’hiver est proche. Qu’il s’apprête à bondir, comme une panthère des neiges. Voilà. »
Admirable sensation de l’écrivain polonais aux prises avec les rigueurs de son pays ! Alors moi, venu des écumes tièdes, des sables chauds et des marais ombragés, au début, tant de froid me faisait frayeur. J’ai vécu mes premiers hivers comme une guerre. Faut dire que ma maison n’était pas prête. Elle avait beau se recroqueviller au coin de la forêt, se tapir sous la neige, quand l’hiver des steppes orientales l’a prise dans ses étaux, les canalisations se sont solidifiées et l’air se glissait par le moindre interstice, mordant le mollet, griffant la peau.
Je n’avais jamais connu cette course quotidienne contre le gel qui risquait de tout démolir ce que nous avions construit de si haute lutte et cette angoisse de voir sur nos têtes le tout s’écrouler sous (j’ai fait le calcul) 65 tonnes de neige, compacte et glacée ! Je me revois aujourd’hui avec une échelle et un râteau de fortune, fabriqué en vitesse, pour faire tomber cette neige, tâcher d’alléger les poutres et, tandis que j’étais en équilibre sur les rolons verglacés, devant mes yeux, le vent soulevant des tourbillons de poudre. Plus je faisais tomber de neige et plus le ciel s’évertuait à en déverser.
Maintenant, la bicoque a fière allure et sait braver, le front altier, les tempêtes sibériennes. Elle fait corps avec son climat. Elle ne s’en laisse pas compter !
Mais tout ce blanc, toute cette glace givrée aux paysages, tout ce silence qu’on croirait que le soleil a suicidé le monde, et ce thermomètre des jours et des nuits bloqué sur les moins vingt degrés, sont pour moi autant de pages directement ouvertes au chapitre extraordinaire d’un exil volontaire.
Dans une autre géographie, sur un autre coin de la terre, différemment exposé au regard de l’univers.
Autant de délices aussi. J’en avais tant rêvé, tout môme, de ces hivers déments de l’est !
Mais les exigences de confort de la vie adulte ajoutent toujours aux rêves d’enfant ces inconvénients prosaïques qui, par définition, leur font défaut.
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.08.2012
L'enracinement de l'exil - 8 -
 Le climat - 1 -
Le climat - 1 -
Le climat continental est d’abord mouvements, confusions et contradictions tumultueuses.
J’en connaissais évidemment quelques bribes retenues des lointaines leçons de géographie ou retirées d’expériences de voyage. Mais les leçons, même bonnes, sont toujours imprécises tant qu’elles n’ont pas été confrontées au réel et les expériences de voyage ne se souviennent pas d’un climat mais d’une météo.
Je maintiens - après Géographiques - que les conditions d’existence des hommes, la valse de leurs humeurs, leur façon d’appréhender leur monde, de forger leurs désirs, d’entretenir leur relations avec les autres, sont étroitement liées à la latitude de leur coin de ciel. La météo, page du climat lue au quotidien, n’est, selon moi, le sujet par excellence des conversations futiles que parce que ce monde a perdu ses repères humains et n’a que des conversations futiles à offrir. Ainsi, en en codifiant une fois pour toutes quelques unes comme archétypes de l’insignifiance, laisse-t-on à penser qu’il en existe, par opposition, de profondes. Ailleurs. Prenez, par exemple, un faux-cul de la pensée photocopiée, un qui se penche avec application sur les sujets qui ont de la barbe, les sujets graves, philosophiques, politiques, religieux, sociologiques ou autres, et parlez-lui de météo. Voyez dès lors son sourire en demi-teinte ! Ce sourire, qui se voudrait empreint d’une ironie supérieure, n’est en fait que le sourire d’un qui est content de vous parce que vous lui donnez l’occasion d’exprimer par un rictus narquois combien il est éloigné de ces préoccupations enfantines, lui, l’homme consistant !
Toutefois, pour démasquer l’imposteur, il suffit bien souvent de l’entraîner, après deux ou trois mots convenus et badins sur la pluie et le beau temps, dans un dialogue plus relevé pour l’entendre alors prêcher des médiocrités au regard desquelles le temps qu’il fait sur nos têtes apparaît comme un chapitre hautement intellectuel du commerce des hommes.
Le climat et ses corollaires, la géographie et l’histoire, sont les terrains de jeu sur lesquels nous vivons notre vie. Ils créent quelque chose de nous, ils ne nous sont jamais extérieurs, j’en suis certain, comme peut l’être la politique, surtout menée par les corniauds à qui on s’obstine depuis des lustres à donner une parole vide de sens. Très loin, très loin de nous. Tellement loin que nous n’en recevons plus rien qui nous concerne.
J’avais au-dessus de ma tête la douceur à peu près égale, sauf cas de crise intempestive, des climats de bord de mer. Des climats qui sentaient le sable, la brume et les algues de la marée. Et puis sous mes pieds, toute cette verdure des marais, des chemins de halage et des berges herbeuses le long des larges conches. C’était, dans mon esprit, un climat sans surprise, un climat dont la respiration était réglée sur celle du grand voisin, l’océan. La lumière y était d’ailleurs en perpétuelle réverbération sur une géographie façonnée par l’eau, le souffle du large et l’histoire des peuples de la mer. Les étés, sans être étouffants, chauffaient la peau et les hivers, sans être tout à fait confortables, ne cisaillaient pas le bout des doigts, ne pétrifiaient pas les paysages et ne gelaient pas les poils du nez quand on marchait dans le vent. Là-bas, quand on discutait météo, c’était pour se plaindre des longs crachins de l’automne ou des opiniâtres pluies de printemps, d’un orage qui avait éclaté sans crier gare et que, ma foi, on eût dit que tout le noir du ciel allait tantôt dégouliner sur les terres. Occasionnellement, vraiment pas très souvent, un peu de neige venait saupoudrer la prairie mais, à la vue de tous ces paysages dont l’eau était l’architecte premier, elle se dépêchait de fondre en larmes, parfois même avant de toucher le sol.
J’ai connu là-bas de vieux maraîchins, descendants des huttiers, manants et hors-la-loi qui peuplaient jadis l’inextricable dédale des fossés, des canaux et des ruisseaux. Ils n’auraient pas su vivre leur sang ailleurs que dans cette végétation luxuriante et moite, ils n’avaient d’yeux et de passion que pour l’anguille des marais et, comme elle, ils semblaient lucifuges au point ne pouvoir respirer que dans l’ombre épaisse des labyrinthes d’eau et de terre.
C’était une latitude, un climat, une géographie et une histoire : celle de la conquête des terres abandonnées par l’océan.
Les hommes étaient, comme tous les hommes du monde, inscrits dans le décor d’une destinée humaine.
Comme le sont, ici, ceux du vent, des étés étouffants, de la neige et de la glace, sur une plaine de sable ouverte aux quatre horizons, déroulée des Carpates à la Baltique et des modestes collines d'Allemagne jusqu'à l'Oural.
A suivre...
09:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.08.2012
L'enracinement de l'exil - 7 -
L'amitié
Que pourrais-je dire de plus, qui ne soit que confidence impudique ?
Le temps et l'éloignement sont des tombes où sont enterrés des vivants.
09:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.08.2012
L'enracinement de l'exil - 5 -

… Je disais donc qu’en ma demeure il n’y a place ni pour internet ni pour tout autre média qui me relierait peu ou prou à la cacophonie du monde.
Je ne dis pas que c’est bien ou que c’est mal, je ne porte aucun jugement de valeur sur une situation qui est de fait et non le résultat d‘une volonté militante ou d’une posture idéologique.
Cet anachronisme d’anachorète me satisfait néanmoins pleinement. Sinon, je tâcherais évidemment d’y remédier.
En ma demeure, il n’y a également pas beaucoup de visiteurs. Et voilà bien ce qui diffère radicalement de ma vie à la française, dans laquelle je ne pouvais me sentir exister que s’il y avait autour de moi le mouvement d’une camaraderie tapageuse et, s’il n’y était pas, du moins fallait-il qu’il soit prévu à très brève échéance.
Il me fallait des rendez-vous. Des points de mire.
Aujourd’hui, le commerce direct avec les hommes est pratiquement absent de mon exil.
Cela non plus n’était pas prémédité, même s’il pouvait paraître évident que, m’éloignant de près de 3000 kilomètres, on n’allait pas tous les soirs venir frapper à mon huis pour prendre l’apéro, jouer un brin de guitare ou discuter le bout d’gras.
La situation m’a fait autant que je l’ai faite et, au fil de ces quelques années, je me suis déshabitué des hommes qui parlent ma langue. Il m’est pénible de faire cet aveu mais, si j’ai toujours plaisir à ce qu’on me rende visite, si je suis toujours aussi joyeux d’ouvrir ma porte et qu’une bonne table soit dressée pour quelques amis ou copains de passage- très rares mais auxquels je voue cependant une franche amitié - au bout de deux jours, un certain silence me manque déjà.
La compagnie, on dirait, efface mes repères.
L’exil a donc dressé autour de moi une espèce de rempart à l’ombre duquel je peux vaquer à mes diverses occupations champêtres, bricoler de la matière, me contredire, rêvasser, lire, écrire, refaire le monde à ma façon sans qu’il ne soit besoin d’en parler à qui que ce soit.
Et je me dis souvent que mon existence, dont tous les aspects avaient eu jusqu’alors ceux d’un gave dévalant en cascades les flancs d’une montagne, a trouvé dans l’exil la plaine pour y prendre le temps de dessiner ses méandres.
Mais il est vrai, pour filer la métaphore, que tous les ruisseaux vont à la rivière, toutes les rivières au fleuve et que le fleuve, toujours, musarde, flâne, ralentit sa course, hésite, avant de s’aller diluer et mourir dans l'anonymat des grands océans.
13:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.08.2012
L'enracinement de l'exil - 4-

Il est indéniable que je passais en France beaucoup, beaucoup moins de temps sur internet que je ne le fais désormais. Pour être tout à fait clair, je n’allais quasiment jamais sur le net hors mes heures de travail et, comme des millions et des millions d’employés de bureau coincés dans leur cage capitonnée au seul dessein de payer leur loyer et d’assurer le fricot, je n’y allais pas pour ledit travail, mais pour des choses personnelles. Quitte à me les inventer.
Pendant ce temps-là, le temps passait et c’était, ma foi, une façon comme une autre de détourner l’ennui.
Le salariat a de ces mesquineries ! Si au moins les salariés pouvaient l’avouer ouvertement plutôt que de s’inventer mille fables à propos de leur conscience professionnelle, de leur utilité, de leur mission et autres sornettes, diantre, il y a fort à parier que la vapeur s'inverserait dans les turbines du consensus social !
Bref, Internet ne m’était en France que d’une utilité négative. Sauf une fois. C’était en 1999, je venais de terminer la rédaction de Brassens, poète érudit et je cherchais un éditeur. Je suis tombé sur Patrick Clémence, j’ai écrit, réponse favorable. S’en est suivi la publication du livre et une belle camaraderie avec ce joyeux et sympathique anar. Salut de loin, vieux gars !
En Pologne cependant, internet fait partie de mon quotidien. L’amusement s’est fait outil. Outil de quoi ? Je l’ai déjà dit, homo internetus s’amuse sérieusement. Le ludique, par un étrange et obscur sentiment de culpabilité peut-être, s’est érigé en outil, le dilettantisme s’est mué en profession (de foi). Je parle là exclusivement de ce qui nous concerne plus spécialement, d’écriture et de littérature.
Et puis, depuis mes plaines orientales, c’est dans cette seule lucarne qu’on parlait français, le bon français même, alors, internet est devenu au fil des années mon oasis romane dans un monde slave.
Sauf, quand même, que je me suis réservé une autre oasis, plus réelle, plus tangible.
Ma maison est en bois et elle sent la résine de pin, la sienne, celle dont elle est construite, et celle qui coule dans les veines de la forêt dressée à proximité. Là, sont mes livres, mes campagnes, le vent de l’est, la suite de mon histoire, mes occupations domestiques, mes petits travaux, le chant du loriot, la neige, les chemins plats et les dégels de printemps. Et le cœur de ma vie. Là, il n’y a pas de place pour internet. Il n’y pas de téléphone, pas de radio, pas de télévision non plus. Là, il y a la vie qu'on n'a pas le temps de raconter parce qu'on la vit.
Internet reste donc toujours ce monde virtuel et cette grange où s’entassent les mots dont l'écho m'a manqué. Mais il n’a pas de visage humain, c’est d'ailleurs pourquoi, parfois, il se veut si humain. Il est si rassurant ! Quand on y apprécie quelqu’un, c’est sans risque : on apprécie une ombre. Quand on s’y engueule, qu’on se brouille avec un autre, on se fâche ou on se brouille avec un fantôme, une imagination de soi-même, ce soi-même étant, à l’autre bout, lui-même imaginé. Théâtre d'ombres chinoises.
Il est d’abord littérature, représentation en fiction d’un monde bien réel et qui a fui sous nos pas. Qui s’est envolé par la fenêtre plutôt.
Ah, que ne me suis-je créé d’antipathies virtuelles sur ces pages aux mille visages invisibles, pour m’y être cru un moment comme dans la vie ! Est-ce qu’on se fâche avec les personnages qu’on crée dans ses romans ? Quand on est mécontent d'un acteur, au théâtre, est-ce qu'on s'en prend à son rôle plutôt qu'à son jeu ? Erreur de jeunesse, dirais-je avec le sourire.
Le seul visage humain d’internet c’est la solitude de chacun reposant sur la solitude de l’autre. Sans aveu. En donnant le change même. Et ce, par-delà l’insignifiance, pourtant révélatrice pour ceux qui exigent encore et encore de la vie, de tous les bavardages.
Internet est un exil.
Et c’est par cet exil dans l’exil que je suis devenu homo internetus à temps partiel.
14:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.08.2012
L'enracinement de l'exil - 3-
 Ecriture et blog
Ecriture et blog
Blog ou pas blog, j’ai toute ma vie consacré à deux velléités : l’écriture et la musique, sans pour autant réussir à devenir ni un véritable écrivain, ni un chanteur ou un musicien accompli. Encore faudrait-il préciser ce que peuvent être un véritable écrivain ou un chanteur accompli par-delà ce qui les définit socialement, c’est-à-dire par-delà l’audience et le succès.
Bernard Henri Levy n’est à ce titre pas plus un écrivain accompli que Johnny Hallyday n’est un artiste émérite. Bernard Henri Levy n’a jamais fait le même métier que Michon ou Echenoz et Hallyday n’a jamais fait le même que Brassens, Brel ou Barbara. Mais laissons ça de côté, c’est un autre propos, souvent injuste, partial, quand il n’est pas atrabilaire et vindicatif. Après tout, si j’avais trouvé sur ma route chaotique un gars qui m’aurait dit qu’il allait me produire un disque avec des chansonnettes à la gomme dans lesquelles amour aurait rimé avec toujours et automne avec monotone - déférence gardée envers Paul Verlaine - peut-être n’aurais-je pas tordu le nez et fait la fine bouche du puriste.
J’ai donc écrit mon premier récit à l’âge de douze ans environ et, comme tous les collégiens-adolescents reclus entre quatre murs où une absurde discipline tenait lieu de morale de vie, j’ai noirci des cahiers entiers de poèmes où les vers tenaient lieu de subversion.
Plus tard, j’ai gribouillé des manuscrits, des romans, des nouvelles, des trucs qui se voulaient être des essais, toutes ces tentatives ayant pris le chemin qui mène directement à la poubelle.
Sans cette poubelle et sans l’exil, deux choses absolument sans aucun lien entre elles, aurais-je ouvert un blog ? Je n’en suis pas certain. Mais on ne peut rien affirmer de fiable quand on se fait apocryphe, qu’on imagine un passé autrement. Disons alors, pour tenter d’approcher la vérité au plus près, qu'eu égard aux dispositions d’esprit dans lesquelles j’étais durant les quelques années qui ont précédé mon départ de France, il n’y avait aucune place pour le temps, l’envie et l’investissement personnel que réclame la tenue d’un blog.
L’ennui dû à une vie dont le seul défaut était d’être depuis trop longtemps la même, le prisme tantôt joyeux tantôt désespérant de l’alcool, les copains, la musique qui, les derniers temps, me donnait toute satisfaction, un travail – sens étymologique oblige -qui m’était devenu exécrable, tout ça avait expulsé de mon âme le désir et le besoin d’écrire.
Et c’est quand j’eus tranché le nœud gordien qui retient prisonnière toute vie sécurisée sous le poids des habitudes, même bonnes, lorsque je me suis retrouvé dans un pays dont je ne savais pas grand-chose, dans un climat autre et une géographie nouvelle et, surtout, avec d’autres espoirs affectifs, que je me suis remis à écrire, tous les jours, avec délectation, avec acharnement, comme si cette écriture avait enfin trouvé, avec le déracinement, l’encre dans laquelle il était nécessaire qu’elle fût trempée.
L'écrivain Denis Montebello, avec lequel j’entretenais une correspondance régulière consécutive à une amitié de plus de vingt-cinq ans, me faisait la juste remarque selon laquelle j’avais attendu d’être coupé de mes racines et de mes amitiés pour écrire – quoique d’impure façon – mon archéologie personnelle avec Le Silence des chrysanthèmes. Comme si je voulais remonter le temps et, remettant au jour les tessons éparpillés de mon enfance, j’eusse voulu comprendre la direction d'un vent de départ qui m’aurait poussé sur les rives du Bug, à l’autre bout de l’Europe.
Puis ce fut Des plages de Charybde aux neiges de Scylla, puis, Chez Bonclou, puis Polska B dzisiaj, puis Zozo, puis Géographiques, puis des nouvelles, puis Le Théâtre des choses, puis deux autres livres actuellement en stand by désolé sur mon disque dur, Agonie et Le Laboureur.
Neuf livres en sept ans avec, entre temps, les quelque 800 textes qui constituent aujourd’hui L’exil des mots. Non, assurément, j‘imagine que je n’aurais jamais fait cela les pieds plantés dans ma glèbe natale et le nez dans un verre où scintillaient autant de désillusions fantasmées que d'espoirs mal définis.
C’est comme ça. Un hasard. Tout n’est qu’hasard logique.
Alors ? Aurais-je la prétention, l’outrecuidance, l’abominable orgueil de prétendre que mon blog est un blog à part en tant qu'épiphénomène du sentiment vécu de l'exil ? Il y a tant d’imbéciles heureux qui me jugent vaniteux, que je serais presque tenté de l’affirmer, histoire de rajouter un peu à leur imbécillité, d’amener de l’eau à leur moulin et de les enfoncer encore plus dans leur fallacieux jugement. Comme le disait plaisamment le fameux dialoguiste : faut pas parler aux cons, ça les instruit.
Mais cela ne satisferait pas du tout ma démarche. Mon blog est donc une goutte d’eau dans la mer inégale des milliers d’autres blogs et sites.
Alors, souvent, je me dis que, soit il y a autant de motivations qu'il y a d’archéologies intimes, autant de raisons d'écrire qu’il y a de gens qui écrivent, soit l’écrivant, le blogueur, est, tout comme moi, un être exilé de soi, à qui il manque un bout de monde constitutif et qui jette sa bouteille à la mer, espérant qu’elle atteigne à d’autres rivages et reçoivent enfin l’écho d’autres voix inconnues.
A la recherche des mots pour faire du monde et de sa vision une unité.
Pour rapatrier ces mots.
Dans l’illusion numérique du directement publiable– dont je me garderai bien de dire si elle est profitable ou non –, d’avoir enfin trouvé les sentiers de traverse qui évitent ceux menant tout droit à la poubelle.
14:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.08.2012
L'enracinement de l'exil - 1 -
PREMIERE PARTIE
Mon pays
Qu’elle émane d’un autochtone ou d’un Français de passage ici, la question m’est souvent posée de savoir si mon pays me manque.
En soi, c’est une question profonde mais posée, il me semble, sur le mode du comment ça va ? Une question de l’urbanité la plus élémentaire, dont on n’attend pas forcément une réponse, quand on ne s’en fout pas éperdument.
Du temps où je travaillais - peu car me souciant comme d’une guigne de gagner beaucoup -, j’avais fait l’expérience amusée, un beau matin où un collègue me demandait, comme tous les matins et comme tous les collègues, si ça allait, de répondre : non, ça n’va pas du tout. Déstabilisation immédiate, trahison du code social, gêne, affolement et fuite.
Surtout ne pas risquer les confidences humaines d’un malaise putatif de l’autre. C’est pourquoi, à la question comment ça va, on répond toujours oui, même si on est aux prises avec les tourments les plus cuisants.
J’avais ainsi pris l’habitude, voulant comme tout le monde sacrifier au code de bonne conduite, de saluer mes collègues d’une formule qui incluait la réponse: Comment c’est-y que ça va bien ce matin ?
C’est donc à ce genre de phénomène que me fait désormais penser la question récurrente : est-ce que ton pays te manque ? Et je me suis ainsi fabriquer une métaphore à quatre sous, que je ressers à chaque fois et qui, je crois, satisfait toujours la non-curiosité de mon interlocuteur :
- Je suppose qu’un marin isolé sur la mer, même amoureux de la mer, a parfois le mal de terre…
C’est une dérobade. Je n’ai en effet pas envie de dire en deux mots si mon pays me manque ou non. C’est beaucoup plus compliqué que cela et c’est un sujet qui, à mes yeux, après sept ans d’exil, mérite en profondeur un long développement. Ne serait-ce que pour y voir moi-même plus clair.
C’est le genre de question auquel, peut-être, seule l’écriture peut répondre.
C’était en mai 2005. La décision de quitter mon pays était ancrée en moi depuis un an déjà. C’était une décision qui m’effrayait et m’enthousiasmait tout à la fois. Je n’avais jamais fait cela, évidemment, je ne savais ni la longueur, ni même le profil de la route sur laquelle je m’engageais. Je ne savais rien de tout cela car je ne savais pas, intérieurement, ce qu’était un pays affublé d’un adjectif possessif. Mon pays. Je n’avais jamais utilisé cette équation, je ne l’avais jamais ressentie, je la jugeais surannée, sans fondement, et même profondément dangereuse. Être français ne faisait pas partie de mon identité, sinon pour les flics et la sécu. Voyageant, en trimardeur ou en touriste, en Espagne, Italie, Danemark, Allemagne, Suisse, Angleterre ou Allemagne, j’avais, comme tous les vacanciers du monde, mon pays dans mon sac et voyageais en parallèle et en boucle, certain que le point de départ, à moins d’un accident mortel, serait aussi le point de retour.
Voyager ainsi, c’est voyager pour voir et entendre seulement. Goûter un brin de culture comme on goûte un amuse-gueule exotique, avant d’en revenir à la saveur bien de chez nous du plat principal.
C’est bien aussi, mais ce n’est pas ce voyage que j’entamai en mai 2005. J’allais passer des frontières qui, peut-être, se refermeraient derrière moi, enjamber des ponts qui, peut-être, seraient coupés une fois la rivière franchie.
Et quelques mois plus tard, évoquant le moment précis où j’avais mis ma décision d’exil à exécution, à un carrefour en pleine campagne, marqué d’un stop, j’écrivais à un ami :
« Ce stop, vois-tu, semblait avoir été posé là pour moi seul et comme limite où devaient s’exprimer, sans qu’aucune dérogation ne soit permise, en même temps la fin de la duplicité et le commencement du courage à vouloir vivre sa vie, à droite comme à gauche.
Le ciel de mai était gris, froid, bas et moche. Je voyais des corneilles bousculées par le vent et qui planaient sur les blés en herbe. Une responsabilité énorme pesait sur mes épaules, depuis toujours peu portées à les recevoir, les responsabilités. Si je prenais à gauche, on pleurerait à droite et inversement.
Que s’est-il passé exactement ? Je ne saurais aujourd’hui trop bien te le dire. Je me souviens avoir hurlé de joie une fois que la voiture eut bondi à plus de cent cinquante à l’heure vers l’entrée de l’autoroute. J’ai hurlé de joie parce que je fonçais vers une décision prise, irrémédiable et franche. Vers d’autres horizons dont je ne connaissais pas encore la couleur et que j’habillais simplement d’espoir.
Aujourd’hui, installé dans cet hiver que la neige englouti, à plus de 2500 km de tout ce que fut jusqu’alors ma vie, dans une langue où je n'entends que des chuintements, heureux et reposé, je me demande souvent ce qui se serait passé si j’avais tourné le volant à droite.
Je ne le saurai jamais. Je mourrai sans le savoir.
Parce que nous sommes des êtres inachevés, des prétentieux qui nous croyons maîtres de nos destins alors que nous ne comprenons rien à la mise en scène de notre propre histoire. Nous sommes suspendus aux quarts de secondes passionnels….» etc.
Ce que je cherche à savoir aujourd’hui c’est en quoi ce coup de volant à gauche, a profondément modifié ma vie.
Répondre donc, sans ambages ni tricheries, à la vaste question : est-ce que ton pays te manque ?
A suivre au cas où cela vous intéresserait…
Image : au bord du Bug
09:46 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.08.2012
Épitaphe
Sur la pierre qui protégera des intempéries mon sommeil éternel, j'aimerais que soit inscrit :
Passant, j'ai moi aussi visité l'au-delà. Là-haut. Où tu as le bonheur de flâner encore
09:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.07.2012
Les métives
 Les toutes premières faiblesses du soleil, sitôt après le quinze août, annonçaient l’heure des métives.
Les toutes premières faiblesses du soleil, sitôt après le quinze août, annonçaient l’heure des métives.
Un mois durant, les paysans allaient de villages en villages et de fermes en fermes, s’échangeant leurs journées pour battre les gerbes de céréales entassées dans les cours en de grosses meules rondes et pointues, qu’on eût dit des habitations conçues par les hommes lointains du néolithique.
La grosse machine à battre, avec ses enchevêtrements de courroies de cuir et de poulies, ses roues ferraillant sur la pierre, arrivait par les chemins, tirée par un vieux tracteur.
Nous l’entendions. Nous l’avions longtemps guettée. Elle était annoncée depuis quelques jours, mais elle avait pris du retard chez un tel, la moisson étant plus abondante que prévue, ou elle avait été contrainte, après un terrible orage chez un autre, d’attendre que le soleil vînt sécher les gerbes.
Le plus souvent, presque tous les ans, elle était tombée en panne chez tel autre et on ne trouvait pas de pièces de rechange. Le forgeron s’évertuait à en bricoler une.
L’arrivée de cette machine tenait lieu de cérémonie. C’était un spectacle et la promesse d’une grande fête. De tous les hameaux alentour arrivaient des paysans, celui-ci sur son vélo, celui-là à pied, ce dernier, plus prospère et souvent plus bedonnant, sur un vélomoteur bleu. Toute une journée, parfois deux ou trois, le grain montait dans les greniers, par des échelles branlantes, dans de lourds sacs de jute portés par les épaules d’hommes sanguins. Il y avait là de l’orge piquante pour vendre, du blé dur pour le pain et de l’avoine pour les chevaux et la basse-cour.
La paille bottelée s’entassait en une barge impeccablement rectangulaire, la balle et la poussière volaient dans l’air, harcelant les yeux, obstruant les narines et maculant le torse en sueur des batteurs qui, tous, avaient noué autour de leur cou leur grand mouchoir à carreaux, comme des cow-boys.
Les repas étaient de véritables banquets d’empereurs décadents. On hurlait, on s’interpellait, on commentait, on jurait et on se soûlait sans retenue. Coqs, poulets, canards, oies, dindes, pintades avaient été saignés, quand un veau ou un goret n’avait pas été sacrifié. Des barriques avaient été mises en perce.
C’est d’ailleurs au jus de ces tonneaux que le propriétaire gagnait pour des années et par toute la campagne à des kilomètres à la ronde, son label de bonne maison, de bon gars ou au contraire sa réputation de gars de rin, de fesse-mathieu et de sale boutiquier, selon que la barrique percée était suave ou aigre.
Certains étaient même publiquement accusés de garder par-devers eux le bon vin, doux et parfumé, et de servir aux battages leur plus mauvaise barrique, de la piquette peutée qui brûlait les estomacs et mettait les boyaux en déroute.
J’étais chargé d’étancher la soif de tous ces farouches batteurs en distribuant les bouteilles de cidre et de vin frais. Je n’y fournissais pas et je courais du cellier au paillé, du paillé au grenier et du grenier au cellier. Dans le vacarme assourdissant des courroies, des pistons, des poulies et des chaînes de l’énorme machine, on me conspuait gentiment, on m’appelait bêtement, on feignait de se plaindre de ma lenteur. Tout le monde avait toujours soif et le tonneau du cellier se vidait, inexorablement, dans le gosier de ces Danaïdes poilus et brailleurs.
Une journée avant la moisson, ma mère avait été demandée pour aider les femmes au fourneau, plumer et vider la volaille, éplucher les pommes de terre et les navets.
Quand sonnait l’heure de la bombance, c’est elle qui servait les plats, adroite, rapide, sautillante et souriante, un bon mot pour chacun, et à la fin, quand la gnôle inondait les cafés brûlants et finissait de détervirer les ciboulots, elle était invitée par toute cette horde de barbares aboyeurs à monter sur les tables et à chanter.
Alors elle chantait, elle chantait à perdre haleine, elle chantait à tue-tête. Elle chantait des temps qui me semblaient ne devoir jamais finir.
Les répertoires de Tino Rosi, de Luis Mariano, de Dario Moreno et de Piaf devaient à n’en pas douter tous passer ces soirs-là par sa glotte. On en redemandait, on tapait des mains et on reprenait en chœur. Elle le tenait, son cabaret ! Elle ne le lâchait plus.
Depuis longtemps cependant la nuit et la fraîcheur étaient tombées et la voie lactée s’arc-boutait dans le ciel des derniers jours d’août.
Alors je m’endormais sur une botte de paille, dans l’ombre de la grange, légèrement à l’écart du banquet, le cœur et l’esprit partagés entre la honte et la fierté.
Et puis c’était la fin. Chacun rentrait chez soi après un grand mois de travail communautaire, de vagabondage de fermes en fermes et de bombance. Chacun s’en retournait à la solitude de ses champs, retrouvait sa tempérance, brossait et ferrait ses chevaux, vaquait à ses occupations ordinaires et recommençait à éventrer la terre en de longs sillons, où seraient déposés les grains prometteurs de nouvelles métives.
Le soleil de plus en plus couleur de miel baissait de plus en plus vite sur la plaine en labours. L’automne dispersait lentement ses lumières obliques et égayait l’herbe des fossés des premières perles de rosée. Les ombres s’allongeaient, les martinets ne criaient plus et les hirondelles ne rasaient plus le sol, ni même ne tournoyaient dans l’air bleu.
Ma mère s’évertuait à rapiécer des pantalons, faisait l’inspection des boutons de chemise, tricotait des pulls ou faisait ressemeler des chaussures.
Le temps de regagner les bancs de l’instruction publique était proche.
08:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.07.2012
Gaston Couté, frère lointain
Je me souviens des grands céréaliers lacérant mes paysages, rayant du cadastre mes chemins de traverse et mes venelles, comblant les fossés, aplatissant les talus où fleurissaient des boutons d’or et arrachant les buissons.
Je me souviens des marais colonisés par l’infect maïs…
Je me souviens des souvenirs détruits. Des pas de l'enfance chassés de la mémoire.
Et j’écoute Couté, cet homme généreux, ce poète de la Beauce, ce libertaire enchanté et qui n’avait pas besoin de gueuler qu’il l'était, libertaire.
Il lui suffisait de laisser couler les larmes de son cœur.
Respect. Toujours. Respect et émotion.
Les Mangeux de Terre
J’passe tous les ans quasiment
Dans les mêmes parages
Et tous les ans, j'trouve du changement
De d'ssus mon passage
A tous les coups, c'est pas l'même chien
Qui gueule à mes chausses
Et puis voyons, si j’me souviens,
Voyons dans c'coin d'Beauce.
Y avait dans l'temps un beau grand chemin
Chemineau, chemineau, chemine !
A c't'heure n'est pas plus grand qu'ma main
Par où donc que j'cheminerai d'main ?
En Beauce, vous les connaissez pas,
Pour que rien n'se perde,
Mangeraient on n'sait quoi ces gars-là,
I mangeraient d'la merde !
Le chemin, c'était, à leur jugé
D'la bonne terre perdue
A chaque labour y l'ont mangé
D'un sillon d'charrue
Z'ont grossi leurs arpents goulus
D'un peu d'glèbe toute neuve
Mais l'pauvre chemin en est d'venu
Mince comme une couleuvre
Et moi qu'avais qu'lui sous les cieux
Pour poser guibolle !
L'chemin à tout l'monde, nom de dieu !
C'est mon bien qu'on m'vole !
Z'ont semé du blé sur le terrain
Qu'i r'tirent à ma route
Mais si j'leur demande un bout d'pain,
I m'envoient faire foute !
Et c'est p't-êt' ben pour ça que j'vois,
A mesure que l'blé monte,
Les épis baisser l'nez d'vant moi
Comme s'ils avaient honte !
Ô mon beau p'tit chemin gris et blanc
Su' l'dos d'qui que j'passe !
J'veux plus qu'on t'serre comme ça les flancs,
Car moué, j'veux d' l'espace !
Ous’que mes allumettes elles sont ?
Dans l'fond d'ma panetière
Et j'f'rais bien r'culer vos moissons,
Ah ! les mangeux d'terre !
Y avait dans l'temps un beau grand chemin,
Chemineau, chemineau, chemine !
A c't'heure n'est pas plus grand qu'ma main
J'pourrais bien l'élargir, demain !
14:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET






















