18.04.2014
Stéphane Beau : Les Perdants, dernier exercice d'équilibrisme
C'est donc le dernier texte de Stéphane sur le sujet - qui est loin d'être épuisé si tant est qu'il soit épuisable - que je vous propose.
J'ai été heureux de relayer ici sa réflexion.
Parce qu'il est un ami ? Oui. Bien évidemment. D'ailleurs, nous venons de travailler ensemble sur le livre que j'ai édité aux Éditions du Petit Véhicule et c'était bien agréable.
Mais, pour nécessaire qu'ait été cette condition d'amitié, elle fut loin d'être suffisante pour que je prenne le parti de publier ici ses textes.
J'ai relayé parce que son livre, Les hommes en souffrance, que j'ai lu et aimé, un livre courageux qui prête forcément le flanc aux morsures de toute la meute ordinaire des idéologues ordinaires, fut le point de départ de sa réflexion.
Réflexion d'un homme touché, ému, blessé sans doute, en tout cas sincère et qui avait besoin de dire son pourquoi.
Le fait est, hélas, assez rare à mes yeux pour mériter d'être souligné.
Merci à lui.
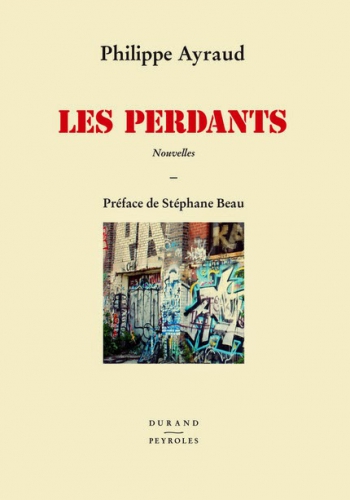 Marcher sur les barrières, jouer les danseurs de corde, se hisser par delà la mêlée, tout cela est bien joli, sur le papier, mais dans la vraie vie, concrètement, ça donne quoi ? Tout soupeser, ne jamais trancher, ne jamais pencher définitivement dans un camp ou dans l'autre parce qu'aucune vérité n'est jamais absolue, c'est intellectuellement très noble, mais est-ce humainement viable ?
Marcher sur les barrières, jouer les danseurs de corde, se hisser par delà la mêlée, tout cela est bien joli, sur le papier, mais dans la vraie vie, concrètement, ça donne quoi ? Tout soupeser, ne jamais trancher, ne jamais pencher définitivement dans un camp ou dans l'autre parce qu'aucune vérité n'est jamais absolue, c'est intellectuellement très noble, mais est-ce humainement viable ?
C'est une question que je me pose régulièrement, bien entendu, et que je me repose forcément depuis plusieurs semaines, à la lecture du blog de Bertrand et des fougueux débats qu'il a allumés autour de la crise ukrainienne. A de multiples reprises, j'ai eu envie d'y aller de mon petit commentaire, et à chaque fois je me suis heurté à mon incapacité à m'arrêter sur un jugement définitif. Dénoncer Poutine et les manœuvres des russes pour s'accaparer de la Crimée, voire de quelques provinces supplémentaires ? Oui, bien sûr. Accuser les États-Unis d'être omniprésents dans cette affaire et d'y jouer avec des dés qui, au fond, ne sont guère moins pipés que ceux de leurs adversaires ? Pourquoi pas ? S'indigner du fait que l'on veuille faire des rebelles de Kiev des héros de la démocratie en s'attachant à gommer les revendications parfois très douteuses de certains de ces dits rebelles ? Évidemment. S'agacer de la niaiserie de la diplomatie européenne qui bien que bombant le torse et roulant des mécaniques, reste aussi emmerdée et impuissante que dans les années trente lorsque la menace nazie commençait à prendre de l'ampleur ? D'accord. Mais après ? Une fois que tout cela sera dit ? Quand la lourde machine sera lancée, que le jeu des ultimatums, des alliances, des escalades d'avertissements et de sommations commencera à se mettre en branle, quelle valeur tous ces mots auront-ils ? Certes, nous pourrons éventuellement nous vanter d'avoir été plus malins que les autres et d'avoir percé à jour l'absurdité de tout cela, d'avoir mis nos contemporains (la poignée de lecteurs qui nous lit autrement dit...) en garde. Mais quand nous serons brassés dans la grande lessiveuse, est-ce que ce sera suffisant comme consolation ?
Je suis actuellement en train de lire le dernier numéro de la revue Agone, consacré à l'Ordinaire de la guerre. Le volume s'ouvre sur une querelle d'historiens, spécialistes de la première guerre mondiale, querelle portant sur la notion de consentement : peut-on dire que tous les soldats qui se sont battus en 14-18, qui y sont morts et/ou qui y ont tué, étaient « consentants ». La relative faiblesse du nombre de mutins et de déserteurs doit-elle nous laisser supposer que tous ceux qui ne le furent pas trouvèrent un sens aux combats qu'ils menèrent ? Quel choix avaient-ils ? Se révolter et finir presque à coup sûr avec douze balles dans la peau ? S'engager dans la guerre et espérer en ressortir sans trop de dégâts ? Sauf que dans la vraie vie, ce choix n'existe pas. Dans la vraie vie, on suit le mouvement. On prend la vague et on essaye de ne pas se noyer. Vous croyez que le type qui se fait embarquer par une rivière en crue a le temps de s'interroger sur le bien fondé de ses choix ? Couler ? Flotter ? Se raccrocher à une branche ? Non, il improvise et s'efforce juste de ne pas suffoquer.
Les choix, de toute manière, on les fera pour nous, sur le moment ou après coup. Car, comme nous le rappelle Ernst Jünger, dans Le Traité du rebelle, le non-engagement n'existe pas. On n'échappe jamais complètement aux barrières et on est toujours plus ou moins fermement sommé de choisir un camp. Et si on ne le fait pas, l'histoire s'en charge pour nous. Plus embêtant : la volonté de non engagement, qui pourrait se traduire comme le « choix de ne pas choisir » est presque toujours réinterprétée comme venant finalement faire le lit des pires horreurs, puisqu'elle ne s'y oppose pas catégoriquement. Cela s'est vu aussi bien en 1914 qu'en 1939. Et cela se reproduit à chaque fois que l'on enferme la pensée dans une opposition binaire et manichéenne, c'est-à-dire quotidiennement.
Certes, tous les choix auxquels nous sommes confrontés au fil des jours ne sont pas aussi cruciaux que ceux qu'ont connus les poilus ou les contemporains d'Hitler, mais quand même : adopter la posture du danseur de corde, de celui qui marche sur les barrières ou de celui qui s'élève au dessus des mêlées reste très compliqué. C'est un « non choix » qui nous engage presque autant, sinon plus, que d'opter pour tel ou tel camp ; car quelle que soit l'évolution de la situation, nous serons au final comptés parmi ceux qui se sont rangés du mauvais côté. Cela est très net au moment des élections où ce sont bien souvent ceux qui se sont abstenus de trancher, justement qui se retrouvent accusés la plupart du temps, par les commentateurs, d'avoir favorisé la victoire de tel parti (le Front National par exemple) ou d'avoir accéléré la chute de tel autre.
Dans un monde ou tout doit quasiment toujours pouvoir être résumé en une opposition binaire le danseur de corde, l'équilibriste de l'esprit, est un handicapé. Son besoin de tout soupeser, d'utiliser les oscillation de son balancier pour éviter de sombrer dans le manichéisme, n'est pas perçu comme une forme d'intelligence mais comme une inadaptation. Sa propension au doute n'est pas reconnue comme une preuve de raison mais comme un signe de faiblesse et d'impuissance. L'équilibriste de l'esprit est un perdant, un éternel perdant. Tant pis pour lui. Tant pis pour le monde aussi, peut-être...
Tiens, en parlant de « perdants », je vous rappelle que Philippe Ayraud a fait paraître, il y a quelques mois de cela, aux éditions Durand Peyroles, un très chouette recueil de nouvelles dont c'est précisément le titre : Les Perdants. Si vous avez trouvé quelque intérêt à me suivre dans ces réflexions, ces dernières semaines, je ne peux que vous inviter à le lire. Vous verrez que si la forme de son propos est forcément différente de la mienne, puisqu'on est là dans le fictionnel, le fond n'est pas si éloigné de ce que j'ai essayé d'exposer ici.
Stéphane Beau
12:03 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.04.2014
Stéphane Beau : par delà la mêlée
 Mon approche de la question féministe ne doit donc pas être séparée de la manière dont je ressens intimement la notion de barrière. Mon problème en effet, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, a toujours été, dans tous les domaines, de refuser d'être assigné à résidence d'un côté ou de l'autre des barrières que l'on m'opposait. Sans en avoir pleinement conscience, la plupart du temps. Et si je parle ici de problème, ce n'est pas par hasard, car c'est une position qui est assez inconfortable. C'est ainsi que j'ai toujours traîné, derrière moi, l'image d'un râleur, d'un réfractaire, d'un objecteur, d'un coupeur de cheveux en quatre, bref, d'un emmerdeur, car les humains, au fond, n'aiment pas qu'on interroge les fondements de leurs idées et les moteurs de leurs actes.
Mon approche de la question féministe ne doit donc pas être séparée de la manière dont je ressens intimement la notion de barrière. Mon problème en effet, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, a toujours été, dans tous les domaines, de refuser d'être assigné à résidence d'un côté ou de l'autre des barrières que l'on m'opposait. Sans en avoir pleinement conscience, la plupart du temps. Et si je parle ici de problème, ce n'est pas par hasard, car c'est une position qui est assez inconfortable. C'est ainsi que j'ai toujours traîné, derrière moi, l'image d'un râleur, d'un réfractaire, d'un objecteur, d'un coupeur de cheveux en quatre, bref, d'un emmerdeur, car les humains, au fond, n'aiment pas qu'on interroge les fondements de leurs idées et les moteurs de leurs actes.
13:17 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.04.2014
Stéphane Beau : approfondissement
Tentative d'équilibrisme
 L'intérêt principal d'un blog, à mes yeux, c'est d'offrir un espace où la réflexion peut se développer au fil des jours, un peu comme dans un journal intime, mais avec une certaine obligation de rigueur et de cohérence due à son caractère public. C'est dans cet esprit que je poursuis aujourd'hui mes réflexions sur l'idée de barrière, ébauchée ici.
L'intérêt principal d'un blog, à mes yeux, c'est d'offrir un espace où la réflexion peut se développer au fil des jours, un peu comme dans un journal intime, mais avec une certaine obligation de rigueur et de cohérence due à son caractère public. C'est dans cet esprit que je poursuis aujourd'hui mes réflexions sur l'idée de barrière, ébauchée ici.
La barrière, qu'elle soit réelle ou virtuelle, coupe toujours le monde en deux. C'est là une évidence, je le sais, mais le grand tort des évidences, c'est justement qu'on finit par ne plus les voir. D'où la nécessité d'aller les chatouiller quelque peu, de temps en temps.
Dans notre vie quotidienne, nous nous comportons en général comme si les barrières étaient des réalités indiscutables, immuables, occupant logiquement, presque naturellement, la place qui est la leur. Dans les esprits, prédomine d'ailleurs l'intuition que la coupure pré-existe à la barrière qui ne vient au final que réunir deux parts distinctes, un peu comme la suture vient recoller les deux lèvres d'une coupure. La barrière n'étant pas envisagée alors comme ce qui sépare, mais comme ce qui rattache, comme ce qui permet de maintenir un semblant d'unité et de sens à l'ensemble. Son absence serait synonyme de chaos.
Car la barrière, on l'oublie trop souvent, a pour fonction première d'offrir aux hommes un repère, au même titre qu'un phare ou qu'une balise, et de fixer du même coup des normes qui s'appliquent à tous. En effet, pour qu'une barrière soit agréée par tous comme concrétisant une séparation objective il faut qu'elle repose sur une convention tacite. Tout comme le mètre, le litre, le degré centigrade ou l'hectopascal, la barrière pose un cadre conventionnel qui n'a de sens que si l'on en accepte le principe. Ce qui n'est pas toujours si simple, comme on peut le voir par exemple dans nos relations parfois tendues avec les peuples traditionnellement nomades qui, n'entendant pas la dimension conventionnelle de la barrière, ne comprennent pas ce qu'elle prétend scinder, et considèrent qu'elle n'a pas, symboliquement, plus de valeur normative qu'un arbre ou qu'une colline.
Si on visualise assez aisément les barrières physiques, on est généralement beaucoup moins à l'aise avec toutes les barrières psychologiques, morales ou idéologiques, qui balisent nos pensées et nos actes. Pourtant elles existent et elles fonctionnent de la même manière. Dans le domaine des idées, des valeurs, ou des croyances, aussi, les barrières viennent marquer une coupure entre deux mondes. Et là encore, l'erreur commune consiste à croire que la coupure pré-existe à la barrière ; qu'il existe par exemple un bien et un mal clairement différents, un vrai et un faux nettement distincts et que la barrière, là encore, se contente de concrétiser la ligne de fracture. Sauf que la réalité est beaucoup plus complexe, voire confuse, que cela.
Les barrières, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde psychique, on l'oublie trop souvent, ne symbolisent pas des faits, mais des choix. Leurs emplacements ne doivent jamais rien au hasard. Bien au contraire, l'art de placer - et de déplacer - les barrières a toujours été éminemment stratégique. C'est une guerre de positions. Poser une barrière, ce n'est pas seulement délimiter son propre camp, c'est également définir, par défaut, celui de ses ennemis. Et, dans le champ des idées, cela est loin d'être neutre. Car, en plantant ma barrière, en plus d'affirmer mon droit, j'impose arbitrairement à mon adversaire le cadre dans lequel il devra exercer le sien.
Pourquoi est-ce que je vous explique tout cela ? Parce que mon dernier billet, disant que j'avais le sentiment, sur la question du féminisme, de me situer du mauvais côté de la barrière, ne me satisfaisait pas. Pas plus que ma conclusion laissant supposer qu'un jour les choses s'inverseraient et que je finirais par me retrouver du bon côté (même si du point de vue l’ego c'était une jolie chute qui m'accordait généreusement le bon rôle). En prétendant cela, je restais en effet englué dans le piège tendu par ceux qui ont intérêt à décréter que les barrières sont des réalités intangibles et que l'on n'a pas d'autre option que de choisir le côté derrière lequel on doit se ranger.
La question qui se pose à moi, maintenant, est la suivante : comment peut-on s'affranchir malgré tout de ces barrières, les dépasser, les contourner, les éviter. Nietzsche nous a déjà indiqué une piste : se situer définitivement par-delà le bien et le mal. Il nous a également proposé une posture : celle du danseur de corde qui confie sa destinée aux lois de la pesanteur. D'où l'hypothèse que je pose ici : le meilleur moyen de s'affranchir des barrières n'est-il pas de grimper dessus et de rester en équilibre sur leurs tranches, là où les deux camps se rejoignent et retrouvent leur unité première ? Position délicate, certes, inconfortable car elle attisera incompréhension et haine dans les deux camps.
Position difficile, donc, mais en existe-il une autre possible quand on a la prétention de vouloir être honnête ?
Stéphane Beau
08:29 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écrtiture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.04.2014
Stéphane Beau : un texte témoin
Ce texte me touche particulièrement par sa force de renversement. L’ami Stéphane nous montre en effet comment l’idéologie dogmatique, sectaire, totalitaire, de la gauche bien-pensante - toutes fausses tendances confondues, même jusqu'à ses extrêmes - peut nous acculer à prendre des positions jugées par elle réactionnaires alors qu’elles ne sont que des tentatives pour rétablir le bon sens, l'honnête sens, du réel.
Il a raison, Stéphane, même s'il ne s'en ouvre pas expressément : Zemmour dit moins de conneries et de saloperies que Bernard-Henri Lévy. Une femme du peuple, de droite mais de bon sens, qui se situe naturellement sur un pied d'égalité avec son compagnon, qui n'a nul besoin pour ce faire que des grenouilles-prêtresses suivies des enfants de choeur de la pensée convenable lui servent la messe, qui aime son compagnon, qui aime qu’on la respecte et qui veut aimer l’amour et la vie, énonce moins de dégueulasseries que Vallaud-Belkacem, baptisée à la tambouille PS, version "ambitions démesurées".
Les idéologues de la contre-vérité érigée en humanisme ont détruit tous les repères afin que ses sujets errent désormais sans boussole sur l’océan des infâmes solitudes.
On parle de dérive droitière. J’ai un sourire amer, crispé. La nausée du dégoût : c’est exactement à ce prétexte que Staline fit torturer et fusiller tous les communistes et anarchistes de la première heure !
La pensée socialiste est le dernier stade du pourrissement du stalinisme et l'homme libre se situe par-delà ses discours autorisés. Par-delà aussi les ignominies droitières et les manœuvres répugnantes de la pensée de gauche. L'homme libre est dissident. A l'écart. En-dehors.
Il se doit ainsi d'être fier de toutes les insultes dont le couvre la horde miaulante des salopards !
Le bon côté de la barrière

Ma mise en accusation du dogme féminisme, que ce soit sur ce blog ou dans mon livre sur les Hommes en souffrance a, je le vois bien, posé quelques problèmes même à ceux qui me connaissent et qui me lisent habituellement. Car critiquer le féminisme aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup c'est, sur le plan politique et idéologique, prendre place du mauvais côté de la barrière. Mais comme ces lecteurs-là savent à qui ils ont affaire, ils ont généralement assez bien compris ce que je voulais dire. Par contre, ceux qui ne me connaissent pas ou mal, ont globalement porté sur mon travail des jugements sans appel (et légers en termes d'argumentation, ceci dit en passant...) : « risible », « masculiniste », d'une « bêtise crasse », « réactionnaire », « misogyne »... aucun rachat possible.
Je mentirais en disant que cela ne me touche pas, ne me trouble pas, ne me questionne pas. Car comme le fait très justement remarquer Philippe Ayraud dans la recension qu'il a consacrée à mon livre, je reste persuadé que je porte clairement le cœur à gauche, parfois même très à gauche, depuis toujours. Avec tout le pack psychologique et idéologique – pas toujours conscient – qui va avec : la certitude d'être du « bon » côté de l'histoire, celui des faibles, des opprimés, d’être dans le camp de la justice et du bien général. Bref, d'être un « gentil ».
Et là, brusquement, en m'en prenant au féminisme, considéré par beaucoup comme étant un des plus nobles combats de la gauche contemporaine, je me retrouve non seulement à m'opposer à celles et ceux qui me sont habituellement les plus proches et du même coup à partager certaines convictions avec ceux que j'avais toujours tenus comme étant indubitablement mes adversaires : penseurs de « droite » voire d’extrême droite, cathos, traditionalistes bornés...
Alors forcément, je me suis posé la question – et je me la repose encore régulièrement – suis-je en train de déconner ? Me suis-je trompé de route ? Quelque part, j'aimerais bien, cela simplifierait nettement les choses pour moi. Mais j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, et même si cela m'embête, j'en reviens toujours à la même conclusion : le féminisme, tel qu'il se développe actuellement est une idéologie dangereuse qui ne pourra rien produire de bon sur du long terme. Et aujourd'hui, oui, hélas, face à ce dogmatisme froid, aveugle, fermé au dialogue et aux débats, c'est chez les penseurs « réactionnaires », de droite, hostiles à la gauche, que l'on trouve parfois les réflexions et les critiques les plus intelligentes dans le sens où elles nous invitent à de réels questionnements.
Qui sont les responsables de cet état de fait ? Ceux qui, comme moi, essayent d'y voir clair, de comprendre, ou ceux qui ont transformé le féminisme en en bloc compact, inattaquable, indiscutable ? Dans un article paru dans le n°1 de la nouvelle fournée de l'Idiot international (1er avril 2014), Stéphane Legrand s'en prend par exemple à la « dérive droitière » de Michel Onfray qui a, dans un article de son site internet, dit sa prise de distance avec l'idéologie du genre. Dérive droitière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne suis pas un grand fan d'Onfray dont j'ai déjà pu dire le peu de bien que je pensais à plusieurs reprises. Mais pourquoi parler ici de dérive droitière ? Je reste persuadé que l'on peut être très critique (dans le sens constructif du terme) vis-à-vis de l'idéologie du genre et rester de gauche. Car si dérive il y a, ne peut-on pas l'imputer plus justement à ces gardiens du temple de ce que Jean-Pierre Le Goff nomme assez justement le « Gauchisme culturel » qui, en fermant la porte à tous débats, laisse les clés de l'intelligence à la disposition de leurs adversaires ?
Et parmi ces adversaires, s'il y en a de parfaitement abjects et lamentables, on en trouve aussi de brillants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hélas, c'est chez les « réacs » qu'il faut peut-être aller rechercher ces clés de la résistance au nivellement du monde, des humains et des idées ; chez les râleurs, les énervés, les infréquentables, Nietzsche, Georges Palante, Léon Bloy, Léon Daudet, Barrès, ou, plus proches de nous Cioran, Philippe Murray, Alain de Benoist, Michel Maffesoli... Autant de penseurs qui, même s'ils peuvent parfois emprunter des routes discutables, même si on peut parfois se retrouver en complet désaccord avec eux, ont au moins ce mérite de n'avoir jamais eu peur de mettre les pieds dans le plat et d'appeler un chat un chat.
Il faudra donc que je m'habitue à être un réactionnaire. Cela ne devrait pas me poser trop de problèmes car, après tout, réagir à l'évolution du monde actuel ne me semble pas être criminel. Résister aux surenchères de la société de consommation, aux méfaits du libéralisme économique, à la destruction de l'équilibre écologique, lutter contre la transformation et l'uniformisation des humains modelés pour n'être plus que des consommateurs décérébrés, voilà des combats qui me parlent. Et être de gauche aujourd'hui, être écolo, être hostile au modèle capitaliste, c'est quelque part être réactionnaire justement, c'est espérer que l'humanité donne un petit coup de frein à son évolution et revienne à un peu de bon sens, quitte à revenir sur ses pas dans certains domaines. Être de gauche, c'est affirmer son amour des humains, certes, mais surtout de leurs différences, de leurs cultures, de leurs parcours, de leurs spécificités, de leur intégrité. Être de gauche, c'est regretter qu'aujourd'hui les ouvriers ne soient plus fiers d'être ouvriers, que les agriculteurs ne soient plus fiers d'être agriculteurs, que les femmes ne soient plus fières d'être des femmes, que tous et toutes n'aient plus qu'une seule ambition : ressembler à un modèle unique qui mange pareil, s'habille pareil, pense pareil, fantasme pareil, lit les mêmes livres, voit les mêmes films, achète ses meubles dans les mêmes boutiques... Être de gauche, c'est refuser que les hommes et les femmes ne soient plus que des corps soumis à des normes hygiénistes de plus en plus totalitaires...
Être de gauche aujourd'hui ce n'est plus voter socialiste ; être de gauche c'est accepter d'être réactionnaire, au sens noble du terme. C'est lutter contre tous les mouvements sociétaux dogmatiques susceptibles d’entraîner le monde à sa perte. Et parmi ces mouvements, il y a le féminisme. Aujourd'hui, le critiquer me rejette du mauvais côté de la barrière, comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas définitif, je le pressens. Nous en reparlerons dans cinq, dix ou vingt ans. Les côtés de la barrière s'inverseront forcément et le bon sens retrouvera ses droits.
Stéphane Beau
14:00 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, écriture, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.02.2014
Un texte de Stéphane Beau
Ce que penser veux dire...
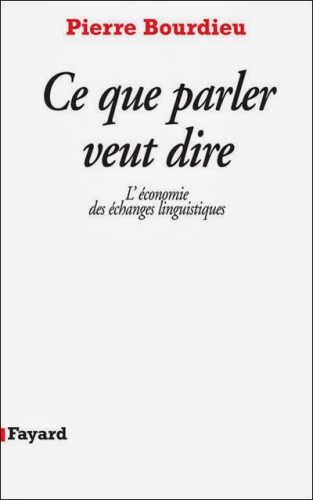
Je relis en ce moment Ce que parler veut dire de Pierre Bourdieu, bouquin que j’avais étudié du temps où j’étais à la fac (ça commence à dater...) et dans lequel j’ai eu envie de me replonger après avoir lu Le Goût des mots de Françoise Héritier – ouvrage qui, sous couvert de déclaration d’amour aux mots, à leur poésie et à leur magie évocatrice, s’applique surtout à resserrer les nœuds et les codes d’une langue élitiste et faussement libre.
Le livre de Bourdieu est intéressant à plusieurs titres. Tout d’abord, parce que du point de vue de la sociologie, il nous rappelle – ce qui n’est jamais inutile – que la langue n’est pas qu’un ustensile commun, partagé égalitairement par tous, mais que c’est avant tout un outil de pouvoir, pouvoir d’autant plus pernicieux qu’il reste la plupart du temps symbolique : « Toute domination symbolique suppose de la part de ceux qui la subissent une forme de complicité qui n'est ni soumission passive à une contrainte extérieure, ni adhésion libre à des valeurs ».
Il revisite par exemple la manière dont le Français, en tant que langue officielle de l’Etat, a commencé par dévaloriser les patois, les dialectes, les langues régionales, en les écartant des organes principaux de la machine sociale : école, justice, emploi, administration, armée... Dans un second temps, une fois que les « parlers locaux » ont été quasi totalement maîtrisés ou remodelés sous des formes folkloriques (comme le Breton, par exemple), le langage officiel a pu s’attaquer aux différentes catégories sociales. Le discrédit ne retombait alors plus sur celui qui ne parlait pas Français, mais sur celui qui le parlait mal ou qui n’en maîtrisait pas bien les codes : l’ouvrier, le paysan, le jeune, l’immigré... Cela permettait aux élites de profiter à la fois d’un système parfaitement égalitaire sur le papier, mais totalement déséquilibré, en termes de pouvoirs, dans les faits.
Et puis le temps a passé et on constate aujourd’hui, que la violence symbolique du langage est en train de connaître une troisième mutation : le pouvoir de la langue repose moins, maintenant sur la qualité de son expression que sur la qualité de son in-expression. Autrement dit, le langage, englué dans les logiques de communication, de management, de propos convenus divise ses utilisateurs en deux camps : ceux qui usent encore des mots pour essayer de dire quelque chose et ceux pour qui les mots ne sont plus que des codes servant à conforter une vérité officielle, une « bien-pensance » formatée et inattaquable.
Ainsi, on a pu voir ces derniers temps, par exemple, une illustration assez nette de cette évolution dans les manifestations des « bonnets rouges » en Bretagne. Il y a un siècle ou deux, ces bonnets rouges auraient été disqualifiés parce qu’ils étaient « Bretons », c’est-à-dire non intégrés au modèle dominant. Il y a une quarantaine d’années, ils auraient été suspects parce qu’ils étaient « populaires », donc pas en mesure de dialoguer et de revendiquer à partir d’un discours élaboré selon les normes en vigueur (qu’on se rappelle des moqueries à l’égard de Georges Marchais ou de Henri Krasucki par exemple). Aujourd’hui, ils sont disqualifiés parce que leurs discours, et leurs actes – qui sont aussi des discours – transgressent un nouveau code qui veut que toute parole qui n’apparaît pas assez mesurée, assez nuancée, assez respectueuse d’une expression polie et policée (les deux termes sont d’ailleurs étonnamment proches) est irrecevable.
De nos jours, donc, le paria, l’inadapté, le malotru, ce n’est plus celui qui fait des fautes de français, c’est celui qui commet des « fautes de pensée ». Cela se constate à tous les niveaux où le « politiquement correct » est devenu la norme et où toute pensée un peu divergente, un peu en décalage avec les canons de la sagesse autorisée, est immédiatement rabaissée et pointée du doigt.
Cela est très net bien sûr, en ce moment, dans tout ce qui touche aux « débats » sur le féminisme, le « masculinisme », l’homoparentalité, le mariage pour tous, le « genre » et autres sujets brûlants qui divisent la société en deux : ceux qui savent, qui ont le savoir, la culture, le vocabulaire adéquat, les positionnements adaptés ; et ceux qui ne comprennent rien, qui n’ont pas lu les bons livres, qui ne réfléchissent pas et qui ne savent que pratiquer la violence, l’invective, l’agression.
La contestation est ainsi devenue ringarde, réactionnaire, malpolie, incorrecte, et tout ce qui peut relever de ses attitudes, de son champ lexical, de ses modalités d'expression peut être pris de haut, avec dédain ou avec moquerie, selon les cas.
Schéma simpliste qui ne reflète en rien le réel qui, de toute manière, ne se découpe jamais aussi simplement en deux partis opposables, mais toujours en une multitude de points de vues et de sensibilités. Mais schéma idéal pour disqualifier d’office toutes celles et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se retrouvent du mauvais côté de la barrière, et pour légitimer ceux qui se trouvent, de par le fait, du bon côté (1).
Et peu importe que les premiers soient parfois moins violents, moins obtus et plus cultivés que les seconds. Le simple fait de tenir des propos qui ne vont pas dans le sens de l’opinion dominante suffit à les disqualifier.
Cette évolution est inquiétante car, si elle n’interdit pas (encore) officiellement l’expression des pensées non conformes aux dogmes en vigueur, elle s’applique toutefois clairement à les rendre inaudibles.
Il y a quelques temps de cela, un ami à moi, Goulven Le Brech, spécialiste du philosophe breton Jules Lequier m’écrivait ceci au sujet de Georges Palante, penseur polémique que je m’efforce de faire connaître au grand public depuis pas mal d’années : « Palante, comme Lequier est devenu folklorique et peu recommandable sur le plan philosophique... ».
« Folklorique »... Sur le coup, le mot m’a semblé amusant mais un peu décalé. Puis en réfléchissant bien, j’ai compris que le terme était rigoureusement adapté. Folklorique, oui, Palante. Tout comme Lequier et plein d’autres, sans doute : Nietzsche probablement, Cioran, ou plus proche de nous Philippe Muray, tous ces auteurs que les médias aiment citer, évoquer, parfois honorer, mais sans jamais souscrire véritablement à ce qu’ils écrivent, en conservant à leur égard une petite moue complaisante, d’un air de dire : « ils tapent fort, mais on ne leur en veut pas : cela participe au spectacle ». Spectacle folklorique, bien entendu, comme les danses bretonnes ou les chants basques.
C’est ainsi. Il faudra bien nous habituer à vivre dans un monde où la libre pensée et l’esprit critique ne seront rien de plus que les vestiges folkloriques d’une intelligence éteinte. Ce monde arrive à grand pas. Il est peut-être même déjà là...
(1) La vraie question étant peut-être de savoir qui pose ces barrières, et surtout à qui elles sont utiles...
Stéphane
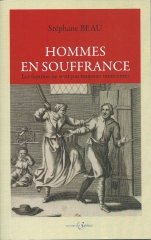
Par ailleurs, vient de paraître aux Editions Les 3 Génies, Hommes en Souffrance de Stéphane Beau.
Dès que je l'aurai lu, je vous en toucherai un mot.
Plusieurs même, tant le propos de cet ouvrage me semble s'attacher à prendre à contre-pied la pensée politique dominante dont nous sommes assommés.
14:05 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.06.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
ROGER
La secrétaire de mairie m’avait appelé un matin pour me demander de l’accompagner. Elle n’osait pas aller te voir toute seule. Tu n’étais pas vraiment méchant, mais tu étais quand même connu pour avoir su jouer des poings, à plusieurs occasions. « C’est qu’il n’est pas fin le Roger », qu’elle pleurnichait, la secrétaire de mairie… Mais le maire avait été formel : « on ne peut pas le laisser comme ça. Un jour, on va le retrouver mort et la commune fera la une de Presse Océan ou de Ouest France… Y a mieux comme publicité… »
Il n’embêtait personne, pourtant, Roger. Il avait 63 ans et il vivait à deux kilomètres du bourg, dans une grange en tôles ondulées qui s’ouvrait sur un bel étang entouré de frênes, de bouleaux et de saules pleureurs. Il créchait entre un vieux tracteur hors d’état de marche et quelques balles de paille. Son lit : un matelas crasseux posé à même le sol de terre. De vieux duvets immondes lui tenaient lieu de couvertures. Dans un coin, une magnifique armoire dénotait vraiment. Et, près de l’entrée, une table recouverte de boites de conserve et de litres de pinard plus ou moins vides. Juste à côté, un énorme bidon/brasero, bourré de braises rougeoyantes, servant en même temps de chauffage et de cuisinière. Il faisait deux ou trois degrés dehors, guère plus dedans. Tu nous avais accueillis en nous envoyant tes deux chiens dans les jambes et notre peur t’avait fait marrer : « Vous en faites pas, ils vont vous laisser rentrer… Par contre pour sortir ce sera une autre histoire ».
Tu nous avais fait comprendre que tu te foutais de notre inquiétude et que le maire « ce grand con-là » ferait mieux de s’occuper de ses fesses… Je constatais soudain qu’il y avait une maison, à quelques mètres seulement de ta grange. « Et avec les voisins, t’avais-je demandé, ça se passe bien ? » « Quels voisins, m’avais-tu répondu ? Elle est à moi cette maison ! » « Et vous n’y habitez pas ? Ce serait plus confortable… » « Nan… Elle a de mauvaises ondes… »
Au moment de te quitter, tu t’étais arrêté devant l’étang et tu avais planté ton regard dans celui de la secrétaire de mairie : « Tu sais que pendant la guerre, y a un motard allemand qui s’est foutu dans cet étang avec son side-car ? Et tu sais pourquoi il a fait ça ? » Silence inquiet de la secrétaire de mairie… « Tu sais pas pourquoi ? » « Non », osa-t-elle balbutier… » Roger avait souri : « P’têt qu’y voulait pas voir ta gueule ! »
Et alors que nous nous éloignions, nous entendions ton rire sonore qui couvrait les aboiements des chiens.
Tu étais un sacré emmerdeur, Roger, mais tu avais du cran.
Je ne t’oublie pas.
11:13 Publié dans Acompte d'auteur, Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.05.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
REMI
Grand, maigre et blond, tu aurais pu être un beau mec, du genre à se balader en 4X4 noir, en costume chic, portable vissé sur l’oreille, style banquier ou agent immobilier. Mais la vie en avait décidé autrement et à même pas quarante ans, voûté, mal rasé et le visage jaune, raviné de cernes et de rides, le chemin qui te séparait de ce modèle – discutable au demeurant – de réussite sociale se calculait en années-lumière.
À 16 ans, déjà, tu ne supportais plus ta vie. Tu avais claqué la porte de chez tes parents pour partir vivre de bric et de broc. Puis tu t’étais engagé dans l’armée d’où tu t’étais fait virer quelques années plus tard, car à cette époque tu n’avais que deux passions : l’alcool et la bagarre. Tu avais ensuite traîné ta gueule cassée de petits boulots en petits boulots, puis des hôpitaux psychiatriques aux cellules des prisons. Tu avais gardé sur tes bras, sous la forme de tatouages plus ou moins inesthétiques, la trace de tous ces périples.
Puis tu t’étais apaisé quelque peu. Façon de parler. Disons que tu t’étais enfermé chez toi et que tu ne sortais plus de cette prison domestique que tu t’étais créée, qu’à de rares occasions, pour faire tes courses. À l’époque où j’ai fait ta connaissance, tu étais déjà cuit. Et tu le savais. Tu souffrais d’une hépatite que tu soignais en descendant une bonne dizaine de litres de vin blanc tous les jours. Tu t’y mettais dès le réveil, coupant l’acidité du vin en le mélangeant avec du Coca-Cola. Tu te marrais quand tu voyais mon regard effaré : « autrement, ça me brûle », m’expliquais-tu, comme si cette explication justifiait quoi que ce soit.
« Autrement ça me brûle… » C’était il y a plus de dix ans de cela… Tu es sans doute mort aujourd’hui…
Je ne t’oublie pas.
07:00 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.05.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
VINCENT
Tu avais un sacré « pet au casque », comme on dit familièrement, mon cher Vincent. Tu étais même parfois sérieusement inquiétant avec tes yeux fous et ton sourire figé. Je me souviens de cette fois où, avec deux infirmiers et un médecin de garde, nous étions venus chez toi pour te faire hospitaliser d’office. Tu voyais des lézards qui couraient sur les murs de ta cuisine. Tu nous les montrais du doigt : « là, mais si, là, regardez, il se sauve ! » Tu hurlais et tu étais tellement persuasif qu’involontairement nous retournions la tête pour regarder où tu nous indiquais. Tu ne voulais pas être hospitalisé car les « aliens » te recherchaient pour te voler le « grand secret français »… Quel cirque dans ton crâne ! Les lézards n’existaient pas, mais ta terreur était bien réelle. Et elle faisait mal.
Je me souviens aussi de cette fois où je devais t’accompagner chez le juge. Tu m’avais fait une scène : tu refusais d’y aller sans ton chien, un brave bâtard au regard doux. J’avais résisté mais tu n’en démordais pas, alors j’avais cédé. Je nous revois entrant dans le bureau du juge, une femme d’une quarantaine d’année, vêtue d’un tailleur gris clair. Elle nous avait toisés d’un œil sévère. Elle t’avait regardé, puis elle avait tourné la tête vers ton chien. Et quand elle avait lu tout l’amour qu’il y avait dans le regard qu’il posait sur toi, elle avait compris, peut-être, que jamais tes frères humains n’auraient à ton égard autant de bonté. Elle avait souri et nous avait invités à nous asseoir.
Tu avais 24 ans et ton avenir, jalonné d’innombrables séjours en psychiatrie, était déjà tout tracé…
Je ne t’oublie pas.
Stéphane
08:41 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.04.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
JONATHAN
Tu avais douze ans. Sylvie, ta mère venait juste de mourir, emportée par l’alcool. Je te revois dans l’église, chétif, vouté, caché derrière tes grosses lunettes de myope. Tu ne pleurais pas. Tu regardais tout autour de toi comme si tu te demandais ce que tu faisais là, comme si tu t’ennuyais. Tu l’aimais pourtant, ta maman. Mais tu avais dû souhaiter sa mort, aussi, quelquefois, lorsqu’elle t’envoyait, avec ton petit vélo, au supermarché, acheter les litres de vin blanc qu’elle s’enfilait ensuite et qui la rendaient mauvaise. Parfois, en revenant, du pinard plein les sacoches, tu croisais des gens de la mairie ou du Secours Catholique et tu sentais bien que le regard qu’ils laissaient tomber sur toi avait le poids d’un couperet, qu’ils te condamnaient tout autant qu’ils condamnaient ta mère. « Pauv’ gosse, c’est-y-pas malheureux… Qu’est-ce qu’il f’ra plus tard ? » Certains, froidement, t’avaient déjà énoncé leur pronostic : « tu finiras comme ton père ! »
Ton père ? Tu ne l’avais quasiment pas connu. Aperçu parfois, seulement, au café. Tu savais juste que l’alcool l’avait emporté, lui aussi, alors qu’il n’avait pas quarante ans. Et malgré toi, tu commençais à te dire qu’ils avaient probablement raison, tous ces cons -là, que c’était sans doute ton destin de finir comme lui… Toi qui, à cette époque n’avait encore jamais bu une seule goutte d’alcool.
La dernière fois que je t’ai vu, tu entamais, aux Orphelins d’Auteuil, un apprentissage pour devenir serveur. Tu aurais voulu t’occuper des chevaux, mais il n’y avait plus de place pour toi.
Je ne t’oublie pas.
08:49 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.04.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
Tous les quinze jours Stéphane Beau me rend visite et me parle des pauvres gens qui ont jalonné sa route. Une façon de leur donner dignité dans la mémoire.
SYLVIE
Tu es peut-être un de mes plus douloureux souvenirs. La souffrance se lisait sur ta trogne. Une tête toute ronde, toute rouge, avec de gros yeux globuleux, jaunes, striés de fines veines. Ta maison s’écroulait de partout, mais elle était à toi : tu l’avais héritée de ta mère. Il aurait fallu faire des travaux, certes, mais avec ton RMI tu avais déjà à peine de quoi manger, alors la charpente…
Ton mari était mort quand tu avais trente ans : l’alcool avait eu raison de lui. Il t’avait légué le souvenir de quelques violents coups de poings, une palanquée de dettes, et un fils que tu aimais. Mais l’alcool t’avait alpaguée, toi aussi. Et ce qui devait arriver arriva : un matin le fiston a été placé dans un foyer de l’enfance et tu es restée seule avec tes bouteilles. Tu ne savais même plus qui tu étais. Syndrome de Korsakoff qu’ils disaient les médecins… Les neurones qui s’éteignaient les uns après les autres, comme des bougies livrées aux vents… Certains jours je te demandais si tu avais des nouvelles de ton fils. Ton visage s’illuminait soudain et tu t’écriais : « bien sûr que j’ai de ses nouvelles, puisqu’il habite ici ! Il va rentrer manger ce midi, après l’école ! » Tu n’avais même pas remarqué qu’il n’était plus là depuis plusieurs mois. Ou si : peut-être préférais-tu faire semblant, pour t'épargner ce surplus de souffrance.
Un beau jour (drôle d’expression car c’était un jour fort triste) ton aide ménagère est venue me voir : en prenant son service, elle t’avait trouvée, allongée sur le carrelage de ton salon. Toute ta vie tu t’étais battue seule, pointée du doigt par tous les braves gens de la commune. Tu avais vécu seule, tu avais élevé ton fils seule… Et tu étais morte seule…
Qui sait ce qu’aurait pu être ta vie si un peu plus d’amour t’avait été offert, lorsqu’il en était encore temps ?
Je ne t’oublie pas.
Stéphane
08:31 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.03.2011
Deux fois par mois, Stéphane Beau sur L'Exil des mots
Bienvenue Stéphane,
Nous avons tous croisé sur notre route incertaine des gens qui, vus sous l’angle trompeur et péremptoire de l’idéologie, ne correspondaient pas exactement à notre profil. Du moins exprimaient-ils complètement différemment leur soif de liberté et leur besoin de rêver. Des gens attachants, un peu fous, fantasques ou timorés, sans prétention.
J’en ai connu des comme ça, dans des bars interlopes où se passaient nos nuits, dans des bas-fonds, dans des endroits d’exclusion forcée, dans des hasards. Dans des fuites en avant.
Il arrive que ces paumés des petits matins reviennent habiter notre mémoire.
Alors, quand j’ai invité Stéphane à venir tous les quinze jours partager avec moi la plume et qu’il m’a proposé ses Humbles à lui, j’ai tout de suite été touché, parce que ces humbles-là, je les ai bien reconnus ! Ils sont universels pour qui a cherché à aimer le monde au-delà de sa surbrillance.
Faut dire aussi que je venais de lire la Semaine des quatre jeudis, le dernier opus de Stéphane. Comme je le supposais grâce à une complicité qui remonte à février 2009 avec les Sept mains, j’ai trouvé dans ses aphorismes et ses textes plus longs, un écho à mes propres quêtes et à mon propre désabusement. Parfois désarroi. Une réflexion commune de soi, au milieu de ce bastringue social à la dérive. Comme là :
Bien sûr que les médias ne disent pas la vérité. Et alors ? Quelle importance ? La vérité : quasiment personne ne serait en mesure de la supporter.
Ou encore :
J‘aurais tant aimé être un artiste maudit ! Hélas, il est plus facile d’être maudit que d’être artiste.

OUVERTURE
Un grand merci, tout d’abord, à Bertrand qui a généreusement proposé de m’ouvrir, tous les quinze jours, les portes de son Exil des mots. Je vais essayer d’être digne de son accueil.
Je vais profiter de cet espace pour rendre hommage à des hommes et des femmes que j’ai croisés et côtoyés, plus ou moins longtemps selon les cas. Ce sont tous des sacrifiés, des brisés, des vaincus de la vie, des exilés, eux-aussi, à leur manière : des victimes de cet exil républicain que l’on nomme « exclusion ». Et pourtant ils étaient tous des êtres exceptionnels, humains, dignes, exemplaires. Des hommes et des femmes qui m’ont beaucoup appris, beaucoup donné. Des hommes et des femmes que j’ai aimés. J’ai su le dire à certains, pas à tous : je le regrette. Le temps est venu pour moi de réparer cet oubli.[1]
JOHNNY
Johnny. Ce n’était pas ton vrai prénom, mais tu l’adorais tellement ce gars-là ! Tu possédais la panoplie complète du fan parfait : les disques, bien sûr, mais aussi le briquet, la boucle de ceinturon, la pendule, la caricature accrochée au mur de ta cuisine, mal dessinée, par un copain sans doute, un soir de beuverie. Et les tee-shirts, bien-sûr, aux couleurs criardes, représentant l’idole transpirante. Tu carburais à la bière à 11° et il fallait choisir son heure pour venir te voir : trop tôt le matin tu dormais encore ; trop tard, tu étais déjà dans le brouillard… Tu avais bien la gueule de l’ex-taulard que tu étais, avec ta grosse moustache, ton crâne rasé et tes traits bleus tatoués au coin des yeux. Au début, tu faisais peur à tout le monde avec ton blouson noir d’un autre temps. Il faut dire que tu aimais ça, jouer les durs. Lorsque tu rencontrais quelqu’un, pour la première fois, c’était systématique, tu alignais vacherie sur vacherie : un vrai festival. Si l’autre se vexait, c’était un con, et tu ne lui adressais plus jamais la parole. S’il avait le culot de te répondre sur le même ton, en soutenant ton regard, un large sourire – où manquaient quelques chicots – éclairait immédiatement ton visage. C’était dans la poche, il pouvait tout te demander.
La dernière fois que je t’ai vu, tu venais enfin de trouver un petit appartement, après des années passées à errer de squat en squat et de foyers sociaux en logements d’urgence. Je me rappelle qu’il y avait un noyer derrière chez toi et que, tous les ans, tu nous amenais un sac plein de noix. Tu grommelais en détournant la tête lorsqu’on te remerciait : pas toujours simple de jouer les durs quand on a le cœur sur la main.
Tu étais un chic type, Johnny, tu sais. Mais qu’ils sont rares ceux qui l’on su ! As-tu réussi à vaincre tes démons ou es-tu retourné partager le quotidien de tes ex - compagnons de trottoir ?
Je ne t’oublie pas.
Stéphane Beau
___________________________________________________________________________
[1] J’ai emprunté le titre de cette chronique à une revue intitulée Les Humbles, publiée dans les années 1920 par Maurice Wullens.
15:26 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET




















