06.02.2012
L'offensive

Dans mes yeux fermés valse une lumière orange peuplée de petites figures, des traits comme des bacilles avec des trous, et qui tournoient… Il fait bon. J’imagine entendre pépier un oiseau. Il faut rentrer très vite, l’air bleu est un glaçon qui vous momifierait sur place !
Le soleil d’ailleurs bascule très vite. Déjà, il effleure les premières cimes…Il a joué son rôle d'illusionniste, il fout le camp dans la nuit... La neige ne scintille plus et le thermomètre dégringole.
Le matin même, j’avais convoqué deux joyeux gaillards pour qu’ils colmatent une légère fissure, par où s’engouffrait un peu d’air. Mais un peu d’air à moins 25, c’est déjà une tempête !
Ils étaient arrivés vers dix heures, mes gars, tranquilles comme Baptiste. Ouf, que je m’étais réjoui, les voilà enfin ! En un quart d’heure l’affaire sera réglée ! Mais les deux joyeux lurons étaient transis…Oui, qu’ils ont dit, pas de pot ! Le chauffage de la voiture est en panne… Aie, aie ! En effet…Faire une quinzaine de kilomètres à moins 28, derrière un volant et sans chauffage, il y a de quoi être pétrifiés! Alors ils se sont installés près du grand poêle et de leur caisse à outils ont d’abord exhibé… deux bières ! Qu’ils ont sirotées, là, peinards, en blaguant…Je me suis demandé combien ils auraient sifflé de canettes si on avait été en juillet avec 35 degrés à l’ombre et j’ai ri : cette désinvolture sympathique avait soudain tout relativisé des conditions climatiques. Ils avaient l’air de s’en soucier comme d’une guigne, de l'hiver, et ils plaisantaient !
C’est leur climat, sévère, sans concessions. Ils portent en eux une latitude du berceau, que je n’ai pas encore acquise…N’empêche qu’ils ont bien fait leur boulot, qu’ils ont bouché le bec à ce petit courant d’air de rien - mais en forme de couteau - qu’ils ont sifflé une deuxième bière, parce qu’ils avaient eu chaud sans doute, et sont repartis, joyeux, sur la neige glacée et dans leur petite voiture sans chauffage.
Quand on habite ces latitudes énervées, l’essentiel est donc de ne pas geler...Un camarade autochtone me disait : « L'hiver polonais, c’est la guerre, Bertrand. Il n’y a pas d’autre issue que de la gagner ! » J’espère bien. J'en ai gagné d'autres. Même si j'en ai perdu bien plus que je n'en ai gagné !
Alors, je n'ai plus fait que ça, faire reculer derrière mes murs les troupes venteuses de l'est sibérien, leur opposer une barricade, les faire fondre au contact de ma maison, les décourager ! Quand l’essentiel réside dans la conservation du confort initial du corps, tout le reste est parfaitement dérisoire.
Je l’ai souvent dit pour l’avoir bien souvent constaté : l’écriture est un amuse-gueule de gens peinards dans leurs bottes -je n’ai pas dit heureux - qui parlent de la vie et du monde quand tout va bien, mais en disant que tout va mal, parce qu’une écriture qui se respecte ne veut jamais se faire l'écho d’un imbécile heureux… C'est comme les chansons, les tristes sont souvent belles, les joyeuses sont le plus souvent culcul la praline.
On n'écrit un vécu extraordinaire que lorsqu’on est de retour dans l’ordinaire. C’est l’art du décalage, l'écriture.
Et c’est pourquoi, aussi, L’Exil des mots s’est tu pendant une semaine.
Il semble cependant qu’avec moins 20 degrés ce matin, l’adversaire en soit à la recherche de son second souffle. Un peu de répit. Mais... Mais, il refait ses forces sans doute, il recharge ses batteries et annonce pour bientôt une nouvelle offensive.
La terre est passionnante, me disais-je ces jours derniers. La terre me passionne. Les petits voyageurs prétentieux qui sont à son bord, englués dans leur modernité misérable, courbent la tête et l’échine devant ses sautes d’humeur. Tant qu’il en sera ainsi, nous garderons en nous quelque chose de profondément humain, d’originel, quelque chose du Grand Pan.
Huit jours, donc, que je n’avais mis les pieds sur internet. Si je puis dire… Je lis alors qu’un imbécile de mes congénères, de mes compatriotes même, un qui pète dans la soie, roule sur un salaire mensuel de plusieurs mille d’euros, déclare que les civilisations ne sont pas toutes égales. Je pense alors qu’on est bien, quand des moins 30 degrés vous ferment les portes d’accès au monde…Dès qu’on les rouvre, ces portes, une odeur de merde, d’égouts et de charogne s’engouffre par une fissure. Une fissure qu’aucun de mes deux joyeux bierophiles ne saurait obstruer.
Je me dis que je m’en fous que les civilisations soient égales ou pas. Je n’en connais qu’une, et encore qu’à grand peine. Comme l’imbécile auteur de cette immondice, d’ailleurs. Ce que je sais, c’est que les hommes ne sont pas égaux devant les rigueurs des latitudes. Ils ne sont pas égaux selon la position qu’ils occupent par rapport à l’inclinaison de la terre. Ils sont plus ou moins pénalisés selon le point où ils sont nés.
J’imagine les Grecs - dont on fait grand cas - ou les Italiens, ou les Portugais, et même les Français, devant dépenser le budget chauffage, entretien et dégagement des routes, des canalisations, des écoles, des lieux publics, secours aux populations, que dépensent chaque hiver les Polonais ! J’imagine mal… Ne leur resterait même plus de quoi se payer un paquet de clopes ! Est-ce que ce truc difforme qu’on appelle l’Europe a pensé à équilibrer ces foutues subventions en fonction des colères climatiques de la terre, devant lesquelles ses contribuables ne sont pas tous logés à la même enseigne ?
Mais il est vrai qu’une Europe qui penserait à autre chose qu’aux marchés et aux ventres replets de ses banquiers, ne serait déjà plus un truc, mais une communauté.
Mieux vaut attendre le dégel, du coup, que d'attendre ce genre d'approches !
Et puisque je suis bavard ce matin, je vous confie que j'ai une pensée attendrie pour mon Zozo, chômeur éperdu qui s’est envolé vers le Québec aujourd’hui, sous les traits du camarade Jean-Jacques Epron…Cela me fait énorme plaisir d’être lu là-bas… De l'autre côté, quasiment, de la Machine ronde.
C'est peut-être ma vanité qui, envers et contre tout, refuse de geler !
12:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.01.2012
L’œil de glace

Disons alors, en ce qui nous concerne, là, que le ciel est bleu. Point. Immense ? Oui, bien sûr immense. Mais vous avez déjà vu un ciel, je suppose, et vous n’avez point besoin qu’on vous écrive, en plus du bleu, qu’il est immense.
Le ciel est donc bleu, en dessous de lui la forêt est sombre et les paysages sont blancs, non pas comme neige, mais de neige. Surtout ne pas dire cette neige comme un linceul… On ferait tout le monde éclater de rire, ce qui n’est quand même pas très courtois quand on parle de linceul… Ne pas dire non plus l’immobilité et le silence et le froid qui cingle… Ils en ont ras la casquette, les gens, de ces images à la noix…
La forêt est sombre et les villages, les champs, les routes, les chemins sont blancs.
Il fait moins vingt, moins vingt deux degrés, et tout ça va dégringoler dans les jours prochains jusqu’à moins trente.
En fait, fi du bleu ! Du niaisement bleu ! Le ciel est un œil, un œil de glace, cruel, vitreux, cyclopéen, posé sur le monde.
L’œil d’un anticyclone qui, d’ordinaire, a ses quartiers sur la Sibérie et qui, là, a décidé de venir faire un petit tour en Pologne de l'est. De s’y installer même. Il irradie de l’air irrespirable, ensoleillé et congelé.
Qui fait presque peur.
12:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.01.2012
Le livre de Marc Villemain
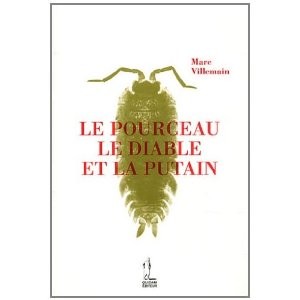 Je ne suis pas - très loin s’en faut - critique littéraire, au sens où je pourrais me permettre de faire une fine analyse et conseiller ou déconseiller tel ou tel livre à un public de lecteurs. Il faut du talent bien spécifique pour ça et surtout beaucoup d’honnêteté intellectuelle. Si je pense être pourvu de cette dernière qualité, ma foi, pas moins qu’une foule de gens parmi lesquels sont aussi ceux qui font profession de la critique, je crois en revanche être dénué de la première.
Je ne suis pas - très loin s’en faut - critique littéraire, au sens où je pourrais me permettre de faire une fine analyse et conseiller ou déconseiller tel ou tel livre à un public de lecteurs. Il faut du talent bien spécifique pour ça et surtout beaucoup d’honnêteté intellectuelle. Si je pense être pourvu de cette dernière qualité, ma foi, pas moins qu’une foule de gens parmi lesquels sont aussi ceux qui font profession de la critique, je crois en revanche être dénué de la première.
Je peux évidemment dire à des amis et à des proches ce qui me plaît dans tel livre et ce qui me déplaît dans tel autre, ou encore trier le bon grain de l’ivraie d'un même ouvrage, tout ça au subjectif intégral.
Ce que tout le monde est en mesure de faire.
Je vous propose ainsi de vous traiter ici en amis en vous livrant une part de ma lecture du dernier opus de Marc Villemain, Le Pourceau, le diable et la putain.
J’entretiens par ailleurs avec cet écrivain des relations fort amicales qui m’autorisent à parler publiquement de ce qu'il fait, d'autant qu'il eut la gentillesse, sur ma demande, de me faire parvenir son livre.
Je l’ai lu avec gourmandise. D’un trait.
Je vous disais hier que je me posais pour moi-même une question qui se mord la queue, à savoir, dans quelle mesure l’écrivain n’est-il pas lui-même écrit ? C’est un défaut récurrent chez moi que de chercher toujours peu ou prou la part investie de l’auteur en personne derrière le verbe du narrateur. Trouver, donc, la clef du traitement littéraire, plutôt que de lire l’ensemble comme un véritable tout, ces deux parts devant fusionner dans l’œuvre réussie, au point d’y être difficilement identifiables.
D’emblée, on ne cherchera donc pas Marc Villemain, sémillant quadragénaire, dans son personnage central, octogénaire grabataire et à l’agonie.
On dévorera dès lors le monologue d’un misanthrope en bout de piste, maculant ses couches de ses incontinences - que l’infirmière Géraldine Bouvier lui change régulièrement avec un sourire écœurant de maternalisme - sous perfusions permanentes, physiquement assez lamentable mais intellectuellement d’une richesse très au-dessus de la moyenne. Un homme d’une finesse exquise même ; un homme qui toute sa vie aura été un misanthrope presque sublime et qui reprend à son compte la formule lapidaire de Chamfort en la prêtant malicieusement à Balzac : «Tout homme qui à quarante ans n’est pas misanthrope n’a jamais aimé les hommes. »
J’ai retenu cette phrase-choc et ce passage, parmi bien d’autres, car j’écrivais il y a quelque temps, à propos du livre de Stéphane Beau, La semaine des quatre jeudis : «La misanthropie naît d un amour excessif des hommes, mais d’un amour déçu. »
Je ne sais pas si Léandre l’octogénaire signerait cette affirmation, mais il me semble qu’il en épouse parfois l’esprit.
Le vieillard cacochyme élève la misanthropie au rang d’un humanisme et c’est d’ailleurs le titre de l’ouvrage qu’il a produit quand il enseignait les lettres à l’université, Le misanthropisme est un humanisme. Facétieuse allusion au pape de l’existentialisme, compromis, lui aussi, tout comme Balzac, par une déclaration d'une dialectique fracassante en faveur de la misanthropie. Ça devrait pas mal grincer des dents du côté des nostalgiques de Saint-Germain-des-prés…Ça devrait aussi tousser un peu, sur un autre sujet et à un autre endroit du livre, du côté de l'épicurisme primaire.
Le récit que l’octogénaire en perdition fait de sa vie et le regard qu’il jette sur sa chambre d’hôpital, sur ses voisins de lit comme sur le personnel infirmier - au centre duquel règne l’incontournable Géraldine - feront découvrir au lecteur que sa position n’est pas une position purement intellectuelle, une position de muscadin en mal d’existentiel, mais une longue, une joyeuse et cohérente disposition de tout son être dans sa confrontation au monde. Un jeu. A quelqu’un qui lui conseilla jadis le suicide, Léandre encore relativement jeune avait rétorqué : Pourquoi diable me suiciderais-je, quand mon bon plaisir tient précisément au spectacle de réjouissante bêtise que vous me procurez ?
Le Pourceau, le diable et la putain, en dépit de l’allégresse intérieure du moribond, est un livre noir, servi par un style qui m’a surpris et que je rapprocherais volontiers de celui dont usait avec brio un certain Henri Calet. Style pur chauffé au feu de l’ironie, parfois du sarcasme. Style distancié, un peu gouailleur aussi, mais style qui coule et vous emmène dans les méandres de Léandre avec beaucoup de tact. Un style en parfaite adéquation avec l’état d’esprit de l'agonisant.
Le seul bémol que je mettrais serait dans la recherche, en de rares endroits, d'un vocabulaire un brin précieux, qui accroche la lecture un peu comme quand on joue une note ou deux hors gamme, pour enrichir un phrasé mais en détournant un court instant l'auditeur de son écoute. Mais il est vrai aussi que c’est Léandre qui parle, qui pense plutôt, et que, tout misanthrope qu’il soit, il est aussi un homme éminemment cultivé.
En tout état de cause, je vous souhaite à tous la lecture de ce livre et, ce faisant, d’en retirer le plaisir que j’y pris.
Quand je dis plaisir, je ne parle pas de plaisir de distraction volé entre la poire et le fromage…Je parle du plaisir à faire un pas de plus sur le terrain de la littérature.
14:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.01.2012
Une légende du Poitou : La louve blanche
Ce qui m'intrigue dans cette légende, censée être du Poitou, c'est qu'elle est la réplique d'un fait divers réellement survenu à Riom, où Arline de Barioux fut jugée et brûlée en place publique le 12 juillet 1588.
Alors qui, du fait divers ou de la légende, a donné naissance à l'autre ? Mystère et boule de gomme, même si Riom se situe à la fin du XVIe siècle et que la légende prend pour cadre historique la fin du XIIe.

En l’an de grâce 1192, par une belle matinée du mois de mai, Géraud de Toufou, seigneur du comté, s’en revenant enfin de croisade après cinq longues années d’absence, reçut un accueil triomphal de tous ses vassaux et de tout le peuple des lieux, hommes, femmes, jeunes gens, enfants et vieillards rassemblés sous les murs de son château, le long des prairies qui descendent en ondulant de la colline jusqu’à la rivière.
Ce fut d’abord un long cortège de chariots et de tombereaux tirés par de splendides bœufs rouges et regorgeant des trésors les plus divers, meubles d‘ébène, diamants, bijoux, émeraudes, ivoires, tapisseries, victuailles, parfums et fines épices d’Orient, armes et fanions pris à l’ennemi, avant que le jeune seigneur, la peau hâlée par les vents du désert, ne ferme la marche, le port majestueux sur son destrier à la robe pommelée, impeccablement harnaché, tel qu’au combat.
Il portait son armure complète, sans le heaume cependant, et de sa main lourdement gantée de fer saluait la foule qui l’acclamait, tombait à genoux, se signait et jetait sur son passage des bouquets échevelés de fleurs multicolores.
Géraud de Toufou, svelte, puissant, beau comme une statue antique, n’eut pas même un regard pour toutes les pucelles du Comté venues sur les prairies, se pressant aux premiers rangs dans l’espoir que son choix de prendre épouse se portât sur l’une d’entre elles.
C’est que juste devant lui cheminait avec élégance un chariot sur lequel une tente de soie blanche avait été dressée et que le jeune seigneur ne quittait pas des yeux. Des hommes noirs, gigantesques, aux muscles luisants, escortaient ce chariot. Arrivé à la poterne du château, Géraud de Toufou fit un geste impératif en leur direction. L’étoffe de soie fut alors déchirée et la foule retint soudain son souffle : une jeune princesse volée à son père, héritier des rois de Thèbes, noire de peau, une lourde et sombre chevelure aux reflets bleutés qui lui retombait sur les épaules telles des houppelandes, d’immenses yeux couleur des ténèbres et qui semblaient lancer des flammes furibondes, était assise sur un trône incrusté d’or et de diamants étincelants comme les astres du firmament. La jeune femme était d’une beauté saisissante, farouche, inaccessible, sauvage. A son annulaire gauche brillait l’anneau que les épouses des Comtes de Poitiers se transmettent depuis Clovis.
La foule mit le genou à terre, se signa encore et laissa échapper un long murmure d’admiration.
Et la vie reprit bientôt son cours au château de Toufou. Tous les soirs y étaient donnés des bals, des fêtes grandioses et des ripailles sans nom. Des tournois et des joutes nautiques étaient organisés sur la Vienne. Des tonneaux de vin et de cidre étaient chaque nuit mis en perce et jusqu’au petit matin, le Comte de Toufou dansait et tournoyait au bras de sa resplendissante épouse, sous les yeux d’une cour subjuguée. Des quatre horizons du royaume, jeunes princes et seigneurs accouraient pour voir flamboyer cette délicieuse étoile noire, venue des lointaines contrées d’Orient. Ils s’en revenaient dans leurs terres avec leurs blondes et grasses épouses aux bras laiteux et se surprenaient alors à appeler de leurs vœux une nouvelle croisade.
Entouré de ses fidèles chevaliers, le Comte Géraud de Toufou s’adonnait également à la chasse dans les grands bois alentour du château. Chaque soir, il déposait aux pieds de sa bien-aimée ses trophées encore tout chauds, cerfs, chevreuils, sangliers ou goupils. Elle recevait les offrandes avec bonheur, assise sur son grand trône d’ébène, entourée de ses demoiselles et en riant de tout l’éclat de ses dents éblouissantes.
Plus d’une année s’écoula ainsi dans l’effervescence des fêtes et des joies et le Comte était chaque jour plus amoureux de sa princesse. Un seul souci cependant venait parfois rider son large front : elle n’attendait toujours pas d’enfant en dépit des ébats passionnés dont il l’honorait.
C’est alors qu’au beau milieu de toute cette insouciance tapageuse, survint l’alarmante nouvelle de la prise de Vouillé par les Wisigoths. On était à l’automne de l’an de grâce 1193. Le Duc de Poitiers envoya des messagers et donna l’ordre à tous ses vassaux de marcher au combat. Le Comte de Toufou leva donc une armée et par un matin bleu du mois de septembre, embrassa tendrement son épouse, salua ses gens et s’en fut porter ses armes contre les envahisseurs barbares.
Commença alors un hiver des plus terribles que la région n’ait depuis longtemps eut à subir. Dès novembre, les blizzards soufflèrent des jours et des jours sans jamais perdre haleine, le gel pétrifia les campagnes endormies et la neige vient tout ensevelir de sa lourde pelisse, qui durcissait aussitôt sous la morsure du froid.
Se languissant de son amant, la belle princesse cessa tout à coup de prendre les repas qu’on lui servait. Elle ne mangea plus. Pour se distraire, elle se mit alors à parcourir tout le désert gelé des campagnes, sur sa jument d’Arabie lancée au grand galop, traversant les plaines, sautant les ruisseaux de glace et dévalant les collines. Elle chevauchait inlassablement, les cheveux au vent et les éperons déchirants les flancs de sa monture. Aucun garde, aucun domestique ne parvenait à la suivre tant elle filait à toute allure, semant son escorte pour disparaître bientôt dans l’épaisseur des grands bois et des fourrés.
Elle revenait au crépuscule, gaie, rieuse, ses grands yeux noirs allumés d’éclats radieux et sa jument dégoulinante de sueur, en dépit du froid qui ne cessait de sévir.
On s’alarma bientôt de la voir ainsi chaque jour passer le pont levis car une autre nouvelle, terrifiante, arriva : des bandes de grands loups gris attaquaient paysans, colporteurs, voyageurs, bûcherons, cavaliers, enfants, et venaient jusque dans les granges et les écuries égorger le bétail. Ils étaient conduits par une splendide louve blanche qui galopait à leur tête, les dirigeait et désignait les proies. C’était elle, disait-on, qui déchiquetait et dévorait tout ce que la meute encerclait et égorgeait. C’était elle qui menait la curée avec une cruauté démoniaque.
L’effroi gagna tout le comté. Des femmes et surtout des enfants furent affreusement mutilés et abandonnés sur la neige, à moitié dévorés, les entrailles béantes. De nombreux paysans avaient trouvé refuge sous les murs du château. On ne dormait plus. Pour effrayer et tenir à distance la meute diabolique on allumait la nuit de grands feux qui crépitaient et lançaient jusqu’aux étoiles glacées des étincelles rougeoyantes.
Et quand le comte Géraud de Toufou s’en revint sur ses terres, en février, il trouva tous ses gens en proie à une folle terreur, ainsi que tous les vilains et manants de la contrée. Il retrouva aussi son épouse adorée dans tout l’éclat de sa beauté, resplendissante de vie et de santé. Ce qui ne manqua pas de le remplir de joie et de bonheur, car il s’était imaginé la retrouver malade et cruellement amaigrie, tant les messagers qu’on lui avait envoyés du château l’avaient à chaque fois informé que la délicieuse princesse observait un long jeûne de tristesse depuis son départ.
Après qu’on lui eut fait le récit des terribles ravages des grands loups gris conduits par une louve blanche féroce, il donna une fête et un bal, tournoya toute la nuit, s’enivrant du parfum délicieux de son épouse et des vins les plus exquis, avant de jurer au petit matin qu’il partirait lui-même à la recherche de cette louve redoutable et qu’il déposerait bientôt sa dépouille au pied de sa princesse. Ce n’est pas une vulgaire louve, fût-elle blanche et terrifiante, qui fera affront à un chevalier ayant vaincu les Cheiks Sarrazins et les rois Wisigoths, tonna-t-il !
A partir de ce jour, le Comte Géraud de Toufou sillonna sans relâche toute la région, les ravins gelés, les fourrés et les grand bois, à la recherche de la meute et de sa louve. Maintes fois, il surprit les bêtes féroces et vit à leur tête leur formidable guide, haute, souple, puissante, les crocs acérés et la rage écumant de ses babines retroussées. Chaque fois cependant, elle déjoua ses pièges et prit l’avantage sur lui dans la poursuite. Le Comte revenait tous les soirs au château, fourbu, de fort méchante humeur et traînant derrière lui les dépouilles ensanglantés des loups abattus, mais jamais celle de la louve blanche, promise à son épouse.
Le Comte en était ulcéré et dès l’aube repartait de plus belle, la rage au ventre…Enfin, dans les tout premiers jours du mois de mars, alors que le soleil déjà plus haut sur le ciel amorçait le dégel, que des gouttelettes d’eau commençaient à pendre aux branches des arbres comme des pleurs, il débusqua la grande louve et ses loups gris, au creux d’un profond ravin. Les fauves étaient en train d’ouvrir sauvagement le ventre d’un bûcheron qu’ils avaient surpris aux aurores et leurs gueules ruisselaient du sang du malheureux.
Le Comte, hurlant de colère et de haine, se lança à la poursuite de la meute, pointant son redoutable épieu sur la louve blanche. Il réussit ainsi à l’isoler de ses loups et, vociférant toujours, il parvint même à l’acculer au fond du ravin. Là, il descendit promptement de cheval et courut sur la bête. La louve lui fit résolument face, se jeta sur lui, cherchant à ouvrir la gorge, et il eut le temps, dans un geste de survie, de faire tournoyer sa hache dans l’air et de la rabattre, coupant tout net une patte avant de l’animal.
La louve poussa un long, un très long cri de douleur, sauvage, horrible, qu’amplifia encore l’écho des parois rocheuses du ravin. D’un bond prodigieux, elle réussit cependant à contourner son adversaire et à regagner, toujours rapide malgré sa patte atrophiée d’où pendaient des lambeaux de chair meurtrie, l’autre bout du ravin, où elle disparut dans l’épaisseur des halliers.
Mais le Comte ne la suivit même pas des yeux, épouvanté. Il avait reconnu ce cri, cette voix enflammée par la haine et la douleur et quand il se pencha pour ramasser la patte de l’animal, il vit une main de femme qui gisait là sur la neige ; une main avec, à l’annulaire gauche, la bague aux armes de Clovis.
En proie à une terreur démentielle, Géraud de Toufou fonça vers le château, hurla qu’on ouvrît les portes, sauta de son cheval encore lancé au grand galop, s’engouffra dans les escaliers du donjon, monta en courant jusqu’à la chambre de son épouse et défonça la porte...
La princesse aux longs cheveux noirs était couchée sur ses oreillers et son bras gauche, amputée de sa main, pendait lamentablement dans le vide, dégoulinant de sang.
Le Comte brandit très haut son épée et, avant qu’il ne lui plonge dans le cœur en poussant un hurlement monstrueux, il entendit la Princesse murmurer :
- Oui, Tue ! Tue-moi ! La vie n’a plus aucun parfum pour moi si je ne puis plus courir la campagne à la tête de mes grands loups gris !
Lorsque les gens du château accoururent, effrayés par les cris du Comte, ils trouvèrent, étendu sur la couche ensanglantée de la Princesse, le cadavre de la grande louve blanche.
Géraud de Toufou interdit sous peine de mort qu’on parlât désormais de sa princesse. Il fit fermer les portes du château, ne reçut plus aucune visite, cessa de complètement s’alimenter, congédia enfin tous ses domestiques, tous ses gardes et tous ses soldats et mourut quelques mois plus tard, terrassé par la folie, la solitude et le chagrin.
13:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.01.2012
Donne-moi plutôt ta main...
En janvier 2010, la température chuta jusqu'à - 33 degrés. Dans ma maison, toutes les tuyauteries avaient sauté. Nous nous étions repliés à l'hôtel, où j'étais, comble de malchance, tombé malade. La fièvre.

Son geste est las et mécanique. Sa cotte de travail verte est foncée. Son bonnet de laine est saupoudré de blanc, ses sourcils ombrageux, ses yeux sombres, les yeux du travailleur des petits matins.
C'est l'heure de ma première clope. L'heure de dire bonjour au ciel.
De translucide, aigu, inexistant qu'il était presque sous moins trente degrés, il est devenu épais sous moins vingt degrés et la neige tombe, tombe, en plumes glacées sur la ville.
Les fumées de charbon se mêlent aux flocons, le blanc contre le noir.
L'homme balaie pour que les messieurs-dames de l'hôtel puissent sortir bientôt sans risquer de glisser et sans trop maculer leurs belles chaussures.
Je le salue.
Il me salue aussi. Mais de loin, sans sourire, sans civilité excessive inscrite sur son visage. Distant.
Je regarde son geste las et mécanique. Je secoue la tête. J'écrase ma cigarette.
Je suis un de ces messieurs pour lesquels il balaie dans le froid gris d'un matin gris d'un hiver des plus gris et des plus redoutables.
Il y a entre cet homme et moi une zone profonde, un no man's land, un océan de préjugés bien plus infranchissable que la langue et ses sonorités contraires.
Une fausse zone, comme toutes les zones qui séparent le regard des hommes.
Ces zones-là sont des alibis pour les feignants du cœur et les menteurs de partout.
Car lui, le balayeur à la cotte verte, le balayeur taciturne, il a dormi chez lui, dans son lit. Ce matin il a fait le feu, il a regardé les flammes danser et il a entendu se fendre le bois sous la chaleur épaisse. Il a bu un café fumant et dégusté des toasts grillés. Sa confiture, rouge, pourpre, sentait bon les fruits de son jardin enfui...
Moi, je suis échoué ici, comme une algue marine sur l'ocre des plages. Réfugié. J'ai quitté mon navire assiégé par des couteaux glacés.
Je regarde le ciel qui se déplume.
Le mauvais sort n'est pas du côté que donnent les apparences sociales, tant les hommes aux hommes sont devenus étrangers .
J'ai souri à celui qui balayait les marches de l'hôtel.
J'eusse aimé lui dire que pour moi, ça n'était pas la peine. Que j'avais déjà glissé et que la neige sur les marches, les culbutes et les chutes, ne me faisaient plus peur depuis longtemps.
Que son geste las et mécanique n'était pas pour moi.
Dans le hall de l'hôtel, j'ai regardé tout un moment une grande et vieille image sous verre, qui trônait là sur le mur. L'équipe de foot polonaise, médaille d'argent de la coupe du monde 1974.
Je me suis demandé ce que je faisais en 1974 et j'ai vu que j'avais alors les mêmes espoirs qu'aujourd'hui. Que les hommes se serrent fraternellement les mains.
Il n'y a pas d'âge pour être idiot. Les utopies ont la peau dure.
Et, lui, le balayeur pour pas que je glisse, moi, un monsieur qui sommeille dans les hôtels, qu'est-ce qu'il faisait, en 1974 ?
Où en est-il de ses espoirs et de ses défaites ?
Il neige sur les fumées du charbon... Le blanc contre le noir...
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.01.2012
Les fourches caudines de nos existences - Echo à Stéphane Beau -
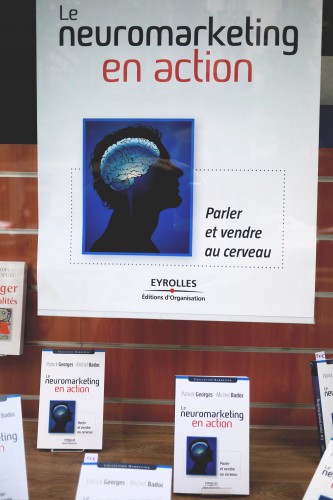
Stéphane :
"Je travaille tous les jours avec des hommes et des femmes qui vivent avec trois fois rien. Un couple et un enfant avec 700 € par mois, par exemple. Quasi rien pour bouffer sans l'aide des restos du cœur ou des colis alimentaires, une fois toutes les charges déduites. Et pourtant, ces familles là dépensent assez régulièrement entre 80 et 100 € de téléphonie (internet, deux ou trois portables...) par mois. Parfois même ils payent encore des forfaits pour des téléphones qu'ils ne possèdent plus depuis plusieurs mois. J'en rencontre même de plus en plus souvent qui ne peuvent plus payer leurs factures d'eau ou d'électricité tant ils dépensent dans ce poste budgétaire. Je ne critique pas : ils sont pris dans un système qu'ils ne contrôlent pas plus que nous, prisonniers comme nous de cette illusion de communication libre qui nous enveloppe tous. Mais si on leur disait demain : "au lieu de dépenser tant de fric dans ces dépenses virtuelles, pourquoi ne le dépenseriez vous pas en achetant une demi-douzaine de livres ou de disques par mois", ils crieraient tous au fou ! Au gaspillage !
Quand je dis que tout cela n'est pas gratuit, c'est aussi à eux que je pense. Et quand je lis ta citation joliment revisitée de Debord, c'est encore à eux que je songe et à qui profite le crime de cette soumission totale aux dieux de l'internet et de la téléphonie.
Quand je vois qu'aujourd'hui la campagne électorale des prochaines présidentielles se joue pour une part sur Twitter et pour l'autre part sur les ordinateurs qui gèrent le cours des bourses je me dis que j'ai peut-être un début de réponse..."
Mézigue
"Ton témoignage-commentaire m’est cher. Pour beaucoup de choses.
D’abord parce que je connais tes convictions et qu'elles sont, si je puis ainsi dire en péchant par raccourci, en adéquation avec ton salariat.
Car parler de la misère sans ne l’avoir jamais vu pointer le bout de son nez à sa propre fenêtre, c’est un peu comme parler de la merde sans jamais n’en avoir respiré l’odeur, avoir peur du loup en sachant bien que nos jarrets ne seront plus jamais à la portée de leurs crocs. Dans cet esprit-là, je me demande souvent, très souvent, d’où parlent tous ces gens qui écrivent de-ci de-là, quand je lis les témoignages et les révoltes par le verbe et les prises de positions critiques, pour sympathiques que tout cela puisse paraître.
Tu dis ces pauvres hères perdus dans la forêt des consommations insensées et tu dis leur désarroi à ne plus retrouver le chemin vers eux-mêmes et vers les autres. Vers la priorité humaine. Le drame de ce début de siècle, et de la fin du précédent, est là.
Là seulement.
La victoire de l’apparence sur l’essentiel est absolument totale et si j’ai cité Debord, c’est que le propos de La Société du spectacle (Buchet/Chastel 1967) n’était autre, pas plus que n’était autre le propos du Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations (Gallimard 1967) de Vaneigem.
Mais pour méritoires qu'aient été ces deux livres, pour grande qu'ait été leur intelligence à démontrer au monde la véritable identité du monde, cela n’a servi strictement à rien.
De Vaneigem, je citerai une phrase phare : Refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de crever d’ennui. Il s’agissait donc de la critique de la misère intellectuelle, morale et sexuelle, misère de plus en plus prégnante au fur et à mesure que la richesse matérielle - l’absence de pauvreté miséreuse plutôt - se «démocratisait», en rupture avec les misères du XIXe et de la première moitié du XXe.
Les choses sont allées depuis de pire en pire, la dictature du spectacle - entendu comme la colonisation de tous les aspects quotidiens de la vie par les apparences et l’image - a peaufiné son assise au point que misère intellectuelle et misère matérielle n’en ont bientôt plus fait qu’une, MAIS, ceci sans abandonner, et même en la renforçant, l’illusion de pouvoir se procurer les biens les plus sophistiqués de la société marchande, parmi lesquels internet, téléphone portable multifonctionnel, télé multichaînes etc…
Du pouvoir d’achat ou de l’achat d’un peu de pouvoir ? Telle est la question que Capital et Finances ont posé à la chaumière, laquelle chaumière a consenti à se vider de sa substance historique et humaine pour goûter aux friandises du grand râtelier. Elle s’y est goinfrée sans retenue et jusqu'à l'empoisonnement. C'est bien fait ! C'est là le lot de tous ceux qui vendent leur âme au diable.
Vaneigem devrait donc reformuler aujourd’hui : Refuser un monde où la certitude de ne pas crever tout à fait de faim, s’échange contre la promesse de se procurer les instruments nécessaires à l’illusion de ne pas crever d’ennui.
Parce qu'il n'y a chez les hommes que deux motivations pour qu'ils se mettent en devoir d'étrangler les puissants et pour qu'ils se décident à brûler les châteaux : la faim et l'ennui. Avec deux miettes de pain pour l'estomac et des amuse-gueule pour contourner l'ennui, le tour est joué ! Les puissants peuvent dîner au champagne et sauter toutes les putes de la terre, tranquilles.
Je dirai alors que tous ces dits instruments de communication sont arrivés comme les chiens de garde chargés d’entraver les hommes, s’il leur prenait tout à coup fantaisie de rétablir entre eux une véritable communication. C’est par la réification de la communication que le système a asservi les citoyens à sa cause et nous sommes, comme les gens que tu cites, partie prenante dans cette réification. Nous avons abandonné la priorité de communiquer, laquelle n’est pas aisée car mettant en scène et en péril, pour pris de la véritable joie, tout le substantifique humain. Nous avons abandonné tout ça pour l’illusion de la communication tenant lieu de véritable communication. Une communication qui ne mange pas de tripes mais se nourrit de bavardages inoffensifs, d'indignation superficielle, quelles que soient les dents que "font montre de montrer" ces bavardages.
Résultat : hommes séparés d’eux-mêmes, séparés de la condition humaine et marchandises au top niveau… Ah, faites-nous encore rigoler, chiens puissants des organigrammes sociaux, misérables politiques et syndicalistes à la ramasse avec votre crise ! La crise, Stéphane, c’est comme si tu avais un voisin ennemi, une ordure finie, qu’il y aurait le feu chez lui et qu’il te demanderait de te jeter dans les flammes pour sauver son or. Si le populo pouvait comprendre que ça n’est pas là son affaire et qu’il serait bien mieux inspiré d’achever la bête, de lui plonger la tête sous l’eau jusqu'à ce que mort s'ensuive plutôt que de négocier sa survie, on aurait une chance de revoir briller le soleil. Mais ce n’est pas demain la veille ! En tout cas, si une telle prise de conscience venait enfin à bouleverser le monde, nous serions toi et moi - et bien que tu aies la chance d’être nettement plus jeune, (disons moins vieux) que moi - crevés depuis longtemps. Alors…
J’ai, comme toi, connu des gens capables de balancer tout leur RMI dans des billets de loto. J’ai connu, voire aimé, des voyous capables de risquer cinq ans de taule, pour détourner des trucs inutiles, farfelus, n’ayant d’autre utilité qu’un ridicule message social d’intégration au grand bazar. J’ai moi-même, à une époque où je ne vivais que d’expédients et d’autres choses, été capable de tout balancer dans le pinard et l’ivresse plutôt que de chercher à me refaire «une santé sociale». Plus tu es pauvre, Stéphane, plus tu es acheteur d’illusions. Normal. Plus tu es pauvre, plus tu as besoin de téléphone portable, d’internet, de télé, parce que plus tu es pauvre, plus tu es seul, plus, donc, tu as besoin des instruments qui mettent socialement en place l’illusion de ne pas l’être.
Et plus tu es nul, plus tu es incapable de faire une œuvre conséquente, puissante, originale, révolutionnaire, de sang et de chair, qui arracherait les tripes par sa beauté, mettrait en pleine lumière la désastreuse nudité du monde en même temps que l’immense potentiel humain retenu prisonnier - c’est grave pour nous tous ce que je dis là, mais tant pis ! - plus tu as besoin d’écrire en public, de dire, de rabâcher, de faire voir que tu es sensible, de niaiser, de faire le beau, d'émettre des vérités à quatre sous, de faire celui qui comprend, qui, qui et qui.
Bref, moins tu es homme, plus tu as besoin d’être bouffon !
Cette nullité scribouillarde qu‘on voit s’étaler partout sur les blogs et les sites, même sur ceux qui se croient très intelligents et peut-être même sur ceux-là d'abord, ces poèmes à la mords-moi l'noeud, ces pages d'une littérature contemporaine qui n'a de contemporain que ses propres efforts à ne pas se montrer archaïque, c’est simplement l’humanité qu’on nous a volée en nous "vendant gratuitement" un champ d’expression afin que se tue, chaque jour un peu plus, l’expression elle-même.
Tout comme on a volé la dignité de vivre à ces pauvres hères désemparés que tu vois tous les jours, sorte de Lumpen sacrifié aux intérêts sordides d'un monde qui, du point de vue de la richesse humaine, ne vaut pas l'allumette qui le réduirait en cendres.
Bien à Toi. "
Image : Philip Seelen
14:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.01.2012
Pour compléter le texte précédent
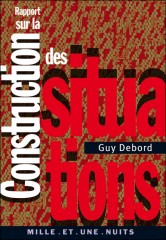
Guy Debord écrivait dans son Rapport sur la construction des situations :
" Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises."
Et moué je dis tout bonnement :
"Les hommes restés un tant soit peu intelligents, quand une structure de la société marchande leur offre des services gratuits, devraient d'abord se demander ce qu'on attend d'eux."
14:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Les filles de joie du verbe

Dans ces milliers de frémissements - auxquels je participe - d'insectes nerveux pris au piège, on entend toutes les musiques, tous les genres et toutes les générations. Des misères quotidiennes, des poissons rouges, des alouettes, des mères au foyer, des vieillards, de jeunes pubères, des imbéciles en mal de philosophie, des élucubrations, des fantasmes, des textes qui veulent être de la littérature, des frustrations, des érudits de la critique, des champions de la subversion, des partisans du système coercitif et financier, des pauètes…
On ne peut décemment tout identifier. C’est le grand bazar, la foire, le zouk, la planète au verbe multiple, entremêlé ! Le champ d’expression libre et c’est...gratuit !
Gratuit ! C’est en cela que réside le génie de l’idée ! On écrit gratuitement, on est publié dans les vingt secondes et, en plus, tout le monde lit gratuitement, publie son avis, se met en colère, critique, cite, congratule, renvoie à et etc. La révolution achevée…
Viva l’anarchia !
Sauf que, quand même, on est en droit de s’étonner que dans un monde de merde pataugeant dans la dictature économique et financière, dans un monde où les âmes et les sensibilités en sont réduites à ne plus guère réagir qu'aux cliquetis des tiroirs-caisses, on trouve, comme ça, des oasis rafraîchissantes, à l’abri de toute aliénation marchande.
On voit alors, si on se pose une ou deux questions, que les blogs ne sont que les putains abusées, inconscientes, d’un système bien en place.
Bon. Pourquoi pas ? Il n’y a pas de sot métier, il n’est que de sottes gens ! Mais alors, déclinons notre identité véritable, ne faisons pas, lecteurs comme blogueurs, croire au mensonge que nous entretenons…Cessons de faire, par notre parole lustrée, les beaux ! Modestie, modestie, profil bas…
La gratuité, je suis pour, absolument pour…Pour tout le monde. Mais…
Voici ce qu’en disait Stéphane Beau dans un commentaire :
« Je crois qu’il y a là encore une illusion d’optique très trompeuse et un partage des richesses très discutable. Car contrairement à ce que tu écris, nos blogs ne sont pas gratuits, ils sont payants. Sauf que les sous ne tombent pas dans nos poches, mais dans celles des fournisseurs d’accès à internet, dans celles des sites d’hébergement, dans celles des fabricants de logiciels, dans celles des fabricants de matériel informatique, dans celles de ces grosses boîtes qui font que, maintenant, plus rien ne fonctionne chez toi (télé, téléphone, internet... à quand l’électricité et le gaz ?) si elles décident de te stopper la fourniture...
Pour accéder (entre autres) à ton blog tous les jours, je dois dépenser (si on fait une moyenne de tous les coûts cités plus haut) 30 ou 40 € par mois... Et ouais... A multiplier par le nombre d’internautes, ça fait combien de milliards ?... Mais qui fait vivre le web sinon ceux qui alimentent les blogs et les sites ? Si demain tous les blogueurs et tous ceux qui ont un site (et qui payent même, parfois, en plus, pour avoir un nom de domaine ou une formule un peu plus fonctionnelle) décident de faire grève et de retirer toutes leurs billes, ils deviendront quoi tous ces fournisseurs d’accès, tous ces fabricants de micro, tous ces magouilleurs de mp3, de ebooks ou de divX ? Tu ne crois pas qu’il y a des droits d’auteurs (et des baffes) qui se perdent, là aussi ?
L’idée de la gratuité d’internet est une grossière et scandaleuse illusion ! »
09:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.01.2012
Adieu camarade !

Nous avions bien ri quand il eut des velléités de se faire installer internet. Avant l’eau courante. Question de priorité dans un monde qui n’en a plus. Monde inconnu des puissants, monde des humbles et qui de leur simplicité, qu'ils ignorent en tant que telle, font littérature. Comme les paysages. Simplicité qui n'est simple que par l'orgueil de notre complexité surperfétatoire. Monde que j’aime, décalé. Sans prétention, que celle d'exister un moment. Monde dont la marche frontalière est en soi une violente diatribe.
Il m’avait raconté les loups. De son enfance. Il parlait comme mon grand-père alors qu'il avait six ans de moins que le petit fils. Sauf que ses loups, à lui, de vrais loups, c’était l’été qu'ils hurlaient. Dans un pays recouvert de neige trois ou quatre mois par an. Il brisait ainsi l’image éternelle que je portais dans ma tête.
Il m’avait beaucoup aidé quand j’avais tout démoli de ma maison et qu’il avait bien fallu reconstruire, ciment au sol, plafond, plancher, cloisons, et tutti quanti. Il m'avait porté du bois aussi, sans que je lui demande, pour que je me chauffe. Mon Auvergnat en Pologne. Main tendue du pauvre.
Après, il s’en était retourné à ses lisières, soigner ses quatre ou cinq cochons et planter ou ensemencer ces trois ou quatre hectares de terre sablonneuse. Il m’avait laissé faire les finitions. Les finitions…Depuis l’été dernier, je le savais, il en était aux siennes. Jest na wykończeniu.
Il neigeait. Il neigeait très fort, une neige oblique et puissante, balayée par les souffles du nord, samedi, quand je l’ai accompagné jusqu’au trou final. L’ouverture du paradis pour lui, les portes d’une absurde métamorphose pour moi.
Il neigeait. Il faisait froid et si triste ! Les gens courbaient l’échine sous l’intempérie et leurs dos accablés, devant moi, se saupoudraient de blanc, la neige accrochée aux poils de leurs lourdes pelisses.
La terre s’est refermée et sur le monticule se sont amassés les flocons. Je fus décontenancé, une nouvelle fois, par la simplicité du terrible rendez-vous qui sous-tend pourtant tous les autres. Leur donne un sens.
La terre n’est qu’une parenthèse entre zéro et zéro.
Adieu camarade ! Et puisque, toi, tu croyais en lui :
Qu'on te conduise à travers ciel,
Au père éternel !
Illustration : mon village, samedi..
12:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.01.2012
Une légende du Poitou
LA FÉE MÉLUSINE
 Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait sa chaumière.
Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait sa chaumière.
Ainsi, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, villages et hameaux, aujourd’hui séparés entre eux par les terres et les routes, étaient-ils reliés, comme partout ailleurs, par les sentiers de la forêt ancestrale. Toute cette province et tous ces grands espaces forestiers appartenaient en ce temps-là au seul Comte de Poitiers, seigneur passionné de chasse et, en même temps, seigneur érudit, gourmand des livres de la science qu’il dévorait en latin ou en grec, et, principalement, ceux qui traitaient de l’astrologie. Il savait, du moins sa cour le prétendait-elle, lire la course des étoiles. Pris d’une affection toute filiale pour son neveu Raymondin, jeune homme vigoureux et d’une superbe tenue, il lui dispensait tous les rudiments de son savoir et, partout, l’emmenait avec lui, quand il lui prenait fantaisie de forcer le cerf, le loup ou le renard dans les vastes forêts de son domaine.
C’est à cette époque que vivait également, aux lisières des futaies, une dame de sang bleu, du nom de Pressine ; une dame redoutée de toute la province et même au-delà, car elle était douée de pouvoirs capables de distribuer autant le bien que le mal. Elle avait trois filles d’une beauté hors du commun, qu’elle élevait seule et auxquelles chaque jour elle répétait:
- Votre père vit loin de nous parce qu’il a trahi sa parole et bafoué les lois sacrées du mariage. Ainsi, mes filles, pour ne pas suivre son déshonorant chemin, faites en sorte que dans votre vie, toujours vous restiez fidèles à la moindre parole que vous aurez donnée.
Ce discours ne manqua pas d’impressionner beaucoup les jeunes filles à la fleur de l’âge, qui fomentèrent bientôt le dessein de se venger de ce père ingrat qui les avait abandonnées pour suivre son plaisir. Elles se rendirent donc chez lui, à une dizaine de lieux de là, se firent introduire sous de fausses apparences et le rouèrent de violents coups de bâtons.
Leur mère entra en un vif courroux quand elles lui racontèrent leur expédition punitive.
- Qu’avez-vous donc fait, malheureuses créatures ? s’écria-t-elle. Suivant les lois immuables du ciel et de la terre, jamais un enfant, au risque d’être maudit pour l’éternité, ne doit porter une main vengeresse sur l’auteur de ses jours !
Et les trois filles subirent aussitôt la malédiction maternelle. L’aînée fut confiée à la garde d’un abominable géant, dans une forteresse humide et sombre des Carpates, la puînée dut couver un œuf d’aigle et toute sa vie durant nourrir l’insatiable aiglon, la benjamine, quant à elle…
Sur ces entrefaites-là, le grand veneur du Comte de Poitiers vint un beau jour avertir son maître qu’un redoutable sanglier, un vieux mâle épais, aux cruelles défenses, imposait sa loi parmi ses congénères et y semait la terreur. Le Comte de Poitiers fit donc sonner le rassemblement et, entouré de sa cour et de ses chevaliers en armes, se déplaça jusqu’à Coulombiers. Bientôt les piqueurs et les chiens débusquèrent en effet le vieux solitaire de sa bauge et les chasseurs, le Comte et son neveu en tête, donnèrent la charge à grands cris. Mais la bête était si violente qu’elle éventra bientôt les chiens, évita les pieux et finit par disparaître à vive allure dans les halliers profonds de la forêt.
- Ce n’est tout de même pas un fils de truie qui va ainsi nous tenir la dragée haute ! s’écria le Comte, hors de lui et en s’élançant à la poursuite de l’animal sauvage.
Le train était cependant si vif que seul parvint à le suivre son neveu, tandis que tous les autres chasseurs se trouvaient distancés, empêtrés dans les fourrés épais et les breuils. Les deux hommes pourchassèrent ainsi le sanglier tout le jour, le repérant ici, le harcelant là, tentant de l’acculer plus loin, mais rien n’y fit. Les chevaux écumaient, étaient fourbus et la nuit tombait, quand ils se résolurent à mettre pied à terre et à bivouaquer autour d’un grand feu de bois mort. Ils étaient au plus profond de la forêt, sans même savoir où exactement. Le comte se retira donc dans les sous-bois, hors du halo de lumière que faisaient danser autour d’eux les flammes, pour se repérer aux étoiles du firmament.
Il revint bientôt, l’air accablé, tant que son neveu s’en alarma.
- Mon, oncle qu’avez-vous ? Sommes-nous donc à ce point égarés que vous ayez si triste mine ?
- Non, mon neveu, nous ne sommes pas perdus, nous avons seulement beaucoup bifurqué vers le nord-ouest, mais j’ai lu dans les astres scintillants, une bien étrange chose. Il est écrit là-haut que celui qui tuera bientôt son Seigneur aura un destin hors du commun, parsemé de gloire et de richesses.
- Oh, mon oncle, l’homme capable d’accomplir un tel forfait ne mériterait rien d’autre que l’enfer et la damnation éternelle !
Mais comme ils étaient là à palabrer devant le feu, les broussailles autour d’eux se mirent soudain à frémir, s’écartèrent brutalement, et l’énorme sanglier, sans doute intrigué par ce feu qui trouait l’épaisseur de la nuit, apparut en pleine lumière.
Le comte se rua sur lui, son grand couteau de chasse prêt à le mortellement frapper. La bête esquiva le coup et fit rouler le chasseur par terre d’une violente charge dans les jambes. Elle allait se ruer sur lui et lui labourer le ventre de ses féroces défenses, déjà elle était dessus lui, quand Raymondin brandit son épée et voulut le transpercer. Mais l’animal esquiva encore le coup d’une roulade et l’épée du jeune homme alla se planter dans le corps de son oncle, le traversant de part en part. Raymondin hurla de douleur. Il tomba à genoux près du gisant et se tint la tête dans les mains, pleurant toutes les larmes de son corps. Le Comte, quant à lui, vidé de son sang, agonisant déjà sur les mousses de la forêt, eut le temps de murmurer, avant de rendre son âme à dieu :
- Les étoiles, Raymondin…Le destin… Accomplis le destin inscrit sur les étoiles…
Au comble du désespoir, le jeune homme enfourcha sa monture et longtemps galopa à travers la forêt, cherchant une issue. Il sauta des fossés, enjamba des broussailles, pénétra des halliers et cent fois se cogna le front aux branches les plus basses des arbres. Enfin, n’en pouvant plus, son cheval se mit à marcher et Raymondin le laissa faire, perdu dans ses pensées et ses remords. Il ne revint à lui que lorsqu’il sentit l’animal tirer fortement sur les rênes en baissant l’encolure pour s’abreuver à un ruisselet qui sourdait à la base d’une énorme roche. Raymondin s’extirpa de sa rêverie et regarda autour de lui : le ruisselet s’épanchait plus loin en une nappe d’eau prisonnière d’un amas de rochers ; une eau claire, où se miraient déjà les premières et pâles velléités de l’aube.
Il écarquilla les yeux, croyant être en proie aux hallucinations de sa souffrance : une jeune fille, très grande, nue, les cheveux ruisselant jusqu’au creux de ses reins, se baignait, fredonnait et dansait en tournant en rond, le visage levé vers le ciel. Elle vit Raymondin et, sans cesser de tournoyer et de fredonner, vint à lui, l’eau de la fontaine aspergeant autour d’elle des cascades limpides :
- Raymondin, dit-elle, je sais ton malheur et je sais ton inconsolable chagrin. Tu viens de tuer bien malgré toi ton oncle et seigneur adoré…Les pas de ton cheval l‘ont ensuite guidé jusqu’ici, jusqu’à cette fontaine que l’on nomme dans tout le Poitou, la Font d’la sé, la fontaine de la soif. Je t’attendais, Raymondin, pour que s’accomplisse le destin que lut ton seigneur sur la course des étoiles. Je ferai de toi l’homme le plus riche, le plus puissant et le plus heureux de tout le royaume de France, mais il faudra auparavant m’épouser et me faire un indéfectible serment, Raymondin.
Subjugué, dans un état encore second, se souvenant aussi des dernières paroles de son oncle, le jeune homme murmura seulement :
- Je veux bien, Princesse. Que me faudra t-il jurer ?
- Il te faut jurer maintenant, en levant la main et en la portant ensuite sur ton cœur que, lorsque nous serons mariés, jamais au grand jamais tu ne chercheras à me voir le samedi et, où que j’aille ce jour-là, tu ne chercheras à me suivre.
- Je le jure, dit Raymondin. Sois ma femme, console-moi de tous mes maux et de toute ma tristesse, et je jure devant dieu que jamais je ne chercherai à trahir mon serment.
Et Raymondin, sur les indications de la belle jeune fille, retrouva l’allée qui mène à Coulombiers, puis celle qui conduit à Poitiers, où il arriva bientôt et déclara que son oncle bien aimé s’était égaré lors de la poursuite du sanglier fabuleux et qu’il ne l’avait jamais retrouvé. Il pleura, sa peine était sincère, on le crut. On alluma des cierges immenses et tout le jour on pria pour le salut de l’âme du bon comte de Poitiers, disparu en donnant la chasse à un sanglier sorti des enfers.
Raymondin cependant brûlait de revoir la céleste jeune fille de la fontaine. Il y retourna donc et manqua de tomber alors de stupéfaction. Il n’y avait plus la roche d’où s’échappait une source, mais il y avait là une chapelle dorée d’où sortait une tendre musique. La demoiselle en sortit bientôt, toute vêtue de blanc, elle prit Raymondin par la main, le conduisit à l’intérieur où tous les deux, devant un vieux prêtre à la barbe si longue qu’elle balayait les objets sacrés de l’autel, s’agenouillèrent. Le saint homme les bénit et les maria, après que Raymondin eut sur la croix renouvelé son serment déjà fait à sa magnifique épouse.
Alors, heureux et légers comme le sont toujours tous les jeunes mariés de la terre, ils s’en revinrent à Poitiers dans un carrosse resplendissant tiré par quatre forts chevaux. Ils vinrent en premier lieu saluer le successeur du Comte, fils du précédent et cousin de Raymondin, pour lui faire allégeance.
- Cousin et cher Comte, lui dit le jeune homme, répétant en cela le discours que lui avait préalablement prié de dire sa jeune femme, voici mon épouse…Vois comme elle est belle et vois comme elle est jeune ! Etre riche d’elle, me suffit, mon cousin, alors je ne demande pour m’établir sur tes terres que la Font d’la sé et, autour d’elle, un territoire si petit qu’une seule peau de cerf serait capable de le recouvrir.
-Tu es bien modeste, mon cousin ! Ta bonté et ta loyauté méritaient assurément bien plus que cela. Mais puisque tel est ton désir, va, Raymondin, ton étrange demande est accordée.
Mais la jeune et belle dame de la fontaine entreprit alors la nuit suivante de découper la peau d’un cerf en fines, très fines lanières, aussi fines que les fils de la toile que tisse une araignée. Elle les mit ensuite soigneusement bout à bout, de telle sorte que le territoire ainsi encerclé fut immense, englobant des forêts, des prairies, des villages, des vallons, des rivières, des champs et des villes. Le Comte de Poitiers ressentit bien là comme une tromperie, mais comme il était un homme d’honneur et de parole, il accorda ces territoires à son cousin et enjoignit à ses tabellions et à ses commissaires d’enregistrer dûment les édits de propriété.
Aussitôt, un château superbe, avec ses donjons, ses tours, ses remparts et ses parcs, fut élevé au beau milieu de ce territoire. En une nuit seulement. Raymondin s’interrogea. Mais d’où vient tout cela ? Et sa belle épouse lui répondit en riant. Bientôt, lui dit-elle, je couvrirai toute la province de châteaux, de villes, d’églises et de places fortes. Il me suffira d’avoir une bouteille d’eau et trois tabliers.
- Mais comment ? s’inquiéta encore Raymondin. Et le même rire, gai, léger, cristallin, lui fut donné en guise de réponse.
Le château de Raymondin et de sa femme est élevé sur une colline déboisée. Raymondin, oubliant ses questions, fou de bonheur au milieu de ses richesses, de ses soldats, de ses gens, de ses serviteurs, voulut lui donner un nom mémorable, que retiendrait l’histoire.
- Ce sera le château de Lusinème, car il y a dans ce nom toutes les lettres éparpillées de mon prénom, lui déclara sa femme, toujours gaie, toujours rieuse.
En une nuit cependant, une ville sortit de terre tout autour du château, une ville avec ses places, ses étals, ses rues, ses maisons, ses marchés, ses églises et ses habitants joyeux qui choisirent de la nommer Lusinème, en hommage au château des maîtres des lieux. Mais comme ils parlaient vite, fort, tous à la fois et de sourde façon, on entendit et on transmit Lusignan.
Si vous passez par là, par Lusignan, vous apercevrez encore, sur la colline, les restes du donjon que le temps a effrité et puis, si vous êtes curieux, si cette histoire vous a plu, vous approcherez encore, vous écarterez la broussaille et les ronces, et vous verrez à vos pieds s’ouvrir un souterrain.
Mais les prodiges ne s’arrêtèrent pas à Lusignan... Comme promis, la belle Lusinème - c’est ainsi que la nommait Raymondin en son cœur, faute de n’avoir su mettre les lettres dans un autre ordre, - sema en toute la région, villes, palais et monuments. A Melle, à Vouvant, à Mervant, à Taillebourg, à Fontenay, à Soubise, à Brouage, à Surgères, à Mirbeau…partout. Et puis, sur les rives de la Sèvre niortaise, un peu plus loin que Lusignan en partant sur l’océan, elle éleva une ville avec des tours, des châteaux, des hôtels, des promenades. C’est aujourd’hui Saint-Maixent et c’est l’œuvre de Lusinème.
Survolant bientôt la Vendée, elle construisit encore une abbaye majestueuse, à Maillezais…Et Raymondin, émerveillé, se disait toujours, mais comment fait-elle ? Comment ma femme, mon adorée, si frêle, si délicate et si fragile, construit-elle tous ces trésors aux charpentes si lourdes et aux pierres si volumineuses ?
Mais ces questions étaient vite occultées par son bonheur, d’abord, mais aussi par une autre interrogation, qui le plongea bientôt dans de sévères et douloureuses inquiétudes.
Sa jeune femme lui donnait en effet régulièrement un fils. Elle lui en offrit dix au total. Mais tous, hélas, souffraient d’une horrible malformation. Ils étaient laids, ils étaient même hideux, repoussants. Le premier, Guy, n’avait qu’un œil. Le second, Urian, possédait bien ses deux yeux mais ils n’étaient pas placés au même niveau, ce qui lui donnait l’air sauvage de la démence. Odon avait des mains très fines, presque transparentes et couvertes d’écailles rugueuses et froides, Raymond disparaissait sous une épaisse fourrure de poils hirsutes, tel un ours, Geoffroy, le plus terrifiant, le plus brutal, le plus fort, anormalement fort, avait une défense de sanglier qui lui sortait de la bouche en lui déchirant les lèvres, et il écumait et il vociférait sans cesse. Thierry n’avait pas d’oreilles, seulement deux larges trous en lieu et place, Froimond était chauve et sa face était ronde, rouge, large, avec des yeux énormes, sans rétine, et qui semblaient lui sortir de la tête. Regnault, chétif, n’avait qu’une jambe et il sautillait comme un passereau, Antoine avait des griffes de lion, acérées et longues de plus dix centimètres à chaque doigt de pieds. Le dernier, enfin, était tellement difforme, tellement bossu, sans bras, sans nez, sans yeux, qu’on le tua au berceau.
Toutes ces monstruosités effrayaient leur père et le plongeaient dans un profond désarroi, surtout celles de Geoffroy, méchant, violent, et qui, malgré tout, était le fils préféré de la belle et douce Lusinème. Raymondin, lui, se consolait avec Regnault, l’unijambiste. Celui-là était d’un caractère doux, rêveur, attendri. Il voulait, dit-il à son père, se faire moine à l’abbaye de Maillezais, s’y retirer et étudier les livres.
Tous les autres garçons, en dépit de leurs atroces infirmités, épousèrent la carrière militaire et s’y couvrirent de gloire et de lauriers. Quand Geoffroy cependant apprit la vocation de son frère Regnault, il entra dans une colère terrifiante, frappa et hurla que dans une famille de guerriers, un moine était une honte. Revenu précipitamment d’une campagne militaire, il fonça donc à toute allure sur Maillezais, seul, il y étrangla tous les moines, supplicia son frère et mit le feu à l’abbaye.
Raymondin fut au désespoir. Son fils préféré, tué par le plus horrible et le plus taré de sa descendance ! Il voulut exiger que sa femme répudie ce monstre, qu’elle le chasse sur-le-champ. Et il se mit à la chercher partout, dans les cours, les donjons, les tours, les chambres…Il ne la trouva point. Il l’appela, elle ne répondit point. Alors, il se souvint soudain qu’on était un samedi et il se souvint en même temps de son serment, deux fois donné…Mais la peine était trop grande, le chagrin trop lourd, il s’engouffrait déjà dans le souterrain du donjon, où il lui semblait avoir perçu une voix : une voix qu’il avait cru reconnaître comme étant celle qui avait fredonné, jadis, la mélodie de la Font d’la sé.
Il marchait maintenant à pas de loup…Une faible lumière vacillait, là-bas, dans le noir lointain. Il approcha et il vit, horrifié : sa femme était nue, plongée dans une sorte de fontaine souterraine…Elle était nue, ses seins resplendissaient et se dressaient, sa taille était fine et, juste après cette taille…Raymondin poussa un cri de douleur. Après cette taille, ce n’était plus une femme mais un serpent, avec une longue, une très longue queue qui fouettait avec violence et furie l’eau de la fontaine.
- Horreur ! Une fée ! s’écria Raymondin. J’ai épousé une fée !
- Lâche ! hurla Lusinème, tu viens de trahir ton serment ! Sois maudit à jamais autant que je le suis et, soulevant la terre, la faisant craquer et jaillir en l’air en même temps que les pierres des remparts et du donjon, elle s’envola dans les airs, sa longue queue d’écailles ondulant derrière elle. Alors un hurlement, une plainte épouvantable, démentielle, d’un désespoir sans nom, déchira les airs, plana longtemps au-dessus des villes et des forêts. On l’entendit, épouvanté, de Poitiers jusqu’à La Rochelle.
Car telle avait été la malédiction maternelle portée sur Mélusine, la benjamine de la fée Pressine. Malédiction terrible la condamnant à une métamorphose régulière, mi-femme, mi-serpent ; une métamorphose qui ne devait jamais être vue d’aucun humain, sous peine de malheurs et de désastres.
Et depuis des siècles, maintes fois épousée, jamais Mélusine, n’a eu l’heur de rencontrer l’époux capable de tenir son serment de ne point assister à la monstrueuse mutation. Alors, depuis des siècles et des siècles, la fée court les bois, les chemins, et les fontaines, à la recherche désespérée de l’impossible époux.
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.01.2012
Quand ça tourne en rond sans vraiment tourner rond
 - Allô ?
- Allô ?
-Oui, j'écoute. Marie Tezniès, Editions La Perle rare, j'écoute...
- Bertrand Redonnet, bonjour madame.
- Bonjour monsieur.
- Voilà : j’ai écrit un livre et je cherche un éditeur.
- Bien. C’est votre premier roman, je présume.
- Comment savez-vous que c’est un roman ?
- Parce que ça doit être votre premier livre et on commence toujours par un roman… En général.
- Ah bon ? Mais comment pouvez-vous savoir que c’est mon premier livre ?
- Parce que sinon vous ne me téléphoneriez pas. Vous auriez vos entrées.
- Ah bon ? C’est assez fulgurant comme raccourci, je trouve. Non, en fait, ce sera mon neuvième livre.
- Ah bon ? C’est curieux. Et pourquoi me téléphonez-vous alors ? Que voulez-vous exactement, monsieur ?
- Je vous l’ai dit, madame : j’ai écrit un livre et je cherche un éditeur.
- Vous venez de me dire que vous en aviez écrit déjà huit.
- Bon…Recommençons depuis le début. J’ai publié huit livres et, là, je viens d’en écrire un neuvième qui n’est pas encore publié et que je voudrais vous proposer.
- Votre éditeur n’en veut pas ?
- Je ne lui ai pas présenté.
- Ah bon ? Et pourquoi donc ? Il a fait faillite ?
- Non. En tout cas pas à cause de moi, si ça peut vous rassurer. Disons que je suis fâché avec lui. C'est bête, mais c'est comme ça.
- Ah bon ? Tiens…tiens… C’est curieux. Et pourquoi ?
- Est-ce bien nécessaire de vous en informer ?
- Ben, c’est que je trouve ça très curieux…C’est rare.
- A cause des droits d’auteur, des contrats, du silence et de tout le merdier…
- Ah bon ? C’est vraiment très curieux…En général, les auteurs ne s’occupent pas de ce merdier-là, comme vous dites. Ça n’est pas leur affaire. Ils écrivent, point.
- I sont vraiment cons à ce point-là, justement ?
- Pardon ?
- Rien…Veuillez m’excuser. Je causais à mon bonnet
- Bien. Et de quoi est-il censé nous parler votre…voyons voir, neuvième livre ?
- De quoi il parle ? Ben, comme ça, à brûle-pourpoint, c'est délicat...Heu... De vous, tenez !
- Ah, ah, ah, ah, vous êtes un comique, vous ! De moi ?
- Oui, des éditeurs qui posent des questions stupides.
- Au revoir, monsieur !
Crac !...tut…tut tut…tut tut…tut tut…tut tut…tut
Illustration:Philip Seelen
12:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.01.2012
Ceci n'est pas un coup d'gueule
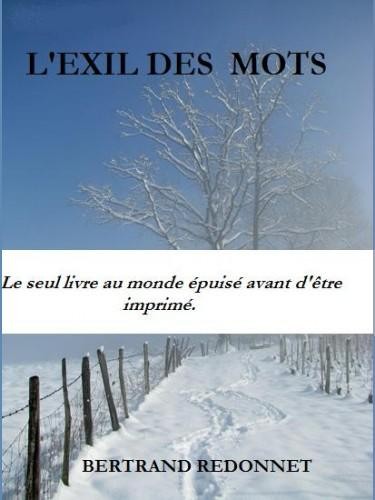
Je vais vite voir et, comme dirait l’autre, en effet ! Je supprime illico la couverture incriminée et en bricole une autre.
Que voici.
J’éclate de rire aussi parce que ça fait du bien, parfois, d’être pris en flagrant délit de mauvais goût, surtout par quelqu’un dont on juge qu’il en a, du goût.
Et cette remarque tombait à pic parce que je voulais justement vous en parler de cette souscription lancée le 17 décembre. Une idée comme ça, un pavé dans la mare.
Vous avez été, jusqu’à aujourd’hui, 21 à souscrire…Le chiffre cacochyme m’oblige à vitement remballer mes gaules et à conclure à l’erreur d’aiguillage : nous sommes bien dans une société systématique où la marchandise est reine sans partage et où l’échange, le troc, sont vaincus, au point d’en être devenus quasiment scabreux.
Et puis comme ces temps derniers il semblerait que mes idées soient plus souvent mauvaises que bonnes, ça n’en était certainement pas une lumineuse que de vouloir vous soutirer 20 euros pour que vous lisiez un livre que vous aviez déjà lu gratuitement. Quel sot !
L’argument pourtant donné par La Zélie était vraiment encourageant ; je l’en remercie vivement : « J'aime les livres, je veux avoir ce livre sans chercher midi à quatorze heures, c'est normal que celui qui écrit (blog ou autre support) ait envie de rassembler ses écrits dans un livre! »
Envie ? Oui. Alors qu’il se débrouille ou passe par le système par tous décrié et néanmoins par tous contresigné !
J’annule donc cette souscription, sans dépit aucun je vous l'assure, un peu amusé même, et m’attache désormais à trouver une autre voie à mon projet d’édition. Il est trop tôt pour que j’en parle maintenant dans le détail car d’autres camarades proposent de s’y investir, qui n’ont pas encore pris publiquement la parole sur le sujet. Ça tournera évidemment autour de l’édition et du livre, mais plus jamais, je ne tendrai mon chapeau.
D’ailleurs, je n’ai jamais eu de chapeau et mes poches ont des trous.
Merci aux 21 souscripteurs putatifs*. Ils verront sans doute, quand même, leur choix se matérialiser, mais sous un autre jour, un autre angle de vue. C’est presque une dette que j’ai contractée envers eux.
En attendant, je signale que Le Manchot a mis en ligne la première partie de Pan Trésor Kowalski, chapitres alternés avec ceux de son roman, Le Parallèle du Sosie.
* Je précise qu’il s’agit d’inscriptions préalables, de principe, et non de sous envoyés. Précision inutile peut-être ?
12:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.01.2012
Un homme qui ne boit que de l'eau n'a pas de secrets à cacher à ses semblables
 Dans mes placards, il y a de l’eau-de-vie de prune, du pineau, de la vodka, quelques bouteilles de vin, un reste de Calvados. Ces quelques soldats de l’ivresse, immobiles et debout, s’ennuient à mourir depuis longtemps sur leurs étagères. Personne ne vient plus rien leur demander. Ce sont des cadeaux que l’on nous a faits et, parfois, ils daignent servir un visiteur. Pas souvent…
Dans mes placards, il y a de l’eau-de-vie de prune, du pineau, de la vodka, quelques bouteilles de vin, un reste de Calvados. Ces quelques soldats de l’ivresse, immobiles et debout, s’ennuient à mourir depuis longtemps sur leurs étagères. Personne ne vient plus rien leur demander. Ce sont des cadeaux que l’on nous a faits et, parfois, ils daignent servir un visiteur. Pas souvent…
Quand on habite un climat aussi éloigné, les visiteurs se font rares. J’aurais élu domicile aux Etats-Unis ou au Canada, ce serait plus facile, je crois. On monte dans un avion à Roissy, on en descend quelque huit ou dix heures après et salut ! Il n’y a pas le choix et quand on n’a pas le choix, les décisions se prennent forcément plus vite.
Mais là. Voiture ? C’est possible. Deux ou trois jours. Fatigant. En bus ? Pouah ! Trente six heures non-stop d’une bruyante promiscuité, de Paris à Varsovie. En train, via Bruxelles et Berlin ? Oui, pourquoi pas ? Long et hors de prix…Et des correspondances de nuit, en plus. En avion, bien sûr. Deux heures et demie. Est-ce que ça vaut le coup, toutes ces démarches, ces contrôles, ces enregistrements, ces attentes, pour voler deux heures et demie ? Sans compter que toutes ces options ne mènent pas jusqu’à mon placard à bouteilles mais jusqu’à Varsovie seulement. Il y a encore trois heures et demie de route pour atteindre ma campagne, sur les rives du Bug.
Bref, la multiplicité des solutions, loin d’être un atout, est certainement un handicap. Il faut être vraiment motivé. Et je ne suis pas assez aimant - je n’aimante pas assez je veux dire - pour inciter sans doute à un tel déplacement. En plus, il fait froid chez moi…Et c’est la Pologne. A part l’amitié, qu’est-ce qu’on viendrait chercher en Pologne ? Et est-on bien certain de la trouver à l’arrivée, cette amitié ? C’est tellement versatile, l’amitié !
Mais revenons à mes bouteilles inutiles. Je les regarde comme d’anciens compagnons de route, ces totems de l’ébriété, ces dieux de l'ivrognerie abandonnés là. Déchus. Ils semblent monter la garde le long du parcours et des souvenirs. On dirait des maîtresses éconduites aussi, mais amicales, sans mal-vécu, l’étiquette souriante. Et je pense à une phrase de Vailland, dans ses Ecrits intimes, que je cite de mémoire, donc en substance : « Autant il m’apparaissait, avant, inconcevable de vivre sans boire, autant il m’apparaît aujourd’hui inconcevable de vivre en buvant. »
Autrefois, une bouteille dans ma maison ne vieillissait jamais. Elle était vitement sacrifiée sur l’autel du quotidien.
Un schisme s’est donc opéré en moi. Il y a sept ans. Je n’ai plus de l’ivresse que des souvenirs qui s’estompent. Beaucoup, beaucoup de souvenirs, des bons, des mauvais, des minables, des sublimes, des avilissants, des violents, des hilarants, des ponts humides dans la nuit sans logis. J’avais bu toute ma vie, de mes premiers bals du samedi soir, à quatorze ans, à mon départ pour la Pologne, à cinquante bien sonnés.
J’y pense souvent : je n’ai fait aucun effort de volonté pour cela ; je ne me suis pas fait militant d’un sevrage ; je n’ai pris aucune de ces résolutions qu’on dit niaisement être bonnes. C’est venu comme ça. Je n’éprouve plus aucun besoin d’alcool, alors que je ne pouvais envisager un quotidien, une fête, un concert, une rencontre nouvelle, sans lui…
Je cherchais alors à ne plus m’habiter ? Je cherchais à mettre en exil ce personnage qui était moi et qui préférait ainsi dresser entre lui et la réalité des rapports humains le prisme déformant, ou plus audacieux, ou plus opaque ou plus aigu, plus clairvoyant, de l’ivresse ? Sans doute.
Voyager n’est pas guérir son âme, disait Sénèque, déjà cité dans Géographiques. Ce n’est pas la question du voyage. Il est même question du contraire. C’est la question essentielle de se retrouver seul, face à face, sans cartes biseautées dans le cerveau, donc de se retrouver vraiment et d’avoir soudain besoin de toute la force et de toute l’intelligence de la situation pour la vivre sans s’y abîmer.
On s’habite plus authentiquement soi-même quand on habite chez les autres. Forcément.
Le jour où j’ouvrirai mon placard pour décapsuler une bouteille, que je m'assiérai à la table pour contempler mon verre, pour le faire tournoyer un moment dans mes mains, pour humer le liquide dansant, pour sentir en moi, soudain, cet éloignement de la pensée et le courage nébuleux d'autres désirs, plus loin que l’immédiat des jours, alors, c’est que j’aurai rompu ma complicité poétique, sanguine, avec l’exil et que j’aurai besoin de m’habiter autrement. D’exiler mon exil.
Car cet alcool que je ne fréquente plus mais dont j'aime encore l'idée a ceci de terrible : il emmène vers des ailleurs qui ne sont accessibles que sans lui.
15:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.01.2012
Le capitaine La Bravoure
A l'époque des Sept mains, je m'étais amusé (distrait ?) à vouloir démontrer qu'à partir des histoires qu'on se raconte entre copains pour se fendre la pipe, on peut faire des textes à prétention littéraire.
Mais, si on sait exactement ce qu'est une histoire racontée pour se fendre la pipe, on ne sait pas encore très bien ce qu'est un texte à prétention littéraire.
Alors vous dire si j'ai réussi ma démonstration est impossible, car il y a presque autant de textes à prétention littéraire qu'il y a d'auteurs et de goûts de lecture.
En tout cas, l'exercice fut plaisant.
 La mer, la très vaste mer, dansait sous les feux du solstice et toute cette lumière réfléchissante, décuplée par les flots capricieux comme des diamants liquides, faisait mal aux yeux pourtant burinés des marins, qui plissaient les paupières et mettaient parfois leur main au front, telle une visière.
La mer, la très vaste mer, dansait sous les feux du solstice et toute cette lumière réfléchissante, décuplée par les flots capricieux comme des diamants liquides, faisait mal aux yeux pourtant burinés des marins, qui plissaient les paupières et mettaient parfois leur main au front, telle une visière.
Le bateau battait pavillon anglais et croisait en mer d’Oman, au large des Indes, ses flancs surchargés d’épices, de thé et autres fines richesses spoliées sur «la perle de la Couronne». Il était en partance vers les terres chéries et lointaines du Royaume, cap plein sud d’abord, sur cette route ouverte par Vasco de Gama, quelque quatre siècles auparavant.
Paisiblement assis non loin de la proue, le capitaine tirait sur une lourde bouffarde et son regard vagabondait sur la grande nappe lumineuse. Peut-être ce regard portait-il même plus loin encore que l’horizon vaporeux, là-bas où semblaient finir les eaux et recommencer le ciel, qu’il se perdait dans ses fiers souvenirs de vieux coureur des mers, dans les bras d’une femme gourmande, allez savoir, et dans un port qui n’avait ni nom, ni patrie, aux ruelles infâmes.
Un homme robuste, gigantesque même, le capitaine. Craint, certes, mais aussi adulé de ses marins. Une épaisse chevelure rousse comme des soleils couchants retombait sur ses épaules et le vent du large bousculait et jouait par moments avec des mèches broussailleuses qui barraient alors le visage et voilaient la profondeur des yeux.
Capitaine La Bravoure. Un nom glorieux qui retentissait jusqu’aux antipodes, un nom comme une sommation en direction de toute la flibuste, un sobriquet légendaire, à la juste hauteur de l’intrépidité et de la loyauté du personnage.
La voilure était gonflée et sereine était la navigation du vaisseau. Le capitaine pensa que bientôt, à quelques mois de là…
Le cri fut jeté de là-haut, du poste de vigie, et courut sur l’étendue des eaux.
- Bateau pirate à tribord !
Les flammes d’une colère déterminée jaillirent dans les yeux du capitaine tandis qu’il voyait flotter dans le vent, encore assez loin au bout de sa lorgnette, le redoutable drapeau noir affublé de la tête de mort. Le navire des pillards fonçait droit sur leur flanc. L’intention était sans ambages et la bataille inévitable.
Le capitaine hurla qu’on virât de bord et dirigea lui-même son vaisseau vers l’affrontement. Il courut d’un côté sur l’autre, fonça d’un poste à l’autre, éructa ses ordres, exhorta ses hommes, les plaça, surveillant tout, organisant tout et, alors qu’allait s’engager le terrible combat à mort, se tourna vers son second :
- Qu’on m’apporte mon pantalon rouge !
La mêlée fut digne d’Homère. Elle fut une débauche de sang et les morts rosissaient bientôt de leurs ventres béants la surface tout à l’heure si bleue des eaux. Les voyous des mers avaient été anéantis, on leur avait coupé la gorge, on les avait amputés de leurs membres, même les plus intimes, avec cet excès de zèle et de raffinement dont seuls les Anglais ont le secret. On les avait pendus même, par le cou ou par les pieds, on les avait passés par le fer et le feu et leur vaisseau disloqué, incendié, massacré, fut bientôt expédié par les gouffres abyssaux des flots.
Le Capitaine La Bravoure commanda alors qu’on mît en perce des barriques de bière et qu’on fêtât, sur le pont et sur-le-champ, l’éclatante victoire des corsaires de sa Majesté sur les flibustiers sans foi ni loi.
Et la fête battait son plein quand le second demanda nonchalamment à son capitaine pourquoi il avait absolument tenu à revêtir un pantalon rouge avant de monter au combat :
- Matelots, hurla alors La Bravoure afin d’être entendu de tous, qui cessèrent un moment leurs libations et tendirent leurs oreilles respectueuses. Matelots, un capitaine digne de son grade et de son nom, doit aimer, protéger et encourager ses hommes ! Supposez que j’eusse été terriblement blessé pendant la mêlée ! Imaginez la vue de mon sang se répandant et maculant affreusement mes habits ! Qu’auriez-vous dit, garçons ? Nous sommes faits, notre capitaine est mourant ! Nous sommes vaincus, voilà ce que vous auriez dit et cédant à la panique aussitôt, auriez laissé les vandales investir notre place, vous égorger et piller la Reine !
Avec un habit rouge, mes garçons, pas moyen pour vous de savoir si un couteau, un sabre, a largement entamé ma chair ! Pas moyen de vous décourager devant mes blessures ! Oui, je le réaffirme avec force : Un capitaine doit montrer, toujours, le chemin de la victoire, ne rien laisser transpirer de ses éventuelles faiblesses et sans cesse galvaniser ses hommes !
Ce ne fut alors qu’une vaste clameur d’admiration et de joie, clameur qui submergea le navire tout entier, s’amplifia, sauta par-dessus bord, chevaucha les houles radieuses, et monta jusqu’aux cieux infinis.
A quelques jours de là cependant, alors que le capitaine tirait toujours sur sa lourde bouffarde et que son regard vagabondait derechef sur la grande nappe lumineuse, et que même, peut-être, ce regard portait plus loin encore que cet horizon vaporeux, là-bas où semblaient finir les eaux et recommencer le ciel, qu’il se perdait dans de vagues souvenirs de vieux coureur des mers, dans les bras d’une femme gourmande, allez savoir, et dans un port qui n’avait ni nom, ni patrie, aux ruelles infâmes, alors qu’il faisait tout ça à la fois, le capitaine, la vigie là-haut lança à nouveau, non plus un cri, mais de nombreux cris, une véritable salve de cris alarmants…
- Vaisseaux pirates à bâbord, vaisseaux pirates à tribord itou, à l’avant et à l’arrière encore vaisseaux pirates, bateaux pirates partout !
Le capitaine, amer, constata au bout de sa lorgnette.
Et ses yeux prirent alors une lueur étrange, qui vacillait, qui tremblait, qui n’arrêtait pas d’aller et de venir d’un coin de l’œil à l’autre. La mer, en effet, la vaste mer n’était plus qu’une forêt hirsute de drapeaux noirs à têtes de mort et le cercle sinistre des bateaux assassins, lentement, silencieusement, inexorablement, glissait sur les eaux et allait bientôt se refermer sur lui.
Alors calmement, le capitaine se retourna vers son second et d’une voix que celui-ci ne reconnut qu’à peine tant elle était livide, susurra cet ordre lapidaire :
- Qu’on m’apporte mon pantalon marron !
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.01.2012
La page du grimaud
 Le fleuve, majestueux et impassible, traversait la ville, roulant ses flots éternels d’aval en amont. Heu…Non. D’amont en aval plutôt.
Le fleuve, majestueux et impassible, traversait la ville, roulant ses flots éternels d’aval en amont. Heu…Non. D’amont en aval plutôt.
Je reprends :
Gna...gna...gna...gna... (…) Le fleuve, majestueux et impassible, traversait la ville, roulant ses flots éternels d’aval en amont, merde de merde ! d’amont en aval.
La lune au dessus de l’eau étirait des couleurs diaphanes. La nuit était blême. On aurait dit une nuit étalée sur un cimetière avec cette pâleur toute lunaire tout avec toute cette pâleur lunaire.
Les gens dormaient dans leur lit, je crois bien…Seuls quelques noctambules avinés, la démarche légèrement chaloupée, hantaient encore les trottoirs où luisaient timidement le jaune des vieux réverbères.
Il faisait froid. Un froid qui cinglait le visage. Je marchais et je me demandais quel souvenir confus m’inspirait cette ville silencieuse dans la nuit blafarde sous la lune sous l’astre nocturne. Je cherchais dans ma mémoire en feu. Mais je ne trouvais rien.
Alors je vins regarder dans l’eau et je vis soudain, à la lueur conjuguée de l’astre de la nuit la lune et des vieux lampions, comme un reflet…Rêvais-je pendant que les autres dormaient ? Non! Impossible Pas Possible ! Je me suis penché pour regarder mieux et, en effet, j'ai vu ton visage qui tremblait au rythme des vaguelettes. J'ai senti aussi, qui flottait dans l'air, ton parfum... Si ! si ! Alors je me suis dit que c’était toi que m’inspirait la nuit blafarde dans cette ville. Mais je ne me suis pas souvenu de la ville qui avait fait que je me souvenais. Je ne me suis souvenu que de toi, de toi, mon amour, que j'ai tant Aimée tant aimé et que je n'arrive pas à oublier ! Ah toi ! T’es donc Toi ! T’es toi donc !
- Ouais, t’as raison, tais-toi donc !
(.....)
Ouf ! Merci.
L'illustration de ce texte, ô combien génial ! est de Philip Seelen
14:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.01.2012
Lire de la littérature
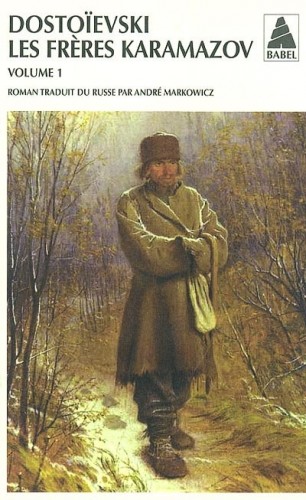 Je n’ai jamais lu Eric Bonnargent ailleurs que sur le net, plus précisément sur l’Anagnoste, blog de très belle tenue aux destinées duquel il préside en compagnie de Marc Villemain ; dans certains textes publiés sur le blog de Juan Asensio et, également, à l'occasion du débat sur la littérature qu’il nourrit à parts égales avec le susnommé Juan Asensio et François Monti, débat que je vous recommande, d’ailleurs, de lire si ce n'est déjà fait.
Je n’ai jamais lu Eric Bonnargent ailleurs que sur le net, plus précisément sur l’Anagnoste, blog de très belle tenue aux destinées duquel il préside en compagnie de Marc Villemain ; dans certains textes publiés sur le blog de Juan Asensio et, également, à l'occasion du débat sur la littérature qu’il nourrit à parts égales avec le susnommé Juan Asensio et François Monti, débat que je vous recommande, d’ailleurs, de lire si ce n'est déjà fait.
Cette lacune est certainement un tort, j’en conviens sans ambages. Mais le nombre d’auteurs qui méritent qu’on les lise et que je n’ai pas encore lus, est effrayant au point de m’effrayer moi-même ! Faute de plein de choses, surtout vivant dans un pays où les librairies françaises ne fleurissent plus beaucoup depuis que, poussées par les vents lénifiants de l’ouest-Eldorado, les librairies anglaises plombent le marché du livre - le monde-image a besoin de codes, pas de mots - et que la langue française, longtemps considérée par les Polonais comme l’expression même de l’esprit, est en décadence complète, à tel point que son enseignement dans les collèges est sur le point d’être abandonné. Varsovie, 160 km de la frontière orientale où j’ai élu domicile, compte une librairie française, encore faut-il y commander préalablement l’ouvrage qui vous intéresse. Lublin n’a pas de librairie française, stricto sensu, sinon une librairie linguistique et universitaire, avec un rayon offrant quelques étoiles du hit parade, genre Le Clézio. Houellebecq, les jours bien achalandés.
Je ne digresse pas…C’est bien de lecture et d’Eric Bonnargent dont je veux parler. Donc, difficultés à me procurer certains livres et redécouverte des grands classiques emportés dans mes valises, ou alors achat à la librairie de Varsovie, ou bien encore, demandes à des amis de France, ce qui, à la longue, est un peu délicat.
Je vous raconte tout ça en préambule car, dans une interview accordée à Joseph Vebret, Eric Bonnargent dit la chose suivante :
« (…°) je n’ai rien contre les livres purement distrayants, du moment qu’ils respectent la langue. Mais si un grand livre peut être distrayant, cela ne peut en aucun cas être sa seule qualité. La grande littérature peut distraire, mais telle n’est pas sa fonction. Madame Bovary n’a aucune fonction à distraire le lecteur. Par contre, si Fred Vargas ne parvient pas à nous distraire, alors elle a raté son but. Et, quand je veux me distraire, je lis bien volontiers un Fred Vargas ! »
Il me semble qu’il y a là, non pas une approche littéraire de la littérature, mais une approche purement philosophique, d'une part, et que, d'autre part, le mot distrayant est employé à la légère, dans son acception la plus vulgaire.
Car si Eric Bonnargent nous dit qu’elle n’est pas la fonction de la grande littérature, il ne nous dit en rien ce qu’est cette fonction. Il dit bien par ailleurs qu’un grand livre est un livre écrit dans une belle langue au service d’une certaine vision du monde, mais ceci ne peut pas lui être compté comme ayant énoncé la fonction de la littérature.
La littérature - ça me semble tomber sous le sens - doit être bien écrite. Une peinture, au risque d’endosser le statut de croûte, doit être bien peinte, une musique, au risque d’endosser celui de soupe, doit être jouée juste et savoir marier les sons d’harmonieuse façon, comme la phrase s’applique à le faire avec les mots. Disons que nous sommes là sur le strict terrain de l’esthétisme, sur le champ de l’art, et que nous ne devrions pas en sortir, s'agissant de littérature.
Parce qu’en la matière, plus que partout ailleurs, la forme n’est jamais dissociable du contenu : si je veux dire que le monde est un monde traversé par un dépérissement désastreux de l’humanité et de la fraternité, si j’ai envie de gueuler sur les faux-monnayeurs qui nous assaillent, devrai-je pour autant travailler mon style ? Oui, si je recherche non pas un monde plus beau, mais la représentation artistique de mon opposition à ce monde.
Sinon, j’écrirai des gros mots sur les murs de la ville ou, mieux, voire pire, j’irai physiquement affronter ce monde. Mais là, n’est pas le propos de la littérature qui, avant toute autre chose, est représentation. Sortie de ce champ-là, elle trahit son propos.
L’art est donc, par définition, distrayant, si je prends le mot à sa racine, si j’en extirpe la sève fondatrice. Est distrayant ce qui distrait et ce qui me distrait, littéralement, détourne mon esprit de mes occupations, voire de mes préoccupations. Je n’ouvre donc pas forcément un livre de littérature pour enrichir mes occupations ou mes préoccupations d’un nouvel apport didactique, mais pour m’en détourner par l’entremise de l’art, même si ce que je vais lire peut rejoindre ces occupations et ces préoccupations : elles seront alors médiatisées par l’art de les dire et surtout par un autre.
La souffrance lue peut distraire de la souffrance éprouvée. Elle le doit même, si tant est qu’elle ait distrait l’auteur de la sienne propre.
Si je veux donc aller plus loin dans ma recherche du monde, affiner ma vision, j’ouvre un livre de philosophie. S’il en existe encore un à portée de main.
L’écriture est un acte profondément onaniste et narcissique. Un acte de détournement du monde par le biais du plaisir pris à le représenter. C’est quand je sais lire, entre les lignes, ce plaisir* pris par l’auteur, quand j’ai plaisir à lire ce qui m’aurait assurément procuré du plaisir à écrire, que je dis : voilà, pour moi, un grand livre !
Et le «pour moi» est essentiel. Pour toi, ce livre sera peut-être une merde.
Car la littérature est une grande Dame : cherchez à l'enfermer dans vos convictions, refermez la porte derrière vous pour la cloîtrer dans vos habitudes et vos propres visions du monde, et elle saura se faire la belle par la fenêtre.
Elle a encore ceci de passionnant par rapport aux religions qu'elle ne supporte pas les papes, ni, par rapport à la démence du foutoir libéral, d'agence de notation autre que la foule immensément diverse de ses lecteurs.
Elle souffre en revanche d'un mal qui la tue : ceux qui en sont amoureux le sont de façon tellement névrotique qu'ils cherchent toujours à exclure de ses faveurs d'autres amants, tout aussi habiles qu'eux, mais qui ne lui parlent pas le langage qu'ils ont eux-mêmes adopté pour avoir l'heur de partager son lit.
L'exclusif en littérature court tout droit vers une tête couronnée de cerf.
Et je ne dis nullement toute cette dernière partie en direction d'Eric Bonnargent, pour l'écriture duquel j'ai goût et estime, dans ce que j'en connais.
* Plaisir au sens très large, c'est-à-dire compris aussi négativement comme absence de déplaisir.
15:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.01.2012
Dédicace posthume
 A l’été 2006, mon ami, aujourd’hui parti de l’autre côté des horizons et auquel je voue toujours un indéfectible sentiment d’affection, grand amateur, entre autres, de littérature noire, était venu me voir en Pologne.
A l’été 2006, mon ami, aujourd’hui parti de l’autre côté des horizons et auquel je voue toujours un indéfectible sentiment d’affection, grand amateur, entre autres, de littérature noire, était venu me voir en Pologne.
Nous avions été complices de pas mal de choses, des choses fortes, dangereuses parfois, des choses qui ne se font plus dans nos sociétés avachies, repues du spectacle permanent, humiliées de défaites maquillées en victoires, de résignations travesties en sagesse, de mensonges lustrés en vérités facilement assimilables.
Nous nous hantions depuis trente ans, depuis l’été 1976. Et nous ne parlions plus jamais de changer le monde. Nous y avions l’un et l'autre laissé bien trop de plumes et ces plumes-là n’avaient, en fait, servi qu’au vieux monde à se refaire de moelleux coussins.
En Pologne donc, lors d’une balade autour d’un petit lac, il me dit :
- Tu devrais écrire un polar, Fred.
- Je n’en suis pas capable.
- Essaye. Tu sauras comme ça si oui ou non, tu en es capable.
Ça tombait sous le sens. Sitôt qu’il m'eut quitté, j’entrepris donc la rédaction du polar, que je bouclai de septembre à novembre. Je lui fis parvenir aussitôt...
Mais la Faucheuse n’a pas permis que je recueille son avis. Sur sa table de chevet, on a retrouvé, m’a-t-on dit, le manuscrit ouvert.
Il portait un titre très court : Des plages de Charybde aux neiges de Scylla.
Je l’avais publié sur ce blog, chapitre par chapitre, en 2008, je crois. Je ne me souviens plus très bien. J’ai ensuite tout supprimé pour le mettre en une page complète, dans la marge. Je viens de supprimer cette page car Stéphane Prat, qui a trouvé ce polar vraiment à son goût, m’a proposé de le publier sous un autre titre.
Je l’en remercie vivement, l’ami Stéphane. Il explique ici sa démarche. Le premier chapitre du roman, lui, est ici.
Et je dédie, un pincement au cœur, cette publication à Jean-Claude, sans le caprice duquel ce livre n’aurait jamais été écrit.
11:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.01.2012
La Pologne atlantique

Et il est vrai qu’aussi loin que je remonte dans mes souvenirs de petit campagnard, je me vois guetter en hiver les nuages qui seraient venus du nord ou de l’est. Je guettais du froid, de la neige, des chemins durs comme la pierre et des cours d’eau immobilisés sous la glace. Je n’ai jamais trop compris pourquoi. Est-ce une rupture du quotidien que je demandais, déjà, aux cieux, ne pouvant la demander aux hommes ? Est-ce que j'attendais des nuages qu'ils brisent la normalité des choses ? Qu'ils contredisent leur latitude ?
Je me demande aujourd’hui si, en fait de tempérance, ce ne sont pas les hommes tempérés, que je n’aime pas. Ceux qui ressemblent aux climats sans amplitude. Les mous. Les calmes. Les sereins. Les cools. Les qui ne montrent jamais d’humeur, ou rarement. Les pacifistes. Et je n'aime pas que les ambiances paysagères prennent le visage des hommes que je n'aime pas. Peut-être.
Quand je suis arrivé en Pologne, il m’a semblé réalisé, aussi, comme une espèce de communion avec le climat continental. Il m’a semblé être venu combler une frustration lointaine, mes attentes enfantines s’étant à peu près toujours soldées, de ce côté-là, par des pluies étalant leurs immenses traînées.
Et il faut dire que j’ai été servi. Si je regarde les deux hivers précédents, on a totalisé sept mois sous la neige et atteint des températures jusqu’à moins 33. J’ai vu le Bug gelé, j’ai vu les routes coupées sous des congères de glace, j’ai vu des toits s’écrouler sous le poids de la neige, j'ai vu toutes les tuyauteries de ma maison bloquées.
Je n’en espérais pas tant, évidemment. Et même j'ai déploré tant de sévérités. Jamais content, quoi.
Cet hiver, mon ancienne détestation me revient avec force. Je sens l’Océan qui flotte dans l’air et depuis un mois, son haleine poisseuse m’a poursuivi jusques là. Ce sont alors des brouillards nonchalants, lourds, disgracieux, opposant aux paysages la force d'une inertie déconcertante. Et ce sont des températures clémentes, des températures hypocrites, mielleuses, entendez par là de - 4 à + 1 degré. Et c’est le gris désolant, ce gris que je connais si bien. Celui de Rochefort et de toute la côte. La neige tombe parfois. Une neige océanique, lourde, humide, collante, poussée par les vents d’ouest...Cette nuit, il en est tombé près de dix centimètres, à gros flocons, et, dès le lever du jour, la pluie, la gadoue. Et les toits qui pleurent comme sous une averse de printemps.
Le blanc refuse obstinément de s’accrocher à la toile des paysages.
Les Polonais vivent cet hiver ce que je voulais vivre enfant : leur latitude contrariée.
Je suis content pour eux. Moins pour moi.
Vous allez me trouver idiot, et pourtant : moins envie d'écrire dans cette ambiance de climat faux-cul.
Illustration : le Bug gelé, - 25, janvier 2010
14:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.01.2012
Villon en Polonais : un impérieux besoin
 Je chante souvent sur ma guitare, "La ballade des Dames du temps jadis.»
Je chante souvent sur ma guitare, "La ballade des Dames du temps jadis.»
J'ai même composé - commis plus exactement - une musique pour l'autre célèbre ballade de Villon, "Ballade des pendus", dont je rappelle que le titre est ridiculement figuratif et fort tardif, du XIXe je crois, même s'il est vrai que celui qu'en avait donné Clément Marot dans son édition complète de 1533 avait besoin d'être quelque peu épuré.
Jugez-en par vous-mêmes : Épitaphe en forme de ballade, que feit Villon pour luy et pour ses compaignons s'attendant à estre pendu avec eulx.
Il arrive donc que D. suive, cependant que je chante - z'avez-vu comme c'est bien dit, ça , hein ? - la traduction polonaise qu'elle possède dans un ouvrage intitulé "Wielki Testament ", Le Grand Testament.
C'est une très belle traduction.
Elle est de Tadeusz Żeleński-Boy, un médecin qui eut l'idée, le besoin impérieux, selon ses propres dires, de lire et de traduire Villon pendant la première guerre mondiale, mobilisé qu'il était dans un hôpital de campagne Autrichien et évidemment témoin direct des atrocités de la grande boucherie.
Un médecin en campagne, un érudit, un humaniste et qui, sans doute, a trouvé dans cette poésie la force de rester un homme.
Plus tard, en 1922, Tadeusz Żeleński-Boy a reçu les palmes de l'Académie française pour ses traductions de Molière. Responsable de la littérature française à l'université de Lwów - en actuelle Ukraine - il sera, comme la majeure partie des hommes et des femmes de l'intelligentsia polonaise, torturé et assassiné par les Nazis.
Emotion et respect.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.12.2011
Et d'une autre !

Je n’ai jamais trop su, voyez-vous, ce qu’on s’obstinait à fêter à la Saint-Sylvestre, si c’était bon débarras ou bienvenue ! Si on célébrait un enterrement ou une naissance, si on faisait valser dans les bulles du champagne - souvent frelaté- les draps d’un berceau ou les plis d’un linceul.
Optons pour les draps du berceau ou alors ne fêtons rien, me suis-je toujours dit. Car une année qui s’achève, même mauvaise, c’est toujours une année de moins à vivre et c’est profondément triste. Une enjambée supplémentaire, faite de trois cent soixante cinq petits pas, vers une date que seul précisera le hasard ou le destin. Les mathématiques de la vie sont comme les sots, qui sont implacables et rancuniers.
Privilégier le berceau et regarder devant, alors ? Pas sûr d’y voir trop clair pourtant. Le devant fourmille toujours d’espoirs, de projets, de surprises, bonnes ou mauvaises…Laissons venir. Tout ça viendra bien assez tôt ou ne viendra pas du tout, d’ailleurs.
Regarder derrière ? Oui, c’est peut-être mieux. Tournons-nous donc un instant vers l’enterrement, mais sans rien fêter. Mangeons notre lapin en silence, comme dirait le Tenancier. Derrière, au moins, on voit quelques traces laissées dans la neige et la poussière. Devant, la neige n’est pas tombée et la poussière pas déposée encore, alors dans quel discours inscrire sa promenade, sinon dans celui, toujours lénifiant des promesses faites à soi-même ?
En 2011, donc, j’ai mis ou remis en ligne 229 textes et, si j’en crois les chiffres de Hautefort (oui oui, pas de messe ! je sais qu’ils sont à prendre avec précaution mais ils indiquent au moins une tendance) vous seriez maintenant 3000 visiteurs sur l’Exil, alors que vous étiez à peine 2000 au début de l’année. Je vous en remercie, chacun individuellement, et, vous sachant gré de votre fidélité, je me félicite en même temps de la mienne à votre égard.
J’ai publié en juillet Le Théâtre des choses, recueil de 10 nouvelles, à l’enseigne des éditions Antidata, recueil qui, selon Philip Seelen est ce que j’ai fait de mieux jusqu’à maintenant en matière d’édition et, selon son compère JLK, recueil qui est «excellent». Plaisir, donc. Beaucoup de plaisir, eu égard à la qualité du jugement littéraire des deux camarades suisses. Vanité diront les fâcheux et je leur concéderai bien volontiers. Je dirais plutôt satisfaction et fierté personnelles, mais bon, on ne va pas chipoter.
D’autres échos sont venus, Elisabeth Legros-Chapuis, Marc Villemain, Solko (un peu mitigé), Stéphane Beau dans le Magazine des livres, Patrice Revert dans la Nouvelle République…Et des mails privés.
Le livre semble vivre sa petite vie de livre. Je saurai tout ça en fin d’année.
Voilà pour le chapitre des satisfactions. Passons à celui des déconvenues, qui risque d’être beaucoup plus long.
- Grosse déception en février lors d’une brouille violente avec un ami du net, suite à une entorse faite, à mon sens, à la déontologie du net, justement, par un étalage public à peine voilé d’un malentendu privé. J’ai réagi violemment, avec colère, et ce fut sans doute mon grand, très grand tort. Il eût mieux valu régler ça par mails privés. Erreur de ma part, donc, et rupture. Dommage. Il n’y avait pas mort d’homme et j’avais en estime le susdit internaute. Mais si je suis capable de reconnaître les dérapages de mes colères, je souligne que mon ex-copain n’a jamais su reconnaître, ne serait-ce que d’un petit mot, le caractère désobligeant de son intervention. J’ai essayé, beaucoup plus tard, de tendre la main. Sans résultat. Alors, si les coléreux sont des gens en proie à une courte folie, les calmes, eux, sont sans doute de sourds volcans de rancune, ce qui n’est pas beaucoup plus reluisant et même beaucoup moins transparent. Au moins, moi, on sait qui je suis.
Mais je regrette cette brouille.
- La deuxième brouille, plus grave, plus conséquente, et que je ne regrette nullement celle-ci, est celle qui est intervenue en juin entre mézigue et François Bon. J’en ai souffert. A deux niveaux. D’abord parce que la mise en évidence de la supercherie faisait s’écrouler en moi un espoir né en mars 2008 quant à la qualité revendiquée de ce monsieur. Ensuite parce que - même si une quarantaine de mails réclamant l’anonymat sont venus m’apporter, soit leur franc soutien, soit leur compréhension embêtée - le débat sur internet n’a pas été celui que j’espérais. Beaucoup, dont j’estime l’écriture engagée, ont tout simplement fermé leur gueule, alors que le problème soulevé n’était pas, à mon sens, un problème Redonnet/Bon, mais le problème plus général de la fourberie en matière d’édition et d’écriture, donc un problème où chacun, écrivant et lecteur, aurait dû s’engager. Comme quoi on ne s’engage bien souvent que pour des causes qui ne mangent pas de pain et la déception que j’en ai éprouvée est encore vive en moi. A tel point que je ne lis plus que d’un œil distrait les différentes critiques du monde faites par les bloggeurs et autres écrivains, et en chantonnant toujours in petto ces vers posthumes de Brassens :
J’ai conspué Franco, la guitare en bataille,
Durant pas mal d’années,
Durant pas mal d’années !
Faut dire qu’entre nous deux, simple petit détail,
Y’avait les Pyrénées
Y’avait les Pyrénées !
Dans cette brouille, je rends cependant honneur et amitiés à certains, au premier rang desquels Ard et Yves Letort, alias le Tenancier, qui ont opposé à François Bon la force d’arguments véritables, auxquels l’intéressé n’a su répondre que par une fuite honteuse ou des propos scandaleusement désastreux. Tout cela est conservé dans les commentaires, catégorie, «Publie.net, une étrange coopérative».
- Autre déconvenue : le refus par les éditions du Sonneur - seul éditeur à qui je l'ai présenté à part Monti qui n'a même pas daigné répondre - de mon roman, écrit fin 2009, début 2010. Refus motivé par «une lenteur un peu ennuyeuse du récit et une écriture quelque peu obsolète ». Juste critique sans doute, mais étonnante de la part d’une maison sérieuse, bonne, et dont le catalogue est principalement constitué d’auteurs anciens. Ceci étant dit, je rends fraternellement honneur à Marc Villemain - de ces éditions du Sonneur - Marc, qui, par ailleurs apprécie mon écriture - de ne pas avoir fait jouer le copinage, dont il a horreur et dont il sait que ce genre de pratique me révulse.
Pas certain que d’autres que lui ou moi auraient eu tant de scrupules. Mais bon...
Je viens donc de retravailler ce long roman, lent et obsolète…A qui vais-je le proposer ? Je n’en sais rien. Tout ça se fera sur un coup de tête, comme d’hab, ou ne se fera pas.
Mes engagements successifs pour une transparence dans l’édition où l’auteur ne serait pas méprisé par un silence dont il se fait complice, m’ont évidemment fermé pas mal de portes. Je ne suis pas de ceux qui font les omelettes virtuelles sans casser les œufs.
Sinon, ce roman, je vous l’offrirai peut-être gratuitement ici, tenez, si je n'ai pas le goût de fouiller dans les adresses d'éditeur ! Ah, sainte gratuité ! Générosité ! J’ai abordé, tout dernièrement, le problème de la gratuité des blogs. Je vous invite vraiment à lire ici, dans les commentaires, la réponse que vient de me faire Stéphane Beau. Très juste. Et nous, bloggeurs, n’avons pas à faire les fiers et à critiquer le monde avec notre pédanterie…Vraiment pas.
Voilà... Ah, j'allais oublié, la souscription. On se dirige tout droit vers un bide ridicule : 18 souscripteurs, que je remercie quand même. Une idée qui finira donc bientôt, très certainement, au chapitre des morts-nés. Coléreux, moué ? Oui, mais aussi et quand même indécrottable naif !
Que te souhaiter, cher lecteur, pour cette nouvelle année qui n’aura sans doute de nouveau qu’une parcelle nouvelle de la fuite du temps ?
Je te souhaite ce que tu souhaites, simplement, et si tu ne souhaites rien, si tu préfères sagement laisser et voir venir, au feeling, je te souhaite quand même ce qui, de plus en plus de façon négative constitue dans nos sociétés, le bonheur : l’absence de tourments et de souffrances, morales ou physiques. Qui que tu sois et quels que soient les sentiments que tu nourris à mon égard.
Amitiés
Stats du 31 décembre :
| Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) |
|---|---|---|---|---|
| 3086 | 10 204 |
29 863 |
963 / 9 824 | 329 / 992 |
10:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.12.2011
Quand ?

C'est là-bas qu'on s'en va. D'aucuns disent qu'il n'y a rien où on s'en va. D'autres disent que si, qu'il y a comme une blancheur qu'on appelle, faute de mieux, l'éternité. D'aucuns et d'autres disent des conneries. Parce qu'ils ne savent rien. Comme moi, comme toi, comme nous, comme vous. Et quand on dit des choses là où on ne sait rien, forcément, on dit des conneries, des bouts d'idéologie, des queues de convictions toutes faites, des trucs qui font intelligent, des récitations qu'on croit avoir soi-même composées.
Nous sommes comme les renards de la forêt de Benon. Nous pissons notre verbe sur tout ce que nous trouvons, attestant ainsi que nous sommes passés par là et que nous y étions chez nous.
Bon, d’accord, me diras-tu, ça je le savais déjà, mais le renard, lui, qui lève la patte sur les fûts forestiers, sait-il qu’il va mourir ?
S’il faut en croire Malraux, qui a fait par ailleurs, sinon écrit, pas mal d'âneries, non, le renard ne sait pas. Parce que l’homme est la seule créature qui sache qu'elle est mortelle.
C’est beau. Comme toute chose invérifiable et balancée gratuitement.
Mais le rat ?
Je me suis laissé dire que suspectant un relief empoisonné, les rats envoient d’abord le vieillard de la bande. Pour qu’il goûte. Un certain temps d’observation s’étant écoulé, si le vénérable patriarche n’est pris d’aucun vomissement, saignement du museau ou autres convulsions préfigurant la mort, alors le reste de la horde se met en appétit.
Il paraîtrait aussi que pour traverser des égouts, ce peuple, grand pontier s’il en est, construit une passerelle grouillante, les plus vieux au fond, servant de bases, puis, ainsi de suite, par ordre décroissant, les moins jeunes, les jeunes et les enfants invités enfin à passer sur l’autre rive, sur le dos des aînés. Si tout le monde se dépêche et s’il n’y a pas trop de cohue, même les premiers, au fond, les ancêtres, s’en sortent. Sinon.
Ce n’est jamais très rigolo d’être vieux. Mais ça le semble encore moins chez les rats.
Cet instinct de conservation de l’espèce est bien lié, sinon à une conscience, du moins à un certain pressentiment de la mort.
Non ? Bon.
Alors, laissons-là les rats et revenons-en aux hommes.
Claudel, pourquoi écrivait-il donc ? Il n’avait pas peur du trépas, celui-là. Il était même persuadé que c’était la porte ouverte sur la béatitude accomplie. Ou alors il faisait semblant, le fourbe. Comme Mauriac et tant d’autres, plus illustres et savants écrivains, révérence parler.
Si mon poncif de départ est juste, c’est que les hommes feignent de croire en Dieu. S’il est faux, alors, ils n’ont pas besoin d’écriture, ni même de tout autre forme d’art.
Je sens que tu m’en veux d’être aussi réducteur. Peut-être même me trouves-tu sot.
Pourtant, moi qui ne suis ni un rat, enfin je ne crois pas, ni Claudel, ça j’en suis sûr, si je n’étais pas un peureux, un peureux amoureux transi de cette belle terre et des hommes, je n’essaierais pas d’écrire, je ne composerais pas sur ma guitare, je n’arrangerais pas des chansonnettes.
Je m’en foutrais de pisser ma mélancolie sur le tronc des chênes. Enfin, peut-être que je ferais tout ça, mais je ne chercherais pas d’éditeur, je ne ferais pas de scène, ni même ce petit blog.
J’ai laissé un frère, en France. Il est aussi mon ami. Il fait des meubles, lui. Il joue à faire de beaux meubles, avec du vrai bois qui sent la forêt et les chemins fangeux. Quand ils seront vieux, ses meubles, ils ressembleront au buffet de Rimbaud.
Il ne cherche pas de vitrine où mettre ses poèmes. Ils sont pourtant fort élégants. Il doit savoir qu’ils vivront longtemps. Je crois qu’il a peur aussi.
Si je dis ça, c’est que j’ai regardé par la fenêtre, vois-tu. J'ai trouvé la forêt et la neige et le silence et le ciel au-dessus qui faisait le mélancolique, très beaux.
Je n’ai vraiment pas envie d’être privé de tout ça, un sale jour. Ce ne serait pas juste.
Je n’ai rien fait pour mériter de ne plus voir, de ne plus sentir, de ne plus aimer, de ne plus espérer, même ne sachant pas ce que j’espère.
L’exilé a toujours peur de crever trop loin de sa tombe.
Ne dis pas que je dis des bêtises, je te prie. Ou alors admets, à ce stade de notre page, que tu aimes lire des bêtises. Toi aussi, tu as peur, peut-être ?
Les hommes sont des prétentieux, tu sais. Ils ne brassent pas assez d’évidences. Ou alors pas les bonnes.
Si j’étais un rat, je serais encore plus rebelle.
Je déserterais sans vergogne tous les diktats de l’ordre social.
C’est que je suis un peu vieux, sans doute.
09:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.12.2011
Polska B dzisiaj - Extrait-

Le jaune des bouleaux, le vert des pins et le rouge des chênes se disputent la vedette. Une huile au couteau. Une palette épaisse et si rude qu’il faut prendre du recul, sortir un peu de soi pour en goûter tout le langage. Pas comme cette aquarelle subtile de nos rivages où les vapeurs océanes diluent les couleurs et liquéfient la lumière qui ruisselle dans l’espace vide d’entre les choses, mais aussi sur ces choses elles-mêmes et sur nous-mêmes. Les paysages de bords de mer fusionnent le spectateur et le spectacle dans un même flux réfléchissant le monde.
Les paysages continentaux, eux, sont plus extérieurs, modelés par la terre et par une intelligence rustique entre les arbres. Le bouleau est un pionnier. Il arrive le premier au gré d’une saute septentrionale du vent et il dit que c’est là qu’il faut planter une forêt, que le sol est riche et que le sable est assez stable.
Le Polonais est un forestier. Il sait lire entre les troncs. Il souscrit aux indications du bouleau et plante là les pins qui feront des maisons, des granges, des fermes et des clôtures. Les forêts de l’est sont des gisements pour bâtisseurs.
Mais le chêne rouge a observé tout ce manège. C’est un erratique, un apatride, on ne veut pas trop de lui ici, trop lent, beaucoup trop flâneur dans sa croissance. Alors il s’incruste, passager clandestin des essaimages, magistral parasite des sylvicultures, arbre de proie.
Tout ce muet panachage de l’éclaireur du nord, du pin de construction et du bel intrus sans papiers, accompagne de lumière la route où cahote un cheval. Il est attelé à une sorte de carriole étroite tout en longueur, avec deux essieux, celui de l’avant savamment articulé. Deux sacs de blé dur y bringuebalent. Ils s’y promènent exactement. Derrière la carriole, piaffe le Renault flambant tout neuf d’une société ouverte au soleil couchant, PTAC quarante tonnes, en route vers la construction des paysages nouveaux, un demandeur d’autoroutes, un qui n’aura que faire de la lecture des bouleaux. Les époques ici se côtoient sans s’agresser, ne se poussent pas du coude, se superposent comme les sédiments de la géologie, se font des signes, sans moquerie, sans marque de supériorité et sans dédain. On sait bien que tout ça, ça va, d’accord, mais que ça peut venir aussi et on a l’air de penser qu’on ne sait pas trop bien qui, du cheval ou du Renault PTAC quarante tonnes, est finalement à contretemps.
Les champs sont immobiles.
On dirait que personne ne vient les éventrer et les bousculer dans leur torpeur. Ils sont comme des trapèzes, c’est pas pratique, un trapèze. Ils sont comme des triangles, ça a des angles aigus difficiles à investir, les triangles. A des quadrilatères difformes et sans angles droits, qu’ils ressemblent parfois. Rarement, très rarement, ils sont ces rectangles pragmatiques des grandes cultures de l’ouest et qui, vus d’avion, dessinent si bien la terre en un jardin impeccablement entretenu, un jardin à la française.
Nous sommes en route pour Janow Podlaski. Par association d’idées contraires, un vieux copain oublié depuis quelque trente années déjà, surgit dans ma mémoire tandis que je regarde ces champs silencieux qu’on dirait bien que ce sont les arbres qui commandent ici et pas eux, les champs. La lisière des bois dessine celle des cultures. Pas l’inverse. Mon copain un peu agriculteur, raisonnablement écolo, passablement anar, résolument fêtard, superbement enjoué et terriblement humain, c’est au sud qu’il habitait, sur la plaine toulousaine bousculée par le vent d’autan, le vent qui rend fou.
Il cultivait le maïs sur des terres qu’il avait en location. Mais tout le monde ici cultivait du maïs. La plaine immense n’était qu’un affligeant tapis de maïs. Alors je lui demandai un jour comment il faisait pour retrouver ses billes dans cet océan monocorde, monochrome, monopoliste, monozygote, monotone, mono tout de maïs. Il dit que c’était simple : il semait et récoltait toujours le dernier. Quand tout le monde en avait terminé, quand cette vaste étendue enfin mise à nue sous les désolations de novembre ne présentait plus qu’une parcelle ridiculement isolée en son beau milieu, c’est que c’était forcément à lui. Ce qui restait. Je crois qu’il a fait faillite.
C’est ce que font forcément les hommes qui, sous nos cieux, n’entendent rien à l’hégémonie des vastes jardins.
A intervalles réguliers, nous doublons une vache attachée à un pieu. Elle broute l’herbe du fossé à grands coups de langue râpeuse. Elle a de lourdes plaques de bouse séchée sur les cuisses et deux os saillants de chaque côte de la queue. L’herbe du fossé est à tout le monde et les champs sont trop maigres. Ou alors le propriétaire de la vache n’a pas de champ. Toute sa richesse est là dans cette vache en fragile équilibre sur un talus. C’est sa crèmerie. Son lait, son beurre, sa crème fraîche et sa raison de vivre au quotidien quelques heures qui lui sembleront utiles. Je pense aux stabulations, aux productions industrielles du lait, aux quotas, aux politiques de Bruxelles, aux prophylaxies vétérinaires et aux farines carnées.
D me dit qu’il y a quelques-uns de ces grands troupeaux dans la région, les fermes d’état de l’époque communiste prestement reconverties en entreprises privées. Le plus souvent par un ancien directeur qui a mis son savoir-faire au service du nouveau vent. C’étaient de vastes coopératives, moins rigides quand même que le kolkhoze.
Je regarde ces champs silencieux, ces quelques vaches éparpillées une par une pour quelques litres de lait familiaux, des vaches du néolithique. Je regarde ces arbres en feu de la forêt panachée, ces maisons en bois exactement comme je m’imaginais les isbas et ces vieilles femmes accroupies devant qui nous voient passer d’un œil évanoui et je me dis que j’ai devant moi un monde qui a connu mes espoirs frelatés de jeune lycéen, un monde qui a vu le communisme et qui n’en dit pas plus que ça.
Ces vieilles femmes-là ont vécu Staline. Je me demande ce qu’elles en pensent, de leur jeunesse. Le dictateur disait que vouloir installer le communisme en Pologne, c’était vouloir mettre une selle à une vache. Se sont-elles laissées seller, ces vieilles dames ? Etaient-elles des rebelles ou des communistes ? Ou bien s’en foutaient-elles de tout ce charabia et qu’elles ont simplement vécu leur vie de femmes polonaises de l’est, à cheval sur deux mondes, la terre sous leurs pas encore tout tremblante et tout fumante des grands tumultes de l’histoire ? Que savent-elles de notre automobile qui passe et du monde qui leur a échappé ? Elles ne sont probablement jamais allées plus loin que le bout de cette rue ou la profondeur de ces champs, mais elles sont allées où je n’irai jamais.
En sont-elles vraiment revenues ?
J’ai souvent dit qu’ayant marché à l’envers, d’ouest en est, je goûtais ici les charmes succulents d’un retard accumulé sans avoir eu à en souffrir les désagréments, le pays bouclé derrière le rideau de fer et fermement bâillonné, les étalages quasiment vides, juste pourvus du strict nécessaire, même si je sais que la dérive communiste a été un peu moins tyrannique ici que dans les autres pays du pacte de Varsovie. L’agriculture, par exemple, n’y a pas été entièrement collectivisée. Les petits paysans y avaient gardé leur maigre lopin en propriété privée et ils y ont vivoté tant bien que mal. En autarcie, sans doute. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Norman Davies dans son histoire de la Pologne en donne quelques explications qui ne me satisfont pas entièrement. Il dit par exemple qu’on peut conduire un Polonais jusqu’à la rivière mais qu’on ne peut pas l’obliger à y boire de l’eau. Et un Tchèque alors, ou un Roumain ? Peut-être parce qu’on ne met, effectivement, pas une selle à une vache. La métaphore de Staline était pourtant à caractère on ne peut plus méprisant.
Je trouve donc cette campagne polonaise pas encore aplatie par le rouleau compresseur des productions hystériques, belle. Parce qu’elle ressemble à la campagne de mes premières années, à mon berceau, avec une agriculture vivrière, des petits champs clôturés de haies, des chevaux, des volailles à l’épave et des gens nonchalants. Je la ramène à moi, à mes nostalgies, à la recherche de mon temps perdu. C’est immoral peut-être. Mais à tout bien considérer, ça ne veut rien dire quand je parle de retard aux charmes désuets. C’est quoi le retard en économie ? Le retard sur quoi ? Sur des plaines réduites au silence des oiseaux par des fous furieux qui arrachaient il y a quelques années encore tout ce qui entravait d’un centimètre l’envergure de leurs semoirs et qui réclament aujourd’hui qu’on les paie pour replanter des haies ? Le retard sur une récolte faramineuse de tonnes et de tonnes de céréales poussées sur des engrais, tellement d’engrais que le sol n’est plus qu’un support relatif, qu’il pourrait tout aussi bien être du carton, du papier, du bois pourri, de la merde de chat, pourvu qu’il soit malléable ?
Mon voisin paysan dit qu’il récolte bon an mal an, trente cinq, quarante quintaux de blé à l’hectare. Il en cultive sept.
J’ai la bouche bée comme un âne bâté.
Quarante quintaux, c’est pas bien ? qu’il dit, mon voisin un peu vexé.
Je dis que les exploitants agricoles de France, du moins ceux de la côte atlantique, parviennent à quatre vingt dix, voire cent quintaux.
Il rigole. Il me prend soudain pour un hâbleur qui aurait la nostalgie de son pays et qui verrait tout en rose des choses de là-bas.
Je persiste et j’enfonce le clou : En plus, ils ont au moins chacun cent hectares à moissonner. Ça, j’en suis pas sûr mais j’annonce de gros chiffres pour qu’il mesure le schisme qui le sépare de ses soi-disant collègues de la famille européenne.
Mais qu’est-ce qu’i font de tout ça ?
Du savon, de l’huile, du rouge à lèvres, des crèmes.
Tes gorets en crèveraient de bouffer leur richesse.
Alors, en retard sur quoi ?
Du retard parce qu’il n’y a pas d’autoroutes ? Immoral jusqu’au bout, que je suis, parce que j’espère qu’il n’y en aura jamais, d’autoroutes. Ça fait hurler d’indignation Marian, un copain francophone et pourtant francophile convaincu. Un égoïste, que je suis ! Parce que, nous, à l’ouest, on a construit des milliers de kilomètres d’autoroutes qui ont détruit des bois, des vallons, des marais, des vallées, des écosystèmes, sans être emmerdés et maintenant qu’on a à peu près fini, on pond des normes, on pond Natura 2000 et on nous empêche de nous équiper convenablement !
C’est un peu vrai…
C’est une question d’arriver à l’heure ou pas au rendez-vous des grandes prises de conscience collective.
In petto, ça me fait penser, sur une échelle sans commune mesure, aux pays qui ont fait péter des bombinettes à tout va pour leurs essais nucléaires, un peu partout dans le monde, Mururoa pour la France, des pays qui ont bien empoisonné pour des milliers d’années leur coin de terre, et qui, une fois bien mises au point leurs armes apocalyptiques, ont tout d’un coup crié aux autres : Stop ! On arrête de jouer avec cette saloperie, c’est trop dangereux, vous ne savez pas faire, vous n’êtes pas adultes, vous en feriez mauvais usage !
Parce que nous, superpuissances nucléaires, c’est pour en faire bon usage ?
C’est pour nous défendre.
Ah ? Et les autres, ils peuvent pas se défendre ?
Personne ne les attaque.
Ah bon ? Et nous, on nous attaque ?
On pourrait nous attaquer.
Avec des fourches alors, ou des manches de pioches.
C’est ce qu’on appelle l’équilibre mondial.
Je ne réclame pas qu’on généralise l’arme nucléaire. J’aimerais que personne ne l’eût jamais eue.
Pour en revenir à l’indignation de Marian, je dis quand même que j’espère simplement que le développement sera ici plus intelligent que chez nous parce qu’il aura su lire nos erreurs. Farouche, il poursuit que nous avons eu le plan Marshall, nous autres. Eux, ils risquaient pas de l’avoir. Marshall reconstruisant Staline….La Pologne est pourtant le pays au monde qui a payé, au niveau de la destruction humaine et matérielle, le plus lourd tribut à la guerre.
Des autoroutes pour quoi faire ? Pour aller où ?
Il me semble que je suis déjà au bout d’un monde et il est trop tard pour être au commencement d’un autre.
Et puis le retard, il est ailleurs.
Il est dans les têtes et il surgit par les regards. Il est un retard de vaincu par les chaos de l’histoire. Plus grand-chose à attendre des hommes, ici. Alors on se tourne vers le ciel.
Qui en prend à son aise.
Qui aplatit lesdits hommes face contre terre.
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.12.2011
Souscription
 J’ai une idée. Deux plutôt.
J’ai une idée. Deux plutôt.
Elles trottent dans ma tête depuis longtemps. Et quand des idées trottent comme ça sous les cheveux, avant qu’elles ne se transforment en obsessions, de deux choses l’une : ou il faut tenter de les réaliser, ou il faut les abandonner.
Je vais donc me servir de L’exil des mots pour vous en dire deux mots, de ces deux idées.
Après avoir réuni tous les textes de ce blog dans un seul manuscrit, j’ai isolé dans un deuxième manuscrit les textes ayant uniquement trait à la Pologne : états d’âmes, paysages, événements, considérations, pérégrinations, culture, etc.
Je les ai retravaillés. Je les ai peaufinés. J’ai rajouté parfois, d’autre fois j’ai retranché. J'ai épuré.
Le manuscrit fait actuellement 160 pages, soit 400 000 caractères. Environ.
L’idée m’est donc venue d’inscrire tout ça dans la pierre et de faire de ce deuxième manuscrit, un livre.
En Pologne, les imprimeurs réalisent vraiment de très beaux ouvrages, méthode offset ou numérique, et le coût défie toute concurrence par rapport aux prix pratiqués en France. Un euro vaut entre 4 ou 4, 50 zlotys.
Impression offset, couverture cartonnée et les frais d’envois (envois individuels) s’éléveraient à 8000 zlotys à peu près, soit 2000 euros. Pour info, l'expédition d'un livre vers la France vaut 25 zlotys.
Je lance donc une souscription à 20 euros et si j’atteins les 100 souscripteurs, dont moi-même, j’y vais.
Et cette expérience me servira de tremplin expérimental pour l’autre idée. Mais sans souscripteurs, cette fois-ci. Cavalier seul et pignon sur rue.
Ce qui m’augmente le coût, c’est que je ne veux tirer qu’à 100 exemplaires, subodorant que je n’aurai, dans le meilleur des cas, pas plus de souscripteurs. Ce serait déjà énorme ! Si je tirais à 500 exemplaires, le prix serait à peu près identique, mais que faire de 400 bouquins dans des cartons ? Ma maison est petite !
Voilà, vous savez à peu près tout. Me donner, je vous prie, votre accord de principe, en privé, adresse de ce blog ou adresse perso pour ceux d'entre vous qui l’ont. Je dis accord de principe car la souscription peut être revue à la baisse si le devis réel pour 100 exemplaires s’avérait être inférieur à celui que j'ai déjà en mains, établi pour un manuscrit de 1 500 000 caractères. Car il va sans dire - mais je le dis quand même - que je n’entends produire absolument aucun bénéfice sur ce projet. Seulement un immense plaisir - que j’espère partagé -, ce qui serait déjà beaucoup, beaucoup… D'ailleurs chaque souscripteur recevrait, sous le même pli que son livre numéroté, la facture détaillée de l'imprimerie.
Peut-être le prix d'un exemplaire descendra-t-il autour de 15 euros. Oui je sais, c'est encore cher. Et si j'optais pour une impression en numérique, comme le font la majorité des éditeurs, je diminuerais le coût de moitié, mais c'est là une expérience unique et je voudrais bien une qualité irréprochable. A voir.
Et si ça n’intéresse personne ou pas assez de monde, hé ben, il n’y aura pas offense, j’abandonnerai l’idée - les deux idées même - et je passerai à autre chose. Au moins, j'aurai la satisfaction d'avoir essayé.
Ce que je puis vous assurer, c’est que le livre serait beau.
Je précise aussi que le nom des souscripteurs, soit serait imprimé en fin d’ouvrage pour ceux qui le désireraient, soit serait tu pour ceux qui m’en feraient la demande.
Mis en ligne le 17 décembre. A ce jour, 15 souscripteurs...La route sera longue.
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.12.2011
La nuit du voyageur
Trouvé dans mes cartons un manuscrit, tapé à la machine, écrit en 1989, aux Contamines Montjoie. J’en extirpe ici le prologue. Le reste est écrit au vitriol et ne correspond plus vraiment à mes frictions au monde, parce que rien n’est venu en vérifier le bien-fondé. Une pierre abandonnée sur le chemin.
On reconnaîtra aisément de quelle œuvre la première phrase est un détournement. Mais que de temps passé à passer le temps !
LE PROLOGUE
Quand le voyageur atteignit l’âge de cinquante ans, il revint vers son pays natal et vers la rivière de son pays natal.
Le soleil devant lui plongeait derrière un horizon restreint par les mélancolies silencieuses des ormes géants. C’était au jour finissant, à l’heure où les ombres en s'allongeant commencent à trembler.
Un à un des vieillards, puis des hommes, puis des femmes, puis des enfants s’extirpaient des maisons basses et venaient en silence jusqu’au chemin empierré et, tous, de leurs yeux froncés par l’effort et le doute, tâchaient de deviner cette longue cape brune qu’un vent léger faisait flotter, ce large chapeau noir qui balançait au rythme de la marche et ce bâton qui frappait la cadence, par-delà la rivière, sur le coteau pentu, juste avant le pont.
Qui pouvait vouloir ainsi venir vers eux, à l’heure où les ombres en s’allongeant commencent à trembler ? D’ailleurs, la silhouette incertaine venait-elle vers eux ? Passerait-elle le pont ? Enjamberait-elle la rivière ou bien longerait-elle l’autre rive, pour disparaître dans les grands bois qui, plus loin, sur l’aval, avaient depuis longtemps englouti la prairie. Des bois où l’on n’allait jamais. Anonymes. Obscurs. Secrets. Mauvais.
Mais la fébrilité agita soudain les yeux des villageois. Car nul doute à présent : la forme brune, après avoir franchi le pont, montait bien vers eux, et le bâton qui soutenait sa marche frappait la pierre du chemin avec le tempo régulier de la direction préméditée.
Qui pouvait vouloir ainsi venir vers eux, à l’heure où les ombres en s’allongeant commencent à trembler ? Quelque bohémien en maraude ? Quelque chemineau, quelque voleur, quelque criminel fraîchement sorti d’un cachot de la ville et en quête d’un abri pour la nuit ? Pire : quelque illuminé porteur d’onctueuses pommades ?
Dans la petite foule, des poings osseux se refermaient maintenant et des coups d’œil cauteleux, tout empreints d’une sournoiserie peureuse, se tournèrent aussi vers les granges, où sommeillaient des outils contendants… Mais l’homme en noir s’arrêtait déjà à une vingtaine de pas, d’où son regard rencontra celui des villageois.
Un regard vidé de la substance même des yeux. Un regard anéanti. Un regard qui, dans une sorte de morosité sublime, ne semblait appartenir qu’à lui-même, comme s’il vivait en dehors du visage. Dans ce regard-là, qui fit frémir d’effroi, femmes, hommes, enfants et vieillards, se balançait le chaos tragique et muet des fous.
La petite foule, dans un murmure de stupeur, reconnut ce regard.
- Le voyageur est de retour…
Les enfants levèrent la tête vers les yeux morts, les femmes serrèrent plus fort le coude de leur homme, les vieillards baissèrent les paupières, en souvenir brutal du temps qui passe. L’un d’eux s’avança enfin et tendit une main qui ne tremblait plus :
- Voyageur, la rivière et le village de ton pays natal se souviennent.
Trente années après avoir franchi le pont, tourné le dos à la rivière, en ne te retournant qu’une seule fois pour nous couvrir de ton mépris, de quels horizons, de quelles contrées, de quelles aventures, nous reviens-tu ce soir ?
Vois comme nous avons passé ! Vois comme tes compagnons de jadis sont devenus des hommes de l’automne, qui donnèrent au village des enfants qui eurent à leur tour des enfants !
Et le bras maigre du vieil homme, d’un mouvement circulaire en arrière, montrait la petite foule agglutinée dans son dos.
- Voilà trente ans, répéta le vieillard, que tu déchiras les draps qui protégeaient ton enfance et insulta nos habitudes. Inexorables, les saisons qui passent t’avaient chassé de notre mémoire. Jusqu’à ce soir, au contact de ton regard désolant.
Le vieillard se tut et une saute de vent fit frissonner les banches d’un noyer.
- Dans ton accoutrement d’un autre temps, il y a quelque chose qui respire comme la mort.
- Ce ne sont ni mes vêtements, ni mon allure qui ressemblent à la mort, vieillard, ni même le souvenir qui s’agite en toi et te mesure la fuite du temps, mais la façon que tu as conservée de voir tout ce qui t’est étranger.
Tu souffres d’immobilisme,villageois, et ce n’est pas le noir qui t’effraie. C’est le mouvement.
09:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.12.2011
Saisons de la mémoire

C’était en septembre. En route, nous avions demandé sa direction dans une petite ville, sur une petite place, sous une petite pluie, avec un petit vent du nord. On nous avait indiqué en prononçant le nom comme on aurait dit Ruffec ou Mansle, ou Couhé-Vérac, ou Mauzé. J’avais imaginé qu’on allait trembler en prononçant ce nom. J’avais imaginé qu’on allait nous jeter un drôle d’air.
Nous sommes venus.
Rien dans du tout. Un vide par-delà le vide. Comme quand on voit beaucoup plus loin que ce qu’on voit mais qu’on ne peut pas dire ce qu'on voit.
- Pourquoi on est là ? demande l’enfant.
Je ne sais pas répondre. C’est ce qui m’a anéanti. Pas un mot qui veuille donner une explication. Nous sommes là pour trop de choses.
Pour la première fois, les paysages m’ont fait peur. Avaient-ils le droit d’être calmes, d’être beaux, de taire ce qu'ils avaient vu et entendu ? La forêt avait-elle le droit de pousser là ? Et cette clairière si jolie, si sereine...Je savais bien qu’elle était immonde. Une clairière qui a servi l'enfer peut-elle rester une clairière ?
L’enfant trouvait qu’elle était reposante. Elle aurait aimé y jouer un moment. Avec l’enfant, nous ne sommes pas à la même saison de la mémoire.
Et moi, auparavant, je pensais qu’il n’existait pas, cet endroit. Je pensais qu’il n'était gravé que dans l'Histoire, comme une métaphysique de la douleur et du pire. Qu’il n’avait pas de géographie. Qu'il n'y avait pas de géographie pour dire ça.
L'enfant me regarde, voit sans doute qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au fond des yeux. L'angoisse lui vient.
- Pourquoi on est là ? répète-t-elle.
Nous étions à Treblinka. Là où Dieu et les hommes ont définitivement cessé d'exister.
11:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.12.2011
Mais qui n'a jamais été compromis à être écouté par des imbéciles ?

Il est beaucoup question de vanité en ce moment, après l’intervention de Sophie sur mon initiative de souscription et avec le texte magistralement publié ce matin par Roland Thévenet sur son Solko.
C’est la raison pour laquelle, vaniteux comme un pou, j’ai cité une interrogation-affirmation du Zarathoustra de Nietzsche en guise de titre, citer Nietzsche étant depuis longtemps - depuis que la bêtise a force de loi - un trait majeur de la vanité intellectuelle.
Que je précise tout de suite que la citation vaniteuse ne s’adresse nullement aux gens qui se sont exprimés sur mon outrecuidance à lancer une souscription. Ceux-là ont dit sans me compromettre et même plus : en faisant évoluer mon point de vue.
La citation est donc un rempart, un vaccin, contre ceux, éventuels, qui trouveraient que je chipote souvent sur les sous et la rémunération des auteurs et qui, donc, pourraient être tentés d’en conclure assez vite que je ne pense qu’à ça.
Je leur oppose, d’emblée et plaisamment, que si je ne pensais qu’à ça, je serais vraiment le dernier des imbéciles, parce que ne pas réussir à obtenir une queue de radis en cinquante ans tout en ne pensant qu’aux radis, dénoterait quand même une certaine bêtise, voire un certain handicap à. Les sous, c'est un peu comme les champignons, si vraiment on veut se donner la peine d'aller les chercher là où ils se cachent, on en trouve partout.
De ces sous, donc, j’en ai pour assurer ma survie. Si j’en avais un peu plus, je voyagerais un peu plus et je ferais plus de cadeaux aux gens que j’aime, mais bon…J'ai passé l'âge d'aller aux champignons. Disons que le moyen n’est jamais rentré dans ma cervelle en tant que fin.
En revanche - et c’est toujours la même conversation - j’ai horreur, comme tout le monde sans doute, qu’on me prenne pour un imbécile et que, subodorant mon non-amour de l’argent, on en profite pour me voler le peu auquel je pourrais prétendre.
La question des droits d’auteur sur lesquels 80 pour cent des éditeurs font l’impasse et 99,99 pour cent des auteurs silence, me révulse donc et me révolte, non pas à cause de ces sacrés sous, mais à cause d’un jeu de poker menteur, où les cartes sont biseautées par tout le monde et comme une tricherie vis-à-vis du public lecteur.
En gros, le deal tacite se présente en ces termes : je te publie, t’es content, je ne vais pas, en plus, te récompenser d’être content ! Vous pensez que j’exagère ? A votre guise…Mais je parle là de vécu, pas d’hypothèses, et je défie quiconque de venir, preuves à l’appui, me contester la véracité de ce vécu.
Si vous avez à cœur de vérifier, posez donc à un auteur la question suivante : alors, tu en es où de ton livre ? Il vit bien ? T’es content ?
A de très rares exceptions près, vous vous entendrez répondre : j’en sais rien, j’en sais rien…J’ai pas de nouvelles.
Désastreux.
Mais il y a bien pire. On fustige, on méprise, on dédaigne, on vilipende, on prend de haut, on toise les publications à compte d’auteur. Suprême hypocrisie !
Car un éditeur, celui que j’avais par exemple, et non des moindres mais un des plus cotés sur la place, un des meilleurs et un des plus sympathiques, vous retire 300 exemplaires de franchise, sans aucun droit. Pour quoi faire ? Ben, pour payer la fabrication, en partie ou en totalité, du livre, tiens, benêt !
Et vous appelez ça être édité à compte d’éditeur, vous ? Et l’auteur, fiérot, en reniflant et en faisant une moue suffisante, vous dira : je suis édité chez machin. Ah, bravo !
Ben oui , mais bravo de ne pas dire la suite, surtout.
Et j’évoque là un des meilleurs cas de figure : celui où l’auteur a un contrat. Parce que si vous saviez le nombre d’écrivains qui acceptent, la tête basse et la queue entre les jambes, d’être édités sans contrat, vous tomberiez peut-être sur le cul ! Peut-être liriez-vous son bouquin avec d'autres yeux, même, à moins qu'il ne vous y dise, clairement, qu'il est un menteur.
Les dés sont donc pipés. Tout le monde falsifie, auteurs et éditeurs…Et quand vous entrez dans la librairie pour acheter un bouquin à 15 euros, demandez-vous donc deux minutes dans quelles poches vont s’éparpiller ces 15 euros. Une certaine éthique de la lecture commande qu’on se pose cette question. Surtout quand on sait que les petits éditeurs comme celui que je viens d’évoquer sont à la peine, que les libraires en voient de toutes les couleurs, que les distributeurs se plaignent d’une baisse tendancielle de leur taux de profit et patati et patata...
Oui, et alors, qu’est-ce que tu en as à foutre de tout ça ? que j’entends murmurer dans mon dos. Tu écris, c’est ton plaisir, tu es lu, et le reste, ma foi…
Juste un mot que je répondrais : on ne construit pas de jeu social plaisant et riche d’esprit sur des montagnes de falsifications. Et ce n’est donc pas les quelques misérables euros que je pourrais glaner ci et là, et qui ne changeraient rien à ma vie, qui me font défaut, mais la fausseté du rapport humain dans une activité qui m’est chère et que, naïvement, à soixante printemps, j’avais pris pour une activité noble. Retrouver dans cette activité les mêmes filouteries, les mêmes sournoiseries qui font une bonne part du mal vécu dans le travail salarié, me donne envie de gerber.
Est-ce qu’un ouvrier, un employé de bureau, un menuisier, qui aimerait son métier, qui, en l’exerçant trouverait du bonheur, travaillerait pour autant sans toucher un traître sou ? Allons, allons, soyons sérieux !
Et comme je suis en porte-à-faux quand je dis tout cela ! Car les arguments qu’on m’a opposés dans ma bagarre furent : ah, ces anarchistes, qui réclament des contrats ! Ben, oui…Facile…Moi je veux bien, au contraire, ne pas avoir de contrat, pas un kopeck, pas un relevé, rien. Mais dans une société organisée fraternellement sur les sentiments anarchistes. Pas dans une société bancale et de marchands pataugeant dans la merde ! J'ai donc répondu que "je n'acceptais les remontrances sur mon éthique anarchiste, que si celles-ci émanaient de gens moins compromis que moi dans un modus vivendi avec le bloc social."
Je ne vous ai pas parlé de François Bon. Je n’en ai que trop parler : avec lui, c’est la révolution de soie. On change de support, on appelle des porte-soie, et on pratique les mêmes âneries avec le contraire de ces âneries comme slogan…Il me doit toujours 75 euros, chiffre officiel. Ça va bientôt devenir mon Delenda Carthago.
Avec tout ça, hé ben voyez-vous, je me retrouve Gros-Jean comme devant. Je n’ai plus d’éditeur - Antidata n’édite que des nouvelles - et j’ai une flemme énorme, un dégoût même, à en chercher un autre. Le roman qui traîne dans mes tiroirs n’a été présenté qu’à un seul éditeur. C’est tout. Démotivé. Incapable de trouver l’énergie pour minauder avec mon chef-d’œuvre sous le bras. Mais ça reviendra, ça reviendra peut-être. Si je retrouve le goût de la vanité.
Et quand je me rase le matin en pensant à tout ça, je vois une gueule attristée, mélancolique même, qui se demande parfois si j’ai bien fait de mettre les pieds dans ce plat, que je me suis privé de beaucoup de choses que j'aimais, mais une gueule encore propre. La propreté, ça coûte très cher. Mais vous le savez aussi bien que moi. Je n’en doute pas.
Tout cela, donc, nous amène à une certaine gratuité acceptée par l’auteur. J’ai bien dit acceptée. Pas revendiquée. Si elle était revendiquée, ça changerait toute la donne.
Comme sur ce blog…Parce que les blogs, c’est gratuit. Et on y lit tous les jours gratuitement. De tout : des poèmes, des nouvelles, des critiques littéraires, des états d’âme, des analyses du monde en guerre ou des dénonciations de scandales financiers. Tout ça, sans débourser un centime. Générosité ?
Hum…J’aurais attendu le Grand soir pendant quarante ans, j’aurais même, des fois, essayer de le pousser au cul pour qu’il arrive plus vite et il serait arrivé, là, sous mes yeux endormis, sans que je m'en sois aperçu ?
Doit y avoir une erreur. Ou alors faut que je recommence à boire, histoire de voir plus loin... Cette générosité n’est peut-être en fait que l’expression d’un désespoir latent où nous ont conduits tous les acteurs dont je viens de vous dresser, en gros, le portrait. Cette générosité est peut-être un exutoire à la solitude où l’écriture a été plongée par les organisateurs des grandes parties de poker menteur.
Je me souviens aussi de l’époque où je faisais plein de petits concerts Brassens, pour des associations. Avec juste raison, les intermittents du spectacle m’avaient reproché de le faire souvent gratuitement. De quel droit allais-je faire le généreux alors que d'autres, beaucoup plus talentueux que moi, se faisaient payer ? Et un gars du métier m’avait dit : "dans nos sociétés, si tu ne demandes rien pour ton art, c’est louche. Dans l’esprit, si tu ne demandes rien, c’est que ça ne vaut effectivement rien."
J’aimerais que nous y réfléchissions tous ensemble. Que nous réfléchissions au pourquoi de notre gratuité. Que nous élucidions un peu, en tant qu’individus, cette notion de nous être embarqués dans un phénomène de société d’envergure. Oui, j’aimerais bien, sans me faire trop d’illusions. Et je vois des forums et des forums et des symposiums organisés partout sur le numérique sans que jamais, jamais, ne soit effleurée du bout des lèvres cette étrangeté de la gratuité dans un monde où même pour aller pisser il faut mettre la main au porte-monnaie. Car si nos blogs étaient payants, oh, pas beaucoup, un tiers d’euros de-ci, de-là, je ne doute pas que la courbe des statistiques accuserait soudain comme une espèce de déprime.
J’arrête là... Bon, qui n’est jamais à court d’arguments, dirait que je déprime, justement, et d'autres vont dire que je tends le chapeau.
Mais je n’ai pas de chapeau et je vais bien. Très bien même.
Mieux que lorsqu’on voulait me faire avancer à reculons.
Franc comme un âne qui recule, disait mon grand-père.
Image : Philip Seelen
13:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.12.2011
Souscription : réponse à un commentaire
 En optant pour le mode public pour me faire très franchement part de sa réaction à la souscription que j’ai eu l’impertinence de lancer, Sophie a fait un choix qui me donne donc le droit, presque le devoir, d’une réponse publique.
En optant pour le mode public pour me faire très franchement part de sa réaction à la souscription que j’ai eu l’impertinence de lancer, Sophie a fait un choix qui me donne donc le droit, presque le devoir, d’une réponse publique.
Qu’elle soit d’abord remerciée d’avoir exprimé ce qu’elle éprouve. Ça n’est pas si courant par les temps qui courent et surtout là, sur ces blogs où chacun vient exposer son talent - réel ou supposé - et où chacun a à cœur de lui dire que c’est bien et que c’est beau.
Il n’en reste pas moins vrai que, passant par là ce matin, j’ai quand même pris un coup en lisant Sophie. Parce que, contrairement à ce que beaucoup sans doute pensent, contrairement même à ce qui peut transparaître dans ce que j’écris quelquefois ici, je ne suis pas un individu sûr de lui, en matière d’écriture.
Marc Villemain appuyait sur ce côté-là dans sa critique du Théâtre des choses et je tiens Marc pour quelqu’un qui sait lire et ne prend pas les gants de la flagornerie quand il a quelque chose à dire sur un livre ou sur un auteur. Je le tiens pour un professionnel.
Il ressort donc du commentaire de Sophie que, subodorant une qualité littéraire à mes textes sur la Pologne qui leur donnerait une légitimité à être compilés dans un livre, je serais vaniteux.
Ça m’a brassé. Car si croire un peu, si essayer de croire plutôt, à ce que l’on fait, c’est être vaniteux, alors, oui, je suis un vaniteux et cela ne colle pas avec ce que je ressens profondément de moi, c’est-à-dire avec ce sentiment qui me prend souvent d’être dénué d’un talent littéraire digne de ce nom. Surtout après moult échecs, et non des moindres ces temps derniers...Mon entourage immédiat pourrait en témoigner. Ici, seule vaut ma parole.
Mais il y a une limite au doute. Un artiste, un écrivain, un chanteur, un peintre, s’il va au bout de sa logique du doute, ne présentera jamais rien au public. Si j’ai eu, par exemple, le plaisir de mettre Baudelaire, Villon, Apollinaire en musique, suis-je un vaniteux de travailler maintenant à monter un spectacle pour offrir au public en octobre prochain ? Suis-je un vaniteux de penser que cela vaut la peine d’être écouté ailleurs qu’en ma maison ?
La question est posée. Je n’ai pas la réponse. Seul le public la donnera, cruelle ou bien réconfortante. Mais, en tout cas, pour le savoir, il faudra bien que je lui pose.
Retirons maintenant la qualité de mes textes. Après tout, peut-être en sont-ils dénués. Reste alors ce plaisir que j’ai eu à lancer cette souscription et ce plaisir que j’aurais de voir ces textes inscrits dans un livre. Sophie dit qu’elle me donnerait bien 20 euros pour acheter du pain si j’en avais besoin, mais certainement pas pour me faire plaisir. Voilà donc, Sophie, une générosité bien populiste et très bien orientée ! Mais je te comprends et c’est là ton droit le plus élémentaire. Sache cependant que j’ai une autre idée de la générosité et de l’engagement personnel. D’ailleurs, demander à souscrire, n’est pas mendier. C’est associer des lecteurs éventuels à un projet qui ne se réalisera qu’avec eux et pour eux. Et je souris car je me rappelle, hors sujet, un jeune trimardeur à qui j’avais donné 20 francs pour qu’il aille s’acheter des clopes. Tu lui aurais donné, toi ? Moi, je ne regarde pas à l’utilisation qu’on fait de ce que je peux offrir. Quand je donne, je ne subventionne pas. Quand j’étais marchand de bois, j’ai laissé des chargements entiers à des familles qui n’avaient pas les moyens de se chauffer correctement. Par contre, ils picolaient oui, et la part du budget qui normalement aurait du être inscrite au chapitre «chauffage» était inscrite au sous-chapitre «alcoolisme». Donc, c’est un peu comme si je leur avais donné du vin. Tu te rends compte? Et pas 20 euros, Sophie. Mais 2 ou 3 mille francs...De quoi prendre de bonnes bitures !
Au début où j'étais en Pologne, avec un jean et un sac à dos, quelqu'un m'a aidé aussi. Spontanément. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, jamais rencontré. Et qui ne m'a pas demandé ce que je voulais faire des sous. Aider. Point. Aider sans philosopher sur son aide. Une main tendue. C'est resté et ça restera inscrit dans mon coeur et dans ma tête. Cette personne se reconnaîtra si elle vient à passer par là.
Mais je répète : chacun a bien le droit de porter l’idée qu’il se fait d’un être généreux. Et je répète aussi que demander souscription n’est pas mendier, mais anticiper. Je crois même que c’est un système qui devrait se généraliser afin qu’entre les lecteurs et les auteurs, il y ait vraiment complicité, avec court-circuitage des malotrus qui se trouvent entre eux. Le souscripteur achète le livre qu'il veut et que lui propose un auteur, pas un intermédiaire...
Le problème de ma souscription, c’est qu’elle est trop coûteuse, d’accord. Je ferais tirer à 1000 exemplaires que ça ne coûterait que 500 zl. de plus et que ça ramènerait le prix du livre, expédition comprise, à 2,50 euros environ. Mais d’ici à trouver 1000 souscripteurs, il y a l’eau d’un océan à passer sous les ponts.
Par contre, Sophie, je te conteste avec force l’affirmation selon laquelle mon plaisir résiderait à voir mon nom sur une couverture. Là, quand même, c’est un peu en-dessous de la ceinture, comme coup. Et ça n’est plus de la vanité que tu m’attribues, mais de l’orgueil et de la bêtise crasse. Et ça, c’est blessant, vois-tu.
J’ai lu…Je suis reparti dans ma campagne. J’ai joué un peu de guitare - on réfléchit aux coups reçus avec des accords sous les doigts, on s’isole - et j’ai décidé de revenir. Je crois que c’est pour ça. Pour cette assertion blessante.
Alors que dire qui soit autre chose que « non, non je ne suis pas comme ça !!! » Dire que j’ai déjà eu mon nom sur la couverture de cinq ou six livres et que je ne suis pas tombé en transe ni n’ai eu d’intempestives érections ? Dire que j’ai déjà vu mon nom sur plein d’affiches à l’époque où je tournais régulièrement avec mon répertoire Brassens, que ce foutu nom a été cité maintes fois par des journaux locaux, voire nationaux (Marianne(1), Chorus), et des radios locales à propos de mon livre sur Brassens ? Dire aussi qu’à une époque où j’avais encore le courage de croiser le fer avec le système, où je me frottais au monde autrement qu’avec des mots, ce nom a été inscrit, bien trop souvent à mon goût, dans les colonnes des journaux ? Alors, lancer une souscription pour voir mon patronyme une nouvelle fois gravé sur le papier, non merci. J’ai une autre idée, une autre estime, une autre dimension, plus humaine, de mon propre plaisir. Si on me demandait d’inscrire sur la couverture du livre pour lequel j’ai lancé cette souscription Gilles DUPONT, je n’y verrais aucun inconvénient.
Enfin, cette affirmation selon laquelle ce qui est publié sur blog est fait pour être éparpillé et non regroupé dans un volume…J’ai devant les yeux un livre que je feuillette souvent et que j’avais avalé d’un trait quand son auteur eut la gentillesse de me l’envoyer : RICHES HEURES, Jean-Louis Kuffer. Sans commentaires.
Et ceux qui te diront ce genre de sornettes d'une écriture à part, spéciale blog, éparse, courte, regarde-les bien dans les yeux si tu les as devant toi. Ils seront en train de mentir et de transvaser leurs échecs côté victoires. De théoriser la défaite. D'embaumer la fatigue. Surtout s’ils sont des écrivant du net.
Enfin pour conclure, tout ça était peut-être inutile. Si j’en crois le nombre de souscripteurs inscrits (tous écrivains publiés cependant) jusqu’à maintenant, cette souscription se dirige tout droit vers le bide. Un de plus…
Au moins ça fera, dans leur coin, plaisir à tous ceux qui me chérissent tant !
En tout cas, je rends une nouvelle fois hommage, avec sincérité, au courage de ton engagement ici.
(1) Même si c'était pour me démolir.
14:52 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.12.2011
Écriture et lecture au numérique : pratiques et pièges
J'avais écrit ce texte en juin 2009 et l'avais mis en ligne le vendredi 19, avant de me retirer dans ma campagne. Je le publie une nouvelle fois aujourd'hui car il donnait mon sentiment sur la pratique des blogs, à une époque bien identifiée, précise, et que certaines choses ont évolué depuis. Pas beaucoup. C'est la première raison pour laquelle, j'ai mis en italique ce que j'ai modifié de ce texte, réadapté à aujourd'hui.
La deuxième en est que je laisse les commentaires de l'époque, certains me semblant de nature à éclairer certaines choses, toujours d'actualité, un autre éclaircissant aujourd'hui ce qu'il advint par la suite... Il n'eût dès lors pas été honnête de laisser les commentaires et de modifier le texte sans le signaler clairement.
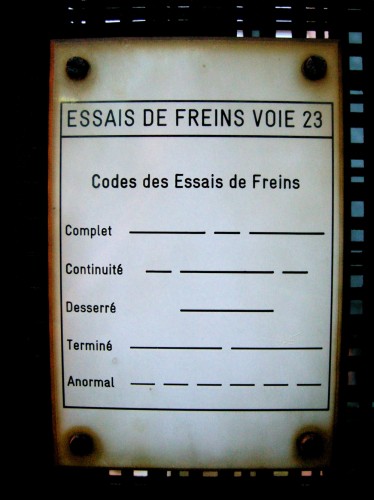 Il est des jours, comme ça, où il faut s’arrêter, poser son cul sur une vieille pierre et, peut-être à mi-pente d’un mamelon herbeux qu’on escalade, jeter un regard en arrière, sur le chemin en contrebas, évaluer aussi, devant, la pente à parcourir encore, puis prendre une décision ou ne pas en prendre.
Il est des jours, comme ça, où il faut s’arrêter, poser son cul sur une vieille pierre et, peut-être à mi-pente d’un mamelon herbeux qu’on escalade, jeter un regard en arrière, sur le chemin en contrebas, évaluer aussi, devant, la pente à parcourir encore, puis prendre une décision ou ne pas en prendre.
Peu importe. L’important est de n’être, un instant, disponible que pour soi-même.
Est-ce là réfléchir ? Le mot est trop vaste pour être noyé dans une simple pause de l’effort. C’est reprendre son souffle.
Soit pour continuer l’escalade d’un pas plus alerte et plus guilleret, regonfler le désir de contempler, de là-haut, le panorama des choses de la campagne, des clochers de villages, des troupeaux, des bois et des brumes, soit pour renoncer et regagner le bas de la colline, sur les berges de la rivière.
Y faire autre chose.
Blogosphère : immédiateté et assiduité
Depuis quatre ans, donc, que j’arpente de mes messages et de mes lectures quotidiennes la montagne internet, j’interrogeais mentalement ce matin le chemin parcouru et celui que j’aimerais y faire encore.
Et si tout ça avait un sens, lequel ?
En premier lieu : si cet espace n’existait pas, écrirais-je ainsi, quasiment tous les jours ?
Je n’en sais évidemment rien. Car rien n'est plus péremptoire que d’affirmer une position réelle dans une réalité supposée.
Je sais en revanche que la motivation est grande de savoir son texte tout de suite disponible pour des lecteurs, certains dont on sait bien qu’ils viendront, peu sans doute au regard des exigences de l’écriture quand elle voudrait être ou devenir une production artistique de l’esprit, mais beaucoup et d’une grande importance cependant quand on sait, et qu’on ose le dire, la solitude du jeteur de bouteilles à la mer.
Avant, le texte se languissait à l'intérieur d'une chemise bien rangée dans un tiroir. Puis, l’auteur prenant quelque hardiesse, il était donné à lire à un proche, à un ami, à un frère.
Verdict le plus souvent bon. Rarement critique. L’affection s’accommode assez mal d’une objectivité déplaisante. Il fallait que l’auteur, si tant est qu’il fût prêt à recueillir un avis, guette le regard fuyant, le poncif énoncé, le raclement de la gorge ou la brièveté de l’échange.
Le manuscrit cependant était porté un beau matin à la poste, en plusieurs exemplaires, avec sur les enveloppes, soigneusement portées, les adresses de maisons prestigieuses ou franchement plus modestes.
Après, c’était l’aléa jacta est, le Rubicon des gens sans armes ni bagages. On jouissait de quelques mois d’attente, campé sur les rives du fleuve. C’était là notre grande récompense. Tant qu’on n’avait pas essuyé le refus, même le subodorant très fortement, surtout après des années et des années d’une même expérience, on était quasiment un écrivain heureux. On attendait. On était en droit de dire et de penser qu’on était un écrivain, qui attendait certes, mais un écrivain quand même. Comme une femme pour la première fois enceinte attend sans doute l’espoir de son enfant et qui, dans sa tête et dans son cœur, est déjà une mère.
On était parturiente promise.
Ce bonheur cessait dès qu’une lettre estampillée par une édition tombait en retour dans la boîte. Avant même de l’avoir ouverte, le charme était rompu. On savait bien, allez, plus d’illusion, ce qu’elle véhiculait : du vide, du rien, du sans-écho.
Immanquablement en effet, c’était l’échec de l’accouchement, l’enfant mort-né. La lettre sans mot et sans audace.
Avec la "révolution internet", donc, le texte vit aussitôt sa vie de texte. In vitro ? Oui, in vitro. Mais au moins il respire, il vit. Et c’est là un certain humanisme des blogs, quels qu'ils soient. Mon propos n'est évidemment pas d'en discuter la qualité.
Pour ce qui nous concerne, la littérature supposée, spontanéité de la publication donc et c’est là, pour qui a bataillé avec les fantômes tentaculaires de l’édition, une grande motivation de l’écriture. Forcément, donc, une générosité nouvelle.
Car tenir un blog, c’est être aussi tenu d’écrire quasiment chaque jour. Et l’écriture se nourrit de beaucoup de choses, parmi lesquelles la continuité. Une bonne raison de ne pas écrire à celui ou celle qui en ressent le besoin ne manque effectivement jamais à personne. Le blog est là, tel un écritoire multifonctionnel, qui exige nourritures et mises à jour et, donc, qui forge, qui chauffe et transforme le fer intérieur. Une chance alors pour l’écriture, presque liée au blog par un contrat d’existence réciproque.
Un copain, lui-même écrivain publié, m’écrivait ceci : l’écriture est un fil ténu. Veiller à ce qu’il ne se rompe pas.
Pièges de l’assiduité
Mais le blog, dans sa générosité justement, représente ce redoutable danger de ne plus écrire que pour être immédiatement mis en vitrine.
Prenons une échelle : sur 500 blogs existants actuellement si, pour ces 500 blogs, les auteurs étaient régulièrement publiés par un éditeur ayant pignon sur rue, combien en resterait-il là, à écrire au quotidien ? Aujourd'hui, décembre 2011, je dirais cent. Et je serais peut-être généreux. Pour beaucoup, dont moi-même, le blog fut au départ l'ersatz, la consolation de l'échec.
L’écriture est un long travail de concentration sur soi-même, de collection d’émotions dans des situations données, de repères retrouvés, cherchés à tâtons, de choses qui voudraient dire l’immatériel enfoui au fond de l’âme, d'éclaircissements de nos confusions, de musicalité intérieure, d’espoir accumulé, de désespoir vaincu, de convictions entr’aperçues, d'archéologie remise au jour par le sentiment du temps qui fuit et qui bientôt ne fuira plus, etc.
Cette écriture-là est celle du loup solitaire. Longtemps, sur le métier sera remis l’ouvrage qui de bribes incertaines fera un tout. C’est l’écriture de l’ombre, la plume qui n’attend rien de l’immédiateté quotidienne, le travail longtemps inaperçu, la main invisible tendue dans des nuits opaques.
Le vent frappe à la fenêtre, le jour se meurt et les ombres grandissent. La page à l’écran reste soudain muette. Grande, grande est la tentation alors de découper l’amont que l’on croit achevé et de l’offrir, dès demain, par tronçons, à la publication sur blog. Ou alors de n'écrire que des textes lapidaires, sur une idée surgie comme ça, pas mûre encore, pas même totalement maîtrisée.
Exister. Écrire sur les murs de la ville. C’est là le piège du blog, la séduction, le miroir suicidaire tendue à l’écriture.
Cette angoisse existentielle nourrie de solitude, et parfois d'états d'âme plus prosaïques, peut même conduire à des aberrations. A des plagiats honteux ou à des textes vidés de leur sang. Parce que personne n'a chaque jour quelque chose à dire qui mériterait vraiment d'être dit. Et quand bien même ! Personne ne peut, à moins d'être un génie - mais ça se saurait par ailleurs - présenter quotidiennement à ses lecteurs un texte achevé du point de vue d'une littérature digne de ce nom.
Alors où est le hiatus ? L'écrivain offre-t-il des sous-marques à ses lecteurs en étant présent tous les jours ou trois ou quatre fois par semaine ? A-t-il dans l'ombre un réservoir travaillé et qu'il distille au numérique ? Et si la quantité risque de produire la pacotille, que dire des lecteurs qui prennent la parole et qui, à chaque fois, trouvent ça malgré tout et toujours formidable ? L'abondance des interventions pervertirait-elle la finesse d'esprit de la lecture ?
Je n'en sais trop rien...Mais j'ai quand même le sentiment, aujourdhui, en reprenant ce que j'écrivais il y a deux ans, qu'il y a dans tout ça, une sorte de décadence due à la générosité internet et, en même temps, une perte réelle de sincérité entre le lecteur et l'auteur. Quand on monte sur scène, par exemple, si on est mauvais, si ça ne passe pas, les applaudissements ne mentiront pas : l'artiste sentira bien, allez, qu'ils sont de politesse et de courtoisie, ces applaudissements. Il ne sentira pas ce chaud enthousiasme, cette amitié complice des soirs où ça veut rire !
Sur le blog, il en va tout autrement sans doute. Le mur du silence souvent mal contourné par le bavardage.
Le livre au numérique
 Des écrivains assidus, tel Jean-Louis Kuffer, ne seront pas d’accord, sans doute, avec cette vision de la fréquence présentée comme pouvant être un handicap sérieux à la qualité et fronceront leurs sourcils dubitatifs.
Des écrivains assidus, tel Jean-Louis Kuffer, ne seront pas d’accord, sans doute, avec cette vision de la fréquence présentée comme pouvant être un handicap sérieux à la qualité et fronceront leurs sourcils dubitatifs.
Les éditeurs, libraires, écrivants, écriveurs et écrivains les plus acharnés contre le numérique, en sont, aujourd’hui, à en supplier les secours. Qu’il les tire de l’ombre où la grande pagaille des lois du marché les a jetés.
Je suis toujours un grand amoureux du livre traditionnel et mon ambition d’écrivain était d’être publié à la fois en numérique et en livre papier, ambition que j'avais partiellement réalisée pour deux ouvrages. Je dis "partiellement" car il s'agissait de deux ouvrages différents et je verrais bien un livre mener double vie, en même temps numérique et traditionnelle.
Ça n'est plus le cas : Bon a supprimé mes livres parce que je lui demandais où j'en étais et que, devant ses mensonges, ses reculades et ses atermoiements, je me suis énervé beaucoup, comme les lecteurs de L'Exil des mots le savent. Je remercie d'ailleurs au passage, les lecteurs qui sont restés avec moi après que j'eus dénoncé les pratiques de cet aflligeant bouffon, comme ceux, nombreux, qui sont venus depuis. Quant à ceux qui ont fui, inutile d'en parler, puisqu'ils ont fui. Ce serait déjà leur faire bien trop d'honneur.
Je crois cependant que, sans la marmite internet, un livre, et à plus forte raison son auteur, n’arrivera plus jamais à être présenté convenablement au grand banquet des lecteurs. Les trois livres que j'ai publiés depuis trois ans m'en persuadent encore plus.
L’édition numérique, donc, quand elle trouvera des gens honnêtes pour lui mettre le pied à l'étrier, publiera des livres. Elle ne sera pas cannibale et ne se nourrira donc pas d’autres livres.
L’atelier de l’artiste
Le site est en même temps l'atelier, la diction du monde au quotidien, la prise de notes, l’accumulation de matériaux, l’esquisse de la réflexion, l'antre du Pygmalion.
Gloire alors aux pratiques ainsi définies de l’internet ! L’artiste a son atelier à ciel ouvert et le public visite, commente et, en amont de l’œuvre, en goûte tous les cheminements. J'ai dit "commente" et c'est un mot important...Lourd de responsabilité. Car si un passant vient régulièrement dans l'atelier et trouve toutes les ébauches formidables, l'artiste va finir par se croire achevé et n'en sera, du coup, déjà plus un. Pour peu qu'une foule d'éditeurs l'aient déjà refusé, il sera en droit de se dire : finalement, je suis meilleur en ébauches qu'en rédaction finie. Ce qui est quand même le monde à l'envers, à moins que cet artiste n'ait l'orgueil et la bêtise de penser qu'il est bon dans le spontané et nul dans le travail. En un mot comme en cent, voilà un fier grimaud !
Cette option de l’atelier suppose cependant que l’artisan/artiste ait d’autres lieux d’exposition, d’autres galeries à faire valoir. L’ébéniste jonchera l’atelier de copeaux et de sciures qui sentiront bon la forêt, qui embaumeront la résine, mais le meuble partira bientôt vers sa vie de meuble cousu main, vers sa destinée «sociale» d’œuvre humaine. Peut-être dans le salon coquet d’un autre artiste qui en sera tombé amoureux.
Mais quel plaisir, quelle délectation de l’avoir vu naître devant vous ! J’ai passé des heures à regarder travailler des artisans, des scieurs de long notamment. Un ravissement, de l’arbre brut à la pièce de charpente aux formes si pures, aux galbes parfois si étonnants, et parcourue par les arabesques des printemps successifs de la vie, immortalisés dans sa matière.
Générosité encore de l’internet. Travail à ciel ouvert. Mais il faut alors une clarté des rapports entre l’artiste et son public, d'autant que le public émet un avis que d'autres publics liront. Et c'est la raison pour laquelle je disais à l'instant que le passant avait une responsabilité énorme vis-à-vis de l'artiste, une responsabilité qui n'admet pas la frivolité. S'il veut flagorner, séduire, rencontrer un auteur plutôt qu'une écriture, il entraîne tout le monde dans sa triste erreur. Mais si ce "tout le monde" est un peu sensible et intelligent, alors le flagorneur passe, in petto, pour un imbécile. Ce qui n'est alors, ma foi, que du pain bénit, comme disait ma grand-mère.
Je suis donc assez heureux de voir le nombre des lecteurs de L'Exil des mots en augmentation régulière, alors que pratiquement plus aucun commentaire ne vient se poser sous les textes, si j'excepte l'ami Solko, Elisabeth, Sophie et quelques autres. Bizarrement - mais non ! ça n'est pas si bizarre que ça, dans le fond - je me retrouve beaucoup plus proche de mes lecteurs. Dans ma tête. Je vous sens proches et amis. J'aimerais quand même, parfois, qu'on me dise où ça n'est pas beau. J'attends beaucoup plus ce genre de contribution que des compliments. J'aime mieux le piment que le miel, moué ! Le piment fouette. Le miel endort.
Lecture des blogs et sites
Tout ceci nous amène à reconsidérer autant notre pratique d’écrivain que notre ambition de lecteur. Le foisonnement des envies d’écrire, la multiplicité de leurs motivations et la diversité humaine des émotions et conviction intimes - et je me réjouis personnellement de toute pluralité - font forcément qu’une sélection s’impose.
Farfouiller partout c’est aller nulle part. Au fil des mois et des années, un parti pris se crée donc. La lecture est ciblée pour chacun d’entre nous et, sur l’immense étang des blogs et des sites où nos barques voyagent à coups de clics, se créent les ronds concentriques de l’affectivité.
C’est le cloisonnement quasiment nécessaire de l’internet. La transversalité a ses limites si elle veut rester effective et qualitative.
Que dire alors de ma zone de navigation ? Six ou sept sites en tout, dont l'atelier cité plus haut, ici, là, ici et quelques autres encore. C’est à peu près le tour d’horizon permis au quotidien si l’on se propose, dans la journée, de travailler à sa propre écriture.
Au-delà, c’est la journée quasiment consacrée au voyage, la journée de congé qu’on s’octroie, la balade chez tous les voisins.
C’est bien, c’est agréable aussi, et c’est parfois nécessaire.
Bon, il faut que je lève mon cul de cette pierre.
Je n’ai pas pris de décision. Il n’y en avait d’ailleurs pas à prendre.
Le ciel au sommet de la colline est dégagé. J’ai repris mon souffle. Je vais aller voir là haut si l’air est frais et si les paysages sont prêts à me tendre les bras.
Nous avons tous nos Mythes de Sisyphe.
Images : Philip Seelen
17:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.12.2011
Idę do koscioła
 La nuit au dehors, que je vois par les vitres de la fenêtre, est noire et sans étoiles. Il est seize heures. Nous prenons le thé en grignotant des gâteaux tout chauds, faits maison. Délicieux, très fins.
La nuit au dehors, que je vois par les vitres de la fenêtre, est noire et sans étoiles. Il est seize heures. Nous prenons le thé en grignotant des gâteaux tout chauds, faits maison. Délicieux, très fins.
Je discute et plaisante avec le jeune homme. Vingt-cinq ans.
Quand je discute avec un autochtone, c’est toujours avec des phrases squelettiques, le verbe est le plus souvent à l’infinitif, les déclinaisons sont massacrées, la prononciation mise à rude épreuve, l’accent tonique rarement sur la bonne syllabe. Traduit dans ma langue, ça pourrait donner, par exemple :
- Hier, moi aller vers marché et acheter de la pomme très pas mauvaise.
Vous voyez le genre !
Mais les Polonais n’ont pas été habitués à ce qu’on vienne habiter sous leurs cieux - surtout des gens venant de l’ouest - et qu’on y parle, en plus, avec leurs mots. Ce sont eux, qui, au cours de l’Histoire, ont dû aller vers les autres et apprendre pour survivre un langage nouveau. Alors, ils sont d’une indulgence et d’une gentillesse exquises. Ils sont contents de l'effort fourni et ils savent bien que leur langue n'est pas facile. Ils ne vous interrompent donc pas pour corriger, ils vous disent pas de soucis, je comprends, et c’est très agréable quand on est un cancre de mon acabit.
Ça n’est pas comme avec ces Anglois perchés sur leur accent à la noix comme des coqs sur leurs ergots et qui vous toisent et qui rectifient et qui font minent de ne pas comprendre, et qui sourient sournoisement, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus dégoiser un son, retour immédiat à la case inhibition. Les Français, quoique un peu moins, sont un peu comme ça. Ils ne supportent pas bien qu’on massacre leur langage, eux qui ne sont pourtant pas de grands linguistes. Ce sont là orgueils des peuples qui ont eu, à un moment donné, la prétention d’être les maîtres du monde. Les pendules de leur cerveau ne sont plus tout à fait à l’heure !
En Polonais, donc, malgré les incorrections et les approximations, le message passe très bien. Humainement. On ne discute pas de Schopenhauer, certes, ni de La Métaphysique des mœurs, mais on discute de petites choses et on rigole, même. Surtout avec ce jeune homme que je connais bien, toujours souriant et que j’aime beaucoup.
Ce soir-là, tout en plaisantant sur la théière qui, selon lui, a des allures "Versailles"(nous sommes chez ses parents), il regarde fréquemment vers la pendule. Je me dis qu’il doit sortir, rejoindre quelques copains au bistro, à Wisznice. Ou alors, il a une petite copine qui l’attend, le coquin ! Il ne veut pas, aussi agréable que puisse lui être ma compagnie, louper son rendez-vous, et ce n’est pas moi qui lui en ferai grief !
Il se lève, me tend la main, me sourit et me dit :
- Idę do koscioła…Je vais à l’église….
Quoique je sois habitué au catholicisme prégnant des campagnes de l’est, la situation pour moi change radicalement. Et je reviens à la réalité : je suis un étranger, bien loin de mon pays, bien loin de tout ce que j’ai connu, bien loin de l’esprit dans lequel je me suis fait, bien loin de ma vision des choses du monde.
Le jeune homme ne m’en reste pas moins et ne m’en restera pas moins sympathique.
Une discussion s’en est suivie.
Je dis à D., vois-tu, c’est dans ces moments-là qu’on se sent vraiment un étranger. Je dis qu’en France, un jeune homme de vingt-cinq ans ne partirait pas, comme ça, à l’église…Alors on discute longtemps. D. a sur moi l’incomparable avantage d’être née ici, de tout comprendre, et de la langue et de la culture, et d’être en même temps très imprégnée par la culture française. Alors elle dit oui, mais tu viens du pays le plus laïc d’Europe et tu vis dans le plus catholique. Forcément, le décalage est abyssal.
Et nous parlons de l’histoire. De l’église polonaise située du côté des opprimés sous la dictature communiste, de l’originalité de ce pays, le premier pays slave à se tourner vers Rome, en 966, et des affrontements qui en ont découlé avec la Russie orthodoxe, du poids de l’église au niveau de l’Etat et dans la tête des gens. Oui. Tout cela est vrai. Indéniable. Sauf que je fais remarquer que l’église polonaise était du côté des opprimés parce qu’elle-même opprimée par le système collectiviste. Sinon, quand elle est du bon côté du fusil, les opprimés qui sont mis en joue, ça n’est pas vraiment son affaire…Au besoin même, elle appuierait volontiers sur la gâchette. Le sabre et le goupillon, etc.
Et j’évoque la France non pas en tant que fille aînée de l’Eglise, comme on se plaît à le dire, mais en tant que bras armé de l’Eglise dans la christianisation du monde. Je parle de dix siècles de servitude exercés sur le peuple, dix siècles de dîmes, de richesses, de spoliation, j'évoque les jeunes filles découvertes à la Révolution dans les couvents où elles avaient été enfermées pour servir de jouets aux perversions sexuelles de la hiérarchie ecclésiastique…Je parle de l’affreux Richelieu.
D. sait tout ça aussi bien que moi. Nous sommes d'accord depuis longtemps là-dessus. Nous ne discutons pas de Dieu. L’idée de Dieu n’a strictement rien à voir avec l’église. Nous discutons du poids historique d’une institution qui, pour moi, tout empreint d’éducation et de culture judéo-chrétienne que je sois, est une institution totalitaire.
Nous discutons de la même église, mais nous en évoquons une histoire différente, parce que déroulée sous une autre latitude historique et géographique.
Et de quel droit jugerais-je l’histoire des autres, ai-je pensé bien plus tard ?
Du haut de quelle vérité condamner ce jeune homme qui file à l’église dans la nuit froide et noire ?
Du haut de la vérité de ces intellectuels, ou pseudo intellectuels athées, qui trouvent leur religiosité dans d’autres espaces, dans d’autres mensonges, dans d’autres leurres, avec la copie conforme de l’esprit totalitaire de l’église comme mode d’appréhension inversée du monde ?
Le contraire d’un contraire revient toujours, tel un boomerang, à son point de départ initial.
Et combien de ces fiers athées, par ignorance ou complicité, ont donné leur caution morale et idéologique aux communistes de Moscou, assassins autant des anarchistes que des chrétiens, affameurs de peuples et briseurs de rêves ? Combien ?
Je suis athée. Je crèverai athée. Je n’ai pas dit matérialiste, j’ai dit athée. Je crèverai avec la détestation de l’église-institution. Mais je ne jetterai plus la pierre aux convictions et habitudes sociales qui ne sont pas les miennes. Qui se situent même aux antipodes de mes ressentis.
Car en fuyant cette erreur vieille de plus de deux mille ans, dans combien d’erreurs nous sommes-nous fourvoyés nous-mêmes ? A combien de menteurs, d’escrocs, d’usurpateurs, de voyous de la conscience, avons-nous, sinon fait allégeance, du moins foutu par faiblesse et lâcheté une paix royale ?
Aurons-nous le courage de dire que nous ne sommes pas plus avancés que l’obscurantisme que nous fuyons de nos belles ailes d’hommes libres et que nos mots ne sont en la matière que piaulements d’impuissants à faire cesser les aliénations ?
Alors va, jeune homme, dans la nuit noire et sans étoiles … Nous partagerons encore le thé et le gâteau et rirons encore de choses simples. Dans mon soi-disant propre camp, j'ai vu et je vois, j'ai lu et je lis encore tous les jours, des comportements et des truismes bien plus hallucinants et bien moins naifs.
Bien moins francs, tout compte fait.
Image : Philip Seelen
13:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.12.2011
Coup d'fil
 Un paysan chez lequel je travaillais régulièrement au ramassage du tabac, les mois d’été quand j’étais môme, m'a légué une expression bien étrange, bien irrévérencieuse aussi, et que je ne retrouve - sans doute pour cause qu’elle n’existait que dans sa bouche - dans aucun lexique des expressions.
Un paysan chez lequel je travaillais régulièrement au ramassage du tabac, les mois d’été quand j’étais môme, m'a légué une expression bien étrange, bien irrévérencieuse aussi, et que je ne retrouve - sans doute pour cause qu’elle n’existait que dans sa bouche - dans aucun lexique des expressions.
Un qui aurait donné du fil à retordre à Alain Rey, donc.
Si d’aventure il avait subitement envie de faire caca alors que nous étions au milieu des champs à nous échiner sous un soleil sans âme et qui nous tannait la nuque, il courait se planquer derrière une haie ou dans le bosquet le plus proche et immanquablement nous lançait son occulte métaphore :
- M'en va téléphoner au pape, les enfants !
Le brave homme avait le goût de l’intimité et la pudeur des grandes choses de la vie. Il ne voulait pas qu’on écoute sa conversation avec un personnage aussi auguste et se prenait sans doute, dans ces circonstances-là, pour le premier moutardier du pape. En tout cas, le coup de fil avait à chaque fois l'air de s'être déroulé de façon fort aimable, car l'homme en revenait béat et, saisissant la bouteille de vin enveloppée du chiffon humide qui la gardait au frais, s’en régalait d'une large lampée, s'essuyait la lèvre d'un revers de son gros bras poilu, se roulait une cigarette de tabac gris et se remettait paisiblement à l’ouvrage.
S’il n’était aujourd’hui parmi les Gentils, il lancerait à coup sûr :
- M'en va envoyer un mail au pape, les enfants !
L’homme n’était pas particulièrement anticlérical, du moins n’en faisait-il jamais montre, sinon, comme tout le monde, par une absence assidue aux messes du dimanche matin.
Alors ? Non...? Vous croyez... ? Ah bon...? Hé ben.. !!
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET



















