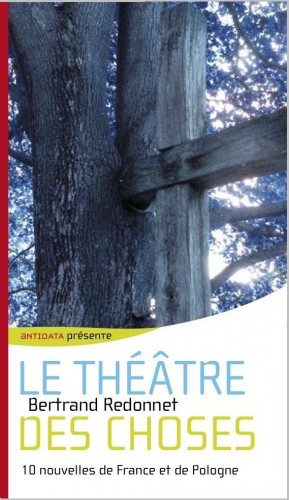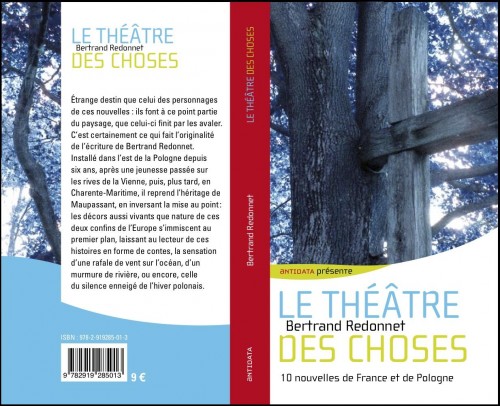05.08.2011
Lettre à un ami - 3 -
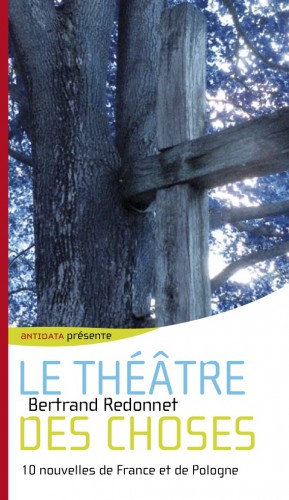 Cher Gustave,
Cher Gustave,
Suis ravi d’avoir reçu de tes nouvelles. Je te pensais parti vers quelque villégiature, comme la grande majorité des gens du mois d’août, mais je vois que tu as - encore - préféré rester en ton jardin, pour y cultiver - encore - ton insatiable misanthropie. Ceci dit plaisamment car, comme je t’ai dit souvent, la misanthropie n’est, en fait, que le dépit amoureux de celui qui a trop aimé les hommes et s’en est forcément retrouvé Gros-Jean comme devant.
Merci d’avoir lu Le Théâtre des choses. Je suis vraiment fier que tu y aies trouvé du plaisir et suis très sensible à tes compliments, que je sais être sincères.
Tu soulignes cependant la présence de cette croix sur la couverture. Tu dis avoir une interprétation que tu me livreras une fois que je t’aurai donné la mienne.
Bien. Tout d’abord, pour avoir publié plusieurs fois, tu sais bien que le choix de la couverture échappe généralement à l’auteur. Dans le cas présent cependant, j’avais fourni à l’éditeur tout un lot de photos prises ici, en Pologne, dont celle-ci sur laquelle s’est portée sa préférence.
Elle est extraite d’images que j’ai faites dans un vieux, très vieux cimetière orthodoxe abandonné, près du village de Gnojno. Un cimetière qui a dû être désaffecté en 1918, quand l’occupation russe a pris fin et, en même temps qu'elle, l’orthodoxie obligatoire en matière de religion. Ce lieu m’a fasciné avec ses tombes écroulées, étouffées sous le lierre et la ronce, ses croix aux deux branches vermoulues, ses bruissements d’insectes, sa touffeur, son inquiétant silence. Quand on marche ici, sur des sépultures qu'on ne voit qu'à peine, qu'on devine sous la végétation rampante, on est sur cette frontière ténue qui sépare archéologie et profanation. Seule la quantité de temps qui a ruisselé sur les mémoires, partout, distingue l’une de l’autre.
J’avais d’ailleurs écrit un texte sur ce lieu; texte que tu peux consulter ici, si ça n’est déjà fait.
L’éditeur du Théâtre des choses m’a donc dit que lui plaisait beaucoup, dans cette photo, le mélange entrelacé des choses humaines et des choses de la Nature. Ce qui est une constante des dix nouvelles du recueil.
Pour ma part, quand je regarde cette photo, avant comme après sa publication, j’y vois, naivement, l’expression symbolisée du retour du Grand Pan, finalement victorieux des religions monothéistes qui l'avaient expulsé, avec la violence que l'on sait, des poésies de l'esprit. Et cette vision des choses correspond bien, dans mon esprit, au Théâtre des choses.
Le grand Pan est mort. Une grande pensée de Pascal ! Le cri victorieux, aussi, de l'église chrétienne.
De toute façon, chacun lira sur cette couverture ce qui lui plaira de lire. D'aucuns ne verront que la croix sans voir l'essentiel : le chêne qui la dévore. Je m’attends donc aux réflexions de quelques fâcheux, promptement enclins au procès d’intention de surface pour éviter d'avoir à regarder plus loin que le bout de leur nez…Des fois que…
Cher Gustave, tu me demandes aussi comment je fais pour être aujourd’hui complètement remonté contre l’édition numérique après en avoir fait les éloges et comment je vis cette « apostasie », comme tu dis malicieusement.
Je te dirai tout ça dans une prochaine lettre.
Pour l’heure, je dois te laisser. Pendant mon mois d’absence, l’herbe abondamment arrosée par les tièdes orages de juillet, a envahi mon territoire et je dois profiter des quelques jours de beau temps que le ciel polonais nous accorde en ce moment, pour essayer de juguler ses ardeurs dionysiaques.
A très bientôt.
Porte- toi bien
B.
15:00 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.08.2011
Entre "Zozo" et Le "Théâtre des choses"
Un article de La Nouvelle République
17/O7/11
Bertrand Redonnet : drôles d'histoires de Zozo
Originaire du Poitou, vivant en Pologne, l'auteur était hier à l'ouverture de Contes en chemin à Sainte-Eanne. '' Le travail salarié bouffe la vie des gens ''.

Jean-Jacques Épron, hier à Sainte-Eanne, interprétant le personnage de Zozo. Une critique sociale pleine de drôlerie et de tendresse.
|
C'est qui, Zozo ? Bertand Redonnet réfléchit deux secondes. « C'est un vieil anar. C'est le plus sincère des rebelles puisqu'il l'est sans le savoir. » Zozo vit à contre-courant. Il est chômeur à une époque - on est dans la France gaullienne - où le chômage n'existe pas.
|
Yves Revert
11:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.08.2011
Lettre à un ami - 2 -
Cher Gustave,
Le mensonge et la falsification désormais institutionnalisés dans les moindres détails de la vie, tel est le titre que je pourrais donner à mon envoi d’aujourd’hui.
Mais écoute plutôt.
Contraint, en France, d’acheter une carte SIM pour un portable, la nôtre étant polonaise et l’opérateur-voyou surtaxant de façon obscène les communications à l’étranger - allant même jusqu’à me faire payer une partie des communications que je recevais - j’eus la désagréable surprise de constater que la technologie marchande ne l'entendait pas de cette oreille et qu’on n’échappait pas aussi promptement aux mailles de son filet : le susdit opérateur-voyou avait pris la précaution de bloquer mon téléphone. Pas question de s’en servir avec un éphémère forfait acheté à la sauvette et à l’étranger !
Me voilà donc également contraint d’acheter un portable de pacotille (24 euros), ou de balancer à la poubelle cette carte SIM, nouvellement acquise dans une maison de la presse pour 15 euros.
Entre parenthèses, comprends aussi que je vis en zlotys et que ces sommes taillées dans mon budget sont à multiplier par 4. Bref…
Résigné, j’achète donc et me lance dans la lecture de la notice d’emploi…Un casse-tête chinois pour mézigue.
Et là, brave Gustave, j'en suis tombé le cul par terre ! Toute une rubrique était en effet consacrée à « comment faire croire à un quidam qui vous ennuie avec son bavardage que vous êtes obligé de le quitter sur-le-champ parce que vous avez un appel ? »
Tout est scrupuleusement expliqué là-dedans, la manœuvre frauduleuse bien détaillée. Très didactique. On irait presque jusqu’à te dire quelle expression il faut donner à ton visage, moue d'agacement feint et soudain, sourire d’excuse ou autres mimiques de tartufe.
Des détails, me diras-tu, toujours prompt, tel que je te sais, à ne t’alarmer de rien…Non, Gustave. Quand l’hypocrisie, la tromperie, la mystification, la dissimulation, la duplicité sont à ce point reconnues comme comportement social normal, qu'elles sont sociologisées, (et même utilisées comme arguments de vente), c’est que l’état des rapports entre les hommes a atteint le stade ultime de la putréfaction.
Ce n’est là, dans ce petit bout de papier, qu’une minuscule partie d’un iceberg gigantesque et monstrueux. Cet artifice marchand est une récupération très habile des perversités et il est aussi d’une redoutable intelligence quant au profit qui peut être tiré d'un état des lieux préalablement fait et, à juste titre, jugé lamentable.
Ah ! solitude, comme je ne te hais point !
Bien à toi
B.
15:23 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.08.2011
Lettre à un ami - 1 -

Mon voyage sur tes lointains rivages se termine et, n’ayant eu l’heur de t’y croiser, je t’en confie quelques bribes.
Côté ciel, ce fut à peu près constant dans la morosité. Je pensais pourtant qu’ayant à parcourir plus de 2500 km vers le sud-ouest et à travers quatre pays - la Pologne, le Nord de la Tchéquie, l’Allemagne et la France - j’allais rencontrer différentes humeurs atmosphériques et forcément découvrir quelque part un coin de ciel plus serein. Que nenni ! Parti sous une pluie battante, je suis arrivé sous d’opiniâtres crachins qui flottaient comme des vagues et suis revenu sous les orages brutaux du climat continental.
Les nuages partout m’ont poursuivi de leur morne assiduité.
Les Sudètes ruisselaient, et, plus loin, Prague, perle posée, selon Goethe, sur la couronne de l’Europe, était en bruine ; une bruine labyrinthique où je me suis carrément perdu.
L’Allemagne, enchevêtrement monstrueux d’autoroutes encombré des mille et mille non moins monstrueux camions du flux tendu de l’hystérie économique, s’était camouflée sous des brouillards que la Toussaint n’aurait pas reniés.
La France - exception faite pour l’Alsace où la plaine s’enivrait de lumière - la France qui depuis des mois se plaignait de trop de beau temps, m’offrit le visage maussade des jours de pluie. J’aurais pourtant bien voulu en goûter un peu, moi, de cette sécheresse honnie du laboureur !
Non, je n’ai vraiment pas eu de chance avec les nuages !
Mais foin des paranoïas météorologiques : je n’étais pas parti à la recherche d’un beau temps qui m’aurait bronzé la pia. J’étais parti respirer l’odeur de mon pays et toucher l’épaule bienveillante de quelques amis. Les paysages, qu’ils soient gris, qu’ils soient bleus, qu’ils soient humains ou qu’ils soient géographiques, sont les chambres d’écho des souvenirs et les repères immobiles du temps qui fuit.
J’ai donc vécu là-bas - ici pour toi- ce que, somme toute, je m’étais proposé de venir y vivre.
Et je me suis étonné de moi-même à Strasbourg : en passant le pont de Kehl, quand j’ai lu cette petite pancarte blanche «FRANCE», les yeux m’ont picoté et…oui, pour tout te dire, sont devenus humides. Ça remontait de loin. Emotion cachée. Insoupçonnée. On a, comme ça, en soi, de petits incendies qui brûlent à feu couvert et qu'un souffle fait crépiter.
Il faut quand même que je te signale une trouée impromptue dans la tristesse du ciel, avec cette journée passée sur l’île d’Aix : du bleu partout, de bas en haut et de haut en bas. Je ne sais cependant quel compte indécis j’ai à régler avec l’Océan. Je le trouve beau, puissant, énigmatique, envoûtant, mais, après une journée passée à le regarder bomber le torse, je m’y ennuie. Il m’ennuie. Je n’ai rien à lui dire de l’intérieur. Ses roulements, ses vagues, ses mouettes, ses algues, ses brumes lointaines, ses sables, ses rochers m’apparaissent très vite d’une affligeante monotonie. D’un décor convenu. L’Océan ne me fait pas rêver longtemps. Je ne l’admire pas. Son orgueil et ses prétentions à l’infini m’agacent. Je ne le respecte, je crois, que comme source première d’éclosion de la vie sur la machine ronde. C’est un respect tout intellectuel. Et ce genre de respect, tu le sais, ne suffit pas pour aimer durablement.
 J’ai parcouru des chemins qui m’étaient familiers. Des chemins deux-sévriens bordés de murailles englouties par les lierres et la ronce. J’aime la ruralité dispersée de ce département. On sent bien que des hommes de chair et d’os y vivent encore. A l’autre bout du pays, dans la région au sud de Paris, les paysages avaient été à vomir d’ennui avec leurs chaumes jaunes, déserts, silencieux, mornes, et leurs routes rectilignes, sans âme, sans arbre, sans mouvement. Des routes artificielles tracées pour ne pas avoir à égratigner un seul poil des immenses propriétés céréalières.
J’ai parcouru des chemins qui m’étaient familiers. Des chemins deux-sévriens bordés de murailles englouties par les lierres et la ronce. J’aime la ruralité dispersée de ce département. On sent bien que des hommes de chair et d’os y vivent encore. A l’autre bout du pays, dans la région au sud de Paris, les paysages avaient été à vomir d’ennui avec leurs chaumes jaunes, déserts, silencieux, mornes, et leurs routes rectilignes, sans âme, sans arbre, sans mouvement. Des routes artificielles tracées pour ne pas avoir à égratigner un seul poil des immenses propriétés céréalières.
C’est en Deux-Sèvres que je suis allé revoir Jean-Jacques - dont je t’ai déjà parlé -lire publiquement Zozo pour l’ouverture d’un festival au bien joli nom, Contes en chemin. La presse locale m’a fait l’honneur de quelques articles. L’un d’eux présente mon Zozo comme un anar des plus sincères puisqu’il s’ignore en tant que tel. Ma foi, ça n’est pas pour me déplaire. Ce livre continue donc sa petite carrière auprès des lecteurs, ce qui me réjouit.
Tout ce temps, je ne me suis pas approché d’internet. Pas envie, d’autres regards à porter. Ailleurs. Même si je sais bien qu’un écrivain - réel ou prétendu - ne peut guère aujourd’hui faire l’économie d’une présence sur le virtuel… Quoique…Me suis beaucoup amusé des angoisses de Jagoda qui me réclamait à tout bout de champ, à chaque arrêt, sans cesse, une connexion WIFI pour donner à manger à son lapin. Oui, un lapin qu’elle élève sur internet et dont il faut qu'elle nettoie la cage, qu'elle lui donne à boire et tout...…Me suis quand même demandé si on ne vivait pas tous, les enfants et les adultes, dans un monde de fous furieux. Dans un monde qui a réussi à abolir le monde. Nous aussi, on élève des lapins avec nos blogs et nos sites.
Qu’en penses-tu, toi qui vis très bien sans un blog ?

Je séjournais, à ce moment-là, en Normandie. A Balbec, exactement. A la recherche de je ne sais quel temps perdu.
Je t’en parlerai dans un prochain envoi.
Porte-toi bien.
Amicalement
B
11:27 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.07.2011
Sortie dans une semaine environ : Le Théâtre des choses
Bonheur de voir tout le travail mené cet hiver, puis tout celui fourni en collaboration étroite avec l'équipe d'Antidata depuis deux mois, porter ses fruits et se matérialiser dans ce recueil.
Un livre que personne ne réduira en cendres d'un coup de clic caractériel, revanchard, irresponsable et malhonnête !
Bref, un vrai livre chez un vrai éditeur.
16:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
CONTES ET LEGENDES DE PODLACHIE
Présentation

C'est s'approprier les lieux dans ce qu'ils ont d'humain. Et de cette appropriation dépend pour une bonne part la lecture qu'on fera des habitants, des paysages, du ciel, des climats et, in fine, de soi-même, tous ces éléments n'en constituant, en fait, qu'un seul.
Un homme de France né au pied des pics pyrénéens et qui ira vivre sa vie sur la plaine des Flandres, un Lorrain venant camper son voyage sur les rives de l'océan, un montagnard du sud polonais coulant ses jours sous les ciels de Podlachie, aura besoin, plus ou moins exprimé, de rencontrer la mémoire de son habitat d'accueil.
Il en aura besoin pour qu'en son cœur le sentiment d'appartenance vienne adoucir celui, manifeste ou latent, du déracinement.
Pour habiter un autre pays, une autre langue, une autre histoire, une autre culture, un autre climat, ce besoin s'est évidemment présenté à moi.
J'ai fouillé l'histoire et la géographie de cette région et, derrière tout cela, très loin et en même temps aux portes du quotidien, ses contes et ses légendes, récits antiques distribués par l'oralité, comme dans toute région et dans tout pays ; récits qui flottent autour des hommes, sans qu'ils n'en devinent forcément la présence.
Le tissu littéraire d'un habitat. Presque sa matière première.
Dans ma langue, J'ai donc repris ici - je veux dire avec les mots que j'emploie pour écrire et décrire et non d'une autre langue à ma langue maternelle - un recueil de contes et légendes de Podlachie, écrit en français par une dame Polonaise, Maria Kasterska.
En quelque sorte, je réécrirai certains contes de ce recueil, je ferai un travail d'écriture, l'auteur elle-même confiant qu'elle s'était attachée à transmettre, alors qu'elle habitait à Paris, sans aucun souci d'écriture.
Il s'agit donc d'ajouter au plaisir de savoir, le plaisir d'écrire.
Si pour vous de lire, alors je serai comblé.
L'auteur
Maria Kasterska est née le 2 février 1894 à Varsovie, dans une famille de propriétaires terriens ruinés.
Son enfance et son adolescence se déroulent en Podlachie. Elle est élève du collège russe de Biała Podlaska, cette partie de la Pologne étant alors sous la botte du tsar.
En 1914, elle émigre en France. Etudiante à la Sorbonne, elle y prépare avec succès un doctorat en littérature *. Elle s'intéresse surtout à la poésie latine et polonaise et aux relations entre la France et la Pologne. Ecrivain prolixe, elle travaille aussi avec la revue « Les nouvelles littéraires », dans laquelle elle publie des critiques aussi bien que ses propres œuvres.
Entre les deux guerres, elle revient en Podlachie pour y organiser des rencontres littéraires avec les jeunes.
Interdite de publication dans les revues polonaises par les communistes, elle habite à Paris, 7 rue du Daubenton, dans le 5ème arrondissement. Ses contes et légendes de Podlachie sont écrits en français et publiés en 1928, à Paris par la librairie Ernest Leroux.
Elle fut la première et, à ma connaissance, la seule femme à être couronnée du prix de l'Académie.
Décédée en 1969, elle repose au cimetière polonais de Montmorency.
Dans les dernières années de sa vie, elle a épousé un Roumain qui garde aujourd'hui précieusement ses œuvres. Ses amis ont fondé à Paris une bibliothèque roumaine, Pierre et Marie Segresco, 39 rue Lhomond, mais l'accès à cette bibliothèque est aujourd'hui curieusement inaccessible.
* Les familles nobles parlaient français et enseignaient le français à leurs enfants
La Podlachie : Eléments tirés de la préface de Maria Kasterska
Podlachie, en polonais, Podlasie, désignait une province située entre la Lituanie et les provinces de Mazovie, de Lublin et de la Prusse orientale. Elle est aujourd'hui à l'extrême est de la Pologne.
Son étymologie a deux écoles. L'une prétend au las polonais, la forêt, et pod, tout près, tout près de la forêt donc, tandis que l'autre s'en réfère aux Lach, tribu polonaise installée sur l'emplacement actuel de Varsovie. Tout près des Lach. Dans les actes du pape Innocent IV accordant en 1253 cette terre à Boleslas, prince de Cracovie, elle porte cependant le joli nom latin de subsylvania.
La Podlachie était habitée par un peuple énigmatique, les Jadzvingues, tribu sauvage renommée pour sa bravoure et dont aucun historien n'a encore déterminé avec certitude les origines.
Certains en font une tribu scandinave, d'autres prussienne.
Le géographe grec Strabon nomme parmi les différentes tribus Sarmates, celle des Jadzvingues et situe son habitat sur les rives du Danube. Il décrit ces Jadzvingues comme bien armés, hommes et chevaux recouverts d'une cuirasse de métal. Ovide, dans ses lettres d'exil, parle également d'une tribu nommée "les Jadzvingues." Ils auraient également été présents dans la plaine hongroise où ils se seraient appelés les Yasok, ou Yazygues. Ils sont mentionnés dans cette plaine du temps d'Alexandre le Grand et lorsque Trajan entreprit la conquête de la Dacie (actuelle Roumanie) ils s'unirent aux Daces. Plus tard, effrayés par les Huns, ils remontèrent au nord et s'installèrent en Podlachie.
Ils ne furent soumis au royaume de Pologne qu'en 1282.
C'est donc les contes et légendes de cette région que j'habite, cette mémoire d'un peuple énigmatique, que je tenterai de vous faire partager.
_______________
La Cigogne

Non, ça n'est pas vraiment très habile de commencer de la sorte. Je crois savoir que ce début fut déjà utilisé pour ouvrir d'autres contes et légendes.
En des temps jadis...Hum, c'est mieux. Mais ça fleure encore un peu le déjà vu....Autrefois, alors ?
Allons-y pour autrefois. C'est un mot passe-partout.
Autrefois, donc, en ces temps reculés où les Jadzvingues nomadaient encore sur les plaines de Podlachie, vivait parmi les hommes un pauvre hère, ce qui n'est pas très original, et de cœur foncièrement honnête, ce qui l'est déjà beaucoup plus, s'agissant d'un homme.
Cet honnête homme, cet homme honnête plus exactement, hélas, n'aimait point à réfléchir. Disons qu'il n'était pas très futé dans sa tête loyale.
Il advint qu'il reçut, gravé sur de l'écorce de chêne, un message de haute tenue et qui le priait de se rendre chez le grand Péroun, dieu des foudres et des tempêtes.
L'homme bon ayant diligemment obtempéré - comme tout homme destinataire d'une divine missive l'eût fait - s'entendit alors confier une mission de la plus haute importance.
Voilà, lui dit la puissance céleste, un sac très lourd. Je te serai éternellement reconnaissant et ton nom méritera d'être inscrit sur le front des nuages si tu le portes jusqu'au Bug et l'y jettes très loin, parmi les remous les plus profonds...Je t'ai choisi parmi tous les Jadzvingues parce que tu es bon et honnête. Car il s'agira de te garder d'ouvrir ce sac, sous quelque prétexte que ce soit.
Va, mon ami, et que le Bug engloutisse à jamais ce fardeau !
Notre homme était perplexe, on s'en doute sans doute, mais promit cependant d'obéir.
Chemin faisant, il arriva au cœur d'une petite clairière qu'inondaient les pâleurs de la lune.
De esprits menaient là grands tapages, dansaient, s'enivraient, chantaient et, même, se livraient sur les mousses du sol à de suaves et frénétiques plaisirs que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici.
Ces joyeux lutins interpellèrent gaiement le brave homme croulant sous son faix, firent autour de lui une joyeuse sarabande et se mirent en devoir de le gentiment brocarder.
Sais-tu ce que tu portes là, sur ton dos fatigué ? Ce sont tous les vices et tous les malheurs du monde...Et tu vas les jeter dans le Bug sans même les avoir jamais vus ? Mais comment peux-tu prétendre être un homme vertueux si tu n'as jamais vu, de près, les vices et les passions des hommes ?
Ouvre ton sac, regarde-les bien dans les yeux et, ainsi, en plus d'être honnête, tu seras devenu un sage parmi les sages puisque, ayant touché de tes mains les luxures, tu les auras bravées...
Le messager du dieu trouva, ma foi, le discours des lutins fort intelligent et, piqué par la curiosité, ouvrit tout grand son fardeau.
Tous les vices et tous les malheurs du monde s'évadèrent alors de leur prison, ricanant et poussant vers la lune des hurlements de joie, accompagnés par les applaudissements des facétieux lutins.
Le pauvre homme, jugeant, un peu tard, qu'il avait été la dupe de ces farfadets, s'en revint tout penaud vers le dieu, assis sur les foudres et les éclairs.
Est-ce besoin de vous dire que ce dernier lâcha la bonde et donna libre cours à son ire ? Et un dieu qui lâche la bonde, ça n'est jamais très bon, certes, mais ça l'est encore moins s'agissant d'un dieu ayant en charge l'administration des orages et des ouragans.
Tu es un mauvais serviteur et un parjure. Je te condamne à l'errance éternelle, d'un point du globe à un autre, tourmenté par l'insatisfaction permanente, en proie aux éternels regrets, sans maison ni patrie.
Et le dieu saisissant un morceau du charbon avec lequel il avait coutume d'allumer les foudres, en frappa le pauvre homme, au niveau des deux épaules.
Le coupable aussitôt se métamorphosa en cigogne et le grand oiseau garda sur ses ailes l'indélébile stigmate de sa faute.
Dès lors, la cigogne n'a cessé de vagabonder, des plaines de Podlachie aux antipodes de l'Afrique, jamais chez elle.
Qui pleure son nid en quittant chaque automne la patrie des Jadzvingues et qui regrette amèrement la tiédeur des climats de ses exils méridionaux, chaque équinoxe du printemps revenu.
*****************
La légende des âmes
 La solitude de l'âme, chantée par les poètes et, plus trivialement, auscultée par les mécaniciens de la psychanalyse et de la psychiatrie, ne serait en fait, si j'en crois les mots de cette légende, que le résultat d'une grossière erreur de calcul.
La solitude de l'âme, chantée par les poètes et, plus trivialement, auscultée par les mécaniciens de la psychanalyse et de la psychiatrie, ne serait en fait, si j'en crois les mots de cette légende, que le résultat d'une grossière erreur de calcul.
Mais oyez plutôt...
Quand le grand manitou créa le monde, il créa d'abord des âmes, puis des individus censés bientôt en porter chacun une.
Hélas, au moment de la distribution, il s'aperçut qu'il s'était, dans sa frénésie créatrice et tout parfait qu'il fût, fourvoyé et avait en son céleste atelier conçu deux fois plus d'hommes et de femmes qu'il n'avait façonné d'âmes.
Le problème était ardu. En supprimer ? Allons, allons, soyons sérieux...Un créateur sacré, ça crée. Ça ne supprime pas. L'élimination pure et simple est d'essence humaine, pas divine.
Mais foin des entourloupettes ! Comment résoudre la délicate équation ?
Cependant qu'il réfléchissait, se traitant in petto de gars de rin et de fichu distrait, le grand manitou avisa son glaive d'or incrusté de diamants, négligemment posé là, à ses côtés, sur un nimbostratus des plus moelleux.
Oui, je vous sens un peu dubitatifs, là. Pourquoi un dieu posséderait-il un glaive ? Pour quoi faire ? Un dieu belliqueux ? Irascible ? Paranoïaque ?
Je n'en sais rien. Je vous raconte tel que j'ai entendu raconter et je n'ai jamais vu de dieu de ma vie...Disons que ça lui servait d'ornement. Il y a bien des gens qui ont chez eux de vieilles lampes de chevet du 18ème (siècle pas arrondissement) et des lampions dernier cri pour économiser l'énergie, un ordinateur, un téléphone portable...Pour quoi faire une lampe de chevet style Directoire, hein ?
Bon...les goûts et les couleurs...
Mais foin encore une fois des entourloupettes ! On cause, on cause et on ne s'occupe pas de l'ardu problème du grand manitou...
Le glaive, donc...Voilà l'instrument qui tranchera la question. Ultima ratio deorum.
Le grand manitou, brandissant son glaive qui ne lui servait à rien sinon à décorer ses nuages, coupa donc les âmes en deux et en distribua une moitié aux hommes et l'autre moitié aux femmes. Puis, se frottant les mains et bienheureux de s'être si facilement tiré d'embarras, il se reposa longtemps en ses sphères éthérées.
Là, c'est moi qui suis dubitatif. Je verrais plutôt une pagaille énorme, un brouhaha inextricable, une ruée, une foire d'empoigne, une bousculade, certains et certaines emportant une âme entière et les autres, bernique, étant condamnés à ne pas en avoir, ce qui, convenons-en, expliquerait pas mal les déboires futurs de l'humanité...
Mais, tout agréable que me soit cette interprétation, ça n'est pas comme cela qu'il en advint et il faut dire les légendes telles qu'elles nous ont été transmises. Non mais, des fois !
Chacun s'en fut donc avec sa moitié d'âme et n'eut désormais de cesse qu'il n'ait retrouvé de par le vaste monde, l'autre moitié, l'âme sœur....
Bonheur à ceux et celles qui ont eu de la chance - ou du flair - et qui réussirent à recoller les deux morceaux, réalisant ainsi l'harmonie parfaite, les autres étant voués à une perpétuelle quête, à la solitude et à la mélancolie.
Mais comme les âmes étaient, au départ, toutes ressemblantes et, partant, les moitiés itou, que d'erreurs, que de vilaines surprises, que de méprises et..... Que de vaisselle cassée dans les chaumières !
Image : Philip Seelen
*****************
La légende du temps

Harassé, il dut bientôt s'adosser au tronc d'un grand pin esseulé sur le désert des champs et, inspirant très fort, levant la tête sur les nuages, fermant les yeux, il implora pour qu'apparaissent bientôt dans les brouillards dansants les premières maisons d'un village.
Les premiers sons d'une voix fraternelle.
Il le fallait avant que la nuit n'engloutisse tout et que ne se mettent en maraude les bêtes sauvages des ténèbres... Sans quoi...
Mais son corps glissa lentement, ses jambes plièrent, il s'accroupit là, sous les morsures blanches du vent, et il s'assoupit.
Il fit encore un effort, secoua la tête, tenta d'ouvrir les yeux, reposa son front sur ses mains et finit par sombrer.
Tu es las, voyageur, très las...Tiens mon bras, prends appui sur mon épaule et viens...Il te faut encore longtemps marcher sur la plaine pour parvenir jusqu'aux hommes. Mais viens un moment te reposer chez moi.
Un vieillard parlait, qui tournait en rond aux côtés du voyageur. Un vieillard plus gris que les horizons, plus blanc que la neige, un vieillard affreusement maigre, sans âge humain tant il semblait surgi de la nuit des temps.
Tant il semblait aussi se confondre avec la plaine noyée de brumes, faire corps avec elle.
Dans son regard dansait pourtant une lumière sublime, étincelante, plus éclatante qu'un soleil au zénith... Il portait sur son front un diadème étrange et ses gestes étaient robustes et francs, sans une ride.
Viens te reposer un peu... Mon palais est là, tout près de toi.
Et un palais de glace et de neige aux murs transparents, recouverts de fleurs et de richesses inouïes, de perles d'or et de ruisseaux de diamants, s'ouvrit alors devant les yeux épouvantés du voyageur.
Ne t'effraie pas...Les richesses que tu vois là ne sont que des reflets. Elles sont tout ce que le monde possède de plus précieux. Elles sont les pensées de ce monde.
Je les recueille une à une dès qu'elles sont exténuées. Comme des fruits blets, sans odeur et sans saveur. Là, elles s'endorment d'un sommeil de glace pour retrouver un jour tout l'éclat que la fréquentation les hommes avait terni, sali, déformé, galvaudé, anéanti.
Car ces richesses resplendissantes, quand elles se sont longtemps assoupies ici, s'envolent à nouveau de par le vaste monde, alors la glace autour d'elle fond et la pensée retrouve tout son éclat, toute sa vitalité, tout son espoir, toute sa force originelle.
Et les hommes lui font alors la fête, s'écrient, hurlent, dansent, souvent même s'entre-tuent pour la mieux posséder et cette idée nouvelle, qui, en vérité, est bien plus vieille qu'eux-mêmes, aussi vieille que le monde est vieux, trompe, abuse et nourrit leur passion, leur vanité et leur orgueil.
Mais, balbutia le voyageur transi, qui es-tu en ton palais de glace et pourquoi tournes-tu ainsi perpétuellement en rond ?
Viens te reposer chez moi. Tu y trouveras le repos avant de reprendre, peut-être, un jour lointain, très lointain, ta marche sans but, ta marche sans raison, ta marche à la rencontre des hommes improbables, sur les neiges et le froid des plaines de Podlachie.
Je suis le Temps qui fuit, qui endort, et qui revient en songe.
*****************
La maison

Je m'étais arrêté là parce que le décor et les parfums de résine chaude auraient pu faire croire, en fermant doucement les yeux, qu'on se trouvait, non point à une cinquantaine de mètres de la Biélorussie, mais bien de l'autre côté du continent, au cœur de l'île d'Oléron.
J'étais donc là à rêvasser et à méditer sur le pouvoir évocateur des paysages et de leurs odeurs, quand j'aperçus un peu plus loin sous la pénombre bruissante de la pinède, dans une petite trouée, une vieille maison de bois, visiblement abandonnée. Rien de bien original, me direz-vous et impatients que je vous sens...
Mais attendez un peu que je vous dise.
Car cette maison, quoiqu’orpheline, solitaire, dégageait pourtant quelque chose d'étrangement présent. Une sorte de palpitation. Le bois, un peu vermoulu, en était propre, les volets en bon état, le toit de chaume non éventré, assez bien peigné même, et la végétation alentour, quoique abondante, semblait plus disposée à la protéger qu'à la vouloir ronger.
Cette maisonnette m'a ému, tant que, lisant bien plus tard le récit de Marya Kasterska, je l'ai spontanément reconnue. Forcément, il ne pouvait s'agir que d'elle. La légende avait soudain un lieu et prenait corps dans mon esprit.
J'ai donc appris que dans cette maison, au temps jadis des Jadzvingues, la clef en était toujours soigneusement disponible, posée sur la serrure. Chacun, à sa guise, pouvait ainsi y entrer.
Et chacun trouvait là un feu qui crépitait dans un grand poêle de faïence verte, une table agrémentée de quelques fleurs séchées et garnie de légumes frais, de fruits et de viande. Dans un coin, tout près du poêle, une couche molle à souhait attendait patiemment qu'on vienne s'y reposer.
Les tourbillons verdâtres du Bug berçaient alors le sommeil du voyageur tandis qu'au-dessus du toit de chaume le souffle de la nuit murmurait une tendre berceuse entre les branches lascives des grands pins et des bouleaux.
Mais un soir, un soir que la neige voltigeait au-dessus de la rivière, avec dans le ciel d'épouvantables nuages noirs qui semblaient vouloir toucher les cimes de la forêt, un étranger survint. Il était très pâle, il était long et maigre, il était vêtu de haillons maculés de boue et il était très triste.
Il se restaura, morose, insensible aux charmes du lieu, avant de s'endormir pesamment, tout crotté encore, sur le lit douillet.
Au matin, il jeta de l'eau sur le feu, fracassa les vases de fleurs, éparpilla dans les sous-bois ce qu'il restait de vivres sur la table et, ayant refermé la porte à double tour, jeta la clef dans les flots tourmentés du Bug.
Depuis lors, la maison est restée hermétiquement close. Bien des gens des alentours, bien des voyageurs - et même un conteur - ont essayé de l'ouvrir et de lui redonner vie.
Mais tous ont frappé vainement à sa porte.
Aussi vainement que s'ils eussent frappé le couvercle d'un lourd cercueil.
*****************
La source et le voyageur

Dans tout le pays des Jadzvingues, on disait de lui qu'il était un vieillard sage, savant et infiniment bon, comme on le dit de tous les ermites, à tel point qu'il semblerait bien qu'il suffit de fuir la compagnie des hommes pour accéder aussitôt dans leur cœur aux statuts éthérés de la philosophie accomplie.
Personnellement, je pense qu'on peut très bien être méchant comme une teigne, con comme un panier et bête comme ses pieds tout en vivant seul au fin des bois ou sur les sommets ensoleillés d'une montagne.
Mais cela n'engage que mes dispositions congénitales à la suspicion, passons donc outre et faisons fi de mes chicanes personnelles, à la fin !
Car il s'agissait là, dit la légende, d'un Zarathoustra des plus augustes.
Or, il advint qu'un soir de grande pluie, une pluie grise et froide qui fouaillait violemment les feuillages de la forêt, alors que le sage, allongé sur son lit de vieilles branches et d'herbes sèches était plongé dans de profondes méditations - car que peut bien faire un sage le soir au fond des bois sinon méditer, hein, je vous le demande bien ?- il advint donc, disais-je, qu'un voyageur égaré vint cogner à son huis.
Enfin, je veux dire plus précisément que le susdit voyageur secoua énergiquement les ramures qui tenaient lieu de porte, pour signaler sa présence et demander l'hospitalité.
Le sage le fit donc entrer, le sécha avec une lourde couverture qu'il lui enroula autour des épaules, le fit asseoir sur un rondin de bois brut et lui offrit un morceau de viande séchée, arrosé d'un petit verre d'une liqueur préparée avec les fruits sauvages des bois, avant de lui demander, de sa voix douce et chevrotante bien entendu, ce qu'il cherchait en ces lieux secrets où, depuis bien longtemps aucun humain, à part lui bien sûr, ne s'était aventuré.
Je suis venu consulter votre sagesse, lui dit le voyageur.
Car je vis sans vivre, je regarde ma vie passer devant moi sans jamais n'y avoir accès et mon cœur est plein d'un lourd chagrin. Je suis né sous une étoile noire, l'étoile des détresses ineffables et pourtant je voudrais vivre, vivre pleinement mon voyage. Je sens parfois dans mon sang bouillir et mugir l'appel de la joie et du désir de vivre mais cet appel reste obstinément prisonnier de mes mélancolies et ma vie passe comme un songe, comme un rêve inaccessible, comme un autre moi-même, comme une ombre fugitive.
L'ermite, vous vous en doutez fortement, ne répondit pas aussitôt. Comme tous les ermites savants, sages et bons, il caressa longuement sa longue barbe - blanche ? Oui, blanche - fronça le sourcil, plissa le front, qu'il avait évidemment large et puissant, et s'enfuit vers de profondes et amphigouriques méditations.
Enfin, il leva ses grands yeux - bleus ? Oui, bleus - sur le voyageur et lui dit qu'il lui fallait marcher droit, droit devant lui, toujours tout droit, sur le soleil levant. Qu'il avait vu sa destinée.
Tu enjamberas sept grands fleuves et escaladeras dix montagnes avant d'aborder une forêt d'aulnes géants, une forêt noire comme les plus noires des ténèbres. Là, tu entendras une source gazouiller sous les grands arbres. Tu boiras de son eau limpide et ton destin s'ouvrira devant toi comme s'ouvrent les portes d'un palais royal. Car c'est là, sous les aulnes géants, que ruisselle la source de la vie. Tu la reconnaîtras à la puissante émotion qui s'emparera de toi.
Le voyageur se mit alors en marche et marcha longtemps, longtemps, très longtemps. Il marcha des jours et des nuits. Il marcha des lunes et des lunes. Il vit les feuilles des arbres se colorer de jaune et de pourpre, il les vit tomber en tourbillonnant au vent, il affronta le gel et la neige et les tempêtes glacées, il vit les arbres reverdir encore, le soleil plomber la plaine sous ses dards brûlants et puis les feuilles à nouveau venir mourir une à une sur le sol...
Il marcha des années et des années durant. Il marcha jusqu'à l'épuisement, toujours droit devant lui.
Il enjamba bien des rivières et bien des fleuves, escalada bien des montagnes altières, écouta bien des sources tintinnabuler sous ses pas, mais ne sentit pas dans son cœur jaillir l'espoir et la soif de vivre.
Puis, un soir, en proie au dernier des désespoirs, il s'allongea sur le sol humide d'une sombre forêt...Alors, son cœur fit un bond joyeux dans sa poitrine, son sang jaillit et alluma ses veines, son âme fut soudain submergée comme par un doux élixir, l'élixir du bonheur et du désir d'aimer.
Sous son corps meurtri, il entendit nettement, à travers une mince couche de terre et de feuilles mortes, chanter la source de la vie.
Il lui fallait maintenant gratter de ses ongles, voir l'eau et la boire. Il exultait, il souriait, il....il se coucha sur le dos, épuisé.
Plus la force soudain de vouloir encore.
Il regarda les aulnes géants qui se balançaient au vent mélancolique du crépuscule, ferma les yeux, tenta de les rouvrir une dernière fois encore et s'éteignit là.
À deux doigts du bonheur d'exister.
*****************
Le cœur de la femme
 On s'affairait dur, ce soir là, dans les gigantesques et célestes ateliers du grand manitou.
On s'affairait dur, ce soir là, dans les gigantesques et célestes ateliers du grand manitou.
Il y régnait la frénésie des veilles de grands évènements et le joyeux brouhaha des derniers préparatifs d'une fête : demain en effet, à l'heure où blanchiraient les nuages, serait créé le vaste monde.
Tandis que les divers aide-manitou vaquaient eux-mêmes à moult vérifications de dernière minute, le maître de céans, grave et sérieux comme (j'allais dire un pape mais c'eût été ridiculement mettre la charrue très loin devant les bœufs), sérieux comme se doit de l'être un grand manitou, alors, était en train de régler minutieusement la course très prochaine de l'astre solaire. Il s'agissait là de ne pas faire d'erreur. Toute la vie sur terre en dépendrait pour une large part.
Un de ses aides vint néanmoins le timidement distraire de ses augustes préoccupations.
Nous avons tout scrupuleusement contrôlé, ô illustre et grand manitou ! Tout nous semble paré pour un monde des plus harmonieux... Nous avons une dernière fois ausculté le cœur des hommes. Il est bien, comme vous l'aviez impérativement recommandé, dur comme le bois de chêne et opportuniste comme le gui qui se nourrit de la souffrance des autres.
Voyez comme la Création avait une curieuse idée de l'harmonie. Mais passons outre, là n'étant point le cœur de la légende et ça nous emmènerait trop loin si nous nous mettions en devoir d'ergoter là-dessus (ndlr)...
Bien, répondit le grand manitou à son céleste ouvrier, sans même se retourner et sans s'extirper de ses profondes méditations quant à la course prochaine du soleil.
L'aide se racla la gorge et, encore plus timidement, se plaignit cependant qu'aucune directive n'avait été donnée quant à l'essence du cœur de la femme et que c'était bien embêtant, ça... Hum...Hum...
Le grand manitou ne répondait pas, toujours penché sur l'astre de feu.
Hum... Hum...se racla derechef l'auxiliaire scrupuleux.
Intervint alors un autre lutin qui accourait d'un atelier voisin et qui s'exclamait, enthousiaste, émerveillé. Aux anges, si j'ose dire.
Je suis allé voir comment seraient les moissons des hommes. J'ai vu des plaines immenses et blondes se courber sous la brise légère et les lourds épis frissonner doucement en se frottant les uns contre les autres. J'ai vu des bleuets aux yeux splendides, j'ai vu des hommes robustes vider les champs, engranger et faire le pain de la vie. Et derrière les glaneuses, j'ai cueilli une toute petite plante aux feuilles finement dentelées, aux fleurs délicatement mauves, et qui avait un parfum frais, un bouquet qui donne le vertige.
J'ai entre mes doigts écrasé une de ses feuilles. Et plus je l'écrasais, plus elle exhalait un arôme encore plus enivrant.
Plus je la tourmentais de ma curiosité et de mon admiration et plus ses effluves se faisaient suaves, folles, sublimes.
Quelle est donc, ô puissant grand manitou, cette plante merveilleuse que vous avez créée là ?
Et le maître de céans, sans répondre à ce petit et second et enthousiaste lutin qui venait le déranger dans ses lumineux calculs, se tourna tranquillement vers le premier.
Cette plante est ce qui te semblait n'avoir pas été créé. Elle est le cœur de la femme.
Laissez-moi maintenant terminer de régler l'alternance des ombres et de la lumière, tel un vaste balancier du temps, de la vie et de toutes choses qui, demain, à l'heure où blanchiront les nuages comme déjà dit, seront le monde.
NDLR encore : Je ne suis pas certain, pour une foule de raisons qui nous emmèneraient trop loin si nous nous mettions en devoir d'ergoter là-dessus, d'être bien d'accord avec l'esprit de cette légende.
Mais les légendes ne sont pas faites pour qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec leur esprit.
Elles sont du vent qui passe. Elles se transforment, voyagent, rebondissent, arrivent jusques à nous, s'arrêtent un instant et repartent à l'autre bout des quatre horizons.
*****************
La légende du rêve

Son cœur en effet était la proie de la plus terrible des douleurs : son fils, son fils bien aimé, le futur souverain du pays des Jadzvingues, étendu sur sa couche depuis des lunes, muet, les yeux obstinément perdus dans le vague, se mourait lentement d’une étrange maladie qu’aucun savant ni sorcier n’était jusqu’alors parvenu à identifier.
Au désespoir, le roi des rois, le bon roi des Jadzvingues, se résolut à faire venir en son palais l’astrologue, celui qui savait lire dans le grand ciel des nuits d'été, celui qui parlait aux étoiles lointaines et prédisait par-delà les horizons.
Il lui enjoignit de se rendre immédiatement au chevet du dauphin et d’en deviner tout le mal. Le lecteur des astres et du grand mouvement des choses veilla alors sur le sommeil de son royal patient et quand Vénus brilla au-dessus de sa couche, l’éclairant d’une fine et pâle lueur qui vacillait, il vit apparaître la maladie qui accablait le jeune garçon.
Ce après quoi, morose, il revint en informer le bon roi.
Parle ! Ne me fais pas languir, parle ! Dis-moi la souffrance de mon fils chéri !
L’astrologue hésita un moment, s'inclina légèrement en frottant sa grande barbe blanche et murmura que le jeune Jadzvingue se mourait d’amour…
À ces mots inattendus, le roi des rois éclata de rire et tendit ses bras charitables vers le savant des firmaments.
Approche, que je t'embrasse ! Approche ! Je te couvrirai d’or et de diamants, astrologue, puisque tu nous délivres aujourd'hui de bien funestes présomptions ! Si le prince est malade d’amour, alors, je saurai le vite guérir. Sois béni, divin astrologue !
Si celle qu’il aime est encore vierge, elle sera sa femme avant que la lune n'atteigne son plein.
Si elle est mariée, alors je déclarerai la guerre à nos plus proches voisins, je placerai son mari aux premières lignes de la bataille, il tombera aussitôt, couvert de gloire et de bravoure (accessoirement de sang, NDLR) et nous fêterons en même temps ses funérailles et le mariage de la veuve et du prince.
(Voyez dès lors comme je ne vous ai point abusés, lecteurs et lectrices, en vous signalant que ce roi était vraiment bon...)
L’astrologue cependant frottait de plus en plus sa barbe en baissant de plus en plus la tête.
Mais, roi des rois, bon roi, on ne peut épouser qu'une femme vivante…
Le roi pâlit, se leva d’un bond et s’écria : Comment ? Que me chantes-tu là, astrologue de malheur ? La femme idéale de mon fils, celle dont il est épris au point d'en avoir sombré, serait-elle morte ?
Elle n’a pas pu mourir, répondit dans un murmure l’astrologue qui se courbait maintenant. Elle n’a pas pu mourir puisqu’elle n’a jamais vécu…
Je l’ai vue néanmoins devant moi, qui dansait sous la lumière étrange des étoiles du ciel…Cette femme est délicieusement belle, roi des rois. La plus belle et la plus inaccessible de toutes les femmes. Ses yeux sont grands et scintillent comme les mille broderies de la nuit, ses cheveux sont noirs et lourds et des reflets d'azur brillent autour de leur long ruissellement, son parfum évoque des rivages inconnus aux couleurs chatoyantes et son corps est plus fin que le plus fin des diamants.
Le prince, hélas, jamais ne la serrera dans ses bras et longtemps se languira encore à vouloir la posséder…Il se languira jusqu’à en mourir bientôt.
Parle, maudit astrologue ! Parle ou je te fais trancher la tête sur le champ, rugit le roi des rois, le bon roi des Jadzvingues …Parle ou je te livre à d’odieuses tortures, je te fais arracher la langue, je te fais dresser un bûcher, je te damne à jamais !
Dis le nom de cette femme !
(Voyez derechef comme je ne vous ai point abusés, lecteurs et lectrices, en vous signalant combien ce roi était bon...)
L’astrologue s’inclina alors très bas, tellement bas que sa barbe en effleura le sol et il chuchota enfin :
Cette femme s’appelle…le Rêve.
*****************
Les Tulipes

Il semblait surgir de derrière le ciel tombé sur l'horizon. Il montait un cheval ordinaire, sans éclat, sans noblesse, et lui-même n'était ni beau, ni resplendissant. Son visage était long, ses yeux semblaient mélancoliques, ses vêtements étaient pauvres sans être des haillons.
De longs cheveux jaunes flottaient sur ses maigres épaules.
La nuit allait tomber et engloutir le monde de ses ombres d'inquiétudes latentes, tant que l'étranger demanda l'hospitalité dans un village tapi aux lisières d'une forêt antique.
Pour prix du gîte et du couvert, il offrit de raconter des contes et de raconter des légendes.
Toute la nuit, sa voix telle une mélopée, décrivit des guerres d'honneur et des princesses enfuies, des fleurs recouvertes de sang, des rois éperdus d'amour ou d'une cruauté sans limites, des aurores flamboyants tels des incendies, des pays inconnus que berçaient les vagues d'un océan, par-delà la forêt et par-delà la plaine, presque par-delà le monde.
L'étranger chantait plus qu'il ne racontait. Sa phrase était longue et douce, rythmée, et son verbe, haut en couleurs, brillait de tous les feux sacrés de la poésie.
Les Jadzvingues étaient sous le charme et la fille du chef buvait jusqu'à l'ivresse les chants du jeune poète. Son âme avide s'envolait très loin, très loin par-delà la forêt et par-delà la plaine, presque par-delà le monde. Un souffle brûlant soulevait sa poitrine et ses grands yeux noirs refermés sur la nuit, levés sur les cieux inconnus, laissaient quelquefois perler entre les longs cils, une larme attendrie.
Quand blanchit enfin la plaine, le poète se tut, remercia, baisa la main de la jeune fille, plongea longtemps ses yeux dans ses yeux, et reprit sur la plaine sa course vagabonde.
La jeune fille le vit qui s'évanouissait entre les herbes sauvages des champs et tomba à genou, par l'amour anéantie....Le jeune poète se retourna, lui aussi éperdu de désir, mais, plutôt que de tourner bride, il fouetta son cheval et disparut au galop.
À partir de ce jour nouveau, la jeune fille, faite femme, ne connut plus que les affres du mensonge. Elle disait des « je t'aime » à un mari qu'elle n'aimait point, elle n'avait de cesse que de lui dire toute sa tendresse et, disant tout cela, s'adressait au poète que les horizons incertains avaient si cruellement englouti. À la mort de son père, son mari devint le chef du village et elle exerça sur tous les villageois un pouvoir sans douceur ni concessions, comme si elle eût cherché à se venger d'un destin contraire et voulu par la laideur de la méchanceté, effacer la beauté d'un rêve fugitif.
Un matin cependant, que l'été montait doucement à l'assaut d'un grand ciel bleu, que tournoyait là-haut l'aigle pomarin, l'étranger réapparut et, prostré devant elle, lui chanta la fin de son errance et toute l'espérance de son amour.
La femme le dédaigna, le repoussa et ne voulut point l'entendre.
Elle le fit par son mari chasser durement du village, tandis qu'en son cœur la flamme de l'amour et la flamme de l'orgueil, le désir de partir et le désir de régner, se livraient une bataille échevelée de souffrances.
Le poète congédié sembla, cette fois-ci, s'enfoncer dans la terre, là où elle embrasse la dernière ligne du ciel, et sa voix où roulaient des sanglots, chantait toute la mélancolie du monde.
La femme au village guetta en secret, chaque jour, les brumes de l'horizon, là-bas, au-delà des herbes folles de la plaine.
Tant qu'elle en mourut de chagrin, un chagrin muet, irrémédiablement condamné au silence par l'orgueil, et que son dernier souffle fut en même temps son dernier mensonge.
Et lorsqu'on voulut l'habiller de ses vêtements mortuaires, de grosses fleurs se répandirent soudain sur le sol, ruisselant en cascades de la froideur de son corps.
Elles avaient des calices rouges, dressés comme des flammes et un mince filet d'or brodait leurs galbes gracieux.
Elles n'exhalaient aucun parfum mais levaient très haut leur superbes têtes, hautaines et vaniteuses.
Ce furent là les premières tulipes qu'il fut donné aux hommes de voir.
*****************
La Viorne
 L’homme venait de loin…De vraiment très loin.
L’homme venait de loin…De vraiment très loin.
Il venait de pays bien plus lumineux que ne le sont les plaines désertes de Podlachie. C’est du moins ce qu’il prétendait.
Il venait de là-bas, par-delà les plaines, les bois, les forêts, les vallées, les montagnes, les fleuves et les rivières…Il venait d’aussi loin que peut venir le vent…Des rives inconnues d’une grande étendue liquide et mouvante, qu’il appelait la mer, à l’autre bout du monde.
Il disait que là-bas, les hommes faisaient sur les tables des tavernes s’entrechoquer des pièces d’or ; Il disait qu’avec ses pièces ils achetaient, ils construisaient, ils échangeaient des richesses et vivaient dans une joyeuse opulence.
Il disait que s’élevaient là-bas, à la gloire du grand Manitou, des bâtiments pharaoniques, à la pierre finement ciselée et dont les clochers en forme d’aiguille s’élevaient bien plus haut que les nuages en pluie. Et, ce disant, il montrait avec dédain les misérables huttes de bois et de chaume, toutes de guingois, des Jadzvingues, qui écarquillaient les yeux, bouche bée, transportés par les mots qui ruisselaient des lèvres magiques du voyageur.
Plus que tout autre, une jeune fille s’enivrait des paroles de cet homme. Son âme s’enfuyait vers ces contrées mystérieuses et ses yeux verts, obstinément rivés sur le voyageur, flamboyaient d’un espoir infini. Elle avait nom Kalina, comme d’autres s’appellent Marguerite, Rose ou même Narcisse car Kalina désigne aussi la Viorne, ce petit arbrisseau aux fines feuilles dentelées et aux baies rouges, qui mûrissent en automne, près des ruisseaux.
L’homme remarqua bientôt le regard de Kalina et la tendre silhouette de la jeune femme et ses longs cheveux bruns qui tombaient en ruisseaux épars sur ses belles épaules.
Il dit qu’il voulait l’épouser, qu’il lui montrerait ces pays paradisiaques d’où il venait et qu’il la couvrirait aussi d’or et d’argent.
Kalina fut aux anges et accepta, le genoux à terre, que le voyageur venu des antipodes devint son compagnon.
On fit une fête énorme, tout le village dansa, s’enivra et chanta et au matin, le voyageur prit la jeune femme en croupe (du cheval, ho, ho, ho…ndlr) et l’emportant loi du village, des huttes et des forêts. Les brouillards de la plaine les enveloppèrent bientôt, qui disparaissaient sur l’horizon humide.
C’est alors que Kalina déchanta...
C’est toujours comme ça, dans les légendes, les bons s’avèrent bientôt être des méchants et vice-versa…Bref…
Car, au cours du long voyage, l’homme lui parlait durement, la rudoyait même, et lui donnait les ordres les plus abjectes, outre la cuisine, le cirage de ses bottes, le dépoussiérage de ses habits, l’étrillage du cheval, et le port des bagages si le terrain était trop lourd et qu’il fallait économiser la fatigue de la monture.
Mais pire il y eut bien pire…Il y eut l’irréparable meurtrissure. Dans des tavernes obscures, turbulentes, remplies du fracas des ripailles, l’homme, pour quelques pièces d’or en vint à vendre les beautés de sa jeune femme.
Kalina ayant réussi à tromper la vigilance de son bourreau, un soir qu’il était ivre et faisait bombance avec d’autres dépravés de son acabit, revint au village après un long, très long voyage.
Mais son cœur était humilié et sali à jamais…Elle pleurait et des larmes de sang s’écoulaient de se paupières.
Elle dit que l’homme était le diable ; Que tous les hommes là-bas, riches, étaient des diables car ils achetaient et vendaient tout, même la vertu des femmes.
Elle alla s’allonger dans la forêt, en lisière du village et voulut mourir là, sur le bord d’un ruisseau et des pleurs de sang, les pleurs de la honte et de l’infamie, ruisselaient de se yeux épouvantés.
Et c’est pourquoi les forêts humides de Podlachie regorgent de cet arbrisseau, la viorne, et qui, chaque automne, sempiternellement, jette au ruisseau ses gouttelettes rouge-sang…
*****************
Le Prince et le mendiant

L'ombre des forêts bruissait de milliers d'insectes affairés et les abeilles y butinaient, dans un bourdonnement incessant, les tilleuls en fleurs. Les ruches disposées là, sur les lisières, ruisselaient d'un miel doré.
L'air en était tout parfumé.
Une légère brise faisait onduler les épis de blé répandu sur la plaine, telles les vagues chaudes d'une mer blonde et lascive.
L'âme du prince se sentait alors pleine de vie en ces paisibles paysages et il chevauchait lentement, goûtant pleinement la beauté de son pays, muet d'une sorte d'attendrissement bucolique, tandis qu'une douce mélodie trottinait dans sa tête enjouée.
Au détour d'un chemin creux cependant, il aperçut, assis dans l'herbe épaisse du bas-côté, un homme qui tendait une main tremblante.
C'était un vieux mendiant, sale, recouvert de haillons tellement troués et tellement en lambeaux qu'on apercevait au travers son corps décharné, bruni par les feux du soleil, martyrisé par la soif et la faim.
Le prince descendit prestement de cheval, examina l'homme d'un œil humecté d'une soudaine compassion. Il prit dans sa main gantée de velours la main tendue, osseuse, longue, qui laissait voir les veines bleuâtres et gonflées, et qui tremblait toujours.
Holà, mes gens ! Qu'on apporte des habits brodés d'or et des fourrures ! Qu'on lave ce malheureux, qu'on le parfume et qu'on l'habille comme un homme de cour. Qu'on lui serve ici-même des viandes rôties choisies parmi les plus exquises et qu'on remplisse d'hydromel frais des coupes d'argent. Qu'on lui donne tout ce qu'il demandera et qu'on le conduise ensuite au château, qu'on lui réserve là-bas la plus belle chambre de la tour et qu'on attache à son service les domestiques les plus zélés.
On se précipita évidemment pour exécuter les ordres du puissant prince, lequel prince souriait aux anges, fier de son infinie bonté. Il s'approcha encore du malheureux et vit, à son grand étonnement, que des larmes abondantes ruisselaient de ses yeux et inondaient la barbe en broussailles.
Mais qu'as-tu donc à pleurer, pauvre homme ? N'es-tu pas satisfait du sort qui t'attend ? Te rends-tu seulement compte de l'avenir radieux qui s'ouvre à toi et que je t'offre ?
Et le mendiant hoqueta, presque tout bas :
Je pleure, Sire, parce qu'il n'y a pas plus grand malheur au monde que celui qui m'advient aujourd’hui de ne plus rien avoir à désirer !
*****************
Le retour du chevalier

Pourtant, cette nuit-là du mois d’août était douce et suave. Sans les milliers d’étoiles au ciel, sans la course étincelante, çà et là, des astres lumineux qui semblaient vouloir tomber des firmaments jusque sur la cime des arbres et allumer la forêt, on eût pu se croire par une belle nuit du mois de mai.
Panachage subtil de résine des grands pins, de serpolet et de bruyère, les senteurs flottaient sur les lisières et par les sentiers obscurs des sous-bois.
Par cette nuit-là, délicieusement calme, un grand cheval noir, puissant, nerveux, s’arrêta devant le portail d’un vieux manoir retiré dans les profondeurs de la forêt, au bout d’une allée plantée d’ormes et de tilleuls antiques.
Le chevalier contempla longtemps la sombre masse du manoir. Tout était silencieux et endormi alentour. Seule une bougie vacillait, très haut posée dans la tour, au rebord d’une fenêtre fermée.
Enfin, s’extirpant de sa rêverie, le chevalier sauta à terre et vint frapper au lourd portail de bois, planté de clous énormes.
Qui vient là ?
Ouvrez, ouvrez, bonnes gens ! Ouvrez, Princesse aux yeux si bleus ! Je suis le chevalier qui jadis vous abandonna à votre solitude et qui revient aujourd’hui vous dire le monde.
Car nulle part ailleurs, il n’y avait de bonheur.
J’ai pourtant traversé des pays, des forêts, des montagnes et des fleuves. Nulle part, il n’y avait le calme de votre demeure.
J’ai même traversé le désert. Nulle part il n’y avait d’oasis. Et je reviens vers vous, ma princesse, pour vous aimer et vous dire que le bonheur est là, entre vos bras, derrière cette porte, et que tout l’inconnu du vaste monde n’est rien comparé à la douceur de votre voix, à la clarté de vos yeux, à la tendresse de vos baisers.
Chevalier noir, dit une voix que le chevalier ne reconnut pas, c’est que la porte est lourdement fermée et rouillée.
Je vais la briser avec mon épée.
C’est que les arbres sont hauts maintenant et obstruent le passage, Chevalier noir.
Je les abattrai avec ma hache.
C’est aussi que la rivière est profonde et tumultueuse à présent.
Mon fidèle cheval l’enjambera d’un bond.
Mais, Chevalier noir, c’est que la Princesse dort d’un paisible et profond sommeil.
Je connais les mots qui la réveilleront ; n’ayez crainte.
Alors la voix, une voix chevrotante et faible, murmura derrière le lourd portail. Chevalier noir, ne touche pas à la porte, ne coupe pas les arbres centenaires, ne franchis pas la rivière aux eaux profondes et ne dit surtout plus rien.
Car il n’existe plus de parole qui puisse réveiller la Princesse aux yeux bleus.
Elle a trop attendu cependant que vous couriez le monde et les déserts brûlants.
Elle a tant attendu qu’elle s’est elle-même, de lassitude et de désespoir, enfuie vers des pays plus lointains encore que les vôtres. Inaccessibles et froids.
Et la bougie qui vacille dans la nuit, là haut-sur la tour, veille depuis des années et des années, sur son voyage sans retour.
Á présent, va - t’en !
*****************
Le lys d'or
 Aux temps d’autrefois, toujours sur les plaines de Podlachie où vivait le peuple des Jadzvingues, était un jeune prince.
Aux temps d’autrefois, toujours sur les plaines de Podlachie où vivait le peuple des Jadzvingues, était un jeune prince.
La légende ne dit pas s’il était charmant, mais elle affirme qu’il était triste, très triste, triste à en mourir, d’une mélancolie maladive et trouvant même un certain bonheur à cette mélancolie.
Un romantique bien avant l’heure, pourrions-nous avancer avec un peu d’audace, si nous en avions. De 'audace, je veux dire...
Son mal de vivre était si poignant, il se croyait tellement le plus malheureux des hommes de la terre, qu’il se retira du monde un beau jour et vint vivre ses accablements en son palais, situé aux confins de la Podlachie, aux portes d’un désert.
C’était un beau palais entouré de jardins luxuriants et agrémentés d’arbres gigantesques, de plantes délicates et de fontaines de toutes sortes ; Un palais comme seuls en possèdent les gens de haute lignée.
Là, dans une volupté secrète, le prince s’isola donc et de sa solitude attisa encore ses douleurs et ses chagrins.
Un matin de grand soleil, très tôt, cependant qu’il était penché à sa fenêtre et contemplait sans les voir son grand parc et ses arbres centenaires, une main se posa sur son épaule.
C’était une jeune femme. Un fantôme de jeune femme plutôt, car elle était toute vêtue de blanc et son visage était entièrement voilé.
Sais-tu, dit l’apparition, qu’il y a en tes jardins un lys d’or qui a soif et qui ne doit pas mourir ? Il doit fleurir aujourd’hui même. Je le sais. Viens avec moi, aide-moi à le découvrir, nous l’arroserons et tous tes jardins en resplendiront d’autant, et la vie jaillira par chaque plante, par chaque fleur, par chaque arbuste et par chaque arbre.
Car vois-tu, la rosée du matin est encore perlée sur les herbes des allées, mais le soleil va monter au zénith et bientôt tout sera desséché. Alors, il sera trop tard…
Mais le prince mélancolique, tout à l’examen de ses blessures et de ses chagrins intimes, se dit que la journée serait longue et que s’il fallait trouver un lys d’or aujourd’hui, il avait encore bien du temps devant lui.
Il n’écouta pas la jeune femme et se réfugia dans ses noires pensées.
Vers midi cependant, sous les feux brûlants de l’azur, la femme revint et l’implora encore. Cette fois-ci, remarqua négligemment le triste prince, ses voiles blancs étaient poussiéreux et sa voix tremblait légèrement.
Longtemps j’ai marché à travers les déserts torrides pour venir te dire et te montrer le lys d’or. Je suis lasse, très lasse. Viens avec moi chercher le lys d’or de tes jardins. Regarde le soleil qui flamboie et incendie déjà la vie. Viens vite. Il faut trouver le lys d’or et le rafraîchir d’une eau claire, sans quoi il sera irrémédiablement perdu.
Mais le prince mélancolique, tout à l’examen de ses blessures et de ses chagrins intimes, se dit que la journée serait longue et que s’il fallait trouver un lys d’or aujourd’hui, il avait encore bien du temps devant lui.
Il n’écouta pas la jeune femme et se réfugia dans ses noires pensées.
Au crépuscule, le petit fantôme tout blanc réapparut pour la troisième fois, mais cette fois-ci, son habit était maculé de terre et de sang, sa voix n’était plus qu’un gémissement et, au travers des voiles, par endroits déchirés, qui recouvraient le visage, le prince vit de grosses larmes qui coulaient.
Pour la troisième fois aussi, il ne l’écouta pas.
Beaucoup plus tard cependant, dans la nuit encore tiède, il s’extirpa enfin de son atrabilaire rêverie, se souvint de l'apparition et voulut l’appeler.
Seul lui répondit le grand silence des étoiles et du ciel. Une chouette passa dans l’ombre épaisse et le frôla de son aile chuintante. Le prince tressaillit.
Il descendit aux jardins.
Dans la grande allée, près d’une fontaine qui ne coulait plus, gisait un magnifique lys d’or, mais il était détruit, flétri, fané et toutes les herbes, toutes les plantes, toutes les fleurs alentour étaient jaunies, desséchées, lamentablement recroquevillées sur le sol, comme si les sables du désert tout proche avaient franchi l'enceinte du palais et s'étaient jusqu'ici répandus.
Le prince crut alors reconnaître, tout près du lys d’or, un morceau de voile souillé et cruellement déchiré.
Et, cette fois-ci, sa douleur fut tellement réelle et tellement vive, qu’il en perdit complètement la raison.
*****************
Le roi et le courtisan

Les bourreaux - comme tous les bourreaux de la planète et de l'histoire - s'appliquèrent avec zèle à obéir à leur souverain. Ils coupèrent le nez et les oreilles de l'homme, puis, jugeant sans doute que c'était bien trop peu en expiation d'un outrage à Majesté, lui crevèrent les yeux et lui arrachèrent les dents.
Enfin, toujours en vertu des ordres royaux, ils le conduisirent aux portes de la ville et le jetèrent à terre, tout gémissant de douleur et tout sanguinolent.
Le pauvre homme réussit néanmoins à ramper, à se traîner dans les hautes herbes des fossés qui tenaient lieu de défenses, puis, titubant, à tâtons, lentement, chutant souvent lourdement, il rejoignit la vaste et sombre forêt.
Or, il advint que des années plus tard, ce bon roi à l'âme on ne peut plus raffinée - comme on vient de le constater - passa par hasard devant une cabane, au cœur de la forêt, alors qu'il forçait un cerf, accompagné de ses seigneurs les plus dévoués et de ses courtisans les plus en vue du moment. (Les pauvres ! ndlr)
Il vit là un vieillard aveugle, habillé d'affreux haillons et assis sur le seuil de la déplorable masure.
Oh, je sens que vous avez deviné, fins lecteurs que vous êtes ! Pas moyen de vous tenir en haleine sur le moindre suspens ! Ah, que c'en est décourageant, tenez, de vous raconter des légendes ! Moi qui avais fomenté le coup de vous surprendre et de vous faire tressaillir !
C'était donc bien, oui, l'ancien courtisan mutilé qui étais assis là, devant sa cabane toute de guingois.
Le roi le reconnut et eut soudain pitié de lui.
Un peu tardivement, il me semble...(ndlr)
Viens avec moi, je t'ai fait bien du mal autrefois et j'en ai des remords...Mais je veux réparer et que tu me pardonnes. Viens avec moi et tu seras à nouveau riche, puissant et heureux de vivre.
Il en a de bonnes, ce fichu roi...Riche et puissant, d'accord, mais le nez, et les oreilles, et les dents et les yeux ? Hein ? Mais il est vrai que les monarques, en cela imités à la perfection par les bourgeois qui leur succèderont un jour sur les trônes et dans les palais du monde, pensaient que tout pouvait s'acheter et être réparé par l'argent, le luxe et le pouvoir.
Mais je m'éloigne, je m'éloigne...
Ce roi-là cependant entendit sa victime lui répondre que la richesse et la joie de vivre, il les avait acquises ici, au cœur de la forêt et qu'il n'avait plus besoin de rien, ni des honneurs, ni du faste princier de la cour.
Ebahi, le roi s'exclama mais comment as-tu obtenu tout cela, solitaire et infirme que tu es, en haillons et vivant sous ce misérable toit ?
Loin du monde, j'ai trouvé le secret du bonheur. J'entends des mélodies que ton oreille n'entendra jamais, monarque ! Je vois des choses que tu ne verras jamais de tes yeux, des choses si belles que ton âme ne peut pas même les imaginer. Les plus suaves merveilles du monde, de ton monde, ne peuvent égaler celles qui parcourent mon rêve. Et tout ceci, monarque, en dépit de ta puissance, tu ne pourras jamais me le prendre : Car tu n'y auras jamais accès. Et ça n'est pas toi, dès lors, qui es mon débiteur mais moi qui te suis redevable de tous ces magnifiques songes qui habitent la nuit dans laquelle m'a plongé ta vengeance.
Et le vieillard se mit à raconter de si beaux contes, de telles légendes, que le roi subjugué, la voix éteinte, demanda : Où donc as tu appris tout cela ?
L''aveugle murmura alors :
Dans la souffrance que tu m'as infligée.
NB : Si je devais faire l'analyse, même succincte, de cette légende, je dirais qu'elle ne me plaît pas beaucoup ... Car la vieille rengaine, souffrance qui déboucherait sur le bonheur immatériel, les curés de tout poil l'ont trop rabâchée pendant des siècles et des siècles pour asseoir leur domination sur l'ignorance et protéger les riches des séditions du pauvre...
Mais je ne dis rien de tout ça, critiquer une légende n'étant pas de ma compétence...
*****************
La joubarbe

Il advint que la petite troupe, longeant un maigre ruisseau qui gargouillait entre de hautes herbes, croisa le chemin d’un vieux mendiant, lui aussi en haillons, mais libre de ses mouvements.
Il portait avec lui un sac en peau de chèvre et une large coupe à boire.
Le chef des soldats - car les soldats, comme vous le savez, ont toujours un chef à leur tête, quand bien même ne seraient-ils que deux - enjoignit alors au vagabond de descendre au ruisseau, d’y remplir immédiatement sa coupe d’eau et de venir la porter aux lèvres desséchées du prisonnier.
L’homme ne regarda même pas le soldat, secoua la tête et passa son chemin en disant qu’il était un pèlerin et qu’il n’avait pas le droit de s’arrêter n’importe où.
Le pauvre prisonnier, passant sa langue sur ses lèvres douloureuses, en fut accablé. Il parvint à murmurer, la tête basse : Si tu es un pèlerin, alors, sois éternellement pèlerin et ne t’arrête jamais !
Quelques jours, plus tard, dans un village tapi à l’ombre des forêts, le prisonnier fut pendu haut et court par ses juges.
Et le mendiant, des années après cet évènement, mourut aussi de vieillesse, quelque part dans un village de la plaine, parmi les siens retrouvés.
Et sur sa tombe, parmi les mousses et les fines herbes, on vit croître une plante étrange et qu’on n’avait jamais vu auparavant, une petite plante aux fleurs dorées.
Elle rampait d’un tombeau à l’autre, tant qu’elle parvint à sortir bientôt du cimetière…On la vit alors qui rampait encore le long des chemins difficiles, brûlés par le soleil et battus par un vent du sud, un vent souvent sec et chaud, chargé d’une âcre poussière.
Depuis, la joubarbe rampe, elle rampe toujours dans les endroits les plus surchauffés des paysages, et elle fuit l’eau, elle déteste la fraîcheur.
On a beau la fouler au pied, l’arracher, elle repousse et reprend sans jamais s’arrêter sa course au ras du sol, sous les feux du soleil.
Et les Jadzvingues disent que c’est là l’âme du vieux mendiant qui erre et expie son crime et qui rampera éternellement, chassé du firmament par les dieux expiateurs.
Post scriptum : Sur cette légende, je vous dois quelque vérité.
J’en ai gardé la trame mais je l’ai entièrement réécrite. J’ai surtout supprimé les héros, car je soupçonne l’auteur d’avoir récupéré de la mémoire collective au profit de sa propre idéologie…
En fait, sous la plume de Maria Kasterska, le prisonnier s’appelle Jésus et les soldats sont ceux de Ponce Pilate.
Or, ça ne tient pas debout, et ça m’a d’autant énervé que l’étymologie de joubarbe « jovibarba », signifie barbe de Jupiter.
*****************
Le pêcheur de perles
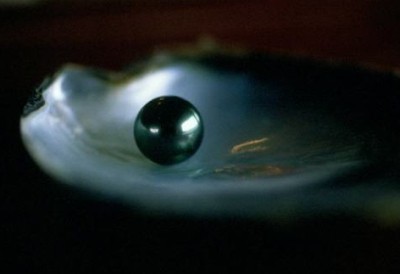 Au bord du lagon, les hommes plongent et replongent encore.
Au bord du lagon, les hommes plongent et replongent encore.
L’air de l’été est chaud. Très chaud.
Une brise accablante dessine sur l’eau des vaguelettes que le soleil fait miroiter tel qu’on dirait des diamants à la dérive.
Les hommes nus s’élancent, plongent et reviennent à la surface, essoufflés, leur longue chevelure ruisselante, avant de disparaître encore dans la profondeur des eaux.
Un homme cependant demeure immobile sur la rive déserte. Il ne plonge pas. Son regard, obstinément, fouille les bords du lagon, là où il vient mourir dans un clapotis tranquille.
Viens avec nous ! Viens ! Nous ramènerons des perles et ce soir au village, les femmes et les enfants nous fêteront. Les enfants danseront et les femmes mettront dans leurs cheveux bruns des fleurs multicolores et des parfums délicats. Nous déposerons à leurs pieds toute la richesse bleutée de nos trésors ! Viens plonger !
Pêcheurs, cherchez sous l’eau encore le rêve de votre vie. Moi, je reste ici, sur les berges désertes.
Car un jour, un jour de plein été tel qu'aujourd’hui, j’ai plongé tout comme vous.
Et des fonds secrets du lagon, j’ai ramené une perle merveilleuse, énorme, polie et ciselée par les temps infinis passés sur son éclat.
Mais peut-être n’était-ce pas une perle. Elle était tellement grosse ! Peut-être n’était-ce qu’une simple pierre et le soleil jouant dessus m’a fait croire un moment que j’avais trouvé la richesse…
Oui, sûrement, c’était un vulgaire caillou…Un mirage.
Avec dédain, je l’ai rejeté loin dans l’eau et là, juste avant de s'engouffrer sous l'eau, il a brillé avec tout l'éclat fugitif du diamant.
J’ai cru…J'ai frissonné...J'ai été épouvanté.
J’ai compris que si c’était une perle, c’était la plus fabuleuse de la terre, la plus précieuse, la plus recherchée, la plus mirobolante...
Mais non. Ça n’était sans doute qu’un caillou.
Mais si c‘était une perle, alors je venais de rejeter à l’eau tous mes rêves, tous mes espoirs les plus fantasques...
Et depuis lors, je guette et j'attends que le lagon me la rende.
Pour savoir si c’était une perle fabuleuse ou une pierre comme on en trouve des milliers, partout.
Mais qui donc me le dira ?
Saurai-je un jour la vérité ?
Plongez ! Plongez ! Je reste sur la rive déserte.
Tenaillé par un doute affreux.
08:06 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.06.2011
Ainsi va le monde

Quand on sait dans quel marasme social l’oxymore du "centralisme démocratique" avait plongé la Russie et, avec elle, une bonne partie du monde, on serait bien évidemment tenté d’affirmer aussitôt, par réflexe culturel et défensif, tout le contraire de la moindre allégation du chef bolchevique.
Le bon mot a pourtant pris un certain sens dans nos sociétés libérales, les deux professions indexées n’étant pas particulièrement réputées pour la finesse de leurs analyses politiques. Mais bon…
Plus tard, beaucoup plus tard, le communisme ayant fait la preuve – pour qui avait bien voulu se pencher un moment sur ce qui se passait réellement à l’est et en Chine comme sur ce qui s’était réellement passé dans l’Espagne de 1936 - de sa duplicité et de son incapacité, voire de sa cruauté, et le drapeau rouge ayant franchement viré au noir, on disait plutôt, goguenard et désabusé : " La situation sera révolutionnaire quand les philosophes deviendront des voyous et les voyous des philosophes."
Ça avait de l’allure aussi…Et on peut effectivement supposer qu’un tel renversement des rôles sociaux eût été de nature à changer radicalement les fondements de toute une société.
Mais c’était de la poésie. Le voyou est forcément philosophe pour son propre compte et le philosophe, depuis le temps qu’il presse le citron sans qu’il n’en sorte aucun jus nouveau, même s’il se faisait voyou, n’arriverait pas à pisser plus loin que son ombre sous le midi d'un solstice d'été.
Donc, les garçons de café et les coiffeurs n’ont jamais décrété la grève insurrectionnelle et les voyous et les philosophes ont toujours fait chambre à part. Au mieux, quand ils se sont retrouvés confrontés dans la même personne, ont-ils fait des ministres.
Alors, vogue la galère…Tout ça, c’est bien du bla-bla et l’histoire va son chemin cahotant.
Mais alors, m'étais-je dit un beau matin en parcourant les nouvelles, comment qualifier un monde où un prêtre se met en devoir de braquer une banque, et ce, dans le pays le plus catholique de notre Europe bien-pensante, ? Là, il y a manifestement un mélange explosif des genres. Un brouillage de cartes tel que n'en avait jamais envisagé le plus farouche des théoriciens de la guerre sociale.
Un Vautrin, alias Jacques collin, alias l'abbé Carlos Herrera ?
Ou alors Jacques Roux.
Dont on sait qu’il fut contraint de se suicider pour éviter que les « révolutionnaires » de l’époque, les Saint-Just, Robespierre et autres Danton, ne lui coupassent le cou parce qu’il dénonçait déjà, et avec quelle force !, une Révolution au service exclusif de la classe sociale qui, depuis, gouverne effectivement le monde.
Pour en revenir à notre malheureux Dillinger polonais et en soutane, sachons donc qu'il s’est évidemment fait sauter, sitôt son forfait accompli.
Il mérite cependant que les poètes se penchent un moment sur son sort et lui consacrent quelques mots fraternels, tant son geste bouleverse les choses communément établies dans les têtes et accuse la solitude et le désarroi dans lesquels sont plongés les hommes et les femmes de ces temps vulgaires.
Le confusionnisme intéressé du sociologue dirait : C'est un cas isolé. Tous les cas sont isolés, mon brave, et, par le fait même, d'une dramatique éloquence.
Quant au parquet de Poznan, il eut des mots qui font sourire, car n’oublions pas que le délinquant est un homme de dieu officiant pour la religion la plus riche du monde :
C'est un vicaire mais sans poste fixe actuellement.
Restrictions budgétaires, peut-être ?
Photo : Sas d'entrée d'une banque en Pologne
11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.06.2011
Le Sauveur est parmi nous !
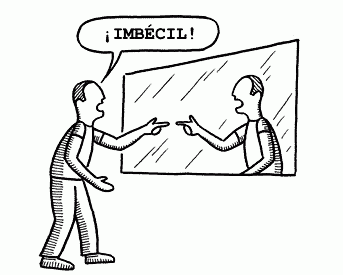 Voici ce que déclamait récemment à Poitiers le patron de Publie.net, dans un spectacle au titre résolument alarmiste : Formes d'une guerre.
Voici ce que déclamait récemment à Poitiers le patron de Publie.net, dans un spectacle au titre résolument alarmiste : Formes d'une guerre.
« Moi, je placarde sur la ville la menace où elle est : mais ce n’est pas moi qui l’énonce, moi je constate, moi j’avertis. Quarante fois que je me place dans la cour et dis : - Méfiance. Que je dis : Eveil ! Que je dis : - Rassemblement ! Mais ils sont à regarder leurs images, ils sont dans leurs alvéoles, devant les écrans en bleu gris des ordinateurs qui luisent, devant les éclats rouges des images qui bougent : on ne regarde plus que la nuit fournie, on ne regarde plus la nuit nôtre (…) »
Passons sur les quatre « Moi » fournis en trois lignes ! Moi, je… Difficile de faire pire en fait d’hypertrophie de l’ego. Une petite déprime, peut-être ?
Et pour le reste, on croit rêver ! Si, si, c’est bien lui, le Publie.net, le numériquologue acharné, le facebookien prolixe, déchaîné, le pourfendeur des livres, qu’il assimile - avec un petit zeste de situationnisme rance - au vieux monde.
Il nous et vous prend pour des cons, non ?
Allez, allez, au jardin ! Aux campagnes jolies ! Aux phrases et aux mots aussi simples que nos vies !
Laissons définitivement là ces apprentis sorciers, ces braconniers qui agitent leur modernité comme d'autres leur miroir aux alouettes!
13:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.06.2011
Publie.net : des lecteurs parlent.
Réponse ouverte d'une lectrice de Publie.net à Monsieur Bon.
 Décidément en écrivant à votre auteur qu'il peut consulter les comptes de Publie.net à son gré, vous manquez de perspicacité et persévérez dans la déconsidération. Vous avez obligation par contrat de lui remettre les comptes. Je cite le contrat : « Un relevé individuel récapitulatif de ses œuvres et des montants dus sera adressé à l’Auteur par Publie.net au plus tard dans les trois mois suivant la date d'arrêté des comptes et dans le même délai le règlement des sommes lui revenant.»
Décidément en écrivant à votre auteur qu'il peut consulter les comptes de Publie.net à son gré, vous manquez de perspicacité et persévérez dans la déconsidération. Vous avez obligation par contrat de lui remettre les comptes. Je cite le contrat : « Un relevé individuel récapitulatif de ses œuvres et des montants dus sera adressé à l’Auteur par Publie.net au plus tard dans les trois mois suivant la date d'arrêté des comptes et dans le même délai le règlement des sommes lui revenant.»
Vous vous abstenez et lui rappelez gentiment qu'il peut procéder à vérifier vos comptes en vertu de la clause de votre contrat : « L'Auteur aura la faculté de faire procéder à son gré et à ses frais, personnellement ou par un mandataire de son choix, à une vérification des comptes de Publie.net relatifs à sa rémunération des années antérieures à l'année en cours. Cette faculté est soumise à notification préalable par lettre recommandée avec accusé de réception et préavis de 30 jours et s'exercera dans les locaux de Publie.net où l'auteur ou son mandataire pourra se faire remettre toute pièces utiles à cet effet.»
En somme, vous vous dédouanez de vos obligations contractuelles en renvoyant l'auteur aux modalités de contrôle, alors que c'est vous qui êtes déficient et que l'auteur n'a jamais demandé à vous contrôler, mais vous a demandé les états de vente de SES publications. En le renvoyant dans ses buts pour qu'il vienne vous rendre visite à ses frais, vous offrez à la communauté de vos lecteurs une piètre image de cette coopérative expérimentale dont on lit chez vous qu'elle se veut être le fruit d'un travail en commun et d'un partage.
Non, Monsieur Bon, nous ne vous suivrons pas dans votre démarche malhonnête qui vise à transformer votre auteur en homme méfiant qui voudrait contrôler vos comptes. Alors qu'il a réclamé SES comptes, et non LES comptes, et en plus, jamais remis en question le nombre de téléchargements de ses livres.
Non, Monsieur Bon, nous ne vous suivrons pas dans votre pratique du partage où le sens de la répartition laisse place à la fragmentation des accès aux données.
ArD
*
On aimerait que Monsieur Bon, dont on sait avec quelle générosité il fustige tous les acteurs du livre quand ils ne relèvent pas de son schéma numérique, apporte sa contradiction éclairée à ce témoignage. Mais faut pas trop rêver…
Et il y a, par ailleurs, cet avis d’Yves Letort, alias Le Tenancier, qui sait de quoi il parle quand il parle de livres. Sa contribution me fait mesurer encore plus l’autorité revancharde, indigne, du patron de l’E.U.R.L. Publie.net (ne nous faites plus rire jaune avec le mot coopérative) qui supprima mes livres sans que cela ne lui fût expressément demandé.
D’un autre côté, satisfaction tout de même car il n’y aura désormais plus de victimes des apparences mais bien des complices à part entière d'une évidence devenue essentielle.
*
 Lorsqu'un éditeur élimine un auteur de son catalogue, on sait que le mal est réparable puisqu’il reste les ouvrages réfugiés dans les bibliothèques des particuliers qui se sont procuré les livres. Il reste une trace : le labeur de l'auteur, le travail du maquettiste, celui de l'imprimeur, parce que tous ce beau monde, théoriquement, y est pour quelque chose également. Le livre a une seconde vie. Et s'il ne reste que 5 exemplaires survivants, c'est assez. Il en a suffi de moins pour Maldoror.
Lorsqu'un éditeur élimine un auteur de son catalogue, on sait que le mal est réparable puisqu’il reste les ouvrages réfugiés dans les bibliothèques des particuliers qui se sont procuré les livres. Il reste une trace : le labeur de l'auteur, le travail du maquettiste, celui de l'imprimeur, parce que tous ce beau monde, théoriquement, y est pour quelque chose également. Le livre a une seconde vie. Et s'il ne reste que 5 exemplaires survivants, c'est assez. Il en a suffi de moins pour Maldoror.
Ici, Bertrand, on a supprimé un livre d'un catalogue électronique dont on peut supposer que les quelques fichiers survivants sont difficilement partageables et seulement dans la sphère de relations des détenteurs (alors que, se retrouvant d'occasion et réel, le livre revient au monde pour cette deuxième vie, justement), si du reste, il est possible de le partager, à cause de verrous numériques possibles. Cette élimination de la liste du catalogue, c'est purement et simplement l’annihilation du texte. La trace est effacée presque irrémédiablement. C'est-à-dire que, dirigeant le fichier vers la poubelle votre texte est nié par celui-là même qui devait en assurer la pérennité et le défendre.
Ce que nous sommes contraints d'appeler "un livre" de par son peu de résistance à la destruction est devenu par le procédé de la virtualisation, un produit à obsolescence rapide. Ce n'est plus la création du texte qui est devenue importante mais bien sa destination comme un bien dématérialisé, un élément embryonnaire d'un profilage économique impitoyable qui arrive masqué et convivial, devrais-je dire "associatif" ?
Yves Letort
Images : Philip Seelen
09:59 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.06.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
ROGER
La secrétaire de mairie m’avait appelé un matin pour me demander de l’accompagner. Elle n’osait pas aller te voir toute seule. Tu n’étais pas vraiment méchant, mais tu étais quand même connu pour avoir su jouer des poings, à plusieurs occasions. « C’est qu’il n’est pas fin le Roger », qu’elle pleurnichait, la secrétaire de mairie… Mais le maire avait été formel : « on ne peut pas le laisser comme ça. Un jour, on va le retrouver mort et la commune fera la une de Presse Océan ou de Ouest France… Y a mieux comme publicité… »
Il n’embêtait personne, pourtant, Roger. Il avait 63 ans et il vivait à deux kilomètres du bourg, dans une grange en tôles ondulées qui s’ouvrait sur un bel étang entouré de frênes, de bouleaux et de saules pleureurs. Il créchait entre un vieux tracteur hors d’état de marche et quelques balles de paille. Son lit : un matelas crasseux posé à même le sol de terre. De vieux duvets immondes lui tenaient lieu de couvertures. Dans un coin, une magnifique armoire dénotait vraiment. Et, près de l’entrée, une table recouverte de boites de conserve et de litres de pinard plus ou moins vides. Juste à côté, un énorme bidon/brasero, bourré de braises rougeoyantes, servant en même temps de chauffage et de cuisinière. Il faisait deux ou trois degrés dehors, guère plus dedans. Tu nous avais accueillis en nous envoyant tes deux chiens dans les jambes et notre peur t’avait fait marrer : « Vous en faites pas, ils vont vous laisser rentrer… Par contre pour sortir ce sera une autre histoire ».
Tu nous avais fait comprendre que tu te foutais de notre inquiétude et que le maire « ce grand con-là » ferait mieux de s’occuper de ses fesses… Je constatais soudain qu’il y avait une maison, à quelques mètres seulement de ta grange. « Et avec les voisins, t’avais-je demandé, ça se passe bien ? » « Quels voisins, m’avais-tu répondu ? Elle est à moi cette maison ! » « Et vous n’y habitez pas ? Ce serait plus confortable… » « Nan… Elle a de mauvaises ondes… »
Au moment de te quitter, tu t’étais arrêté devant l’étang et tu avais planté ton regard dans celui de la secrétaire de mairie : « Tu sais que pendant la guerre, y a un motard allemand qui s’est foutu dans cet étang avec son side-car ? Et tu sais pourquoi il a fait ça ? » Silence inquiet de la secrétaire de mairie… « Tu sais pas pourquoi ? » « Non », osa-t-elle balbutier… » Roger avait souri : « P’têt qu’y voulait pas voir ta gueule ! »
Et alors que nous nous éloignions, nous entendions ton rire sonore qui couvrait les aboiements des chiens.
Tu étais un sacré emmerdeur, Roger, mais tu avais du cran.
Je ne t’oublie pas.
11:13 Publié dans Acompte d'auteur, Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.06.2011
A propos de l'insoutenable médiocrité morale des auteurs de chez qui vous savez et d'ailleurs...

 Dans le texte précédent j'ai cité comme émanant d'une voix amie le jugement fort avisé que voici :
Dans le texte précédent j'ai cité comme émanant d'une voix amie le jugement fort avisé que voici :
C'est la démonstration d'autres petites choses, que nous imaginons tous sans peine : beaucoup sont prêts à pas mal de silences, d'arrangements, pour "en être" ; être d'une fratrie dont on voudrait hériter du prestige supposé, "être" d'une maison d'édition dont on compte sur son taulier pour être populairement contagieux, et surtout : ne pas perdre le peu d'entrée qu'on suppose précieuse dans un monde qu'on suppose important.
Or, la susdite voix amie me fait savoir que cette appréciation ne vient pas d'elle, même si elle adhère complètement au propos. Elle citait une tierce personne, dans un autre débat, mais bien à propos de mes déboires éditoriaux.
Je vous prie donc de m'excuser et, tenez, puisque vous êtes là, je vous prie aussi de vous recueillir un instant - pas de souci, je ne le répèterai pas et personne ne vous voit - sur la mémoire de deux livres assassinés sans procès digne de ce nom, sinon celui de Moscou.
Mais les livres sont comme les peuples : on peut détruire leur terre, pas leur âme. Forcément alors, ils renaîtront de leurs cendres, mes livres.
Et à bien meilleure enseigne.
11:25 | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.06.2011
En guise de synthèse ouverte
 Avec les trois textes ci-dessous - Auteurs balancez donc donc un coup de pied dans la fourmilière !, Publie.net : un kolkhoze dans la pure tradition stalinienne, et Désillusions numériques, analyse succincte (…) - j’ai mis les pieds dans le plat que voulait, et veut sans doute toujours, servir une certaine pratique de l’édition coopérative, qui n’en a que le nom.
Avec les trois textes ci-dessous - Auteurs balancez donc donc un coup de pied dans la fourmilière !, Publie.net : un kolkhoze dans la pure tradition stalinienne, et Désillusions numériques, analyse succincte (…) - j’ai mis les pieds dans le plat que voulait, et veut sans doute toujours, servir une certaine pratique de l’édition coopérative, qui n’en a que le nom.
Je rappelle d’ailleurs qu’une coopérative est une personne morale, juridique, avec des statuts bien particuliers et qu’il ne suffit pas de se claironner coopérative pour en être une.
J’ai donc mis sur la place publique des pratiques peu ragoûtantes, qui sont les pratiques de la majorité des éditeurs, mais qui sont encore plus scandaleuses venant d’une boîte innovante, qui, jusqu’alors, n’a fonctionné que par effets d’annonces sur la dénonciation de ces pratiques :
- Non respect des engagements contractuels quand il y a contrat, ce qui n’est pas toujours le cas,
- Aucune transparence sur ce qui se lit ou ne se lit pas au catalogue, en dépit des promesses faites au début,
- Aucun relevé annuel des droits acquis,
- Aucun versement des droits après trois ans de mise en ligne.
J’ai grillé pas mal d’énergie dans cette dénonciation et il m’en a coûté du côté de l’affectif. J’ai mis l’accent aussi sur la naïveté - pour ne pas être trop méchant aujourd'hui - des auteurs qui, croyant avoir trouvé sous l’aile protectrice d’un chef, le sentier qui les mènerait à la reconnaissance de leur talent, réel ou supposé, se taisent et se font complices de la malhonnêteté. Suivez le bras du guide ! Ce qui serait bien plus éloquent sous la forme plaisante de la contrepèterie.
« C'est la démonstration d'autres petites choses, que nous imaginons tous sans peine : beaucoup sont prêts à pas mal de silences, d'arrangements, pour "en être" ; être d'une fratrie dont on voudrait hériter du prestige supposé, "être" d'une maison d'édition dont on compte sur son taulier pour être populairement contagieux, et surtout : ne pas perdre le peu d'entrée qu'on suppose précieuse dans un monde qu'on suppose important. », dixit une voix amie.
C’est à eux, à eux seuls, ces auteurs, de reprendre leur dignité et de lever le poing. C’est à eux et à eux seuls de mettre fin à leur participation à une tromperie générale, tromperie qui s’exerce sur eux-mêmes, sur les lecteurs et sur l’ensemble de la sphère éditoriale. J’étais de ces auteurs. J’ai dit. Satisfaction à pouvoir me raser désormais sans rougir tous les matins, devant ma glace. Si je n’en tire que cette satisfaction-là, elle n’en est pas moins très importante.
Je remercie tous les commentateurs qui ont apporté leur contribution sous mes trois textes. Il apparaît dès lors que ce que j’ai dit avait besoin d’être dit : "ce qui était essentiel est devenu apparent". J’exclus de mes remerciements une commentatrice qui s’est faite complice de l’escroquerie en voulant chercher midi à quatorze heures et excuser l’inqualifiable comportement de Bon, qui, dans les heures ou minutes qui ont suivi mon premier texte, a supprimé mes livres, au mépris, encore une fois, de ses engagements contractuels, pourtant longs d’une dizaine de pages et rédigés par Monsieur Olivier Cazenave, Président du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes.
Je répète ici ce que j’ai déjà dit à Bon dans les commentaires : il n’a répondu à aucun de ces commentaires où il est pourtant directement mis en cause. Il n’a montré le bout de son museau que pour celui qui lui était favorable.
Je crois que c’est en dire assez long et qu’il est temps pour moi de passer à autre chose.
Je remercie également les personnes qui m’ont contacté en privé pour me dire leur soutien. Je dis soutien, pour faire court. Toutes ces personnes disent d’une seule voix, et sans se connaître entre elles : Nous nous en doutions. Merci d’avoir éclairci.
Oui, je les remercie. Ces mails m’ont fait du bien. Mais je regrette vivement que ces voix n’aient pas voulu s’exprimer publiquement. Preuve que l’omerta n’est pas une invention de mon esprit. Preuve que des gens ont peur de se voir mis au rebut par toute une petite tribu de chefaillons, dictant sa loi sous des apparences débonnaires.
Ces preuves, je les détiens. Elles sont des témoignages privés. En aucun cas, sous aucune injonction, sous aucune menace, je ne les divulguerai. Par respect de la parole donnée, quant au silence demandé.
Même si je le regrette énormément.
Mes trois textes ont été écrits sous l'impulsion d'une juste colère : j’ai perdu en même temps quelqu’un que je comptais parmi mes amis et l’illusion d’un autrement de l’édition.
Ces textes sont donc mal écrits et bourrés de coquilles.
Certains techniciens du langage sans paroles, certains fouineurs de la virgule, certains qui doivent dire Je t’aime à leur maîtresse en s’efforçant de chanter juste, m’en ont fait le reproche, arguant du fait que le mal-dit desservait mon argumentaire.
Je les comprends. Je ne leur en tiens évidemment aucune rigueur, et ce, d’autant plus facilement que je ne les connais pas. Mais un mutin, un révolté, un indigné, un dont on vient d’escroquer en même temps la confiance et l’amitié, souffre d’abord. Le style est dans son sang et s’il se trouve dans son auditoire des gens pour qui l’exclamation est faite d’émotion, ce qu’il dit mal saura être bien entendu.
La guerre se passe des fioritures du style. Que ces techniciens de la parole ouvrent préalablement un de mes livres ! Ce qu'ils n'ont à l'évidence pas fait !
L’espoir maintenant est dans mon travail d’écriture et mes prochaines publications. Il est aussi dans la conviction que le temps me donnera raison envers et contre tous les courtisans de l’éphémère présent.
Dans le combat pour les causes qui me semblent justes, « j’aurai porté mon maillon de la chaîne éternelle. »
Illustration : Philip Seelen
16:32 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.06.2011
Désillusions numériques, analyse succincte et résolutions anciennement nouvelles

Ayant, dans deux textes polémiques, dit ce que j’avais à dire et dénoncé ce qu’il me semblait juste – et qui me le semble toujours jusqu’à ce que quelqu’un vienne me prouver le contraire avec autre chose que des arguties courtisanes– de dénoncer (trois ans sans la moindre information sur les téléchargements de mes livres, trois ans sans le moindre état des ventes au mépris d’un champ contractuel préalablement ouvert, et trois ans sans un traître centime de droits éventuellement acquis), il est nécessaire maintenant pour moi de tirer de la mésaventure les réflexions générales.
Le virage à 180 degrés effectué a d’abord un nom : Publie.net. Ce qui est d’une importance capitale car peut-être ne faut-il pas dès lors jeter le bébé avec l’eau souillée du bain. Sans doute cela ne remet-il pas en cause l’édition numérique dans sa totalité. Peut-être se trouvera t-il bientôt un ou des éditeurs numériques conscients de leur métier et vraiment au service des auteurs de littérature et des lecteurs.
Publie.net, rendons-en grâce à l’histoire, n’a pas le monopole de la modernité dans le domaine. Le numérique a certainement des atouts dans sa poche. Suffit simplement qu’il ne coupe pas une couleur de laquelle il conserve l’as dans sa manche pour remporter le dernier pli. Voire la mise du tapis.
Ces atouts-maîtres ont été maintes fois rabâchés par rapport à l’édition traditionnelle (plus large éventail de publication car moins de risques engagés financièrement sur un ouvrage, rotation de plus en plus rapide dans les librairies évitée, pratique sociale de la lecture numérique de plus en plus dense et cætera.)
Pour Publie.net, le vers était déjà dans la pomme. Je ne le vois que maintenant, après avoir mordu dans le fruit. Car si ces avantages avaient été déterminants dans les choix, s’ils avaient suffi à convaincre lecteurs et auteurs de s’engouffrer sous son aile protectrice, alors il n’eût pas été nécessaire de répéter à l’envi que les prix du livre numérique étaient cassés en trois par rapport au livre traditionnel, il n’eût pas été nécessaire d’appâter les auteurs avec des 50 pour cent de droits, même si cet appât n’a pas été déterminant dans le choix de ces auteurs. D’autant, je le répète, qu’il s’agissait d’un leurre. D’une cuillère aux reflets argentés dans les tourbillons d’une cascade soit-disant innovante.
D’autres éditeurs viendront, donc, dans la pratique numérique, mus par une respectable éthique. C’est inévitable.
Cependant, dans ma courte, juste, rageuse, mais bien tardive bataille pour le respect de l’esprit coopératif claironné chez Publie.net, les réactions des deux protagonistes ont mis à l’évidence les inconvénients, voire les leurres désastreux, de la publication numérique. Là encore, des éditeurs, des auteurs et des lecteurs d’un autre esprit, d’une autre génération, trouveront sans doute les moyens d’y remédier.
Car en partant du postulat selon lequel les chiffres de vente annoncés n’aient pas été ceux d’un poker menteur, il faut constater deux choses :
- soit mes ouvrages sont d’un intérêt médiocre - ce qui remettrait fondamentalement en cause mes prétentions à écrire - et, ou, la connaissance de l’éditeur relativement à la littérature de qualité digne d'être publiée est nulle, cette dernière éventualité étant à exclure au vu de l’œuvre que ce dernier a déjà derrière lui, deux éventualités, donc, fondamentalement antinomiques,
- soit la pratique sociale de la lecture ne s’opère en fait que sur le journal, les mails, les blogs à textes rapides, les cours de la bourse, les promotions de la Redoute, les clubs de rencontre, la connaissance encyclopédique telle que chez Wikipédia et tutti quanti, et alors la présence de la littérature sur internet est encore un vœu pieux.
Une autre contradiction, grave, très grave pour la réputation et la fiabilité du numérique et mise au jour par le conflit, est de taille à faire frémir : c'est la rapidité avec laquelle l’éditeur peut d’un seul coup de clic, supprimer votre ouvrage, sur simple interprétation d’une phrase courte, coléreuse, pas forcément juste, j’en conviens.
Mes deux ouvrages ont disparu dans l’heure qui a suivi cette phrase : "Adieu illusion numérique !" Plus encore : sur mauvaise interprétation de ma part d’une douteuse allégorie assimilant un projet d’édition à un nouveau champ de bataille.
On le voit : ceci relève de tout, sauf du sérieux et de l'honnêteté. Et ceux qui, à l'instar d'une commentatrice, donnent justification à ce genre de pratique n’ont vraiment rien à faire ni sur internet, ni dans l’édition, ni même dans les débats-conflits entre les différents acteurs sociaux de la littérature. Qu'ils aillent flagorner ailleurs, loin d'ici !
Cette pratique, pour moi, souligne la dramatique fragilité du livre numérique, épée à double tranchant à manier avec précaution. Et souligne aussi l’incontestable supériorité du livre traditionnel : les autodafés ne sont en effet plus de mise !
François Bon dit " tout mon travail ne méritait pas l'insulte". Certes. Mais, lui qui est aussi écrivain, a-t-il eu l'intelligence ou l'honnêteté de penser que toutes les heures, les doutes, les angoisses dont un livre est fait, ne méritent pas de partir en fumée en une seconde ? Non. Il n'y a pas pensé ! Parce qu'il n'est plus un écrivain mais exclusivement un marchand !
Et me revient en mémoire la phrase désabusée d’un auteur ami à l’époque, qui, venant de publier un livre numérique refusé par d’autres éditeurs sous une forme traditionnelle (livre de grande qualité littéraire pourtant ): " Encore un livre virtuel !"
Je m’étais inscrit en faux.
Comme un âne. Cet auteur-là avait diablement raison et voyait bien mieux et bien plus loin que moi.
Mes prochains livres seront donc résolument couchés sur du vrai papier et confiés aux soins de vrais éditeurs.
Gageons qu'ils seront lus à plus de 5 exemplaires en trois ans et qu'un blabla enjôleur ne les embourbera pas dans l'impasse !
Vous pourrez aussi les lire avec vos seuls yeux. Pas besoin de suivre une formation aux nouvelles, toujours plus nouvelles et accablantes technologies de l'illusion numérique en littérature.
Illustration : une curiosité de la nature relevée par mézigue il y a quelques jours : un sorbier a élu domicile à trois mètres du sol, sur la fourche d'un peuplier géant. Sa vie sera courte.
Suis pressé. Merci et excuses aux commentateurs des textes précédents.Répondrai bientôt.
10:56 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Publie net : un kolkhoze dans la pure tradition stalinienne
 Après trois ans de silence sur l’état des téléchargements et autres, il a fallu deux heures tout au plus à François Bon pour me rayer de son catalogue.
Après trois ans de silence sur l’état des téléchargements et autres, il a fallu deux heures tout au plus à François Bon pour me rayer de son catalogue.
J’en déduis, avec un certain contentement, que le bonhomme patelin est quand même très réactif quand il le veut et qu’il sait trancher d’un seul coup d’un seul le nœud gordien devant une situation qui l’embarrasse.
Une question de trop ? Dehors, la racaille !
Je constate également la modernité progressiste, profondément humaine, du numérique par rapport au papier. Un coup de clic, hop, le livre n'existe plus.
Le Temps qu'il fait, lui, est quand même diablement plus honnête : il n'a pas proposé de jeter mes livres à la poubelle !
Quel fut donc mon crime pour être ainsi exclu du Kolkhoze ?
Mais que je dise préalablement, afin de n’être point lu dans l’amer, que je suis très satisfait de ne plus appartenir à cet amalgame sectaire et silencieux, abusivement dénommé coopérative d’auteurs de littérature contemporaine au numérique.
Je pousserai même l’insolence à en remercier le patron...Le gérant, le directeur, le créateur, comme vous voulez.
Mon crime fut d’abord d’avoir réclamé - oui, réclamé, les mesquins vous mettant toujours dans une situation de mesquinerie - le droit de savoir le nombre de téléchargements effectués sur mes deux ouvrages : Chez Bonclou et Polska B dzisiaj.
Si quelqu’un trouve ma démarche illégitime, qu’il m'explique. Que je ne crève pas idiot.
Résultats : 5 pour l’un, 10 pour l’autre.
Le couac…Le couac, pour deux raisons :
- La première, c’est que je pourrais établir- il me faudrait leur autorisation et je ne l’aurai pas car la loi du silence est plus forte que ma grande gueule - une liste de quinze personnes, au moins, qui ont téléchargé Chez Bonclou en 2008.
- La seconde, c’est que, ne s’agirait-il là que d’une légère erreur de calcul, une distraction passagère du gestionnaire débordé, quand un auteur se voit annoncer qu’il a vendu 5 livres en trois ans (Chez Bonclou), s’il lui reste un peu de jugeote sous les cheveux, il est quand même soumis à une terrible remise en question de son savoir-faire ou de celui de son éditeur.
Le deuxième acte de mon crime de lèse-majesté fut d’avoir publié un texte qui remet en question la pratique similaire de deux de mes éditeurs, dont lui.
Mais, avant cette publication, François Bon, devançant le conflit, m’avait proposé de retirer mes ouvrages de son merdier, alors que je lui demandais s'il voyait un inconvénient à ce que je publie mes médiocres chiffres sur L'Exil... Le sommelier avait senti que le pinard était en train de virer vinaigre.
J'avais répondu : "fais ce que tu veux, je m'en fous !"
Je vous laisse apprécier la logique démocratique de cet établissement : une coopérative d'où le coopérant est exclu s’il pose la moindre question après trois ans de silence.
J’imagine une coopérative vinicole où le vigneron est prié d’aller jeter son vin au ruisseau parce qu’il a demandé le nombre d’hectolitres qu’il avait fournis !
Il est donc temps de démasquer ce fonctionnement autoritaire, sournois, de l’entreprise Publie.net et de ramener le mot coopératif à sa juste noblesse.
A mon avis, tout silence a désormais valeur de complicité frauduleuse. Et ça n’est pas très reluisant. Car ce silence fausse complètement les données de la parité et de la justice entre tous les éditeurs de littérature et les écrivains. Un auteur qui, par son silence, laisse croire qu’il perçoit la moitié du prix de vente de ses livres alors qu’il reçoit en fait peau de balle et balai de crin, est un voyou qui sape les autres auteurs et les petits éditeurs traditionnels qui, eux, proposent 10 pour cent, bien peu, certes, mais qui les donnent réellement.
Comme est un voyou de la place publique, un auteur qui laisse son éditeur ( traditionnel) , lui bouffer la laine sur le dos, remettant le soin à des emmerdeurs de mon acabit de se griller pour eux.
Je l'ai déjà dit : la littérature est affaire d'hommes libres face au monde. Pas d'esclaves corrompus ! Que peut-il y avoir d'intéressant à lire un esclave qui tait son esclavage ?
Je n’invente rien. Je rends public un vécu. D’ailleurs, l'escouade silencieuse des auteurs de Publie.net le sait bien. Et moi, je sais les risques qui peuvent sanctionner ma franchise : se fâcher avec François Bon, c’est se fâcher avec tout le petit peuple qui gravite autour, au sein duquel peuple sont des gens éminemment sympathiques, pourtant.
Je n’avais pas, au départ, l’envie de me brouiller avec François Bon. J'éprouvais pour lui du respect. Je l’ai croisé dans la cour du lycée, au tout début du bal. Mon objectif premier était de dénoncer clairement les choses telles qu’elles faussent les rapports entre éditeurs et auteurs, rapports auxquels participe Publie.net, bien plus gravement encore que les autres éditeurs, puisque son fondateur les dénonce sans arrêt sur son site.
Pour mieux les pratiquer dans l’ombre. Presque un pompier pyromane.
Mais les réactions d’épicier du tenancier de cette boutique, m’ont déterminé à dire ce que je dis ici. Réactions humiliantes : le bonhomme me propose soudain 75 euros, comme à un clochard qui passerait par là et qui réclamerait sa soupe ! Il me somme de lui donner un RIB et, fier, hautain, soudain étrangement scrupuleux, crie qu'il veut s'acquitter de sa dette.
Misérable. Pitoyable, tout ça.
Fasse que ma révolte l’incite désormais à plus de respect pour ses auteurs et plus de justice dans sa conception de ce qu’est véritablement une coopérative !
Elle n'aura, alors, pas été vaine.
Une autre vie maintenant, bien meilleure, bien plus belle, attend Chez Bonclou et Polska B Dzisiaj.
Il y a, dans toute rupture, aussi pénible soit-elle, l’étincelle de nouveaux espoirs et le point de mire de nouveaux horizons.
D’autant que, dans mon cas, l’étincelle comme l’horizon étaient antérieurs à la révolte.
10:56 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
AUTEURS, BALANCEZ DONC UN COUP DE PIED DANS LA FOURMILIERE !
 Il y a un moment, il y a toujours eu un moment, dans toutes les activités humaines, où le respect de soi-même commande qu’on dise : NON !
Il y a un moment, il y a toujours eu un moment, dans toutes les activités humaines, où le respect de soi-même commande qu’on dise : NON !
Je dis donc NON ! à deux éditeurs avec lesquels j’ai travaillé ces dernières années.
L’un fait de beaux livres traditionnels et publie de l’excellente littérature, l’autre fait de beaux fichiers numériques.
Je ne me lancerai pas ici dans des diatribes ad hominem : j’ai eu avec ces deux hommes des relations agréables. Disons que leur façon de traiter les auteurs m’est quand même apparue, à la longue, comme étant fort cavalière.
Ils ne sont pas, hélas, dans leur manière d’agir, de grands originaux. Ils sont les seconds couteaux d’une société littéraire aux mains de grands falsificateurs. Car j’ai profité de mon absence d’ici pour contacter pas mal d’écrivains et, ma foi, le traitement du silence, de l’opacité, du tout petit chiffre et de la pleurnicherie permanente qui m’a été réservé, ne leur a pas été épargné. Ce qui, croyez-le bien, ne m’a pas fait plaisir, mais affligé encore plus.
J’avais, il y a déjà quelque temps, de vive-voix, entendu un écrivain, pourtant maintes fois publié, dire ceci : On ne va pas réclamer des droits d’auteur, voire même des contrats, aux éditeurs. Déjà, qu’ils nous publient !
Et la femme du susdit écrivain de renchérir que oui, c’est sûr !
J’en avais eu le cul par terre, moué !
Et ce rôle inversé, ce rôle qui déshonore la littérature, cette prostitution de salon, cette prostitution pour la bonne cause, il s’est avéré que beaucoup d’écrivains, des, pourtant, qui fanfaronnent sur leur blog, sur leur site et dans leurs livres, la pratiquent régulièrement. Dans les couloirs obscurs de « T’as vu, j’ai publié un bouquin ? »
Alors, merde ! Quitte à ne plus trouver le moindre éditeur sur la place, je dis, haut et fort sur Hautefort : Merde !
Au moins, je ne crèverai pas complice d’un lâche non-sens.
Certes, l’édition est en crise, la librairie, le livre et tout le bastringue. Ne vais pas me lancer dans une analyse que je ne maîtrise pas et d’autres font ça mieux que moi. Ne font que ça, même, pour justifier toutes sortes de louvoiements. Mais cette crise, n’est pas une crise de la lecture et de l’écriture. On a peut-être jamais autant lu ni autant jamais écrit ! Elle est une crise de prises de pouvoir diverses et de parts de marché que se disputent les grandes maisons d’édition dans la jungle du libéralisme sauvage, les petites et les moyennes besognant à ramasser les miettes... Les moyennes, elles, n’ont rien trouvé de mieux à faire, pour tenir la barre et ne pas réduire à néant leur marge, que de spolier leurs auteurs.
Qui ne demandaient pas mieux, d’ailleurs.
En fait, quand vous signez un contrat chez un éditeur, c’est un contrat à compte d’auteurs que vous signez : c’est vous qui payez la facture de la fabrication de votre bouquin avec les 300 premiers exemplaires vendus non porteurs de droits pour votre pomme…Circulez !
En numérique, c’est une autre histoire : vous ne savez jamais rien. Sinon, pour ce qui me concerne et sur ma demande, quelques exemplaires vendus en trois ans …Si c’est là la bonne voie, salut ! Je préfère suivre d’autres pistes. Adieu numérique illusoire !
Mais les éditeurs, ceux de mon expérience, ne sont pas entièrement coupables : car c’est quand même effaré que je me suis aperçu que caquetaient et gloussaient autour d’eux toute une cour d’inconscients, de têtes de péronnelles, de courtisans et de courtisanes leur ouvrant les portes et leur déroulant le tapis. Presque de la gouroutisation…Vous seriez des sots, messieurs, de ne pas traiter ces sots comme des sots ! Quand un âne braie comme ça, c’est qu’il veut un brin de paille dans le cul. A quoi bon lui servir de l’avoine et de l’eau sous le museau ?
En 1979, vous voyez que ça n’est pas d’hier, je téléphonais, depuis la poste de Mauzé-sur-le-Mignon, à un éditeur parisien qui avait chez lui un de mes manuscrits (non publié en France mais traduit en espagnol, dans ce pays où il n’y en avait pas un sur mille mais qu’il en existait pourtant) et la première question que m’avait posée la nana à l’autre bout du fil, avait été :
-Vous êtes enseignant ?
Parce que fut une époque où il n’y avait que les enseignants qui écrivaient…. Ou presque…Et puis ce furent les cadres et puis les ingénieurs…. Tous des gens du salariat de vol moyen et qui, ma foi, n’avaient strictement rien à foutre de quelques centaines de francs de droits d’auteur par an.
Ça a commencé comme ça. Avec des corniauds qui n’ont pas compris et qui ne comprendront peut-être jamais que les droits d’auteur, l’écriture avec contrat, ce n’est pas pour bouffer, s’enrichir ou faire le beau, mais que c’est la reconnaissance fraternelle d’un travail fourni et d’une collaboration amicale autour d’un ouvrage artistique.
Un éditeur qui ne prend même pas la peine de dire à l’auteur ce qu’il vend comme livres, numériques ou papier, on s’en fout, qui ne le paie pas, qui ne rédige pas de contrats, prend son auteur pour une merde qui n’a qu’à la fermer, du moment qu’il a été édité !
Et tout le monde est content.
Moi, pas. Parce que je ne suis ni enseignant, ni ingénieur, ni même salarié de quoi que ce soit, ni éditeur et qu’à peine écrivain.
Je ne suis chef que de ma soupe. Mais elle vaut de l’or, ma soupe ! Et je sais que, jusqu'à preuve du contraire, la littérature, c'est fait par des écrivains.
Foin donc de tous ces obscurs, souvent de gôche, hé, de gôche, et qui, en coulisses, pipent tous les dés du jeu social de la littérature !
Et respect, toujours, respect intégral pour les petits éditeurs pas révolutionnaires à l’affiche, tels qu’Antidata et bien d‘autres, mais qui, avec leur petite échine, supportent encore le poids de l’honnêteté et de la camaraderie. Sans faire de bruit, sans aller faire les fanfarons à France culture, sans s’en prendre à tout le monde dès qu’on leur oppose une velléité de penser autrement qu’eux !
Je dis donc Non à ce foutoir ! Et comme je suis têtu, comme écrire est mon allègre volonté et mon inextinguible plaisir, j’ai de beaux projets sur la planche.
Et puis, un dernier mot, écrivains, vous qui pensez, parfois, avec vos têtes de poètes à la ramasse : comment voulez-vous être beaux, crédibles, intelligents, vrais et libres dans ce que vous racontez du monde sur vos pages, quand, en coulisses, dans l’ombre duveteuse de vos silences, vous courbez la tête, tels des manants besogneux sous les fourches caudines de maîtres qui ne sont maîtres que par la vertu de vos non-dits !
Affaire à suivre très bientôt…Joyeusement, allègrement.
10:55 | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.06.2011
Si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi
 Le théâtre des choses, recueil de dix nouvelles sur lequel j’ai travaillé tout l’hiver et qui paraîtra fin juin - avec un rendez-vous bientôt pris dans une librairie parisienne - Zozo, chômeur éperdu, Géographiques, trois livres qui m’ont donné, en trois ans, dans leurs moments d’écriture, tout ce que j’attends de l’écriture.
Le théâtre des choses, recueil de dix nouvelles sur lequel j’ai travaillé tout l’hiver et qui paraîtra fin juin - avec un rendez-vous bientôt pris dans une librairie parisienne - Zozo, chômeur éperdu, Géographiques, trois livres qui m’ont donné, en trois ans, dans leurs moments d’écriture, tout ce que j’attends de l’écriture.
Le temps est venu pour moi, en ce qui concerne la pratique numérique, d’identifier l’arbre qui me cache une forêt que je pressens peuplée d’inavouables sournoiseries. De l’abattre le cas échéant.
Le temps de la réflexion est venu. Prendre le temps d’y voir clair. Je ne trouve plus - momentanément sans doute - le plaisir que j’avais à m’exprimer ici.
Standby.
D’autres projets m’attendent qui me passionnent et qui, toujours depuis le grand corps de la littérature, voudraient bien voir le jour. Pour un autrement. Merci aux quelques amis contactés d'avoir répondu présents. Dans le principe.
A plus tard, donc. Cela peut être la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou dans six mois, ou dans un an.
Liberté des désirs et des envies sans échéance.
Merci à tous et à toutes de votre lecture de l’Exil, dont la fréquentation, si j’en crois la rumeur chiffrée des coulisses, s’est toujours maintenue au même niveau depuis un an.
Image : Philip Seelen
Titre : proverbe arabe
10:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.05.2011
Une plume au curare
J'évoquais, il y a quelque temps, Henri calet et je faisais un rapprochement entre son écriture et celle de Georges Darien, en ce que ces deux auteurs ont en commun une plume délectable au service de l'antiphrase permanente.
Une plume ironique, façonnée par une impeccable maîtrise de la dérision.
Plus de trente ans que l'Epaulette me suit partout et plus de trente ans que je relis toujours, de temps en temps, avec le même plaisir et les mêmes sourires, l'ouverture de ce livre magnifique.
Dans le genre, peu, pour ne pas dire aucun, ont fait mieux depuis Georges Darien (1862 -1921).
Céline peut-être.
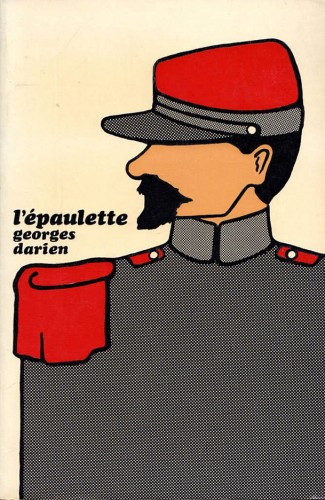 Le colonel Gabarrot racontait de belles histoires.
Le colonel Gabarrot racontait de belles histoires.
Il disait que les Russes étaient des coquins, que les Prussiens étaient des bandits, et que les Anglais valaient encore moins. Quelquefois, il me montrait sa croix d’officier de la Légion d’honneur qu’il avait gagnée à grands coups de sabre, et qu’il gardait dans une belle boîte noire ; si je voulais en avoir une pareille, quand je serai grand, je n’aurais qu’à tuer beaucoup de Russes, beaucoup de Prussiens, et surtout beaucoup d’Anglais.
- Malheureusement, disait-il, on ne tue plus guère, à présent ; on est devenu sentimental.
Et il ricanait.
Mon père lui faisait observer qu’on tuait encore pas mal. La Crimée, par exemple. Le colonel avouait que la Crimée, c’était très bien. Tuer des Russes, rien de mieux ; on n’en éventrerait jamais assez. Mais pourquoi aller s’allier avec les Anglais ? Sans doute, l’Empereur avait eu ses raisons, et des bonnes ; quand on est un Napoléon, on a une cervelle sous son chapeau ; mais enfin, il n’aurait pas dû oublier que les Anglais, c’est des Anglais, et qu’ils avaient empoisonné son oncle. Mon père haussait les épaules ; et le colonel éclatait.
- Tonnerre de Brest ! commandant Maubart, je ne souffrirai jamais !... Ils l’ont empoisonné à Sainte-Hélène, je vous dis ! Sans ça, il serait revenu, mille bombes ! Je l’ai connu, moi, et depuis la campagne d’Egypte, encore ! Et je puis vous le dire, qu’il serait revenu, et qu’il ne nous aurait pas laissés en panne, les bras ballants, à nous manger le sang en demi-solde, sous des gueux de Bourbons qui n’avaient jamais vu le feu qu’au bout des cierges ! Il serait revenu, pour sûr, si les Anglais ne l’avaient pas empoisonné !
Mon père faisait semblant d’admettre la chose, et parlait de la campagne d’Italie.
Le colonel avouait que l’Italie, c’était très bien. Tuer des Autrichiens, rien de mieux ; on n’en éventrerait jamais assez.
- Quoique, à vrai dire, ce ne soit pas la mer à boire que de donner une raclée aux Autrichiens ; nous leur avons flanqué une telle volée à Wagram que, depuis ce temps-là, ils ont le foie plus blanc que leurs tuniques ; vous avez vu, il y a deux ans, comment ils se sont fait battre par les Prussiens. Qu’est-ce que vous voulez ? Quand un peuple se laisse vaincre par des Prussiens, des vagabonds, des cosaques manqués, il n’y a plus qu’à prononcer son de profundis.
Mon père prenait la défense des Prussiens, fort à la mode en 1868 ; mais le colonel tenait bon. Il connaissait les Prussiens, et très bien.
- Je n’ai pas été à Iéna pour le roi de Prusse, peut-être ! Tenez, je vais vous dire ce qu’ils savent faire, les Prussiens : ils savent vous tirer dans le dos pendant que vous bourrez votre pipe. C’est tout. Et pour leur fameux fusil à aiguille, voici mon opinion : avec ce fusil-là, on n’a pas à déchirer les cartouches, et c’est rudement commode pour des gens qui n’ont jamais pu regarder l’ennemi sans claquer des dents.
Nous aimions beaucoup le colonel Gabarrot ; il avait été l’ami intime de mon grand-père, le colonel Maubart ; après avoir fait les dernières guerres de la République et celles de l’Empire, jusqu’à Waterloo, ils n’avaient repris du service, ensemble, qu’en 1830, lorsque le drapeau tricolore remplaça le torchon blanc dans lequel les traîtres de l’Emigration avaient empaqueté leurs goupillons et leurs poignards, avant de quitter Coblentz. Il y avait bien un coq au lieu d’un aigle, à la hampe de ce drapeau-là ; et Gabarrot, pas plus que mon grand-père, n’aimait "les oiseaux qui se laissent manger". Mais enfin, les couleurs y étaient (...)
L'épaulette - Georges Darien -
12:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.05.2011
Les galeries souterraines de la langue

Chateaubriand, dans une œuvre magnifique à bien des égards, Le Génie du christianisme, ambitionnait de prouver l'existence de dieu en s'appuyant sur les merveilles présentes dans la nature.
Je ne me souviens plus exactement de l'intégralité des textes, mais je me souviens des pages parfaitement ciselées sur le chant du rossignol. D'autres pages aussi sur lesquelles il est écrit que les oiseaux et leurs mélodies n'ont d'autre raison d'être que celle de chanter les louanges de la Création.
C'était une sensibilité assoiffée de métaphysique et l'on voit dès lors en quoi elle allait ouvrir la porte à la déferlante romantique.
Un livre superbe, donc, dont certains passages me sont restés comme des références, sur lequel je m'appuyais même, adolescent reniant pourtant, instinctivement, l'existence d'une quelconque puissance céleste et du grand horloger de Voltaire.
Des pages de littérature qui donnaient un sens encore plus intime à mes escapades à travers les champs, les bois et le long des rivières. À mon affection pour les oiseaux aussi, pour leurs mœurs et leur présence partout furtive.
Ici, sur la platitude ouverte ou boisée des saisons qui s'enchaînent, je les ai retrouvés, mes oiseaux. Les mêmes que sous les brises océanes, sauf l'hiver. Dès la mi-août, la plupart à tire-d'aile traversent le ciel en direction de l'ouest, cap sur les tempérances océaniques. Mes sédentaires ou erratiques de là-bas sont ici migrateurs : grives, ramiers et tout le peuple discret des petits passereaux. L'hiver continental est silence.
J'ai retrouvé les oiseaux et, pour beaucoup, ai su les reconnaître à leur chant, sans même les voir dans les feuillages lumineux du printemps ou poussièreux de l'été. Cette langue que chantent les oiseaux n'a ni frontières ni pays. Ces ramages, à la note près, sont les mêmes aux portes du cyrillique que sous les brumes d'inspiration romane.
Ils portent cependant d'autres noms, les oiseaux. C'est ce qui fait d'eux des étrangers, en dépit de l'universalité des trémolos, de la façon de voler, de construire leur nid et d'arborer les mêmes couleurs de plumage. En apprenant leurs noms, il me semble les apprivoiser mieux, les faire poètes complices de mes paysages...
Des noms parfois difficiles, comme celui de ce bel oiseau, orange et turquoise, couleurs veloutées, fureteur des eaux et des ajoncs, le long des rivières ou des eaux dormantes d'un étang. Le martin pêcheur...celui qui hantait les canaux et les chemins de halage du marais poitevin, tout en aquarelles de vert et de jaune.
Le martin pêcheur polonais, c'est zimorodek, littéralement celui qui naît en hiver...
Nous avons longtemps cherché le pourquoi de cette bizarrerie. Les oiseaux naissent au printemps, à plus forte raison sous ces rudes latitudes.
J'ai feuilleté mes grands livres d'oiseaux, leurs textes et leurs images. J'ai consulté les sites consacrés à l'ornithologie...Le martin pêcheur naît bien en mai ou juin...Alors ?
De guerre lasse, j'ai interrogé un ami dont je savais qu'il avait un ornithologue parmi ses proches. Et la réponse, linguistique en fait, est venue éclairer le non-sens.
Le martin pêcheur creuse des galeries souterraines dans les berges des cours d'eau et c'est là, dans ces tunnels, qu'il fait son nid et se reproduit....
Oui, ça je sais ..Mais encore...
Ziemia, c'est la terre...Initialement, l'oiseau avait nom ziemiorodek, celui qui naît sous la terre...L'oiseau souterrain....
Et la lumière fut.
La langue polonaise, comme française, comme toutes les langues du monde, vit. De l'érosion déposée sur elle par des siècles de pratique, d'un emploi fautif un jour glissé entre ses lignes, pour une toute petite voyelle tombée aux oubliettes, elle s'introduit ainsi triomphalement dans les dictionnaires et les manuels, gommant son histoire aux yeux du quotidien inattentif.
Zimorodek. Celui qui naît bien au printemps, mais sous la terre....
Et qui s'évanouit de mes paysages, le grand hiver blanc venu.
Chaleureux remerciements à Aurélien pour ce beau zimorodek
12:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.05.2011
Les pointus
 Là-bas, à l’autre bout du monde, dans la poussière ou la boue des pénitences, on les appelle, par une de ces allégories propres à l'enfermement carcéral, les pointus. Ceux qui sont tombés pour la pointe.
Là-bas, à l’autre bout du monde, dans la poussière ou la boue des pénitences, on les appelle, par une de ces allégories propres à l'enfermement carcéral, les pointus. Ceux qui sont tombés pour la pointe.
Souvent, si toutefois vous parvenez à le saisir, à leur voler plus exactement, leur regard est glauque. Vitreux. Pitoyable. Misérable. Un peu comme ceux des chiens errants, la digne mélancolie des pauvretés en moins. Le long des routes de nulle part.
Ils sont vraiment derrière les murs, les pointus. Juste derrière les murs. Ils les rasent. Ils se perdent dans la contemplation honteuse du bout de leurs godasses. Ils sont méprisés, haïs même, par leurs codétenus. Rejetés par ceux que la société a bannis. Plus bas que la cave. Plus bas que la terre dans laquelle ils semblent vouloir rentrer pour s'y cacher. Alors, ils se rassemblent, les pointus, dans la cour de promenade, comme des oiseaux malades à la plume déchirée. Ils font masse.
Et les insultes pleuvent sur leur lamentable troupeau gémissant. Parfois un crachat.
L’administration aux clefs redoutables les protège, les pointus. Les protège des coups qu’on a envie de leur donner. Comme si on était concerné par la souffrance et la destruction de leurs victimes.
Les pointus. Les erreurs humaines. Les antérieurs au Neandertal. Des chiens fossiles dans un chenil de loups. Aux gamelles rouillées, cabossées. Et qui montrent, quand ils font mine de vouloir sourire en retroussant leurs babines exsangues, des restes de chicots noirs.
Les pointus. Leurs fesses sont maigres et leur membre, leur arme, à la douche commune, d'une pathétique débilité.
11:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.05.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
REMI
Grand, maigre et blond, tu aurais pu être un beau mec, du genre à se balader en 4X4 noir, en costume chic, portable vissé sur l’oreille, style banquier ou agent immobilier. Mais la vie en avait décidé autrement et à même pas quarante ans, voûté, mal rasé et le visage jaune, raviné de cernes et de rides, le chemin qui te séparait de ce modèle – discutable au demeurant – de réussite sociale se calculait en années-lumière.
À 16 ans, déjà, tu ne supportais plus ta vie. Tu avais claqué la porte de chez tes parents pour partir vivre de bric et de broc. Puis tu t’étais engagé dans l’armée d’où tu t’étais fait virer quelques années plus tard, car à cette époque tu n’avais que deux passions : l’alcool et la bagarre. Tu avais ensuite traîné ta gueule cassée de petits boulots en petits boulots, puis des hôpitaux psychiatriques aux cellules des prisons. Tu avais gardé sur tes bras, sous la forme de tatouages plus ou moins inesthétiques, la trace de tous ces périples.
Puis tu t’étais apaisé quelque peu. Façon de parler. Disons que tu t’étais enfermé chez toi et que tu ne sortais plus de cette prison domestique que tu t’étais créée, qu’à de rares occasions, pour faire tes courses. À l’époque où j’ai fait ta connaissance, tu étais déjà cuit. Et tu le savais. Tu souffrais d’une hépatite que tu soignais en descendant une bonne dizaine de litres de vin blanc tous les jours. Tu t’y mettais dès le réveil, coupant l’acidité du vin en le mélangeant avec du Coca-Cola. Tu te marrais quand tu voyais mon regard effaré : « autrement, ça me brûle », m’expliquais-tu, comme si cette explication justifiait quoi que ce soit.
« Autrement ça me brûle… » C’était il y a plus de dix ans de cela… Tu es sans doute mort aujourd’hui…
Je ne t’oublie pas.
07:00 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.05.2011
L'implacable Saturne
 Nous passons.
Nous passons.
Nous voyageons clandestins. A peine si nous voyons cette parallèle qui nous accompagne et que nous nommons, parfois, sans vraiment y penser, le temps.
Comme sur une règle graduée, des repères s’inscrivent pourtant. C’est en jetant un coup d’œil sur ces repères qu’on voit que tout ça prend dangereusement de la vitesse. Destination l’horizon sans horizon.
C’est tout droit, la route est bonne, toute tracée, pas de souci, vous ne pouvez pas manquer l’objectif, vous êtes programmé pour ça. Il vous attend.
J’ai changé mes lunettes…Tout. Qui veut voyager loin ménage ses montures. Tiens, déjà quatre ans ! Oui, la vue avait encore faibli un peu. Je le sentais bien, mes livres de plus en plus près du nez et la lecture commandant de plus en plus de lumière derrière mon dos. C’est un signe. Un repère sur la règle. Encore quelques fois quatre ans et il n’y aura plus rien à voir.
Est-ce qu’on enterre les gens avec leurs lunettes ?
Et puis, bientôt six ans déjà que je vis hors de France. Six ans qui se sont évaporés, que j’ai vécus pleinement, à fond, et il me semble que c’était hier seulement que j’embarquais mes trois jeans, ma guitare et quelques bouquins pour décider de laisser derrière moi tout un pan de mon histoire.
J’ai perdu mes amis. Pas assez solide comme lien, sans doute. Le mien comme le leur. Les nœuds pas assez serrés pour supporter le fracas des changements de cap à quatre-vingt dix degrés. Crac ! Dommage, tout ça.
Six ans sous cette latitude de l’intempérance. Il y a quelques semaines seulement, je me battais bec et ongles avec des moins vingt- cinq degrés pour que l’eau ne gèle pas dans mes tuyaux et là, je suffoque sous un ciel trop bleu, trop blanc, trop lourd, trop grand avec cette boule de feu plombée sur son visage et qui n’arrête pas de faire ruisseler les peaux.
La canicule, force des étymologies, c’est vraiment un temps de chien !
Le corps morfondu, l’esprit au ralenti.
Mais ce sera un jour l’automne. Les changements de perspective de l’équinoxe. La lumière entraînée de l’autre côté par un poids gigantesque. Lumière oblique, délicieux frissons des brouillards qui trembleront sur les champs.
Une meule qui tourne et qui nous broie, tout ça...Le nombre de fois de trop où nous avons dit vivement bientôt ! Nous croyons attendre des rendez-vous et c'est eux qui nous attendent, goguenards !
Que coule notre beau voyage à bord de ce vaisseau spatial qui se balade parmi toute une flotte désordonnée d’autres vaisseaux !
Qui tourne en rond, comme une espèce de derviche schizo. Des siècles et des siècles après Copernic, je suis toujours émerveillé de voir l’astre rouge disparaître au soir derrière le toit de Paul et resurgir derrière celui de Pierre, à l’opposé, dès trois heures du matin.
Seules les grandes naïvetés nous ramènent sans ambages à notre condition de poètes malgré nous. Soyons naifs, candides, ras les pâquerettes. Le nombre de mensonges vaniteux qui se cachent au fond des grandes questions qui n'en sont pas !
J’aimerais que ça soit comme ça, la fin : qu’on soit surpris à voyager clandestin, sans billet, et qu’on soit balancé par-dessus bord. Dans le cosmos. Avec des poussières d'étoiles comme des lampes de chevet.
Pour faire la pige à Saturne et répéter à l’infini la scène du derviche. Une vraie scène, cette fois -ci.
Car nous avons passé nos vies, notre temps, notre énergie, notre savoir et notre envie, à rejouer des scènes. Saltimbanques sans théâtre et sans public.
Image : Philip Seelen
15:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.05.2011
Connais-toi toi-même
 À l’âge où tous les invisibles remparts de l’enfance et toutes les sensations premières s’écroulent, quand la coquille se lézarde et qu’on se désolidarise du monde pour s’essayer à être un individu à part entière, face à ce monde, quand le corps veut séduire et vivre sa vie, que le désir bout à l’intérieur et que l’esprit a peine à suivre tout ce qui se passe réellement entre l’extérieur et nous, quand l’horizon s’élargit devant, tellement qu’il devient effrayant et qu’on se perd à vouloir s’y repérer, quand il faut commencer à faire parler véritablement ce redoutable je, j’ai souffert toutes les plaies du cœur à dire d’où je venais, d’où je sortais et qui j’étais.
À l’âge où tous les invisibles remparts de l’enfance et toutes les sensations premières s’écroulent, quand la coquille se lézarde et qu’on se désolidarise du monde pour s’essayer à être un individu à part entière, face à ce monde, quand le corps veut séduire et vivre sa vie, que le désir bout à l’intérieur et que l’esprit a peine à suivre tout ce qui se passe réellement entre l’extérieur et nous, quand l’horizon s’élargit devant, tellement qu’il devient effrayant et qu’on se perd à vouloir s’y repérer, quand il faut commencer à faire parler véritablement ce redoutable je, j’ai souffert toutes les plaies du cœur à dire d’où je venais, d’où je sortais et qui j’étais.
A dire mon monde de simplicité et de pauvreté rurales.
J’avais honte de ma tribu, honte de ma racine, honte de ma condition, honte de mes vacances d’été passées au cul des vaches, honte de n’avoir pas de télévision, honte d’avoir une mère et pas de papa, honte de mon village, honte d’être pauvre, honte d’être boursier au collège, honte d’être d’une famille nombreuse, honte de mes vêtements recousus.
Ma seule fierté était d’être premier en latin. Ça fait peu, très peu, pour séduire l’adolescence qui cogne à l’intérieur.
J’ai ainsi vécu cette adolescence sous une fausse identité, rejetant tout de moi, inventant des souvenirs, falsifiant mon parcours, apocryphe de mon histoire.
La révolte et l’intelligence fulgurante des journées de mai sont venues me sauver des abîmes de la schizophrénie.
Comme tant d’autres. Car lorsque j’ai levé mon drapeau et réclamé de vivre mon âme d’apache comme je la sentais à l’intérieur, j’ai bien vu alors qu’à peu près tout le monde en était là et que la poésie mutine de ce printemps ne disait pas autre chose que ce que j’avais à dire pour rester moi-même.
Si j’avais à définir, pour moi seul, ce mois de mai-là, je dirais qu’il fut une révolution en ce qu’il transforma la honte de vivre en fierté d’exister.
Soixante-huitard, moi ? Tout le contraire précisément : on n’éprouve aucune nostalgie - du grec νόστος, le retour, et de άλγος, la tristesse - des moments où l’on s’est réellement rencontré.
Car c’est bien à dix-sept ans qu’on est le plus sérieux. Passé ce cap de la première blessure et des premières contradictions vécues entre nous et le monde, on s’évertue à devenir peu à peu ce qu’on ne sera jamais. Parfois même, on fait des efforts titanesques, douloureux, pour être exactement ce qu’on n’aurait jamais voulu devenir.
Je n’ai dès lors jamais trahi mes premières illusions. Et j’ai fait ça sans stratégie ni courage particulier. Je l’ai fait parce que je ne savais pas faire autrement ; le désordre fut d’emblée mon élément, comme la rivière est celui du poisson.
Ma mère voyait loin, quoique de façon fort approximative, qui me qualifiait parfois de gibier de potence.
Je n’ai jamais vu de potence. Mais ma route a croisé celle de centaines et de centaines de gibiers traqués. Des fuyards du grand bordel social, des hors-la-loi, des méchants. Des condamnés à la nuit.
Et ce sont ceux-là, parfois illettrés, qui m’ont surtout appris à écrire ce que je sais écrire.
11:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.05.2011
Vases communicants :

08:34 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.05.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
VINCENT
Tu avais un sacré « pet au casque », comme on dit familièrement, mon cher Vincent. Tu étais même parfois sérieusement inquiétant avec tes yeux fous et ton sourire figé. Je me souviens de cette fois où, avec deux infirmiers et un médecin de garde, nous étions venus chez toi pour te faire hospitaliser d’office. Tu voyais des lézards qui couraient sur les murs de ta cuisine. Tu nous les montrais du doigt : « là, mais si, là, regardez, il se sauve ! » Tu hurlais et tu étais tellement persuasif qu’involontairement nous retournions la tête pour regarder où tu nous indiquais. Tu ne voulais pas être hospitalisé car les « aliens » te recherchaient pour te voler le « grand secret français »… Quel cirque dans ton crâne ! Les lézards n’existaient pas, mais ta terreur était bien réelle. Et elle faisait mal.
Je me souviens aussi de cette fois où je devais t’accompagner chez le juge. Tu m’avais fait une scène : tu refusais d’y aller sans ton chien, un brave bâtard au regard doux. J’avais résisté mais tu n’en démordais pas, alors j’avais cédé. Je nous revois entrant dans le bureau du juge, une femme d’une quarantaine d’année, vêtue d’un tailleur gris clair. Elle nous avait toisés d’un œil sévère. Elle t’avait regardé, puis elle avait tourné la tête vers ton chien. Et quand elle avait lu tout l’amour qu’il y avait dans le regard qu’il posait sur toi, elle avait compris, peut-être, que jamais tes frères humains n’auraient à ton égard autant de bonté. Elle avait souri et nous avait invités à nous asseoir.
Tu avais 24 ans et ton avenir, jalonné d’innombrables séjours en psychiatrie, était déjà tout tracé…
Je ne t’oublie pas.
Stéphane
08:41 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.05.2011
Nouvelle
Cette nouvelle n'a pas été écrite pour le recueil Le Théâtre des choses, à paraître fin juin chez Antidata.
Elle a été écrite comme ça. Un clin d'œil au Front russe de Jean-Claude Lalumière, peut-être. En tout cas, toute ressemblance avec des personnnages existant ou ayant existé ne serait évidemment que pure et malencontreuse coïncidence, parce que c'est comme ça qu'on dit toujours.
UNE METAPHORE
 On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?
On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?
On le dit de l’écrivain mais on devrait le dire aussi du hâbleur, quoique pour de tout autres raisons. Le danger le guette en effet de se faire repérer dans des utilisations différentes de ses mêmes forfanteries. Tel est le conseil que je donnai en tout cas un jour à un de mes nombreux chefs de service, qui n’était pas écrivain pour deux sous, du temps où je m’étais fourvoyé dans une administration décentralisée, aux multiples compétences.
Mais comment m’étais-je donc retrouvé petit soldat dans cette armée de généraux ? Commençons par là si vous le voulez bien; juste pour dire que, y étant entré par erreur, je ne pouvais en sortir que par une porte dérobée et en m’essuyant le front comme quand on l’a échappée belle après avoir encouru un sérieux danger.
J’avais préalablement été un peu tout et rien, étudiant, chômeur, promeneur, ouvrier, délinquant plus ou moins actif et, en dernier lieu, bûcheron. Ce fut donc absolument éreinté, les mains abîmées par les intempéries et le contact rugueux du bois, las aussi de fuir les petits papiers blancs, puis roses, puis bleus, d’huissiers sempiternellement lancés à mes trousses pour me soutirer des arriérés de cotisations, des retards de TVA, des échéances d’impôts et autres persécutions légales, que je décidai un beau jour de déposer mes armes sur un bureau de la Chambre de commerce en y signant, dépité, la cessation de mon activité de bûcheron-négociant en bois, entamée quelque dix ans plus tôt.
Fin d’une complicité que j’avais imaginée possible entre une espèce de rousseauisme nigaud, la nature, les p’tits oiseaux, l’air pur et les matins clairets, et un gagne-pain. La faim, c’est bien vrai, fait sortir le loup du bois et je quittai donc l’ombre des allées forestières, des chemins creux et des parcelles boisées en laissant accrochées dans les branches, tels les oripeaux de la défaite, mes dernières illusions d’un travail librement choisi, non salarié et en dehors du convenu social.
Libre, les bras ballants, le nez en l’air, je réfléchis ainsi quelque temps sur la direction à prendre. Réfléchir, c’est bien beau, mais réfléchir à quoi au juste ? Je ne savais pratiquement rien faire, je n’avais jamais appris le moindre métier et il était désormais bien tard pour m’aventurer dans une vie de larron capable de m’assurer la survie : j’étais donc mûr pour tenter de me mettre au vert dans une administration quelconque. Ce que je fis, au grand amusement de mes amis les plus chers. Je passai outre leur gouaillerie, j’étais fourbu, je vous l’ai dit, et j’avais grand besoin de me reposer sur des lauriers putatifs pendant que bouillerait quand même sur mon maigre feu un semblant de marmite.
Je fis donc une dictée, un extrait de Madame Bovary. On me demanda ensuite d’expliquer l’expression faire le philosophe à propos de Bovary-père préconisant pour l’éducation de son fils qu’on le laissât courir nu dans la nature, puis je calculai deux ou trois pourcentages d’une somme empruntée par un quidam, je dégageai le capital, et le coût total du crédit, - ça j’avais appris à le faire à mes dépens -, je répondis enfin avec bonheur à quelques questions de droit - ça aussi, j’avais appris sur le tas car il n’y a pas plus fin juriste qu’un gars qui a longtemps cherché à vivre en contournant les lois -, et hop, je vis comme par miracle s’ouvrir devant moi les portes confortablement capitonnées d’un emploi de fonctionnaire.
Moi qui venais de traîner mes bottes par des chemins fangeux et qui avais besogné dur à soulever des bûches, scier des troncs et entasser des branches, je me retrouvai soudain au paradis quand on m’installa, au quatrième étage d’un immeuble massif, dans un bureau propret et bien chauffé, en compagnie de deux autres bonhommes. Seule ombre au tableau cependant : les fenêtres donnaient en surplomb sur les toits et le chemin de ronde de la prison de la ville. Je ne vis pas cela d’un très bon œil et me surpris à penser que ça n’était pas forcément de bon augure pour la suite des événements. Décidément, ma vie n’arrêtait pas de tourner autour de ces satanés lieux de pénitence, même dans ses résolutions les plus sages et les plus honnêtes.
Je passe sur mes débuts assez cocasses dans un service où il n’y avait pas grand-chose à faire, sinon se montrer poli avec tout le monde, ne jamais avoir l’air de bayer aux corneilles et toujours faire semblant de griffonner de la quelconque paperasse ou d’être absorbé par un écran d’ordinateur.
Je ne puis cependant faire l’économie d’un mot sur ce petit monde découvert derrière les portes de bureau, petit monde souterrain, replié sur lui-même, hors des réalités extérieures, prétentieux, affable avec la hiérarchie, méprisant avec la piétaille du dessous, car on a croit toujours avoir quelqu’un en-dessous de soi en ces lieux où le grade tient lieu de lettres de noblesse, ne serait-ce que la femme de ménage ou, à l’époque, un Contrat Emploi Solidarité. Petit monde aussi ignorant de tout, de la littérature, des arts, de l’engagement personnel, mais expert en tout ce qui ne sert à rien, comme par exemple savoir présenter un budget clair avec des recettes, des dépenses et des tendances, en trois couleurs et sous Power point animé, bien sûr.
En gros, on eût dit un monde inventé par Molière. En dehors des femmes savantes, toute l’œuvre du maître à peu près était en effet représentée ici, des malades et des cocus imaginaires, des précieuses ridicules, des misanthropes, des tartufes, des bourgeois gentilshommes, des étourdis et des fâcheux. Un vrai panel de farces plus ou moins burlesques. J’en eus souvent le souffle coupé.
Ce que j’ai vraiment mal vécu en ces territoires étranges - exception faite pour une vingtaine d’individus sympathiques enlisés là sur un faux-pas de jeunesse- c’est la malveillance. Malveillance à l’égard du joyeux, du différent, de l’original, du décontracté. Malveillance aussi envers le chômeur, l’alcoolique, le décadent, le Rmiste, le SDF, alors que la plupart de ces gens-là, incapables de voler de leurs propres ailes ailleurs qu’à l’intérieur de leurs murs, y avaient, pour les trois-quarts, trouvé refuge par le biais d’un misérable piston d’une vague connaissance, d’un cousin du cousin au beau-frère d’un quelconque hobereau de village. Sans quoi, ils auraient été assurément de ces traîne-savates qu’ils méprisaient avec tant de zèle. En fait, c’est une image refoulée d’eux-mêmes, une sorte de destin auquel ils avaient échappé de justesse, qu’ils vilipendaient chez l’exclu.
Un dernier mot avant de cesser ces vaines diatribes et d’en venir à mon hâbleur sans carnet, pour dire aussi que, aspirés par les rouages puissants, bien huilés, lents et silencieux de la machine administrative, tous ces inoffensifs gredins étaient devenus d’incorrigibles fainéants et, comme tous les fainéants qui n’assument pas leur fainéantise, ils voyaient du laxisme et de la paresse chez tout ce qui n’était pas eux.
Sur la foi d’une plume qu’on jugea en hauts lieux originale et alerte dans les quelques rédactions administratives que j’avais été amené à commettre, je fus cependant nommé rédacteur en chef du journal interne, une publication destinée à promouvoir la grandeur des compétences, des actions et des projets de l’établissement. Un outil de management et de culture d’entreprise pour développer le sentiment d'appartenance, ne cessait de me claironner dans les oreilles mon chef en se balançant sur sa branche, une branche intermédiaire de l’organigramme mais si élevée pour sa cervelle de moineau, qu’on eût dit qu’il était pris de vertiges permanents.
Moi qui n’avais eu à manager jusqu’alors que ma famélique entreprise forestière et gérer mes déficits récurrents avec le banquier, j’aurais bien voulu qu’on m’expliquât en quoi mes élucubrations sur ce satané journal pouvaient servir les autorités et, surtout, donner à tout ce petit peuple piaulant et caquetant, le sentiment d’appartenir à une respectable et gigantesque volière.
On organisa donc force réunions autour de la notion de communication interne. Des flèches multicolores se mirent à voler dans tous les sens sur un tableau, du haut vers le bas, décisions des dieux de l’Olympe, puis du bas vers le haut, remontée des infos vers l’Olympe, puis transversalement, dans les deux sens, ces flèches-là devant faire tomber les cloisons, résoudre les conflits d’intérêts, libérer les rétentions d’informations et mettre de sérieux bémols aux mesquineries dues, un peu partout sur l’organigramme, à l’exercice du petit pouvoir.
Voilà, me dit-on, la communication interne, c’est abolir les différences, créer la transparence et prévenir ainsi les risques de conflits. C’est aussi faire en sorte que chacun des mille cinq-cents agents de notre Collectivité - avec un C majuscule obligatoire - comprenne à quelle grande œuvre il participe et en soit d’autant plus fier et motivé.
Ite missa est.
Mais encore, hasardai-je ? Car si une mission d’une telle noblesse et d’une telle grandeur m’était pour partie dévolue - faire comprendre à tout le monde pourquoi il travaillait et à quoi - la condition sine qua non pour la mener à bien, était que je comprenne moi-même ce que je faisais.
On ricana, goguenard et bonhomme. Rire supérieur de la hiérarchie qui sait et qui du même coup se trouve légitimée par l‘impéritie intellectuelle de son subordonné. Pour un peu on m’aurait tapé sur l’épaule et remercié de faire montre de tant d’ingénuité.
D’abord, bannir le mot travail de mon langage. Ici, on ne travaillait pas, on œuvrait. Bien. Enfin quelque chose qui me plaisait, on prenait soin des mots, quoique je n’aie jamais vu personne dans tous ces bureaux et ces couloirs où dégoulinait une lumière jaunâtre, qui eût un tant soit peu l’air d’un artiste penché sur son œuvre. Mais passons. On œuvrait à un projet commun, grandiose, énorme, celui du confort des contribuables, qu’il était d’ailleurs préférable d’appeler des clients, par qui nous étions payés et, in fine, donc, pour la réélection des élus qui présidaient aux destinées de notre collectivité.
Voilà qui ne me plaisait pas du tout. Je me vis aussitôt dans la peau d’un vil collaborateur mais je repris aussitôt mes esprits et retrouvai tout mon amour-propre en recadrant tout ça comme ça devait l’être, rubrique blabla.
Mais pour faire comprendre sa fiche de poste à un abruti tel que moi, rien de tel qu’une bonne métaphore, n’est-ce pas ?
Ecoutez donc un peu, me dit-on, tout sourire et en se balançant de suffisance sur un large fauteuil. Hier soir, je lisais justement un article dans Le Mensuel du territorial à propos de la communication. On prenait l’exemple d’un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creusait un trou avec une pioche et à qui on n’avait pas dit pourquoi ce trou. Un promeneur venant à passer par là lui demandait ce qu’il faisait. Ah, qu’il geignait le bougre, je besogne, je besogne. J’en bave, j’en ai marre, c’est dur, c’est éreintant. Chienne de vie !
Puis on prenait un autre gars du même tonneau et qui creusait aussi un trou, mais à qui l’on avait préalablement expliqué que c’étaient les premières fondations d’une cathédrale, d’une magnifique cathédrale, qu’il creusait là. A la question du promeneur, le type se relevait, essuyait son front en sueur, se tâtait les reins et s’exclamait, un sourire radieux illuminant tout son visage : mais comment ? Vous ne savez donc pas ? J’œuvre aux fondations d'une prochaine et gigantesque cathédrale, monsieur !
Voilà, avez-vous compris maintenant ?
Oui, j’avais compris.
Seulement, quoique m’évertuant au cours des quelques années qui suivirent à écrire aux endormis qui constituaient mon public qu’ils étaient en train d’élever un monument considérable à la gloire de je ne sais quoi, qu’ils participaient à une œuvre collectif dont tout le peuple contribuable était fier, je ne vis jamais s’allumer dans leur regard l’éclair joyeux du créateur. En fait de trous, ils creusaient chacun le leur, juste aux dimensions de leur fessier, pour s’y caler confortablement et voir ainsi passer l’inutilité des choses.
J’abandonnai très vite l’inexprimable challenge, moi-même me sentant de plus en plus solitaire et schizophrène dans cet univers à l’envers de la vie. Je pris le parti de la désinvolture. Je finis même par passer plus de temps au bistro du coin que dans mon bureau. C’était ma manière à moi de ne pas rompre tout à fait avec la rue, les vivants, les désespérés, les enjoués, les rêveurs à l’élocution pâteuse et tous les désœuvrés qui, sachant bien qu’ils l’étaient, n’avaient cure de le dissimuler.
Quelques semaines seulement avant que je ne rende mon tablier, survint cependant l’anecdote bis du prolétaire bâtisseur de cathédrale. Je ne saurais dire le sujet de cette énième réunion dont étaient parsemés les jours, les semaines et les mois, toutes plus laborieuses les unes que les autres. Ce dont je me souviens très bien, c’est qu’un type demanda au chef de service si…ah, j’y suis, c’était à propos des horaires à la carte qu’on venait d’installer et le gars, sans doute inquiet que de plus futés que lui trouvent sans lui une combine pour détourner les pointages, demandait si on avait mis en place des moyens de contrôle sérieux, service par service. Un truc magnanime dans ce goût-là. En tout cas un truc qui n’avait absolument rien à voir avec le confort du contribuable et l’érection d’un grand monument.
Le chef sourit benoîtement et fit d’abord une assez longue introduction morale, du style, nous sommes des adultes, nous sommes des gens responsables, nous ne sommes plus des lycéens, avant de s’interrompre brusquement, de faire semblant de se souvenir de quelque chose de précis et d’annoncer, que, tenez, hier soir justement, il lisait un article sur les horaires variables dans Le Mensuel du territorial et qu’on y disait que des gens motivés dans leur travail ne cherchaient jamais à truander des horaires, parce que, par exemple, prenez un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creuse un trou et qui…Et ainsi de suite jusqu’au creuseur enjoué.
Cette fois-ci, ma soupape de sécurité trop longtemps mise à contribution n’y tint pas, se grippa soudain et lâcha la bonde. J’éclatai de rire, semant le trouble et la confusion dans la petite assemblée. On s’offusqua, on remua énergiquement la tête en signe d’une vive désapprobation et on murmura que j’avais sans doute encore bu et que c’était honteux à la fin ! Excédé par leurs clabauderies et leurs jérémiades, c’est donc à cet endroit que je conseillai gentiment au maître de la séance de noter sur un petit carnet ses brillantes métaphores, car ça lui éviterait de raconter les mêmes balourdises à trois ans d’écart et sur des sujets complètement différents.
Ou alors, rajoutai-je, c‘est qu’il lisait depuis des années et tous les soirs le même numéro du Mensuel du territorial. Ce qui était quand même fort inquiétant.
Aucune suite disciplinaire n’eut le temps d’être donnée à mon insolence. Je pris la clef des champs quelques semaines plus tard, abandonnant tous ces gens à leur cercueil matelassé de certitudes. Mais j’étais au bord de l’asphyxie, il me fallait de l’air, tant d’air que je courus, courus à en perdre haleine jusqu’à l’autre bout de l’Europe, d’où aujourd’hui je me souviens, sans colère ni rancune. Avec un certain amusement, même.
Car le monde est fait de mondes juxtaposés, parfaitement étanches, sans passerelle de l’un à l’autre. C’est ainsi. J’avais simplement franchi un mur pour pénétrer un territoire qui n’était pas le mien.
L’intrus c’était moi et le pénible quiproquo était de mon seul fait.
Mais j’ai toujours depuis lors un crayon dans la poche de mon veston.
Du papier rarement.
11:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.05.2011
Réformes spectaculaires de la grammaire et du vocabulaire
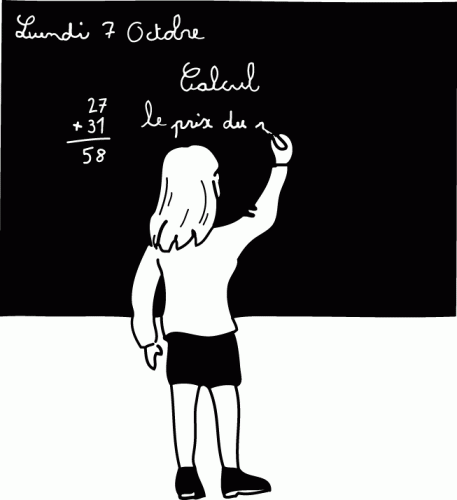 1 –VERBES
1 –VERBES
- Les verbes d’Etat sont : surveiller, mentir, voler, camoufler, falsifier.
- Tous les verbes d’action sont intransitifs.
2 – SUJETS
- Les attributs du sujet sont exclusivement réservés à la conservation de l’espèce.
- Les sujets sont tous des relatifs.
- Leurs antécédents sont sérieusement examinés avant introduction de toute proposition.
- L’inversion du sujet est fortement encouragée.
3 – PROPOSITIONS
- Les propositions sont toutes des subordonnées.
- Les propositions principales sont prohibées.
- L’analyse logique est supprimée.
4 – LES COMPLEMENTS
- Le complément d’objet direct est soumis à tergiversation préalable.
- Les compléments circonstanciels doivent être pleinement circonstanciés.
5 – LES PARTICIPES
- Le participe passé ne s’accorde avec son complément d’objet direct placé avant, qu’à la condition expresse de ne pas contredire le présent.
- Il est déconseillé de participer au présent.
6 - LES AUXILIAIRES
- Les auxiliaires de conjugaison deviennent : se taire, acquiescer, gagner, travailler, paraître.
- L’auxiliaire avoir ne s’emploie plus qu’accolé aux substantifs « travail et argent » et se conjugue le plus souvent au futur compliqué.
- L’auxiliaire être est remplacé par « avoir l’air de », beaucoup plus précis.
7 – LES MODES ET LES TEMPS
- L’impératif est le mode du législateur.
- Le conditionnel est forcément le mode des pauvres.
-Le lâche subjonctif du doute et de la probabilité est incorrect.
- L’indicatif ne conjugue plus rien.
- Le présent est décomposé.
- Le futur est réservé aux loups garous
8 - GENRE ET NOMBRE
- Tout ce qui est singulier est à employer avec précaution.
- Le masculin l’emporte toujours sur le féminin, même et surtout en cas de désaccord.
- Certains mots avaient mauvais genre. Il passe carrément au neutre : critique, pensée, enthousiasme, désir, etc. …
09:01 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.05.2011
Nouvelle
Seconde nouvelle ayant échoué à son examen de passage dans le recueil Le Théâtre des choses, à paraître en juin à l'enseigne d'Antidata.
Je ne la relis ni ne la remanie, laissant aux lecteurs de l'Exil des mots un texte brut de décoffrage, toujours dans le même esprit qu'ici.
L’ENTERREMENT
 Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.
Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.
De lointains bâtisseurs avaient dû considérer qu’une église digne de ce nom, ça ne devait pas être mêlé au quotidien des ouailles, que ça ne devait pas être mitoyen d’une épicerie, d’un café, d’une mairie, d’un marchand de chaussures, que le parvis ombragé et recouvert d’une fine couche de sable blanc n’était pas destiné à devenir le terrain de prédilection des joueurs de pétanque, mais que ça devait se tenir à l’écart de la vulgarité des préoccupations d’ici-bas, se montrer digne, respectable, hiératique même.
Aussi, pour accéder à cette église, fallait-il sortir du bourg par la rue principale et gravir bientôt un faible mamelon en empruntant une petite route fraîchement goudronnée, souvent maculée de bouses verdâtres, toute droite et qui, sitôt passé le point culminant de ce maigre relief, juste devant l’église, redescendait en de nonchalants méandres jusqu’à la forêt de Benon, chère à Rabelais.
Le saint édifice, élevé en grosses pierres taillées, jaunâtres, qu’enlaçaient par endroits le lierre et la viorne, surplombait ainsi le village et semblait de loin veiller à la bonne moralité des citoyens.
Peut-être même étaient-ils allés jusqu’à penser, les bâtisseurs avisés d’antan, que si on voulait se tourner un tant soit peu vers l’église – ne serait-ce que pour y lire l’orientation des vents qu’indiquait un coq au jabot avantageusement bombé– on serait obligé de se tordre le cou pour regarder très haut vers le royaume des cieux, dans la bonne direction, donc.
Créer une manière de réflexe, en quelque sorte.
Et tant qu’à isoler les abstractions spirituelles du tangible commun, on avait aussi construit là-haut le presbytère, qu’on avait accolé au côté sud du monument. Pour que le tout soit enfin à l’unisson, on avait également choisi d’établir sur ce tertre herbeux l’enclos des repos éternels.
Ce bel et digne ensemble était résolument tourné vers l’ouest et le proche océan. Il était ainsi battu par le grand vent des équinoxes, fouaillé par les brumes de novembre, mais aussi offert aux rayons incandescents des solstices de l’été, sans une once d’ombre pour le venir rafraîchir. Il régnait de fait sur ce modeste monticule une atmosphère de grave et lourde solitude. Trop grave peut-être. Si grave que les gens depuis longtemps ne prenaient plus guère la peine de le gravir pour les offices ordinaires du dimanche. Ils y consentaient encore, quoiqu’en automobile seulement, pour les grandes représentations de la liturgie, Noël, les Rameaux et les Pâques.
Cette lente érosion de la foi avait donc contraint la hiérarchie ecclésiastique à une bien prosaïque compression de personnel. Un seul curé présidait désormais au salut des âmes dispersées aux quatre coins des deux ou trois paroisses alentour et il avait été logé ailleurs, au centre de tout ça sans doute, sur Courçon d’Aunis peut-être, dans un souci évident — et bien de ce monde — de réduction des frais de déplacement, de sorte que le presbytère était inhabité depuis déjà une bonne décennie.
Ses volets de bois de chêne, épais, noirs d’intempéries, frappaient avec furie contre les murs et se disloquaient sous les coups de boutoir des vents, le jardinet était la proie des ronces et de la vermine, son allée avait été engloutie par les halliers, la clôture en était toute de guingois, effondrée par endroits, ce qui ajoutait encore à la mélancolie désolante, un peu mystérieuse, des lieux.
Il n’y avait plus guère que pour les enterrements qu’on daignait encore grimper à pied jusqu’au sommet de l’insignifiant relief, qu’on y accompagne un défunt qui passerait par l’autel ou un qui serait directement conduit en sa dernière demeure sans les lénifiantes fioritures de l’espérance. Une petite assemblée se regroupait alors en bas et y attendait la voiture funéraire, l’hiver en tapant du pied, en se frottant les mains et en soufflant dessus, l’été en cherchant l’ombre des noyers plantés au bord de la route ou celle des grands murs de la dernière ferme du bourg.
Un bref coup d’œil jeté sur ces hommes et ces femmes aurait pu d’ailleurs déterminer avec assez de justesse si le mort qu’on se proposait de suivre là-haut était bien à sa place de mort, dans le cours normal des choses, où s’il s’agissait d’une anomalie, d’une injustice et d’un drame.
Sans pour autant aller jusqu’à la désinvolture, si le groupe semblait décontracté et désordonné, si on y bavardait à son aise, si un ou une s’en détachait un peu pour appeler ou répondre sur son portable, si les hommes avaient les mains dans leurs poches et fumaient des cigarettes, si les femmes portaient des foulards qui n’étaient pas forcément d’une sombre couleur, alors on était, à n’en pas douter, à un rendez-vous prévisible, inéluctable et sans surprise. On enterrait aujourd’hui un ou une qui avait fait son temps.
Presque une formalité.
Si, au contraire, le groupe était absolument muet et compact, si les yeux étaient rougis, si on avait pris ses habits les plus noirs et si on baissait légèrement la tête, les mains croisées derrière le dos, immobiles, alors c’est que la Faucheuse avait frappé dans le désordre, à l’aveuglette, et que celui ou celle qu’on attendait là n’aurait jamais dû y venir de sitôt.
La mort reprenant alors tout son sens, qui est celui d’être un grand malheur, la tristesse et l’effroi imprégnaient les visages et enveloppaient les cœurs d’une austère compassion.
Dans les deux cas cependant, après avoir vu et entendu les lourdes mottes de glaise heurter le bois du cercueil, on redescendait toujours la colline par petits groupes de trois ou quatre, avec la mine fort triste et en hochant la tête de consternation impuissante. On commentait, toujours avec les mêmes mots, la fatalité et que tout ça, hélas, serait le lot de chacun, que c’était inévitable, notre tour viendrait, qu’il valait mieux ne pas trop y penser, mais que quand même c’était bien affligeant de s’en aller comme ça sous les ténèbres de la terre, et sans que personne ne sache vraiment où, et que ce « plus jamais » était absolument terrifiant.
On en avait des frissons. On hâtait alors le pas car on n’avait subitement plus qu’une idée en tête : s’engouffrer le plus vite possible au bistro pour y sentir à nouveau palpiter le chaud brouhaha de la vie.
Survint cependant une exception de taille dont tout le monde éprouva bien de la honte après coup et qui fit grand bruit à des kilomètres à la ronde, colportée peut-être par le prêtre au cours de ses différentes pérégrinations de clochers en clochers ou bien par les quelques derniers fidèles de la paroisse, outrés, à juste titre il faut le dire, par l’énormité du scandale.
On était le 28 décembre de l’année 1999.
La nuit précédente, la région avait été littéralement ravagée par un ouragan d’une épouvantable violence, on s’en souvient sans doute. Des toitures s’étaient envolées comme fétus de paille, des cheminées avaient été renversées, des granges s’étaient écroulées, les lignes électriques avaient été arrachées et jetées à terre en un inextricable désordre, celles du téléphone également, et on avait entendu, recroquevillé qu’on était dans les ténèbres en furie, les hauts peupliers des marais qui se fracassaient avec des craquements épouvantables, tels des coups de fusil tirés par-dessus les mugissements de la tempête.
Au petit matin on avait, les bras ballants, la gorge serrée, contemplé le désastre des paysages massacrés, les haies couchées, les fruitiers déracinés, les clôtures éparpillées, les peupleraies rasées, les chênes qui s’étaient répandus en travers des chemins et des routes, disloqués, lamentables, leurs vénérables troncs lacérés de longues et profondes échardes, comme sous la morsure enragée d’un monstre surgi des enfers.
On avait regardé, atterré, les horizons béant aux quatre coins du monde, écartelés, soufflés, pulvérisés par la terrible tourmente. On avait baissé la tête, on avait levé les poings, des yeux s’étaient humectés et on avait même (on n'avait : coquille corrigée par une lectrice), pour les plus désespérés, craché au ciel et insulté la terre.
Puis, le cœur lacéré, on avait retroussé ses manches et on s’était mis à l’ouvrage. Celui-ci tronçonnait, celui-là maçonnait, cet autre déblayait, un autre encore remettait tant bien que mal les tuiles du toit. On s’entraidait, on se prêtait des outils, on allait de chez l’un à chez l’autre, on se hélait, on se demandait conseil et tout ça en tempêtant, en jurant vilainement et en maudissant, bien sûr, le réchauffement climatique, les engins satellitaires, les Américains, l’aménagement imbécile du territoire avec ses autoroutes, ses rocades, ses ponts et, aussi, quoiqu’à voix plus basse, les irrigants de la plaine à maïs qui vidangeaient la terre de son sang, mais parmi lesquels on comptait quelques voisins.
Les femmes vidaient les congélateurs et cuisinaient des quantités effroyables de viandes, de poissons, d’escargots, de légumes, de fruits, car, c’était certain, ce ne serait pas demain la veille qu’on rétablirait l’électricité au vu des poteaux brisés sur les talus, des lignes enchevêtrées sous les ramures effondrées des arbres, et toute cette nourriture, qu’on avait soigneusement entassée pour l’hiver, allait se gâter et n’être bientôt plus bonne que pour la pâtée des chiens !
Vers le milieu de l’après-midi cependant, alors que le soleil vacillait déjà, très bas suspendu à l’horizon d’un ciel malade, bleu livide comme s’il ne s’était pas encore remis de ses épouvantes de la nuit, on se souvint soudain que la vieille Irène Bertholeau, née Soubise, 91 ans, avait paisiblement tiré sa révérence le 26 au soir, dans son lit, et que c’était aujourd’hui qu’on la portait en terre.
Elle avait été une brave et bonne voisine, elle était une ancêtre respectable et respectée, on l’avait toujours connue là, elle était déjà une vieille femme quand on était soi-même encore en culottes courtes et c’était un nouveau pan de la mémoire communale qui s’en allait aujourd’hui vers les ténèbres. Personne ne pouvait décemment, en dépit des circonstances dramatiques qui venaient de lui tomber sur la tête et en dépit de ses urgences, ne pas l’accompagner jusqu’à la tombe.
Les femmes enlevèrent donc leur tablier et abandonnèrent leurs ragoûts, leurs confitures et leurs rôtis, les hommes remisèrent leurs outils, firent taire les tronçonneuses et jetèrent sur les toits endommagés de larges bâches de protection, pour arriver bientôt par petits groupes silencieux, le visage fermé, au pied de la colline.
Pas un mot n’était échangé, les yeux étaient baissés, les poignées de main molles et distraites. Tout le monde avait manifestement la tête ailleurs, qui à sa grange effondrée, qui à son toit éventré, qui à ses arbres fracassés, qui à ses clôtures chambardées.
Le temps pressait. La nuit tomberait très vite et on allait devoir s’éclairer ce soir à la bougie, comme dans les temps reculés. Certains n’auraient même pas de chauffage ! Pour les producteurs de lait, il faudrait apprendre ou réapprendre les gestes antiques de la traite à la main, comme les générations d’un temps innommable ! Tous ces gens de la côte atlantique, en ces jours mémorables, se retrouvaient donc démunis et anxieux, presque handicapés, soudain privés du confort primaire auquel nous nous sommes tous évidemment accoutumés, quoique nous n’y prêtions plus la moindre attention dans le cours de nos vies quotidiennes.
Alors les regards torves guettaient l'arrivée du corbillard, les hommes tapaient du pied et hochaient la tête, nerveux et de fort méchante humeur, les femmes affichaient un visage hermétique, soucieux, et, de temps à autre, s’inquiétaient dans un murmure auprès de leur voisine la plus proche de l’heure qu’il était.
Bref, le trouble était trop profond pour qu’on gardât les extérieurs de la convenance la plus élémentaire. On s’impatientait sans vergogne.
Et ce fut quasiment au pas de course que le maigre cortège se mit bientôt à arpenter la hauteur derrière le cercueil enrubanné, car les employés communaux, eux aussi sans doute pressés de s’en retourner aux réparations domestiques avant la nuit noire, conduisaient la voiture à une allure peu convenable.
Tout ce beau monde s’engouffra donc dans l’église presque en courant, en se brûlant même la politesse, et s’installa en vitesse dans les stalles humides et froides, sitôt que le cercueil eut été déposé devant l’autel.
La distraite assemblée grelottait et de temps en temps levait ses yeux pleins d’angoisse vers une large déchirure du toit — signe que l’ouragan n’avait épargné absolument personne — et par laquelle on apercevait un bout de ciel de plus en plus sombre, tandis que le prêtre, un gros bonhomme tout de blanc vêtu, court sur ses jambes, tant qu’on n’apercevait quasiment que son visage rougeaud et fort sanguin derrière l’autel, psalmodiait et bénissait, un livre énorme, un vieux livre, grand ouvert devant lui. Les hommes et les femmes expédiaient les signes de croix et les prières à haute voix, quelques mécréants intraitables gardaient ostensiblement les bras croisés et, dans cette posture, tambourinaient nerveusement leurs avant-bras du bout de leurs gros doigts. De pieuses et vieilles femmes s’appliquaient néanmoins, d’un timbre haut et clair, à chanter avec le curé.
Et ce fut justement à la chute d’un de ces chants, alors que tout cela paraissait aux gens de plus en plus interminable et de plus en plus lourd, que l’abbé, les bras levés au ciel en direction de l’énorme brèche de la toiture, prononça la phrase par laquelle survint le scandale.
Dieu, prêcha le brave homme — ou Jésus, je ne saurais l’affirmer — est la lumière qui réchauffe les hommes et éclaire leur chemin.
Une voix puissante, railleuse, surgie de la pénombre des derniers rangs et qu’amplifièrent encore les hautes voûtes du sanctuaire, lui fit immédiatement écho et tonna : Hé ben, le f’rait pas mal de v’nir faire un tour à La Ceriseraie dans la soirée, vot’ citoyen, parce que de la chandelle et du feu, y’en ons pu chez nous autres!
Les nerfs des campagnards, mis à rude épreuve depuis vingt-quatre heures, se détendirent alors tels des ressorts trop longtemps retenus prisonniers et libérèrent tout à coup le tumulte incongru de leur énergie.
Tout le monde s’étant retourné vers le plaisantin, l’église ne fut plus soudain qu’un immense éclat de rire. On s’interpellait, on se tapait sur les cuisses, on se donnait de grandes bourrades dans les côtes, on était plié en deux, on avait des hoquets et des soubresauts frénétiques, on était rouge comme des pivoines, on répétait en hurlant à l’envi l’insolente répartie et on avait de grosses larmes de fou rire qui coulaient sur les joues.
Précipitamment descendu de son autel, le curé courait comme un perdu d’un bout à l’autre de la nef, se fâchait, admonestait, agitait les larges manches de sa chasuble, faisait tinter une clochette, bénissait le cercueil au passage, criait, fulminait, enrageait, se signait désespérément, levait en tremblant les yeux au ciel et tâchait (tachait : coquille corrigée par une lectrice) en pure perte de ramener à la raison tous ces gens brusquement pris de folie.
Quelqu’un prétendit même plus tard, beaucoup plus tard, des années plus tard, l’avoir entendu crier des noms étranges, comme Sodome et comme Gomorrhe.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.04.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
JONATHAN
Tu avais douze ans. Sylvie, ta mère venait juste de mourir, emportée par l’alcool. Je te revois dans l’église, chétif, vouté, caché derrière tes grosses lunettes de myope. Tu ne pleurais pas. Tu regardais tout autour de toi comme si tu te demandais ce que tu faisais là, comme si tu t’ennuyais. Tu l’aimais pourtant, ta maman. Mais tu avais dû souhaiter sa mort, aussi, quelquefois, lorsqu’elle t’envoyait, avec ton petit vélo, au supermarché, acheter les litres de vin blanc qu’elle s’enfilait ensuite et qui la rendaient mauvaise. Parfois, en revenant, du pinard plein les sacoches, tu croisais des gens de la mairie ou du Secours Catholique et tu sentais bien que le regard qu’ils laissaient tomber sur toi avait le poids d’un couperet, qu’ils te condamnaient tout autant qu’ils condamnaient ta mère. « Pauv’ gosse, c’est-y-pas malheureux… Qu’est-ce qu’il f’ra plus tard ? » Certains, froidement, t’avaient déjà énoncé leur pronostic : « tu finiras comme ton père ! »
Ton père ? Tu ne l’avais quasiment pas connu. Aperçu parfois, seulement, au café. Tu savais juste que l’alcool l’avait emporté, lui aussi, alors qu’il n’avait pas quarante ans. Et malgré toi, tu commençais à te dire qu’ils avaient probablement raison, tous ces cons -là, que c’était sans doute ton destin de finir comme lui… Toi qui, à cette époque n’avait encore jamais bu une seule goutte d’alcool.
La dernière fois que je t’ai vu, tu entamais, aux Orphelins d’Auteuil, un apprentissage pour devenir serveur. Tu aurais voulu t’occuper des chevaux, mais il n’y avait plus de place pour toi.
Je ne t’oublie pas.
08:49 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.04.2011
A paraitre fin juin
LE THEATRE DES CHOSES
10 nouvelles de France et de Pologne
 Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.
Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.
Et ce sera aussi l'aboutissement d'une belle connivence, entamée il y a plus d'un an, entre l'équipe d'Antidata et moi-même.
Sur les dix nouvelles écrites cet hiver et que j'ai proposées, huit ont été retenues. Le recueil incluera donc deux autres nouvelles déjà éditées, Souricière et La Faucheuse n'aimerait pas les aubades ?, respectivement parues en 2009 et 2010 dans les recueils collectifs, Capharnahome et Douze cordes.
Les lieux - les théâtres donc - des récits se partageront équitablement les pages du recueil, tantôt en Poitou-Charentes, tantôt en Pologne.
Première fois que j'écris en complicité préalable avec un éditeur. Si on y trouve un certain confort, celui du sentiment de ne pas travailler pour rien, on y éprouve aussi une grosse angoisse, celle de décevoir.
En tout cas merci à Olivier Salaün et à ses camarades. Je signale d'ailleurs au passage qu'Olivier est aussi musicien, auteur-compositeur dans le groupe de rock Cvantez et que vous pouvez écouter, si le coeur et l'oreille vous en disent, des échantillons de leur dernier opus, ici.
Belle création musicale.
13:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.04.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
Tous les quinze jours Stéphane Beau me rend visite et me parle des pauvres gens qui ont jalonné sa route. Une façon de leur donner dignité dans la mémoire.
SYLVIE
Tu es peut-être un de mes plus douloureux souvenirs. La souffrance se lisait sur ta trogne. Une tête toute ronde, toute rouge, avec de gros yeux globuleux, jaunes, striés de fines veines. Ta maison s’écroulait de partout, mais elle était à toi : tu l’avais héritée de ta mère. Il aurait fallu faire des travaux, certes, mais avec ton RMI tu avais déjà à peine de quoi manger, alors la charpente…
Ton mari était mort quand tu avais trente ans : l’alcool avait eu raison de lui. Il t’avait légué le souvenir de quelques violents coups de poings, une palanquée de dettes, et un fils que tu aimais. Mais l’alcool t’avait alpaguée, toi aussi. Et ce qui devait arriver arriva : un matin le fiston a été placé dans un foyer de l’enfance et tu es restée seule avec tes bouteilles. Tu ne savais même plus qui tu étais. Syndrome de Korsakoff qu’ils disaient les médecins… Les neurones qui s’éteignaient les uns après les autres, comme des bougies livrées aux vents… Certains jours je te demandais si tu avais des nouvelles de ton fils. Ton visage s’illuminait soudain et tu t’écriais : « bien sûr que j’ai de ses nouvelles, puisqu’il habite ici ! Il va rentrer manger ce midi, après l’école ! » Tu n’avais même pas remarqué qu’il n’était plus là depuis plusieurs mois. Ou si : peut-être préférais-tu faire semblant, pour t'épargner ce surplus de souffrance.
Un beau jour (drôle d’expression car c’était un jour fort triste) ton aide ménagère est venue me voir : en prenant son service, elle t’avait trouvée, allongée sur le carrelage de ton salon. Toute ta vie tu t’étais battue seule, pointée du doigt par tous les braves gens de la commune. Tu avais vécu seule, tu avais élevé ton fils seule… Et tu étais morte seule…
Qui sait ce qu’aurait pu être ta vie si un peu plus d’amour t’avait été offert, lorsqu’il en était encore temps ?
Je ne t’oublie pas.
Stéphane
08:31 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET