30.08.2012
L'enracinement de l'exil - 12 -

L'histoire - 3 -
Dans l’histoire, quand la violence se déchaîne, c’est souvent pour longtemps : elle se succède alors à elle-même par paliers reliés entre eux par des relations complexes de causes à effets.
Mais cette violence ne s’exprime pas toujours avec la même brutalité. Elle va crescendo, atteint son paroxysme, puis se retire decrescendo. Telle une vague atteignant aux rivages des présents successifs en perdant à chaque fois de son ampleur et de sa cruauté, elle épouse un mouvement de ressac.
Ce fut le cas pour la Révolution française : d’abord mécontentement sourd, banqueroute de l’état, puis convocation des Etats généraux, puis Assemblée constituante tentée par une monarchie constitutionnelle, puis l’exécution de Louis XVI, puis le paroxysme de la Terreur, avant les apaisements relatifs du Directoire jusqu’à la reprise de la force avec le coup d’Etat et l’Empire.
En Pologne, pour douloureuse qu’elle fût, donc, la période communiste ne s’accompagna pas de la même sauvagerie que celle dont s’évertua à faire preuve l’occupation nazie. D’ailleurs, de par le monde et de par le temps, aucune sauvagerie ne fut jamais exercée au point d’égaler celle des exécutions, crimes de masse, exterminations, génocides, tortures, qui se déroulèrent sur le territoire de la Pologne pendant la dernière guerre mondiale. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, pour ne citer que les plus sinistres, sont des lieux à jamais frappés du sceau de l’infamie et qui font frissonner d’effroi tout humain encore digne de ce nom.
La période communiste fut une période de muselage idéologique, une période d’anéantissement de la pensée, une période d’interdiction, de censure, mais pas une période de crimes organisés. Ce sont d’ailleurs les communistes qui, pierre après pierre, ont remis debout Varsovie, complètement détruite. Si vous vous promenez un jour sur les remparts, aux abords de Stare Miasto reconstruite à l’identique pendant plus de dix ans, vous ressentirez en filigrane ce charme de la vieille ville, cette architecture colorée, désuète, comme un voile tentant désespérément de recouvrir les stigmates d’un crime.
Tout le reste de la ville est neuf. On sent que la mémoire, celle des siècles qui nous ont précédés, y a été gommée, anéantie, niée par un cataclysme. Varsovie a subi le sort qu’Hitler réservait à Paris. Rasée. Imaginez dès lors Paris avec seulement le Quartier Latin reconstitué à l’identique et, partout ailleurs, une architecture de soixante dix ans d’âge seulement ! Imaginez la conscience collective évoluant dans un présent dont tout l’amont a été violé. Je vous laisse imaginer. Et si vous allez jusqu’au bout de votre imagination en marchant dans Paris, sans doute rencontrerez-vous Varsovie.
Le crime est irréparable, le crime ne trouvera jamais, quoique disent et fassent les hommes, sa compensation. Les Nazis n’ont pas été complètement vaincus car partout sur le visage de la Pologne ils ont laissé l’indélébile empreinte de leur folie.
Les communistes, rendons leur cet honneur, ont tenté de retrouver la mémoire au cœur de la vieille ville. Et ils y ont réussi. Mais c’est comme à Lascaux : c’est beau et émouvant, mais, intellectuellement, vous savez que vous êtes en présence d’une réplique.
Dans les campagnes, les paysans, tout du moins ceux avec qui je cause, ceux qui n’étaient pas en coopérative, n’ont pas ressenti durement le communisme. Ils vivotaient en autarcie sur quelques lopins, et, du moment qu’ils ne militaient pas contre le régime, qu’ils se montraient assidus au défilé du 1er mai et ne se rendaient pas trop ostensiblement à la messe, on leur foutait une paix royale, semble-t-il.
La messe… La Pologne, baptisée par les Tchèques dès 966, est férue de messes. Et si, sans Hitler et sa chute, elle n’aurait jamais été communisée par un puissant appareil d’état au mépris du peuple polonais, sans les communistes et leur chute, elle n’aurait jamais été cléricalisée comme elle peut l’être aujourd’hui.
Les époques s’enchaînent, chacune voulant nier la violence de l’autre alors qu’elle en est le produit direct. Chacune porte en elle les gênes de la violence du passé immédiat qui l’a enfantée.
Depuis la renaissance de 1918, il en est ainsi en Pologne : rien n’est fait dans la mesure.
A suivre...
07:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.08.2012
L'enracinement de l'exil - 11 -

L'histoire - 2 -
Le Reich nazi pris entre deux étaux marchant l’un à la rencontre de l’autre, celui des troupes occidentales et celui de l’Armée rouge, Churchill aura beau affirmer que d’accord, on serrerait la main des Russes, mais le plus loin à l’est possible, le rouleau compresseur soviétique en route vers le soleil couchant depuis Stalingrad, arrivera avant lui à Berlin et sera le premier à planter son drapeau rouge au sommet du Reichstag.
Que l’opiniâtreté de l'Union soviétique, son esprit combatif, son immensité, ses plaines et son insoutenable climat aient été les victorieux de l’immonde machine nazie, ne fait aucun doute, sinon pour les révisionnistes occidentaux. Car c’est bien un poncif d’affirmer que si Hitler n’avait pas violé le pacte Ribbentrop-Molotov, pacte qui comportait la clause secrète du quatrième partage de la Pologne et qui fut et restera devant l’histoire la honte de tous les communistes, le 6 juin 1944 n’aurait su avoir lieu.
Le Reich se serait forcément écroulé, mais d’une autre manière et sans doute à plus long terme, laissant derrière lui une somme encore plus effroyable de crimes et l’ampleur de l’holocauste eût été encore plus hallucinante.
Certes, tout cela est archi-connu. Ce que l’on sait peut-être moins - ou peut-être fait-on simplement mine de l’avoir oublié - c’est qu’en février 45 à Yalta, Staline et sa diplomatie arguaient du fait qu’ils avaient été agressés deux fois, en 1914 et en 1941, et que, cette fois-ci, chats échaudés n'aimant pas trop l'eau froide et puisqu’ils avaient tous les atouts en main pour imposer leurs vues ( l’Armée rouge n’était plus qu’à une centaine de kilomètres de Berlin), ils exigeaient qu’entre eux et l’Ouest, après la victoire, soit dressé un rempart de protection, c’est-à-dire, en plus clair, que les territoires qu’ils auraient libérés deviennent leurs vassaux.
Américains et Anglais n’avaient plus qu’à baisser leur pantalon et à faire le dos rond, comme ils l’avaient toujours fait - pour le sanglant Katyń notamment -devant l’ancien séminariste devenu le maître absolu du Kremlin.
Staline partageait avec Hitler, entre beaucoup d'autres choses dont un antisémitisme féroce, un sentiment commun envers les Polonais : la haine.
Pour l’un et l’autre, c’était là un sous-peuple, un peuple de dégénérés, voué à être dominé et l’esclave des puissants. Hitler avait fait de la Pologne le cimetière le plus démentiel et le plus démoniaque de l’histoire des hommes, Staline en fera sa proie de prédilection après 45, exigeant que le pays soit gouverné par des amis sûrs de l’Union soviétique et donnant à sa conquête de toute l’Europe centrale une assise militaro-juridico-politique, sous le nom glorieux de Pacte de Varsovie.
La Pologne, anéantie de 1795 à 1918, dévastée à partir de 1939, ensanglantée et torturée comme aucun autre pays ne le fut par les Nazis, se voit donc libérée par un libérateur qui la hait et qui a décidé de la saigner à blanc. Il est assez éprouvant pour la mémoire de se rappeler que les camps de concentration à peine libérés aient vu leurs baraquements aussitôt réutilisés pour qu’y soient enfermés et réduits au silence tous les résistants et patriotes polonais qui avaient combattu le nazisme et espéraient reconstruire une Pologne polonaise.
Il s’agissait pour Staline de faire le ménage avant d’installer là son gouvernement fantoche, à la tête d’une République populaire de Pologne.
Le pays ne retrouvera sa dignité que quelque cinquante ans plus tard, totalisant en tout et pour tout, 1919/1939, vingt ans de liberté depuis Louis XV ! Il sera d’ailleurs le premier, dans le bloc dit de l’est, à secouer le joug, le premier à imposer de haute lutte à son oppresseur des élections libres et des syndicats libres, bien avant la chute du mur.
Pour cette raison, cette chute ne signifie rien pour les Polonais. Elle n’est qu’un symbole, qu’une image superficielle pour consommateurs d’histoire. Ils avaient déjà fait craquer l’ogre soviétique, avaient déjà payé cette chute du mur au prix fort, emprisonnés ou tués, et subi l’Etat de guerre décrété le 13 décembre 1981, en donnant ainsi une image qui s’accroche encore au monde, celle d’un pays exsangue, affamé, privé de tout et où il fallait attendre des semaines et des semaines avant de pouvoir prétendre s’acheter le moindre morceau de viande.
1981, messieurs-dames ! C'était hier... Que dis-je ? C'était il y a une demi-heure à peine !
Si je vous raconte tout cela, - que peut-être vous savez déjà - dans un texte ayant trait à mon exil personnel, c’est parce que chaque 1er septembre, à midi pile, quand toutes les sirènes se mettent à mugir comme si elles pleuraient des larmes intarissables, comme si elles lançaient aux cieux la douleur d'une plainte qui n’en finit pas de jaillir d'une blessure qui ne se referme pas, j’ai le cœur qui tremble et je suis saisi par une émotion de forte compassion, avec, au fond, un puissant sentiment d’amitié pour cette terre et ce peuple, moi l’exilé occidental dans ce pays mis en ruines pendant des siècles et à qui les puissants d’Europe ont voulu tour à tour tranché le cou.
C’est cela, entre autres, que je voulais vous dire sur la page précédente en vous disant que je vivais mon interprétation du monde (acquise dans une conscience collective) au sein d’une conscience collective qui n’était pas la mienne.
Qui ne pouvait être la mienne.
Et je ne m’éloigne ainsi nullement de ma question initiale : est-ce que ton pays te manque ?
11:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.08.2012
L'enracinement de l'exil - 10 -
 L'histoire - 1 -
L'histoire - 1 -
Tous les pays du monde ont dans leur sillage les désordres ensanglantés de leur histoire.
Tous.
Pas un qui n’ait creusé son sillon, ensemencé son futur et récolté son présent sans avoir plongé l’épée dans les tripes de son voisin ni détruit par le feu ses villes et ses campagnes. L’histoire des hommes, dont la pensée dominante et dominatrice voudrait bien nous faire accroire qu’elle s’est apaisée dans nos contrées européennes et que le feu et le glaive appartiennent désormais à un passé barbare aboli par l’intelligence et la sagesse, cette histoire, se résume aux massacres et aux pillages des uns par les autres ou des autres par les uns. Le monde, avec ses banques, ses richesses, ses misères, ses équipements, ses frontières, ses conforts, ses morales, ses hypocrisies, ses convictions, ses religions, ses systèmes, ses loisirs, ses arts, que nous y fassions allégeance ou que nous nous en fassions les critiques résolus, n’est que l’éphémère et toujours fragile conclusion d’assassinats, de crimes et de mensonges perpétrés sur une échelle dantesque.
Les peuples d’aujourd’hui - pour nous en tenir à ce coin de monde qu’on appelle l’Europe - vivent en bonne intelligence, ont aboli la plupart des frontières gagnées pour les uns par le fer et le feu, perdues pour les autres par les larmes et le sang, et envisagent à présent leur avenir avec une sérénité désarmante. C’est le cas de le dire.
Bien sûr que c’est fort louable et bien sûr que c’est beau dans l’esprit ! Mais nous savons trop quels chemins nous avons empruntés pour parvenir à cet eldorado politico-financier courant des lisières de la vaste Russie aux plages de l’Atlantique, puis des rivages de la Méditerranée aux fjords gelés du Nord.
Les hommes de l’Europe peuvent bien avoir le même discours, s’abreuver aux mêmes sources bancaires et faire mine d’épouser les mêmes idéologies consolatrices, nous pensons, nous, que toutes les flaques de sang n’ont pas séché à la même vitesse sur tous ces chemins qui nous ont conduits jusques là et nous croyons que l’homme qui vit dans la nuit finlandaise, sous la neige et dans le vent, à deux doigts du pôle, ne voit pas de semblable façon la terre et la vie s’y organiser que celui dont les pieds baignent dans les eaux bleues de la Méditerranée, à l’ombre des oliviers, pas plus que l’homme qui a passé cinquante ans de sa vie sous la menace des chars de Moscou n’a la même vision du temps historique que celui qui n’a entendu le vacarme des chars que sur un écran de cinéma, dans ses livres d’histoire ou de littérature.
Je suis de ces derniers et je vis parmi les premiers. J’appartiens à la conscience collective de ceux qui n’ont jamais vu de chars braquer leurs canons aux portes des banlieues ni d’armée tirer sur la foule. Je suis donc le cul entre deux chaises, vivant ma conscience individuelle - les racines de mon interprétation du monde - au milieu d’une conscience collective autre… Et cette position entre deux consciences populaires résulte du choix que j’ai fait de vivre hors de chez moi.
Ce n’est donc nullement une position intellectuelle. C’est une réalité tangible, car l’histoire des sociétés laissent dans la conscience des hommes une conception durable du monde. Une conception agissante et lisible.
J’avais fait mes premières armes de contestataire du capitalisme contre un homme, De Gaulle, alors que les hommes d’ici étaient prêts à payer de leur vie pour l’avoir comme chef d’Etat. J’ai brandi le drapeau rouge et noir alors que les jeunes gens de mon âge, ici même, dans les années soixante dix, se faisaient tirer dessus ou étaient emprisonnés manu militari pour avoir voulu déchirer et passer par les flammes ce même drapeau qui ligotait leur existence. Un fossé me sépare donc de ces hommes, nous séparera toujours, même dans la fraternité la plus sincère.
Tous les chemins, en histoire, ne mènent donc pas à la même Rome. Même s’ils mènent aux mêmes mirages.
L’Europe est un mirage que seule dissipera une véritable fraternité, une fraternité sociale et non usurpée, ou, hélas, le déchaînement des contradictions reprenant du service sur les champs de bataille.
Je le sens. Je le déplore mais je le sens. J’ai appris ça de mon exil. Non point que les Polonais soient des gens belliqueux et mauvais coucheurs– bien au contraire, leur hospitalité est des plus chaudes ! – mais parce qu’ils n’habitent pas exactement, de par le sang que l’histoire leur a demandé de verser, la même Europe. Et il en va certainement de même pour tous les peuples d’Europe centrale, chacun avec leurs spécificités, longtemps réduits au silence derrière le rideau de fer, celui-ci étant, on ne le sait que trop, né d’un pacte signé par certains et accepté par tous, entre l’empire stalinien et l’occident.
Tous les discours peuvent bien dire le contraire. Ils ne serviront pour moi qu’une idéologie diplomatique dont la vision à trop court terme tente d’aliéner aux intérêts bancaires, mercantiles et immédiats du communautarisme géopolitique, la conscience chèrement acquise sur les chaos de l’histoire.
A suivre...
09:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.08.2012
L'enracinement de l'exil - 9 -
Le climat - 2 -
La valse des saisons en Pologne de l’est est une valse acrobatique, capable d’exécuter en même temps de grands écarts et des bonds prodigieux. Le mercure en effet caresse fréquemment les 40 degrés en juillet, avec si peu d’air que les arbres en tremblotent et que les cigognes, juchées sur le rebord de leurs gros nids, ouvrent tout grand leurs ailes pour tâcher de prodiguer un peu d’ombre à leurs oisillons. Les orages succèdent aux orages, les cieux se fracassent, déversent avec violence leurs trombes, s’en vont ailleurs distribuer leur colère et la marmite se remet à bouillir sur un zénith limpide. Et ainsi de suite…
En janvier, ce même mercure déprimera jusqu’à des 30 degrés de froid, parfois avec un tel vent surgi de l’est qu’on croirait bien que la contrée est soudain survolée par des escadrilles invisibles d’aiguilles lancées à toute allure.
On dirait que cette plaine est alors une demeure aux murs et au toit tellement béants que tout peut s’y engouffrer avec démesure, et ce sentiment qui fait synthèse des conditions climatiques, des sculptures de la géographie et des tumultes de l’histoire, ce sentiment qui donne envie d’écrire aussi, je crois qu'Andrzej Stasiuk le partage.
Lors d’un collectif d’écrivains se proposant de composer sur quelques grandes villes européennes, il consigne ainsi son passage à Lublin :
«Il fait froid. On est en novembre et il fait froid. Un vent glacé souffle de l’est, il faut s’emmitoufler. Pas moyen de s’abriter. La terre est toute plate depuis l’Oural. Plus plate que plate. Les phénomènes atmosphériques ne rencontrent pas le moindre obstacle. Les armées non plus. C’est ce que s’est dit Napoléon, et après lui, Hitler. Ils sont revenus la tête basse. Ils n’imaginaient pas qu’il pouvait exister quelque chose d’aussi vaste que la plaine de l’Est. On peut marcher autant qu’on veut, on n’arrive jamais au bout. On peut envoyer autant d’hommes qu’on veut, ils périront. Voilà ce qu’on se dit quand on descend par l’escalier de la rue Grodzka jusqu’à la place et qu’on prend en pleine figure ce vent venant de droite. Ce vent qui passe au-dessus des barres d’immeubles en venant du fond des ténèbres qui commencent quelque part au-delà de Khabarovsk, de Vladivostok. J’enfile tout ce que j’ai : col roulé, polaire, manteau, capuche, rien n’y fait. Il suffit que je quitte la rue Grodzka pour sentir que l’hiver est proche. Qu’il s’apprête à bondir, comme une panthère des neiges. Voilà. »
Admirable sensation de l’écrivain polonais aux prises avec les rigueurs de son pays ! Alors moi, venu des écumes tièdes, des sables chauds et des marais ombragés, au début, tant de froid me faisait frayeur. J’ai vécu mes premiers hivers comme une guerre. Faut dire que ma maison n’était pas prête. Elle avait beau se recroqueviller au coin de la forêt, se tapir sous la neige, quand l’hiver des steppes orientales l’a prise dans ses étaux, les canalisations se sont solidifiées et l’air se glissait par le moindre interstice, mordant le mollet, griffant la peau.
Je n’avais jamais connu cette course quotidienne contre le gel qui risquait de tout démolir ce que nous avions construit de si haute lutte et cette angoisse de voir sur nos têtes le tout s’écrouler sous (j’ai fait le calcul) 65 tonnes de neige, compacte et glacée ! Je me revois aujourd’hui avec une échelle et un râteau de fortune, fabriqué en vitesse, pour faire tomber cette neige, tâcher d’alléger les poutres et, tandis que j’étais en équilibre sur les rolons verglacés, devant mes yeux, le vent soulevant des tourbillons de poudre. Plus je faisais tomber de neige et plus le ciel s’évertuait à en déverser.
Maintenant, la bicoque a fière allure et sait braver, le front altier, les tempêtes sibériennes. Elle fait corps avec son climat. Elle ne s’en laisse pas compter !
Mais tout ce blanc, toute cette glace givrée aux paysages, tout ce silence qu’on croirait que le soleil a suicidé le monde, et ce thermomètre des jours et des nuits bloqué sur les moins vingt degrés, sont pour moi autant de pages directement ouvertes au chapitre extraordinaire d’un exil volontaire.
Dans une autre géographie, sur un autre coin de la terre, différemment exposé au regard de l’univers.
Autant de délices aussi. J’en avais tant rêvé, tout môme, de ces hivers déments de l’est !
Mais les exigences de confort de la vie adulte ajoutent toujours aux rêves d’enfant ces inconvénients prosaïques qui, par définition, leur font défaut.
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.08.2012
L'enracinement de l'exil - 8 -
 Le climat - 1 -
Le climat - 1 -
Le climat continental est d’abord mouvements, confusions et contradictions tumultueuses.
J’en connaissais évidemment quelques bribes retenues des lointaines leçons de géographie ou retirées d’expériences de voyage. Mais les leçons, même bonnes, sont toujours imprécises tant qu’elles n’ont pas été confrontées au réel et les expériences de voyage ne se souviennent pas d’un climat mais d’une météo.
Je maintiens - après Géographiques - que les conditions d’existence des hommes, la valse de leurs humeurs, leur façon d’appréhender leur monde, de forger leurs désirs, d’entretenir leur relations avec les autres, sont étroitement liées à la latitude de leur coin de ciel. La météo, page du climat lue au quotidien, n’est, selon moi, le sujet par excellence des conversations futiles que parce que ce monde a perdu ses repères humains et n’a que des conversations futiles à offrir. Ainsi, en en codifiant une fois pour toutes quelques unes comme archétypes de l’insignifiance, laisse-t-on à penser qu’il en existe, par opposition, de profondes. Ailleurs. Prenez, par exemple, un faux-cul de la pensée photocopiée, un qui se penche avec application sur les sujets qui ont de la barbe, les sujets graves, philosophiques, politiques, religieux, sociologiques ou autres, et parlez-lui de météo. Voyez dès lors son sourire en demi-teinte ! Ce sourire, qui se voudrait empreint d’une ironie supérieure, n’est en fait que le sourire d’un qui est content de vous parce que vous lui donnez l’occasion d’exprimer par un rictus narquois combien il est éloigné de ces préoccupations enfantines, lui, l’homme consistant !
Toutefois, pour démasquer l’imposteur, il suffit bien souvent de l’entraîner, après deux ou trois mots convenus et badins sur la pluie et le beau temps, dans un dialogue plus relevé pour l’entendre alors prêcher des médiocrités au regard desquelles le temps qu’il fait sur nos têtes apparaît comme un chapitre hautement intellectuel du commerce des hommes.
Le climat et ses corollaires, la géographie et l’histoire, sont les terrains de jeu sur lesquels nous vivons notre vie. Ils créent quelque chose de nous, ils ne nous sont jamais extérieurs, j’en suis certain, comme peut l’être la politique, surtout menée par les corniauds à qui on s’obstine depuis des lustres à donner une parole vide de sens. Très loin, très loin de nous. Tellement loin que nous n’en recevons plus rien qui nous concerne.
J’avais au-dessus de ma tête la douceur à peu près égale, sauf cas de crise intempestive, des climats de bord de mer. Des climats qui sentaient le sable, la brume et les algues de la marée. Et puis sous mes pieds, toute cette verdure des marais, des chemins de halage et des berges herbeuses le long des larges conches. C’était, dans mon esprit, un climat sans surprise, un climat dont la respiration était réglée sur celle du grand voisin, l’océan. La lumière y était d’ailleurs en perpétuelle réverbération sur une géographie façonnée par l’eau, le souffle du large et l’histoire des peuples de la mer. Les étés, sans être étouffants, chauffaient la peau et les hivers, sans être tout à fait confortables, ne cisaillaient pas le bout des doigts, ne pétrifiaient pas les paysages et ne gelaient pas les poils du nez quand on marchait dans le vent. Là-bas, quand on discutait météo, c’était pour se plaindre des longs crachins de l’automne ou des opiniâtres pluies de printemps, d’un orage qui avait éclaté sans crier gare et que, ma foi, on eût dit que tout le noir du ciel allait tantôt dégouliner sur les terres. Occasionnellement, vraiment pas très souvent, un peu de neige venait saupoudrer la prairie mais, à la vue de tous ces paysages dont l’eau était l’architecte premier, elle se dépêchait de fondre en larmes, parfois même avant de toucher le sol.
J’ai connu là-bas de vieux maraîchins, descendants des huttiers, manants et hors-la-loi qui peuplaient jadis l’inextricable dédale des fossés, des canaux et des ruisseaux. Ils n’auraient pas su vivre leur sang ailleurs que dans cette végétation luxuriante et moite, ils n’avaient d’yeux et de passion que pour l’anguille des marais et, comme elle, ils semblaient lucifuges au point ne pouvoir respirer que dans l’ombre épaisse des labyrinthes d’eau et de terre.
C’était une latitude, un climat, une géographie et une histoire : celle de la conquête des terres abandonnées par l’océan.
Les hommes étaient, comme tous les hommes du monde, inscrits dans le décor d’une destinée humaine.
Comme le sont, ici, ceux du vent, des étés étouffants, de la neige et de la glace, sur une plaine de sable ouverte aux quatre horizons, déroulée des Carpates à la Baltique et des modestes collines d'Allemagne jusqu'à l'Oural.
A suivre...
09:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.08.2012
L'enracinement de l'exil - 7 -
L'amitié
Que pourrais-je dire de plus, qui ne soit que confidence impudique ?
Le temps et l'éloignement sont des tombes où sont enterrés des vivants.
09:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.08.2012
L'enracinement de l'exil - 5 -

… Je disais donc qu’en ma demeure il n’y a place ni pour internet ni pour tout autre média qui me relierait peu ou prou à la cacophonie du monde.
Je ne dis pas que c’est bien ou que c’est mal, je ne porte aucun jugement de valeur sur une situation qui est de fait et non le résultat d‘une volonté militante ou d’une posture idéologique.
Cet anachronisme d’anachorète me satisfait néanmoins pleinement. Sinon, je tâcherais évidemment d’y remédier.
En ma demeure, il n’y a également pas beaucoup de visiteurs. Et voilà bien ce qui diffère radicalement de ma vie à la française, dans laquelle je ne pouvais me sentir exister que s’il y avait autour de moi le mouvement d’une camaraderie tapageuse et, s’il n’y était pas, du moins fallait-il qu’il soit prévu à très brève échéance.
Il me fallait des rendez-vous. Des points de mire.
Aujourd’hui, le commerce direct avec les hommes est pratiquement absent de mon exil.
Cela non plus n’était pas prémédité, même s’il pouvait paraître évident que, m’éloignant de près de 3000 kilomètres, on n’allait pas tous les soirs venir frapper à mon huis pour prendre l’apéro, jouer un brin de guitare ou discuter le bout d’gras.
La situation m’a fait autant que je l’ai faite et, au fil de ces quelques années, je me suis déshabitué des hommes qui parlent ma langue. Il m’est pénible de faire cet aveu mais, si j’ai toujours plaisir à ce qu’on me rende visite, si je suis toujours aussi joyeux d’ouvrir ma porte et qu’une bonne table soit dressée pour quelques amis ou copains de passage- très rares mais auxquels je voue cependant une franche amitié - au bout de deux jours, un certain silence me manque déjà.
La compagnie, on dirait, efface mes repères.
L’exil a donc dressé autour de moi une espèce de rempart à l’ombre duquel je peux vaquer à mes diverses occupations champêtres, bricoler de la matière, me contredire, rêvasser, lire, écrire, refaire le monde à ma façon sans qu’il ne soit besoin d’en parler à qui que ce soit.
Et je me dis souvent que mon existence, dont tous les aspects avaient eu jusqu’alors ceux d’un gave dévalant en cascades les flancs d’une montagne, a trouvé dans l’exil la plaine pour y prendre le temps de dessiner ses méandres.
Mais il est vrai, pour filer la métaphore, que tous les ruisseaux vont à la rivière, toutes les rivières au fleuve et que le fleuve, toujours, musarde, flâne, ralentit sa course, hésite, avant de s’aller diluer et mourir dans l'anonymat des grands océans.
13:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.08.2012
L'enracinement de l'exil - 4-

Il est indéniable que je passais en France beaucoup, beaucoup moins de temps sur internet que je ne le fais désormais. Pour être tout à fait clair, je n’allais quasiment jamais sur le net hors mes heures de travail et, comme des millions et des millions d’employés de bureau coincés dans leur cage capitonnée au seul dessein de payer leur loyer et d’assurer le fricot, je n’y allais pas pour ledit travail, mais pour des choses personnelles. Quitte à me les inventer.
Pendant ce temps-là, le temps passait et c’était, ma foi, une façon comme une autre de détourner l’ennui.
Le salariat a de ces mesquineries ! Si au moins les salariés pouvaient l’avouer ouvertement plutôt que de s’inventer mille fables à propos de leur conscience professionnelle, de leur utilité, de leur mission et autres sornettes, diantre, il y a fort à parier que la vapeur s'inverserait dans les turbines du consensus social !
Bref, Internet ne m’était en France que d’une utilité négative. Sauf une fois. C’était en 1999, je venais de terminer la rédaction de Brassens, poète érudit et je cherchais un éditeur. Je suis tombé sur Patrick Clémence, j’ai écrit, réponse favorable. S’en est suivi la publication du livre et une belle camaraderie avec ce joyeux et sympathique anar. Salut de loin, vieux gars !
En Pologne cependant, internet fait partie de mon quotidien. L’amusement s’est fait outil. Outil de quoi ? Je l’ai déjà dit, homo internetus s’amuse sérieusement. Le ludique, par un étrange et obscur sentiment de culpabilité peut-être, s’est érigé en outil, le dilettantisme s’est mué en profession (de foi). Je parle là exclusivement de ce qui nous concerne plus spécialement, d’écriture et de littérature.
Et puis, depuis mes plaines orientales, c’est dans cette seule lucarne qu’on parlait français, le bon français même, alors, internet est devenu au fil des années mon oasis romane dans un monde slave.
Sauf, quand même, que je me suis réservé une autre oasis, plus réelle, plus tangible.
Ma maison est en bois et elle sent la résine de pin, la sienne, celle dont elle est construite, et celle qui coule dans les veines de la forêt dressée à proximité. Là, sont mes livres, mes campagnes, le vent de l’est, la suite de mon histoire, mes occupations domestiques, mes petits travaux, le chant du loriot, la neige, les chemins plats et les dégels de printemps. Et le cœur de ma vie. Là, il n’y a pas de place pour internet. Il n’y pas de téléphone, pas de radio, pas de télévision non plus. Là, il y a la vie qu'on n'a pas le temps de raconter parce qu'on la vit.
Internet reste donc toujours ce monde virtuel et cette grange où s’entassent les mots dont l'écho m'a manqué. Mais il n’a pas de visage humain, c’est d'ailleurs pourquoi, parfois, il se veut si humain. Il est si rassurant ! Quand on y apprécie quelqu’un, c’est sans risque : on apprécie une ombre. Quand on s’y engueule, qu’on se brouille avec un autre, on se fâche ou on se brouille avec un fantôme, une imagination de soi-même, ce soi-même étant, à l’autre bout, lui-même imaginé. Théâtre d'ombres chinoises.
Il est d’abord littérature, représentation en fiction d’un monde bien réel et qui a fui sous nos pas. Qui s’est envolé par la fenêtre plutôt.
Ah, que ne me suis-je créé d’antipathies virtuelles sur ces pages aux mille visages invisibles, pour m’y être cru un moment comme dans la vie ! Est-ce qu’on se fâche avec les personnages qu’on crée dans ses romans ? Quand on est mécontent d'un acteur, au théâtre, est-ce qu'on s'en prend à son rôle plutôt qu'à son jeu ? Erreur de jeunesse, dirais-je avec le sourire.
Le seul visage humain d’internet c’est la solitude de chacun reposant sur la solitude de l’autre. Sans aveu. En donnant le change même. Et ce, par-delà l’insignifiance, pourtant révélatrice pour ceux qui exigent encore et encore de la vie, de tous les bavardages.
Internet est un exil.
Et c’est par cet exil dans l’exil que je suis devenu homo internetus à temps partiel.
14:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.08.2012
L'enracinement de l'exil - 3-
 Ecriture et blog
Ecriture et blog
Blog ou pas blog, j’ai toute ma vie consacré à deux velléités : l’écriture et la musique, sans pour autant réussir à devenir ni un véritable écrivain, ni un chanteur ou un musicien accompli. Encore faudrait-il préciser ce que peuvent être un véritable écrivain ou un chanteur accompli par-delà ce qui les définit socialement, c’est-à-dire par-delà l’audience et le succès.
Bernard Henri Levy n’est à ce titre pas plus un écrivain accompli que Johnny Hallyday n’est un artiste émérite. Bernard Henri Levy n’a jamais fait le même métier que Michon ou Echenoz et Hallyday n’a jamais fait le même que Brassens, Brel ou Barbara. Mais laissons ça de côté, c’est un autre propos, souvent injuste, partial, quand il n’est pas atrabilaire et vindicatif. Après tout, si j’avais trouvé sur ma route chaotique un gars qui m’aurait dit qu’il allait me produire un disque avec des chansonnettes à la gomme dans lesquelles amour aurait rimé avec toujours et automne avec monotone - déférence gardée envers Paul Verlaine - peut-être n’aurais-je pas tordu le nez et fait la fine bouche du puriste.
J’ai donc écrit mon premier récit à l’âge de douze ans environ et, comme tous les collégiens-adolescents reclus entre quatre murs où une absurde discipline tenait lieu de morale de vie, j’ai noirci des cahiers entiers de poèmes où les vers tenaient lieu de subversion.
Plus tard, j’ai gribouillé des manuscrits, des romans, des nouvelles, des trucs qui se voulaient être des essais, toutes ces tentatives ayant pris le chemin qui mène directement à la poubelle.
Sans cette poubelle et sans l’exil, deux choses absolument sans aucun lien entre elles, aurais-je ouvert un blog ? Je n’en suis pas certain. Mais on ne peut rien affirmer de fiable quand on se fait apocryphe, qu’on imagine un passé autrement. Disons alors, pour tenter d’approcher la vérité au plus près, qu'eu égard aux dispositions d’esprit dans lesquelles j’étais durant les quelques années qui ont précédé mon départ de France, il n’y avait aucune place pour le temps, l’envie et l’investissement personnel que réclame la tenue d’un blog.
L’ennui dû à une vie dont le seul défaut était d’être depuis trop longtemps la même, le prisme tantôt joyeux tantôt désespérant de l’alcool, les copains, la musique qui, les derniers temps, me donnait toute satisfaction, un travail – sens étymologique oblige -qui m’était devenu exécrable, tout ça avait expulsé de mon âme le désir et le besoin d’écrire.
Et c’est quand j’eus tranché le nœud gordien qui retient prisonnière toute vie sécurisée sous le poids des habitudes, même bonnes, lorsque je me suis retrouvé dans un pays dont je ne savais pas grand-chose, dans un climat autre et une géographie nouvelle et, surtout, avec d’autres espoirs affectifs, que je me suis remis à écrire, tous les jours, avec délectation, avec acharnement, comme si cette écriture avait enfin trouvé, avec le déracinement, l’encre dans laquelle il était nécessaire qu’elle fût trempée.
L'écrivain Denis Montebello, avec lequel j’entretenais une correspondance régulière consécutive à une amitié de plus de vingt-cinq ans, me faisait la juste remarque selon laquelle j’avais attendu d’être coupé de mes racines et de mes amitiés pour écrire – quoique d’impure façon – mon archéologie personnelle avec Le Silence des chrysanthèmes. Comme si je voulais remonter le temps et, remettant au jour les tessons éparpillés de mon enfance, j’eusse voulu comprendre la direction d'un vent de départ qui m’aurait poussé sur les rives du Bug, à l’autre bout de l’Europe.
Puis ce fut Des plages de Charybde aux neiges de Scylla, puis, Chez Bonclou, puis Polska B dzisiaj, puis Zozo, puis Géographiques, puis des nouvelles, puis Le Théâtre des choses, puis deux autres livres actuellement en stand by désolé sur mon disque dur, Agonie et Le Laboureur.
Neuf livres en sept ans avec, entre temps, les quelque 800 textes qui constituent aujourd’hui L’exil des mots. Non, assurément, j‘imagine que je n’aurais jamais fait cela les pieds plantés dans ma glèbe natale et le nez dans un verre où scintillaient autant de désillusions fantasmées que d'espoirs mal définis.
C’est comme ça. Un hasard. Tout n’est qu’hasard logique.
Alors ? Aurais-je la prétention, l’outrecuidance, l’abominable orgueil de prétendre que mon blog est un blog à part en tant qu'épiphénomène du sentiment vécu de l'exil ? Il y a tant d’imbéciles heureux qui me jugent vaniteux, que je serais presque tenté de l’affirmer, histoire de rajouter un peu à leur imbécillité, d’amener de l’eau à leur moulin et de les enfoncer encore plus dans leur fallacieux jugement. Comme le disait plaisamment le fameux dialoguiste : faut pas parler aux cons, ça les instruit.
Mais cela ne satisferait pas du tout ma démarche. Mon blog est donc une goutte d’eau dans la mer inégale des milliers d’autres blogs et sites.
Alors, souvent, je me dis que, soit il y a autant de motivations qu'il y a d’archéologies intimes, autant de raisons d'écrire qu’il y a de gens qui écrivent, soit l’écrivant, le blogueur, est, tout comme moi, un être exilé de soi, à qui il manque un bout de monde constitutif et qui jette sa bouteille à la mer, espérant qu’elle atteigne à d’autres rivages et reçoivent enfin l’écho d’autres voix inconnues.
A la recherche des mots pour faire du monde et de sa vision une unité.
Pour rapatrier ces mots.
Dans l’illusion numérique du directement publiable– dont je me garderai bien de dire si elle est profitable ou non –, d’avoir enfin trouvé les sentiers de traverse qui évitent ceux menant tout droit à la poubelle.
14:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.08.2012
L'enracinement de l'exil - 1 -
PREMIERE PARTIE
Mon pays
Qu’elle émane d’un autochtone ou d’un Français de passage ici, la question m’est souvent posée de savoir si mon pays me manque.
En soi, c’est une question profonde mais posée, il me semble, sur le mode du comment ça va ? Une question de l’urbanité la plus élémentaire, dont on n’attend pas forcément une réponse, quand on ne s’en fout pas éperdument.
Du temps où je travaillais - peu car me souciant comme d’une guigne de gagner beaucoup -, j’avais fait l’expérience amusée, un beau matin où un collègue me demandait, comme tous les matins et comme tous les collègues, si ça allait, de répondre : non, ça n’va pas du tout. Déstabilisation immédiate, trahison du code social, gêne, affolement et fuite.
Surtout ne pas risquer les confidences humaines d’un malaise putatif de l’autre. C’est pourquoi, à la question comment ça va, on répond toujours oui, même si on est aux prises avec les tourments les plus cuisants.
J’avais ainsi pris l’habitude, voulant comme tout le monde sacrifier au code de bonne conduite, de saluer mes collègues d’une formule qui incluait la réponse: Comment c’est-y que ça va bien ce matin ?
C’est donc à ce genre de phénomène que me fait désormais penser la question récurrente : est-ce que ton pays te manque ? Et je me suis ainsi fabriquer une métaphore à quatre sous, que je ressers à chaque fois et qui, je crois, satisfait toujours la non-curiosité de mon interlocuteur :
- Je suppose qu’un marin isolé sur la mer, même amoureux de la mer, a parfois le mal de terre…
C’est une dérobade. Je n’ai en effet pas envie de dire en deux mots si mon pays me manque ou non. C’est beaucoup plus compliqué que cela et c’est un sujet qui, à mes yeux, après sept ans d’exil, mérite en profondeur un long développement. Ne serait-ce que pour y voir moi-même plus clair.
C’est le genre de question auquel, peut-être, seule l’écriture peut répondre.
C’était en mai 2005. La décision de quitter mon pays était ancrée en moi depuis un an déjà. C’était une décision qui m’effrayait et m’enthousiasmait tout à la fois. Je n’avais jamais fait cela, évidemment, je ne savais ni la longueur, ni même le profil de la route sur laquelle je m’engageais. Je ne savais rien de tout cela car je ne savais pas, intérieurement, ce qu’était un pays affublé d’un adjectif possessif. Mon pays. Je n’avais jamais utilisé cette équation, je ne l’avais jamais ressentie, je la jugeais surannée, sans fondement, et même profondément dangereuse. Être français ne faisait pas partie de mon identité, sinon pour les flics et la sécu. Voyageant, en trimardeur ou en touriste, en Espagne, Italie, Danemark, Allemagne, Suisse, Angleterre ou Allemagne, j’avais, comme tous les vacanciers du monde, mon pays dans mon sac et voyageais en parallèle et en boucle, certain que le point de départ, à moins d’un accident mortel, serait aussi le point de retour.
Voyager ainsi, c’est voyager pour voir et entendre seulement. Goûter un brin de culture comme on goûte un amuse-gueule exotique, avant d’en revenir à la saveur bien de chez nous du plat principal.
C’est bien aussi, mais ce n’est pas ce voyage que j’entamai en mai 2005. J’allais passer des frontières qui, peut-être, se refermeraient derrière moi, enjamber des ponts qui, peut-être, seraient coupés une fois la rivière franchie.
Et quelques mois plus tard, évoquant le moment précis où j’avais mis ma décision d’exil à exécution, à un carrefour en pleine campagne, marqué d’un stop, j’écrivais à un ami :
« Ce stop, vois-tu, semblait avoir été posé là pour moi seul et comme limite où devaient s’exprimer, sans qu’aucune dérogation ne soit permise, en même temps la fin de la duplicité et le commencement du courage à vouloir vivre sa vie, à droite comme à gauche.
Le ciel de mai était gris, froid, bas et moche. Je voyais des corneilles bousculées par le vent et qui planaient sur les blés en herbe. Une responsabilité énorme pesait sur mes épaules, depuis toujours peu portées à les recevoir, les responsabilités. Si je prenais à gauche, on pleurerait à droite et inversement.
Que s’est-il passé exactement ? Je ne saurais aujourd’hui trop bien te le dire. Je me souviens avoir hurlé de joie une fois que la voiture eut bondi à plus de cent cinquante à l’heure vers l’entrée de l’autoroute. J’ai hurlé de joie parce que je fonçais vers une décision prise, irrémédiable et franche. Vers d’autres horizons dont je ne connaissais pas encore la couleur et que j’habillais simplement d’espoir.
Aujourd’hui, installé dans cet hiver que la neige englouti, à plus de 2500 km de tout ce que fut jusqu’alors ma vie, dans une langue où je n'entends que des chuintements, heureux et reposé, je me demande souvent ce qui se serait passé si j’avais tourné le volant à droite.
Je ne le saurai jamais. Je mourrai sans le savoir.
Parce que nous sommes des êtres inachevés, des prétentieux qui nous croyons maîtres de nos destins alors que nous ne comprenons rien à la mise en scène de notre propre histoire. Nous sommes suspendus aux quarts de secondes passionnels….» etc.
Ce que je cherche à savoir aujourd’hui c’est en quoi ce coup de volant à gauche, a profondément modifié ma vie.
Répondre donc, sans ambages ni tricheries, à la vaste question : est-ce que ton pays te manque ?
A suivre au cas où cela vous intéresserait…
Image : au bord du Bug
09:46 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.08.2012
Épitaphe
Sur la pierre qui protégera des intempéries mon sommeil éternel, j'aimerais que soit inscrit :
Passant, j'ai moi aussi visité l'au-delà. Là-haut. Où tu as le bonheur de flâner encore
09:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.07.2012
Les métives
 Les toutes premières faiblesses du soleil, sitôt après le quinze août, annonçaient l’heure des métives.
Les toutes premières faiblesses du soleil, sitôt après le quinze août, annonçaient l’heure des métives.
Un mois durant, les paysans allaient de villages en villages et de fermes en fermes, s’échangeant leurs journées pour battre les gerbes de céréales entassées dans les cours en de grosses meules rondes et pointues, qu’on eût dit des habitations conçues par les hommes lointains du néolithique.
La grosse machine à battre, avec ses enchevêtrements de courroies de cuir et de poulies, ses roues ferraillant sur la pierre, arrivait par les chemins, tirée par un vieux tracteur.
Nous l’entendions. Nous l’avions longtemps guettée. Elle était annoncée depuis quelques jours, mais elle avait pris du retard chez un tel, la moisson étant plus abondante que prévue, ou elle avait été contrainte, après un terrible orage chez un autre, d’attendre que le soleil vînt sécher les gerbes.
Le plus souvent, presque tous les ans, elle était tombée en panne chez tel autre et on ne trouvait pas de pièces de rechange. Le forgeron s’évertuait à en bricoler une.
L’arrivée de cette machine tenait lieu de cérémonie. C’était un spectacle et la promesse d’une grande fête. De tous les hameaux alentour arrivaient des paysans, celui-ci sur son vélo, celui-là à pied, ce dernier, plus prospère et souvent plus bedonnant, sur un vélomoteur bleu. Toute une journée, parfois deux ou trois, le grain montait dans les greniers, par des échelles branlantes, dans de lourds sacs de jute portés par les épaules d’hommes sanguins. Il y avait là de l’orge piquante pour vendre, du blé dur pour le pain et de l’avoine pour les chevaux et la basse-cour.
La paille bottelée s’entassait en une barge impeccablement rectangulaire, la balle et la poussière volaient dans l’air, harcelant les yeux, obstruant les narines et maculant le torse en sueur des batteurs qui, tous, avaient noué autour de leur cou leur grand mouchoir à carreaux, comme des cow-boys.
Les repas étaient de véritables banquets d’empereurs décadents. On hurlait, on s’interpellait, on commentait, on jurait et on se soûlait sans retenue. Coqs, poulets, canards, oies, dindes, pintades avaient été saignés, quand un veau ou un goret n’avait pas été sacrifié. Des barriques avaient été mises en perce.
C’est d’ailleurs au jus de ces tonneaux que le propriétaire gagnait pour des années et par toute la campagne à des kilomètres à la ronde, son label de bonne maison, de bon gars ou au contraire sa réputation de gars de rin, de fesse-mathieu et de sale boutiquier, selon que la barrique percée était suave ou aigre.
Certains étaient même publiquement accusés de garder par-devers eux le bon vin, doux et parfumé, et de servir aux battages leur plus mauvaise barrique, de la piquette peutée qui brûlait les estomacs et mettait les boyaux en déroute.
J’étais chargé d’étancher la soif de tous ces farouches batteurs en distribuant les bouteilles de cidre et de vin frais. Je n’y fournissais pas et je courais du cellier au paillé, du paillé au grenier et du grenier au cellier. Dans le vacarme assourdissant des courroies, des pistons, des poulies et des chaînes de l’énorme machine, on me conspuait gentiment, on m’appelait bêtement, on feignait de se plaindre de ma lenteur. Tout le monde avait toujours soif et le tonneau du cellier se vidait, inexorablement, dans le gosier de ces Danaïdes poilus et brailleurs.
Une journée avant la moisson, ma mère avait été demandée pour aider les femmes au fourneau, plumer et vider la volaille, éplucher les pommes de terre et les navets.
Quand sonnait l’heure de la bombance, c’est elle qui servait les plats, adroite, rapide, sautillante et souriante, un bon mot pour chacun, et à la fin, quand la gnôle inondait les cafés brûlants et finissait de détervirer les ciboulots, elle était invitée par toute cette horde de barbares aboyeurs à monter sur les tables et à chanter.
Alors elle chantait, elle chantait à perdre haleine, elle chantait à tue-tête. Elle chantait des temps qui me semblaient ne devoir jamais finir.
Les répertoires de Tino Rosi, de Luis Mariano, de Dario Moreno et de Piaf devaient à n’en pas douter tous passer ces soirs-là par sa glotte. On en redemandait, on tapait des mains et on reprenait en chœur. Elle le tenait, son cabaret ! Elle ne le lâchait plus.
Depuis longtemps cependant la nuit et la fraîcheur étaient tombées et la voie lactée s’arc-boutait dans le ciel des derniers jours d’août.
Alors je m’endormais sur une botte de paille, dans l’ombre de la grange, légèrement à l’écart du banquet, le cœur et l’esprit partagés entre la honte et la fierté.
Et puis c’était la fin. Chacun rentrait chez soi après un grand mois de travail communautaire, de vagabondage de fermes en fermes et de bombance. Chacun s’en retournait à la solitude de ses champs, retrouvait sa tempérance, brossait et ferrait ses chevaux, vaquait à ses occupations ordinaires et recommençait à éventrer la terre en de longs sillons, où seraient déposés les grains prometteurs de nouvelles métives.
Le soleil de plus en plus couleur de miel baissait de plus en plus vite sur la plaine en labours. L’automne dispersait lentement ses lumières obliques et égayait l’herbe des fossés des premières perles de rosée. Les ombres s’allongeaient, les martinets ne criaient plus et les hirondelles ne rasaient plus le sol, ni même ne tournoyaient dans l’air bleu.
Ma mère s’évertuait à rapiécer des pantalons, faisait l’inspection des boutons de chemise, tricotait des pulls ou faisait ressemeler des chaussures.
Le temps de regagner les bancs de l’instruction publique était proche.
08:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.07.2012
Gaston Couté, frère lointain
Je me souviens des grands céréaliers lacérant mes paysages, rayant du cadastre mes chemins de traverse et mes venelles, comblant les fossés, aplatissant les talus où fleurissaient des boutons d’or et arrachant les buissons.
Je me souviens des marais colonisés par l’infect maïs…
Je me souviens des souvenirs détruits. Des pas de l'enfance chassés de la mémoire.
Et j’écoute Couté, cet homme généreux, ce poète de la Beauce, ce libertaire enchanté et qui n’avait pas besoin de gueuler qu’il l'était, libertaire.
Il lui suffisait de laisser couler les larmes de son cœur.
Respect. Toujours. Respect et émotion.
Les Mangeux de Terre
J’passe tous les ans quasiment
Dans les mêmes parages
Et tous les ans, j'trouve du changement
De d'ssus mon passage
A tous les coups, c'est pas l'même chien
Qui gueule à mes chausses
Et puis voyons, si j’me souviens,
Voyons dans c'coin d'Beauce.
Y avait dans l'temps un beau grand chemin
Chemineau, chemineau, chemine !
A c't'heure n'est pas plus grand qu'ma main
Par où donc que j'cheminerai d'main ?
En Beauce, vous les connaissez pas,
Pour que rien n'se perde,
Mangeraient on n'sait quoi ces gars-là,
I mangeraient d'la merde !
Le chemin, c'était, à leur jugé
D'la bonne terre perdue
A chaque labour y l'ont mangé
D'un sillon d'charrue
Z'ont grossi leurs arpents goulus
D'un peu d'glèbe toute neuve
Mais l'pauvre chemin en est d'venu
Mince comme une couleuvre
Et moi qu'avais qu'lui sous les cieux
Pour poser guibolle !
L'chemin à tout l'monde, nom de dieu !
C'est mon bien qu'on m'vole !
Z'ont semé du blé sur le terrain
Qu'i r'tirent à ma route
Mais si j'leur demande un bout d'pain,
I m'envoient faire foute !
Et c'est p't-êt' ben pour ça que j'vois,
A mesure que l'blé monte,
Les épis baisser l'nez d'vant moi
Comme s'ils avaient honte !
Ô mon beau p'tit chemin gris et blanc
Su' l'dos d'qui que j'passe !
J'veux plus qu'on t'serre comme ça les flancs,
Car moué, j'veux d' l'espace !
Ous’que mes allumettes elles sont ?
Dans l'fond d'ma panetière
Et j'f'rais bien r'culer vos moissons,
Ah ! les mangeux d'terre !
Y avait dans l'temps un beau grand chemin,
Chemineau, chemineau, chemine !
A c't'heure n'est pas plus grand qu'ma main
J'pourrais bien l'élargir, demain !
14:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
L'instituteur à compte d'auteur
 J’envisage malgré tout de faire quelques apparitions dans ma vacance. De temps en temps. Des trous dans le vide. Est-ce qu’on peut voir des trous inscrits dans du vide ? Difficile sans doute.
J’envisage malgré tout de faire quelques apparitions dans ma vacance. De temps en temps. Des trous dans le vide. Est-ce qu’on peut voir des trous inscrits dans du vide ? Difficile sans doute.
Quant à les lire…
Je suis en vacance. Ces apparitions sporadiques constitueront donc des textes de la vacance. Mais en existe-t-il qui soit autre chose ?
Oui, sans doute. Des trous dans du vide. Des trous qui comblent. C’est quand même un comble, ça, des trous qui comblent ! Et ça me rappelle plaisamment la définition du néant donné par un humoriste célèbre : le néant c’est un trou avec rien autour.
Alors, allons-y. Je vais vous parler de rien. C’est-à-dire du prix Goncourt, celui qui chaque automne, au seuil des frimas, consacre le chef-d’œuvre concocté au cours des quatre dernières saisons écoulées et qui permet, le plus souvent, à un auteur complètement inconnu de se retrouver soudain sous les feux de la rampe. Pas longtemps - le plus souvent encore -mais quand même le temps d’un éblouissement. Tous les auteurs, de vive-voix ou in petto, rêve de ce flash là. Comme un shoot : du vide dans le trou d’une veine.
L’auteur est donc ébloui. On ne sait pas trop si c’est par le trou ou par le vide… Le public, lui, - toujours le plus souvent - fait mine de l’être. Il prend la chandelle qu’on lui tend obligeamment et il se la met sous les yeux. Il s’écrie que c’est beau et il retourne lire de l’ombre. Ça sert à ça, un prix Goncourt. De l’aveu même de celui qui en fut gratifié en 2010, ça permet à de pauvres gens qui ne sont jamais éblouis de voir un peu de lumière au moins une fois dans l’année.
Oh, générosité sublime et grandiose de la gloire et du succès !
Mais ils ne sont pas tous comme ça, les prix Goncourt. Je médis, je médis… Certains furent d’une indéniable valeur et je pense, entre autres, à Vailland et La Loi, à Rouault et les Champs d’honneur, à Tournier et Le Roi des aulnes… Mais, vous l’aurez noté, j’ai pris la précaution de dire trois fois : «le plus souvent.»
Je pense également à un autre. Un vieux celui-là. Une vieille barbe. Un ancêtre fossilisé. Un des premiers. Lui, ce fut un cas. Mais pas un cas d’école. Pourtant, il était instituteur.
Figurez-vous que cet auteur, que j’affectionne particulièrement parce que sa plume est champêtre, intelligente et, aussi, parce que c’est quelqu’un de mon pays, quelqu’un des Deux-Sèvres, un lointain voisin du temps qui passe, et que les villages, les hommes et les paysages qu’il évoque, je les vois parfaitement dans ma tête, figurez-vous, disais-je, que lui, il ne trouvait pas d’éditeur. Il avait sans doute beau chercher, il avait beau solliciter, un lourd refus, voire un silence obstiné, toujours lui faisait écho.
On connaît tous ça. La routine.
De guerre lasse, notre auteur publie donc un livre à ses frais. Chez Clouzot, à Niort et... à compte d’auteur. Le geste de l’opiniâtreté. Parfois du désespoir. Dans notre présent, il faudrait y croire bougrement, à son livre, pour faire ça quand tous les éditeurs vous disent qu’il est bon mais qu’il ne correspond à rien, en tout cas pas à eux, genre «votre livre est bon et original, mais nous ne le publierons pas parce que ce qu’il a de bon n’est pas original et ce qu’il a d’original n’est pas bon»!
Quoi répondre à ça ? Rien. Mettre l’écritoire au clou ou alors faire l’insolent. Mépriser le mépris en publiant soi-même.
C’est ce que fit ce modeste instituteur de vers chez moué, des Deux-Sèvres. Et l’Académie Goncourt, éblouie, lui décerna son fameux prix… Du coup, l’auteur obscur, le campagnard des bocages et des plaines, fut projeté en pleine lumière et cessa d’être instituteur pour devenir un écrivain. Oui, en ce temps-là, quand on écrivait, quand on était un passionné de l’écriture, quand on trempait sa plume dans l’encrier des lettres, on n’aurait su la tremper par ailleurs et en même temps dans celui d’un veule salariat.
On était animé par la foi. On rentrait en Ecriture, en quelque sorte.
Et on écrivait- le plus souvent - des choses pleines comme des œufs frais.
L’avez-vous lu, vous, ce prix Goncourt publié à compte d’auteur ? Sinon, je vous laisse chercher le nom de son auteur. Avec les quelques indications que j’ai données, en farfouillant sur Google, vous devriez le trouver aisément. Après, c’est une affaire de motivation. On lit ou on ne lit pas. Tout cela a sans doute considérablement vieilli.
Et je suis sûr que s’il était en lice cette année, le livre de l’instituteur, il serait brillamment moqué par tout le sérail au bec pincé. D’ailleurs, son livre aurait cette constance de ne pas trouver d’éditeur, donc, en plus, publié à compte d’auteur, il ne verrait même pas le bout du nez du moindre lecteur, sinon celui d’un ou deux membres de la famille et de quelques rares amis. Tous complaisants. Par affection autant que par charité.
Au grenier ! Même pas déballé de ses cartons, tout neuf, sous de vieilles poutres de chêne, parmi les vieilles roues de bicyclette, les vieux meubles, les souris, les vieilles valises, les vieilles pendules, les vieux chiffons, les toiles d’araignées et les poussières éternelles des objets mis au rebut, le prix Goncourt hyper putatif !
Quand je vois ça, moi, je ressens plein de dédain pour mon époque au modernisme falsifié et je me sens profondément romantico-passéiste.
07:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.07.2012
VACANCE
En prenant soin de faire tomber le "s"...
13:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.07.2012
Langue et langage
 Chez notre ami Le Tenancier, il était question l’autre jour de Joseph Conrad. Avec un extrait superbe, intemporel…
Chez notre ami Le Tenancier, il était question l’autre jour de Joseph Conrad. Avec un extrait superbe, intemporel…
Et je lis justement dans un article de Polityka que les linguistes et les scientifiques de la langue, appellent «le Cas Conrad», le cas de celui qui maîtrise parfaitement une langue étrangère, dans l’esprit de tous ses concepts, au point même d’écrire dans cette langue des joyaux de la littérature, mais qui, oralement, est complètement incompréhensible pour un autochtone, même très complaisant.
Dès lors, je dirais plutôt Le cas Teodor Józef Konrad Korzeniowski. L’écrivain d’origine polonaise trimballait en effet avec lui un tel accent, lourd, pesant, qu’aucun Anglais digne de ce nom ne pouvait communiquer, ou si peu, ou au prix d’un effort terrible, avec lui.
Comme quoi une langue, ça n’est pas forcément fait pour parler.
12:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.07.2012
Avec le latin
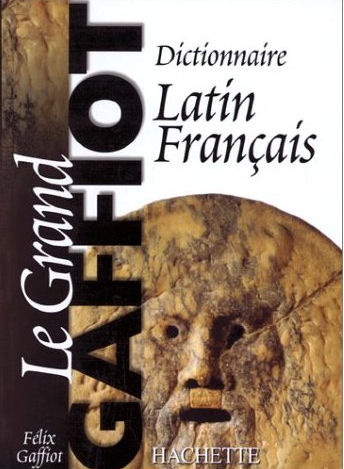 Je considère parfois, à tort ou à raison, que celui qui écrit sur internet fait partie d’un tout. Qu’il apporte sa pierre à un édifice qui, pour virtuel qu’il soit, n’en reste pas moins historique en ce qu’il laisse des traces. Qu’il en laissera et qu'il est donc en devenir de se constituer mémoire.
Je considère parfois, à tort ou à raison, que celui qui écrit sur internet fait partie d’un tout. Qu’il apporte sa pierre à un édifice qui, pour virtuel qu’il soit, n’en reste pas moins historique en ce qu’il laisse des traces. Qu’il en laissera et qu'il est donc en devenir de se constituer mémoire.
Je me place alors, en rêvassant, dans la position d’un chercheur ou d’un archéologue de temps hautement lointains, qui tomberait sur cette masse gigantesque d’écrits éparpillés et qui, à travers leur langage, chercherait, sans doute en vain, à saisir l’esprit d’une époque. Du moins un des aspects de cet esprit.
Quand je me dis ça, toujours en rêvassant, je me demande si le jour où je déciderai de mettre fin à L’Exil des mots, je ne détruirai pas en même temps d’un coup de clic assassin, les textes qui le constituent. Je me demande si j’ai envie d’être lu un jour comme un petit bout de roche de cette immense montagne de textes présents sur internet. D’y être associé.
Je n’en sais rien, en fait… Je répète que c’est une rêverie, un fantasme. Et l’envie de tout suicider pour ne pas participer à cette mémoire ne part pas du préjugé mégalomane selon lequel mes textes vaudraient mieux que les autres et refuseraient la promiscuité avec le médiocre. Ce serait de la pure folie. D’autant que mes écrits sur L’Exil ne viennent pas à la cheville de beaucoup qui sont inscrits ailleurs, par d’autres auteurs.
Cette envie fantasmée est plutôt dictée par le fait que, participant à l’édification présente d’une cathédrale, je ne suis pas d’accord du tout du tout, parfois, avec les formes qu’elle prend et les choses qu’elle veut exprimer.
Et on ne peut répondre à tout, contre-argumenter partout. On ne ferait plus que cela.
Alors, me direz-vous avec raison, la valeur humaine de cette masse d’écrits réside justement dans son incohérence et dans sa diversité. C’est à cela que tu participes ; c’est à cette mémoire là que tu donnes un sens. Ton sens. Dans ton petit coin.
Et le chercheur de l’an 3098 ou de l’an 5043 saura, s’il est un véritable chercheur, retrouver à quel pan de la mémoire tu appartenais, à quel morceau de mur de la cathédrale tu as apporté ta modeste contribution.
Certes. Mais avant d’être mémoire, une praxis est avant tout une inscription du présent, ça tombe sous le sens. Et si je me suis éloigné de ce présent, si je ne fais plus guère attention, à de rares exceptions près, à ce que construisent à côté de moi les autres, je n’ai pas envie - toujours en rêvassant, toujours sur le mode de la pensée qui s’évade un peu au-delà des contingences - d’être un jour jugé complice des plus grandes erreurs inscrites dans la pierre du monument. Surtout si ces erreurs touchent un point sensible chez toi, concernent ton cursus, ton vécu, ton ressenti, et... galvaudent ta culture.
Je me disais tout cela et je me le dis encore après avoir jeté un œil chez un voisin ex-ami et chez lequel je ne veux plus intervenir. J’ai jeté un œil, poussé par la curiosité de savoir s’il enfonçait toujours le même clou, ce clou qui nous a fâchés. J’ai même poussé l’indiscrétion jusqu’à lire ce qu’en disaient ses contemporains, les témoins directs de l’enfonçage du clou.
Mais, me suis-je dit, qu’en as-tu à faire si, comme tu le présumes, tu fais disparaître tes traces avant d’abandonner ta participation à l’ensemble ?
Mais si tu ne détruis pas ? Tu auras vu et tu auras laissé faire, tu auras laissé déformer ce qui te touche et, pour l’archéologue futur, c’est plutôt ennuyeux.
Pour le cas, donc, où resterait mon empreinte, j’ai choisi de fournir au futur - toujours en rêvassant - une indication sur cette erreur, volontaire ou pas, et de m’inscrire en faux.
Je dis bien : pour l’homme d’esprit du futur. Je n’attends donc aucun écho du présent.
Il s’agit de latin. Le voisin en question s’inquiète, avec juste raison, de la disparation de l’enseignement du latin et du mépris dont cette langue ancienne et fondatrice de notre conscience parlée est partout l’objet.
Latiniste passionné dans mes jeunes années et toute ma vie fouilleur de la langue, de son histoire, de ses racines, je ne puis que m’associer in petto à l’indignation du voisin enfonceur de clou. Trahir la langue latine, c’est trahir ses origines profondément culturelles, le bien-fondé de sa langue et la limpidité de ses références.
Mais là où le tour de passe-passe est inacceptable, c’est que le voisin parle en fait d’un certain latin.
Il eût fallu que l’enfonceur du toujours même clou précise de quel latin il demandait la résurrection. Il ne le fit point - et pour cause - , je me vois donc contraint, dans mon souci de réponse soliloque, (dans mon interpellation du futur plutôt,) d’inscrire ici un bref aperçu de l’histoire du latin pour préciser celui que nous avons aimé avec nos Gaffiot, et qui nous sert effectivement de base culturelle.
Je serai évidemment très schématique, le sujet étant vaste comme vaste est l’océan.
Notre langue, comme toutes les langues européennes, excepté le finlandais et le hongrois, est une langue issue d’une immense famille, la famille indo-européenne. La langue parlée par les peuples italiques, dont ceux du Latium, était une subdivision de cette gigantesque famille. Elle était fortement imprégnée de la langue des Etrusques, voisins septentrionaux du Latium.
Je saute des siècles et j’en arrive au latin archaïque, c'est-à-dire le latin pratiqué des origines jusqu’au premier siècle av. JC.
Notez bien ce av.J-C, il a son importance.
La Rome antique et la République donnant bientôt naissance à l’Empire romain, ce latin devint la langue officielle, c’est-à-dire langue de l’administration et des armées, d’un empire couvrant toute l’Europe occidentale, l’Afrique du Nord, l’Asie mineure et une partie de l’Europe centrale. L’actuelle Roumanie par exemple.
Cette époque fut l’époque très florissante de la langue latine. C’est elle qui préside en effet aux messages historiques et littéraires, c’est le latin du Bellum Gallicum, celui d’Ovide et de Tite-Live. C’est ce latin, dit classique, qui va servir de base à l’édification de la langue française, par le biais de son imprégnation dans la civilisation gallo-romaine.
Et c’est ce latin-là que j’ai appris à l’école, c’est ce latin-là qui est notre racine, c’est ce latin dont je déplore que les ministères de tout poil, droite, gauche, centre et à l'écart, aient cru bon de débarrasser l’Education.
C’est au Vème siècle, avec le partage de l’Empire en deux entités, Rome et Constantinople, que le latin classique devient latin vulgaire, c’est-à-dire langue non littéraire et parlée par le peuple et c’est dans ce latin-là également que nos mots plongent leurs racines.
Ils les plongent aussi, dans une moindre mesure, dans un autre latin, dit médiéval, qui fut une tentative de restructuration, au XIe siècle, du latin classique afin d'éviter qu'il ne soit complètement détruit par la propagation des langues vernaculaires, sous l'influence notamment des étymons d'origine germanique.
Bien. Veuillez, je vous prie une nouvelle fois, me pardonner le caractère trop étriqué de ces rappels élémentaires et leur forme quelque peu didactique.
L’enfonceur du toujours même clou s’appuie en fait sur un livre auquel participa un religieux, secrétaire d’Etat au Vatican. Aie ! ça sent la poudre ! On sent déjà que l’on s’éloigne du latin et qu’on entre dans l’ère d'un autre latin, le latin ecclésiastique, qui est une langue à part, grammaire un peu bouleversée et prononciation différente et, surtout, dont les règles n’ont été fixées que tardivement, par Charlemagne !
De plus, en amont, rappelons que les textes fondateurs de l'Eglise, dont le Nouveau Testament, étaient initialement écrits en hébreu et en grec. Ils n’ont été traduits en latin, pour ce qui concerne ce qu'on appelle La Vulgate, qu’au Ve siècle a.p. JC !
Près de six siècles après César !
Alors, lorsqu’on lit que notre patrimoine latin, celui dont on devrait aujourd’hui sauvegarder l’enseignement, est en même temps le patrimoine chrétien et fait partie du modelage de notre civilisation par le christianisme, tout simplement, on se moque du monde…
Que l’Eglise romaine ait choisi d'édifier sa liturgie en latin est un fait ; que c’est ce latin-là qui est source de notre culture et qui éclaire notre mémoire est tout simplement affirmation abusive. D’ailleurs, après le schisme Byzance/Rome, la liturgie gréco-latine sera bientôt faite en grec et, plus tard encore, en langue slave, transcrite en cyrillique.
C’est tout… Pas besoin d’être un grand humaniste pour me suivre, suffit de savoir lire des dates.
Chercheur du futur, te voilà donc un texte qui témoignera - s’il reste en ligne - de ce que tout le monde en 2012 ne commettait pas cette erreur grossière à propos du latin, erreur récurrente qui consiste, dans tous les domaines depuis 2000 ans, à faire de l’église la propriétaire historique de tout ce qu’elle a pu trouver, utiliser ou voler sur son passage.
08:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.07.2012
Internet et dieu

Motwica est un petit bourg, pas très loin situé du manoir de Josef Kraszewski, aujourd’hui charmant musée consacré à l’écrivain du XIXe. Ceux qui ont lu Le Théâtre des choses, sont au fait, et vlan, un pt'it coup de pub...
Motwica, donc, est un petit bourg solitaire, cerné de plaines indolentes et de forêts éparses.
Ce n’est pas une gmina, une commune. To wieś, c’est un village. Mais il n’en fut sans doute pas toujours ainsi et il a dû être, par les temps passés, plus conséquent que le bourg même de la commune duquel il dépend, Sosnòwka. C’est en son beau milieu en effet que se dresse une haute église.
C’est donc une parafia, une paroisse.
L’église a son découpage territorial spécifique, hérité de l’histoire, et une paroisse peut même s'étendre sur plusieurs communes.
Les gens du bourg doivent ainsi se rendre à Motwica pour les besoins de la prière et honorer leurs morts, au cimetière de ladite paroisse.
C’est même une paroisse importante puisque jusqu'à quinze kilomètres à la ronde fleurit tout un chapelet de petites chapelles, des succursales de la maison-mère, si j'ose, éparpillées dans les hameaux. Pour les prières de proximité, si j’ose encore.
A Sosnòwka donc, le pouvoir administratif, à Motwica le pouvoir spirituel. L’ordre règne. Le concordat de 1992 veille à ce que les deux entités, là comme partout, cohabitent en juste intelligence.
La mairie, comme toutes les mairies, s’occupent de la citoyenneté, des caniveaux, de l'équipe de football, des impôts et des ronds-points.
L’église, comme toutes les églises, vaquent à de plus hautes occupations ; elle s’occupe du salut des âmes.
Les deux entités ont donc des compétences qui se complètent allègrement, l’une besognant sur le présent et l’autre spiritualisant l’avenir ; celui qui nous attend tous, après la dernière pelletée du fossoyeur.
Même si nous ne voyons pas tous cet avenir-là en rose.
Bref, que l’on s’occupe d’éternité ou de chaussée déformée, on a cependant, par les temps qui courent, un point commun : la frénésie d’informer. Une manie.
La mairie s’est donc fendue d’un site internet, comme toutes les mairies de Pologne, de France et de Navarre et même de Montcuq… mais, le plus curieux, c’est que la paroisse, ne voulant sans doute pas être en reste et faire montre de son adaptation au siècle de la communication obligatoire, s’est aussi dotée d’un site.
Hé oui, bonnes gens, les cloches n'y suffisaient plus ! Le son de ces bonnes vieilles cloches que le vent portait de villages en villages, par-dessus les toits, les bois et les ruisseaux, tantôt joyeux, tantôt sinistre glas.
Tout ça, c’est du passé. Le vent ne transmet plus, depuis belle lurette, que du vent aux oreilles des hommes. Un petit clic sur la paroisse et, hop, voilà les horaires de la messe qui apparaissent ! Plus loin, la date des communions, le budget, les travaux en cours en le saint lieu ou au champ de navets, les mariages et enterrements les plus frais, le cursus du curé, le nom de la bonne et, plus intéressant quand même, une page spéciale pour l’histoire complète de la paroisse…
Ah ! Internet, est vraiment cette passerelle qui relie entre eux les hommes esseulés ! Même l’église a bien senti qu’elle n'était plus à la hauteur pour souder convenablement une petite communauté villageoise autour de ses vénérables icônes. Championne en tous genres de la virtualité, elle s’est emparée de la parole virtuelle.
Qu’elle continue d'enseigner, et ce depuis 2012 ans, le mépris et la négation complète de la vie, n’y change rien : elle enseigne tout ça de façon moderne.
Car c’est ça la modernité : révolution des moyens au service de valeurs multiséculaires.
Comme en littérature, en somme : nous assistons à la révolution numérique de l’église.
Et gageons que prêtres et ouailles abandonneront tantôt le missel poussiéreux et racorni pour la liseuse.
Ce sera marrant.
Mais ça ne changera rien à la dernière pelletée du fossoyeur.
13:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.07.2012
L'antienne et l'antienne encore
 C’est toujours la même histoire, le même scénario et les mêmes balbutiements effarouchés des princes de la politique et du syndicalisme : Finance et Capital se proposent de se refaire une santé - qu’ils n’ont de fragile que l'apparence stratégique - pour jeter à la rue des milliers de femmes et d’hommes et les princes toussent, font mine de s’offusquer, se renvoient de façon obscène la balle de leurs irresponsables responsabilités .
C’est toujours la même histoire, le même scénario et les mêmes balbutiements effarouchés des princes de la politique et du syndicalisme : Finance et Capital se proposent de se refaire une santé - qu’ils n’ont de fragile que l'apparence stratégique - pour jeter à la rue des milliers de femmes et d’hommes et les princes toussent, font mine de s’offusquer, se renvoient de façon obscène la balle de leurs irresponsables responsabilités .
C’était Longwy, c’était Daewoo, c’est Peugeot et c’est toujours la même histoire dans un monde à l’histoire hautement falsifiée depuis des lustres.
Il est un mot qui revient comme une clef et qui n’a de véritable sens que dans son acception taboue : compétitivité. Comment ouvrir une porte avec une clef dont la serrure a été obstruée d'une habile soudure ?
Depuis les salons matelassés de leurs palais respectifs, princes d’hier, au repos en attendant l’aube d’un nouveau règne, et princes d’aujourd’hui, la mine enjouée de leurs récents couronnements, en ont plein la gueule, de ce mot qui ne dira jamais clairement ce qu’il veut dire : stratégie de dégagement d’un profit encore plus épais avec frais engagés pour le réaliser de plus en plus minces.
Il veut dire agrandissement de la marge. C’est simple comme bonjour, vieux comme le monde économique, aussi ennuyeux et poussiéreux qu’une ligne de Karl Marx, mais comment développer ça devant la cohorte des expulsés sans leur dire : vous n’êtes pas des hommes, vous n’êtes que des frais !
Les princes n’y ont jamais rien pu, n’y peuvent rien et n’y pourront jamais rien. Les expulsés non plus.
Parce que les princes assistent à la marche autonome d’un système qui les fait régulièrement princes mais qui contredit dans cette marche autonome tout le discours par lequel ils s’appliquent à devenir des princes, et que les expulsés n’ont jamais imaginé leur vie autrement que tributaire d'un système qui les méprise jusqu'à la négation.
Comme si je m'abreuvais de poison et refusais de mourir.
Tous sont devant les échéances régulières, douloureuses - devant la facture - d'une allégeance complice et lointaine faite au monde réduit à son expresssion économique, et ce dans tous les aspects de l'existence individuelle et collective et au lent et opiniâtre détriment du sens même de la présence humaine sur cette planète.
Je serai dès lors assez cruel pour signifier que tout cela ne concerne nullement ceux qui, depuis le début, souffrent de cette vie réduite à néant par l'impérialisme du ventre et des plaisirs marchandés ; crient pour un retour illusoire des hommes parmi les hommes et, jamais, ne sont entendus.
Ni des princes, ni des hommes-frais, souffrant de la même surdité à l'humain puisque pareillement preneurs - chacun à leur niveau - du même bonheur à n'être que des monnaies d'échange.
10:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.07.2012
L'interview
-Vous avez une façon récurrente de terminer vos ouvrages : le personnage central y meurt presque toujours. Pourquoi ?
- Parce que la vie n’a pas d’autre issue que la mort.
- Oui, je comprends bien, mais… Un roman, un texte, un conte, une fable, a-t-il pour vocation de montrer forcément la porte de sortie ?
- Pour moi, oui. S’il veut raconter de la vie, l’écrivain ne peut éviter de raconter ce qui en constitue l’essence dramatique et absurde. Il ne peut éviter de mettre en scène ce qui le tourmente chaque jour et qui est, en même temps, ce pourquoi même il écrit.
- C’est un point de vue romanesque, mais pourquoi pas ?
- Non, ça n’est pas un point de vue romanesque. L’écriture n’est pas la vie, elle en est représentation… Elle ne peut donc occulter dans cette représentation l’omniprésence de la mort. Ou alors, elle écrit des contes pour les enfants… Ce qui est bien aussi, ce qui est nécessaire, ce qui est louable et ce qui est difficile. Mais je ne sais pas faire ça.
- Il y a d’excellents livres et qui n’en tuent pas pour autant leurs personnages.
- Lesquels ? Citez-moi, je vous prie, un excellent livre, comme vous dites, dont la mort n’est pas le personnage central ? Je vous fais par ailleurs remarquer que mes livres n’ont jamais prétendu à l’excellence.
- Je ne vois pas, comme ça, d’emblée…
- C’est sans doute parce que, d’emblée, ils ne sont pas si excellents que ça. Si je vous avais dit, citez moi la mort dans d’excellents livres, je suis certain qu’une foule de titres vous seraient venus immédiatement à l’esprit.
- C’est fort probable. Oui... Bref, c’est quand même pessimiste, votre vision des choses.
- Au contraire. Ma vision est celle d'un incorrigible optimiste : puisque la vie, celle qu’on raconte et celle qu’on vit, se dirige inéluctablement vers la mort, il faut mordre dans cette vie à pleines dents. L’Au-delà se situe non pas après la mort mais avant. C’est-à-dire qu’il est l’exact antinomie de l’éternité.
C’est une vision d’athée où chaque jouissance est d’abord victoire volée au désespoir.
12:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.07.2012
La liseuse
 Elle a douze ans et elle tape du pied.
Elle a douze ans et elle tape du pied.
Elle tape souvent du pied. Normal. Quand on a douze ans et qu'on évolue dans une société qui propose sans relâche de vendre de tout pour que les gens n'aient plus rien de valable à se procurer, on tape souvent du pied.
Il paraît cependant que les parents sont là pour représenter le principe de réalité, celui qui met un frein raisonnable au fougueux désordre des désirs. Dur, ce principe de réalité ! Car cela suppose qu’on l’ait vraiment soi-même et c’est pas toujours joyeux, la réalité. Surtout érigée en principe.
Bref, elle tape du pied pour avoir des sucreries à foison, des glaces, des vêtements de marque, des godasses de sport dernier cri, des trucs inutiles, des gadgets, des revues, une DS Nintendo… Elle tape du pied et, réflexe du principe de réalité oblige, je fais les gros yeux.
Alors elle abandonne et convient que oui, t’as raison, ça sert à rien tous ces trucs.
Mais j’ai parfois l’œil moins vigilant, tout occupé à d’autres réalités moins réelles, alors… Alors ça donne, par exemple, un téléphone portable qui sert à tout, sauf à téléphoner. Qui fait caméra, qui fait appareil photos, qui donne la météo, les résultats sportifs, l’humidité de l’air, GPS et tout et tout…
Et le forfait pour appeler tes copines ? Bof, c’est pas très utile. Mes copines, je les vois à l’école.
Bon.
Mais pour avoir douze ans, elle n’en est pas moins une grande lectrice. Elle adore les livres. Sa bibliothèque regorge de classiques qu’elle a lus, entre autres Sienkiewicz et Jack London, et aussi des bandes dessinées à foison et en français, Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, pour les plus connues.
Géographiques, elle a essayé. Elle dit que c’est trop dur. Qu’elle verra ça plus tard.
Je baisse le nez.
J’en suis fort aise cependant, de toutes ces lectures. Quelque chose de sain, lui dis-je, surtout que l’orthographe polonaise n’est pas vraiment son fort et je rajoute, les pieds bien ancrés dans la réalité, que c’est comme ça aussi qu’on apprend à photographier les mots.
Ceci étant doctement énoncé, je reconnais in petto que l’orthographe polonaise, ses déclinaisons et ses amoncellements de consonnes, avec ou sans accent, c’est quelque chose !
La lecture, voilà bien une passion qui l’éloigne considérablement des vitrines flamboyantes et surchargées d’inutilités, que je pérore, toujours in petto bien entendu.
Las ! Las ! Las ! Trois fois las ! La jeune et gourmande lectrice jette tantôt son dévolu sur une liseuse ! Pratique, qu’elle dit, tu te rends comptes, la place que je peux gagner dans ma chambre ? Dans ce petit truc de rien du tout, je peux mettre plus de six cents livres ! Avoir ma bibliothèque dans ma poche ! Et la tienne aussi !
J’hallucine ! On dirait François Bon !
Et qu’est-ce que tu en as à faire, dis-moi, d’avoir six cents livres dans ta poche ? Hein ? A quoi ça sert ?
Ça sert à lire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et toc ! Imparable ! On dirait vraiment une copine à François Bon.
Je fais la grimace… Je suis dans mon domaine de prédilection et le gadget vient se mettre en travers de ma route, m'emmerder, m’acculer dos au mur… Je ne veux pas m’aventurer sur un terrain où je risque de perdre pied, alors je dis simplement que c’est des conneries.
Des conneries ? Ah, ah ! Elle est bien bonne, celle-là ! Dis-donc, t’as pas publié deux livres sur Internet ? Hein ? Et même que tu disais qu’avec une liseuse ce serait pratique.
Le principe de réalité craque de partout. La technologie obligatoire me joue un sale tour. Je suis pris au piège, au cercle vicieux : marchandise pure, gadget, modernité, blog, lecture, édition numérique.
Je dis : bon, on va voir…
Et on finit par voir. Je suis poussé par la curiosité. Pire. Je crois que je profite lâchement de son désir de consommer pour expérimenter le truc. Pour consommer moi-même. Sans elle, je n'aurais sans doute jamais essayé. Trop fier ! Trop droit dans mes bottes d’amoureux du livre ! Ah, il est beau, tiens, le principe de réalité !
Pour me faire plaisir et me récompenser de m’être rendu à ses arguments, elle me demande cependant mes textes en PDF, dont un même pas encore publié, encore en chantier, et elle télécharge. Je suis le premier à me servir de la liseuse. Juste récompense du principe de réalité pris en défaut.
Je me lis égocentriquement sur liseuse… Je me trompe de bouton, j’agrandis le texte, je saute des pages, je rends les mots trop petits pour mes lunettes, j’arrive quand même à accrocher une page, je tourne, merde ! j‘ai fait une fausse manœuvre et me voilà de retour au menu général...
Je repose le tout et je dis que c’est bien.
Elle, elle télécharge des trucs sur Internet, des textes, des images. Et elle lit, elle trifouille, elle bidouille… Deux ou trois jours.
Elle reprend vite ses livres ou son ballon de basket.
La liseuse est maintenant posée dans ma bibliothèque. Curieusement, pas dans la sienne.
Et il a l’air ridicule, entre Stendhal et Tolstoï et d’autres livres qui ont traversé des siècles, cet objet qui n’a servi à lire que trois jours.
J’adore ma fille. Elle est ma meilleure critique en actes, presque mon avant-garde, dans une société qui propose sans relâche de vendre de tout pour que les gens n'aient plus rien de valable à se procurer.
___
Merci à Yves pour avoir publié ce texte - qu'il trouva, sur ma proposition, à son goût - sur ses Feuilles d'automne.
14:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.07.2012
Brouillons les brouillons
- Je n’aime pas ce que vous écrivez. C’est emphatique. C’est surfait.
- Bon…
- Il vous faudrait prendre plus de recul par rapport à vous.
- Et comment fait-on pour prendre du recul par rapport à soi quand on n’est que soi ?
- On s’imagine être un autre.
- Mais… Que peut bien avoir à dire un autre, s’il doit quand même parler en mon nom ?
- Il le dira mieux que vous. Faut lui lâcher la bride. Lui donner du mou. Le faire autonome.
- Mais c’est de la schizophrénie, ça !
- Vous ne le saviez pas ? Vous ne saviez pas qu’écrire c’est d’abord être schizophrène ? Alors, je comprends mieux. Tout s’explique…
- Non, je ne savais pas. Je pensais que c’était une maladie, mais pas à ce point-là.
- Mais la schizophrénie n’est pas une maladie, mon brave !
- Ah bon ?
- C’est une manière intelligente de voir les choses de double façon. Contradictoire... Et d’en tirer profit. Le tout réside dans la synthèse.
- Admettons. Et si l’autre est aussi emphatique que vous prétendez que je le suis ?
- Alors, il vous faudra lui reprendre le micro et parler à sa place.
- Retour à la case départ, quoi…
- Exactement. Mais retour après un détour ; même infructueux. Après une recherche.
- Moi, j’appelle ça faire des brouillons…
- Oui, un peu. Mais l’ennui, c’est que chez vous les brouillons sont meilleurs que la version achevée.
- De sorte que je devrais publier mes brouillons ?
- Tout à fait.
- C’est ce que je viens de faire.
11:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.07.2012
Manuscrit en musique

Une tiédeur épuisante servie par un astre laiteux qui n’en finit pas de se traîner sur un ciel barbouillé de pesantes nébulosités.
La poussière sablonneuse est chaude. Les cigogneaux avachis sur les nids ont leurs jeunes ailes écartées et ils ouvrent tout grand leur bec, qui halète et qui cherche dans l’air surchauffée la bouffée de fraîcheur d’un improbable courant d’air.
A quatre heures du matin, le monde revêt enfin un costume plus seyant. La rosée perle aux herbes torturées de lumière et l’ombre des grands arbres est allongée. Les oiseaux aux halliers se dépêchent de chanter, une orgie de trémolos, avant de se terrer, au fur et à mesure que le jour s’enflamme, dans les profondeurs d’un silence inquiet.
Comme les hommes. Surtout ceux qui, comme eux, se mêlent de vouloir participer au chant du monde.
Difficile de travailler les mélodies et les enchaînements, quand le doigt maculé de sueur s’accroche à l’arpège, que le manche de la guitare est moite et colle à la paume, que la voix est sèche... Il faut viser les quelque cinq heures de fraîcheur de la journée.
Baudelaire, Villon, Marot, Apollinaire, Couté, La Fontaine et les autres au menu. Travailler, ajuster la bonne mesure sur la bonne parole, respecter la coupure, donner corps à l’enjambement, hausser le ton ou le laisser mourir sur un accord, selon ce que l’on ressent du verbe du poète.
C’est comme un manuscrit : dix pour cent d’inspiration et le reste de transpiration, sans pour autant sombrer dans la besogne, sinon en allant chercher le mot au plus profond de sa racine. Dans sa fraîcheur initiale.
Préparer une création qu’on se propose d’offrir à un public, c’est anticiper un rendez-vous. Et on n’a guère le droit d’être médiocre sur rendez-vous.
Ces textes, cette musique que je leur ai donnée, c’est une grosse responsabilité, me dis-je souvent. Je me souviens toujours du vieil Hugo grondant qu’il ne tolérerait pas qu’on mette ses poésies en musique, celles-ci étant, d’elles-mêmes, suffisamment musicales.
Outre que la modestie n’étouffait pas, on le voit, le poète-sénateur à la barbe fleurie, on sait quand même gré à Georges Brassens d’avoir désobéi par deux fois, avec Gastibelza et La légende de la nonne…
Mais - des siècles s'en faut - je ne suis pas Brassens ! Le risque est donc grand pour moi de dénaturer le propos originel par une mélodie superfétatoire.
Seul le public dira. Le public découvrira une nouvelle façon de lire - d'écouter - La Ballade des pendus et Le Blason du beau tétin et applaudira ou boudera notre interprétation.
Il n’y a pas d’art qui ne risque d’être désavoué.
C’est comme un manuscrit, disais-je. A cette grande différence, tout de même, qu’un manuscrit peut être sauvé de l’opprobre par un refus sagement formulé en amont.
Là, pour notre création, l’annonce de la publication est déjà faite.
Et il en est très bien ainsi. Ça limite considérablement le risque d’erreurs et ça n’admet pas les velléités.
L’important de toute façon, avant l’heure fixée pour son rendez-vous, c’est que l’artiste soit heureux de son travail.
Et y ait pris un réel plaisir.
13:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.06.2012
Stand by
Image d'un vaniteux - doublé d'un coquet - qui met son p'tit blog au point mort, tout occupé qu'il est jusqu'au 8 juillet à travailler une création musicale, qu'il espère, évidemment, digne de ce nom.
A bientôt, donc, à toutes et à tous.
Merci de votre lecture.
Cordialement
Bertrand
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.06.2012
Soir

Même les fleurs des tilleuls sont tristes. Elles ne bourdonnent pas. Les acacias se courbent. A se briser.
Assis sur une énorme pierre de granit, je vois la forêt qui s’assombrit. Les nuages s'effilochent comme des peaux démentes. Le jour se tait.
J’aimerais qu’un exilé volontaire me parle. Qu’il me dise le vent qui l’a déraciné. Pour que j’y trouve, peut-être, mon propre souffle.
Peine perdue. On n’est jamais plus seul que lorsqu’on cherche à ne pas l’être.
Et puis, moi, que lui dirais-je qui aurait un sens ? Qui aurait le sens de ce que je ressens, là, sur ma pierre de granit posée comme une limite ?
08:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.06.2012
Un morceau d'anthologie
On avait 18 ans. L'adversaire avait la parole. Ce sont de tels adversaires qui font aujourd'hui cruellement défaut. Des adversaires qui savaient dire qu'ils l'étaient.
08:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.06.2012
C'est sans doute comme ça
 Longtemps, nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Cette génération - née grosso modo entre 1945 et 1960 - a eu cette fatuité de se croire en effet la génération élue pour mener à bien cette glorieuse entreprise. Avant de s'apercevoir - un peu tardivement parfois - que toutes les générations avant elle avaient eu la même et ridicule ambition.
Longtemps, nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Cette génération - née grosso modo entre 1945 et 1960 - a eu cette fatuité de se croire en effet la génération élue pour mener à bien cette glorieuse entreprise. Avant de s'apercevoir - un peu tardivement parfois - que toutes les générations avant elle avaient eu la même et ridicule ambition.
Laquelle fait dire pas mal d’inepties et même commettre pas mal d’actions comme autant de coups d’épées données en eaux troubles.
Car le monde se fout bien des postillons et des postillonneurs comme de Colin-tampon. Quelquefois même, pour un petit coup reçu, un peu plus appuyé et énervé que les autres, il vous balance un savant uppercut qui vous met K.O pour un bon bout de temps.
Il a sa logique que la logique ne comprend pas, le monde. Il a aussi sa longévité, son immensité et sa complexité que l’éphémère, la petitesse et la simplicité de l’individu n’entrevoient que très partiellement mais, hélas, toujours de façon fort péremptoire.
Le recul et la sagesse commandent donc, - si tant est qu’on ait pris la ferme résolution de ne pas mourir un jour aussi con qu’on a vécu - de revoir toutes ses prétentions révolutionnaires à la baisse et surtout, dans la solitude des petits matins clairets, d’imaginer, sourire aux lèvres, cinq minutes seulement, ce que nous aurions fait de mieux dans un monde supposé meilleur.
Si on n’est pas définitivement pourri au point de mentir même dans un face à face intime, (ou trop con pour se comprendre vraiment tel qu’on est) la réponse tombe, limpide : rien. Absolument rien. Parce que nous ne connaissons rien aux implications, aux engrenages des sociétés et surtout aux désirs profonds des hommes qui cohabitent avec nous sur la grande boule bleue. Nous supposons tout ça. Nous le supposons ex cathedra. Parce que, aussi, notre vide et notre impuissance sont à l’intérieur, tout comme notre puissance et notre volonté de vivre.
Dès lors, accuser le canevas social du monde, son organisation, ses injustices, son immoralité, ses guerres, ses embrouilles, de notre tristesse et de nos échecs, c’est accuser, pour une bonne part, le miroir quand il nous renvoie une gueule que nous voudrions plus belle. C’est se dédouaner de soi et on comprend bien qu'il est plus facile de chercher la clef de son énigme sur des manifestations extérieures - auxquelles nous ne participons pas sinon par une vaine parole - plutôt que dans ses propres dispositions à vivre, dans sa propre éthique et dans ses propres désirs.
Le comble est alors de briser le miroir. Plus de sale gueule en face !
Mais le passant qui vous croisera dans la rue l’instant d’après vous trouvera toujours aussi moche.
Image : Philip Seelen
09:04 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.06.2012
Brassens et Villon
 On m’a tellement fait l’élève de François Villon, qu’il a bien fallu que je finisse par en faire mon maître, s’amusa un jour Brassens.
On m’a tellement fait l’élève de François Villon, qu’il a bien fallu que je finisse par en faire mon maître, s’amusa un jour Brassens.
C’était une boutade bien sûr, comme le poète aimait à en faire, et c'était au cours d’une interview, je ne me souviens plus laquelle.
Il faudrait pour le bien savoir se reporter au livre de Loïc Rochard Propos d’un homme singulier, qu’il publia d’abord à compte d’auteur, avec l’amicale complicité de Patrick Clémence, avant de céder aux sirènes de Cherche midi (à 14 heures), lequel Cherche Midi, soit dit en passant, avait sans doute perdu le Nord quand, par une lettre incisive, il m'avait refusé mon manuscrit, Brassens, Poète érudit, au prétexte que "Brassens était un auteur trop populaire" et "mon texte pas assez " !
Brassens a donc bu sans retenue à la fontaine Villon.
Par la magie d’une ligne d’accords en Do majeur, que je joue personnellement en La, il a magnifiquement remis au grand jour, on le sait, la Ballade des dames du temps jadis.
Une accolade entre deux frères par-dessus cinq siècles d’histoire, la rencontre de deux œuvres également jugées «licencieuses», l’une par Malherbe et les virtuoses de la Pléiade, l’autre par tous les tenants officiels de la poésie des années cinquante et soixante.
Le gage d’un attachement profond aussi.
Car il fallait oser faire porter par la chanson cette poésie du Moyen-âge dans une époque peu encline à versifier vers l’arrière, à peine remise des salves de l’épuration, empêtrée dans les débats de l’existentialisme et bientôt résolument tournée vers le pragmatisme de lendemains chanteurs, matériellement riches.
C’était surtout 14 ans avant que la poésie ne fasse joyeusement irruption, en s’imposant comme exigence immédiate à vivre, par un beau mois de mai qui, finalement vaincu, ne tint, lui, que partiellement ses promesses.
Quand mon prof de Français, c’était en seconde, homme de lettres et d’enseignement s’il en fut, homme rond et d’une gentillesse pleine de délicatesse, catalogué Cicéron au chapitre sobriquets des potaches, voulut nous emmener faire un tour chez François Villon, il nous y conduisit par le sentier Brassens.
C’était un homme intelligent.
En me prenant par cette main-là, il savait qu’il m’ouvrirait aux jardins du Moyen-âge, qui autrement me seraient restés inaccessibles et abscons, tout du moins à 16 ans.
Je considère personnellement le geste de Brassens d’une importance égale, relativement aux complexités spécifiques des deux époques, à celui de Clément Marot qui rassembla et publia en 1533 sous le titre « Le testament », l’oeuvre de François Villon, quoique ces deux gestes aient été accomplis dans un esprit complètement différent.
Marot établit en effet une édition critique, sans même prendre le goût de décrypter le jargon, en s’attachant surtout à présenter Villon comme un voyou :
Peu de Villon en bon savoir
Trop de Villons en décevoir,
Ou bien en développant narrativement « l’épitaphe Villon », venue jusques à nous sous le titre célèbre de « Ballade des pendus », en des termes tels qu’il en fait une œuvre autobiographique alors que c’est un des très rares morceaux de Villon d’où le « je » soit absent. Marot intitule le poème :
L’épitaphe en forme de ballade que feit Villon pour luy & pour ses compaignons s’attendant estre pendu avec eulx.
Rabelais, chapitre 13 du Quart Livre, mettait certainement le doigt plus près de la réalité en faisant de Villon un homme de théâtre, en ce que nous sommes rentrés, justement, dans la légende Villon par des éléments uniquement suggérés par l’œuvre et souvent abusivement perçus comme autobiographiques.
Brassens, quant à lui, admire d’abord le poète. Il a forcément grande sympathie pour le mauvais garçon, iconoclaste libertaire avant l’heure, certes, mais il s’attache d’abord aux vers, même s’il admet quelque part dans une autre interview que s’il n’avait dû rencontrer le succès, il eût pu lui-même tourner gangster tant il ne savait rien faire d’autre que d’écrire des chansonnettes.
Après l’édition de Marot, l’œuvre de Villon a sombré dans l’oubli le plus total durant trois siècles.
Nous avons tendance à l’oublier.
Et trois siècles, c’est long. Elle fut timidement et peu à peu redécouverte vers le milieu du dix-neuvième, grâce à l’édition de l’abbé Prompsault, en 1832.
A la vitesse historique, et le temps que les poèmes arrivent jusques sur les pupitres des «escholiers», nous touchons à 1954, année où Brassens enregistra donc la ballade.
Mais l’hommage, l’imprégnation de Villon chez Brassens, ne se résument pas, loin s’en faut, à cette ballade en Do majeur.
En 1961, (et je m’en remets désormais à l’ouvrage d’André Tillieu « d’affectueuses révérences » publié en 2000 chez Arthémus,) à la question :
- Vous essayiez d’être Villon sur quel plan ?
L’autodidacte Brassens répondit :
- C’est-à-dire que pendant deux ans, quand je faisais mes «humanités», je ne pensais qu’à Villon, et que par Villon, à travers Villon. Je refaisais ses vers et je les arrangeais à ma guise. J’essayais de m’imprégner de son art.
Tillieu rapporte que, bien que Brassens comme tout honnête homme, répugnât à établir une hiérarchie parmi ses poètes de prédilection, force fut bien de constater pour ceux qui le fréquentaient que Villon occupait le haut du pavé.
Le dessus du panier de Madame de Sévigné.
Le nombre de livres consacrés au poète que recelait sa bibliothèque était, paraît-il, impressionnant.
Ce fut en 1941, il avait tout juste vingt ans, que Brassens se procura le premier recueil de Villon. Un Villon miniature, les éditions Larousse du moment, 1937, faisant la part belle à Clément Marot et ne consacrant au poète-voyou qu’une trentaine de pages.
Les livres de Villon et sur Villon qui ont appartenu à Brassens sont bourrés d’annotations, de considérations et de commentaires. De nombreux vers sont soulignés.
Tillieu note très habilement que s’il est vrai, comme le disait Voltaire, "qu’un homme qui lit sans un crayon à la main dort", assurément Brassens n’a pas dormi sur Villon.
Il est en filigrane partout présent chez lui et fut son véritable credo en manière d'écriture.
Du point de vue de l’expression poétique déjà. Villon, sans innover, est coutumier des rejets et des enjambements audacieux.
Que dire alors de :
Les chansons de salle de garde
Ont toujours été de mon goût,
Et je suis bien malheureux car de
Nos jours on n’en crée plus beaucoup.
Mélanie
Ou de certains distiques parmi lesquels le célèbre :
Mais les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux.
On sait aussi que Villon, quand il vient à être profond et mélancolique, douloureux, tout aussitôt dans le vers suivant ou dans la strophe, a besoin d’ironie, d’humour, comme pris d’une sorte de pudeur de s’être trop mis à nu. L’autodérision des grands. D’épanchements point trop n’en faut.
C’est aussi tout l’art brassensien. Telle cette chute qui en surprend plus d’un de «Sale petit bonhomme», poème d’une délicieuse mélancolie sur les amours mortes :
Ma mie, ne prenez pas ma complainte au tragique
Les raisons qui ce soir m’ont rendu nostalgique,
Sont les moins nobles des raisons,
Et j’aurais sans nul doute enterré cette histoire,
Si pour renouveler un peu mon répertoire,
Je n’avais besoin de chansons.
Je ne compte pas assez de cordes à ma guitare ni même de doigts sur mes mains pour vous dire le nombre de gens qui, dans les petites conversations qui ont toujours lieu autour d’un verre après un concert, m’ont posé la question du pourquoi de cette dernière strophe aussi désenchanteresse.
Par ailleurs, le succulent "Venez pleurer avec nous sur le coup de midi" des Funérailles d’antan ne serait peut être pas venu sous la plume de Brassens sans le "Je riz en pleurs et attens sans espoir" de Je meurs de seuf auprès de la fontaine.
On pourrait multiplier les illustrations à l’envi. L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard, procureur et ivrogne superbe chez Villon :
On ne lui sceu(t) pot des mains arracher :
De bien boire ne feut(s) oncques fetard.
Nobles seigneurs, ne soufrez empescher
L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard
est convoquée dans les mêmes termes, à peu de choses près, par Brassens dans « La Légion d’honneur » :
L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard
Se réincarnait chez ce vieux fêtard.
Tenter de l’empêcher de boire un pot
C’était ni plus ni moins risquer sa peau.
Le mélange, le mariage de la belle langue et de l’argot, l’emploi de termes recherchés juxtaposant les archaïsmes de bon aloi, sont des vertus chères à Brassens et à Villon et ce sont les mêmes sots qui, à cinq siècles d’intervalle, en ont fait grief autant à l’un qu’à l’autre.
Comme quoi la constance est bien la seule qualité dont puissent se targuer les imbéciles.
On me pardonnera, j’ose espérer - sans trop d'illusion cependant tant certains esprits mal intentionnés et haineux rôdent autour de ma maison ces temps derniers - cet exposé qui prend parfois les allures fastidieuses d’un mémoire de maîtrise. Mais j’ai tellement eu les oreilles polluées par les postillons «des abstracteurs de quintessence pour qui la chanson est un genre bâtard que sa popularité même exclut du royaume d’élection », bref, entendu tant de muscadins de la plume et (ou) du micro décrier Brassens et encenser Villon que, sans pour autant me lancer dans l’exhaustivité d’une thèse, entreprise bien au-dessus de mes compétences et hors de portée de ma fainéantise, j’avais besoin de prendre le raccourci pratique de l’illustration.
Et je persiste, signe et continue pour terminer par cet hommage brassensien à Villon :
Je mourrai pas à Montfaucon,
Mais dans un lit, comme un vrai con,
Je mourrai, pas même pendard,
Avec cinq siècles de retard.
Ma dernière parole soit
Quelques vers de Maître François,
Et que j’emporte entre mes dents
Un flocon des neiges d’antan.
Le moyenâgeux – 1966 –
Si ce n’est là du grand art, alors soyez assez bons de me monter enfin ce qu’il en est de l’art.
Ou du cochon.

Alors, fortement tenté quand même, il aura peut-être trouvé ce biais en passant par Théodore de Banville, Le jardin du roi Louis. Même thème, mêmes images, notamment celle des oiseaux picorant les suppliciés.
Doublement intelligent en tout cas.
Par Théodore de Banville, Brassens chantait du Villon et rejoignait le célèbre blues sur les noirs lynchés dans les états du sud, Strange fruit, chanté par Billie Holiday et écrit par Abel Meeropol :
- Les arbres du Sud portent un étrange fruit,
- Du sang sur les feuilles et du sang aux racines,
- Un corps noir qui se balance dans la brise du Sud,
- Étrange fruit suspendu aux peupliers.
- Albert Meeropol
- Ce bois sombre où le chêne arbore,
- Des grappes de fruits inouis
- Même chez le Turc et le More,
- C'est le verger du Roi Louis.
- Théodore de Banville
09:37 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.06.2012
Le bon grain de l'ivraie
Lettre d'un ami
Janvier 2012
 Cher Bertrand,
Cher Bertrand,
Je te dois quelques explications, il me semble, ne serait-ce que pour m’excuser d’être venu polluer ton Exil des mots avec le contentieux qui m’oppose à qui tu sais. Je ne vais pas revenir sur l’historique de notre différend, car cela ne t’intéresserait probablement pas. Je compte juste essayer de préciser pourquoi je combats l’idéologie qu’il porte et tâcher de te démontrer que mon coup de gueule n’était pas seulement atrabilaire, mais répondait à des convictions que je crois plus profondes.
Je parle ici d’idéologie à dessein car, contrairement à ce que prétend le personnage, ses idées, au fond, ne se situent pas dans le champ du débat. Pour lui, elles ne se discutent pas. Il est toujours prêt à les reprendre de blog en blog, à les répéter d’article en article, c’est vrai (souvent mot pour mot, avec les mêmes exemples : Duras, le cinéma, etc.), mais jamais à les remettre en question. J’ai pu le constater à plusieurs reprises.
Il prétend dénoncer l’existence d’une fracture « indiscutable » (le terme est de lui) entre la « littérature grand public » et la « littérature exigeante ». Pourquoi pas, après tout. Nous avons tous, et je ne m’exclus pas du lot, des idées préconçues sur cette opposition. Oui, j’ai tendance à ne pas classer Hugo, Balzac ou Zola dans le même sac que Musso, Marc Levy ou Gavalda, pour reprendre des têtes de turcs chers à notre homme. Pourquoi ? La réponse à cette question est extrêmement complexe car elle intègre des données liées à mes goûts propres, mais aussi à la manière dont le monde social et scolaire m’a modelé depuis ma plus tendre enfance. Depuis toujours l’école nous répète qu’il existe une culture noble (celle dont elle défend les valeurs et dont le personnage, par son métier comme par son discours, s’impose comme étant un zélé représentant) et une culture plus vile, populaire, qui doit être pointée du doigt. Et tout le monde sait bien maintenant que, malgré ce que prétendent les discours officiels, l’école demeure un des principaux outils de la reproduction des inégalités, car elle se contente globalement de bien rappeler aux classes populaires qu’elles doivent rester à leur place et de conforter les élites dans leur statut supérieur, bref de valider logiquement les inégalités sociales.
Ce long préambule pour te dire que si je combats l’idéologie portée par le personnage, ce n’est pas tant en raison de ce qu’il nous dit sur la littérature que sur la portée politique de ses propos. Je combats son discours parce que je considère que c’est un discours insidieux, discriminant (au sens négatif du terme) et dangereux.
Je ne sais pas si tu as pris le temps de te plonger dans les différents entretiens où il développe ses idées. Tu remarqueras que son argumentation repose presque toujours sur deux procédés principaux : un usage de termes flous, qui lui permettent de rester dans le champ de la posture plus que dans celui de l’explication claire, et un renvoi assez systématique à ses propres qualités humaines, qui, selon lui, ne peuvent pas être contestées, renvoi servant à expliquer qu’il ne faut pas avoir peur de ce qu’il dit, car tous ceux qui le connaissent peuvent confirmer que c’est un brave garçon, manquant parfois de confiance en lui, mais gentil et plein d’humanité.
Je ne m’étendrai pas sur ce dernier procédé, même s’il y aurait matière à le faire. C’est un procédé qui fonctionne pourtant très bien, et c’est d’ailleurs pour ça que les hommes et femmes politiques en usent et en abusent. D’autant qu’il est d’un usage très simple et consiste juste à clouer le bec de son adversaire en lui disant : « vous n’avez pas le droit de vous en prendre à mes idées car je suis quelqu’un de bien ». Ce brouillage entre qualité personnelle et valeur des idées qu’on défend est selon moi particulièrement dangereux et contient le germe de graves dérives. Certes, notre homme ne s’appelle ni Sarkozy, ni Le Pen, ni Hollande*, mais il n’est pas anodin de constater qu’il utilise les mêmes techniques d’argumentation que ces grands manipulateurs.
De la même manière, ce n’est pas anodin de constater que notre homme fait reposer l’essentiel de son discours sur des termes flottants, qu’il se garde bien de définir précisément, et qu’il utilise les uns à la place des autres, en fonction de ce dont il a besoin pour défendre sa cause. Et là encore, difficile de croire qu’un professeur de philosophie, habitué à manier les concepts, puisse laisser planer un tel flou par inadvertance.
J’ai noté au moins quatre termes qu’il utilise quasiment comme des synonymes : « différence », « discrimination », « distinction », « hiérarchie ». Ce qui lui permet, lorsqu’il expose son système, ouvertement basé sur une échelle hiérarchique de valeurs séparant les œuvres, les auteurs et les lecteurs, de se défendre de toute forme de sectarisme en expliquant qu’on ne peut pas nier l’existence de « différences » dans tous ces domaines.
Des différences, oui, il y en a, c’est indéniable. Mais parler de « différence » ou parler de « hiérarchie », ce n’est pas la même chose. Parler de différence, c’est admettre que tel livre est dissemblable de tel autre (à la limite, c’est presque une lapalissade sans grand intérêt). Parler de hiérarchie, c’est poser une échelle de valeur dont la graduation se mesure en degrés de supériorité et/ou de pouvoir. Ce n’est pas du tout la même chose, et les conséquences de cette nuance peuvent être lourdes de sens. Car, si parler de hiérarchie au sein d’une organisation ou d’une institution n’est pas absurde, puisque cela répond à une logique fonctionnelle, parler de hiérarchie dans le domaine des valeurs ou des goûts, là où aucun lien organisationnel n’est nécessaire, c’est tout simplement rajouter de l’aliénation où il y en a déjà bien assez.
A plusieurs reprises, notre homme a tenté de noyer le poisson en se réfugiant derrière d’autres termes tels que « distinction » ou « discrimination ». Mais là encore, ces mots ne sont pas neutres. Si le mot « hiérarchie » renvoie à la notion de supériorité, celle de distinction louche plutôt du côté de l’excellence et de la qualité. La distinction, aussi bien dans son acception classique (ce qui est distingué, autrement dit chic) que sociologique (la distinction vue par Bourdieu), c’est ce qui permet à certains êtres d’exception, de sortir des rangs, aussi bien pour de bonnes que pour de mauvaises raisons. La notion de discrimination, pour sa part, met plus spécifiquement le doigt sur l’idée de rapport de force ou d’équilibre entre plusieurs « groupes ». Dans un entretien avec un directeur de magazine littéraire, notre homme nous rappelle que le verbe « discriminer » n’a rien de négatif en soi, ce qui est vrai. La dimension positive ou négative vient en plus, en fonction de l’usage que l’on fait de la discrimination. Et la discrimination pratiquée par notre homme, malgré tout ce qu’il en dit, n’a rien de positif pour celles et ceux qui n’ont pas l’heur de se retrouver du même côté de la barrière que lui. D’un côté les bons, les grands, les exigeants, ceux qui ont quelque chose à dire, qui portent une vision du monde (les termes sont de lui). De l’autres, les écrivaillons, ceux qui recherchent la gloire ou l’argent facile, les faibles, les mauvais, les femmes au foyer (sic), celles et ceux qui se vautrent dans les loisirs faciles et les séries TV (là encore, les exemples sont de lui, il est important de le noter).
Ça, de la discrimination positive ? Bien sûr que non ! C’est un discours d’exclusion, très clairement et il peut bien répéter autant de fois qu’il le désire, qu’au fond il ne leur veut pas de mal, à tous ces gens là, -avec lesquels il ne se confond pas - cela ne retire rien au principe de discrimination négative qui entache ses propos. Car, derrière les deux catégories qu’il dessine, on sait très bien qu’il y a des fractures socio-économiques claires avec statistiquement, du côté des bons, plus de cadres supérieurs, de professeurs, de diplômés et de l’autre, le mauvais, plus d’ouvriers, de travailleurs précaires, d’agriculteurs, d’immigrés sous qualifiés ou à cheval sur plusieurs cultures…
On peut évidemment se dire que tout ceci n’est pas grave, qu’on ne parle que de littérature après tout, que les limites du discours ne sont le fruit que de quelques imprécisions sans conséquences, sauf que ce n’est pas le cas. On ne joue jamais impunément avec la discrimination. Car en nous vendant de la hiérarchie ou de la distinction en guise de différence, il ne met pas n’importe quoi sur la table. Il pose, du moins dans le champ littéraire, l’idée qu’il y a une élite indiscutable et qu’il y a le commun des mortels. Bien-sûr, il ne juge pas ces derniers. A la limite, il nourrit même un peu de compassion à leur égard. N’empêche que, faisant fi de tout ce qui peut rationnellement expliquer que lui, le prof de philo, n’a pas forcément les mêmes lectures que le gars qui, pour des raisons diverses, s’est retrouvé en CAP espaces-verts, il laisse entendre que les inégalités entre les individus ne reposent sur aucune injustice et que si élite il y a, c’est comme ça, que ça ne s’explique pas, que c’est un phénomène naturel et que la seule posture légitime consiste à accepter docilement cet état de fait. C’est clairement un discours d’oppression et d’aliénation.
En effet, comme par hasard, il ne construit pas son élite n’importe comment : il la construit à son image. Il en fait naturellement partie. Oh pas plus que ça, minaude-t-il, modeste ! Il lui arrive même d’avoir des loisirs populaires parfois, de lire un Fred Vargas ou d’aller voir un film grand public. Ben tiens…
Oui, je combats son idéologie (plus que lui-même, parce qu’il n’est finalement, qu’un des porte-paroles du principe de domination qu’il défend). Oui je la combats, comme je combats toutes les idéologies tendant à transformer les injustices sociales en inégalités naturelles et objectives. Oui je combats toutes les idéologies qui tendent à tracer une ligne de démarcation entre les élus et les exclus. Et je continuerai à combattre à chaque fois que cela sera possible tous les Copé, Wauquiez, Guéant et autres Fabius *, qui n’ont à transmettre au plus grand nombre des individus que leur dédain et qui sont incapables d’admettre, au fond, que les goûts, les valeurs et les idées de ceux qui n’appartiennent pas à leur caste, puissent avoir une vraie légitimité.
Voilà, Bertrand, cet éclairage me semblait nécessaire. Et voilà pourquoi, selon moi, il ne m’a jamais nettement répondu et restera toujours incapable de le faire car il lui faudrait alors tomber le masque de son cynisme, et, éventuellement, faire une croix sur tous les avantages qu’il lui procure…
* Réactualisé, à la faveur des récents non-évènements électoraux, par le destinataire de la lettre
11:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.06.2012
Octobre en musique
 Mouuââ, guitariste émérite et qui, même, pour faire chier Tanguy et consorts, expose ma photo de vieux musicien coquet dans la marge de mon blog, je suis en pleine répétition.
Mouuââ, guitariste émérite et qui, même, pour faire chier Tanguy et consorts, expose ma photo de vieux musicien coquet dans la marge de mon blog, je suis en pleine répétition.
Répétition qui va s’accélérer car je reçois bientôt, ici pour une semaine, Jean-Jacques Epron, lecteur public de Zozo, chômeur éperdu, et avec lequel je monte un spectacle de poèmes mis en musique par mézique.
Ce sera à la mi-octobre. Il faut donc mettre tout ça bien au point. Travailler les enregistrements faits en août dernier, travailler ensemble, travailler chacun de notre côté, puis, à l’automne, répéter encore toute une semaine, chaque jour, en France cette fois-ci, avant de soumettre au public le résultat de nos élucubrations poético-musicales.
Dans six petites salles différentes, je crois. En Deux-Sèvres.
Au programme, donc :
LA FONTAINE
Les deux mulets
Le Mulet se vantant de sa généalogie
L’oiseau blessé d’une flèche
La Mort et le bûcheron
L’âne portant des reliques
François Villon
La Ballade des pendus
Clément Marot
Le blason du beau tétin
Baudelaire
L’Albatros
Sans titre
Guillaume Apollinaire
Baladins
Georges Brassens
Le Revenant
(Titre posthume mis en musique par mézigue)
Gaston Couté
Le Testament d’un sale drôle
L’amour qui s’fout de tout
Bertrand Redonnet
Figure d’exil
Z'avez-vu comme je suis prétentieux et misogyne ? Non ? Ouf ! J'ai eu peur !
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET




















