30.12.2010
Carte de voeux
 Je vous souhaite, à tous et à toutes, une excellente année 2011, c’est-à-dire :
Je vous souhaite, à tous et à toutes, une excellente année 2011, c’est-à-dire :
Une année qui serait une sorte de temps mort, une suspension sinon un arrêt total, de la courbe obstinément déclinante des intelligences, sensibilités et honnêtetés humaines,
Une année où vous ne trébucheriez pas, au moins une fois, sur les écueils de la fourberie forcément posés à un moment donné sur votre chemin,
Une année où sombreraient autour de nous les tyrans de la finance, du mensonge et de la magouille. Ceux qui gouvernent nos vies, bien sûr, mais aussi tous ceux qui, chevauchant une contestation aussi mièvre que spectaculaire, se proposent tout bonnement de venir poser leur sale cul sur les trônes vacants,
Une année de gloire à la fraternité non usurpée, à l’amour passion au fond des grands draps blancs et à l’amitié pure et simple, celle dont la main se pose sur votre épaule et vous réchauffe de partout,
Une année de mise en échec de la stratégie globale de la peur et de l’angoisse par une volonté de vivre aussi primaire qu’efficace,
Une année où des pièces essentielles de votre puzzle seraient retrouvées.
Je vous souhaite tout ça, vraiment - je me le souhaite d’ailleurs à moi-même depuis un demi-siècle - mais ne vous faites pas trop d’illusions quand même.
Pour sincères que soient ces voeux, ils n’en ont pas moins les allures lénifiantes du chant liturgique dont les espérances sans cesse sont remises aux calendes grecques.
Le mieux, je crois, pour rester dans le domaine du raisonnable et du crédible, sans pour autant patauger dans la résignation, est de vous souhaiter une année qui vous épargne les grands malheurs, et si, en prime, survient un coup de bonheur impromptu, alors tout ne sera pas si mal.
Amitiés
Bertrand
10:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.12.2010
Déclinaison approximative de certains génitifs
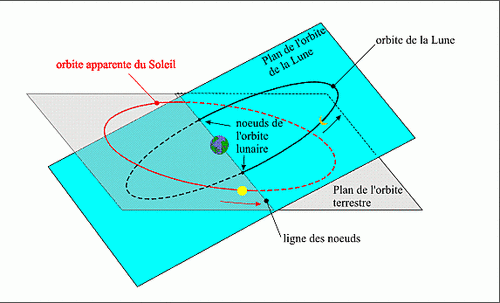 - L’amour de la poésie sans la poésie de l’amour est une supercherie de l'esthétisme. Ou, plus exactement, un esthétisme de la supercherie.
- L’amour de la poésie sans la poésie de l’amour est une supercherie de l'esthétisme. Ou, plus exactement, un esthétisme de la supercherie.
- Tenter d'échapper à la bêtise du monde sans se donner les moyens de fuir le monde de la bêtise me paraît relever d'un redoutable mythe de Sisyphe
- Misère de la fatuité et fatuité de la misère : Les vies de cadres ont partout en cela les mêmes cadres de vie.
- La déontologie de la politique s’efface toujours devant une certaine politique de la déontologie.
- Le centenaire d’un événement quel qu’il soit est tellement désolant qu’on dirait bien un évènement de centenaires.
- La folie des grandeurs d'un individu est inversement proportionnelle à la grandeur de ses folies.
- Son intelligence des situations renseigne vite sur la situation de l’intelligence d’un quidam
- En période de soubresauts révolutionnaires, le pouvoir réduit toujours la jeunesse d’une théorie à une théorie de la jeunesse
- Le combat de la littérature, fort heureusement, ne s'est jamais limité à une prétendue littérature de combat
- Le monde est vraiment mal fait : La littérature des amoureux fait le plus souvent fuir les amoureux de la littérature
- Le combat contre la pauvreté de l’existence va bien au-delà du combat contre l’existence de la pauvreté
- Le politiquement correct soumet sournoisement le respect des règles aux règles du respect
- Equilibre mondial : Quand la guerre des nerfs se fait nerf de la guerre
- L’athée redoute la fin du voyage, le croyant spécule sur le voyage de la fin
- L’ennui, en amitié comme en amour, naît souvent de cette lâcheté : Quand le sentiment du glas tarde à sonner le glas des sentiments
- Une femme aux cheveux teints de façon outrancière (un homme également mais c'est quand même plus rare) est pathétique en ce qu'elle (ou qu'il) exhibe autant l'inexprimable refus de son déclin que l'inéluctable déclin de son refus
- L'esprit de revanche ne peut jamais animer, au risque de la réduire à zéro, la revanche de l'esprit
- La nostalgie des grands moments n'est pas forcément un grand moment des nostalgies.
- Les fêtes de fin d'année sont d'autant plus insupportables que la fin des fêtes a été depuis belle lurette signifiée à tout le monde.
11:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.12.2010
Il
 Il y a dans ma tête un homme qui tourne parfois en rond. Au hasard, par associations d'idées pleinement conscientes ou beaucoup plus lointaines, mais toujours éveillées.
Il y a dans ma tête un homme qui tourne parfois en rond. Au hasard, par associations d'idées pleinement conscientes ou beaucoup plus lointaines, mais toujours éveillées.
Jamais dans mon sommeil, d'autant qu'il m'en souvienne.
Je ne l'ai pas connu, cet homme.
J'ai seulement croisé son regard, mais c'était plus dense, plus pathétique et plus vrai que tous les discours, que tous les poèmes, que tous les livres, que tous les sonnets et que toutes les musiques du monde.
Si tu croises un jour un regard pareil, forcément, il se promènera aussi, longtemps et parfois, dans ta tête.
Si tu as su la conserver humaine.
Je ne l'ai pas connu, cet homme, parce que c'était dans un univers où personne ne connaît personne. Un univers où l'on se croise, où l'on n'échange que des regards, des coups ou des cigarettes. Une sorte de superlatif microcosmique de nos sociétés organisées pour et autour de la misère, le plus solide des jougs posé sur la nuque humaine.
De cet homme, j'étais le seul à avoir le droit de croiser le regard, en tant que bibliothécaire. Disons plus modestement préposé à la distribution des livres.
Pour lui en tendre un, j'étais donc bien obligé de voir ses yeux. Interdiction de lui serrer la main, interdiction de le saluer, interdiction de lui dire une parole, interdiction de le toucher, interdiction qu'il fût un homme.
Seulement avec les yeux.
Le fonctionnaire en casquette et uniforme, derrière mon dos, veillait à ce que je lui présente seulement le livre demandé, du bout des doigts, à bonne distance, et sans desserrer les lèvres.
Il était assis sur une chaise rudimentaire. Il n'avait pas le droit à son lit le jour, on lui clouait dans le mur lépreux. La nuit, il n'avait pas le droit à l'obscurité non plus, une chandelle nue l'arrosait du crépuscule au matin et, par un immonde judas, un œil où dansait de l'alcool frelaté, un œil mensualisé sur l'échelle mobile des salaires, veillait à ce que ses insomnies fussent douloureuses.
Il avait des chaînes à ses pieds et il avait des chaînes à ses mains. Pour qu'il ne puisse faire aucun mouvement brusque...Pas contre quiconque - il ne voyait jamais personne - mais contre lui-même.
La société avait décidé que ce serait elle, et elle seule, qui aurait le privilège du geste fatal.
Bleu comme l'océan sous juillet, qu'il vacillait son regard...Mais un bleu de la bourrasque, un bleu des tempêtes inconnues. Un ouragan, un cyclone, un cataclysme limpide, une furie accrochée au zénith, sans un nuage. Une incohérence. Et de l'humidité qui flamboyait. Comme de l'eau qu'on aurait incendiée de l'intérieur.
Je lui ai tendu La Mare au diable.
Etait-ce bien raisonnable ? Il y était depuis longtemps, au diable, et il pataugeait dans des eaux plus glauques qye celles d'une mare.
Plus tard, quand je ne fus plus un préposé à la distribution des livres, quand j'eus posé mon cul sur la plage humide pour regarder le bout de l'île d'Aix, le dos de l'île d'Oléron, fort Énet et fort Boyard accroupis dans des brumes incertaines, avec des goélands criards et fientant au-dessus, pour, aussi, réhabituer mes poumons à l'air dont ils avaient tant manqué, pour cracher la poussière, j'ai appris que le législateur avait permis qu'il se couche désormais le jour s'il était fatigué, qu'il ait droit au noir pour son sommeil, qu'on lui parle, qu'on lui serre la main avant de lui donner un livre ou un bout de pain, qu'on enlève les chaînes qui lui brisaient les pieds...
Que sa tête resterait solidaire de son cou.
Il se promène encore dans la mienne, des fois.
Il me semble, dans ces moments-là, avoir traversé un lambeau de Moyen-âge, qui s'est oublié là, accroché sur ma peau.
Image : Philip Seelen
12:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.12.2010
Il a dit anarchie ?
 C’est un véritable poncif de dire que Georges Brassens n’écrivit dans ses textes qu’une seule fois le mot anarchie. C’était dans une des ses premières compositions, Hécatombe.
C’est un véritable poncif de dire que Georges Brassens n’écrivit dans ses textes qu’une seule fois le mot anarchie. C’était dans une des ses premières compositions, Hécatombe.
Le mot est entaché de tant de confusionnisme, intéressé ou tout simplement stupide, il a tant fait les frais des soubresauts, des luttes, des compromis, qu’il est quasiment impossible de définir quelqu’un comme tel, du moins en tant que concept politique.
Chaque fois qu’un écrivain, un orateur, un militant, un historien, un théoricien, un copain en fin de soirée, veut employer le mot, s’il voulait être, rester ou devenir un homme honnête et intelligent, il devrait indiquer clairement une référence historique ou poétique, d’où émanerait le sens exact qu’il entend donner au mot.
On peut en effet dire de Nestor Makhno, de Bakounine, de Ravachol, de Jules Bonnot, de Malatesta, de Durrutti, de Proudhon, de Stirner, de Fourier, de Pancho Villa, de Louise Michel et de la plupart des communards, d’Emile Henry, de Paul Lafargue, de Coeurderoy, de Kropotkine, de Sébastien Faure et de tant d’autres, qu’ils furent des anarchistes. Bien sûr.
Mais on peut tout aussi bien le dire de Guy Debord, de Raoul Vaneigem, de Rimbaud, de Nietzsche, de Géronimo, de François Rabelais, d’Albert Camus, d’Oscar wilde, des encyclopédistes, de Jim Morisson, de Dylan, de François Villon, de Spartacus.
Car on peut le dire de tous les hommes qui n’ont pas voulu faire allégeance aux aliénations, de tous ceux qui ont cherché à voyager le nez dans les étoiles, de tous ceux qui ont souffert et souffrent de l’injustice, de la connerie, des dogmes, du mensonge, du vol, du viol, du crime, de la volonté des puissants, des complots, de l’oppression quotidienne des corps et des esprits.
De tous ceux qui ont voulu ou veulent connaître, par delà le bout de leur nez, le sens véritable de ce qu’on leur interdit de vivre.
De tout individu qui supporte mal les conditions qui sont faites à sa vie.
On peut le dire de tous les poètes qui dans leur chair ont vécu la poésie comme un impossible autrement. On peut le dire de tout promeneur qui, un jour, a eu la sensation puissante d’un autre bonheur possible, humain, ailleurs, par delà les contingences et contraintes de chaque jour.
Pour toutes ces raisons, on peut donc le dire aussi de Brassens, mais pour comprendre ce qu’il fut et aimer ce qu’il fit, il n’est pas besoin de le dire.
C’est pourquoi, sachant combien le mot était à la fois trop réducteur et trop vaste, il ne l’écrivit qu’une seule fois.
Humainement, l’anarchie est un sentiment puissant, profond, une vision du monde et une façon d'être avec les gens.
Politiquement, c’est un os à ronger, une merde spectaculaire pour chiens de garde de pouvoir.
L'Anarchie se situe bien en-dehors de toutes compromissions avec la pensée politique : Elle est la poésie en actes.
Extrait - sauf deux dernières lignes - de "Brassens, poète érudit" publié en 2001 (1ère édition) et 2003 (2ème édition) chez Arthémus.
09:00 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.12.2010
En pagaille - 2 -
 1 - Un Algérien condamné pour outrage au drapeau français, une première.
1 - Un Algérien condamné pour outrage au drapeau français, une première.
Le titre, lu ce matin, a de quoi interpeller. C’est « cette première » qui m’a fait sursauter…Parce que c’est vrai que si l’histoire se mettait à condamner tous les Français qui ont outragé le drapeau algérien, ça ferait du monde à passer devant les chats fourrés.
Mais il fallait lire que c’était le premier homme condamné en vertu d’un décret, pas d’une loi, d’un décret, émis en juillet dernier par la horde à Sarkozy/Fillon, hautement respectueuse, comme chacun le sait, de l’intégrité républicaine.
Pas de pot que ce soit un ressortissant algérien qui essuie les plâtres ! Il s'était énervé, le sacripant, contre les employés de la préfecture des Alpes-Maritimes qui n’en finissaient pas de répondre à une sienne requête administrative, ce qui est quand même rare, voire exceptionnelle, que des employés de l’administration française ne répondent pas avec célérité aux administrés.
L’homme avait brisé la hampe du drapeau national qui pavoisait dans le hall d’entrée. Vous vous rendez compte ?
Il aurait pu faire preuve d’un peu de patience, ce salaud d'Algérien ! Est-ce qu’un Français, un brave Gaulois, ferait ça, lui, même bourré comme un coin ?
Jamais ! En tout cas, on ne titrerait pas : Un Français condamné pour outrage etc.….On dirait simplement un citoyen, un homme, un gars pris de boisson...
Ah, Matin brun, tu n’en finiras donc pas de te lever !
2 - Noyeux Joël, Minuit Crétins et et caetera : Dans la Drôme, un trufficulteur a tué avec son fusil à pompe un gars qui cherchait, selon lui, à lui voler des truffes !
Au moins le champ lexical est respecté :
Mort truffé de plombs au champ de truffes.
C’est évidemment un assassinat, pas un meurtre. Un crime crapuleux…Selon le parquet, le voleur a été abattu de deux coups de fusil. Pas un. Deux. La détermination. La réflexion glacée d’un assassin.
Et bien vous savez quoi ?
Une manifestation de près de 200 sympathisants du jeune agriculteur incriminé, par ailleurs président des Jeunes agriculteurs de la Drôme, a été organisée devant le Tribunal de grande instance de Valence.
Et puis :
A l'initiative du syndicat des trufficulteurs locaux, qui dénoncent des vols de truffes notamment en cette période de fêtes - ben oui, que voulez-vous qu'on foute de vos truffes au 14 juillet ! - une marche de soutien à l'agriculteur avait été organisée mardi à Grignan, rassemblant environ 250 personnes.
Que réclament donc tous ces bons citoyens qui n'auraient jamais idée d'outrager leur drapeau, eux ? Que réclament -ils, sinon le droit d’assassiner ?
Ah, Matin brun, tu n’en finiras donc pas de te lever !
3 - Et pourquoi j'écris des faits de société depuis quelques jours plutôt que des textes ayant plus ou moins trait à la littérature ?
Parce qu'une littérature qui cause de tout sauf du pot de chambre dans lequel elle fermente, est une littérature bien logée : Une littérature de merde.
10:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.12.2010
En pagaille
 - L’écriture sur blog ou site a ceci de particulier et d’innovant qu’on y écrit tous les jours. Ce qui fait dire à ses détracteurs que la chose n’est pas possible, comme s’il était exceptionnel qu’un écrivain, un écrivant, un auteur, appelez-le comme bon vous semble, en gros quelqu’un dont c’est le métier ou l’immense plaisir d’écrire, n’écrive pas que tous les ans ou tous les trois mois.
- L’écriture sur blog ou site a ceci de particulier et d’innovant qu’on y écrit tous les jours. Ce qui fait dire à ses détracteurs que la chose n’est pas possible, comme s’il était exceptionnel qu’un écrivain, un écrivant, un auteur, appelez-le comme bon vous semble, en gros quelqu’un dont c’est le métier ou l’immense plaisir d’écrire, n’écrive pas que tous les ans ou tous les trois mois.
Un écrivain, un vrai, ça se présente devant un public ébahi aux équinoxes d’automne avec son bébé dans les bras, conçu hors champ social.
Défaillance du raisonnement quand il refuse de s’adapter à d’autres conditions que celles dont il est issu.
- Numérique et édition traditionnelle : La coexistence encore pour longtemps de la diligence et du moteur à explosion. C’est bien normal et c’est certainement tant mieux. Mais faudrait quand même savoir - pour ne pas mourir tout à fait idiot (e) pendant ce long modus vivendi - qui est quoi et quoi est qui là-dedans !
Surtout de la part d’écrivains et poètes qui n’ont d’autre raison d’être que celle de vouloir dire, depuis leur Mont Parnasse, le monde.
- Et à propos de ce monde, justement, en sautant du coq à l’âne, c’est bien un monde de fous furieux avec des drames qui prêtent hélas à rire, ce qui le rend encore plus furieux et plus fou : En Allemagne, un homme a tué son voisin à coups de pelle, après une dispute pour savoir qui devait déneiger leur allée commune.
Comme ça le problème est résolu pour tout le monde, un au champ de navets et l’autre en taule. Il n’y a plus qu’à attendre le printemps pour déneiger cette putain d’allée !
- En Biélorussie, ça s’énerve dur, le Président est élu avec 80 pour cent des suffrages, les candidats qui lui étaient opposés sont sous les verrous ou carrément disparus, le ministre de la justice (faut bien l’appeler par quelque chose) propose d’interdire désormais tous les partis politiques.
Je vous dis ça pour trois raisons : Je trouve qu’il y a un petit rapport allégorique avec les deux Allemands ci-dessus mentionnés, que dans 10 jours on est en 2011 et que ça se passe à 18 km de ma maison.
- La France et l’Allemagne s’opposent à l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen. L’Allemagne je ne sais pas trop pourquoi, la France parce que expulser les Roms deviendrait vraiment problématique !
Il n’y aurait plus qu’une solution politique d’envergure : Expulser la France de l’espace Schengen.
Ce sont les plus gênés qui doivent partir, après tout.
- Etre riche, dans nos sociétés vautrées sur des amoncellements de marchandises pour la plupart inutiles, consiste à ne pas être indigent.
Dans le langage des sociologues, observateurs, politiques et de toute la sale engeance chargée de faire tenir debout le système, les riches sont ainsi de plus en plus nombreux et les pauvres n’existent plus qu’en minorité marginale.
Comme ça tout le monde est content.
Et une société où tout le monde est content parce que les adjectifs qualificatifs ont simplement changé de degré d’évaluation est une société inqualifiable.
- Un moine bénédictin Polonais, un brave et honnête homme, vient d’adresser une lettre au Vatican dans laquelle il s’insurge et dénonce la corruption et les déviances de l’église catholique en Pologne, érigée en classe dominante, arrogante et possédante.
Le courage de cet homme mérite notre respect, sa candeur notre compassion : Car comment aller se plaindre de la voracité des loups auprès des ogres sans finir dévoré par les uns ou par les autres ?
13:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.12.2010
Cartes postales
 Il arrive parfois - pas assez souvent à mon goût - qu’on soit saisi par un aspect particulier du monde et de ses paysages, qu’on en est un peu ému, que ça fait écho à l'intérieur et qu’on voudrait bien écrire tout ça, mais qu’on ne trouve pas les mots, tant ils sont nombreux, éculés, rabâchés, pontifiés, obsolètes, usés jusqu’à la corde, convenus jusqu’au risible.
Il arrive parfois - pas assez souvent à mon goût - qu’on soit saisi par un aspect particulier du monde et de ses paysages, qu’on en est un peu ému, que ça fait écho à l'intérieur et qu’on voudrait bien écrire tout ça, mais qu’on ne trouve pas les mots, tant ils sont nombreux, éculés, rabâchés, pontifiés, obsolètes, usés jusqu’à la corde, convenus jusqu’au risible.
Alors on essaie de se taire. C’est tout de même dommage. Les sentiers battus en écriture sont pavés des pièges de l’oxymore : Plus ils sont grand ouverts, moins ils sont confortables. Les sentiers escarpés, presque vierges, conviennent mieux à l’art d’écrire.
Sauf quand ils sont inventés de toutes pièces et ne sont plus qu'art pour art, évidemment.
Ce matin, donc, je me suis engouffré dans une brèche plus que fréquentée. Il était à peine cinq heures, une fin de nuit où la pleine lune, ronde comme un symbole coquin, ruisselait sur la neige. Il en faisait nuit-jour. Le village dormait encore, pas une fumée qui ne s’échappait des toits lourds de glace, sinon du mien.
Et cette lumière satellitaire prenait en enfilade l’unique rue du village. Les ombres des arbres comme morts, des maisons comme inhabitées, des clôtures comme inutiles, qui s’étiraient sur la neige. Pas un bruit encore. Moins 13 degrés. Le monde réduit à un tel essentiel immobile, réduit à son ombre en fait, qu’il n’est pas forcément idiot de se demander si des fois on ne serait pas sur la lune et si ça ne serait pas la terre qu’on verrait se promener, là-bas, derrière les pins recouverts de givre.
Si la planète bleue ne connaissait pas les hommes, elle aurait cette sagesse opaline, énigmatique, cette désespérance d'un voyage inutile dans le cosmos et alors…Mais ma première cigarette était terminée.
Je suis rentré.
Plus tard, sur le bord de la route, en lisière extrême de la forêt, une maison complètement isolée, recouverte de neige, rejetait vers le ciel les volutes épaisses d'un premier feu.
Comme sur les cartes de bonne année que ma mère envoyait à ses sœurs, avec du brillant partout, des pleins et des déliés et des souhaits sincères de bonheur et de santé.
Parfois, oui, les matins sont comme ça : On dirait qu’ils se plaisent à moquer tous les clichés des hommes.
Ils n'y fourniront assurément jamais.
Et c'est sans doute pour cela qu'on ne les regarde plus.
11:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.12.2010
J'ai un problème avec les femmes : élargissement des contributions
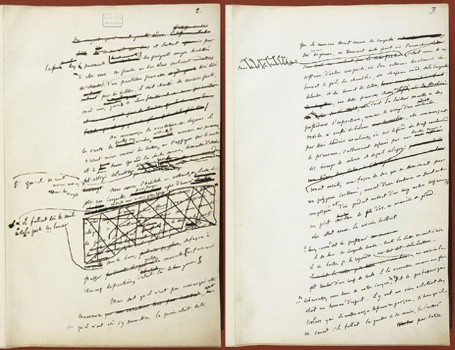 Je choisis cette solution de réponse plutôt que le commentaire , parce-que c'est mieux. Voilà un argument - convenez-en - imparable et bien développé, n'est-il pas ?
Je choisis cette solution de réponse plutôt que le commentaire , parce-que c'est mieux. Voilà un argument - convenez-en - imparable et bien développé, n'est-il pas ?
C'est donc avec certain plaisir que j'ai lu vos divers commentaires (contributions) qui se penchaient sur ce que j'ai appelé plaisamment mon problème. Surtout de votre part, gentes dames, même si les réflexions de Stéphane et de Feuilly sont tout à fait pertinentes à mon goût et si le long commentaire de Nauher apporte de bien probantes précisions.
D'autant qu'on n'est pas là pour dire des choses nouvelles ou (et) époustouflantes, mais des choses qu'on ressent comme vraies, sans jurer qu'elle le sont, bien sûr.
J'avais fait allusion à Brassens - ça ne m'arrive pas souvent - dans lequel les petites paumées des matins féministes se plaisaient, et peut-être se plaisent encore, je n'en sais rien, à identifier un affreux mysogine moustachu, les connes !
Faudrait qu'elles lisent Schopenhauer (traité sur les femmes) pour pouvoir parler enfin de misogynie. Ou alors Baudelaire invectivant la femme Sand. Qu'on écoute "Une jolie fleur" ou " Concurrence déloyale" et qu'on dise que Brassens eut des velleités misogynes, ça d'accord. Mais qu'on écoute aussi, qu'on lise même, "La non-demande en mariage", " Saturne ", Bécassine", " Les Croquants" et qu'on me trouve, si on a bien compris, un poète qui ait parlé avec autant de délicatesse de sa compagne.
Bref, le problème chez moi, que je voulais signifier dans le texte précédent, c'est que je ne sais pas me mettre dans la peau d'une femme. Voilà. Quand j'essaie, je ne ressens rien de vibrant et qui m'appartienne. J'ai même l'impression de n'écrire que des balourdises. J'atteins ainsi les limites de la fiction, celle-ci se voulant quand même une réévaluation littéraire du réel, d'où un certain mépris fort contemporain pour le roman, d'ailleurs, mépris dont on pourrait parler longtemps, dont je reparlerai sans doute, car je commence - je commence seulement - à accumuler des expériences et observations qui ne vont pas vraiment dans le sens du vent.
Je trouve donc qu'il n'y a somme toute pas grand chose d'anormal dans cette difficulté à mettre en scène une ou des femmes. Faut du génie pour ça sans doute. D'ailleurs, vous aurez remarqué l'illustration que j'avais choisie et que je répète ici.
Mais je me demande quand même, contradictoirement à tout ce que je viens de dire : Est-ce que le bovarysme, cette insatisfaction permanente due, en partie, à des fantasmes romanesques et livresques, est un mal essentiellement féminin ?
Et Balzac, avec sa "Femme de trente ans", ne dresse t-il pas plus un échec de l'amour conjugal universel - en prenant comme tremplin la brutalité nocturne d'un médiocre soldat - qu'une déception sensible propre aux femmes ?
Est-ce que Balzac, tout comme Flaubert, étaient les mieux placés pour parler de la frustration et de la misère sexuelles féminines dans un couple et d'en décrire le dégoût psychologique qui s'ensuit ?
Donc : Y a-t-il quelque chose qui soit essentiellement féminin, que voudrait capter l'écriture sans vraiment y parvenir ? C'est là, peut-être le nœud gordien, que seule une réponse négative pourrait trancher.
Duras n'a t-elle écrit qu'au féminin, même si les grenouilles féministes l'ont prise à un moment donné pour leur chantre ? Mais que n'ont -elles pas pris - passons sous silence Gisèle Halimi- pour elles ou contre elles !
Enfin, tu dis, Michèle, que c'est de l'écriture, pas de la vie...Je ne suis point d'accord. L'écriture qui n'est que superstructure, essor artistique par-delà les tripes désordonnées de la vie, n'est, à mon sens, que bouillie pour gros chats de salon.
Illustration : Feuillets du manuscrit " Madame Bovary"
10:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.12.2010
J'ai un problème avec les femmes
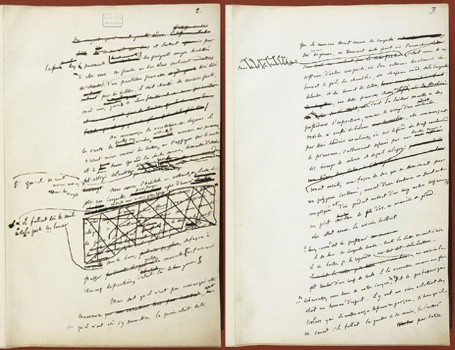 C’est ce qu’on appelle un titre accrocheur, cabotin, pour ne pas dire racoleur. Je crains, hélas, que les moteurs de recherche et les espions Google n’égarent alors sur L’Exil des lecteurs qui leur demandaient tout autre chose, de bien plus urgent et poignant.
C’est ce qu’on appelle un titre accrocheur, cabotin, pour ne pas dire racoleur. Je crains, hélas, que les moteurs de recherche et les espions Google n’égarent alors sur L’Exil des lecteurs qui leur demandaient tout autre chose, de bien plus urgent et poignant.
Ceci étant dit, si tous les hommes qui ont un problème avec les femmes - de quelque nature qu’il soit - viennent se fourrer là, mes statistiques d’épicier mensuel risquent d'exploser.
Je précise donc tout de suite, pour ne pas leur faire perdre plus longtemps un temps qui doit être précieux, que j’ai un problème avec les femmes en écriture. Si j’en avais un ailleurs, ce n’est pas sur l’Exil que je serais tenter de le résoudre car, selon Le Modeste :
... mettre en plein soleil
Son cœur ou son cul c’est pareil.
En écriture donc, chaque fois que j’ai voulu faire intervenir une dame dans mon récit, j’ai échoué.
Je ne sais pas faire.
Dans Brassens poète érudit, si j’ai parlé des femmes, c’était bien évidemment à travers les chansons du poète.
Dans Chez Bonclou et autres toponymes, des dames interviennent parfois, notamment sur la controverse autour de Chanteloup, mais elles sont encadrées par leur passion de la toponymie et tiennent des propos qui n’ont rien de spécifiquement féminins.
Dans Polska B Dzisiaj, si je parle des femmes, c’est sous le terme général de "Polonais", tout sexe confondu.
Dans Zozo, n’en parlons pas ! Il n’y a que Zozo ! Il prend toute la place, il tire toutes les couvertures à lui. Il y a bien sa femme en filigrane, comme une ombre qui ne dit jamais rien, qui cuisine toujours, qui est grosse en plus, à tel point qu’on m’a fait le reproche d’être un tantinet misogyne. Une femme, bien sûr. Le genre de critique qui ne mange pas trop de pain.
La femme de Zozo, quand même, s’avère être plus maline que son épicurien de mari et se montre capable d’une stratégie à long terme, celle-ci fût-elle meurtrière.
Dans Géographiques, là, c’est le black-out complet. Parmi les géographes, météorologues, océanographes et autres climatologues, pas l‘ombre d’une présence féminine.
C’est hier soir que je dressai in petto cette espèce d'auto-bilan d'une plume discriminatoire.
J’écrivais une nouvelle. L’île de Ré à l’époque du bac. Tempête, bac du soir annulé, gens coincés, certains le prennent avec bonhommie, les autres avec fureur, des rapports nouveaux, spontanés, s’installent entre ces gens, comme à chaque fois dans des situations de brouhaha inhabituel, trains en grève, vol annulé dans un aéroport et tutti quanti.
Ça me plaisait bien.
Mais le narrateur devait y rencontrer une dame. C'était mon projet. J'ai fait une longue, très longue, trop longue introduction, avec grand plaisir. J'ai planté le décor, j'ai dit la mer, l'île et le vent, retardant toujours, avec mes détails, le moment où la dame entrerait en scène...
Puis il a bien fallu.
Elle est comment la dame ? Qu’est-ce qu’elle fait là ? Qu’est-ce qu’elle dit ? Quel âge a-t-elle ? Qu’est-ce qu’il y a d’exceptionnel à rencontrer une dame et qui mérite d’être raconté, mis sur la place publique ?
Silence complet. Blocage. Panne.Tarissement soudain de la fontaine clavier.
Un seule solution, la touche suppr.
Et ce sera un homme avec qui il entrera en commerce, mon narrateur.
Oui.
Il y a vraiment un problème.
Dans Le Silence des chrysanthèmes, j’avais pourtant fait beaucoup parler ma mère.
Aie, ai, aie…Ça sent le roussi. Les psychanalystes, toujours en promotion en tête de gondole, ne manqueront pas de voir là - Mais c'est bien sûr ! - comme un Oedipe mal assumé.
Il n’y a pas plus rigolo qu’un imbécile qui se pique de psychologie profonde.
Il a, sinon la solution, du moins l’explication de tous les problèmes.
Illustration : Feuillets du manuscrit " Madame Bovary"
12:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.12.2010
Fin sans guère de suite
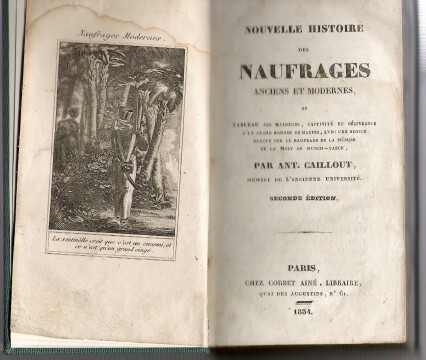 Avec la fin de Non de non, s’achève aujourd’hui ma troisième expérience d’un blog collectif.
Avec la fin de Non de non, s’achève aujourd’hui ma troisième expérience d’un blog collectif.
Sans doute aussi la dernière car les trois navires ont prématurément sombré. Pour des raisons diverses.
Mais peut-être ce genre d’entreprise est-il voué à l’éphémère et que son essentiel réside justement là-dedans.
C’est ce qu’on appelle une réflexion empirique, a posteriori : Si les faits disent le contraire, suffit de modifier les faits.
La première de ces expériences date de février 2009, sur l’initiative de Marc Villemain, que je salue bien amicalement au passage.
Les sept mains. Il y avait là, outre Marc et moi-même, Claire Le Cam, Jean-Claude Lalumière - pas encore envoyé sur Le Front russe - Emmanuelle Urien, Fabrice Lardreau et Stéphane Beau.
Les sept mains jetèrent l’ancre six mois après, chacun étant appelé sur d’autres priorités et, surtout, il était inscrit sur son bulletin de naissance que ce blog serait de courte vie. Parole tenue.
Ce furent de joyeux moments, pleins d’échanges et d’amitiés tant que je fomentai de prolonger l’expérience. Je proposai alors Tempête dans un encrier . Stéphane et Emmanuelle acceptèrent. Aglaé Vadet, Thomas Vinau et Manu Causse nous rejoignirent et c’était reparti pour un tour.
Là, je fus seul à la barre et je ne m’en plains nullement. C’était gratifiant.
La tempête annoncée fut cependant déroutée par un anticyclone imprévu et s'avéra n'être bientôt qu'à peine un ouragan, audience plus médiocre, en dépit d’une réelle qualité des textes. On s’est un peu marré et on s’est vite lassé…C’est comme ça.
Les bouteilles à la mer, c’est bien, mais c’est quand même mieux quand il y a quelqu’un sur la plage pour ramasser les messages.
On s’est quitté bons amis…Tchao ! C’était en janvier 2010.
Stéphane Beau et moi-même ne l’entendîmes cependant pas tout à fait de cette oreille. On a la vie dure. On est des têtus, tous les deux. De mails en mails, nous mîmes au point une nouvelle formule. On était d’accord sur le ton : Révolte et indignation face au monde de cloportes et de soumission qui nous est chaque jour proposé de vivre. Large part faite aux auteurs anarchistes.
Stéphane amène avec lui Stéphane Prat, le joyeux et perspicace Manchot Epaulard, j’amène avec moi Roland Thévenet, alias Solko, parce que nous nous lisons réciproquement depuis longtemps, que nous ne sommes pas toujours d‘accord mais nous vouons cependant l’un et l’autre une belle estime.
Son blog est d’une haute tenue et ceux qui ne le lisent pas ont tout simplement tort.
Et c’est reparti….
Je note donc que Stéphane et moi, sommes ensemble depuis février 2009. Déjà un vieux couple.
Salut à toi, camarade nantais et Grognard impénitent !
Et, là aussi, le souffle peu à peu s’est épuisé.
Je n’ai, personnellement, pas été assez disponible. Stéphane a tout fait, puis il en a eu un peu marre d’avoir à peu près seul les mains dans le cambouis. Il a battu le rappel. Peu d’écho….Salut !
On se saborde. Mais on ne se noie pas. On reste ensemble. Pour quoi faire ? Rien d’apparent en continu.
C’est ça aussi la grande trouvaille du net. Des rencontres qui ont du sens et qui meurent avant les grandes morosités de l’épuisement.
Reste ses limites.
- Ses limites résident dans son immensité. On a tous un blog perso et un blog, c’est exigeant, il faut y être tous les jours, avec, tant qu’à faire, des mots qui portent.
C’est épuisant mais c'est notre plaisir et halte à la vieille dichotomie entre travail et plaisir, autant que halte à la confusion entre travail et travail salarié.
Si on a tous un blog, ça veut dire qu’on a beaucoup de lectures sur le net. On se lit, on se commente, on s’écrit en privé. On lit aussi à la maison, d’autres livres…Pour l’heure, j’en ai quatre en chantier. Quatre c'est beaucoup et je ne lis pas vite.
Ça m’a toujours amusé d'ailleurs les gens qui parlent sur le net de tous les livres qu’ils lisent. J'ai fait une fois le calcul. Il ne restait pas beaucoup de place pour faire autre chose. A peine dormir quelques heures. D’un sommeil sans coquineries, bien sûr.
- L’audience. Le net n’est pas une chambre d’écho. Ou alors il y a trop de réverb….ça sature…on n’entend pas toutes les notes. Chacun aussi cultive sa parcelle par-devers lui.
Le temps, c’est humain. La parcelle par devers-soi aussi.
C’est humain vous dis-je. Ce qui veut tout dire et rien du tout.
Souvent quand même l’impression de parler dans le vide, ou du moins entre lascars toujours du même tonneau.
Lassitude.
Je salue donc fraternellement tous ces amis et amies, des Sept mains, de Tempête dans un encrier, et en dernier, mes trois compères de Non de non…
Un grand merci pour tous ces échanges, écritures et lectures. Notre réussite réside dans la tentative. C'est comme les utopies : si on en réalise seulement un pour cent, on a déjà avancé beaucoup plus loin que tous les spécialistes de la résignation.
- Reste aussi que ces blogs sont toujours en ligne.
Comme de la matière morte ? Non de non ! Comme les messages échoués d’une volonté encore imparfaite.
Il faudra un jour inventer une archéologie du net.
12:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.12.2010
La cinquième puissance mondiale aplatie sous cinq centimètres de neige

N'importe lequel imbécile sait ça.
Comme tous les pays d'Europe centrale soumis pendant cinquante ans à la bienveillance griffue de Moscou, me direz-vous. Oui, mais la Pologne, plus que ses compagnons d'infortune collectiviste, est restée dans l’esprit de l’ouest comme l'archétype du retard, parce que les images distribuées pendant l’état de guerre - dont c’est aujourd’hui le 29ème et triste anniversaire - ces images d’un pays exsangue, sans vivres, avec d’interminables queues devant les magasins vides, dans la neige et le froid, sont restées gravées dans les mémoires.
Et les mémoires, une fois que les images leur ont bouffé les neurones, ont du mal à remettre les pendules à l’heure.
C’est comme ça que les gens sont devenus des idiots et le resteront sans doute longtemps encore. Par goût du raccourci et fainéantise cérébrale.
En octobre dernier, dans le train, je discutais avec un couple sympathique. L'homme m’a demandé soudain si je mangeais de la viande en Pologne, si je trouvais ce que je voulais dans les magasins et si ça n’était pas trop dur. J’ai eu envie de répondre que les magasins polonais en étaient au même stade de putréfaction désolante que ceux de France, c’est-à-dire regorgeant d’ignobles marchandises pour la plupart superflues, dérisoires, chimiques, frelatées, mais bon, j’ai voulu rester urbain (ça m’arrive) et j’ai répondu que bien sûr, pas de problème.
Même dans ma propre famille - parmi ceux qui ne sont pas venus ici - on m'a parfois demandé ce qu’on mangeait là et patati et patata….Hum..Hum….Ma mère, elle, quatre-vingt dix printemps bientôt, s’est inquiétée s’il y avait du beefsteak, parce que le beefsteak, c’est le signe d’un pays qui est à la hauteur. Ça ne trompe pas. C’est par le beefsteak qu’elle est sortie du néolithique et a connu jadis ses premières jouissances de la consommation démocratisée, ma mère.
Je la rassure. A quatre-vingt dix ans, on a besoin d’être rassuré sur tout. Affection et respect.
Si je vous raconte tout ça, c’est que ces jours derniers on a eu l’occasion de mesurer l’affligeant retard de la moyenâgeuse Pologne par rapport à la resplendissante et 5ème puissance mondiale !
Nous sommes sous la neige depuis le 28 novembre. Cinquante centimètres environ. Il neige tous les jours, toutes les nuits, sans relâche, il gèle fort, on a déja atteint les -23 degrés. Les petites routes sont des rubans bleus de glace…Et il y a de grandes chances pour que tout ça ne dégèle qu’en mars…Plus de trois mois et demi d’intempéries continentales et blanches.
De vieux engins, orange, s’affairent à déblayer chaque jour et les talus des routes deviennent des collines de neige. Les petites collectivités territoriales engloutissent chaque hiver un budget pharamineux pour le déblaiement des routes, un budget à faire pâlir n'importe lequel maire rural de France. Une piscine peut-être. Ou une salle des fêtes.
Tout le monde roule. Les voitures, les camions, les trains et les autobus. Jagoda ne manque pas un jour d’école. Nous faisons soixante kilomètres par jour, dont vingt en pleine forêt.
C’est l’hiver. Point.
Et j’entends là-bas, la région parisienne bloquée, les pouvoirs publics qui s’invectivent, cet imbécile et lamentable Fillon qui s’en prend à la météo, un ministre qui a fait une trouvaille géniale : C’est surtout sur les routes inclinées que ça pose problème…Quelle idée aussi, ces cons des Ponts et Chaussées d'aller faire des routes inclinées !
Et Sarkozy qui s’en mêle avec sa petite voix de corneille aux nombreuses entorses grammaticales. Une cacophonie d'impérities désastreuses ! Grotesque, tout ça. Vu d’ici, honteux…
La cinquième puissance mondiale, avec son avion présidentiel doté de chambres - on ne sait jamais à quel moment elles peuvent surgir, les pulsions de la libido !- connexion internet, salle de bain et tout et tout, qui crie au loup parce qu’il a neigé ! En hiver, en plus !
La Pologne en retard ? En retard sur la bêtise ? Oui, un peu.
Les Polonais haussent les épaules. Ils ne sont pas mal élevés, contrairement à ce que bavait ce voleur de Chirac. La preuve, ils haussent les épaules, simplement. Ils pourraient se montrer beaucoup plus insidieux et goguenards.
Ils aiment la France comme on aime une grande sœur… Peut-être même qu’ils la plaignent, in petto.
Et moi qui vis avec eux, je me demande ce que mon pays a fait au monde pour être tombé sous la férule de ces bouffons ridicules qui le déshonorent à chaque fois qu’ils ouvrent la gueule ou, pire, qu'ils prennent une décision.
C’était mon coup de gueule du lundi.
Demain, nous en reviendrons à la littérature.
Française bien sûr.
Un truc qui ne les intéresse pas. Et c'est mieux comme ça, en fait.
12:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.12.2010
Propos délirants du début 2007 et d'un réactionnaire en écriture
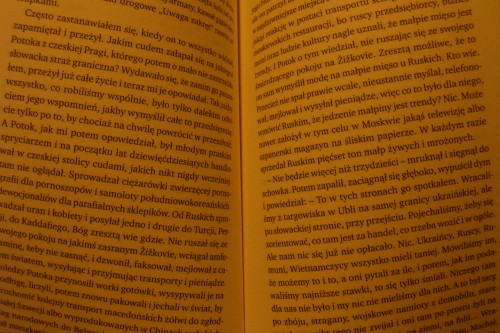 Ils ont dit que le monde avait changé mais ça n’a pas beaucoup de sens parce que quand on dit que le monde a changé c’est qu’on dit qu’il faut faire autre chose très vite pour vivre sinon « dans » du moins « avec » ce monde et qu’on est déjà foutrement en retard, qu’on est en train de courir après un train qu’on n'avait pas vu passer ou qui n'était pas à l’heure, ou alors à celle d’hiver alors qu’on était en avril, ou bien qui allait trop vite, ce train.
Ils ont dit que le monde avait changé mais ça n’a pas beaucoup de sens parce que quand on dit que le monde a changé c’est qu’on dit qu’il faut faire autre chose très vite pour vivre sinon « dans » du moins « avec » ce monde et qu’on est déjà foutrement en retard, qu’on est en train de courir après un train qu’on n'avait pas vu passer ou qui n'était pas à l’heure, ou alors à celle d’hiver alors qu’on était en avril, ou bien qui allait trop vite, ce train.Je veux dire que la manière de penser le monde était sclérosée tandis que le monde, concept effrayant tant c’est métaphysique, il mouvait, lui.
Toujours au profit des mêmes, mais il bougeait.
On peut aller loin comme ça, c’est-à-dire à peu près nulle part. En tout cas jamais où on avait prévu d’aller mais où le monde veut aller, dans une logique étrangement autonome. On l’accompagne en quelque sorte comme un cavalier qui ne maîtriserait pas son cheval. Si je veux dire un monde que je ne vois pas bouger, quoi écrire qui puisse être compris et lu avec plaisir par ceux qui ont couru avant moi, qui ont déjà sauté dans le wagon alors que je m’essouffle, moi encore, à courir sur le ballast et en agitant les bras pour signifier qu’ils ont oublié un voyageur qui voulait bien faire le tour du problème avec eux ?
Ça m’étonne toujours, moi, que le monde change de rue sans prévenir les hommes.
Je me dis depuis que je suis tout petit que les hommes doivent bien y être pour quelque chose tout de même, comme quand j’étais môme et que mon voisin se lamentait qu’on allait saigner son cheval à l’abattoir parce que maintenant c’étaient des tracteurs qu’il fallait pour semer du pain et si on voulait rester un paysan comme l’avaient été son père et son grand-père et tous les autres avant lui.
Comme aussi les mineurs de Longwy, un beau matin on leur a dit de circuler, qu’il n’y avait plus de place dans le monde qui avait changé pour leurs pioches et leurs sales gueules noires et hop, à la rue, vidés, bons à rien, vos maisons vos femmes et vos enfants démerdez-vous, nous on s’en fout on s’en va dans le monde. Les Lantier et autres Maheu se sont bien extirpés de leur trou, ont tapé du poing et lancé des pierres contre les changeurs du monde, mais rien n’y a fait.
Un monde qui change c’est comme un rouleau compresseur et c’est toujours plus fort que les gens qu’il tue. Evidemment.
C’est cruel un monde qui va son p’tit bonhomme de chemin sans demander leur avis aux hommes.
Ou alors c’est qu’on est déjà morts et on ne voit rien venir. Ça serait normal pour des morts de ne rien voir qui bouge, mais nous qui mangeons des bonnes recettes de viande en sauce ou des poissons frits extirpés de la mer océane, nous qui pensons des trucs, buvons du vin, nous promenons dans les sous-bois et les chemins que les ornières de décembre ravinent, jouons au ballon avec les enfants, on n’est pas morts, tout de même.
Ou alors c'est qu'on naît mort.
Ça n'est pas compliqué : quand on ne voit pas tout c’est qu’on est sot comme un âne ou mort. On n'est rien de tout ça à ce que nous prétendons. Alors il faut comprendre que nous comprenons le monde d’abord avec les satisfactions du ventre et que la tête suit, mais après, en décalage, un peu comme ces étoiles d’été, couchés qu’on est après dîner sur l’herbe où naviguent des aoûtats et qu’on contemple là haut des lumières qui sont mortes depuis trois mille ans ! Faut surtout pas essayer de remonter la lumière. On n'est pas équipés pour ça dans nos têtes et ça donnerait des vertiges tels que nos vies en sombreraient assurément dans la folie. Et puis qu’elle soit morte ou vivante cette lumière, elle n’en garde pas moins son bel éclat mystérieux.
Ne nous agaçons pas de réalité !
C’est pas un grand livre mais la réflexion est bien aiguisée.
J’ai lu quelques pages de ceux qui galopent jusqu’à la source des rayons lumineux, ceux qui ont vu aussi qu’un nouveau train était né et qui allait vite et qu’il fallait se dépêcher de grimper dedans si on voulait continuer à faire des pages qui tiennent la route.
J’étais en train de rêvasser comme un couillon avec Maupassant et Stendhal et les autres que vous connaissez aussi bien que moi, mieux sans doute. Enfin, autrement. Un peu de Giono aussi. Je voulais chanter comme eux, pas aussi bien évidemment, mais chanter avec leurs partitions. Des vieux trains à vapeur tout ça, tout propres, trop brillants pour circuler dans un monde poussiéreux, des trains avec des phrases et des virgules partout, qui coupent la conversation et des paragraphes aussi pour bien caler la pensée descriptive. Des points itou pour reprendre son souffle et le temps de digérer l’immédiat posé en amont. Parfois, vicieux, malin comme une belette, un passé conditionnel deuxième forme, pas facilement dissociable d’avec un imparfait du subjonctif, c’est vrai, mais qu’importe, on s’en fout du coup de pinceau, pourvu que la toile soit belle.
Ces vieux trains-là, c’était la préhistoire du déplacement.
Ils ont eu leur glorieuse utilité et ont transporté des hommes bien loin, cheveux aux vents par la fenêtre qu’on pouvait encore ouvrir à condition de ne pas passer sa tête au dehors au risque de la perdre et ils étaient si paisibles ces trains que les vaches s’arrêtaient de brouter pour les regarder passer.
Mais i sont foutus.
Toujours aussi beaux mais sur des voies de garage où batifole le chardon entre les rails et ils ont encore, c’est bien, beaucoup de visiteurs pour venir caresser leur vieille échine. On se promène là-dedans et on discute avec Sorel ou Rastignac, des fois dans un wagon un peu plus moderne avec Bardamu. Toujours quelque chose à raconter, des amours, des crimes, des avarices, des parties de chasse ou de jambes en l’air - plutôt suggérées celles-ci - des complots, des belles femmes, des arrivistes, mais surtout en prenant son temps de dire, en digressant à l’envi, en musardant sur la syntaxe et le verbe, où et comment ça s’est passé, la saison, la couleur des nuages, l’histoire des aïeux de celui qui a trahi ou qui a été trahi, voire qui est mort.
C’est ça qui les a essoufflés, ces gars là, et c’est là que le foutu monde a changé sans le dire, en catimini.
Le monde a filé à l’anglaise, à la française disent les Anglais, mais ne chipotons pas sur les gamineries vexatoires, le monde a glissé entre nos gros doigts.
Plus d’histoire à dormir debout. Avec des oiseaux qui pépient là, dans les lauriers en fleurs. Qu’est-ce qu’on s’en fout des oiseaux et des lauriers en fleurs à l’heure qu’il est ! Est-ce que ça ajoute quelque chose à l’histoire dont on est déjà rassasié ? Plus d’histoire ! Ou alors racontée vite fait, brossée à l’essentiel avec des mots rapides et bien aiguisés comme des lames qui peuvent couper des deux côtés.
Si on veut plaire à tout le monde il ne faut séduire personne.
Avec des fautes si possible, parce que l’orthographe ça entrave le libre cours de la pensée poétique, les mots sont parfois des murs infranchissables tant ils sont lourds de lettres inutiles, muettes, des ph aux éléphants, par exemple, quelle ringardise scolaire !
Le verbe à l’infinitif, pathétiquement seul entre deux points, ça c’est une trouvaille, le point d’orgue d’une pensée trop riche pour ne pas être mystérieuse. Là, la lecture s’affole, tâche de saisir au vol une émotion sublime qui lui échapperait. Le fond de l’art est frais. Ça me donne des frissons parce que je suis un gars qui suit pas bien le fil et que j’arrive pas toujours à saisir la douleur, la peine, l’espoir, l’angoisse ou la jubilation de celui ou de celle qui essaie de me parler comme ça. J
Je ne critique pas, je n’en ai ni l’envie ni le goût ni la compétence. Je discute. Je dis comme il faut penser vite et bien dans ce désordre impeccablement construit et que j’ai du mal.
Ça n'est pas de la critique : Un gars qui se noie il appelle au secours, il ne remet pas forcément l’existence de l’eau en cause.
Je n'aime pas le cinéma. Je n'aime pas lire sur un fond musical incitatif qui n’existe pas dans mes situations directement vécues, avec une émotion qui a un visage et qu’il faudrait que je m’approprie tout ça sur mon siège, avec un gars qui tousse à côté de moi . C’est vieux ce que je raconte là mais c’est comme ça qu’ont commencé à mourir les vrais raconteurs. J’ai connu un tas de gars qui n’ont jamais voulu lire Octave Mirbeau parce qu’ils avaient vu le journal d’une femme de chambre et d’autres qui n’ont jamais ouvert Darien pour avoir regardé Louis Malle.
Les raconteurs ont essayé de suivre un moment le train en causant comme des images mais ils n’y sont pas arrivés parce que des images il y en a beaucoup et elles défilent trop vite. Une plume ou des doigts sur un clavier ça peut pas créer l’illusion fugace d’une image ou alors il faut être sacrément véloce et qu’un seul mot puisse en signifier en même temps trois cent au moins.
Ben alors, qu’est ce que ça te fout de pas tout saisir dans un texte ? Mets y ce que tu veux. Ben oui, mais je n'ai pas besoin de lire pour ça. Ou plutôt, l’autre n'a pas besoin de m’écrire…Pourquoi me décrire une vision du monde aussi sensible et intelligente soit-elle si j’ai la mienne et que je ne décrypte pas la sienne ? Un train, c’est fait pour que des voyageurs montent à l’intérieur et c’est un peu comme en musique un accord inlassablement répété ça peut être une source d’une vive émotion pour celui qui joue parce qu’en même temps il y a des images et des souvenirs ou des espérances qui défilent dans sa tête, visibles que de lui-même. Mais celui qui écoute ?
Si j’veux construire un monde illusoirement à moi tout seul, j’vais à la pêche dans le Bug et je mets ce que je veux dans ces remous frontaliers aux couleurs qui changent tout le temps et où s’agitent des gros poissons blancs que capturent les moines orthodoxes.
Ceci dit en passant, ils m’ont invité une fois à en goûter, les moines, de leurs poissons, parce que j’étais là à rêver le cul par terre et que je me disais qu’il suffisait d’un remous de rivière pour séparer des mondes et déclarer des guerres. Un régal, n’eût été leurs marmonnements métaphysiques à l’heure du déjeuner que j’eusse, oui, j’eusse, j’use du j’eusse à ma guise parce qu’il s’impose à moi comme un outil qui est là à sa place pour dire ce que je dis, j’eusse donc collationné avec un plaisir décuplé.
Voilà bien une phrase qui est inquiétante parce que ça manque de coupures et de virgules et on dirait bien, plus haut là-bas, que ce sont les poissons qui ont marmonné des métaphysiques. En fait les incorrections de la syntaxe, de la construction et le déficit de ponctuation, c’est des anacoluthes, comme Baudelaire avec son albatros exilé sur le sol au milieu des huées avec des ailes de géant qui l’empêchent de marcher, cité par tous les théoriciens coupeurs de poils de cul en quatre de la métalangue.
C’est ça que j’essaie de dire.
J’ai essayé de voyager dans des pays littéraires avec des vieux trains qui roulaient au charbon et en construisant une histoire qui commençait par renseigner qu’il pleuvait ce matin-là ou qu’on était au mois de janvier et que Pierre ou Paul étaient des cordonniers ou des instituteurs. Pour un peu j’aurais poussé la niaiserie à les commencer par il était une fois, mes histoires qui avaient une chronologie linéaire et qui s’inscrivaient dans le temps qui passe, temps qu’on croyait qu’il était comme une flèche, un trait, disons un vecteur orienté toujours dans la même direction. On croit ça encore parce qu’on se voit vieillir à coups d’hiers d’aujourd’huis de demains et surtout de peurs ; Mais on sait maintenant, enfin on croit savoir, que le temps et l’espace c’est pas comme ça du tout et si on va en avant on peut aller aussi en arrière et même que ça n’est plus stupéfiant du tout de considérer qu’un corps peut être à deux endroits différents à la fois, avec un don d’ubiquité donc si j’exagère un peu, qu’un corps puisse s’emparer de ses rêves et superposer son réel et les disposer comme des sédiments de la mémoire.
Le passé et le présent, le futur un peu moins, ne sont pas si opposables l’un à l’autre qu’ils en ont eu l’air.
Alors si on veut vraiment raconter une histoire, car quoi raconter sinon une histoire même si c’est une histoire qui n’existe que par une vision fulgurante contraignante et désordonnée du monde, un roman, tranchons le mot qui rebute tant les abonnés du TGV remonteurs de lumière, il faut aussi qu’elle soit dans cet esprit-là et non tout imprégnée des erreurs du passé qui ne comprenaient de la fuite du temps qu’une expérience unilatérale et dirigée dans le même sens, celui de l’angoisse du saut final. Je trouve qu’un roman qui ne suit pas la chronologie est un roman qui colle à la chair dont il est fait. Comme un poulet de grain. Nos émotions, nos peurs, nos joies, nos désirs racontables comme indicibles, n’ont pas non plus à être subordonnés au présent. Il arrive qu’on soit dans le sens des aiguilles de la montre, mais il arrive seulement et des fois ce que nous ressentons de profondément vrai en cet inconnu qui nous habite, et que nous considérons comme digne d’être transmis, est un volcan à l’irruption actuelle mais aux racines tellement anciennes, alternant tour à tour leurs places dans l’instant, s’éloignant, revenant, se mariant pour faire un présentement vécu.
Je tâchais - j’ai bien dit je tâchais - donc d’écrire un peu comme mes glorieux modèles parce que je trouve ça beau. J’aurais tout de même dû considérer que ce qui était beau à la fin du 19ème et au début du 20ème reste bien entendu beau mais ne peut pas prétendre dire notre ère et en flatter l’esprit.
Pourtant j’ai toujours été un moderne. Je ne l’ai jamais trouvé ni beau ni humain le monde qu’on nous proposait et j’ai grillé une bonne partie de ma vie à gueuler qu’il fallait le changer, en agissant dans ce sens-là aussi, ce qui comporte de gros risques, et en refusant de faire longtemps le même métier et en traînant dans tous les milieux, des couloirs jaunes de la fac aux fréquentations les plus interlopes de la violence et de la nuit et jusqu'aux verrous crasseux de la force républicaine.
C’est quand même désolant de passer sa vie à vouloir changer le monde et que ça soit les autres qui vous disent : eh, coco, oh, oh, le monde a changé !
C’est comme ça.
Et je suis bien content qu’on m’ait alerté parce que j’allais continuer avec mes histoires à la noix de coco, en automne dans le marais poitevin ou je n’sais où avec des frênes qui tremblent dans des brouillards et des corneilles qui picorent les labours, et mes souvenirs fantasmés ou réels dont à juste titre personne n’a cure. Y’a un copain en France, un écrivain, tiens, je peux bien vous dire son nom après tout, on est pas là pour se faire des cachotteries et il ne m’en voudra pas, Denis qu’il s’appelle et on s’est tenus bras dessus bras dessous vingt-cinq ans durant avant que je ne quitte la France et il m’écrivait un jour que les ateliers d’écriture étaient bourrés de gens qui voulaient écrire mais qui ne lisaient jamais. Tout pour ma gueule, c’est la morale des temps modernes, qu’il a conclu Denis !
Pour écrire des choses c’est vrai que y’a pas besoin d’avoir lu des bibliothèques entières mais quand même là comme partout ailleurs y’a un minimum de complicité qui s’appelle l’échange. Il a raison Denis. Tout pour ma gueule. Ecoute ce que j’ai à raconter. On discutera après si on a le temps.
Ça doit être le changement de monde. Pourtant Denis, je sais qu’il est ponctuel et il n'aime pas louper son train mais celui-là va peut-être plus vite que ses yeux. En tout cas il n'a pas aimé et moi j’ai aimé qu’il me fasse part de son cruel sentiment.
Qu’il ne s’inquiète pas, Denis, ateliers ou pas, même dans les blogosphères du changement de monde c’est tout pour ma gueule. J’ai écrit un tas de textes là-dedans et j’en ai lu beaucoup, beaucoup, ponctuant ça et là mon passage d’un petit commentaire. Y’en a là qui écrivent, écrivent, noircissent du blog à qui mieux mieux, des logorrhées de considérations parmi lesquelles des choses bien, et qui jamais, jamais ne viennent foutre un coup de clic pour savoir ce qu’écrit le voisin. J’ai fait l’expérience. Du m’as-tu-vu dans mon joli blog et si tu viens à étouffer dans le tien tu peux crier au secours là-dedans personne ne viendra t’entendre.
Du changement de monde ça ? Allons, allons je n’y vois là que les vieux sentiments qui régissent la nuit des temps.
Tout pour ma gueule.
Non. En vérité, le monde n’a pas changé parce son propre justement c’est de changer tout le temps. Le monde changerait s’il s’immobilisait tout à coup et c’est nous, décalés, qui réclamons plus d’inertie et la question qui obsède en cet instant le clavier sur lequel je m’excite bêtement est de savoir si j’ai envie, si je sais, ou si je suis capable de l’accompagner plutôt que de rester à rêvasser à mon obsolète convenance, car quand même par-delà le plaisir d’une écriture il y a aussi ce qu’on veut de son devenir. Est-ce que la façon dont on écrit est subordonnée aux virtualités changeantes d’un monde que l’on comprend et avec lequel on fait corps ou est-ce que cette façon de dire les choses est une manière de survivre en dépit des manières lunatiques de ce monde ? La liberté totale s’impose là comme partout du moment que celle des autres n’en est point altérée : que chacun chante comme il le veut et que chacun écoute ce qu’il lui plaira d’écouter.
STOP !
Ça, ça n’est bougrement pas vrai parce que l’écriture est une marchandise, délicieuse j’en conviens, mais une marchandise et vous me pardonnerez - ou non peu importe - ces notions marxistes lycéennes éculées, une marchandise où la valeur d’échange a supplanté depuis belle lurette la valeur d’usage avec la bénédiction onctueuse de quatre-vingt dix-neuf pour cent des éditeurs, des distributeurs, des libraires et in fine des écrivains et en dépit de quelques-uns parmi les meilleurs qui ont organisé la résistance et ont pris le maquis en se servant intelligemment des outils de ce qu’il convient d’appeler l’adversaire médiatique.
La plupart des écrits marchands ne sont pas des écrits du cœur mais bien du cul, ce dernier même très discret.,mais un cul discret reste un cul. Je veux dire des trucs bien mis en évidence pour que le monde marchand puisse y rentrer à son aise et y faire son marché, une écriture prostituée à une demande vaguement sociale puisque fabriquée, mais même la prostitution peut s’exercer avec talent et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne digresse point car seulement la moitié de ma susdite revendication selon laquelle tu écris comme tu veux et je lirai comme j’ai envie est juste puisque côté lecteurs, il y en a encore beaucoup, mais peut-être n’ai-je connu aimé et fréquenté que des ringards, qui ne peuvent pas rentrer dans les nouvelles modalités de l’écriture du monde. Le côté lecteur est donc bien obligé de lire ce qui est publié de littérature s’il ne veut pas sombrer dans l’archaïsme comme moi ou pire encore, si, si, mais je crois qu’il est armé pour cela, dans les romans à quatre sous, de la cervelle de grimauds et grimaudes servie comme du foie gras.
A ce propos, j’avais beaucoup aimé la réponse que fit François Bon à un de ses visiteurs du Tiers Livre qui contestait à Tumulte sa qualité de roman, mais que si bien sûr avait dit l’écrivain parce que justement il ne fallait pas se laisser déposséder du concept roman en le laissant à l’exclusivité des faiseurs de trois cent cinquante pages d’une vague histoire de cul où s’agitent deux ou trois personnages. J’ai cité de mémoire bien sûr, juste pour illustrer d’un trait la réalité des rayons de librairies. Ils sont tellement mazoutés par une marée de parutions intellectuellement obscènes mais aux quatrièmes de couvertures alléchantes et au bourrage de crâne tellement assommant qu’il faut, si l’on aime lire encore et qu’on n'est pas bien renseignés, soit qu’on n'a pas le temps ou soit que, bien que grand lecteur, on ne suive pas les circonvolutions du petit monde littéraire et de ses enjeux, qu’il faut, disais-je, être vigilant sur ce qui est proposé…
Ou alors - et c’est ce qui se passe le plus souvent - on en revient aux valeurs sûres, aux vieux trains qui ont vu du pays et qui ne décevront pas. C’est que le jeu est inégal et j’affirme tout de même qu’écrire abscons à tout prix parce que le monde serait abscons, hé bien ça n'est pas gentil pour une foule de lecteurs parce que ce qu’ils aiment lire, archaïque certes mais de qualité, ne verra plus le jour que dans des manuscrits passés sous le manteau.
Il va sans dire, mais je le dis quand même, que mon propos élimine d’emblée la pédanterie de ceux qui croient qu’ils aiment tels ou tels livres parce qu’il sont sortis d’un milieu qui a la réputation de faire de belles œuvres hors champ d’application de la pollution exclusivement marchande ou qui disent détester, parfois dans les deux cas sans avoir lu, tels autres parce qu’ils sont des narrations stricto sensu ou qu’ils ont été publiés par des éditeurs à la réputation douteuse. Le bon goût est plus exigeant et plus compliqué et ça ne marche pas comme le tri sélectif des déchets du développement durable et il arrive que la littérature au sens noble produise de véritables merdes et qu’un diamant s’égare par inadvertance ou ignorance dans une poubelle.
C’est rare mais ça peut arriver.
A propos d‘archaïsme je m’arrête une seconde sur Brassens qui reste un de mes poètes de prédilection boudé par une bonne partie des muscadins de la poésie parce qu’il était un chanteur alors que justement l’astuce était de faire passer la poésie sur le mode populaire afin que le plus grand nombre y ait accès. Un internet avec des moustaches et une guitare. C’est un poncif mais sans Brassens Villon serait resté inconnu de beaucoup plus de gens qu’il ne l’est en vérité même si un seul poème ne suffit pas à qualifier une rencontre avec une œuvre, j’en conviens. A un journaliste qui lui disait donc qu’on le taxait en coulisses de passéiste il répondit d’abord en forme de syllepse qu’il n’aimait pas le mot avant de préciser : avec ce hiatus au milieu. A un autre qui formulait à peu près la même critique un peu plus littéraire puisqu’il s’agissait cette fois d’archaïsme il dit que oui bien sûr mais que ceux qui lui reprochaient d’employer un vocabulaire suranné étaient ces mêmes qui fouillaient les brocantes à la recherche de vieilles lampes, alors tout est absolument relatif, n’est-ce-pas et écrivons comme nous le voulons chaque lecteur y reconnaîtra bien le sien, moderne, archaïque, poétique, vulgaire ou politique, un jour ou l’autre.
Mais
Confronté à cette incapacité à comprendre totalement les nouvelles formes autant qu’à les écrire, nouvelles formes qui pourtant j’en suis certain sauveront un moment l’écriture et la littérature du naufrage de leur époque, mais seulement de leur époque qui n’est point éternelle et dont les choix ne sauraient être universels , parce qu’elles sont en harmonie avec des hommes virtualisés et de plus en plus complexes et surtout parce qu’elles détournent intelligemment vers l’intérieur poétique les abstractions matérielles de l’empire exclusivement marchand, il ne faut pas le perdre de vue un seul instant même si de faux puristes écervelés revenus de tout sans avoir jamais mis les pieds nulle part trouvent que ça fait ceci ou que ça fait cela. Je fais donc mienne l’observation publiée chez Corti selon laquelle l’écrivain sachant qu’il n’a plus aucun enjeu médiatique à attendre de son travail peut enfin se consacrer à l’absolu intime de son écriture. J’en suis et je remercie ce Georges Picard de l’avoir énoncé avec force. Sans enjeu la littérature redevient un art à part entière, une activité plus humaine et plus haute que toute autre puisque débarrassée des préoccupations de la reconnaissance immédiate et éphémère du plus grand nombre.
Elle est là, la résistance des écrivains, écrire en dépit des créneaux des éditeurs à l’affût des coups juteux, des faux libraires en carton bouilli et des monopoles de la distribution cybernétisée à outrance. Ecrire pour entrer en guerre contre ceux qui tirent les ficelles et les cordons des bourses, même dans notre propre camp où ils sont nombreux et avancent masqués. Le pouvoir doit changer de mains, de l’absolu du marketing glisser à la relativité de la plume, et je suis certain que les écrivains, ceux dont la seule ambition est l’écriture, sortiront vainqueurs de la confrontation même si beaucoup, dont je suis sans doute, y mourront en soldats inconnus, sans même avoir vu le point du jour.
Mais l’enjeu est de gigantesque taille. Nous verrons bien car, reprenant ce que je disais au tout début de ces intempestives cogitations, le monde est un concept métaphysique, un fourre-tout du flou, un prétexte bâtard et exempt de toute intelligence concrète.
Le monde n’est rien sans les hommes et les hommes, jusqu’à preuve d’un contraire fort hypothétique, c’est quand même nous.
Points. De suspension bien sûr.
12:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.12.2010
Douze cordes
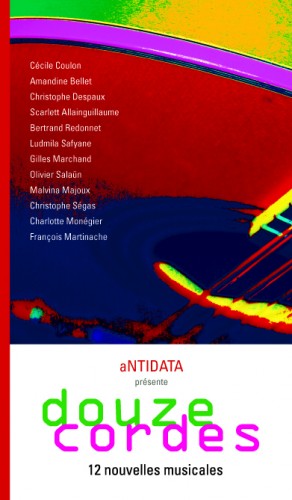
Les éditions aNTIDATA viennent de publier un recueil de 12 récits thématiques sur la musique, auquel j'ai participé à hauteur d'un : La Faucheuse n'aimerait pas les aubades ?
Les auteurs : Cécile Coulon, Amandine Bellet, Christophe Despaux, Scarlett Allainguillaume, Ludmila Safyane, Gilles Marchand, Olivier Salaün, Malvina Majoux, Christophe Ségas, Charlotte Monégier et François Martinache
L'an passé j'avais publié une nouvelle, La souricière, dans un autre recueil, Capharnahome.
Bonne lecture à tous et à toutes, donc, si le coeur vous en dit....
11:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.12.2010
A la tienne, Etienne !
 Boire. Ecluser. Téter. Siffler. Chaner. Picoler. Tisser. S’en mettre entre le nez et le menton. Caresser la bouteille. Trinquer...
Boire. Ecluser. Téter. Siffler. Chaner. Picoler. Tisser. S’en mettre entre le nez et le menton. Caresser la bouteille. Trinquer...
Le langage ne manque pas de ressources pour qualifier la passion de boire, toutes plus allégoriques les unes que les autres.
Je les ai à peu près toutes essayées, sous toutes les coutures. Cinq ans et demi maintenant que je n’ai pas trempé la moindre lèvre dans le moindre élixir des illusions. Sans contrainte, juste un message à l’intérieur qui s’est imposé comme vital. Vient un moment où l’illusion est de moins en moins illusoire et de plus en plus inopérante, confrontée à la connerie humaine.
Maintenant que je peux un peu réfléchir sur le sujet, je crois que je n’ai jamais su boire, en fait. J'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas su.
Parce que je demandais à ce que les ivresses soient permanentes, et, forcément, ça ne peut que tomber dans l’ivrognerie, le principe même de l’ivresse, son immense plaisir, son génie, étant d’être éphémère, discrète, égoïste. En soi.
Elle est un basculement sensuel perché sur un équilibre très précaire. Son paroxysme est fragile comme du verre de cristal et sa frontière avec le malaise et l’incohérence intérieure ténue. Tenter de la faire perdurer, c’est la tuer dans l’œuf. Par essence.
Mais quel plaisir que ce premier verre, fin de matinée, une terrasse, des gens sur le trottoir et des solitudes multiples, ce premier verre dans lequel se diluaient toutes les incertitudes et toutes les angoisses ! Un fourmillement d’idées aussi qui apparaissaient toutes plus éloquentes les unes que les autres et comme le monde paraissait soudain paisible, sans agressivité !
A partir de ce moment-là, il eût fallu retourner à mes moutons. Redescendre. Mais c’est inhumain de fuir une colline où l’on est bien pour s’aller vautrer dans le quotidien.
Un autre, puis un autre et le prisme se renverse, le beau devient laid, pas comme des compléments nécessaires du monde, mais comme de féroces antinomies, sans modus vivendi. Trop tard. Comme quand on est malade et que plus rien ne nous plaît.
L’ivresse trahie dans ce qu’elle est fulgurante, se venge et sur le nirvana entraperçu ouvre soudain les portes d’un enfer.
Une simple erreur de calcul : L’ivresse n’est pas proportionnelle aux grammes d’alcool, mais inversement proportionnelle, jusqu’à une certaine limite que l’homme pondéré saura trouver.
Mais un homme pondéré a-t-il besoin d’ivresses ? J’en doute. Il se saoule de sa pondération. Insoluble dilemme.
Et c’est cette limite, contradictoirement, que je trouvais désastreuse. S’imposer des limites quand on ne cherche justement qu’à les faire reculer. On se mord la queue.
Les limites, je les trouvées dans l’abstinence totale. Sans effort.
Et j’ai vu que le monde laid, mesquin, il était bien plus laid et plus mesquin que je ne le pensais encore, mais cette laideur avait perdu toute son efficacité destructrice. C'est-à-dire qu'elle me concernait beaucoup moins.
Ce qui me fait sourire aujourd’hui, c’est que ceux qui critiquaient, faisaient la moue, jugeaient, qui étaient farouchement indignés par la recherche de cette ivresse-là et m’en faisaient le reproche - milieu professionnel surtout - avaient des arguments d’une telle lourdeur, d’une telle tristesse, d’une telle vulgarité, d'un tel désespoir de vivre, qu’ils ne me donnaient qu’une envie : fuir encore plus loin dans les vapeurs pour ne plus les entendre, tant ils ressemblaient à des panneaux publicitaires à la gloire de l'ennui !
Comme ça n'était pas des pervers - le pervers poursuivant le dessein inverse de son discours - ça devait être des cons, ce qui me faisait leur opposer cette maxime populaire, sans doute pas très juste parce que j'en ai vu beaucoup qui cumulaient les deux états, mais qui a quand même son charme :
Mieux vaut être saoul que con, ça dure moins longtemps.
11:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.12.2010
L’exil des mots
Texte écrit au printemps 2006 pour l'ouverture d'un premier blog " Exil volontaire", puis remis en ligne en juillet 2007 à l'ouverture de ce blog-ci.
Mon premier texte en Pologne, écrit pour le numérique.
Il est déjà une partie de mon histoire.
Il est ici un peu modifié. A peine.
*
Ce n’est point là Jersey et ce n’est point Guernesey. Et quand bien même. Ce n’est pas un Badinguet - quoique les arcanes de nos institutions en fourmillent - qui m’a conduit là, et je n’ai pas l’envergure d’Olympio.
Poétique. Parce que politiquement, ça n’a pas toujours été très reluisant.
Non.
Ici, il n’y a pas de mer et il n’y a pas d’Anglais. C’est dire comme on y est bien. Pourtant, je les aime bien, les Anglais, moi. J’en ai connu quelques uns, autfoué, et qui n'étaient pas tout à fait Américains.
En se proposant de trottiner jusqu’à l‘Oural, l’Europe musarde pour l'heure sur la berge de ce cours d’eau tumultueux. Elle prend son temps, l’Europe, et elle a peut-être raison : C’est en traversant ce fleuve que le conquérant au bicorne et à l’ulcère à l’estomac a débuté son enlisement.
Enfin, c’est une cruelle métonymie que je dis là. Je veux parler de l’enlisement et de la mort de quatre cent mille pauvres bougres, soldats de toutes nations.
J’aime venir rêvasser sur ces berges.
Le printemps continental pointe son nez et je n’y suis pas venu de tout l’hiver. Difficile de rêvasser, même pour un rêveur, quand l'air qu'on respire est à moins trente deux. Je n’avais jamais vu un thermomètre avec un moral aussi bas. Une vraie dépression, toute livide, avec des larmes de glace qui dégoulinaient sur d'invisibles visages.
Plus loin, là bas, dans l’autre pays, celui qui n'aime pas qu'on dise son nom, je vois une ville qui résonne comme si elle était bretonne et que des embruns salés venaient fouailler ses remparts. C'est une forteresse. Brest. Avant, c’était Brest de Lituanie, Brest litovsk. La ville au traité honteux, selon le rusé Oulianov qui s'y fit rouler par plus rusé que lui.
Cette forteresse-là a connu des tempêtes bien plus dévastatrices et humiliantes que celles qui font rage à la pointe du Raz. Ballottée d’une carte d’identité à l’autre, sans même prendre le temps de la lire jusqu’au bout. Polonaise un peu lituanienne, puis Russe, puis Allemande, puis à nouveau Polonaise à part entière, puis encore Russe, puis Allemande une nouvelle fois, puis Soviétique, puis…puis plus de Soviétiques, alors Russe, finalement, mais blanche.
La forêt me cache la steppe mais je la sais se dérouler derrière, tout près, sous la course du vent. Mes pieds sont bien là, sur un tapis d’herbes jaunies par trois mois de neige, mais mes yeux voient presque jusqu’à Moscou.
Il y a un vieil homme.
Il pêche. Il s’en fout des steppes et du vent.
Ce vieil homme, si j’en juge par le relief accidenté du visage, a feuilleté des pages effrayantes d’Histoire. Il s’en fout aussi, je crois. Je l’interroge de mes yeux de curieux. Il me sourit gentiment. C’est le seul langage que nous ayons en commun. Un sourire.
L’Histoire, elle est aujourd’hui sur ce bouchon qui frétille sous les vaguelettes et qu’il ne quitte des yeux que pour me sourire. Son peuple a été trahi, vendu, écartelé mille fois, son jardin a été dévasté par des ogres aux dents ruisselantes de sang et il me sourit, à moi l’étranger.
C’est vraiment un homme.
Je suis venu jusqu’à cette frontière. Sans dictionnaire. Seulement avec ma guitare, des partitions de Brassens et des feuillets de manuscrit chiffonnés et jamais publiés.
Je ne comprends pas un mot de mon exil. Alors ils prennent toute leur signification musicale, les mots. Ils sont faits pour être entendus et devinés. Je ferme les yeux et j’entends des gens qui disent des choses intéressantes. Ils échangent des idées et des émotions, même à l’épicerie de mon quartier. C’est splendide de voir ces hommes et ces femmes qui fabriquent des mots qui ne veulent pas causer à mes oreilles. Pourtant, je suis sûr qu’ils voient le même monde que moi. Ils en parlent autrement.
Je me sens seul. Mais ça n’est pas douloureux. Au contraire. Quand j’étais chez moi, les pieds dans l’Océan, je savais lire la musique des mots et je me sentais seul quand même, de plus en plus seul. Parce que lorsqu’on connaît trop la musique on finit par ne plus écouter les paroles.
L'exil des mots n'a pas de frontière. Il suffit souvent d'un ciel de lit pour qu'ils ne soient plus chez eux et contraints à l'exode.
Et tu as raison de les aimer, les mots, Poète. Ils sont tous à toi, même ceux que tu ne connais pas. C’est en continuant de les chanter que tu feras sourire les vieillards à la pêche et empêcheras que les villes soient meurtries, d’un char à l’autre.
Si, des fois, furtivement, j’essuie une vieille larme, elle ne prend sa source qu’au désespoir de cette naïve espérance.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.12.2010
Vases communicants : Feuilly sur L'Exil
Me voilà donc invité sur l’Exil, site que je connais bien pour le fréquenter tous les jours. Par certains côtés, je ne suis donc pas trop dépaysé, même si pour une fois c’est moi qui tiens la plume. Mais d’un autre côté, je me retrouve en Pologne et là, c’est plus compliqué. Je ne connais rien à la Pologne, moi ! Heureusement, il y a toujours les livres… Ceux-ci sont toujours d’un grand secours quand il faut nous tirer d’embarras. Alors, puisque Bertrand a quitté la douce France (oui, c’était avant l’ère Sarkozy…) pour se transformer ici, bien loin de sa patrie, en écrivain français, je vais lui parler d’un Polonais qui, lui, s’est mis à écrire en français après avoir beaucoup voyagé.
Je veux parler de Potocki, l’auteur du « Manuscrit trouvé à Saragosse ».

Notons aussi qu’il a ouvert le premier salon de lecture gratuit à Varsovie, ce qui nous le rend assurément sympathique.
Mais au-delà de ses récits de voyage et de ses travaux historiques, c’est évidemment le « Manuscrit trouvé à Saragosse », écrit en français, qui l’a rendu célèbre.
L’histoire de l’édition de ce livre est déjà en soi tout un roman. Du vivant de Potocki (décédé en 1815), seules furent imprimées les Journées 1 à 13, ainsi que quelques extraits (sans nom d’auteur), soit à peine la moitié de l’œuvre. Potocki s’est suicidé avant la publication de cet ouvrage auquel il a travaillé pendant les vingt dernières années de sa vie et dont il n’aura jamais vu le livre sortir de presse. Cela laisse rêveur car tout qui écrit un tant soit peu a envie d’être lu et reconnu comme tel. Or ici, on se rend compte que l’auteur n’a fait que travailler et retravailler sans arrêt ce roman à tiroirs (où les événements s’imbriquent les uns dans les autres et où les mises en abyme sont légion) sans jamais avoir la moindre reconnaissance de sa qualité d’écrivain. C’est facile pour nous, lecteurs, de nous dire que nous lisons un livre posthume, mais encore faudrait-il se rendre compte de ce que cela implique pour l’écrivain qui a devant lui sa page blanche et sur le coin de son bureau des monceaux de feuilles manuscrites qui s’empilent. Cela ne doit pas être facile de remanier et de réécrire ainsi un manuscrit pendant une période aussi longue sans que jamais personne n’ait pu reconnaître en lui un véritable écrivain.
En fait, la première publication date de 1847. Un certain Chojecki publia en polonais à Leipzig une partie du roman, qui a donc été retraduit d’après l’original en français. En France, il faudra attendre 1958 pour que Roger Caillois publie une autre partie du roman (plus ou moins le quart). Puis, ce n’est qu’en 1989 que chez Corti sort une édition « basée sur la totalité des sources accessibles », autrement dit les imprimés, les autographes et les copies manuscrites de fragments de l’œuvre, ainsi que la traduction de Chojecki. Ce qui veut dire que pour avoir l’œuvre complète, il a fallu rassembler des morceaux épars et même retraduire du polonais au français un certain nombre de chapitres.
Personnellement, c’est cette version de chez Corti que j’ai lue.
Elle est fabuleuse.
Mais en 2006, paraît chez Peeters, une version finalement plus authentique du roman et qui laisse voir ses versions successives. Dominique Triaire, Directeur adjoint de l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'Âge classique et les Lumières (IRCL) à Montpellier, a mis plus de vingt ans (lui aussi !) pour reconstituer la genèse de l’œuvre.
A la mort de Potocki, ses papiers avaient été divisés en trois tas, puisqu’il y avait trois héritiers. Un tas a été retrouvé aux archives publiques de Poznan, en Pologne, sous le titre « Decameron ». On suppose que l’archiviste polonais avait été bien embarrassé pour inscrire dans son répertoire cette paperasserie rédigée en français. Comme le texte de Potocki est conçu par « parties » de dix journées, il lui aura donné ce nom de « Decameron » non sans humour. On se demande quand même comment Dominique Triaire a pu faire pour le retrouver. Mais bon, ce n’est pas un spécialiste pour rien… La preuve, c’est qu’après Poznan il s’est rendu à Madrid où il a découvert dans une banque une partie du manuscrit cédé par un certain Alfred Potocki (lointain descendant de notre écrivain), qui avait dû s’en séparer pour régler quelques dettes. Enfin, c’est à Moscou que notre chercheur découvrit quelques épreuves du roman (les seuls chapitres publiés du vivant de l’auteur). Avec tout cela, il a tenté de faire un tout, ce qui ne fut pas facile car ce roman, raconté sous forme de « journées », est truffé de mises en abyme (un personnage raconte une histoire en faisant parler les différents protagonistes et un de ceux-ci, à son tour, raconte une histoire, etc. )
Pour Triaire, il n’y aurait pas un seul roman mais trois ! Cela reviendrait à dire que Potocki aurait en fait écrit trois versions du même roman, une en 1794, une en 1804 (quarante-cinq journées) et une en 1810 (soixante et une journées). La version de Corti (soixante-six journées), celle que j’ai lue, serait donc fausse et tronquée puisqu’elle ne serait qu’un agrégat de différents morceaux.
Dommage, je l’aimais bien…
Reste à savoir pourquoi Potocki aurait réécrit trois fois son roman, sans le publier jamais (ou à peine quelques chapitres, encore ceux-ci ont-ils pu être édités à son insu). Sans doute voulait-il le rendre plus parfait, plus limpide. Ainsi, dans la dernière version, les histoires seraient moins enchâssées mais aussi moins libertines et moins osées (j’ai donc raison de conserver précieusement chez moi l’édition de Corti). Le texte qui est finalement sorti chez Peeters propose donc parallèlement les versions de 1804 et de 1810 (celle de 1794 n’est pas publiée car encore trop incomplète).
Tout cela laisse rêveur.
On se trouve donc devant un homme qui écrit (mais dont l’œuvre romanesque n’est pas publiée), qui retravaille son texte à l’infini, proposant chaque fois une version différente, et qui finit par se suicider avant de connaître la reconnaissance du public, du moins pour son travail de romancier. Cela nous oblige quand même à nous demander à partir de quel moment un texte littéraire peut être considéré comme fini. Jamais, sans doute, car il est toujours perfectible. Mais d’un autre côté, à toujours modifier un texte initial, on se retrouve devant une autre œuvre, l’écrivain ayant vieilli et ayant une autre manière d’aborder la réalité extérieure, laquelle, en vingt ans, a elle aussi évolué.
Un autre problème se pose : la version de 1958 est incomplète et est due à Caillois et non à Potocki. Celle de Corti est séduisante, mais là aussi elle est plus l’œuvre de l’éditeur que du romancier, qui n’a jamais imaginé publier son texte sous cette forme. Reste donc les deux versions proposées par Triaire, me direz-vous. Certes, mais fallait-il publier la version de 1804, puisque Potocki lui-même l’a retravaillée ultérieurement ? De plus, nous proposer finalement deux textes (sensiblement différents par ailleurs), c’est bien là une invention d’éditeur et de spécialiste. Jamais Potocki ne nous aurait proposé deux versions en un seul volume. Ce paradoxe a fait dire à certains qu’on éditait finalement un manuscrit introuvable puisque les différentes versions proposées dépendent plus du choix des éditeurs que de l’auteur lui-même. Qu’est-ce donc qu’un texte littéraire ? Celui que l’auteur aurait voulu (mais ici Potocki est décédé avant de mettre le point final à sa dernière version, finalement plus rigide que la précédente) ou celui que nous propose l’éditeur ?
Quoi qu’il en soi, il demeure que le Manuscrit trouvé à Saragosse reste un chef-d’œuvre. Le titre lui-même (cette histoire d’un livre qui raconte celle d’un manuscrit trouvé) suggère déjà que tout ici sera mise en abyme, comme la littérature elle-même, finalement, qui réécrit sans fin la réalité et qui se (re)copie elle-même.
Ecrit en français par un Polonais, le Manuscrit nous parle de l’Espagne, mais pas de n’importe quelle Espagne, celle des Maures, dont quelques représentants survivraient dans des grottes de la chaîne des Alpujaras. Le héros rencontre plusieurs protagonistes qui lui racontent l’histoire de leur vie. Dans cette histoire interviennent d’autres personnages qui à leur tour entament une narration, etc. Roman picaresque qui confine au fantastique, libertin à ses heures, le Manuscrit tient du roman noir et du conte philosophique, sans oublier que les histoires d’amour y ont leur place.
Bref, il représente un véritable miroir de tous les genres qui se sont écrits avant lui. Mais il offre aussi l’intérêt de refléter la complexité du monde. En effet, il se veut le reflet de différents systèmes de valeurs (religieuses, philosophiques, etc.) souvent contradictoires et parfois incompatibles. On sent qu’il a été écrit par un homme qui a beaucoup voyagé et beaucoup observé, mais un homme qui a su aussi s’enfermer pendant vingt ans avec son manuscrit en devenir pour tenter d’exprimer au mieux ce qu’il avait à dire.
Finalement, il nous a donné une œuvre qui est aussi une réflexion sur l’art de la narration et sur le genre romanesque.
08:40 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.12.2010
Consultations novembre
Opération portes ouvertes aujourd'hui, comme tous les mois depuis janvier 2010.
Une fréquentation nettement supérieure à celle des mois précédents.
1696 visiteurs uniques. 21 441 pages consultées pour 6330 visites.
Satisfaction.
Il y eut un premier pic le 5 novembre, c'était le jour où François m'honorait de sa visite tandis que j'étais reçu chez lui.
Puis, le 18 brumaire, plus de 600 visiteurs et le lendemain plus de 450. J'avais mis la veille ce texte en ligne. J'ai cru alors que des sportifs essouflés cherchaient une recette pour se gonfler un peu les pectoraux et s'étaient fourvoyés là.
Comme à une séance du film " L'Angoise du gardien de but au moment du pénalty" de Peter Handke à laquelle j'avais assité à Paris : Salle pleine à craquer et absolument vide après 15 minutes de projection.
Mais là, non. Pas de mots-clefs olympiques dans les moteurs de recherche. Je ne m'explique donc pas cette affluence de ces jours-là et je m'en réjouis.
Mille excuses aussi à ces nombreux visiteurs-là pour les avoir soupçonnés un moment de n'être pas là où ils auraient voulu être.
Demain, journée vases communicants : J'ouvre donc ma porte à l'ami Feuilly et je m'installe chez lui pour la journée. Paraît qu'il a préparé un bon dîner et tout et tout...
Salut à toutes et tous et un cordial merci pour votre fidélité à l'Exil.
Bertrand
Résumé
| Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) |
|---|---|---|---|---|
| 1 696 | 6 331 |
21 441 |
714 / 5 963 | 211 / 637 |
Statistiques quotidiennes
09:44 Publié dans Statistiques | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.12.2010
Du blanc et des mots

Je n’en sais trop rien. Sans doute que oui parce qu’en regardant ce matin le monde en blanc, je me récitais tous les poncifs qu’on a voulu lui faire supporter : pureté, virginité, honnêteté et tutti quanti.
Mêmes les politiques, noirs comme du charbon en-dedans, se présentent aux élections sous l’étymologie latine du blanc : Candidat. Tout blancs, tout propres, irréprochables.
Candides, quoi…Tombés de la dernière neige.
Le blanc serait-il alors, avant tout, un mensonge, un déguisement ? La robe de mariée de l’hédoniste camouflée ?
C’est fort possible.
Et que cachent alors ces paysages livides ? Les champs sont blancs, les guérets sont blancs, la forêt est blanche, les maisons sont blanches, les routes sont blanches, les rues sont blanches.
Le monde est blanc et n’a plus qu’un seul discours.
De quels humains brigue-t-il donc les suffrages ?
Blanc comme neige.
Dès ce matin dans la nuit noire, le paysage me fit dire tout haut une phrase bateau, une phrase rabâchée, avec des adjectifs usés jusqu’à la corde, qu’on attend, une suite d’affligeants poncifs pour clavier tari, tant qu'elle en devient quasiment une antiphrase. :
La lune blafarde arrose les champs immaculés.
C’était exactement ça mais avec ces mots-là, ça n’était déjà plus ça. L’instant devenait décor. Le charme était rompu.
Ça n’était même plus beau.
Tordre le cou à la phrase aurait-il changé quelque-chose et renverser la tendance ?
Oui. Sur une page mais, là, en prise directe, non.
La littérature dite romanesque est sans doute comme les étoiles.
Sa lumière jaillit après l’extinction de son propos sensible, sans rien inventer que ses propres mots.
C’est ce qu’on appelle parfois son style.
Des fâcheux diront son mensonge.
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.11.2010
Devant

In petto, je bénis le susdit réchauffement sans lequel les dernières nuits d’un mois de novembre chuteraient sans aucun doute à moins 40…
A moins que les inversions de tendance en soient à ce point de basculement où elles disent le contraire de leur véritable trajectoire.
Pour l’heure, la tourmente neigeuse, opiniâtrement, engloutit un monde monochrome.
Et ce matin trois enfants, emmitouflés, encapuchonnés, engoncés dans de lourdes pelisses, marchaient en file indienne sur le chemin de l’école. Ils baissaient la tête pour éviter au visage la gifle du vent et des tourbillons poudreux.
Devant eux, la route était droite, muette, solitaire dans un grand brouillard blanc.
Je me suis demandé ce qu’ils allaient y apprendre, à cette école aujourd’hui, et qui vaille la peine d’affronter ainsi les colères glacées d’un hiver.
Peut-être en reviendront-ils ce soir avec la vague idée que devant, oui, justement, la route est toujours droite, muette et solitaire, avec un grand brouillard blanc, mais que…
Peut-être…
C’est ce qui crée le mouvement, ce pas devant l’autre infiniment répété, ce pas sans horizon qu'à l'intérieur : L’espoir sans objet, tellement sans qu'il ne sait même pas qu'il est espoir.
10:34 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.11.2010
Internet : Histoire d'une rencontre - 2 -
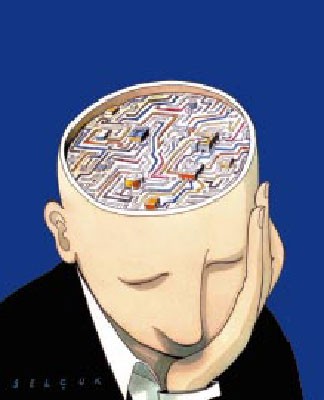
A peu près dans le même temps que la chambre de commerce m'offrait gracieusement un minitel, J’avais acheté à l’irascible contrebassiste et son ridicule délire, un Amstrad 1512 d’occasion avec système d’exploitation. Deux disquettes larges comme des feuilles de platane, une qui servait d’environnement en fait, et l’autre de page pour écrire.
L’ordinateur de l’âge de pierre non encore taillée.
Mais tout cela ne dépassait pas, dans ma tête, le stade de la fantaisie même si j’avais quand même abandonné la machine à écrire pour besogner sur le Word d’avant Windows, version 1, avec le menu en noir et blanc en bas d’écran, « Lire–écrire » « Paragraphe » « Justifier » etc. et qu’il fallait mettre, docte expression et qui en imposait aux néophytes médusés, en « vidéo inversée ».
J'étais encore très loin du réseau. Je travaillais sur un manuscrit que l'Amstrad 1512, fatigué, usé déjà, engloutit un beau matin dans ses entrailles ésotériques et ne me restitua jamais.
Comme un raz de marée cependant qui monterait sans vagues, sans bruit, sans tempête et sans détruire devant lui, mais qui monterait quand même inexorablement, couvrant la plage bien au-delà des rochers et bien au-delà de l’estran, la Bizarrerie opéra en douceur.
Elle atteignit d’abord les rivages de la sphère travail avant d’engloutir ceux de la vie privée, puis ceux de la vie tout court.
Et déjà, à tous les échelons de la hiérarchie sociale, on ne parlait plus que messagerie et courrier électronique en reniflant bruyamment et d’un air entendu. On se perdait en de savantes conjectures d’archéologues sur l’origine du cabalistique @.
Ne sachant en effet absolument pas comment ça pouvait bien fonctionner – on n’a d’ailleurs jamais trop su – au moins abordait-on la chose avec les outils intellectuels qu’on avait à sa disposition, l’histoire et la littérature. On se dédouanait ainsi de l’effort de compréhension tout en faisant mine de savoir de quoi il en retournait.
Et on avait bien raison tant il en va de même de toutes les inventions humaines. Je n’ai jamais su comment je pouvais techniquement passer un coup de fil au Canada ou à Honolulu, mais je sais faire. Tous les secrets du moteur à explosion ne m’ont jamais été totalement dévoilés et j’ai quand même fait plus de vingt fois le tour du monde en automobile. En distance, je veux dire.
On fit donc moult formations un peu partout, on acheta des modems, puis des machines de plus en plus puissantes et on ne cessa d’acclamer toujours plus fort cette source inépuisable d’informations capable de fournir dans l’instant le moindre détail sur n’importe lequel domaine de la connaissance humaine.
La chose apparut donc d’abord, dans sa phase contemplative, comme une incommensurable encyclopédie de tout ce que l’esprit humain avait su produire jusqu’alors.
On ne jura plus que par le www. Pour acheter des chaises, des vacances, des voitures, faire une rencontre, consulter des livres, savoir la profondeur de tel fond marin, visiter des musées, louer des appartements, habiter là plutôt qu’ici, et même, fantasmer ses pulsions les plus secrètes et les plus refoulées.
Tout se conjugua à la vingt- troisième lettre de l’alphabet multipliée par trois. On palabra, on critiqua, on échangea, on proposa, on réalisa, on projeta tout en www, véritable Sésame d’une caverne abritant trois milliards de cerveaux et reliés entre eux, dans les trois minutes, par un langage commun aux multiples centres d’intérêt.
L’ampleur du phénomène m’a tout d’abord fait sourire. Je trouvai tout cela benêt, surtout quand le moindre artisan, le moindre petit commerçant, par exemple, planqué à l’ombre de son clocher rural entre le bistrot et la vieille épicerie, se gaussa à son tour d’être immatriculé tout neuf en www.
Ça faisait fat, connaissances de sot. En l'occurrence, c'était moi le sot et ces gars-là avaient sur moi une longueur d'avance.
Car ils jouaient leur survie. Pas l’équilibre de leur budget, non, mais leur survie d’homme vivant en société car on ne survit pas dans un monde dont le langage mute et vous échappe totalement.
On peut vivre en exil sans la langue dont on a été allaité.
J’y vis.
On ne peut pas vivre chez soi dans un langage ésotérique.
Du ludique et de la connaissance pure, on en était donc venu à ne plus respirer que par les trois lettres. Il suffit alors qu’on apprît la signification de ces trois lettres, la fameuse toile étalée sur le monde entier, pour que tous les rouages, culturels, économiques, intellectuels, affectifs dussent, pour plus d’efficacité et d’intelligence, êtres tissés sur les mailles de cette toile.
Ce que pudiquement et doctement on avait appelé, au début, virtuel, parce qu’il fallait bien pour en conjurer l’angoisse nommer cette nouvelle lecture/écriture du monde, finit donc par devenir la réalité et c’est l’ancienne réalité qui, en s’éloignant, devint tout à fait virtuelle.
Personne ne prit véritablement conscience de l’inversion totale des concepts et de l’irréversible renversement de la perspective.
J'avais, quant à moi, suivi des formations sur un traitement texte révolutionnaire, Works et sur environnement windows...J'étais fier et content. Je passais mon temps libre à écrire et à mettre en pages.
En dehors du monde.
Mon fils, alors étudiant à l'INSA de Rouen, me tendit à Noel un petit carton bien enveloppé et à l'intérieur, ce qui me sembla être une petite boîte en fer.
Un cadeau, ça fait toujours plaisir, mais là, je me demandais bien...
Une demi-heure plus tard, Internet entrait dans ma vie.
On était en 1997.
10:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.11.2010
Colères sans objet contre objets
 J’ai toujours eu un problème avec le monde des objets.
J’ai toujours eu un problème avec le monde des objets.
Avec le monde des humains aussi, mais là, au moins j’ai des interlocuteurs doués de parole et de mouvement. Avec eux, dans les situations conflictuelles, il y a au moins un écho. Même leur silence résonne très fort.
Avec les objets, dont l’autre pleurnicheur bourguignon se demandait s’ils avaient une âme attachante, il n’y a qu’un protagoniste, soi-même, à l’intérieur, et, pour garder quand même un peu de tenue et ne pas sombrer dans la folie, force m’est bien alors de leur prêter, sinon une âme, du moins un comportement.
Et c’est le plus souvent un comportement détestable.
Les objets se mettent quotidiennement en travers de ma bonne humeur.
A mes petits projets de tous les jours, ils opposent fréquemment leur force d’inertie, leur muette imbécilité, la sournoiserie de leurs petites dimensions, la complexité de leur utilisation.
Ouvrir une poche de café, au saut du lit, est pour moi un cauchemar.
Elle résiste, se durcit, refuse de livrer son secret, se rebelle, se replie…Un bout se déchire enfin. Mais il y a un autre bout derrière. Un vrai labyrinthe.
Je finis toujours par prendre un couteau et par l’éventrer, cette satanée poche ! Le bel arôme matinal se répand alors, mais la poudre aussi…Colère.
On accuse gentiment ma maladresse. Moi aussi, je m’accuse et je m’auto-incendie.
Mais l’autre jour, tout de même, j’ai acheté une poche de café avec, dessus, le mode d’emploi bien indiqué pour l’ouvrir. Une poche de café didactique. Et je me suis dit que si la marchandise prenait de telles précautions, c’est que c’était vraiment difficile pour tout le monde d’ouvrir son café.
Ça m’a un peu rassuré.
Quand je bricole, la guerre est totale et sans merci.
Il y a une quinzaine de jours, en posant de la laine de verre dans mon grenier, j’ai passé plus d’une demi-heure à chercher le grand couteau qui me servait à la découper.
J’ai regardé partout, je me suis mis à quatre pattes, j’ai fouillé dans tous les recoins, j’ai investi avec une lampe de poche tous les endroits où j’étais passé, j’ai soulevé un rouleau entier que je venais pourtant d’installer avec mille peines, voir si ce connard de couteau ne s’y serait pas glissé.
Gorge serrée, fureur totale, cris furibonds. Je devenais certain que ce couteau était planqué là, tout près, et qu’il riait à lame déployée de mon désarroi.
J’ai fini par le découvrir. Confortablement installé sur une poutre. Je l’ai balancé rageusement par terre. Il a rebondi, s'est glissé entre deux planches. J'ai failli le perdre une deuxième fois.
Après, ça allait mieux…
Je pourrais multiplier les exemples à l’envi. Les meubles dans lesquels je me cogne, les tapis dans lesquels je me prends les pieds, les escaliers roulants que j’emprunte dans le mauvais sens…Une fois, j’ai perdu mon paquet de cigarettes…Là, ça tournait à la rage et ça a duré un moment et plus ça durait plus je haïssais ce paquet de cigarettes et plus j’en avais besoin.
J’ai fini par le découvrir. Dans le frigo. Entre le beurre et un pot de confiture.
Il y a quelques jours aussi, en fendant du bois, j’ai perdu ma hache.
Une petite hache. Une hachette. Pas un lourd outil de bûcheron, quand même.
Enervé par ses mesquineries et ses enfantillages pervers, après l’avoir retrouvée et m’être remis à l’ouvrage, je me suis finalement blessé assez profondément le doigt.
Parfois, je me dis quand même que je suis un inadapté. Un poisson qui ne sait pas nager, par exemple.
Mais quand je suis vraiment de bonne humeur et de mauvaise foi, je me dis que c'est le monde, qui est vraiment trop encombré d'objets.
Et ça n'a absolument rien à voir, mais il y a un graffiti du joli mois de mai que je ne supporte pas : Cache-toi, objet !
14:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.11.2010
Le mode d'utilisation du numérique en écriture : Une certaine vision du monde
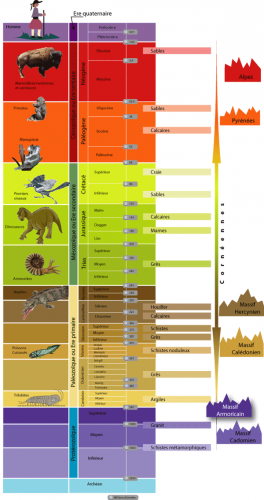 Je me suis lancé - pas sûr du tout de l’exactitude de l’expression - dans la rédaction d’une dizaine de nouvelles.
Je me suis lancé - pas sûr du tout de l’exactitude de l’expression - dans la rédaction d’une dizaine de nouvelles.
Un genre difficile et exigeant, on le sait, si on appelle nouvelle autre chose qu’une forme brève du roman et comme j’ai décidé d’en écrire dix, sans lien apparent entre elles, le travail en est d’autant plus long et passionnant.
Cela me prend évidemment des heures et une certaine énergie au point que ma présence sur l’Exil pourrait en pâtir, ce que je voudrais éviter à tout prix car l’atelier public, le poumon par lequel respire l’écriture, il est là plus que sur les pages isolées d’un traitement de texte.
Mais écrire sur blog ne tient pas du bavardage et il faut surtout éviter que ce qu’on y écrit soit moins beau et utile que le silence qu’on pourrait y afficher.
Sur la page non reliée aux lecteurs aussi, me direz-vous avec juste raison, mais sur celle-ci, on a le temps de retravailler, on est seul et on peut même, si vraiment ça ne dit rien qui en vaille la peine, l’expédier à la poubelle.
Sur le blog, on est en prise direct. L’artiste travaille sans filet, si j’ose.
Là comme partout ailleurs de toutes façons - et c’est ce qui fait de l’acte d’écrire un acte à dimension humaine - si on a l’impression de presser un citron, mieux vaut balancer le citron par-dessus bord et passer à autre chose.
Dans cette manie d’écrire, donc, qui fait l’essentiel de mon activité, il n’y a pas de séparation fondamentale entre ce qui se fait dans l’ombre avec projets (ou fantasmes) éditoriaux - disons traditionnels parce que je n’ai pas envie de me lancer dans une longue digression - et ce qui s’écrit ici.
Les deux veulent participer d’une même présence au monde mais encore en deux temps pour moi, l’un immédiat et l’autre différé. C’est certainement là que j’en suis toujours à la préhistoire du numérique, sans laquelle il n’y aurait pas d’histoire à espérer, bien évidemment.
On peut être certain que dans un avenir plus ou moins lointain - gardons-nous de jouer les astrologues tant les méandres du monde sont capricieux - tout d’un écrivain se passera sur son site, à visage de plus en plus ouvert et dans l’immédiateté de sa création.
Deux mondes pour l’heure se superposent comme les sédiments de la géologie, la librairie et le site internet, et si nous participons des deux couches d’un même limon c’est que nous sommes à une charnière, à un changement d’ère en train de se faire.
En équilibre…
En écrivant cela, je pense à deux écrivants d’internet qui ne se connaissent pas entre eux : François Bon qui travaille exclusivement à ciel ouvert, et Feuilly (avec lequel je vasecommuniquerai le 3 décembre), qui ne partage ni le même esthétisme ni les mêmes convictions en façon de numérique, mais qui, pendant plus d’un an, a mené l’expérience d’une écriture romanesque en direct, avec projet de retravailler le texte et de le soumettre à l’édition traditionnelle.
Deux pratiques presque contradictoires : L’un offre une écriture qui se veut définitive, l’autre une écriture en devenir.
Je prends ces deux exemples comme deux exemples probants de comment on aborde, chacun selon son goût et sa liberté, la préhistoire numérique et je me dis qu’avec mes nouvelles sur le métier et l'Exil, je suis dans une troisième utilisation.
Oui, mais le contenu dans tout ça, que j'entends qu'on murmure...
Le contenu ? Mais la littérature s'écrit plus avec le monde qu'à propos du monde alors, forcément, le choix des moyens, c'est aussi le choix de sa littérature.
13:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.11.2010
Andrzej Stasiuk, un merle blanc
 Il nous arrive – il nous est arrivé plutôt ou, encore mieux, il nous arrivait parfois - autour d’une table enfumée où refroidissaient les restes d’un repas abondamment mouillé d’un jaja rouge et noir, de refaire le monde, tard dans la nuit, sous des lunes incertaines et la chevelure en bataille.
Il nous arrive – il nous est arrivé plutôt ou, encore mieux, il nous arrivait parfois - autour d’une table enfumée où refroidissaient les restes d’un repas abondamment mouillé d’un jaja rouge et noir, de refaire le monde, tard dans la nuit, sous des lunes incertaines et la chevelure en bataille.
Tunnel à sens unique, sans embouchure ni sortie, que les espérances décousues de ces soirées ! Et maudit soit ce maudit temps qui passe sans nous laisser le temps de peaufiner nos rêvasseries !
Le plaisir n’était pourtant pas de refaire le monde car il résidait dans l’idée même, substantielle, de le défaire. Comme un ravissement présexuel. Celui qu’on connaît avant d’aborder le fulgurant mystère de l’orgasme.
Qu’aurions-nous fait, franchement, d’un monde à refaire? Nous étions de simples fainéants faiseurs de néant, des voyous en mal de philosophie et notre talent résidait exclusivement dans une espèce d’insatisfaction obstinée.
A l’heure qu’il est dans ma vie, avec un horizon de plus en plus prometteur de la fin des horizons, avec les priorités qui s’accélèrent aussi, je me dis qu’on a bien eu de la chance de n’avoir pas eu à faire ça, d’avoir laissé le monde s’accomplir tout seul, sur sa lancée, accompagné de nos seules diatribes.
Je vis dans un pays où le monde n’a quasiment jamais cessé de se faire et de se défaire. Un pays où ça s’écroule aussi vite que ça s’élève, où l’éphémère a jusqu’alors tenu lieu de sempiternel. À tel point que les Polonais, parfois, semblent vouloir marcher sur la pointe des pieds, comme s’ils craignaient de provoquer une nouvelle avalanche, avec, encore, derrière elle, des montagnes et des vallées à remodeler.
Leur monde, celui que nous appelions, nous, dans nos soirées d'inspiration anarchiste, le vieux monde, est tout neuf. L’ancien s’est écroulé de lui-même, tel un mur qu’aurait trop longtemps miné l’humidité d’une gouttière pourrie.
Et un mur qui s’écroule, ça produit un grand nuage de poussière et une onde de choc qui frappe l’intérieur des cervelles. C’est physique. Peu importe alors si cet éboulement libère des espaces, élargit des horizons, ouvre de nouveaux champs et procure plus d’oxygène !
Ça, c’est au mieux de la morale sociale, au pire, de la phraséologie politique.
C’est l’onde de choc qu’il faut considérer, quand un monde défait demande imagination et énergie phénoménales pour déblayer les ruines et qu’on est encore tout éberlué, suffoqué par le souffle du cataclysme, celui-ci fût-il de bon augure.
On a déjà vu des prisonniers condamnés à de longues peines et ne plus savoir trop quoi faire de leur cœur et de leurs bras et de leur âme une fois remis à l’air libre, pourtant des années et des années convoité, sublimé, fantasmé ! Encombrés de la responsabilité de vivre et du devoir d’exister. Des prisonniers forgés, entièrement construits par l’enfermement, par les murs, le silence, la privation et les barreaux. Souvent même, de guerre lasse, on les a vus qui repassaient sous les fourches caudines pour aller s’endormir de nouveau dans le ventre hermétique d’une cellule, là où l’existence se nourrit du non-être, là où on devient, par définition, un vieillard sans devenir.
Les espaces contraignants de la dictature sont tels. Il faut, quand le ciel s’éclaircit soudain, cligner des yeux et s’accommoder à la lumière. S’impose alors l’envie d’aller au bout de ce rien qu’on entrevoit devant soi.
Le mur s’écroule. Le monde crie à la libération enfin… Mais que font donc les ex-emmurés, compagnons de Stasiuk ?
Ils ont trente ans, la gorge nouée par la fumée des cigarettes et le cerveau bousculé par les flots de la vodka et de la bière.
Qu’apporte ce nouveau monde qui naît au moment même où sombre leur jeunesse délabrée par l’enfermement ? Que donne t-il d’espérance ? L’espérance, c’est du temps qu’on a devant soi…Et devant, il n’y a rien…Que de la laideur. Le mot liberté se traîne comme un fantôme dans la grisaille de Varsovie, dans ses rues froides et désœuvrées et dans ses nuits de bohème absurde.
Le leurre est encore plus pernicieux que l’autorité de la botte car, enfin, comment se plaindre d’être désormais libre ? À quelle calamité imputer son mal-être ?
La liberté dont on ne sait par quel bout la prendre se mue souvent en allégorie de la liberté.
Les ex-emmurés de Stasiuk rejoignent donc les montagnes et la neige et le froid du « Far East » polonais, à la recherche d’une vieille ferme vaguement entrevue par l’un d’entre eux, avant, dans le brouillard communiste.
À la recherche d’une vision, d’une sublimation de leurs paniques d’exister.
Tenter de faire reculer encore plus loin les murs. Voir s’il n’y aurait pas autre chose que ses ruines n’auraient pas dévoiler. Elargir ces murs à la grandeur des paysages de montagnes et de neige. Pour aller nulle part.
Sinon au bout d’une indicible chimère, jusqu’à la folie et même jusqu’à la mort.
Un corbeau blanc, Biały Kruk, oiseau rare et étrange des solitudes montagnardes, est le témoin fortuit de cette escapade dont ne saura pas si elle est testamentaire ou initiatique. Détail insignifiant du récit, le corvidé albinos se pose par deux fois au sommet des arbres de la vallée.
En polonais, Biały Kruk est une expression figée pour signifier un homme qui n’est pas à sa place, un décalé. Ou alors une chose rare, le rara avis latin, et plus spécialement un livre, un livre d’exception, un chef-d’œuvre introuvable.
L’introuvable chef d’œuvre de vivre sa vie, peut-être, et à la recherche duquel s’épuisent les ex-emmurés de Stasiuk.
Qui, avec Biały Kruk, a peut-être offert à la littérature contemporaine un de ses Biały Kruk.
Article écrit pour le Numéro 78 de juillet 2009 de la revue "Passe-Muraille" de JLK
14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.11.2010
Internet : Histoire d'une rencontre - 1 -
Notre utilisation quotidienne d'internet dans tous les grands secteurs de l'existence est irréversible.
Notre rapport au monde - sa compréhension autant que notre action en sa compagnie, notre manière de lui parler et d'en parler, notre façon de nous frotter à lui et d'y trouver nos liens et nos repères sociaux - a été bouleversé de fond en comble et ce bouleversement fut de la même ampleur sur l'échelle ethnologique que celui qui survint avec le feu, le fer et l'écriture.
Nous avons eu la chance de vivre le phénomène de plein fouet et de nous l'approprier, cette appropriation ayant été la condition sine qua non à son existence d'abord, à sa pérennité ensuite.
Comment, pourquoi, à quel moment sommes-nous devenus Homo internetus ? Ce sont là des questions d'archéologues.
Et c'est ce secteur propre de mon archéologie personnelle que je vous propose de suivre ici une fois par semaine, pendant quelques vendredis.
Quand on sait un peu mieux l'hier on voit un peu mieux l'aujourd'hui...
Quant au demain, ce n'est point là affaire d'archéologie.
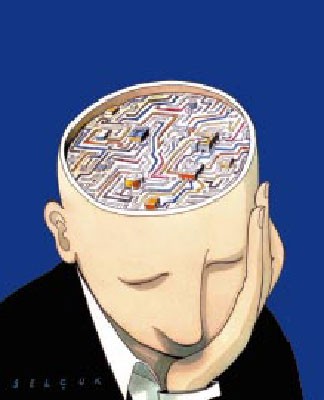
Au début, seuls quelques farfelus à la pointe et à l’affût des nouveautés technologiques s’étaient aventurés vers cette Bizarrerie, par curiosité, par jeu, par goût de l’extraordinaire et lui avaient ainsi offert une place de choix dans leurs préoccupations intellectuelles. Encore abscons, ils en parlaient comme d’une machinerie qui bousculait le temps et l’espace.
Ceux-là mêmes, pour la plupart, ne prévoyaient pourtant pas qu’elle allait s’installer de façon hégémonique, jusque dans le moindre ministère professionnel, privé et intime, les privant ainsi du privilège d’être les seuls à savoir la fantastique modernité des choses.
On leur opposait la vieille conception de l’authenticité des rapports humains.
On leur opposait aussi l’argument de l’isolement, tactique du pouvoir selon laquelle toutes nouvelles techniques de communication visaient à enfermer les gens dans leur appartement, coupant le cordon qui les reliait au corps social et les faisant ainsi esseulés, incapables d’une pensée et d’une stratégie communes.
L’opposition par ignorance se nourrissait autant des restes d'un romantisme naïf que des résidus nébuleux de la comète situationniste qui, comble de l’erreur, était justement très mal adaptés à la situation naissante.
Dans une comète, on le sait, la queue fait toujours plus illusion que la comète elle-même, très loin devant elle.
J’étais de ces phraseurs nostalgiques, militant acharné du rapport véritable entre les gens et paranoïaque invétéré de tout ce qui émanait du haut de l’échelle sociale et, à plus forte raison, si ça venait d’outre-atlantique.
Je me souviens donc très nettement d’une soirée festive entre amis et qui, sur le sujet naissant, se termina malheureusement en jus de boudin.
On était vers le milieu des années quatre-vingt. Il y avait là, entre autres, un pionnier de l’informatique, par ailleurs excellent contrebassiste.
Nous jouions parfois Brassens ensemble.
Comme on le fait souvent entre amis après un repas bien parfumé aux arômes de la treille, on chanta. Je pris ma guitare et interprétai quelques modestes chansons de mon non moins modeste répertoire.
Le musicien pionnier d'informatique rentrant alors en un courroux aussi subit qu’intempestif, me prit violemment à partie, disant que tout cela, c’était révolu ! Finis les littérateurs, finie cette conception sensible du monde, finie la dictature intellectuelle des poèmes et de l’écrit ! On allait être balayés par un monde nouveau ! Lui, avec son ordinateur, il avait conversé tout à la fois dans l’après-midi avec un Japonais, un Québécois et un Pakistanais et cette nouvelle manière de se transmettre spontanément, par-delà les barrières de la culture et de la géographie, rendait totalement surannées toutes autres formes de diffusion de la pensée et de l’émotion !
Il avait bien trop bu, évidemment. Il n’était d’ordinaire pas si sot. Mais il voulait surtout faire montre, au prix de n’importe quelle ineptie sans queue ni tête, qu’il était entré dans la nouvelle ère et que moi, avec ma guitare à la noix et mes chansonnettes à la con, j’appartenais au vieux monde larmoyant.
Déstabilisé autant par la violence du propos que par les vapeurs opalines d’une énième Mirabelle, j’en pris stupidement ombrage alors qu’il eût fallu en rire. Je rétorquai donc violemment que discuter avec les antipodes était ridicule. Ce qui m’importait c’était la teneur du propos et non la distance – le téléphone avait déjà fait la preuve de son verbiage - et qu’il avait, lui, l’air d’un bouffon en calecons à palabrer comme ça avec le monde entier alors qu’il ne disait même pas bonjour à son voisin de palier.
Nous nous insultâmes sans retenue et nous nous quittâmes finalement très fâchés.
Nous ne nous sommes jamais revus.
Ce que je regrette beaucoup aujourd'hui tellement c’est bête.
Ce fut donc là ma première véritable rencontre avec l’idée de cette étrange chose dont tout le monde parlait, même ceux qui ne savaient pas trop de quoi il en retournait. Beaucoup croyaient en effet nécessaire de faire savoir qu’ils n’en ignoraient pas l’existence, se vantaient même pour avoir cliqué deux ou trois fois de-ci de-là et que c’était formidable, sans trop savoir cependant ce que ça venait foutre dans le monde.
La Bizarrerie n’était donc pas encore dans la vie mais déjà dans les têtes.
J’en avais moi-même, bien avant cette malencontreuse altercation d’après libation, un vague pressentiment.
Car j’étais alors forestier et la Chambre de Commerce nous avait gracieusement dotés d’un minitel. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais bigrement rien. Pour annuler l'annuaire et faire ainsi des économies énormes de papier, m'avait-on quand même renseigné.
L'argument m'avait paru d'une déconcertante faiblesse, mais comme mon métier c'était de couper des arbres et qu'avec les arbres ont fait du papier et etc...
Je me servais donc de cette petite machine comme annuaire en composant le 11, ou alors pour savoir l’enneigement sur les pentes des Pyrénées à Noël ou encore pour demander - ce qui arrivait souvent - un crédit à la banque.
Déjà, je trouvais ça confortable de négocier avec l’écran, bien au chaud chez moi en train de piailler qu’on versât une énième provision de liquide dans mon tonneau des Danaïdes à dix chiffres, sans avoir à affronter les sourcils toujours moralisateurs et toujours infantilisants d’un banquier.
Il y avait là un confort nouveau et fort séduisant...Ce furent mes premiers pas vers l'écran-médiateur.
Je n’étais donc pas complètement ignare quant à la Bizarrerie. D’après ce que j’en entendais, de-ci, de-là, je faisais le rapprochement entre elle et mon minitel, pour l'heure préposé à me renseigner sur l'enneigement des stations de ski et aux demandes récurrentes de renflouement de mes découverts.
A suivre ...
11:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.11.2010
Des mots pour les sportifs qui ont du souffle
 On aura peut-être remarqué que je parle ces derniers temps assez souvent de la langue polonaise. C’est sans doute à défaut justement de ne la pas parler suffisamment.
On aura peut-être remarqué que je parle ces derniers temps assez souvent de la langue polonaise. C’est sans doute à défaut justement de ne la pas parler suffisamment.
Mais c’est aussi que je suis un peu jaloux.
Parce que D. lit Karpowicz.
J’ai envie aussi, alors, pendant qu’elle lit, je la harcèle de mes questions.
C’est comment ? Et l'écriture ? Et qu’est-ce qu’il dit ? Et par rapport à Stasiuk, tu le vois comment ? Même friction au monde ? Est-ce que ça te plaît ?
Elle s’en agace un peu…Difficile de lire quand un énergumène - pas vraiment réputé pour sa patience - gesticule à côté et vous presse d’interrogations débiles.
Elle me racontera et me donnera son avis complet après lecture complète.
Parole tenue et il en est ressorti que j’espère que Karpowicz sera traduit bientôt.
Pour Stasiuk, bon, je suis un peu moins frustré. Je ne le connais pas dans le texte, certes, mais je le connais quand même, La Route de Babadag, Fado, Le Corbeau blanc…
Je me souviens cependant que François Bon écrivait à propos de La Route de Babadag : que tout ça doit être beau en Polonais !
Tu le connais ?
D. lit maintenant Taksim, le dernier de Stasiuk, publié en 2009. Pas traduit encore alors, forcément, mes questions reprennent de plus belle.
Essaie de lire dans le texte…C’est facile, regarde. Et elle pointe du doigt un seul mot du livre :
Siedemdziesięciosześciomilimetrowym
Une demie-ligne. J’écarquille les yeux…Notre anticonstitutionnellement est largement battu, que je dis, tout piteux.
Oui, en plus c’est beaucoup plus simple au niveau du sens, parce que anticonstitutionnellement, est-ce que ça veut dire quelque chose, vraiment ? C'est surtout une prouesse technique tirée par les cheveux, non ?
J'en conviens, j'en conviens.
Là, ce mot, c'est un adjectif qui qualifie le canon d’une arme de soixante-seize millimètres de diamètre.
C’est tout.
La langue polonaise est belle en ce qu’elle adjectivise le monde là ou les langues romanes font une périphrase ou, au mieux, un complément du nom.
Ulica Ogrodowa, la rue des jardins, par exemple. Littéralement, la rue jardinière, quoi.
Bref, c’est la calligraphie qui fait peur quand ça qualifie beaucoup.
Me tarde de lire Taksim avec périphrases et compléments du nom quand même.
J’’en sais désormais, outre les adjectifs longs comme un jour sans pain, des choses qui me plaisent bien.
Photo Wikipédia : Taksim (Istanbul)
10:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.11.2010
Ne lire que des signes

Vous poussez la porte et vous entrez bien au chaud. Vous vous dirigez vers le rayon littérature et vous ouvrez, vous caressez, vous parcourez quelques pages, vous taquinez du chapitre.
Les phrases murmurent et tombent sous le sens.
Vous n’entendez plus le petit grelot de la porte qui s’ouvre et se referme sur les chalands, vous ne voyez plus la libraire, vous ne sentez plus sur vos glabres mollets l’haleine humide de la rue.
Vous ne connaissez pas votre bonheur, vous dis-je.
Je peux suivre un peu une conversation. Le sujet global. Je peux aussi faire les politesses d’usage, bonjour, au revoir, il neige, combien je vous dois, pardon, et tous ces mots de la convenance sociale qui sont imprégnés sur nos lèvres pour dire aux inconnus qu’on est là.
Mais lire ?
Dans la ville aux rues frigorifiées par la neige et le vent, c’est pourtant vers les librairies que je vais.
Quand je suis à Varsovie, une seule adresse. Marjanna, dans le hall de l’Institut français.
C’est comme à la maison…
J’y reste des heures.
Mais là, plus à l’est, j’entre dans la librairie, je tape mes chaussures pour en faire tomber la neige, et je vais directement au rayon des beaux livres.
Je caresse leur belle couverture, je les ouvre.
J’ai l’impression de retrouver là de vieux copains qui m’attendaient.
Balzac et « Stracone złudzenia », Stendhal et « Czerwone i czarne », Hugo et « Nędznicy», Camus et « Dżuma », Dostoïevski et « Bracia Karamazow ».
Mais ils sont tous devenus fous….Je scrute la belle écriture. C’est une belle police et le papier est bien blanc et bien lisse.
Je sais qu’il y a là de belles choses. Je déchiffre, entourés d'une forêt de signes cabalistiques, Sorel, Valjean, Aliocha. C’est à peu près tout. Alors j’essaie de me resituer dans le récit…
Mes yeux s’embrouillent.
Je me retourne.
Dépité, je prends un livre d’images. Un loup dans un sous-bois, un élan qui traverse la plaine ou alors l’Armée rouge grignotant peu à peu le territoire polonais repris aux bourreaux nazis.
Les images ont un langage universel. Seuls les yeux lisent. Méthode syllabique. C'est sans doute pour ça que le spectacle - tel que mis au jour par les situationnistes - endort si bien les gens. Quand leur cerveau n'est plus capable de lire que des images.
Je vais rentrer chez moi et prendre ma Takamine. Je me suis permis de mettre, il y a longtemps, l’Albatros en musique. Comme Ferré, l’emphatique en moins.
Do, Mi mineur, La Mineur, Fa, Do, Sol 7 etc.
Il n’y a pas plus simple. Tout est dans l’arpège et la mélancolie et mes ailes d’exilé n’ont rien de celles du géant.
Ouvrir mes livres aussi et voir si je sais encore lire.
Oui, je sais encore. La nuit tombe.
Et je sais que demain je pousserai encore la porte de la librairie.
La dame me sourira et me dira « Dzien dobry » puis ne me regardera plus.
Elle me prend pour un grand lecteur, je crois.
Dernière mise en ligne, septembre 2007
Illustration : Dans le parc du musée Joseph Kraszewski.
12:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.11.2010
La langue et sa musique

Quels accents ? que je demande, légèrement vexé.
Tous, qu’elle dit.
Des accents graves, aigus, circonflexes ? que je plaisante.
Le verdict tombe alors : Plutôt graves.
Ouais, je me doutais bien de la gravité du problème. Ces amoncellements de consonnes chuintantes, Szczygieł, par exemple pour dire un chardonneret…Un vrai calvaire pour un latin ! Et puis cet accent tonique sur l’avant-dernière syllabe, voire l’antépénultième pour les mots longs, tout ça, c’est quand même laborieux.
Une langue difficile. Comme toutes les langues, bien sûr, mais celle-ci particulièrement, au point que Norman Davies prétend qu’elle aurait dû être écrite en cyrillique - un signe pour un son - plutôt qu’en alphabet latin.
D. me disait un jour que ça n’était pas non plus une langue très indiquée pour le chant. Parce qu’elle n’a pas assez de voyelles. En langues romanes, les i, les é, les u, les o chantent, pointent la mélodie, ont une couleur…
Rimbaud. Oui. Peut-être.
N’empêche que Jagoda saute, elle, d’une langue à l’autre, français/polonais ou l’inverse, comme cabri saute le ruisseau…Je ne lui entends aucun accent. Elle parle de tout et comme les enfants de France et de Navarre.
Je ne l’entends plus, en fait. Car quelqu’un qui l’entend pour la première fois, s'amuse de ce qu’elle a un tout petit accent charmant, nous l'avons dernièrement vérifié en France.. Cette avant-dernière syllabe peut-être…Je n'en sais rien, moi, je n’entends rien.
Comme quoi la musique natale de sa propre langue s’estompe ou se module. Comme quoi, aussi, cette musique peut se chanter sur plusieurs tonalités approximatives, sur plusieurs partitions bien écrites, sans déformer l’œuvre initiale.
C’est parce que tu vis depuis longtemps parmi nous, me dit-on.
Sans doute.
Mais en m’écoutant l’autre jour sur l’interview de TV-Villages je me suis découvert un accent poitevin, nasillard même, que je ne m’entends jamais dire.
Ça fait déjà longtemps que je vis parmi moi-même, que je me suis surpris à murmurer, du coup.
Ah, c’est bien compliqué la musique d’une langue ! Ça met au grand jour tant de morceaux d’archéologie enfouis sous les sédiments de la mémoire et de l'habitude !
Est-ce qu’on peut écrire un accent ? Ècrire à haute voix ?
15:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.11.2010
Enfin !

Image AFP
15:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.11.2010
Voltaire et la Pologne
 Enoncer que Voltaire était un esprit exceptionnellement brillant est un lieu tellement commun qu’il en est déconcertant.
Enoncer que Voltaire était un esprit exceptionnellement brillant est un lieu tellement commun qu’il en est déconcertant.Dire que Voltaire était également et souvent versatile, sans être tout à fait original, constitue une allégation un peu plus relevée.
Affirmer, comme je me propose de le faire, que c’était aussi un piètre observateur des choses de son époque, participe alors d’une appréciation scandaleuse que beaucoup ne manqueront pas de ranger au rang des hérésies intellectuelles.
Mais les anathèmes ne m’effraient pas.
D’abord, si ses écrits, comme ceux de bien d’autres, servirent de terreau fertile aux idées révolutionnaires, ils furent aussi les lumières qui permirent au despotisme de perdurer un peu plus longtemps, en se prétendant justement éclairé.
Mais ne lui en tenons pas rigueur : c’est le lot de toute critique radicalement intelligente que de renseigner l’adversaire sur ses failles les plus réelles et les plus menaçantes pour sa survie afin qu’il y sursoie, tout aussi intelligemment, et assure ainsi la pérennité de sa domination.
C’est le lot de toute critique mais, à mon goût, on le passe bien trop souvent sous silence s’agissant de Voltaire.
Ensuite, s’il fut certes, deux fois embastillé par un régime qu’il conspuait à merveille, il se fit aussi le thuriféraire d’une Angleterre royale, qualifiée par lui de Pays de la liberté, et fut également accueilli à bras ouverts par le roi de Prusse. Passons encore.
Nul n’est prophète en son pays.
Ce qui me dérange beaucoup plus, ce sont ses divagations sur la Pologne, où il n’a jamais mis les pieds, où il ne comptait aucun ami et où il était cependant beaucoup lu et même influent.
Ses détracteurs y étaient bien évidemment les catholiques.
Mais pour être décrié par des catholiques point n’est besoin d’être un grand subversif. Suffit juste d’être un homme qui écrit le mot « liberté ».
Pour être déjà une République, la Pologne intriguait donc Voltaire. Le nom sans doute le fascinait.
Mais une République nobiliaire. Une République avec un roi catholique et des nobles catholiques, donc une forte centralisation du pouvoir. Voltaire y perdait son latin.
Ainsi quand les nobles non-catholiques exigèrent eux aussi de participer au pouvoir, Voltaire les soutint-il en même temps que Catherine de Russie.
On ne peut être que d’accord.
Mais les aristocrates catholiques, soucieux de leur hégémonie - comme tous les catholiques de l’histoire et du monde - et pour juguler l’influence grandissante de la Russie, ne l’entendirent pas de cette oreille. Ils constituèrent alors la Confédération de Bar, notre Fronde, et s’attirèrent ainsi les foudres de la grande Catherine, qui n’attendait que le prétexte de l’intransigeance de ces catholiques polonais pour voler au secours de son amant, le roi de Pologne, et surtout pour engloutir le pays.
Attiré, subjugué, séduit par les discours de la grande impératrice, despote sanguinaire, plus encline à convaincre ses contradicteurs par le glaive que par la joute verbale et au regard de laquelle Louis XV eût pu apparaître comme un grand démocrate, Voltaire se prononça avec enthousiasme pour une intervention militaire en Pologne.
C’est quand même assez troublant pour une Lumière.
Une Lumière aveuglée par ses propres reflets et qui ne voyait en la Russie qu’une adversaire redoutable du catholicisme et de « la cour de Rome ».
Funeste et grossière erreur d’appréciation. La Tsarine nymphomane (paraît qu'elle appréciait aussi beaucoup les chevaux) écrasa les confédérés mais aussi et surtout la Pologne, qu’elle se partagea comme une ogresse avec l‘Autriche et la Prusse.
C’était en 1772. Le premier partage d’une série de quatre dont l'avant-dernier, en 1795, rayera carrément le pays de la carte, même dans sa dénomination, pendant 123 ans, jusqu’au 11 novembre 1918.
Le moins que l’on puisse dire c’est que si Voltaire n’était pas un salopard, il était un candide qui n’entendait strictement rien aux préoccupations expansionnistes des despotismes de son temps et d’Europe.
Il avouera d’ailleurs, dans une lettre à Frédérique II à propos de cette affaire de la mise à sac de la Pologne: « J’ai été attrapé comme un sot .. .»
C’est exactement ce que je voulais dire. Sans vraiment oser.
Mais il l’avait dit mieux que moi.
16:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.11.2010
Prendre de la hauteur pour ne plus rien voir
 Je regardais par le hublot.
Je regardais par le hublot.
C'est que je n’ai pas une grande expérience de l’avion, aussi je m'en étonne toujours assez naïvement…En plus, j’ai la frousse.
Ni du décollage, ni de l’atterrissage - j’accueillerais plutôt ce dernier, fût-il assez brusque, avec un soupir de soulagement - mais du vol lui-même.
Quand il ne se passe plus rien.
Au-dessus, que du bleu, mais qui ne semblait pas plus proche que vu depuis la terre. Normal, le bleu du ciel n’existe que dans nos yeux.
En-dessous que du quadrillage imprégné sur des teintes indécises. Une forêt, un cours d’eau, une route, à moins que ce ne soit l’inverse, des champs, des maisons, un pont, tiens, une ville, reconnaissable au désordre de ses dessins, comme un truc fait à la hâte, dans la panique, puis un grand lac. Enfin, je suppose...
J’aurais bien voulu savoir quand même à quelle géographie appartenait tel quadrillage à tel moment.
Une fois, il y a quelques années, j’ai volé au-dessus de la mer. C’était beaucoup plus facile. La tête se repère beaucoup mieux dans le rien que dans le tout et rien.
Le soleil frappait cette maquette désordonnée. J’ai cru voir d'obscurs cours d’eau, surplombés de noirs, comme encastrés dans le décor. Les Vosges ou les Ardennes, me suis-je dit. Et puis d’autres points de vue mais qui tous se ressemblaient curieusement. Une géométrie sans grande imagination.
Les paysages sont profondément humains en ce qu’ils réclament la proximité horizontale. Qu’on en palpe l’humidité, qu’on en sente l’aridité, qu’on en étreigne le fouillis, qu’on en respire le froid ou le chaud. Qu'on les regarde dans les yeux, à hauteur d'homme. Pas sur la tête.
Ils ne supportent pas d’être survolés, en fait. Comme des livres. Il leur faut de la complicité, à l'intérieur.
Vus du haut, ils n’ont plus aucun sens, les paysages. Ils sont dans un envers inexprimable.
Mais quand même, que je me disais, c’est là-dedans qu’on vit tous. C’est dans ces rectangles, ces triangles, ces rubans, ces demi-cercles, ces trapèzes qu’on rampe et ces formes géométriques de la géographie ne sont tracées que par l'activité des hommes.
C'est ce qui les rend inhumaines, sans doute.
Juxtaposer tout ça dans un seul coup d’œil, ça n’a pas de sens et ça donne l'impression d'un tableau excécuté à mille mains, sans que Pierre ne voit jamais ce que fait Paul.
Et ça m’a fait penser aussi à certaines fresques rupestres de Lascaux, chevaux ou autres animaux sauvages, peintes sur le tournant d’une paroi coupée par un boyau étroit, de sorte que l’artiste n’a jamais pu voir la totalité de son œuvre.*
Et je me demande quelle vision les oiseaux, les grand migrateurs qui voyagent à 10 000 mètres d’altitude, peuvent-ils avoir du monde, eux qui n'y sont pour rien dans ces découpages et pliages des paysages verticaux ?
A quel moment se sentent-ils le plus "oiseaux "?
Avec un seul paysage dans leurs yeux ou avec tous agglomérés les uns aux autres, insensés ?
Quand j’ai commencé à avoir très mal aux oreilles, que Jagoda s’en est plainte aussi, que les paysages se sont rétrécis, se sont mieux emboîtés pour faire enfin un bout de terre cohérent, que bientôt la confusion bleue et grise de la grande agglomération s’est devinée dans la brume, que même l’ombre de l’avion, en bas, s'est mise à tanguer, alors je me suis dit que tout ça, qui s’était mélangé dans ma tête, ça avait été un sacré moyen de conjurer mes peurs.
De survoler mon vol.
* Si vous ne me croyez pas, demandez à Sarkozy. Lascaux n'a plus de secret pour lui...
13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET

















