12.11.2010
Ne lire que des signes

Vous poussez la porte et vous entrez bien au chaud. Vous vous dirigez vers le rayon littérature et vous ouvrez, vous caressez, vous parcourez quelques pages, vous taquinez du chapitre.
Les phrases murmurent et tombent sous le sens.
Vous n’entendez plus le petit grelot de la porte qui s’ouvre et se referme sur les chalands, vous ne voyez plus la libraire, vous ne sentez plus sur vos glabres mollets l’haleine humide de la rue.
Vous ne connaissez pas votre bonheur, vous dis-je.
Je peux suivre un peu une conversation. Le sujet global. Je peux aussi faire les politesses d’usage, bonjour, au revoir, il neige, combien je vous dois, pardon, et tous ces mots de la convenance sociale qui sont imprégnés sur nos lèvres pour dire aux inconnus qu’on est là.
Mais lire ?
Dans la ville aux rues frigorifiées par la neige et le vent, c’est pourtant vers les librairies que je vais.
Quand je suis à Varsovie, une seule adresse. Marjanna, dans le hall de l’Institut français.
C’est comme à la maison…
J’y reste des heures.
Mais là, plus à l’est, j’entre dans la librairie, je tape mes chaussures pour en faire tomber la neige, et je vais directement au rayon des beaux livres.
Je caresse leur belle couverture, je les ouvre.
J’ai l’impression de retrouver là de vieux copains qui m’attendaient.
Balzac et « Stracone złudzenia », Stendhal et « Czerwone i czarne », Hugo et « Nędznicy», Camus et « Dżuma », Dostoïevski et « Bracia Karamazow ».
Mais ils sont tous devenus fous….Je scrute la belle écriture. C’est une belle police et le papier est bien blanc et bien lisse.
Je sais qu’il y a là de belles choses. Je déchiffre, entourés d'une forêt de signes cabalistiques, Sorel, Valjean, Aliocha. C’est à peu près tout. Alors j’essaie de me resituer dans le récit…
Mes yeux s’embrouillent.
Je me retourne.
Dépité, je prends un livre d’images. Un loup dans un sous-bois, un élan qui traverse la plaine ou alors l’Armée rouge grignotant peu à peu le territoire polonais repris aux bourreaux nazis.
Les images ont un langage universel. Seuls les yeux lisent. Méthode syllabique. C'est sans doute pour ça que le spectacle - tel que mis au jour par les situationnistes - endort si bien les gens. Quand leur cerveau n'est plus capable de lire que des images.
Je vais rentrer chez moi et prendre ma Takamine. Je me suis permis de mettre, il y a longtemps, l’Albatros en musique. Comme Ferré, l’emphatique en moins.
Do, Mi mineur, La Mineur, Fa, Do, Sol 7 etc.
Il n’y a pas plus simple. Tout est dans l’arpège et la mélancolie et mes ailes d’exilé n’ont rien de celles du géant.
Ouvrir mes livres aussi et voir si je sais encore lire.
Oui, je sais encore. La nuit tombe.
Et je sais que demain je pousserai encore la porte de la librairie.
La dame me sourira et me dira « Dzien dobry » puis ne me regardera plus.
Elle me prend pour un grand lecteur, je crois.
Dernière mise en ligne, septembre 2007
Illustration : Dans le parc du musée Joseph Kraszewski.
12:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.11.2010
La langue et sa musique

Quels accents ? que je demande, légèrement vexé.
Tous, qu’elle dit.
Des accents graves, aigus, circonflexes ? que je plaisante.
Le verdict tombe alors : Plutôt graves.
Ouais, je me doutais bien de la gravité du problème. Ces amoncellements de consonnes chuintantes, Szczygieł, par exemple pour dire un chardonneret…Un vrai calvaire pour un latin ! Et puis cet accent tonique sur l’avant-dernière syllabe, voire l’antépénultième pour les mots longs, tout ça, c’est quand même laborieux.
Une langue difficile. Comme toutes les langues, bien sûr, mais celle-ci particulièrement, au point que Norman Davies prétend qu’elle aurait dû être écrite en cyrillique - un signe pour un son - plutôt qu’en alphabet latin.
D. me disait un jour que ça n’était pas non plus une langue très indiquée pour le chant. Parce qu’elle n’a pas assez de voyelles. En langues romanes, les i, les é, les u, les o chantent, pointent la mélodie, ont une couleur…
Rimbaud. Oui. Peut-être.
N’empêche que Jagoda saute, elle, d’une langue à l’autre, français/polonais ou l’inverse, comme cabri saute le ruisseau…Je ne lui entends aucun accent. Elle parle de tout et comme les enfants de France et de Navarre.
Je ne l’entends plus, en fait. Car quelqu’un qui l’entend pour la première fois, s'amuse de ce qu’elle a un tout petit accent charmant, nous l'avons dernièrement vérifié en France.. Cette avant-dernière syllabe peut-être…Je n'en sais rien, moi, je n’entends rien.
Comme quoi la musique natale de sa propre langue s’estompe ou se module. Comme quoi, aussi, cette musique peut se chanter sur plusieurs tonalités approximatives, sur plusieurs partitions bien écrites, sans déformer l’œuvre initiale.
C’est parce que tu vis depuis longtemps parmi nous, me dit-on.
Sans doute.
Mais en m’écoutant l’autre jour sur l’interview de TV-Villages je me suis découvert un accent poitevin, nasillard même, que je ne m’entends jamais dire.
Ça fait déjà longtemps que je vis parmi moi-même, que je me suis surpris à murmurer, du coup.
Ah, c’est bien compliqué la musique d’une langue ! Ça met au grand jour tant de morceaux d’archéologie enfouis sous les sédiments de la mémoire et de l'habitude !
Est-ce qu’on peut écrire un accent ? Ècrire à haute voix ?
15:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.11.2010
Enfin !

Image AFP
15:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.11.2010
Voltaire et la Pologne
 Enoncer que Voltaire était un esprit exceptionnellement brillant est un lieu tellement commun qu’il en est déconcertant.
Enoncer que Voltaire était un esprit exceptionnellement brillant est un lieu tellement commun qu’il en est déconcertant.Dire que Voltaire était également et souvent versatile, sans être tout à fait original, constitue une allégation un peu plus relevée.
Affirmer, comme je me propose de le faire, que c’était aussi un piètre observateur des choses de son époque, participe alors d’une appréciation scandaleuse que beaucoup ne manqueront pas de ranger au rang des hérésies intellectuelles.
Mais les anathèmes ne m’effraient pas.
D’abord, si ses écrits, comme ceux de bien d’autres, servirent de terreau fertile aux idées révolutionnaires, ils furent aussi les lumières qui permirent au despotisme de perdurer un peu plus longtemps, en se prétendant justement éclairé.
Mais ne lui en tenons pas rigueur : c’est le lot de toute critique radicalement intelligente que de renseigner l’adversaire sur ses failles les plus réelles et les plus menaçantes pour sa survie afin qu’il y sursoie, tout aussi intelligemment, et assure ainsi la pérennité de sa domination.
C’est le lot de toute critique mais, à mon goût, on le passe bien trop souvent sous silence s’agissant de Voltaire.
Ensuite, s’il fut certes, deux fois embastillé par un régime qu’il conspuait à merveille, il se fit aussi le thuriféraire d’une Angleterre royale, qualifiée par lui de Pays de la liberté, et fut également accueilli à bras ouverts par le roi de Prusse. Passons encore.
Nul n’est prophète en son pays.
Ce qui me dérange beaucoup plus, ce sont ses divagations sur la Pologne, où il n’a jamais mis les pieds, où il ne comptait aucun ami et où il était cependant beaucoup lu et même influent.
Ses détracteurs y étaient bien évidemment les catholiques.
Mais pour être décrié par des catholiques point n’est besoin d’être un grand subversif. Suffit juste d’être un homme qui écrit le mot « liberté ».
Pour être déjà une République, la Pologne intriguait donc Voltaire. Le nom sans doute le fascinait.
Mais une République nobiliaire. Une République avec un roi catholique et des nobles catholiques, donc une forte centralisation du pouvoir. Voltaire y perdait son latin.
Ainsi quand les nobles non-catholiques exigèrent eux aussi de participer au pouvoir, Voltaire les soutint-il en même temps que Catherine de Russie.
On ne peut être que d’accord.
Mais les aristocrates catholiques, soucieux de leur hégémonie - comme tous les catholiques de l’histoire et du monde - et pour juguler l’influence grandissante de la Russie, ne l’entendirent pas de cette oreille. Ils constituèrent alors la Confédération de Bar, notre Fronde, et s’attirèrent ainsi les foudres de la grande Catherine, qui n’attendait que le prétexte de l’intransigeance de ces catholiques polonais pour voler au secours de son amant, le roi de Pologne, et surtout pour engloutir le pays.
Attiré, subjugué, séduit par les discours de la grande impératrice, despote sanguinaire, plus encline à convaincre ses contradicteurs par le glaive que par la joute verbale et au regard de laquelle Louis XV eût pu apparaître comme un grand démocrate, Voltaire se prononça avec enthousiasme pour une intervention militaire en Pologne.
C’est quand même assez troublant pour une Lumière.
Une Lumière aveuglée par ses propres reflets et qui ne voyait en la Russie qu’une adversaire redoutable du catholicisme et de « la cour de Rome ».
Funeste et grossière erreur d’appréciation. La Tsarine nymphomane (paraît qu'elle appréciait aussi beaucoup les chevaux) écrasa les confédérés mais aussi et surtout la Pologne, qu’elle se partagea comme une ogresse avec l‘Autriche et la Prusse.
C’était en 1772. Le premier partage d’une série de quatre dont l'avant-dernier, en 1795, rayera carrément le pays de la carte, même dans sa dénomination, pendant 123 ans, jusqu’au 11 novembre 1918.
Le moins que l’on puisse dire c’est que si Voltaire n’était pas un salopard, il était un candide qui n’entendait strictement rien aux préoccupations expansionnistes des despotismes de son temps et d’Europe.
Il avouera d’ailleurs, dans une lettre à Frédérique II à propos de cette affaire de la mise à sac de la Pologne: « J’ai été attrapé comme un sot .. .»
C’est exactement ce que je voulais dire. Sans vraiment oser.
Mais il l’avait dit mieux que moi.
16:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.11.2010
Prendre de la hauteur pour ne plus rien voir
 Je regardais par le hublot.
Je regardais par le hublot.
C'est que je n’ai pas une grande expérience de l’avion, aussi je m'en étonne toujours assez naïvement…En plus, j’ai la frousse.
Ni du décollage, ni de l’atterrissage - j’accueillerais plutôt ce dernier, fût-il assez brusque, avec un soupir de soulagement - mais du vol lui-même.
Quand il ne se passe plus rien.
Au-dessus, que du bleu, mais qui ne semblait pas plus proche que vu depuis la terre. Normal, le bleu du ciel n’existe que dans nos yeux.
En-dessous que du quadrillage imprégné sur des teintes indécises. Une forêt, un cours d’eau, une route, à moins que ce ne soit l’inverse, des champs, des maisons, un pont, tiens, une ville, reconnaissable au désordre de ses dessins, comme un truc fait à la hâte, dans la panique, puis un grand lac. Enfin, je suppose...
J’aurais bien voulu savoir quand même à quelle géographie appartenait tel quadrillage à tel moment.
Une fois, il y a quelques années, j’ai volé au-dessus de la mer. C’était beaucoup plus facile. La tête se repère beaucoup mieux dans le rien que dans le tout et rien.
Le soleil frappait cette maquette désordonnée. J’ai cru voir d'obscurs cours d’eau, surplombés de noirs, comme encastrés dans le décor. Les Vosges ou les Ardennes, me suis-je dit. Et puis d’autres points de vue mais qui tous se ressemblaient curieusement. Une géométrie sans grande imagination.
Les paysages sont profondément humains en ce qu’ils réclament la proximité horizontale. Qu’on en palpe l’humidité, qu’on en sente l’aridité, qu’on en étreigne le fouillis, qu’on en respire le froid ou le chaud. Qu'on les regarde dans les yeux, à hauteur d'homme. Pas sur la tête.
Ils ne supportent pas d’être survolés, en fait. Comme des livres. Il leur faut de la complicité, à l'intérieur.
Vus du haut, ils n’ont plus aucun sens, les paysages. Ils sont dans un envers inexprimable.
Mais quand même, que je me disais, c’est là-dedans qu’on vit tous. C’est dans ces rectangles, ces triangles, ces rubans, ces demi-cercles, ces trapèzes qu’on rampe et ces formes géométriques de la géographie ne sont tracées que par l'activité des hommes.
C'est ce qui les rend inhumaines, sans doute.
Juxtaposer tout ça dans un seul coup d’œil, ça n’a pas de sens et ça donne l'impression d'un tableau excécuté à mille mains, sans que Pierre ne voit jamais ce que fait Paul.
Et ça m’a fait penser aussi à certaines fresques rupestres de Lascaux, chevaux ou autres animaux sauvages, peintes sur le tournant d’une paroi coupée par un boyau étroit, de sorte que l’artiste n’a jamais pu voir la totalité de son œuvre.*
Et je me demande quelle vision les oiseaux, les grand migrateurs qui voyagent à 10 000 mètres d’altitude, peuvent-ils avoir du monde, eux qui n'y sont pour rien dans ces découpages et pliages des paysages verticaux ?
A quel moment se sentent-ils le plus "oiseaux "?
Avec un seul paysage dans leurs yeux ou avec tous agglomérés les uns aux autres, insensés ?
Quand j’ai commencé à avoir très mal aux oreilles, que Jagoda s’en est plainte aussi, que les paysages se sont rétrécis, se sont mieux emboîtés pour faire enfin un bout de terre cohérent, que bientôt la confusion bleue et grise de la grande agglomération s’est devinée dans la brume, que même l’ombre de l’avion, en bas, s'est mise à tanguer, alors je me suis dit que tout ça, qui s’était mélangé dans ma tête, ça avait été un sacré moyen de conjurer mes peurs.
De survoler mon vol.
* Si vous ne me croyez pas, demandez à Sarkozy. Lascaux n'a plus de secret pour lui...
13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.11.2010
Nous avons deviné que nous étions amis
Voilà l'homme que j'ai rencontré en Deux-Sèvres, qui mit Zozo en voix et qui, inlassablement, le cœur en bandoulière, bat la campagne pour donner sa parole aux textes...
13:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
31.10.2010
Je connais des halliers
 Ce sont d’inextricables taillis aux épines longues comme des dédales, orphelins, tout tremblants d’abandon aux portes des villages, engloutis par le lierre, inondés de verdure enchevêtrée.
Ce sont d’inextricables taillis aux épines longues comme des dédales, orphelins, tout tremblants d’abandon aux portes des villages, engloutis par le lierre, inondés de verdure enchevêtrée.Des oiseaux y nichent, des serpents y réchauffent la froideur de leur sang sur des herbes séchées, des rongeurs y grignotent et le souffle du vent dans des branches qui se croisent et s’entrecroisent, y fredonne des murmures.
Sous les frondaisons bourdonnantes ou sous le tapis rouge de listopad*, le mois des feuilles qui tombent, ou encore sous l’épaisseur d’un suaire de glace, dorment des hommes, dorment des femmes et parfois des enfants.
Les croix sur les tombes ont deux branches par l’oubli vermoulues.
Ce sont là nécropoles que le seul printemps vient fleurir.
Ce sont là sanctuaires où l’homme n’hasarde plus sa mémoire.
Presque des sanctuaires maudits, plus resplendissants pourtant que le marbre tellement glacé d’en face, celui des vrais cimetières où crisse le gravier sous la chaussure, où les floraisons n’ont pas de saison et où reposent de vrais morts, avec les vrais sacrements d’une vraie religion et de vrais visiteurs à petits pas menus, courbés sous un vrai chagrin, courbés sous le regard des lourdes croix à branche unique, courbés sous de vraies gerbes de fleurs, de vrais souvenirs, de vrais présents en pleurs...
Pas comme ceux de ces fourrés sauvages, là où nichent des oiseaux, se réchauffent des serpents, grignotent des rongeurs et fredonne du vent.
Ici sont des anciens, des qui ont éteint la lumière avant qu’elle ne revienne sur le pays ressuscité par les armes et le sang.
Pour s’endormir en paix, ceux-là avaient dû faire allégeance aux dogmes du conquérant, baisé les deux branches du tsar de toutes les Russies.
Ce sont des dormeurs sans val, qu’aucun poète ne songe à venir immortaliser.
Brutalisés par le sabre, agenouillés par le goupillon, répudiés par le néant.
Preuves de son inexistence, dieu qui ne pardonne pas qu’on se trompe de dieu, fait que le châtiment est plus beau encore que ne l’eût été la récompense.
Oecuménisme. Pourquoi un si beau mot pour dire la fusion du mensonge ?
Viens.
Viens dans ces halliers que des sommeils inondent, au milieu de ces tombes écroulées, qui se cachent, qu’il faut chercher, qui ne sont plus que débauche grandissante d’une végétation qui s’empile à chaque printemps, tels les sédiments de l’irrévérence.
Dans ce jardin-là, tu es en équilibre. Sur l’intangible frontière, entre l’indécence de la profanation et la sagesse de l’archéologie.
Tu peux fermer les yeux. Ici, on peut marcher partout…
Ces broussailles sont en même temps un paradis accusateur des falsifications d’en face, avec toutes ces choses vraies sous la froidure de ses faux marbres et le souffle dans les branches, là-haut qui croisent et s’entrecroisent, chante et chante….
Le mépris des hommes rend libre et beau.
Ecoute…Ecoute encore. Tu peux t’asseoir et te reposer là. Te faire ronces débridées, lierre englobant, liane, branche, tout esprit de Dionysos, souffle, fauvette, esprit errant au secours d’un néant.
On dirait qu’il entonne, le vent au-dessus de ta tête, l’anecdote sanglante des choses de l’esprit à l’esprit imposées et le ressentiment revanchard, inextinguible, des hommes de la bonne foi.
Là, sans morale, jamais ne seras seul.
16:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.10.2010
Poésie et mémoire usurpées

Non pas que les saints, connus au calendrier ou inconnus au bataillon, m’inclinent à quelque abstraction métaphysique - les saints qui m’inspirent ne s’orthographient pas du tout comme ça et sont resplendissants de vie - mais parce qu’elle est, dans ma tête, dans mon archéologie, comme un grand portail qui s’ouvre et sous lequel on s’engage pour rentrer sur le long territoire des mortes saisons.
Après la toussaint, on marche résolument dans l’allongement des ombres. Le monde se dépouille : on n'en voit bientôt plus que l’architecture primaire, presque l’essentiel. Un reste de soleil maladif traîne encore sur le blanc des gelées, les forêts s’inclinent et déposent leurs habits au pied du grand vainqueur, le ciel est pâle, les chemins boueux ou gelés, le peuple ailé clairsemé et sans voix.
Il fait frisquet. Parfois des brouillards rampent au ras des eaux. J’ai l’impression qu’on est, à chaque heure du jour, au crépuscule d’un soir. La nuit viendra, certes, mais elle n’est pas encore là. Il est temps d’écrire. Je n’ai jamais su dire pourquoi, peu importe, c’est même d’une naïveté déconcertante, mais : il est temps d’écrire, de semer dans cette ombre où se mêle une rumeur.
Voilà donc ma toussaint : Le point de départ de la fuite. Rien à voir, sinon comme strict point de repère, avec la célébration de tous les morts. De stricte intimité, d’ailleurs, on ne célèbre en son cœur que ceux qu’on a croisés vivants, c’est-à-dire bien peu au final, et dont on a encore mal qu’ils soient passés sur l’autre rive.
Encore et toujours une supercherie du catholicisme triomphant, cette toussaint ! Cette fête était, aux premiers siècles de l'église, célébrée le 13 mai.
En plein renouveau des choses, donc.
Mais les Celtes de l’Europe du nord s’obstinaient, en dépit de l’hégémonie de plus en plus gourmande et autoritaire des chrétiens, à rendre honneur à leurs morts le 1er novembre, qui correspondait aussi à la fin de leur année, celle-ci ne comptant que deux saisons : L'été et l'hiver. Ils croyaient que, pour enterrer cette année, les morts revenaient taquiner les vivants. Ils ouvraient les tombes, allumaient de petites torches dans des navets et se livraient, en sus, à de copieuses ivresses.
Comment tordre le cou aux coutumes de ces barbares ignorants ? Comment leur enlever la mémoire ? Comment frapper les cieux d’alignement et obliger tout le monde à regarder vers un seul nuage ?
En leur volant leur fête. Tout simplement.
En 835, donc, foin de ces comédies ! Le pape Grégoire IV instaure la date du premier novembre pour la célébration des martyrs de l’église et, pour arrondir les angles dirais-je, pour faire passer la pilule avec une sorte de concession aux anciens rites païens, ordonne qu’une messe sera dite le 2 novembre, institué dès lors jour des morts.
Un truc qui n'a donc aucun sens. Au mieux un truc politique, au pire le camouflage d'une annexion.
Je me suis laissé dire que l’Eglise bedonnante d'aujourd’hui voyait d’un sale œil refleurir un peu partout en Europe les citrouilles avec leurs bougies à l’intérieur.
Sans doute y voit-elle un rappel caustique de sa mauvaise conscience et de ses innombrables combines.
13:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.10.2010
Transcendance d'un Ego
 C’était dans une auberge isolée au milieu des marais de Nuaillé d’Aunis et dans laquelle nous avions coutume de jouer Brassens tout un week-end - vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi - chaque année au mois de novembre.
C’était dans une auberge isolée au milieu des marais de Nuaillé d’Aunis et dans laquelle nous avions coutume de jouer Brassens tout un week-end - vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi - chaque année au mois de novembre.
Un certain dimanche d'un froid de canard où le soleil tout pâle et tout fluet dans un ciel tout bleu éclairait les prairies muettes et désertes alentour, nous avions cependant bien failli nous y faire voler la vedette, dans cette auberge !
Après une première partie, nous nous étions installés dans la salle pour prendre un pot et le hasard avait fait que nous nous étions assis à côté d’un tout petit bonhomme, tout maigre, tout sec et tout nerveux.
Il portait de grosses lunettes de myope, il avait la bouche un peu taillée en biseau, une raie impeccable tracée sur le côté de ses cheveux légèrement gominés, une mèche relevée en arrière et il était un peu voûté.
Il ressemblait à Jean-Paul Sartre dans sa période maoïste.
Forcément, il en vint à nous interpeller. Mon camarade était en pleine forme mais moi, j’avais la voix qui se cassait, éraillée. Nous en étions à la sixième heure de concert en deux jours, quand même, sans compter que chaque soirée se prolongeait en copieux sacrifices à Bacchus.
Sartre nous enseigna alors qu’il fallait soigner, entretenir, travailler, échauffer, entraîner la voix.
Il était lui-même chanteur dans un groupe, à La Rochelle !
Tous les matins, dans sa salle de bain et devant la glace, il faisait des gammes, lui. Oui, Messieurs !
Et il nous montra.
Comme font les bébés quand ils remuent les lèvres très vite et qu’ils y passent leur main et qu’ils font «brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.»
Mais là, c’était un bébé chanteur. Le « brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr » s’articulait plaisamment, se modulait habilement pour donner la gamme complète, jusqu’à l’octave et même au-delà.
Les lèvres remuaient et s’agitaient dans un tremblement frénétique.
C’était gentiment grotesque et absolument désopilant. Tellement que, nous voyant pliés en deux, le bonhomme n’arrêtait plus de nous montrer et répétait à l’envi ses singeries de mélomane.
Un peu interloqués, les gens regardaient ce vieux fou en train de nous donner la leçon.
Sartre en vint cependant à demander sa récompense. Pouvait-il monter sur scène avec nous et chanter une chanson ?
J’ai cru un instant qu’il voulait chanter Dans la rue des Blancs-Manteaux…Mais non, mais non, ce fut « Le Mauvais sujet repenti » qu’il proposa.
A la reprise, il chanta donc, d’une petite voix haut perchée, juste cependant : « Elle avait la taille faite au tour, les hanches pleines… »
Mon camarade l’accompagnait et Sartre cabotinait à son aise, se dandinait sur ses petits pieds vernis et, épousant parfaitement le texte avec son corps fluet, se déhanchait effectivement comme une demoiselle de la nuit.
Puis il voulut en chanter une autre, puis une autre encore.
Nous dûmes finalement faire les gros yeux pour qu’il consente à reprendre sa place dans le public…
Sartre, vous dis-je !
Le bidon d’huile en moins !
14:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Petits architectes de la vanité universelle

Lorsque nous avons décidé, en 2007, de chercher une maison dans la campagne la plus reculée possible, il allait de soi que nous cherchions une maison qui fût authentique, une maison avec une histoire et dont le style et l’âme seraient depuis longtemps intégrés dans le paysage.
Bref, une maison polonaise. Une maison pour habiter. Pas seulement pour y être à l’abri, manger et dormir. C’était donc forcément une maison en bois. Comme toutes celles que j’avais vues avec envie dans tous ces villages-rues de l’est.
Pour moi, c’était et c’est encore exotique tout en étant une affirmation, une volonté de rencontrer véritablement les lieux. Pour D., c’était et c’est toujours une fidélité aux paysages et à la mémoire de son pays.
On voulait donc une maison mariée avec la forêt, qui fait corps avec elle, qu’on dirait qu’elle n’est qu’un dessin, une arabesque de plus sur le paysage forestier.
Tout comme les maisons de pierres, là-bas, dans les villages des Deux-Sèvres, s’inscrivent dans une campagne où dominent la pierre, le calcaire et les murailles le long des chemins et des prairies. Les hameaux y ressemblent à des fossiles incrustés sur les parois de la mémoire. Une maison de bois y serait incongrue. Comme une verrue sur le bout du pif.
Avec qui ou avec quoi se marie une maison en briques, en ciment, en béton, sinon avec un habitat exilé des hommes ?
Surtout ici.
Et pourtant fleurissent à tout va les constructions les plus hétéroclites. On rivalise de grandeur, de hauteur, de superficie, on multiplie les toits, les courbes, les niveaux, les fenêtres de toutes dimensions, les cassures, les ruptures de plan, les balcons emberlificotés. Une débauche d’imagination entre la mégalomanie mal maitrisée et la schizophrénie à un stade inquiétant, je vous assure.
La croissance polonaise dévore goulument l’âme polonaise.
On construit partout. Dans les bourgs, les villages, et jusqu’au beau milieu des champs. On se joue à qui mieux mieux du « m’as-tu vu dans ma jolie maison ? »
C’est nous autres, avec les vieillards et quelques farfelus de notre acabit, qui sommes passés minoritaires dans un paysage essentiellement et historiquement fait de bois.
Des maisons surgissent de la terre comme de grotesques champignons. Des jaunes, des rouges, des violettes, des vertes et des pas mûres, et toutes ont la prétention de célébrer la liberté retrouvée.
La richesse plutôt. Les plénitudes du libéralisme triomphant. La liberté, bof…C’est un mot de philosophie politique, ça.
Lamentable …On veut ressembler à l’ouest aussi, comme une sorte de revanche sur la frustration. On veut ressembler à ces grosses maisons, ces gros étrons de la vanité constipée devrais-je dire, qu’on voit partout en France, en Allemagne, en Angleterre.
On veut effacer la différence. Habiter en bourgeois.
Bref, on veut être tout : confortables, riches, démonstratifs, en dur, en large et en travers, mais surtout pas en bois.
Le bois, Pouah ! C’est synonyme de bicoque, de pauvreté, d’attardé, d’obscurantiste et de passé désastreux !
Ben moi, quand je vois toutes ces constructions idiotes des nouveaux riches - ou des gros emprunts - le mot de Stasiuk, déjà relevé dans ce blog, me revient toujours :
La Pologne, comme tout le reste de l’Europe centrale, ne sera bientôt plus qu’une notion pour les météorologues.
Parce que lorsque la richesse et la bêtise font bon ménage - et elles le font souvent - elles chevauchent toujours le cheval d’Attila.
08:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.10.2010
Une histoire vraie à la façon d'Esope ou de La Fontaine
 En ces temps là - c’était hier - nous hantions de nos assiduités désordonnées, voire tumultueuses, la région toulousaine. La ville comme la campagne. La première pour nos frasques, la deuxième pour nous en remettre.
En ces temps là - c’était hier - nous hantions de nos assiduités désordonnées, voire tumultueuses, la région toulousaine. La ville comme la campagne. La première pour nos frasques, la deuxième pour nous en remettre.
Je ne puis évoquer cette période sans que l’image de mon ami fauché prématurément en décembre 2006, ne revienne me hanter.
C’est surtout lui que je rejoignais là-bas. A part mon frangin, il fut d’ailleurs le seul de mes amis à venir me voir en Pologne, l’été 2006, juste avant le grand saut dans les ténèbres.
Je ne m’éloigne point de ce que je voulais dire initialement : Le passé et le présent, en écriture, se conjugue souvent au même temps et sur le même mode sans qu’il y ait pour autant offense à la musique grammaticale. Ce n’est qu’au futur que ça sonne toujours faux.
Là-bas donc où soufflait parfois le vent d’Autan, une copine à lui avait eu l’idée de louer, à l’écart, direction Mazamet je crois, un vaste domaine, maison emberlificotée, genre gentilhommière du 18ème, parc ombragé d’arbres centenaires, buissons échevelés, pelouses sauvages et mal entretenues, hautes grilles de la ségrégation sociale en piteux état.
Tout ça avait en somme le charme romanesque de l’aristocratie déclassée.
Elle avait en même temps eu l’idée, la copine, d’adopter un chien à la SPA. Un chien cacochyme, famélique, maigre, gris pommelé, haut sur pattes, avec de belles moustaches cependant qui le faisaient ressembler au Clochard de Disney.
Plume, qu’elle l’avait baptisé. Nous avions pensé spontanément à un clin d’œil à Michaux, mais non, c’était tout simplement, comme s’il se fût agi d'un boxeur, un clin d’œil au poids désastreux de l’animal.
Plume avait le regard vert, doux et humide et d’une humilité des plus mélancoliques.
Nous l’avons tout de suite aimé. Il trottinait à nos côtés, il était fort demandeur de caresses, levait vers nous son regard inondé de tendresse et se couchait sagement à nos pieds, comme tous les clebs du monde, quand nous étions assis à discutailler, à picoler ou à en rouler un.
Un amour de chien….
Mais voilà que l’été suivant nous venons rendre visite à la copine et, chemin faisant, nous rappelons aussi de Plume le chien que nous allons revoir, sans doute parfaitement remis de sa vie de paria et qui va nous faire joliment la fête.
Mais foin du Plume d’antan ! Nous avons trouvé là un chien épais, gras comme un moine, le regard halluciné, le poil lustré, arborant un collier de luxe à son cou, le croc hargneux et qui, derrière la grille, aboyait tel un forcené.
Bref, un chien de garde.
Impossible de rentrer avec un fauve comme ça en travers du chemin : Plume avait pris du poil de la bête, si j’ose, et, n'eût été l’intervention de la maitresse de céans, nous aurait assurément déchiré les mollets, sans autre forme de procès.
Nous avons bien tenté, dans les jours suivants, de ramener l’ingrate bestiole à de plus nobles sentiments, en faisant les niais cajoleurs, en émettant de petits bruits imbéciles de bisous, comme des grands-mères, et en tentant de lui caresser l’échine, qu’il hérissait aussitôt.
Tout ça en pure perte. Plume nous traitait en intrus et nous faisait nettement sentir la hâte qu'il avait de nous voir déguerpir de son territoire.
Et nous en avons conclu, après avoir réussi quand même à lui balancer un coup de pied rageur dans son sale cul d’exécrable parvenu, que ce chien-là avait quelque chose de profondément humain : capable de toutes les caresses les pieds dans le ruisseau et de toutes les bassesses la tête au pinacle.
10:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.10.2010
Chanson en direct, Pinder song
J’m’en va vous raconter
L’histoire du gars ZOZO
D’un gars plein de bobos.
En saison d’rabiboche
Sa vie fait des bouloches,
Chasseur de vent sous ses galoches.
Refrain :
C’est la Pinder song à ZOZO
Un swing pour tous les bias cochons
Sentiers de pluie, vairons, hérons
C’est la Pinder song à ZOZO
Un avant-deux, une scottish,
Pour doux rêveurs, song un peu kitsch.
Homm’ de terre et d’lisière
Rond’ frontières, champs derrière
Courant plaines et venelles
Met l’chemin sous ses semelles
Benaise, déterviré
Tout allongé sous son pommier
Réfractaire au travail
Heureux en ses futailles.
Gars d’peu mais beau rebelle
Et joueur de marelle
Poète à sa manière
Chaussure au cœur en bandoulière
Là-bas dans son Poitou
Le v’là qui chamboule tout.
Montré dans son village
Sa vie rate le virage,
Quand on vit en limite
Sur l’autre rive on passe plus vite
Paroles : Jean-Jacques EPRON
Musique : Bertrand Redonnet, gars d’rin !
14:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.10.2010
De l'immobilité de la vitesse
 Un soir, je revenais de Bressuire et la nuit tombait.
Un soir, je revenais de Bressuire et la nuit tombait.
Nous avions rendez-vous à Villeneuve-la-Comtesse pour la lecture de Jean-Jacques. En Charente-Maritime, entre Saint-Jean-d’Angely et Rochefort, pour être tout à fait précis.
Comme nous avions un peu d’avance, j’ai voulu m’arrêter dans un bourg situé aux lisières de la forêt de Chizé. Un bourg avec une grande place rectangulaire et démesurée par rapport au reste. De ces bourgs qui n’ont, en fait, qu’un centre, les alentours ayant été mangés par les constructions-dortoirs de citadins en mal de verdure ou, le plus souvent, aux comptes en banque pas assez solides pour s’offrir un terrain minable aux abords immédiats de la ville, entre la rocade et la ligne TGV.
Tout autour de cette grande place sont divers petits commerces et deux cafés.
Je connaissais bien ce bourg. Beauvoir-sur-Niort. Je disais à Dorothée que dans les années où il m’avait pris fantaisie d’être un marchand de bois, je venais souvent là. Tous les jours à vrai dire. Après avoir chargé mon camion dans quelque allée de la forêt, je m’arrêtais ici pour déjeuner, dans un des deux cafés, avant de reprendre la route direction La Rochelle, l’ile de Ré ou la Vendée.
Je m’attardais à jouer au billard, à lire le journal, à discuter de choses insignifiantes avec les autres habitués, à casser du sucre sur le dos de Mitterrand et de ses acolytes ou, encore, à ne rien faire, en sirotant un verre. Voire deux.
Nous avons fait le tour de la grand-place. J’ai jeté un œil dans l’estaminet, à travers la vitrine maculée d’affiches, tournois de belote, match de foot local, loto et autres réjouissances des solitudes rurales. Il m’a semblé que rien n’avait changé à l’intérieur. Même lumière jaune, mêmes chaises vieillottes et lustrées, mêmes petites tables rectangulaires recouvertes de toiles cirées à carreaux noirs et blancs et….même patronne.
Car elle a surgi sur le trottoir, la patronne, avant même que je ne la vois. Elle a ouvert de grands yeux et s’est écriée, ah ben ça, alors, un fantôme ! Un revenant ! Ça fait longtemps qu’on t’a pas vu dans les parages, dis-donc ! Qu’est-ce que tu es devenu ? Tu ne roules plus de bois ?
J’ai dit que non. Que tout ça, c’était fini…
Et j’ai, une nouvelle fois, eu cette terrible vision, dans ma chair, du temps qui coule à toute vitesse en donnant l’illusion d’être inerte. Parce que les voyageurs, à l'intérieur, sont parfaitement immobiles.
J’aurais pu répondre en effet qu’entre ce roulage du bois et cette nuit d'automne qui tombait sur le petit bourg silencieux, ce roulage du bois à laquelle cette brave dame faisait allusion comme si je m’étais arrêté hier ou la semaine dernière pour déjeuner chez elle, il y avait quand même eu quatorze ans passés dans un bureau à Niort et cinq ans en Pologne ! Presque vingt ans.
J’en ai éprouvé une profonde tristesse et j’ai dit un truc tellement vrai qu’il en est devenu une ânerie : Le temps passe vite !
Nous sommes allés voir la forêt noyée de crépuscule. Elle m’est apparue chétive, un peu délabrée. En tout cas elle n'avait nullement la fierté altière de la forêt polonaise. Une lumière orange, triste, une lumière à son agonie, glissait entre les arbres.
Une grande, très grande impression de solitude, de désespérance et d’inutilité de tout.
On devrait toujours voyager à bord du seul hasard et sans repère de mémoire.
Nous nous sommes enfuis vers la lecture où Jean-Jacques nous attendait, les bras et le sourire resplendissant de présent.
Image : Scène de la lecture de Jean-Jacques Epron
14:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.10.2010
Re-salut à Toi, Pologne !

En sortant de l’avion, l’air tiède m’a fait tressaillir et je ne savais plus quoi faire de mon blouson, de mon pull et de ma chemise. C’est comme ça que j’ai réalisé que Varsovie était déjà loin, de l'autre côté du bout de ciel que je venais de traverser : Quand je me suis retrouvé en T-shirt.
Plus tard, c’est sous cette lumière oblique, jaune et instable, cette lumière qui allonge les ombres de l’automne, que j’ai revu le Poitou-Charentes et l’océan, étale, avec, comme toujours, ses sarabandes de grands goélands, ses brumes incertaines sur l’horizon, ses bateaux superflus de la plaisance, toujours d'un blanc qui scintille en même temps que l'eau, et, au loin, les côtes imprécises des îles : Aix, Madame, Ré et Oléron.
Il m’a semblé qu’il y avait, au-dessus de tout ça, comme un respectable silence, presque une tristesse d'avoir à exister toujours de la même manière.
J’ai retrouvé mes jardins désertés de leurs anciennes plantes humaines, comme je le savais, sinon celles de la proche famille. Ces jardins me sont apparus comme si je les avais quittés hier et comme si, dans la nuit, la terre avait brusquement changé de saison.
J’ai circulé beaucoup, 1000 Km environ, à travers les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vienne. Par de petites routes connues, immuables, avec des talus plantés d’érables, de chênes, de châtaigniers ou de frênes.
Là, un souvenir embusqué au détour d’un virage, là-bas, sur une sorte de colline, un point de repère, un village lointain dont je sais dire le nom. Navigation entre les fantômes que mon départ a tués et qui, en tant que fantômes, font des efforts - puisque je suis revenu sur les lieux du crime - pour se rappeler à mon bon souvenir.
Sentiment que ces cinq années polonaises sont passées à une vitesse fulgurante. Que les cinq prochaines feront de même, et - si tant est qu'elles voient le jour - les suivantes aussi, et que tout est dérisoire de ce temps qui s’enfuit bien plus vite que nous ne savons le vivre.
J’ai traversé ces jours un peu comme on écrit une page : En glissant à côté des choses et pas vraiment dans les choses.
A Marie-Claude Rossard, du Temps qu’il fait, qui me demandait comment je ressentais tout ça, je crois que j’ai dit que je ne savais plus qui, de moi ou des paysages anciens, des paysages de ma mémoire, avaient pris la fuite et que c’était comme si je ne faisais plus corps avec les instants. Comme si je me voyais marcher au lieu de marcher, comme si j’entendais ma voix surgie de l’extérieur et comme si j’étais dans un décor planté, plus que sur les lieux réels d’un automne rural, qui m'attendait, que j'attendais, avec qui j'avais pris rendez-vous.
Le temps a filé. Chaque jour une lecture de Jean-Jacques. Mises en voix et en espace de Zozo impeccables. J’ai découvert un autre texte. J’ai ri et même humecté mes yeux, comme à une première lecture. J’ai découvert aussi un artiste généreux, avec un cœur grand comme je voulais, quand j'étais petit, que soit le monde.
Salut à Toi, l’ami. Le chemin qui s'ouvre devant nous sera joyeux ou ne sera pas.
Et ma grande émotion fut au lycée des Sicaudières, à Bressuire. Là, des élèves avaient choisi de me faire une surprise. Ils avaient relevé deux ou trois textes sur ce blog et ils me les ont lus à plusieurs voix, en se donnant la réplique et en guise de bienvenue parmi eux...
Emu que ces jeunes gens connaissent mon blog, en extraient des textes et se les approprient ; Heureux aussi que des adolescents lisent numérique. Comme quoi, les défenseurs à tout prix de l’édition traditionnelle, pour importante qu’elle soit, ont déjà une adolescence de retard.
Mais, me direz-vous, à quoi ça sert d'être à l'heure ? A rien. Je vous l'accorde. Qu'on soit en retard, ponctuel ou en avance dans son époque, on est rarement là où on avait pensé qu'on allait.
En tout cas, un merci chaleureux aux profs de français pour conduire leurs élèves sur des chemins encore nouveaux.
Après, les questions sur Zozo, qu’ils avaient étudié en classe, ont fusé. Dont une récurrente :
- Pourquoi avez-vous fait mourir Zozo ?
- Parce qu’il n’avait plus de place dans le devenir du monde.
Le ciel était bleu, en haut. En bas, les hommes étaient plutôt moroses et battaient le pavé. J’ai accompagné mon frère dans un cortège de la contestation. lI se bat, mon frère. Trente ans qu'il est derrière un volant et les nervis au pouvoir qui le poussent à y rester encore jusqu’à des âges indues.
Je l’ai accompagné en frère, en ami.
Mais derrière quel drapeau marcher, sinon, stricto sensu, celui de la fraternité ?
Depuis longtemps en berne sont mes propres étendards.
Et quelle joie, quel calme, de n'avoir plus rien à espérer des sociétés imbéciles !
Cap sur les amitiés qui naissent et sur le temps qui fout le camp !
12:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.10.2010
Zozo, un texte et des rencontres

J'en reparlerai sans doute beaucoup, de ce que j'en ai vécu de l'intérieur.
Pour l'heure, il y a une interview que j'ai donnée spontanément, dès mon arrivée, sans m'y être du tout préparé. Vous me pardonnerez donc les hésitations et les imprécisions.
Merci à Valérie Sarrazin et à toute l'équipe de TV -Villages, autant pour leur travail que pour leur gentillesse.
Je n'ai pas de lien direct.
Vous faudra donc farfouiller un peu à partir de là, puis "choisissez votre programme", "Nouveautés", et dans "Moulin du Marais ITW, Zozo, chômeur éperdu."
Amicalement
Bertrand
15:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.10.2010
Lettre aux lecteurs et lectrices de l'Exil des mots

Je vous abandonne pour quelque temps à une lecture statique de l’Exil des mots. L’occasion, peut-être, de fouiller dans les archives, de lire ou de relire quelques textes anciens, empilés là, les uns sur les autres, selon l’architecture verticale du blog.
Je sais bien qu’Internet est a-géographique et que c’est même là une de ses caractéristiques fondamentales, que changer de lieu n’est pas en être coupé, mais, dans mon cas, il s’agira de manque de disponibilité pour venir y écrire.
Je rejoins en effet les horizons maritimes pour soutenir la lecture/mise en scène qu’un conteur professionnel, Jean-Jacques Epron, assisté d’un artiste des Matapeste, a réalisée à partir de mon texte « Zozo, chômeur éperdu », publié à l'enseigne du Temps qu'il fait en avril 2009.
J’ai, pour l’heure, participé à ce spectacle à hauteur d’une chanson écrite par Jean-Jacques et mise en musique, ces derniers jours, par mézigue, cent fois répétée, tant que Jagoda en a par-dessus ses petites oreilles. Elle s'amuse néanmoins à la chanter en polonais, ce qui, ma foi, est assez drôle.
Je vais donc découvrir à peu près tout de cette lecture vivante et la curiosité est grande de voir sa propre écriture prendre corps par le souffle poétique d’un autre.
De nombreux rendez-vous sont prévus, du Nord des Deux-Sèvres à l’île d’Oléron en passant par la Vienne…Un par jour, plus du temps que je compte bien consacrer à mes frangins, retrouver les pas qui sont inscrits là-bas dans mon histoire, le séjour en terre océane risque d’être court.
J’espère tout de même ramener dans mes bagages une vidéo que je mettrai pour vous sur l’Exil des mots.
Emotion de retrouver tous ces lieux que j’ai brodés de mes fantômes. Emotion intime, personnelle, voyage de l’intérieur car, excepté les frangins, aucune attente, hélas, de tout ce qui fut, jadis, le cercle joyeux de mes amitiés.
L’expérience de mai 2009, de laquelle j'étais ressorti accablé et qui avait ouvert le chapitre II de mon exil volontaire en lui donnant ce caractère d'irréversibilité sur lequel je ne m'étais jamais vraiment penché, m’a enseigné beaucoup.
Bien cordialement à tous et à toutes et à bientôt si la grève générale - ce qui serait marrant, de bon augure pour le peuple de France et digne d'un plaisant oxymore - ne me contraint pas à m'exiler plus longtemps en terre natale.
Bertrand
14:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.10.2010
Légende, fantasme, fait divers horrible ou je ne sais quoi encore...
 Il y a quelque temps de cela, je m’étais procuré un vieux livre de contes et légendes dans une bibliothèque. Un mauvais livre de reprises et qui ne citait même pas les auteurs ! Le tout desservi par un style d'une naïveté déconcertante.
Il y a quelque temps de cela, je m’étais procuré un vieux livre de contes et légendes dans une bibliothèque. Un mauvais livre de reprises et qui ne citait même pas les auteurs ! Le tout desservi par un style d'une naïveté déconcertante.
Parmi ces légendes, mal dites, mal écrites, souvent bêtes comme chou, de ce vieux livre, une seule m’avait accroché quand même. Par son sujet.
Sans que le mot ne soit prononcé, il s’agissait en fait de lycanthropie. La Louve blanche, qu’elle s’appelle, cette légende.
La lycanthropie. L’être redoutable qui remonte à la surface. Le monstre humain atavique qui prend soudain le dessus. Légende, fantasme ou réalité psychotique ?
Alors, je m'étais documenté un peu. Faut dire qu’ici, en Pologne où la forêt et la plaine sont blanches le tiers de l'année durant, dans ce silence héberlué des hivers continentaux, je suis un peu hanté, parfois, par l’image des loups.
Mon voisin le plus proche prétend même qu'un couple vagabonde dans la forêt, en face de chez moi ; qu'il a vu les traces.
Moi-même, un soir tout froid et de vent glacé, j'ai cru entendre hurler comme on dit que hurlent les loups.
Ce qui fait bien rire Dorota et Jagoda, mais bon...
Avec mon vieux et mauvais livre de légendes, donc, je suis resté pantois : Je me suis en effet aperçu que la légende était, en fait, un copier/coller d’un fait divers rapporté comme authentique !
Elle disait mot pour mot le cas d’Arline de Barioux, dont le procès avait eu réellement lieu en 1588, à Riom.
Je vous livre à peu près ce que j’ai pu en lire :
Arline de Barioux, épouse de Nicolas de Barioux, vivait une vie ordinaire et agréable dans les montagnes du Cantal. Elle était jolie, aimable, et son mari en était, paraît-il, follement épris.
Tous les vendredis après-midi, celle-ci avait cependant l’habitude de quitter le logis familial pour aller, la chère âme, porter de quoi se nourrir aux pauvres de la campagne environnante.
Une femme, ou un homme, qui s’absente régulièrement, même jour, même heure, sous quelque prétexte que ce soit, moi qui suis un peu parano, je trouve ça bizarre depuis la Fée Mélusine.. Mais bon, passons…
En fait, là, dans cette histoire précise, j’ai raison. Parce que tous les vendredis après-midi, il s'est avéré que l’angélique Madame de Barioux se rendait à la forêt où elle…. se changeait en louve furieuse et dévorait des enfants !!!
C’est en tout cas ce que l’enquête a déterminé.
Où ça, des enfants ? Est-ce que ça pousse dans la forêt, des enfants ?
Je n'en sais rien...Je dis simplement ce que l'enquête a établi.
Mais, las, las, las, trois fois las, un vendredi du gai printemps de 1588, Roger Griffoul, le chasseur du coin, revient bredouille de sa chasse. Il est pas content du tout, Griffoul. Comme tous les chasseurs bredouilles du monde.
Ça me fait penser, tiens, à une réflexion de Léautaud : Si les lièvres avaient des fusils, on en tuerait moins…
Mais ça n’a rien à voir ici…Et puis Léautaud, c’étaient plutôt des chats…
Revenons donc à nos moutons : Roger Griffoul, tout dépité qu’il était, voit alors surgir devant lui un énorme loup qui a vraiment l’air féroce. C’est dit comme ça dans l’histoire, d’où je me suis mis à supposer qu’il y en a des qui ont l’air gentil.
Griffoul tire. Sans succès.
En fait, ce Griffoul, ça doit être un maladroit, que je me dis. Parce que louper un merle, d’accord. Mais un loup ? Hein, c’est gros, quand même, un loup féroce !
Le loup, lui, en dépit de ce coup de fusil raté du chasseur dépité, veut en découdre et il montre d’horribles crocs baveux….Pour se défendre, Griffoul saisit son couteau de chasse et un combat féroce s’engage alors entre l’homme et le loup.
Et ça n'est pas une allégorie...
Courageux, Griffoul. Moi, poltron comme tout, j’aurais détalé de là en vitesse ou j’aurais grimpé à un arbre, quitte à attendre là-haut jusqu’au jugement dernier.
Mais Griffoul, lui, il n'est pas comme ça. Il réussit même à trancher une patte du loup…La patte droite, disent exactement les minutes du procès de Riom. L’animal abandonne alors le combat et s’enfuit, tout sanguinolent, sous les taillis épais.
Peu après, Nicolas de Barioux rencontre le chasseur Griffoul sur la route. Par hasard, sans doute. L’histoire ne le dit pas… Mais le hasard fait bien mal ou mal bien les choses. Parce que le chasseur, la face livide, le menton convulsif et la lèvre sèche et exsangue, balbutie :
- “Je me suis battu avec un loup, dis donc, je lui ai coupé la patte et voilà ce que je rapporte! ” et il montre une main de femme !
On serait effrayé à bien moins, convenons-en….Nicolas, lui, sent sa tête qui chavire : il reconnaît la bague au doigt de la main sanglante. Il s’agit de la bague de sa femme, bon sang de bon sang de bonsoir !
Arline de Barioux revient, elle, subrepticement au logis en fin de journée, longe les murs et se renferme à double tour dans sa chambre .
Mais comme de Barioux sait tout, il force la porte, et oblige la femme dont il est follement amoureux, à montrer l’ignoble blessure. Il exige des aveux. Comment ? Je ne sais pas…Toujours est-il que la louve, heu, la femme, avoue tout et moi c’est tout ce que je sais.
Eh, ben, dis-donc, il a dû avoir une de ses frousses a posteriori, le gars de Barioux ! Moi si je m’apercevais un jour que j’ai couché avec une louve sanguinaire pendant des années, que je l’ai caressée, aimée, qu’elle m’a embrassé le cou, la pomme d'Adam et même pire, je deviendrais vraiment fou à lier.
Pas lui. Il garde la tête froide et sa femme, heu, sa louve, il la livre à la justice.
Elle eut donc droit à un procès qui passionna les foules et elle fut brûlée le 12 juillet 1588 sur la grand-place de Riom.
Vous ne me croyez pas ? Mais allez-y, à Riom, vous verrez ! Vous demandez le tribunal, les greffes, les archives...Allez-y ! En plus, c'est joli, Riom...J'y suis allé. Une fois.
Voilà donc l’histoire…Je me demande quand même : en quoi un tribunal humain était-il compétent pour juger un animal ?
Mais c’était une femme !
Bon, ben alors, où était le problème ? On la jugeait parce que c’était pas une femme, justement...
Il y a de la controverse de Valladolid, là-dedans.
N'empêche que la légende du mauvais livre figure en langage approprié dans les archives d’un tribunal !
Et la question qui me tarabuste : Qui, du juge ou du grimaud, s'est nourri de l'autre ?
14:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.09.2010
Une situation singulière

Je connais un village dont le boulanger avait fait faillitte en une seule nuit au cours de laquelle les taux d’intérêts bancaires avaient été majorés de plus de 1000 pour cent ! Avant de faire sa valise au petit matin, le boulanger dépité avait inscrit en grosses lettres vindicatives sur le mur de son établissement « POMNIK DEMOKRACJI !", monument de la démocratie !
Vingt ans après, le sarcasme est intact et depuis la petite route qui serpente à travers la forêt, la colère de l’artisan est encore très lisibe.
Faut décrypter. Cette inscription est une éloquence de l’histoire.
On ne fait pas d’omelette sans casser les oeufs, n’est-il pas ?
Je vous dis tout ça parce que, des fois, ce passage à la vente forcée ne me semble pas partout complètement acquis dans les têtes et c'est ainsi que je m'étais retrouvé, il y a un an ou deux, dans une situation assez cocasse.
Ma maison est tout en bois. Il me fallait la peindre avant les rigueurs de l’hiver. Le menuisier avait été catégorique et il avait établi une ordonnance avec la quantité exacte et le nom de la peinture à utiliser. La meilleure. La plus chère aussi, diablement chère même, mais en contrepartie qui protège de tout : de la neige, des terribles gels, de la pluie, du vent, du soleil, des champignons, des bestioles xylophages dont toute la forêt alentour est infestée.
Je m'étais donc rendu, fort de l’avis d’un spécialiste, dans un grand magasin de peinture et j’avais montré fièrement ce que je voulais.
Le vendeur responsable, homme affable et grisonnant, s’était moqué. Pourquoi celle-là ? C’est la plus chère !
Oui, mais c’est la meilleure !
Oh vous, vous regardez trop la télévision ! Vous vous faites avoir par la télévision !
J’ai pas la télévision.
Alors, des gens qui l'ont vous ont abusé. Parce que cette peinture, vous savez pourquoi elle a du succès ?
Ma foi non. Peut-être parce qu'elle est bonne...
Ah, ah, ah... Bonne ! Vous pensez ! C'est parce que ses fabricants ont un budget publicitaire énorme et que tous les soirs ils assomment les benêts avec leurs boniments ! Faut pas croire, c’est de la vraie merde, cette marque !
Je suis pantois. Je remballe mon ordonnance...
Je désigne alors une autre peinture, moins chère. Ça vaut pas grand chose, ça non plus, affirme le sympathique grisonnant.
Bon, l’autre, alors, là, plus haut...Non, non, c’est du sous-produit, un mélange, ça vaut rien. Dans un an à peine, il vous faudrait tout refaire...
Je suis de plus en plus déconfit...
Bon, alors pas de peinture mais un produit spécial, là, que je vois avec un chalet de montagne bien joli sur l’étiquette. C’est bon ça ?
Alors ça, cher monsieur, vendre ça, c’est vraiment se moquer du monde ! Non, autant badigeonner votre bicoque avec de l’eau de source !
Je suis atterré.
Il n’y a plus qu’une seule marque. Je montre timidement.
Surtout pas ! C’est bourré de poisons, cette saloperie ! Sûr que vous feriez crever les parasites, mais vous en même temps.
Alors ?
Alors rien du tout.
Le vendeur avait fait son devoir. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Déjà il m'avait quitté et se précipitait au secours d'un autre acheteur qui, lui, voulait du vernis pour ses clôtures.
J'avais observé le manège d'assez loin et constaté que tout ce que voulait acheter ce nouveau chaland en fait de vernis, ça valait pas une queue de cerise selon le petit grisonnant.
J'étais donc sorti bredouille et décontenancé.
Inquiet aussi pour l’avenir de ma maison.
Et je m'étais dit que c'était là un gars honnête, ou parano, ou je ne sais quoi, mais en tout cas un gars qui n’avait pas bien compris que le monde était devenu un vaste tiroir-caisse.
Un monde où il n'y aurait bientôt plus de place pour lui.
14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.09.2010
Bingo !

Je ne reviens pas souvent en France. La dernière fois, c’était en avril 2009 !
Mais j’ai pris toutes mes précautions. Je suis un homme attentif à ses brèves incartades sur le sol de la mère-patrie : J’ai donc tous mes billets réservés, dûment payés, depuis le 22 février.
Huit mois à l’avance, que je m’y suis pris, pour être sûr de revoir la mer, mes frères, un ou deux copains et mon Zozo mis en lecture-spectacle.
Hé ben, bingo ! Ce jour-là, grève…Me voilà comme un con avec mes billets soigneusement rangés depuis le début de l’année dans un gros livre, les œuvres complètes d’Apollinaire, exactement !
C’est assez dire si j’y tenais à ces billets !
Je ne vais pas vous chanter les sempiternelles jérémiades anti-grévistes du consommateur de base pris en otage…Non… Non…On sait bien que les syndicats ont raison, les manifestants itou et que c’est dégueulasse de vouloir faire travailler les gens jusqu’à avoir un pied dans la tombe. On sait bien aussi que les syndicats vont faire reculer le législateur, que tout ça va s’arranger ; iIs sont résolument contre cette loi, les syndicats !
Je le sais bien : Je faisais déjà la grève contre Juppé, puis contre la loi Fillon, alors ministre des Affaires sociales sous Raffarin, c’est-à-dire ministre ayant en charge de briser menu les acquis sociaux… Quatre jours que j’ai fait la grève, la dernière fois...On était mobilisé à fond ! Sur 1200 employés que comptait mon administration, on était cinq ou six à la faire…Y’avait même un gars de FO qui ne la faisait pas toute, la grève. A cause des sous, voyez-vous…
Mais j’suis bien content d’avoir fait cette grève : Fillon, il a reculé…D’un poil de cul pour faire un bond en avant de dix mètres !
Comme il va reculer, là, c’est sûr…d’un millimètre pour foutre tout le monde dans la merde jusqu’à 67 ans.
Et ils le savent bien, les ténors grassement payés des syndicats….Ils le savent bien…Si cela ne se passe pas comme je dis là, je leur ferai, ici même, des excuses publiques.
Bref, me voilà dans l’incertitude complète pour un voyage que j’ai prévu depuis huit mois et tout ça, pour rien, en plus…Si ça devait servir à ce que les gens arrêtent de travailler à 60 balais et même avant, je serais prêt à sacrifier mes visites en France jusqu’à la Saint-Glinglin. Peut-être même jusqu’au dernier soupir et je le dis sans ironie aucune.
C’est ça, qui me fout en rogne…L’inutilité complète. Et mon manque de bol, aussi…Parce que je leur ai quand même donné huit mois et sur ces 240 jours, ils choisissent le mien pour faire grève ! On est parano, des fois, on se demande pourquoi…
Parce j’essaie bien de changer les billets, mais ils ne veulent pas, les malins…Oh, c’est pas sûr, on peut pas dire à l’avance, ce n’est pas de notre faute, faut venir à l’embarquement ….Et si l’avion i vole pas ? On trouvera un vol….Et la correspondance à Paris ? Ah, ça, c’est pas notre problème…Bon, ce doit être le mien alors…De toute façon, s’il n’y a pas d’avion, y’aura des sacs de couchage, au moins, que j’ai envie de demander ? Je serais seul que je m’en foutrais. Mais il y a une gamine aussi…
On s’arrangera pour vous trouver un vol, ne vous inquiétez pas…
On s’arrangera, j’aime bien l’expression…Et à l’autre bout, démerde-toi !
Surtout qu’à l’autre bout, c’est la SNCF qui prend le relais et la SNCF, celui qui s’en méfie ne perd pas son temps…Dernièrement, un groupe de Polonais n’a pas pu avoir son avion parce que le train avait plus de deux heures de retard ! Cloués à Paris, les Polonais ! Ils ont dû prendre un bus grandes lignes ; 36 heures de route, à leurs frais…
La SNCF rembourse ? Sans doute que non parce que le retard était dû à un vol de câbles, que ce n’était pas son fait à elle et que…Mais oui, mais c’est quand son fait à elle ? Quand un désespéré ou une, choisit de se jeter sous le convoi, elle n’y est pour rien non plus. Quand un arbre tombe, qu’un grand animal s’échoue sur les rails, qu’un automobiliste grille le passage à niveau, que la météo est vraiment trop mauvaise (formation de blocs de glace sur les câbles), elle n’y est pour rien non plus…Elle ne prend pas beaucoup de risques, l’entreprise modèle !
Les Polonais, ils sont revenus un peu éberlués par les façons de faire à la Française….
Alors, venir échanger, sans frais, des billets parce que les camarades sont en grève, non, ça, c’est de l’utopie. Du culot même !
Les syndicats, eux, pendant ce temps-là, ils comptent leurs ouailles ; ils donnent un coup de peinture fraîche à une légitimité qui en avait bien besoin…
Et la clique au pouvoir n’en a rien à foutre de tout ça ; un jour par ci, un jour par là…Bof, ça fait désordre mais les meubles seront sauvés…Pour lui faire lâcher l’os qu’elle tient dans sa gueule, il n’y aurait qu’une bonne grève insurrectionnelle, illimitée et coordonnée, tiens ! Mais ça, syndicats, politiques de tous bords et patronat en ont une telle peur bleue - et c'est bien là le consensus et le modus vivendi de tous ces apôtres - que c’est pas demain la veille que vous danserez la Carmagnole de la victoire, camarades empêcheurs de rentrer au pays en rond !
13:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, politique, parti socialiste | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Le livre de Michel Houellebecq
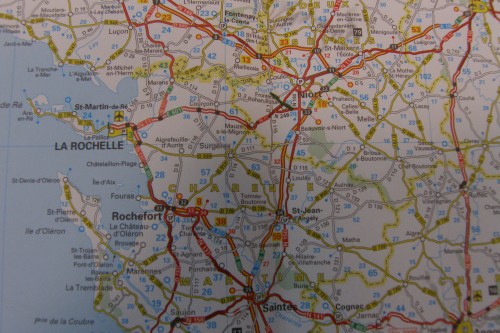
Ceci dit surtout pour un livre nouveau assez vierge de toute critique sérieuse, les ovations de bon aloi et les dénigrements systématiques - les oppositions par principe - ne rentrant évidemment pas dans le cadre d’une critique sérieuse.
De toute façon, je ne lis que très rarement les critiques d’un ouvrage :
« Bien avant l’écriture, on lisait. On décryptait alors le vol des oiseaux, la course des planètes, les signes avant-coureurs d’une saison, l’empreinte de l’animal, la couleur des pierres, les étranges avatars de la lune, la peinture sur la roche et la couleur des nuages. On lisait donc les choses et les êtres vivants dans leur confrontation directe au monde.
Avec l’écriture, nous sommes passés à la lecture indirecte. La lecture de la lecture de l’autre. Permettez cette petite digression : je ne lis jamais les critiques d’un livre. Se plonger dans la lecture de la lecture de la lecture d’un quidam m’est harassant. On finit par ne plus savoir ce qu’on lit et de quel monde on est parti. On tourne en rond, comme à peu près tout ici bas, et le propre d’un rond, c’est de finir où ça a commencé, n’est-ce pas ? »
Géographiques - TQF -
Pour bien d’autres livres autres que les nouveautés, disons les baroudeurs, ceux qui ont essuyé des années, voire des siècles de lecture, on est plus ou moins enclin à les aborder avec un bagage dans la tête.
« Je » lit, mais quelque part imprégné d’un « nous » et d’un« eux » plus ou moins confus.
Parfois aussi, pour les classiques, me revient en mémoire des bribes de très vieilles appréciations de mon prof de français, au lycée, excellent prof qui nous fit en même temps aimer Balzac, Villon et Stendhal, et que nous avions affublé d’un auguste sobriquet, « Cicéron ».
C’est donc tout à fait par hasard que j’ai lu « La carte et le territoire » de Michel Houellebecq. De lui, je n’avais lu qu’un recueil de poèmes que m’avait offert jadis Denis Montebello et, comme à peu près tout le monde, quelques années plus tard, Les particules élémentaires.
Depuis, je n’avais pas prêté attention à l’écrivain, franchement même rebuté par sa popularité, ses frasques convenues de misanthrope convenu et, plus dernièrement, ses imbécilités avec le penseur décervelé, Henry Levy. Tellement penseur, celui-là, qu’à chaque fois qu’il se mêle d’intervenir sur un évènement dramatique du monde, il a tout faux et devient recordman au bout de deux ou trois de ses interventions du nombre d’erreurs et de contre-vérités exprimables dans un laps de temps minimum.
Mais laissons le philosophe à ses tristes performances et revenons au livre de Houellebecq.
Je disais que le hasard avait voulu que je le lise. Ça n’est pas tout à fait exact, puisque ce hasard, je l'avais provoqué.
J'avais remarqué dans les notes de lecture de Jean-Louis Kuffer une certaine insistance à vouloir dire ce livre et je m’en étais un peu agacé. Je lui en avais fait part dans un commentaire, puis, dans l’après-midi, occupé à rentrer mon bois de chauffage à la brouette - dans un de ces instants où l'on pense à tout, sauf à ce que l'on est en train de faire - je m'étais dit que si un gars de la trempe de l’écrivain suisse, un bon camarade en plus, tenait absolument à faire figurer Houellebecq dans ses Riches Heures, c'est qu'il devait y avoir matière à bonne lecture.
Sur ces entrefaites-là, Dorota, alors en France, m’appelle et me dit qu’elle est en train de fouiner dans une librairie. Elle me demande de lui dire un titre, pour me faire un cadeau, bien sûr. Spontanément je dis « La carte et le territoire », puisque c’était à la sortie de ce livre que j’étais en train de cogiter en brouettant mon bois.
Voilà pour l’histoire de mon achat et pour tenter, bien vainement et sans importance aucune, de me dissocier des 200 000 autres qui, apparemment, ont eu le même réflexe que moi.
A la différence près que, eux, certainement, sont des Houellebecquephiles fins et avertis.
J’ai lu le livre sur un Week-end. Avec beaucoup de plaisir.
J’y ai trouvé un auteur attachant, oscillant toujours entre la dérision, le sordide, le dramatique, l'humour noir et la désespérance. J’y ai surtout trouvé, lu plus exactement, une quête pathétique de l’élément humain dans un monde résolument tordu.
Et j’y ai lu cette tragédie du XXIème siècle - amorcée à la fin du siècle précédent et finement énoncée en son temps par Debord - dans laquelle la représentation de la vie a complètement supplanté la vie, au point de devenir cette vie elle-même.
Un monde où le faux, l'image, le rendu, l'apparence, la mise en scène, tiennent lieu de vérités tangibles, définitives, en dehors desquelles nulle existence n'est possible.
Bref, un monde où la "carte est plus intéressante que le territoire" et qui, fatalement, en l'absence de toute présence véritablement humaine, est voué à l'engloutissement végétal.
08:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.09.2010
Mon voisin Stanisław
1

De l’autre côté de la rivière, commencent les steppes de Biélorussie qui se déroulent monotones jusqu’à Moscou.
C’était dans ma maison, donc.
Au dehors, le thermomètre déprimait en dessous de moins vingt-cinq et la neige était phosphorescente sous la pleine lune. Par la fenêtre, je voyais l’ombre pétrifiée des arbres, immobiles, mortes, encore plus mortes sous les reflets lunaires comme sont mortes les ombres des tombeaux antiques.
Un chien errant, famélique, rôdait devant ma porte, à la recherche des restes du repas que je mets là, par température plus clémente, disons jusqu’à moins dix, pour le chat.
C’était en janvier.
Assis en face de moi, le dos confortablement appuyé sur la chaleur du grand poêle, l’homme qui sirotait son thé était un vieil homme. Un vieux Polonais. Accablé par sa solitude de vieillard.
Le vieil homme, Stanisław qu’il s’appelle, me rend quelquefois visite, comme ça, l’hiver, avant le dîner. Pour causer un peu et rogner un lambeau de la longue nuit de l’est. J’aime qu’il me raconte….Il a vécu dans sa chair des tumultes sanglants.
Il dit souvent que la Pologne, au cours de son histoire, a été frappée par la damnation des enfers ! Comment ne pas l’être, hein, quand on a eu pour voisins, d’un côté la Prusse impériale et de l’autre la Russie des tsars ? Deux ogres… Avec en bas, en plus, les Empires Centraux…Pauvre Pologne ! Un mouchoir déchiqueté entre les puissantes mâchoires de trois pitbulls…Et plus tard, hein, l’Allemagne nazie d’un côté, de l’autre L’Union Soviétique…Des sanguinaires…Des fous furieux…Bouffée à l’ouest, la Pologne, le 1er septembre par le plus désaxé des hommes du 20ème siècle et à l’est, le 17 septembre, par le petit père des peuples.
Ah, elle en a vu la Pologne ! Et Stanisław sirote son thé et des ombres, des fantômes endormis, des douleurs inépuisées, sillonnent l’espace bleuté de sa pupille humide.
Stanisław, ce soir là, soudain, s’est mis à pouffer…Je ne lui connaissais pas cette gaité. Tiens, qu’il me dit, une fois, en janvier 1960 je crois, je montais la garde avec un camarade russe, Sergueï. Sur la frontière russo-finlandaise…Il faisait froid. Très froid. Il gelait à pierre fendre. Comme ce soir…Et comme ce soir aussi, c’était la pleine lune. C’est peut-être pour ça, que ça me revient aujourd’hui, cette histoire avec le camarade Sergueï….On se frottait les mains, on soufflait dedans, même avec nos gants, le fusil en bandoulière, et on arpentait inlassablement la rive d’une rivière gelée. On disait pas grand chose. On pensait à la relève, on pensait à nos femmes, à nos enfants et à nos frères…On aurait bien voulu rentrer chez nous, très loin, lui, du côté du Caucase, moi ici, au village. Mais un pacte est un pacte et celui de Varsovie ne rigolait pas !
Garder une frontière, quand le monde est partagé en deux, ça n’est pas rien !
Et tout d’un coup, là, sur la berge déserte, entre les barbelés, qu’est-ce qu’on voit, tous les deux en même temps, hein, qui flottait au vent et sous la lune et qui se traînait par terre…Hein, qu’est-ce qu’on voit ?
Un billet de 100 roubles ! Bon dieu ! Une solde entière qui se traînait là à nos pieds ! Et Sergueï avait été le plus rapide. Il avait couru, il s’était baissé prestement et avait agrippé le billet…
J’étais comme deux ronds de frites et furieux contre moi-même.
Alors, grand seigneur, Sergueï a déclaré :
- Camarade Stanisław, comme nous l’avons trouvé ensemble, ce beau billet, je propose qu’on le partage….
J’ai fait la gueule encore plus. Et j’ai protesté comme ça :
- Ah, non camarade Sergueï, pas partager avec toi, un Russe ! Je préférerais nettement qu’on fasse moitié-moitié !
*****
2

On a soudain frappé à ma porte et j’ai regardé par la fenêtre.
Oui, dit comme ça, ça fait un peu bizarre comme réaction …. Pourquoi ne pas regarder par la porte si c’est à la porte qu’on frappe ?
Parce que c’est une grosse porte pleine, voilà tout. Alors si on frappe à ma porte, je regarde par la fenêtre. Si on frappe à ma fenêtre, je ne regarde pas par la porte, rassurez-vous.
Elle est pleine, je vous dis, on ne voit rien au travers.
Donc, je regarde par la fenêtre : Surprise ! Il neige, il neige à gros flocons et le crépuscule est déjà tout blanc, tout livide….Le printemps, c’est pas pour demain, que je me dis, morose, et la grive et ses vrilles se sont fourvoyées et moi en même temps. Comment je vais faire, moi, si j’ai plus de bois pour me chauffer ? Il va falloir que je…
Oui mais pendant que je suis là, retenu à la fenêtre par mes considérations angoissées, le visiteur s’impatiente sous la tempête neigeuse et pousse la porte. Ah, salut ! C’est mon vieux voisin, Stanisław...
Sa lourde pelisse et sa chapka sont complètement enneigées et il s’ébroue à son aise pendant que je prépare le thé. Je lui propose une cigarette et on discute un peu. Je lui dis mes angoisses de chauffage. Il dit que c’est rien, faut pas que je me tracasse, ça ne va pas durer, on est en mars quand même ! Il ne fera pas en dessous de zéro, malgré la neige et la pleine lune qui arrive…Lui, il en a connu des grands froids ! Et le voilà qui, parti sur le froid et la pleine lune, se met à me raconter la même histoire que ci-dessus… Au détail près, tout, les gants, les barbelés, les 100 roubles sous la lune, ce que le camarade Sergueï a dit, mot pour mot, et ce qu’il a répondu, lui !
Alors moi je me dis que si un vieux gars peut raconter deux fois une même histoire qui s’est passée il y a cinquante ans, avec la même précision de détails, c’est que l’histoire est absolument vraie.
Je vous sens bouche bée, tout votre scepticisme anéanti.
Donc, moi qui suis un garçon poli et qui aime bien mon voisin, je fais semblant d’écouter pour la première fois, je suis suspendu à ses lèvres, je m’exclame aux bons endroits, je ris comme un bossu à la chute. Mais comme je me sens faux-cul quand même, je crois bon de rajouter, pour faire diversion, ah, cette époque communiste, ça ne devait pas être tous les jours dimanche !
Stanisław dit que bon sang (pas de virgule) de bon sang, non, c’était pas rigolo tous les jours et que…Tiens, une fois, qu’il dit…Tu peux pas savoir comme les flics étaient nigauds sous ce régime de flics !
Un soir, à Varsovie, pendant que j’attendais mon bus à l’entrée du pont Poniatowski, je vois deux flics sur ce pont qui étaient penchés et qui regardaient la Vistule.
« Sous le pont Poniatowski coule la Vistule,
Et nos amours… »
que je me mets à réciter comme un âne et Stanisław se trouble, légèrement hébété.
Je lui demande de m’excuser et, sirotant une petite gorgée de thé comme sirotent les vieillards, du bout des lèvres tremblantes, il continue que les deux flics ramassaient des pavés et les jetaient un à un dans le fleuve. C’était vraiment curieux.
Il était fort intrigué, Stanisław.
Alors il s’est approché doucement, faisant mine de rien, regardant au ciel la couleur des nuages et sifflotant un petit air de folklore russe…Plouf ! Plouf ! que ça faisait, et les deux flics à chaque fois mettaient les poings sur leurs hanches et hochaient la tête, comme des benêts perplexes. C’est alors que Stanisław en a entendu un qui disait à l’autre :
- Camarade Bogdan, j’ai vu et compris beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça…J’comprendrais jamais comment des pavés carrés comme ça réussissent à faire des ronds dans l’eau !
- Moi non plus, camarade Marek, qu’il a dit, l’autre, et il a jeté un énième pavé dans la Vistule et il s’est penché encore plus, bouche bée.
Celle-là, je ne sais pas si elle est vraie. Faudra que je vérifie. Je vais justement à Varsovie cette semaine et je passe par ce pont.
*****
3

Ces ronds dans la Vistule ont cependant bien failli coûter des ronds à mon pécule et je ne tenterai plus l’expérience. Je ne chercherai plus à prouver à tout prix la vérité de ce que j’écris là…
Sur le pont Poniatowski, donc, je me suis arrêté. J’avais laissé ma voiture un peu plus loin, à l’entrée, au pied de la statue du général de Gaulle. Oui, de Gaulle, d’un pas martial que lui auraient assurément envié les meilleures légions romaines de l’Empire à son apogée, orne une petite place des bords de la Vistule.
Qu’est-ce qu’il fout là, de Gaulle, hein ? que vous vous demandez sans doute…
C’est qu’il était venu aider les Polonais à guerroyer victorieusement contre les troupes de Lénine, en 1920. Une histoire de frontière que le rusé Lénine, après s’être fait rouler comme un bleu à Brest-Litovsk, ne voulait plus reconnaître…Il n’était encore que capitaine, de Gaulle. Mais la statue polonaise a quand même voulu l’immortaliser avec la stature d’un général…
Bref, tout ça, ça n’a pas grand chose à voir avec les ronds dans l’eau du pont Poniatowski. C’est juste pour dire que le fondateur de la 5ème République française encombre, pardon, orne, une place de la 3ème République de Pologne et que, moi, personnellement, si j’étais….Mais, bon, bon, aux ronds, aux ronds !
Donc, j’arrive à desceller en suant sang et eau un de ces foutus pavés carrés et je le balance dans le fleuve. Un rond énorme, de plus en plus énorme, qui s’est élargi, élargi et qui est enfin venu mourir en clapotis sur les bords de la Vistule, que ça a fait. Ben merde alors, que je me suis dit ! C’est de la sorcellerie ! Tu m’étonnes que les deux flics communistes, matérialistes comme ils étaient, on dû être estomaqués…
Des nigauds, qu’il dit Stanisław ! Il en a de bonnes, lui ! J’voudrais l’y voir ! Faudra que je l’emmène constater ça un jour…Et je m’apprête à reconduire l’expérience étonnante, je m’échine derechef à vouloir arracher un deuxième pavé quand retentit derrière moi un coup de sifflet rageur et que j’entends hurler :
- Prosze Pana co sie dzieje ? Co Pan robi tutaj ? ( S’il vous plaît, monsieur, que se passe t-il ? Que faites-vous là ? )
Je n’ai pas tout compris du mot à mot, mais j’ai quand même compris que les deux uniformes qui me fonçaient droit dessus voulaient que je leur explique ce que je fabriquais exactement là, à arracher les pavés de la voie publique. Tous les flics du monde - mis à part les deux originaux de Stanisław - savent qu’il y a toujours dans ce geste une sorte de gendarmophobie latente ou, quand ça chauffe vraiment, manifeste.
J’ai donc bredouillé en anglais que je faisais une expérience pour nourrir un texte sur mon blog, The exil of words, que j’ai balbutié, et les deux pandores ont froncé le sourcil, me tenant en arrêt sous leurs gros yeux inquisiteurs. Ils ont fini par comprendre que j’étais Français et qu’il ne fallait dès lors pas chercher à comprendre. Ils m’ont gentiment dit de déguerpir et hop, me v’là parti en courant vers ma voiture, au pied du général de Gaulle.
Je me suis éclipsé vers le centre de la ville. Si vous ne connaissez pas, venez un jour flâner à Stare Miasto, la vieille ville. C’est rose comme à Toulouse, c’est beau comme nulle part ailleurs et il y a là autant de mélancolie romantique qui flotte dans l’air que de désabusement sympathique et de désinvolture de bon aloi. Les vieux remparts, si chers au cul de madame Brel, ceinturent Stare Miasto sur l’un de ses côtés et surplombent les faubourgs de Varsovie, la belle, la martyre, l’éternelle Varsovie.
Un thé ! que j’ai commandé dans un petit bistro feutré, pour me remettre de mes émotions d’avec ces deux flics et de ces ronds bizarres faits dans l’eau par des pavés carrés ! J’ai allumé une Chesterfield et j’ai pris le journal…
J’aime être anonyme dans cette grande ville étrangère. Je n’existe pas, je ne suis pas là, les gens ne me parlent pas, ne me voient pas, je suis dilué, face à moi-même, face à mon destin d’exilé et mes ailes qui ne sont pas de géant ne m’empêchent nullement de marcher au milieu des huées de la foule…Je ne me fais jamais remarquer et…
Je me suis esclaffé très fort en me renversant très loin en arrière sur ma chaise, si loin que mes genoux ont chahuté la table, que le cendrier à terre s’est brisé et que mon thé a fait la culbute, maculant affreusement le beau tapis…. Les gens se sont retournés, certains ont haussé les épaules, d’autres ont souri, d’autres se sont levés pour m’aider à réparer le désastre, la patronne est accourue, aussitôt suivie du garçon de café empressé et gazouillant des trucs…
Bref, l’émeute.
C’est que je venais de lire le compte rendu d’un jugement d’assises…Si, si, j’arrive à déchiffrer en lisant lentement et en suivant du doigt les amoncellements de consonnes qui forment des syllabes, puis des mots, puis des lignes, puis enfin un petit texte.
Ça racontait un gars de la campagne, au nord, vers la Baltique, qui avait tué l’amant de sa femme. Son voisin, en plus, le fourbe de lubrique ! Le gars les avait guettés, puis pris en flagrant délit dans son lit en train de jouer gaillardement le jeu de la bête à deux dos, de souffler comme des phoques et de s’ébrouer comme des pourceaux…Il avait préalablement dissimulé un puissant arrache-clou dans un journal avec lequel il avait frappé son rival par derrière, sur la nuque, cependant qu’il besognait sa légitime par derrière, oui, Monsieur le Président, sur la nuque, qu’il l’avait frappé. (Je me demande si je n’ai pas oublié un point quelque part, moi…)
- Mais avec quoi avez-vous donc frappé ? que le Président de la cour avait demandé.
- Avec le journal, avait répondu le mari bafoué et vengeur.
- Et qu’est-ce qu’il y avait dans ce journal ?
- Je ne sais pas, votre Honneur. Je ne l’ai pas lu…
Et moi, à cause de ce foutu cocu assassin, de ces deux journaux, celui qui a tué et celui que j’ai lu, jamais plus je ne serai anonyme et peinard dans un petit bistro feutré de Stare Miasto.
*****
4

Et lui, qui les avait pris pour des demeurés ! Ah, il s’en voulait, il s’en voulait, le père Stanisłas ! Même plus de trente ans après, il ne se le pardonnait pas ! Comme quoi, avait-il conclu en hochant la tête à la manière de quelqu’un qui vient de découvrir une évidence définitive, faudrait toujours vérifier avant de moquer qui que ce soit !
Moi, le voyant embêté comme ça, je lui disais que ça n’était pas grave du tout ! Que de toute façon, les pavés dans la Vistule eussent-ils produit des triangles, des losanges et même des pyramides, les flics n’en restaient pas moins d’indécrottables jocrisses.
Par principe. Par postulat.
Il a froncé les sourcils, mon vieux voisin, il a bu une gorgée de thé, il a semblé réfléchir un moment et il s’est mis à rire, d’un petit rire chevrotant, du bout des lèvres, mais d’un de ces rires auxquels participe tout le corps, en tressautant, en se trémoussant légèrement et avec les yeux qui disent des choses gaies.
C’est sûr ! Ah, tu as bien raison ! Ils sont comme les Russes, les flics!
Là, j’ai voulu faire diversion et je lui ai offert un morceau de gâteau. Du gâteau aux graines de pavot. Les Polonais, et plus généralement les autochtones de l’Europe centrale, adorent ça.
Moi, un peu moins.
Stanisłas s’est penché en avant, il a délicatement pris la part de gâteau dans une main aux lourdes veines bleutées et en a détaché un bout de l’autre main, avant de le tremper dans son thé, le maintenant ainsi jusqu’à ce qu’il en soit bien imbibé.
C’est très bon, a t-il dit, et je te certifie que les Russes sont des sots. J’en ai fait maintes fois l’expérience. Tiens, dans les années soixante, j’étais de garde avec un brave type sur la frontière russo-finlandaise. Sergueï qu’il s’appelait. Un gars du Caucase.
Merde, que je me suis dit ! Il va me resservir pour la troisième fois son histoire de partage d’un billet de 100 roubles, histoire que je vous ai moi-même retransmise ici. Pauvre vieux, il radote un peu…C’est ennuyeux, quand même…J’ai allumé une cigarette et me suis préparé à faire derechef et poliment l’hypocrite attentif.
Oui, on était souvent de garde ensemble, là-haut, pas très loin des rivages de la Mer Blanche. Sergueï, il désespérait complètement de revenir un jour dans son Caucase natal, alors il avait loué une petite isba dans un village frontalier.
Tiens, tiens, que je me suis dit, confus, c’est pas le même scénario… Et j’ai réellement tendu l’oreille.
Il y ferait venir sa famille, un jour, qu’il disait…
Et c’est vrai que c’était grandiose cette région, avec des forêts immenses, des loups qu’on entendait hurler aux étoiles, des rennes, des lacs tout bleus et des monts sauvages. Le camarade Sergueï était très fier de son petit chez lui et toute sa maigre solde passait dans des réparations de fortune. Il clouait des planches là, changeait des madriers là-bas, retapait le toit, refaisait les ouvertures. Tout. Et quand il m’invitait, des fois, à venir passer un moment en son royaume, le Premier Secrétaire du Politburo n’était pas son cousin !
Un jour qu’on était de repos, donc, il m’invite. Il faisait un froid à ne pas mettre un révisionniste dehors, comme il disait toujours, le camarade Sergueï, en s’esclaffant comme un perdu.
Elle était très sommaire, sa maison : Deux pièces, un poêle en faïence un peu comme les tiens, là, mais beaucoup plus petit, un lit, une table et quelques chaises.
Et justement ce jour-là, de plein soleil sur un ciel glacé, Sergueï était en train de réchauffer le samovar quand le gros téléphone - obligatoire d’avoir un téléphone quand on est un militaire de garde sur une des frontières de l’empire - a sonné.
C’était un chef qui appelait. Un planqué de Moscou. Sergueï s’est tout de suite mis au garde-à-vous, comme si l’autre à 1000 km de là pouvait le voir ! J’ai trouvé ça sot comme tout…Bref… Le chefaillon au bout, il s’inquiétait du temps que nous avions là.
- Allô, camarade Sergueï, que j’ai entendu qu’il hurlait. Allô ? Comment ça se passe là-bas, avec ces températures, hein ? La rivière frontière est carrément gelée sans doute ! Va falloir redoubler de vigilance, camarade ! Il paraît qu’il fait moins 38° chez toi.
- Non camarade, Nikolaï, non, non, qu’il a bafouillé Sergueï. Il fait tout juste moins 15°.
- Comment ça, moins 15° ? Les bulletins officiels annoncent moins 38° sur la frontière. À l’endroit précis où tu es ! Moins 38°! Si tu veux démentir, camarade, il me faut un rapport. Tout de suite. Tu m’entends ? Il fait moins 38° chez toi ! C’est officiel !!
Alors le Sergueï, tout penaud, il est allé se pencher sur le petit thermomètre suspendu à une cloison, il a scruté, il a tapoté dessus et il a répondu poliment au camarade chef moscovite :
- Bon, d’accord…Mais ça doit être dehors alors…Parce que chez moi, comme je t'ai dit, il fait…
L’autre a raccroché.
*****
5

Il répandait ses premières douceurs par tout le pays. La neige accumulée durant des mois avait finalement fondu, mais la terre rassasiée ne parvenait plus à engloutir tout ce dégel dont l’eau stagnait maintenant dans les creux et les vallons, formant partout de petits étangs impromptus. Le ciel bleu et blanc s’y mirait, le vent en ridait la surface et des cigognes s’y reposaient, juchées sur une patte, leur long cou légèrement rentré, immobiles et la plume ébouriffée.
Quelques papillons jaunes d’or voltigeaient déjà de brin d’herbe en brin d’herbe. Dans les buissons alentour, les grives et les merles cherchaient aventure nuptiale, modulant des gammes toutes plus harmonieuses les unes que les autres, tandis que sur les branches les plus hautes des bouleaux, des ramiers accroupis roucoulaient, rauques et sérieux.
L’hiver polonais, le long et blanc hiver polonais, avait desserré l’étau et les choses de la terre, longtemps étouffées sous l’étreinte, ouvraient grand leurs poumons et reprenaient leur souffle.
À la faveur de ce premier soleil, nous étions assis, Stanisław et moi, sur le petit banc installé devant la maison. Nous regardions sans parler tout ce réveil s’ébrouer devant nous, le goûtant chacun avec notre peau, chacun avec nos yeux, chacun avec ce que nous portions en nous de printemps mémorables.
Sur le chemin de terre qui longe mon territoire, un grand cheval roux cependant, avec une crinière très blonde, tirait une petite charrette. Un vieil homme était assis sur le côté, les pieds pendants dans le vide et tenant dans ses mains les rênes. Tout cet attelage allait bientôt s’engouffrer dans la forêt et Stanisław me le montra d’un geste vague, en riant sous cape et en hochant les épaules.
- Il me fait toujours penser au général Kipetrovotch, ce corniaud, avec sa jument, ricana t-il.
Je levai la tête.
Ce cheval, ce vieil homme, cette charrette, me ramenaient, chaque fois que je les voyais monter vers la forêt, au pays de mon enfance, très loin, vers les balbutiements d’une autre époque. J’éprouvais toujours la même impression d’un arrêt du temps, comme une goutte d’eau soudain suspendue dans l’air. Des visages, des odeurs, des sons, des espoirs revenaient. Puis les images s’estompaient et je revenais au présent, très loin devant, beaucoup plus près du fatal horizon.
Apparemment, le cheval et sa charrette ramenaient aussi Stanisław vers un ailleurs à lui. Je lui tendis une cigarette. Je savais bien qu’il attendait que je le questionne alors…
- Le général Kipetrovotch ? Connais pas…Qui est-ce ? Demandai-je, un tantinet faux-cul.
- Ah, tu peux pas connaître…Pas célèbre du tout, le gars… Ecoute, moi, je m’en souviens très bien parce que…
Stanisław s’interrompit, se frappa très fort sur la cuisse et partit d’un grand éclat de rire…Ah le con ! Le con ! Un Russe, comme tu peux t’en douter ! Je t’ai déjà dit qu’ils étaient tous sots comme des brebis. Même leurs généraux…Parce que celui-là…
Figure-toi qu’en cinquante-neuf, j’avais été mobilisé très loin à l’est. Notre régiment avait été gentiment invité, si tu vois ce que je veux dire, à venir faire des manœuvres et des exercices avec un régiment russe, très loin sur les rivages de la Mer Blanche, où il faisait un froid abominable.
Le général Kipetrovotch, qui commandait toute la région militaire, nous avait fait la mauvaise surprise de débarquer un soir et de passer en revue ce maigre échantillon, stationné ici pour un temps, des vaillantes troupes cosmopolites du pacte de Varsovie. Nous étions en rase campagne. Une campagne glacée, blanche, déserte, immobile. Sans une voix. Presque lunaire.
Le hasard voulut que le général s’adressa d’une voix forte et puissante à notre petite escouade.
- Comment ça va, ici, camarades soldats ?
- Très bien, camarade général !
- Il ne vous manque rien ?
- Absolument rien, camarade général. Tout va bien, brailla l’escouade d’une seule voix.
- Mais….Le haut militaire sembla hésiter un instant et s’approcha doucement du plus petit d’entre nous. C’était le camarade Sergueï, tu sais, celui que j’ai retrouvé plus tard sur la frontière finlandaise et dont je t’ai déjà parlé. Tu te souviens ?
J’opinai du chef. Stanisław en racontant avait toujours un demi-sourire accroché aux lèvres…Quelque chose de cocasse flottait à n’en pas douter dans sa vieille tête. Il se pencha à mon oreille, mit sa main comme un petit porte-voix et chuchota, imitant ainsi le général Kipetrovotch à l’oreille du pauvre Sergueï.
- Et les filles, hein ? Comment faites-vous pour les filles, dans ce désert, camarade soldat ?
- Les filles ? Ah, les filles….Il avait l’air d’un benêt, le Sergueï. Il était rouge comme un soleil couchant, il baissait les yeux, il se dandinait comme un dindon sur une braise…
- Alors, hein ? réponds-moi, soldat…Comment faites-vous, pour les filles ?
- Heu…Pour…Pour ça….Il y a la jument, là, dans le petit baraquement, et Sergueï, honteux et le regard toujours baissé, montra d’un geste vague une écurie en bois, un peu à l’écart, juste à la lisière de la forêt.
- Ah, la jument ! Les coquins ! Ah, les coquins ! Les polissons ! Le général était fendu jusqu’aux deux oreilles et il se frisait en même temps la moustache, d’un air content. Il flatta familièrement l’épaule de Sergueï, et tourna les talons, soudain gai comme un pinson.
Il advint cependant qu’il se présenta à nous le lendemain matin, l’appendice nasal douloureusement tuméfiée, le visage défait, un œil au beurre noir, le pantalon froissé, maculé, déchiré par endroits ….Il se précipita sur Sergueï, comme ivre de colère. Il lui commanda méchamment de sortir des rangs, l’entraîna à l’écart en le tenant par le bras et en le soulevant quasiment de terre, puis, serrant les poings devant son visage, lui demanda : La jument, hein ! La jument ! Et comment vous y prenez-vous donc, avec cette satanée jument ?
Le pauvre Sergueï tremblait de tous ses membres. C’en était pitoyable ! Il en tremblait doublement. De froid et d’effroi. Alors il balbutia l’exacte vérité.
- Camarade général…C’est simple…..Nous l’attelons au traîneau et…et nous filons au village de Brdnoï, à huit kilomètres derrière la forêt…Il y a là bas un cabaret.
Un cabaret avec des filles, camarade général…
*****
6
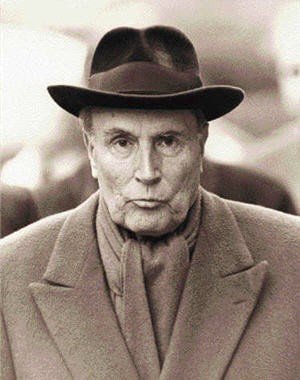 J’ai bien ri, sans vergogne je l’avoue, quand Stanisław en eut terminé de son histoire.
J’ai bien ri, sans vergogne je l’avoue, quand Stanisław en eut terminé de son histoire.
J’ai bien ri de la méprise de ce général aux fantasmes sordides et Stanisław, cabotin, en a évidemment rajouté aussitôt, imaginant le général aux prises avec cette jument, grotesque, ridicule, impudique et finalement maltraité.
Oui, oui, que j’ai dit….Mais ça ne veut pas dire que, pour un général désaxé, deux flics benêts qui lancent des pavés dans la Vistule, un Sergueï ingénu devant son thermomètre, tout le peuple russe soit idiot ! Enfin, père Stanisław ! Des histoires de ce type, tous les peuples en possèdent un échantillon ! Même les Belges !
Ah, tu dis ça, parce que tu les connais pas ! J’pourrais t’en raconter des centaines, sur eux ! Toutes plus cocasses les unes que les autres ! Tiens, toi, qui es un Français, en as-tu une, par exemple, de ce que les Français pourraient être des idiots, des fois…Hein ?
Pas une que tu as à me raconter ! Tu vois bien !
Le soleil d’avril nous réchauffait les os. J’écoutais toujours les fourmillements du printemps s’éparpiller autour de nous. Je pensais à la France, justement, quittée depuis si longtemps et que j’allais bientôt revoir. J’y pensais avec douceur. Des visages et des voix amis se recomposaient. Vrai alors qu’une histoire qui aurait pu la dénigrer, de si loin, maintenant que je n’y vivais plus depuis des années, ne me venait pas à l’esprit.
Et Stanisław triomphait de mon silence, me tapant sur l’épaule comme pour me consoler, et riant de toutes ses quelques dents.
Je lui offris une cigarette et lui dis que lorsque je vivais en France, c’est au-delà d’elle que je trouvais que c’était beau. Je m’en foutais de mon pays. Mais l’exil, même volontaire, transforme les émotions. L’arbre déraciné pleure ses racines, sa rivière et ses roseaux…Alors, non, je ne trouvais pas d’histoires qui puissent faire rire aux dépens de mon pays.
Stanisław me dit, les yeux soudain baissés, qu’il savait cette étreinte des exils. Il est d’un peuple à forte tradition d’exil. Tous ses enfants vivent hors de Pologne et ses petits-enfants aussi.
C’est alors que j’intellectualisai ma réflexion. Je me dis soudain que France ou pas France, cette nation renfermait en son sein un tas de corniauds et de salopards. J’en avais fait la triste expérience pendant un demi-siècle quand même ! Je pensai à la politique : Pompidou, d’Estaing, Mitterrand, Chirac et maintenant, cerise sur un gâteau qui n’en avait nul besoin, Sarkozy le mesquin, le petit, le chafouin…Est-ce qu’un peuple qui se choisissait régulièrement des timoniers aussi vulgaires était digne de ma nostalgie ? Qu’est-ce que c’était que ce vague à l’âme à quatre sous ? Je m’ébrouai, comme sortant d’une rêverie.…
Eh bien si, que je dis à Stanisław, j’en ai une, anecdote, tellement grossière qu’elle a bien failli tourner au drame et raviver tantôt les cataclysmes des guerres de Cent ans. Et tu vas voir comme les Français peuvent être raffinés dans la sottise. Tout autant que tes Russes.
C’est une histoire de cheval aussi.
Stanisław fronça les sourcils, plissa les yeux, incrédule, et fit un petit « ah ? » haut perché, avant de tendre une oreille dubitative.
C’était en octobre 1984.
Le Président de la République, en la personne de François Mitterrand, rendait visite à la Cour d’Angleterre. Reçu avec tous les honneurs dus à son rang, faste, solennité, luxe et protocole royal, le socialiste en bombait avantageusement le torse, lui qui, en privé, se passionnait pour l’histoire généalogique de toutes les têtes couronnées d’Europe.
La foule applaudissait, la garde faisait sonner haut et clair les trompettes et battait le tambour, tandis que le cortège officiel parcourait lentement les abords du château Saint-James.
Depuis une élégante voiture que tirait un cheval blanc somptueux, confortablement installé aux côtés de Sa Majesté, Mitterrand saluait, souriait, resplendissait tandis que la Reine faisait de même, agitant délicatement sa main gantée de blanc en direction de son peuple en liesse.
Mais il advint, tu ne vas pas me croire, Stanisław, que le cheval, bien que serviteur zélé de la famille royale et des grands de ce monde, leva la queue qu’il portait ornée de pompons rutilants et se soulagea sournoisement, comme un vulgaire canasson de ferme, d’une de ces flatulences pestilentielles dont seuls les équidés ont le secret.
La Reine et le Président, fort incommodés, firent comme si de rien n’était et continuèrent, tout sourire, leurs simagrées face à la foule radieuse. Pour aguerris cependant qu’ils fussent l’un et l’autre à l’hypocrisie, pour maîtres qu’ils fussent passés dans l’art de se composer un visage et de faire fi des détails inconvenants au nom de leur auguste image, tous les deux avaient tellement hâte que cette chaude puanteur s’évacuât qu’ils ne pensaient désormais plus qu’à ça ….La Reine était rouge comme une pivoine et, de temps à autre, s’épongeait le front avec un petit mouchoir de dentelles brodées.
Enfin, n’y pouvant plus tenir, elle murmura à l’adresse de son hôte, en remuant à peine les lèvres, sans le regarder et tout en saluant ses sujets de sa belle et vieille main gantée :
- Vous me voyez absolument désolée, Monsieur le Président…Je vous prie de bien vouloir nous pardonner cette terrible entorse faite au protocole.
Et le socialiste démocrate de Président de répondre, tout en continuant lui aussi ses singeries à l’adresse des spectateurs :
- Oh mais, n’eussiez vous rien dit, Majesté, que j’aurais continué d’incriminer in petto ce pauvre cheval…
*****
7
 J’ai dû tapoter énergiquement le dos courbé de mon vieux voisin, tant son hilarité l’étouffait, tant il était rouge et tant il était agité de petits mouvements convulsifs.
J’ai dû tapoter énergiquement le dos courbé de mon vieux voisin, tant son hilarité l’étouffait, tant il était rouge et tant il était agité de petits mouvements convulsifs.
J’ai quasiment eu peur.
Puis il s’est remis lentement, les yeux en pleurs, le corps tressautant encore sous les dernières ondes de choc du fou rire.
On s’est tu alors et on s’est laissé bercer encore par les premiers rayons du soleil d’avril. Une cigogne, sa large envergure déployée sur le printemps bleu, est passée très haut. Nous l’avons suivie des yeux un moment. Sa course a coupé à la perpendiculaire le nuage rectiligne d’un avion silencieux qui filait droit sur Moscou.
- Mais…Faut pas que ça te vexe, a murmuré Stanisław.
- Quoi donc ?
-Ben, je t’ai un peu forcé la main pour que tu racontes une histoire sur ton pays… Ton pays qui te manque…Je sais que c’est pas bien…
J’ai bien sûr rassuré Stanisław. Je lui ai dit que je m’en foutais complètement de Mitterrand, de Sarkozy, de Royal et de tous les autres canards boiteux de la scène politique…Ça n’était pas ça, pour moi, mon pays….Je lui citai Brassens : Je n’aime pas ma patrie, mais j’aime beaucoup la France….
Ceux que j’aimais là-bas, n’accéderaient jamais à ce niveau spectaculaire de la veulerie. Ça n’était point là ni leur goût, ni leur cheminement et ni leur ambition.
Ah, je pense bien ! Mais tu sais, en Pologne aussi, il y a des sots…Et je pressentais que Stanisław cherchait à être quitte, s’obstinait à vouloir faire un échange. Un Français ridicule contre un Polonais pas brillant. Une sorte de dédommagement. Par amitié.
- Ah bon ? Non ? Pas des sots comme les Russes, quand même ? Ai-je taquiné.
- Non, quand même pas ! N’a pas pu s’empêcher de s’exclamer Stanisław. Mais quand même…
Ecoute…. Après avoir été démobilisé, j’ai travaillé quelque temps dans les usines Polonez, la seule voiture qui ait tenu durablement la route et qu’on ait réussi à fabriquer chez nous.
C’était le 12 avril 1961…Ça te dit quelque chose, le 12 avril 1961 ?
Je cherchai dans ma tête. 1961 la guerre froide, bien sûr…C’était vaste…Non, ça ne me dit rien.
- Tu vas comprendre.
Ce matin-là donc, comme tous les matins d’ailleurs, on était à l’atelier de montage. Ça burinait là-dedans, ça tapait, ça soudait, ça forgeait, ça vissait, ça découpait…Il y avait un potin d’enfer !
Et soudain, est entré dans tout ce fourbi, en retard comme d’habitude, le camarade tourneur-ajusteur Franciszek.
Il levait les bras au ciel, il gesticulait comme un pantin, il hurlait, il était rouge, il suait, il vociférait. Il voulait être écouté.
On s’est arrêté d’usiner et le silence est tombé dans l’atelier, étrange, apeuré même :
- Les gars, les gars, a crié éperdument Franciszek, les Russes sont sur la lune ! Les Russes sont sur la lune !
Ce fut alors une exclamation unanime de joie, des clameurs, des embrassades, des accolades, de petites valses improvisées même, certains camarades se prenant par la main et exécutant deux ou trois pas de danse autour des machines. On était aux anges…
Soudain, j’ai eu un doute. Trop de bonheur d’un coup, tout ça… Trop facile. Trop beau. Craignant le pire, j’ai réclamé silence en tapant sur de la tôle avec mon marteau. Je me suis égosillé. On s’est tu peu à peu, on m’a regardé vilainement comme une bête curieuse, comme un emmerdeur de russophobiser en rond.
J’ai demandé doucement à Franciszek :
- Tous les Russes ?
- Heu..Non…Non, non…Un seul… Youri Gagarine, qu’il s’appelle.
Et ce fut la stupeur, le désappointement, la tristesse, puis enfin la colère, d’autant plus grande qu’un formidable espoir venait de souffler sur l’atelier.
On s’est remis au travail, plus morose que jamais, et on a menacé du poing le pauvre Franciszek.
Certains même l’ont pris à partie et qualifié de traître et de sale menteur !
Textes -modifiés- publiés sur Les sept mains au printemps 2009
12:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.09.2010
Archéologie
 Chaque matin de septembre, ou presque, sur la route impeccablement revêtue, la route régionale qui musarde de Łomazy à Biała, entre les forêts, je les rencontre.
Chaque matin de septembre, ou presque, sur la route impeccablement revêtue, la route régionale qui musarde de Łomazy à Biała, entre les forêts, je les rencontre.
Je sais qu’ils seront là.
A la sortie de tel ou tel virage.
Il me faudra freiner à mort avant de les doubler, si la voie est libre. Ou alors, il y aura déjà une file d’attente, les feux stop aux abois, les clignotants impatients, un coup de klaxon peut-être, d’un qui est déjà en retard, ou qui est plus nerveux que tout le monde.
Car ils ne vont vraiment pas vite. Ils flânent, ils cahotent, ils vont peinards, insouciants, en marge, dans le matin gris de l’automne qui s’annonce.
Avec du vent qui frissonne dans les branches, de chaque côté de la route.
Ils sont lents, mais ponctuels.
Ils, c’est un cheval, une charrette et un homme. Un grand cheval roux avec une crinière généreuse et noire, un peu maigrichon, et qui hoche la tête de droite à gauche tout en cheminant sa vie de cheval. Il a des pompons de laine rouge qui se balancent sur ses œillères ; C’est son code de la route à lui et ça veut dire : Attention, cheval qui s’effraie des voitures !
Il tire une charrette étroite lourdement encombrée de bois de chauffage. Des chutes de la scierie de Lisy, toute proche. Du chêne.
L'homme est assis sur le chargement, presque au sommet, confortablement installé entre les bois, les pieds dans le vide comme s’il montait en amazone. De très longs rênes flottent de l’encolure du bidet jusque dans ses mains, en effleurant la croupe chevaline et le timon de la petite carriole.
C’est un assez vieil homme. Il peut bien avoir soixante-dix ou quatre vingt printemps. Invariablement, un brûle-gueule s’agace entre ses quelques dents et comme il est obligé de le tenir serré, on dirait qu’il sourit.
Il est mal rasé et il a les yeux très bruns.
De temps à autre, il soulève une fesse, étire son cou, se pousse du col et jette un regard en arrière, pour voir si l’embouteillage n’est pas trop conséquent quand même.
Qu’il le soit ou pas, de toute façon ça ne changera rien. Il fait ça pour voir, histoire de se montrer urbain, peut-être.
Car il n’ira pas plus vite pour autant, le cheval est à fond, quatre ou cinq à l’heure. Et il ne se rangera pas sur le bas-côté. Il n’y a pas de place…Un bidet, c’est pas une mécanique, ça ne se manœuvre pas comme ça ! Et puis, s’il est là, c’est qu’il a à faire. Chacun son rythme. Chacun sa saison. Chacun son époque. Chacun son commerce.
Il tire sur sa bouffarde et il sourit.
Il a rendez-vous. Il va livrer son bois à quelque citadin de Biała. Un chargement doit bien lui prendre la journée entière. Son arithmétique est autre. Son commerce, c’est presque encore du troc.
Il est un de ces derniers Apaches encore debout, encore ponctuels, avant que l’Europe centrale, comme l'écrit Stasiuk, n’en soit réduite à n’être plus qu’une notion météorologique.
S’il venait à disparaître, un bout de poétique de ce coin de Podlachie s’envolerait au vent et il est pour moi comme un frère parce qu’il est un morceau éparpillé de ma propre archéologie.
Ferait-il son petit trafic en tracteur, qu’il m’agacerait, à me ralentir comme ça !
Jagoda jette toujours un œil à la pendule, du plus loin qu’elle aperçoit le sombre chargement, avec les pattes du cheval qu’on voit, par en-dessous la charrette.
L’école est à huit heures…
13:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.09.2010
Prolétaires de toutes les unions, dépaysez-vous !
 Sans doute une des qualités premières de l’intelligence réside-t-elle aujourd’hui dans cette humilité : Admettre que nous ne comprenons plus grand-chose au monde auquel nous sommes confrontés.
Sans doute une des qualités premières de l’intelligence réside-t-elle aujourd’hui dans cette humilité : Admettre que nous ne comprenons plus grand-chose au monde auquel nous sommes confrontés.
Même si nous y trempons régulièrement notre plume, même si nous disons notre mot sur à peu près tout, parce que nous refusons, au fond, cette démission. Une démission n’est jamais très reluisante, si elle n’est l’expression intégrale de la souveraineté du démissionnaire.
Mais au moins savons-nous désormais que nous ne savons plus rien et laissons-nous avec joie aux muscadins du sérail – critiques littéraires, critiques tout court, commentateurs politiques, journaleux etc. - le soin de faire les bouffons qui savent, les lèche-culs, contre-culs et autres tailleurs de pipes molles.
Nous ne comprenons rien au monde parce que les dés en sont tous pipés. Ce monde a perdu son discours, notre langage en a du même coup été confisqué. Les mots sont désamorcés, les manches bourrées de fausses cartes. Nous reste que les clichés qui, par définition, sont les standards de la pensée quand elle ne pense plus et de l’émotion quand elle ne s’émeut plus de rien.
Accident tragique là-bas ? Bof…C’est peut-être un attentat. De ceux de cette guerre permanente, sournoise, que se livrent avec délices les Etats en temps de paix, quand ce ne sont pas les factions à l’intérieur d’un même pays.
Ben Laden ? Terroriste insaisissable de l’islamisme ou invention spectaculaire de l’occident ? Chapitre de la stratégie globale de la peur, comme les glaciers qui fondent, les menaces de pénuries d’eau potable, les moustiques qui tuent, la grippe qui ravage ? Tout est devenu possible tant l’impossible a été imaginé par tous les pouvoirs.
J’exagère ? Allons, allons, trêve de feinte candeur ! Souviens-toi de Katyń. Une tuerie monstrueuse, une boucherie démentielle, suivie d’un mensonge diabolique que toutes les démocraties du monde – tous pouvoirs et opposants de gauche confondus - ont fait semblant de croire pendant un demi-siècle parce que le mensonge était du côté du vainqueur. Staline aura apporté cette phénoménale contribution à l’histoire : La mise en dimension réelle du Prince de Machiavel, le mensonge d’Etat et la peur comme arts suprêmes de gouvernement.
Les démocraties modernes lui doivent beaucoup. Qu’elles rabaissent un peu leur caquet moralisateur ! Et il ne peut d’ailleurs en être autrement : L’homme est, en soi, un être ingouvernable sans l’épée, factuelle ou virtuelle. C’est même là son côté le plus attachant. Celui que j’aime en lui. Reste l’essentiel jamais atteint : trouver les intelligences et les courages capables de briser l’épée sur le crâne du conquérant.
Sortie d’un bon livre ? Ouais, après gesticulations dans tous les sens de la critique professionnelle ou amatrice, plateaux de télévision et relais par la presse de masse, en papier ou numérisée, faiseuse de chefs-d’œuvre. Lisons plutôt les livres de l’ombre, de la solitude silencieuse, ou revenons-en calmement, restons-en peut-être, à Balzac, Stendhal ou Flaubert. Au moins, s’ils ont été supportés par la pub, je suis certain qu’elle ne m’était pas destinée. Face à eux, je suis vraiment seul dans ma lecture.
Lisons à l’abri des brouhahas de salons qui n’osent même plus dire leur nom.
La retraite au-delà de soixante ans, presque à soixante-dix ? Ben, ça, c’est vraiment vache…Mais comment qu’on finance, sinon, qu’il dit Fillon. Et comment ce qui était possible il y a plus de 25 ans ne l’est-il plus ? Que je dis, moi….On recule ? Mais alors que vaut une organisation sociale qui recule sinon la corde qui la pendrait ? Et la croissance, alors, elle est allée où dans tout ça ? Ce sont les patrons et les capitalistes qui…Oh, oh, du calme ! Ça fait des années et des années, des décennies - des hommes même dans les siècles passés sont morts sur des barricades avec ce discours-là au bout des fusils - qu’on te dit de leur casser la gueule, à ces salauds, et tu n’a jamais bougé d’un poil…Pire, il t’est arrivé de prendre leur parti contre nous. Quand nous te disions, du temps de notre fol enthousiasme, que le meilleur de cette racaille était digne du peloton, tu nous traitais de voyous et de désaxés ! Alors, ta retraite, hein, tes banderoles, tes jérémiades face au désastre accompli, démerde-toi ! Tu me diras que je ne suis pas concerné et que j’en parle à mon aise. Certes. Mais le nombre de fois où une loi scélérate est venue briser mes espoirs, bouffer ma liberté et me toucher de plein fouet dans ma vie, je n’ai pas vu ton bouclier haut levé !
De toute façon, ils t’auront la peau. Parce qu’elle est à vendre au plus offrant, ta peau : Tes porte-parole sont aussi pourris que tes adversaires, dans cette lamentable histoire.
Les Roms ? Tout le monde y va de sa sauce prête à l’emploi. Les uns avec des arguments de la plus sinistre mémoire, les autres avec des bêlements de vierges effarouchées, des couinements d’anges outrés dans leur chair. Les Roms eux-mêmes, dans cette cacophonie, on s’en fout un peu.
Et qui les connaît en fait ? Ils passent, viennent, reviennent, disparaissent, s’exhibent ou se dissimulent. C’est selon. Le caractère insaisissable est un trait marquant de leur différence. Inconnus aux bataillons des fichiers retraite/sécu/INSEE. Plutôt enclins aux fichiers qui relèvent du ministère de l’intérieur, ces gens-là. C’est bien ce qu’on leur reproche, les uns en les expulsant manu militari, les autres en les faisant des citoyens européens à part entière. Tout d’un coup. On dirait qu’ils viennent de le découvrir, ces corniauds !
Même si cette qualité est incontestable du point de vue de la géopolitique, ce me semble une étiquette de propagande qu’on leur a collé en vitesse sur le dos, plus qu’une claque amicale. Pour les besoins de la cause.
Et toi, le pleurnicheur au grand cœur, n’as-tu jamais baissé les yeux de honte et de dégoût des hommes, devant cette vieille Roumaine, visage buriné, visage hâlé, visage défait sous ses cheveux luisants, accroupie sur le trottoir, devant l’église où tu étais venu discuter le bout de gras avec ton dieu ou devant le supermarché où tu étais venu chercher de quoi te goinfrer ; cette vieille roumaine avec des yeux qui savent implorer, avec les larmes qu’il faut et des mains qui savent trembler en se tendant vers toi ?
Qu’as-tu fait à ce moment-là ? Tu ne t’es pas dit que ton pays n’était un pays d’accueil que dans l’esprit ? Quand tu accueilles un ami, tu lui verses sa soupe sur le pas de ta porte, peut-être ? Comme aux chiens errants ? Dis-moi, pleurnicheur attendri, quelle différence fondamentale avec l’expulsion ? Dis-le-moi. Eclaire ma lanterne sur la haute idée que tu te fais de la dignité. ! Sais-tu ce qu'est l'exil et, à plus forte raison, un exil vautré dans le ruisseau, la main tendue vers ton confort ?
Les commentaires sont ouverts, lâche la bonde si tu viens à passer par là !
Qui a raison dans tout ça ? La bonne conscience dit : Nous, braves défenseurs des droits de l’homme.
C’est ce que j’aurais évidemment tendance à dire tout de suite. Mais trop aguerri aux mensonges et à l’occultisme des intérêts qu’ils servent, prudence. Prudence sur les Roms, comme sur tout.
S’approcher des vérités définitives comme le chat s’approche de la braise.
D’où je parle, moi, me diras-tu, vexé sur tes ergots ? De l’intérieur. Et je vis ma vie en étranger, mon pote. Voilà d’où je parle.
Les Roms, on m’a appris à en avoir peur quand j’étais petit. L’Autre. Celui qui vient de loin. Celui de l’ailleurs. Celui qui passe trois semaines avec toi sur les bancs d’école, dont le père vole tes poules, qui a une fronde plus puissante que tout le monde dans ses poches, qui ne sait pas lire mais qui rit de tout, qui te serre la main très fort, si fort que ça fait chaud jusqu’aux poumons, et puis qui s’en va. Celui qu’on envie. Le libre. Salut, gadjo ! Le Grand Meaulnes.
Puis, après, dans la vie qui s’est répandue sous mes savates. Ça a dépendu des circonstances. Ici je les aimés d’une franche amitié, là je les ai violemment détestés. Il y en a même un que j’avais hébergé à sa sortie de cabane et qui, pour me remercier, m’avait cambriolé avant de prendre la poudre d’escampette. Salut gadjo ! Oui, je sais, pas la peine de rabâcher, je ne suis pas sourd aux poncifs de troisième catégorie, ça aurait pu être un Suisse, ou un Norvégien, ou un gars du Poitou.
Mais les aimer ou les détester, comme je disais à l’instant, c’est déjà du racisme. Y’a tous les ingrédients du poison là-dedans. Y’a moi, nous-autres et…eux. Comme pour toutes les couleurs de peau et toutes les façons de vivre sa vie ou de consacrer un Dieu.
Alors, les Roms, non, ce n’est pas bien de les expulser. On en est dégoûté de ces façons d’un autre temps ! J’en suis, de ceux que ça répugne. Mais je ferme ma gueule. C’est ce que j‘ai appris de mieux à faire pour mon bonheur.
Parce que c’est bien joli et tout plein mignon tout ça, mais qu’est-ce qu’on fait ? On laisse faire ou on leur casse la gueule aux expulseurs ? Et qu’est-ce qu’on a fait avant, pour que le discours hystérique de Grenoble ne soit même pas envisageable ? Rien, strictement rien. Des blogs. On a bavardé entre potes.
Hortefeux, le fourbe, l’a bien compris qui interpelle les milliardaires de gauche et leur dit, bon, bien, donnez un de vos terrains, on les installe là. A vot’ bon cœur…Ce n’était même pas la peine d’interpeller les ténors milliardaires. Pourquoi se donner tant de mal pour accoucher d’une image somme toute d’Epinal ? Y’avait qu’à demander gentiment à n’importe lequel petit instit de gauche avec un grand terrain – beaucoup ont ça -, un grand terrain où il bucolise, où il fait pousser ses fleurs, sa pelouse et ses arbres de Judée.
Tu prends un convoi de caravanes chez toi, cet été, camarade ? Ça nous arrangerait bien. Silence radio à tous les étages. Misérable douleur de la contradiction entre vécu et idéologie avalée, ruminée et recrachée comme du bon lait.
Chacun se renvoie la balle de ses propres abjections et de ses répugnantes défaites.
Les Roms ? J’ai mon cœur d’artichaut qui dit non et ma tête de dégoûté qui dit ça dépend…Faut voir…J’en sais trop rien…
Ça te choque ?
Tu es comme moi, pourtant. Tu n’y comprends pas grand-chose à toute cette bouillie. Tiens, je saute du coq à l’âne, y’a un gars qui pourrit en taule depuis 25 ans bientôt, dans tes taules françaises, tes taules démocrates et des droits de l’homme. Pour violence armée, un qui pensait généreusement que tes capitalistes et tes patrons, ceux qui veulent te faire aller au charbon jusqu’à 67 ans aujourd’hui, on pouvait les mater par l’insurrection. Plus puni que le bras droit et successeur désigné d’Hitler, Albert Speer, 20 ans de réclusion. Plus puni qu’un des plus grands complices de l’Holocauste. Ça te dit quoi, ça, humaniste de mes deux roubignolles ? Ça ne te dit pas qu’un homme qui se propose de détruire le capital fait plus peur qu’un qui se proposait de réduire la moitié de l’humanité en cendres ? Et l’immaculée conception de Poitou-Charentes qui s’en est réjouie en claquant du bec comme une péronnelle !
Ça t’empêche de dormir, ça ? Non. Tu t’en fous parce que tout le monde s’en fout qu’un type qu’on a bouclé à 34 ans soit encore au cachot à soixante balais. Il est pourtant la preuve enterrée vivante de la monstruosité d’un système. Ce dont tu ne te fous pas, en revanche, c’est ce qui fait hurler la meute. Quand ça se voit, faut qu’on t’entende !
Mais tes canines sont des implants, mon pote. A la moindre velléité de mordre, crac…Des dents de lait. Mettrai-je mon bras robuste et poilu entre tes crocs qu’à peine sentirais-je comme une répugnante caresse de toutou.
Sarkozy, le salopard, parle de zones de non-droit, lui qui le bafoue tous les jours, le droit, et qui protège de sa fonction les entourloupettes mafieuses de ses ministres.
Les autres, en face, s’offusquent, hurlent, font appel à tous les bons sentiments du monde tout en pétant dans la soie comme de véritables bourgeois de la Monarchie de juillet. Les Roms, c’est comme les anarchistes de la chanson, on ne les voit jamais que lorsqu’on a peur d’eux. Et là, ça emmerde autant l’angélisme des défenseurs que la brutalité des accusateurs.
Le pape s’en mêle. C’est le bouquet ! Un imbécile de L’UMP lui dit de fermer sa gueule parce qu’il est allemand...Et vlan ! Ça vole de plus en plus bas. Beaucoup plus bas que la ceinture. Tous les coups sont permis. Moi l’iconoclaste, le mécréant, l’athée, le bouffeur de curés, j’en viendrais presque à me faire l’avocat du pape !
Et nous resterait-il un brin d’espoir de sortir de tout ce bourbier avant de crever, que nous éclaterions d’un gigantesque rire à en faire trembler les étoiles.
Nous reste peut-être la dérision en guise de langage.
Mais pour quoi faire ? On ne sait même plus quel côté brocarder !
Et ce texte, là, livré comme ça, à chaud, te dit simplement que tu ne comprends rien, comme moi, comme nous tous, alors ne te fais ni l’allié des salopards aux commandes, ni le chantre des loups bâtards qui lorgnent sur ces mêmes commandes, des loups qui hurlent sous la pleine lune, pour qu’on les entende bien, qu’on les voit bien, mais qui s’en foutent comme de l’an quarante, de la pleine lune.
On ne défend jamais mieux la liberté que lorsqu’on est soi-même un homme libre. Libre de tout engagement. En dehors.
Les révolutions d’esclaves, vois-tu, c’est bon pour les péplums, les mauvais romans et les professionnels de la Théorie.
Et tout ça, me diras-tu avec raison, ça mène à quoi ? Nous ne savons rien. D’accord. Nous ne saisissons que les reflets qu’on nous donne en pâture. Et après ?
Après rien. Mon plaisir réside dans le fait d’écrire ce rien.
Ça mène pourtant à la fierté et à la solitude. La belle et franche solitude. Regarder s’étriper les monstres qui se croient des Titans, s’invectiver les imbéciles qui se prennent pour des génies et s’agiter les esclaves qui pensent gueuler pour les causes justes, depuis le dôme venteux de la colline.

Et pendant qu’elle gambadait devant moi, ma fille, en faisant gaffe que ses longs cheveux auburn ne s’agrippent aux ronces et aux broussailles, je me disais que j’étais un menteur. Un inévitable et sacré menteur.
Comment dire à une enfant de dix ans qui éclaire la forêt de ses rires et de ses éclats de voix au moindre petit champignon découvert, que le monde des hommes vers lequel elle s’en va en courant est un monde de primates au déclin, un monde qui s’éteint avant même d’avoir appris à prononcer le mot qui le désigne : Humanité ?
Image du haut : Philip Seelen
08:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.09.2010
Ciels

Tant qu’elles galopaient, poursuivies par les colères furibondes d'Èole. Elles galopaient si vite, paniquées telles des armées en déroute, que bientôt les marais et les champs redevenaient jaunes et bleus, reconquis par la lumière.
Des mouettes aux têtes noires et des grands goélands aux becs jaunâtres, avaient suivi le mouvement, de la falaise à la plaine puis de la plaine à la falaise.
Sur la voûte au-dessus s’éparpillaient les restes de la bataille en de gros flocons laiteux, inoffensifs, réduits au simple décor. Derniers témoins d'une échauffourée titanesque.
Ici, quand le ciel devient gris, lourd, accablant de pénombre, les nuées sont nées sur la Mer noire ou sur la Méditerranée. Elles sont méridionales.
Alors, elles ne galopent pas, ces nuées-là. Elles sont indolentes, elles flânent, elles badent. Le vent qui les poussait au départ est déjà à bout de souffle et n'a plus sa conviction. Il a fait demi-tour et les a abandonnées là, sur la grande plaine. Elles prennent alors le temps de manger tout le ciel, de bien le déguster, et quand elles en sont à le complètement digérer, elles s’assoupissent, elles s‘endorment sans vergogne, elles stagnent.
Bref, elles sont chez elles. Elles s’étirent, lascives, des côtes de Turquie ou de Géorgie jusqu’au pôle.
Bruine, pluie, silence obscur et ténébreux. La prairie s’émaille de petits plans d’eau, la forêt cache sa tête dans des brumes incertaines, dont on ne sait si elles sont déjà crachin du bas ou encore nuages du haut.
C’est l’automne. Mais un automne qui ne frime pas encore dans son image d’Epinal, si haute en couleurs. Le vert de l’été s’est fait grisonnant et les saisons sont en transit, en mutation, en attente. Comme un train en gare qui préparerait son aiguillage.
Cette léthargie de la chappe immobile peut bien durer un mois. Alors, les maisons jettent vers elle les premiers signaux d'une fumée bleue. Elle les engloutit, elle les intègre, elle les dissipe.
Quand le ciel dort, la terre somnole et s'ennuie.
Les hommes, depuis le coin des poêles, jettent leur regard par la fenêtre. Tout ça, bientôt sera lavé par un soleil d’octobre affaibli de sa trop longue réclusion derrière l’écran trop gris. Tout sera remis au propre, bien ouvert, séché, avant que ne s’ouvre la grande page blanche, lisse, muette, chaque année immaculée, et sur laquelle, par divertissement, nous écrirons encore l’agonie du monde.
Pendant que tournera la terre et que s’écoulera de nos doigts l’impalpable temps.
09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.09.2010
Création des pages sur Hautetfort
 Avec la création de ces pages, peut-être un remède au phénomène d'empilage des notes et des billets nous est-il proposé, phénomène "fosse à bitume", expression que j'emprunte volontiers et sans sa permission à François Bon.
Avec la création de ces pages, peut-être un remède au phénomène d'empilage des notes et des billets nous est-il proposé, phénomène "fosse à bitume", expression que j'emprunte volontiers et sans sa permission à François Bon.
Sur cette partie du blog, les écrits ne sont pas datés et un texte nouveau ne vient pas s'entasser sur un autre : Ils sont autonomes, comme les livres et les revues de votre bibliothèque, donc consultables à tout moment.
Ce qui permet également une lecture suivie de textes complets ou en chantier, peu importe, mais une lecture dans l'ordre, que l'on peut interrompre pour y revenir plus tard, par exemple.
Un pas est donc franchi par le blog en direction du site web.
Pour expérimenter l'affaire, j'ai créé ma première page (en haut de la colonne) et y ai transferré le roman, sorte de polar entre Pologne et Poitou-Charentes, que j'avais écrit fin 2006 et que j'avais publié ici, chapitre par chapitre, en 2008.
Voilà. Bonne lecture et merci aux développeurs de la maison "Hautetfort."
14:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.09.2010
Cauchemardesque !
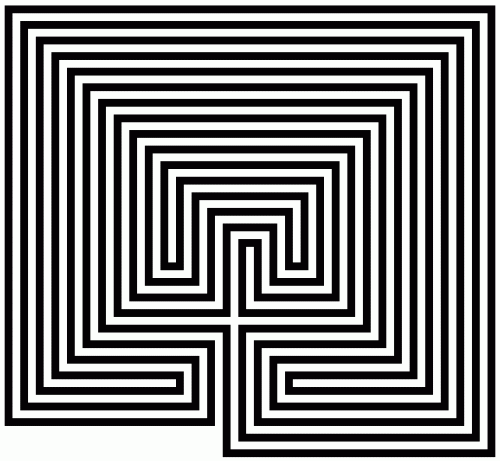 Quelqu’un m’aurait raconté ça, que peut-être je ne l’aurais pas cru. Ou bien j’aurais dit, in petto, ce corniaud se débrouille vraiment mal…
Quelqu’un m’aurait raconté ça, que peut-être je ne l’aurais pas cru. Ou bien j’aurais dit, in petto, ce corniaud se débrouille vraiment mal…
Alors, même si mon blog n’a pas vocation à traiter de mes petites déconvenues, je vais quand même vous dire une mésaventure parce qu’elle est révélatrice d’un monde de fous, d’imbéciles, un monde où tout est compliqué, inhumain, désarticulé, et que c’est dans ce foutoir que nous vivons et que c'est aussi dans ce bordel sans nom que la littérature et l’écriture se font, disent et contredisent.
Sept médecins polonais doivent donc se rendre en France à la mi-septembre, pour y rencontrer certains de leurs homologues français, échange de savoir-faire et d’expériences.
Ils veulent dormir à Paris, flâner un peu dans la capitale, avant de rejoindre le Poitou-Charentes, lieu de leur rendez-vous de travail.
Je suis Français, j’habite ici, ma compagne les accompagne, je me fais donc l’intermédiaire pour leur réserver sept chambres dans un hôtel du côté de Montmartre. Quoi de plus normal et de plus facile ?
C’est ce que je pensais.
Un cauchemar ! Un vrai cauchemar ! Un truc à se taper la tête contre les murs ! Un truc qui vous fait perdre l’équilibre, qui vous fait peur, même, tant on se sent soudain démuni devant un vide effroyable.
J’ai commencé ma réservation lundi matin à 8 heures, on est mercredi midi et je n’en ai pas encore fini. J’ai dû donner plus de 20 coups de téléphone au moins, j’ai eu autant de réponses différentes, de discours, d’atermoiements, d’explications, de bredouillements, de demandes de documents, d’affirmations et de dénégations et j’ai fini par hurler. Ils se sont énervés, eux aussi…L’insulte au bord des lèvres.
Je n’ai toujours pas ma confirmation et je ne sais toujours pas où vont dormir les médecins. Ils ne sont au courant de rien. J’ai trop honte. Oui, honte. C’est intellectuellement inconfortable d’avoir honte de sa nationalité et de son pays quand on s’est toujours prétendu apatride et citoyen du monde !
Je vais donc essayer de vous reconstruire le scénario, mais je vais certainement oublier beaucoup de bribes décousues tant c’est un imbroglio ubuesque.
Toute la journée de lundi :
- Bonjour, madame...Je voudrais réserver…Blabla blablabla…
- Oui. Mais il nous faut un fax et on vous renvoie aussitôt, nous, un fax de confirmation.
- Bien.
Envoi d’un fax, dates, nom de la personne qui réserve, heure d'arrivée etc...Pas de réponse. Téléphone à nouveau…
- Allô ? Blablabla...
- Ah, non ! C’est pas noté. Vous pouvez refaire ?
- Oui, je voudrais blablabla…
- Il nous faut les noms des personnes…
- Ah bon ? Mais c’est réservé au nom d’une entreprise !
- Ah bon, alors, tout va bien..on vous envoie un fax de confirmation tout de suite.
Fax désespérément muet, retéléphone…Non, je ne vois rien..ah, si…Bien, ça va être traité…C’est que vous n’êtes pas seul, monsieur !
- Bon
La nuit tombe. Toujours rien.
J’ai dû sauter dans le descriptif de cette première journée trois ou quatre épisodes d'échanges tous plus opaques les uns que les autres.
Mardi matin.
Enervement.
- Allo, j’ai téléphoné hier blablabla…
- Ah, oui je vois, mais il nous faut un numéro de carte de crédit ; On peut pas traiter comme ça, monsieur, surtout si ces gens-là arrivent tard dans la soirée. Il nous faut des garanties.
- Bordel, mais vous ne pouviez pas me le dire, hier !
- C’est pas moi, c’est un collègue !
- J'en ai eu au moins dix de vos collègues !
- Oui, monsieur, mais c'est pas moi... (médisances à peine voilées sur les collègues qui sont vraiment bons à rien.)
- Bon, bon, voilà le numéro de carte de crédit, XXXXXXXX, Blablblabla...
- On vous envoie un fax de confirmation
Rien. Silence radio à tous les étages. Le temps passe...
- Allô ? Blabla bla..J’en ai marre de vous appeler...Je vous appelle de Pologne depuis deux jours pour blablabla..
- Ne quittez pas, je vous passe les réservations…
Longue pub complètement idiote sur un couple qui a dormi là-bas, qui a bien mangé et que c’était bien, le petit déjeuner à onze heures…La pub ne dit pas s’ils ont baisé…Mais ça m'étonnerait, ils ont l'air tellement corniauds !
Je patiente. Je suis écoeuré par tout ça et par la mièvrerie de la pub, en plus. Par son indécence.
Petit déclic :
- Allo ? je vous écoute...
- Oui, je téléphone pour blalalalalalalalalalallalalalalalalal !
- Oui, oui, mais vous énervez pas…J’y suis pour rien..C’est mes collègues..Et puis, c’est la grève ici, c’est le bordel….
- Comment ça ? que je hurle… Mais en quoi êtes-vous concerné ? Vous ne la faites même pas, vous, cette grève ! Vous êtes au boulot ! Qu’est-ce que ça a à voir ? Je ne vous commande ni par train, ni par métro, que je sache...
Silence complet du gars qui a dit une connerie qui lui a échappé.
- Bon, je m’en occupe…C'est donc pour la nuit du tant au tant.?..Oui...Bien....Au revoir.
Rien de toute la journée. Dix coups de téléphone au moins, toujours les mêmes âneries, fax, numéro de carte, à quelle date, combien de personnes, les noms, à quelle heure ils seront là ?....J’ai envie d’étrangler mes interlocuteurs(trices) successifs.
Vers le soir, après moult tentatives pour me faire comprendre :
- Ne vous inquiétez pas, je vois mon collègue, là, à deux pas, qui est au fax et qui est en train de vous envoyer votre confirmation…Vous l’avez dans dix minutes..
Une heure après, rien. Absolument rien. Je me gratte la tête, je tâte mon pouls pour être sûr de ne pas rêver.
Téléphone encore...Pub indécente, voix, déclics, murmures, re-pub, terft..yruijh...tryuzuuuiii....Allô ?
- Il me faut absolument le nom des personnes…
Je raccroche. Je suis excédé.
Je comprends comment un pauvre bougre peut soudain basculer vers le crime.
Vite au village ! La maison, l'air frais, les couleurs, la forêt, lecture.
Mercredi matin
Allo ? Je réexplique tout depuis le début, on s’énerve…On vérifie…on bredouille, on se coupe la parole, on ne se comprend pas, on ne sait plus très bien de quoi on parle.
- Ah, non, il n’y a rien..Si, si..Voilà le numéro de réservation….XXXXXXXX…Bon, je vous envoie un mail tout de suite, ce sera mieux qu'un fax.
Je reçois le mail…
ENFIN !
Non ! Non ! Non ? C’est pas vrai !
La réservation que je suis en train de faire depuis 48 heures pour 7 personnes, porte sur une seule personne ! Tout est à refaire !
Je retéléphone….Une autre voix…Ce n’est jamais la même voix….Une jeune femme…Je dis, je redis encore..On me dit que c’est pas moi..Je dis, attendez, vous appartenez à une même entreprise, vous faites le même boulot et vous avez chacun un discours ! Mais si, c’est vous..Là, à l’instant où je vous parle, c’est vous qui représentez l'entreprise, non ?
- Oui..Je vais essayer de démêler votre problème….Cliquetis de clavier, silence, petite pub des deux imbéciles qui ont couché là bas une fois et qui étaient tellement heureux d'avoir bien dormi et de s'être levés tard…Toujours pas d'infos sur leurs éventuels ébats nocturnes.
- Ah ! non, ça , le mail que vous avez reçu, c’est pas nous du tout ! C’est la centrale de réservation qui...
- Comment, que je hurle ? Cette fois-ci je porte la main à ma poitrine...J'ai vraiment peur de l'infarctus.
- Peut-être vous vous êtes trompé d'hôtel, poursuit la voix, comme irréelle...
Il faut tout reprendre à zéro…Remonter à lundi matin 8 heures....Le mythe de Sisyphe me semble une vaine plaisanterie à côté de tout ça.
Je répète pour la vingtième fois..La voix dit qu’elle ne travaillait pas depuis dimanche, qu’elle n’y est pour rien…Mais qu’il lui faut le nom des personnes et que...Ah, non, pardon, pas la peine...Voyons voir....Je m'en occupe tout de suite...C'est pour quelle date exactement ?
Je suis épuisé. Tout ça ne peut pas être vrai...Et pourtant.
Une anecdote, une simple anecdote, vous me direz.
Non !
Le procès-verbal révélateur d’un monde d’imbéciles, d’idiots, de schizophrènes et de chacun pour soi.
L’hôtel porte un nom d’oiseau.
Mais pas le bon. C’est tous les noms d’oiseaux du monde qu'il faudrait lui flanquer à la facade !
Une anecdote ? Et si je vous disais que ça n'est pas la première fois ? Que déjà l'an passé, du côté de Metz, pour une réservation...
Mais je ne vais pas vous la refaire.
Suis épuisé.
Pauvre France !
15:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.09.2010
Dématérialiser, j'en remets une couche
 Je parlais hier de dématérialisation, à propos des poubelles. Voir ci-dessous pour ceux qui arrivent en retard.
Je parlais hier de dématérialisation, à propos des poubelles. Voir ci-dessous pour ceux qui arrivent en retard.A l'écran, plus exactement.
Dématérialisation.
Tout un programme. On se donne du philosophe. Dématérialisation ? Rendu métaphysique alors ? Abstraction plutôt ? Non ? Intangible alors ?
Alors, je ne vois pas bien.
La première fois que j'eus à froncer le sourcil devant l'emploi intempestif du concept, c’était avec un gars qui se croyait malin en matière de développement durable. Il m’avait dit, et il avait l’air content de lui comme c’est pas possible : « Faut dématérialiser l’information, mon pote. »
Moi, à part ne plus rien dire du tout, je ne vois pas comment je pourrais dématérialiser une information. Par des ondes supranaturelles, peut-être… Et encore. C’est même pas sûr.
Dématérialiser l’info, la communication, ça veut dire la numériser, oui, qu’il m’a expliqué, le gars. En fait ça voulait dire plus simplement : Plus de papier !
Bref, ça ne veut rien dire du tout parce qu’un fichier informatique, un livre numérique, il n’y a pas plus matériel, visible, tangible, palpable, transformable, lisible et transmissible. Et c'est tant mieux parce que c'est un outil de travail et de création.
C’était vraiment pas la peine de faire le philosophe. Numériser. Point barre.
Figurez-vous que dans un moment de colère dont je suis, hélas, assez coutumier, j’avais supprimé 20 pages d'un texte sur lequel je travaillais.
Un tapuscrit dématérialisé, si vous voulez.
Puis j'étais allé, consciencieusement, vider la corbeille. Colère froide, donc, organisée, réfléchie, préméditée. Un assassinat beaucoup plus qu’un meurtre.
J’avais regretté aussitôt mon forfait accompli.
Peut-être qu’il y avait quelque-chose de récupérable là-dedans.
Où les retrouver les 20 pages ? Nulle part.
Dématérialisées vraiment. Comme n’ayant jamais existé, comme n’étant jamais sorties de mon cerveau.
C’eût été à la machine à écrire, que j’aurais fouillé la poubelle, défroissé les pages, les aurais repassées et que j’aurais relu.
J’ai déjà fait ça. Autrefois.
Mais là, rien.
Néant.
Et y’a pas plus dématérialisé que le néant.
Et quand je pense à mon développeur durable, j’espère qu’ils n’en viendront jamais, alors, à dématérialiser complètement l’info.
Et que mon employée de bureau va tout faire pour donner un sens tangible, palpable dirais-je, à sa dématérialisation.
11:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.09.2010
Dématérialiser la veulerie humaine

Les Polonais, du moins la plupart des ruraux, n’ont absolument aucun sens de la citoyenneté et de l’environnement. Le passé et ses réflexes de délinquance sous une dictature aux règlements absurdes ? L’éducation ? Le laxisme des pouvoirs publics ? Tout ça à la fois, je crois bien.
Mais il serait peut-être temps qu'ils prennent conscience, ces Polonais, que le communisme, c'est vingt et un ans derrière eux et que lorsqu'on se débarrasse d'un système calamiteux, c'est pour faire mieux, c'est pas pour se vautrer dans la fange pendant un quart de siècle !
Dans notre village, le ramassage des ordures a lieu….tous les trois mois ! Il faut donc mettre ça dans des grandes poches et aller s’acquitter de trois zlotys par poche chez le ¨sołtys¨, sorte de chef de village désigné par les habitants, sorte d’intermédiaire physique, sans prérogatives spécifiques, entre le hameau et l’autorité municipale.
Pour nous qui vivons à trois, dont une gamine de dix ans, un trimestre ça fait de dix à douze grandes poches d’ordures à faire évacuer chaque fois ! Il m’a été alors aisé de constater que les poubelles alignées devant les cours, le jour du passage des éboueurs, étaient singulièrement peu nombreuses. Une famille de cinq ou six individus pose timidement une poche, rarement deux, comme pour dire, vous voyez, je range mes déchets, moi aussi !
Devant la plupart des maisons, il n’y en a aucune : Les déchets ont pris, par une nuit sans lune, le chemin de la forêt !
Il y a quelque temps, un an peut-être, une délégation française était venue ici, mobilisée sur un programme européen de gestion des déchets. Mon avis était qu’il ne pouvait y avoir avec les responsables polonais que dialogue de sourds.
Impossible en effet de parler le même langage quand certains sont au tout début de la prise de conscience du problème - la consommation de masse en Pologne a à peine dix ans – et que les autres réfléchissent, si c’est bien le mot juste, depuis plus de vingt -cinq ans sur la question après tergiversations, atermoiements, enfouissages, incinérations, récupérations et autres expériences plus ou moins heureuses !
J’avais assisté également au discours d’un monsieur polonais spécialiste du traitement des déchets de la Ville de Biała. Dithyrambique, qu’il était ! Il dressait le tableau idyllique des traitements et parlait même de transformation en matières combustibles. Ultra moderne, qu’il disait ! Un triage plus moderne, même, que tout ce qu’il avait pu voir en France, d’où il revenait.
Oui, c’était bien joli, tout ça, mais il n’y a pas de collecte ! Ben oui, faudrait commencer par là, mon brave monsieur ! Ce gars me faisait penser à un meunier qui aurait eu le plus fabuleux des moulins à sa disposition et aucun paysan dans les alentours pour lui livrer le moindre sac de blé.
Le courage politique manque scandaleusement aux politiques. C’est un poncif, mais ça fait du bien de le répéter. Les hommes sont des brutes et ne réagissent qu’aux brutalités : suffirait alors d’établir ici un impôt, même léger, mais payé par tous, déchets ou pas déchets. Plus personne n’irait salir la forêt. Pour rentabiliser l’impôt honni, on inventerait même des déchets à mettre devant sa porte le jour du ramassage…
Et je pense avec colère à l’Europe capable d’enfanter des textes réglementant à la virgule près l’enculage des mouches dans toutes les positions et incapable de dénoncer de manière significative les carences les plus scandaleuses, les comportements les plus barbares.
Pour en revenir à la délégation française soucieuse de la gestion des déchets dans ladite Europe, vous savez quoi, qu’elle offrait aux Polonais pour leur faire voir comme c’était bien de prévoir de ne plus faire des ordures ? Des clefs USB qui dématérialisent l’information !
Ah, dématérialiser ! Voilà qui en jette ! Voilà qui fait savant et sérieux !
Qui fait surtout très con, oui, quand le concept pédant, mis à toutes les sauces, est divorcé d'avec la réalité.
J'aurais voulu prendre hier tout ce beau monde par la peau du cul et le conduire dans la forêt de Łomazy, au bord de ce gouffre ordurier de l’irresponsabilité. Dire au meunier sans blé, tiens, traite-moi ça de façon ultramoderne et sans délai et aux métaphysiciens de l’info, tenez, fourrez-moi donc toute cette merde dans votre poubelle virtuelle !
Quand le doigt montre le soleil, l’imbécile regarde le doigt, c’est bien connu.
Et cette verrue, une de plus, ce furoncle pestilentiel jeté sur la candeur de la forêt, m’a mis hier de fort méchante humeur.
14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.09.2010
Quiproquo toponymique
 En toponymie, langage émotif de la mémoire collective, tout peut dépendre des dispositions de l’esprit présent.
En toponymie, langage émotif de la mémoire collective, tout peut dépendre des dispositions de l’esprit présent.J’en veux pour preuve cette plaisante anecdote dont fut dernièrement acteur et témoin un vieil homme de Podlachie, anecdote véridique rapportée d’ailleurs par quelque quotidien de la région, ce qui, je vous l’accorde, ne constitue pas un gage d’irréfutable authenticité.
Toujours est-il qu’après Wisznice, si on file en direction de Lublin, on traverse un village du nom de Kolano. Cela signifie littéralement «Le Genou.»
A quelques kilomètres de là, derrière la forêt, un autre hameau plus petit, posé sur une timide élévation recouverte de fiers bouleaux et de chênes antiques, se fait appeler Puchowa Góra, "Le Mont duveteux".
Or il advint qu’une dame distinguée voulant se rendre dans ce hameau, s’égara, tergiversa, recula, avança, se fourvoya et finit par s’arrêter à Kolano afin de s’y enquérir de la juste route.
Elle stoppa donc sa voiture, en descendit fort élégamment et héla notre bonhomme trop content, quant à lui, de causer à quelqu’un, pour rendre service de surcroît, dans ces mornes solitudes qui font les longs après-midi de la campagne, en Pologne comme partout ailleurs.
Il dit que c’était simple.
A partir du Genou, il fallait remonter doucement.
Il montrait d’un geste la petite route qui s’enfonçait dans l’épaisseur des bois.
Ça le fit rire, lui, qu’on pouvait arriver de tous les côtés au petit Mont duveteux qui était au beau milieu.
La dame distinguée ne l’entendit point de cette chaste oreille.
Elle rejoignit alors précipitamment sa voiture, effarouchée comme une poule qui aurait vu le goupil, la mèche des cheveux indignée, invectivant, insultant, levant le poing et vouant aux gémonies ce vieux malade, lubrique et délabré.
Notre homme cependant était resté bouche bée, complètement abasourdi par cette volée de bois vert qui lui tombait si brusquement dessus.
Ce ne fut que quelque temps plus loin, alors que la voiture avait depuis belle lurette disparu et que, vexé, il réfléchissait encore à l’incivilité de cette réaction, qu’il comprit enfin l’étendue de la méprise.
Alors, on entendit son rire briser le silence du chemin et qui s’envolait très haut dans l’air immobile de Kolano.
Distinguée, la dame ?
On ne voit que ce à quoi on pense.
Elle était partie voir le loup, assurément, conclut-il.

09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.08.2010
Les béotiens et le casse-croute
 Vers le début des années 1980, en plein retour de l'ennui, mon frère et moi en étions encore au romantisme du non-travail, ce foutu travail, source de toutes les aliénations et de toutes les misères du monde et dont je ne cessais de claironner aux quatre vents qu’il avait la même étymologie que le mot torture.
Vers le début des années 1980, en plein retour de l'ennui, mon frère et moi en étions encore au romantisme du non-travail, ce foutu travail, source de toutes les aliénations et de toutes les misères du monde et dont je ne cessais de claironner aux quatre vents qu’il avait la même étymologie que le mot torture.
Nous badions donc d’aise et de révolte devant la basse turpitude du monde où les maitres et les esclaves semblaient avoir résolu en une sereine et veule synthèse en forme de modus vivendi, le dilemme de la fameuse dialectique.
Nous, nous ne mangions pas de cette synthèse-là ! Alors nous cherchions forcément - avec d’autres Apaches de notre acabit bercés dans l’illusion des lendemains chanteurs et nourris aux saintes liqueurs de Bakounine et autres Debord/Vaneigem - les moyens de vivre notre marginalité sans forcément marcher pieds nus et crever de faim.
De soif surtout.
Pas toujours facile d’être cohérent dans ces cas-là ! Et si l’un d’entre nous venait à craquer et enfilait le bleu de travail de la honte et de la collaboration sociale, nous ne lui jetions certes pas la pierre, mais l’accompagnions de notre amicale compassion, lui fixant le regard sur le bout du tunnel, six ou trois mois, et hop, un an de chômage à rêvasser sous les étoiles.
Notre seule crainte était qu’il y prît goût, à ce fichu bleu de travail !
Mais il y avait aussi des prises de risques...La beauté du monde se fait parfois payer très cher pour ceux qui veulent la contempler gratuitement.
Alors quand un des Apaches avait été confronté, dans sa quête révolutionnaire de la pitance, aux oppositions musclées de la maison Poulaga et se retrouvait pour quelque temps hébergé, nourri et blanchi au frais de l’état honni, il était évidemment assuré de notre soutien moral, de nos visites quand c’était possible, de notre courrier régulier dans tous les cas et, bien sûr, retrouvait la tribu au grand complet pour lui remettre le pied à l’étrier des réjouissances , sitôt sa faute expiée.
Ça me fait sourire aujourd’hui…C’étaient là des amis. Certains, deux pour tout dire, le sont encore. Les autres sont partis loin fonder leur Rome ou alors, partis tout court, là d'où l'on ne revient plus.
Des amis de l’erreur ?
Au regard de ce champ en putréfaction qu’est devenu le monde, avec toute une volée d’escrocs, de bandits, de voleurs et d'usurpateurs aux commandes, étions-nous en retard ou en avance ?
La seule chose dont je suis certain c'est que nous n’étions pas à l’heure.
Dans ce contexte-là, survint un jour une anecdote.
M’installant en Charente-Maritime, dans une maison qui avait jadis tenu lieu d'épicerie, de restaurant et de café du village, un de mes premiers boulots fut d’aller explorer le grenier.
Il y avait là, comme dans tous les greniers du monde, un inextricable fatras : de vieux vélos, de vieux journaux, des caisses, une vieille pendule, des bidons, des chapeaux, des costumes, des balais et, comme c’était le grenier d'un ancien lieu public, de vieux drapeaux tricolores, souillés et déchirés, qui avaient dû autrefois pavoiser pour des fêtes de village et des 14 juillet en liesse.
Et puis, dans tout ce capharnaüm insignifiant, une toile…Un grand paysage vert et jaune, un paysage de plaine avec du vent sans doute car il n’y avait là aucune verticale digne de ce nom.
C’était peint avec furie et le tout était prisonnier d’un gros cadre, énorme, torsadé, lourd comme de la pierre.
Mon frère était présent…Nous débarrassâmes l’œuvre de ses poussières et de ses toiles (d’araignée). C’était moche comme le cul des chiens. C'était pas beau du tout. C'était même affreux.
Mais mon esprit se mit néanmoins à battre la campagne…Je me souvenais vaguement d’une vieille histoire d’une mémé qui s’était servie d’un Van Gogh inconnu, une ébauche, pour obstruer un passage dans son poulailler. Une fortune colossale quelle avait avec ses poules, la mémé !
Je savais aussi que, des fois, il était arrivé qu'un artiste crève-la-faim de son vivant mais dont la postérité a jugé qu’il avait du génie, et surtout un prix, ait parsemé ses velléités de-ci, de-là, au hasard de sa misère et de ses errances.
Et pourquoi pas dans le grenier d’un ancien restaurant, bistro épicerie de Charente-Maritime, hein ?
Je vous le demande bien.
Mon frère doutait fortement. Il ricanait et moquait mes fantaisies. Nous n’étions guère habitués à voir quand même la chance venir nous sourire comme ça ! Les alouettes qui nous tombaient dans le bec étaient rarement rôties.
Nous examinâmes néanmoins le tableau à la loupe…La signature…Très important, la signature...Nous étions arrivés à identifier un vague gribouillis…Peut-être que c’était un chef-d’œuvre, après tout, et qu’avec ce chef-d’œuvre, tout le problème social de notre existence hasardeuse était résolu….Nous n’y connaissions vraiment rien …
Mais ça pouvait quand même être un chef- d’œuvre : C’était assez moche pour ça.
Je crois même qu'un troisième larron, appelé à la rescousse, hasarda que ces machins-là, plus que c’était laid et plus que c’était cher. Un qui n'aimait pas les critiques d'art, sans doute.
Cet avis lapidaire nous décida. On se cotisa, on fouilla dans l’annuaire et on prit rendez-vous à La Rochelle avec un gars expert en tableaux et œuvres d’art.
Le gars en question nous fit poliment asseoir quelques jours plus tard dans une sombre boutique. Il s’installa derrière un grand bureau sur lequel il avait posé notre fortune putative et il se pencha dessus avec sa lorgnette.
Très sérieusement.
Nous retenions notre souffle. On aurait entendu dans cet obscur atelier voler une mouche. Car si un expert, un vrai, un objectif, un savant en la matière, prenait la peine de se pencher comme ça sur notre affaire, c’est qu’on avait décroché le pompon, pardi !
On se donnait de petits coups de coude complices et de satisfaction et on était béat.
Mais tout à coup mon frère me donna des coups de coude plus rapides et plus petits encore, comme pour m’alerter de quelque chose . Je me tournai vers lui et il me fit signe de bien regarder ce que faisait ce couillon d’expert.
Ce que je fis… Et je vis que le gars promenait sa lorgnette dans tous les coins du cadre, sur la boiserie, partout, sauf sur la toile.
Je me suis d’abord dit que c’était peut-être comme ça qu’on faisait... Qu'il fallait tout voir, qu'il fallait être très minutieux , que ça prouvait l'honnêteté du prix qui allait sortir de tout ça, jusqu’à ce que le bonhomme nous demande la permission de déchirer la toile afin qu’il puisse mieux examiner l’intérieur de la boiserie.
Déchirer ? Comment ça déchirer la toile ? Qu'est-ce qu'il nous chante, cet oiseau-là ?
La méprise apparut alors au grand jour : Jamais l’homme de l’art n’avait pu imaginer un instant que nous étions ici pour la toile et non pour le cadre dont nous n’avions que faire…
C’était pourtant le seul objet qui avait un tout petit peu de valeur dans ce bourrier !
Quant au reste…
L'homme déchira doucement le tableau, sans violence ni méchanceté, comme quand on fait le ménage, et en jeta les débris derrière lui, dans une grande poubelle.
Il nous offrit vingt francs, que nous prîmes avidement, avec une facture même, avant de déguerpir, déconfits et plus colère que jamais.
12:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET


















