10.03.2010
Clins d’œil des latitudes
Là-bas,
sous les respirations océanes, le vieux Lacus Duorum Corvorum, au retour promis de l'équinoxe, quand le grand mouvement des choses se décidait enfin à peser équitablement sa lumière, s'habillait d’une subtile aquarelle.
Le vert et le bleu y tenaient le haut de la toile. Le bleu deux fois, qui se mirait avec volupté, vers le bas. Deux fois parce qu’épuisé par sa longue absence, comme s’il voulait reconquérir le temps puni de réclusion , derrière la voûte des mortes saisons.
La terre était ivre alors. Elle déversait sur les paysages son surplus d'orgie liquide et des souffles en vadrouille, déjà confortables, dessinaient sur ce lac impromptu des vaguelettes tremblantes.
C'était de l'eau qui n'avait jamais été que de l'eau. De l'eau entière.
La fille rebelle et victorieuse des décors gris.
Parfois, surgies de leurs blanches falaises, les mouettes et les goélands poussaient le coup d'aile jusque là, voir si la machine ronde ne venait pas de leur offrir un nouvel océan.
Ici,
Sous l’haleine encore gelée des grands continents, la plaine et les bois, au retour promis de l’équinoxe, quand le grand mouvement des choses se décide enfin à peser équitablement sa lumière, s’habillent d’une aquarelle, plus compacte, et jouent un moment aux rivages océaniques.
Le bleu et le blanc y tiennent le haut de la toile, le bleu qui se mire aussi, mais de façon moins péremptoire…. Il sait bien, allez, qu’il n’a pas encore purgé toute sa réclusion derrière les nuages.
Il a dès lors tous les délices de l’éphémère illusion.
La terre s’est enivrée. Pas d’eau. De tempêtes neigeuses et de glace. Elle exige maintenant de respirer liquide, épuisée par les mois d’attente sous le noir d’une chape, froide comme les tombeaux.
C’est de l’eau devenue. Qu’on ne voyait pas telle. Parce que jusqu'alors déguisée en fantôme, pour vaincre les ténèbres.
La fille rebelle et victorieuse des lourds hivers continentaux.
Parfois, surgis de leurs sombres forêts, de grands corbeaux poussent le coup d'aile jusque là, voir si la machine ronde ne vient pas de leur voler un bout de territoire.
Les latitudes sont sur ma peau comme la fraternité. Elles s’épousent de leurs contraires.
Et j'aime sur ma promenade l’unisson de leurs dissemblances.
Inextinguible sentiment de l'unité du monde.
L'exil est une notion du dedans.
12:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.03.2010
Naufrage

Touché dans l'âme par les nouvelles de la tempête qui a balayé la côte ouest de mon pays et ma région, évènement climatique comparable à celui de 1999 auquel j'ai consacré une page de " Géographiques" , et lisant par ailleurs que la colonisation urbaine et marchande du littoral est mise en cause (ça fait plus de 25 ans qu'on déplore ce gâchis et cette insulte permanente aux paysages sans jamais être entendu) je remets en ligne ce texte écrit à l'automne dernier pour les éditions Antidata.
Au nord de La Rochelle, battues par les vents mouillés, aspergées par les embruns ou ruisselantes de soleil, s’élèvent de blanches falaises au sommet desquelles pavoisent les bourgades d’Esnandes et de Lhoumeau.
Toutes les maisons font face à l’océan et depuis les fenêtres où pendent des rideaux à fleurs, les habitants, rêveurs, discernent parfois sur le lointain brumeux des eaux, les lourdes cheminées d’un bâtiment fantomatique glissant sur la crête des flots.
Les parcs à moules hérissent l’estran de leurs noirs bouchots, quand la mer est basse et que le ciel au-dessus d’elle vient s'envaser dans l’horizon morose. Territoires humides et froids des opiniâtres artisans de la marée, tout enveloppés de noirs cirés de pluie.
Les maisons regardent l’océan, oui, mais d’assez loin. L’autorité les a contraint à reculer d’une centaine de mètres, pour la sérénité du littoral et la sécurité des citoyens : La falaise est abrupte, soumise à la violence des éléments et son herbe humide, aplatie sous la puissante haleine du large, peut être glissante, incertaine à la marche.
Aussi les vieux villages, les vrais villages de pierres brunes et de pêcheurs, conscients de l’énergie supérieure de l’océan, prévenus de son tumulte caractériel, sont-ils sagement retirés.
Plus impavides, par le lucre rendus audacieux, les lotissements de maisons toutes semblables se sont aventurés, eux, plus loin en avant, pour mieux voir, pour mieux être vus et mieux être balayés par les vents marins. Ils font désormais écran entre les villages historiques et la fougue des tempêtes récurrentes. Aux premières loges du spectacle, ces habitations-là en prennent à leur aise, bombent avantageusement le torse, se négocient à prix d’or et se réservent aux gens confortablement dotés.
À Lhoumeau cependant, eussiez-vous emprunté, voici quelque vingt ans déjà, cette allée de sable et d’herbes folles étrangement baptisée d’un oxymore, Ruelle du large, jusqu’à son terminus, en réalité un cul de sac, que vous auriez aperçu sur votre gauche une construction rebelle aux règlements de la prudence et des paysages, une maison aux volets bleu très foncé, coquette et basse, aux larges baies vitrées, qui lançait un défi à l’immensité venteuse et qui se dressait, provocante, solitaire, bravache et magnifique sur les bords même des escarpements de craie.
Son jardin se déroulait jusqu’à l’extrémité même de la falaise. C’était une maison du bout du monde. La maison des extrêmes où le vide vertigineux puis, au- delà, l’indomptable univers des flots, tenaient lieu de clôture.
On entendait jusqu’à l’intérieur de ses murs respirer la gigantesque poitrine de l’océan. Et les gens du lieu, les nouveaux venus dans les alignements des lotissements, jalousaient ce site d’exception. Ils commentaient, accusaient, récusaient et murmuraient des suppositions. Un homme de la plus haute importance ? Un qui aurait le bras tellement long qu’il lui aurait été permis, par-dessus l’austérité de la loi, de tendre ce bras pour caresser la houle ?
Les gens du cru, eux, ceux des maisons de pierre, les pêcheurs, les gens de moules et d’huîtres, ceux qui savent causer avec la mer, qui luttent avec ses caprices, dont la vie dépend de sa sagesse ou de sa fureur, haussaient simplement les épaules et levaient les yeux au ciel si on en venait à leur parler de la demeure isolée sur les hauteurs interdites.
N’empêche. La grâce déraisonnable de cette propriété soustraite au regard avide des curieux, côté continent, par de hautes palissades de haies vives, imposait le respect, forçait l’admiration et l’envie du promeneur, celui-ci eût-il été des plus insensibles aux charmes de la côte. On s’arrêtait là un moment, on contemplait les cormorans, les grands goélands et les mouettes qui venaient faire demi-tour au-dessus du jardin avant de regagner leurs lointains horizons de brume, on voyait les arbres d’ornement dodeliner sous la brise océane, on devinait les grandes baies vitrées où réfléchissait la lumière tremblante de l’eau et on se disait ne pouvoir rêver séjour plus marin et plus fidèle métaphore d’un paradis sur terre.
Mais aujourd’hui, vous aventurant au bout de la Ruelle du large, vous pourrez seulement lire le décret d’une autorité placardé sur un poteau de bois et qui vous interdira absolument de tourner sur le vide chaotique de votre gauche, là où s’amoncellent encore, protégés par d ‘épaisses pelotes de barbelés toutes rongées de rouille, les débris d’une effroyable érosion.
Car une folle nuit de décembre, une nuit où la houle en délire soulevait des vagues comme des montagnes et creusait des tourbillons profonds comme des vallées, qu’elle frappait et creusait et rongeait le socle de la falaise avec une férocité démentielle en projetant très haut sur la noirceur des cieux des gerbes mêlées d’algues et d’écume, que l’ouragan brisait les beaux arbres d’ornement, faisait se plier les haies vives, éparpillait les buissons du jardin, que les radios signalaient au large un cargo des antipodes en détresse, le nez piqué tel un monstre marin mortellement blessé et qui, ne pouvant plus n’y avancer ni reculer, aurait chercher à fuir vers les gouffres abyssaux, la falaise s’était éventrée en une profonde crevasse qui avait couru sur toute sa largeur, tel un répugnant lézard soudain libéré des entrailles mugissantes de la terre.
Vieillie, éreintée et fourbue par cette lutte inégale menée depuis la nuit des temps, elle venait de plier le genou sous les coups de boutoir des fureurs océanes. Vaincue, elle s’était enfin résignée à jeter au vacarme des vagues tout un pan de son bel équilibre, entraînant dans sa défaite et sa rémission la maison solitaire et son infortuné occupant.
Devant le drame, les gens du lieu, ceux des lotissements, s’étaient faits gens du cru, gens qui savent. Ils avaient donc dit que c’était couru d’avance, que la mer, la vaste mer, l’énigmatique mer, ne se laissait approcher que de loin, comme toutes les idoles, et que l’orgueil coupable des hommes était seul responsable de ses colères meurtrières.
Les gens du cru, les vrais, ceux des cirés de pluie, des huîtres, des moules et des pierres antiques, n’avaient rien dit.
Des femmes s’étaient signées et avaient dans des murmures égrené de vieux chapelets de buis.
Les hommes avaient constaté le désastre, donné de précieuses et brèves indications aux services de secours, regardé au loin le dos arrondi et maintenant paisible de l’océan, hoché la tête, et, traversant les rues des lotissements pour s’en revenir chez eux, un peu plus loin sur l’abri des terres, avaient posé sur les maisons alignées, toutes semblables, un regard infiniment triste et d’une profonde commisération.
Image AFP
11:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.02.2010
Amer et dialectique constat
 Le mensonge, surtout quand son fondement consiste à défendre et à justifier un vol, a cela de fabuleux qu’il se nourrit de lui-même, grandit, prend de l’élan, de la superbe, et n’a tantôt plus de limites.
Le mensonge, surtout quand son fondement consiste à défendre et à justifier un vol, a cela de fabuleux qu’il se nourrit de lui-même, grandit, prend de l’élan, de la superbe, et n’a tantôt plus de limites.
Il s'affuble dès lors des habits de la vérité, la menteuse, ou le menteur, ayant fini par se persuader qu’elle ne profère que la vérité et rien que la vérité.
À ce stade-là, assez proche des états seconds de l'enfermement schizophrène, même le plus engagé des hommes, même le plus farouche défenseur de son bon droit et de sa dignité, n’a plus qu’une issue : la fuite, l’abandon de la lutte, la rémission, le dépôt des armes.
Car c’est en persistant qu’il perdra toute dignité et sera ainsi doublement humilié.
Il s’enfoncera dans la contradiction, dans la démesure et l’incohérence, il s'avilira dans la menace, il écumera d'une douloureuse colère, le mensonge étant beaucoup plus serein que la vérité, beaucoup plus sûr de son fait, beaucoup plus armé pour la guerre totale.
Il a en effet pour lui la non-réalité des faits sur lesquels il a grandi, il ne peut donc offrir de flanc tangible, cette non-réalité changeant en fonction des épisodes de la lutte alors que la vérité, elle, ne balbutie toujours et toujours que sur les mêmes bases, jusqu'à n'être plus bientôt qu'un murmure épuisé.
Elle est donc vite dépassée par la dialectique du cours des choses. Les pôles s’inversent soudain et le bon droit change de camp.
C’est la raison pour laquelle je suis un pauvre et le resterai toute ma vie.
Il est une lutte que je mène depuis des années et que j’ai dû abandonner, mes arguments figés, immuables, pulvérisés par les foudres d’une hydre aux multiples têtes.
Lecteur, lectrice, pardonne-moi, je te prie, le ton sibyllin de cet écrit.
Juste te dire, pour qu’au moins mes mésaventures aient valeur d’avertissement : on ne se bat pas à coups de vérités mais à coups de falsifications et le refus de brandir de telles armes en guise d'arguments offensifs ou défensifs ne doit conduire le sage qu’à l’abandon du combat ou, mieux encore, à ne pas engager de combat du tout.
Ainsi, beaucoup d’énergies, mentales et viscérales, seront économisées et le bonheur de vivre, vivre pauvre, démuni, vaincu par le réel, mais bonheur quand même, bonheur debout, n’en sera pas moins intouchable et brillant.
Image : Philip Seelen
11:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.02.2010
À propos de "Polska B dzisiaj"
 Je l'ai appris de la bouche même des Polonais : Il y a deux Polognes, la A, à l'ouest de Varsovie, et la B au-delà, jusqu'aux frontières biélorusse, russe et ukrainienne....Comme si ce pays avait du mal, encore et toujours, à se reconnaître comme définitivement assis sur sa chaise.
Je l'ai appris de la bouche même des Polonais : Il y a deux Polognes, la A, à l'ouest de Varsovie, et la B au-delà, jusqu'aux frontières biélorusse, russe et ukrainienne....Comme si ce pays avait du mal, encore et toujours, à se reconnaître comme définitivement assis sur sa chaise.
Comme un et indivisible.
Car « « frontière » est en Pologne un mot indécis et fourbe. Un mot qui bouge comme les feux follets des cimetières de novembre, un mot qui se dit dans toutes les langues pour ne pas forcément dire les mêmes choses définitives.
Un mot de la fortune des armes et des imperfections de l'histoire.
La Pologne B, celle que je hante de ma vie, de mon regard et de ma langue maternelle, est rurale. Deux grandes villes seulement, Lublin au sud et Białystok au nord. Et c'est un pays tourné vers les vents d'est, un pays en bois le long de routes interminables sur la blancheur d'une plaine. Un pays où les gens savent le prix d'un pays et voient les grandes mutations avec encore un demi-sourire accroché au coin des lèvres.
La Pologne A, elle, a la mémoire plus guérie, plus tournée vers les nuées océanes, vers le nouveau monde. Ses grandes cités , Wrocław, Poznań, Katowice, ont leurs pierres taillées dans l'architecture de l'ancienne Allemagne et la même frénésie désordonnée que leurs sœurs occidentales.
Ici, à l'est, on flotte dans l'époque, toujours un peu sceptique : L'histoire, enfin, a t-elle jeté son venin et la route est-elle vraiment libre pour escalader les siècles futurs ? Le grand voisin est là, à un vol de cigognes, de l'autre côté de la rivière Bug... Son ombre tarde à disparaître des mémoires et les mains tardent à se tendre pour une fraternelle embrassade.
C'est ce pays que j'habite, ce pays qui m'a pris dans ses grands bras maigres, sans me demander mon nom, sans me demander pourquoi et sans me demander qui j'étais.
Être là, simplement, c'est aimer...
Et je l'habite avec ma langue. Face à lui, face à son passé de désastres, face à son présent entre deux eaux, la langue pour l'aimer a force de littérature.
C'est ce que j'ai tenté de vous traduire par « La Pologne B aujourd'hui ». Tenté de traduire aussi avec les mots de mon berceau, l'universel humain sur le chemin de la dignité et aussi ce qui me bouleverse particulièrement de cette Europe centrale dont Stasiuk, mon voisin de quelques centaines de kilomètres, dit qu'elle ne sera bientôt plus qu'une notion pour les météorologues.
Avant donc qu'elle ne disparaisse sous la gomme des vents venus de l'autre bout du monde. Les vents confortables et, contradictoirement, combien dévastateurs de l'âme.
Il n'y a que la littérature pour fixer ces moments qui vacillent, qui meurent pour se multiplier autrement.
Sous nos yeux. Pendant notre humble passage.
Aujourd'hui.
13:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Passage supprimé - 2-
 Les gens avaient peur de la mort, bien entendu. Les gens, de quelque lénifiante idéologie qu'ils se réclament, ont toujours eu peur du Grand peut-être.
Les gens avaient peur de la mort, bien entendu. Les gens, de quelque lénifiante idéologie qu'ils se réclament, ont toujours eu peur du Grand peut-être.
Mais c'était là une peur qui leur appartenait. Une peur à eux, génétique, atavique, héréditaire ou alors très intime.
Ça n'était pas la peur fabriquée. La peur politique, subtil outil de l'asservissement.
Aussi, quand elle survenait en vrai, la prenait-on de plein fouet, cette mort, surtout si elle se montrait brutale. Elle était d'autant plus redoutable qu'on n'avait pas appris à la redouter chaque jour, on ne l'avait pas vue tous les jours fleurir chez les autres ou venir nous menacer nous-mêmes par le biais d'un écran obstiné, entre la poire et le fromage, comme si de rien n'était.
La mort, c'était le mystère, le très lointain, la méchanceté occulte, l'inexplicable détresse. Si, comme ce fut le cas dans la descente de Chez-Fouché, en plein bois du Fouilloux, une voiture, une R8 précisément, venait à heurter le talus et que des morts déchiquetés par la violence fussent retrouvés dedans, on en parlait des mois entiers avec effroi de maison en maison, on se rendait même longtemps après sur les lieux, et on regardait la Nationale 10 d'un œil torve, on la traitait d'infernale en sourdine, on tâtonnait l'herbe arrachée du talus par l'impact du drame, on jaugeait l'arbre meurtrier, on tentait d'imaginer ce qui avait bien se passer là de ténébreux et on maudissait des années durant ce lieu que la mort avait vu de ses yeux, avait foulé de ses pas et où elle avait frappé telle la foudre tombée des cieux.
C'est dire si (..........) jeta toute la communauté dans une épouvante inconsolable. Car la mort n'était pas venue d'elle-même. Quelqu'un l'avait appelée, quelqu'un la fréquentait, quelqu'un était capable de lui donner même des ordres, quelqu'un la maîtrisait.
Un loup enragé se promenait donc parmi tous et qui ressemblait à tous. Et il était bien là, le grand tourment : le monstre était comme tout le monde et tout le monde, ou presque, pouvait du même coup être perçu désormais dans la peau d'un monstre. On espérait éperdument - pour le peu sachant prier, on allait même jusqu'à prier - que la police allait bientôt mettre un nom sur ce fauve anonyme et pourtant si proche, faire tomber le masque, c'est lui, le criminel, pour que chacun puisse se trouver à nouveau beau et fréquentable, puisse respirer plus librement et recommencer à vaquer à ses occupations sans sentir sur son dos peser le regard d'une suspicion honteuse.
Mais l'instruction de cette affaire pataugeait et avait bien du mal à trouver un rai de lumière. Parce qu'elle soupçonnait trop de monde et trop superficiellement, sans pénétrer à fond dans la fibre même du tissu. Elle regardait avec un regard de myope, un regard de moraliste et de citadin, aveugle aux mécanismes du tissage souterrain des relations paysannes. Elle ne trouvait pas de mobile à cet (.....) parce qu'elle en voyait partout et, examinés à la loupe, tous ces mobiles lui apparaissaient dès lors comme des balivernes, presque des enfantillages.
Le raisonnement échouait donc sur l'essentiel, par ignorance.
Devant cette défaillance, les hommes et les femmes s'auto-proclamèrent, par murmures, forcément juges et désignèrent un coupable, chacun le sien, parfois plusieurs, et même en changeant souvent de conviction.
La communauté se fissura donc en profondeur. Chacun se mit à claudiquer, comme marchant sur des oeufs pourris.
Image : Philip Seelen
Le premier passage supprimé de ce manuscrit aujourd'hui à peine terminé est ici.
08:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.02.2010
Couverture
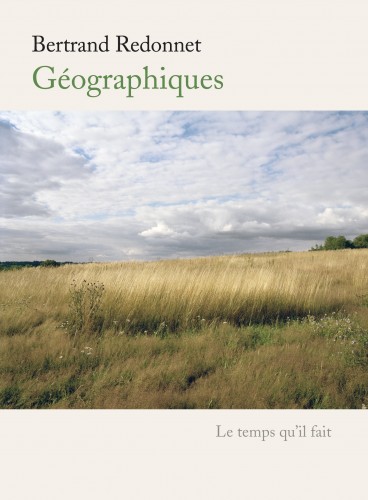
14:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.02.2010
Chienne de vie

La pratique est courante. Dans les villages, se traînent souvent des chiens errants, livrés au vagabondage, mendiant pitance et chaleur. Ils vadrouillent d'une cour de ferme à l'autre, ils arpentent inlassablement la rue unique, le regard torve, les yeux malades, la queue basse, le museau obstinément rivé à la neige.
Je les entends parfois qui se battent autour d'un os arraché au hasard de la nuit.
Ça n'est point que je veuille vous attendrir avec une rubrique larmoyante sur les chats et les chiens écrasés. Non. Moi, je n'aime pas trop les chiens. Quand ils ne sont pas bassement serviles, ils sont faits pour mordre le monde, pour défendre les prétentieux et les paranoïaques de la propriété.
À moins qu'ils ne soient carrément barbouzes dans la police.
Alors, je n'ai jamais eu de chien. Il paraît que c'est le meilleur ami de l'homme. Justement. Quand je vois comment les hommes traitent leurs amis, autant les laisser à leur condition de chiens, les chiens.
Je n'aime pas trop les chats non plus, quoique, eux, on m'ait souvent imposé leur présence. Je n'aime pas les allures chafouines et patelines de ces créatures-là. Ce sont là bêtes aux figures hautement politiques, n'en déplaise et révérence parler, à Baudelaire, Brassens et tant d'autres poètes chattophiles.
Bref, dans la neige, le froid, le vent et le gel, il y a un petit chien errant qui, du plus loin qu'il m'aperçoive désormais, accourt pour me rejoindre. Au début, il rampait. Ventre sur la glace, il se traînait lamentablement jusqu'à mes pieds.
Rien ne peut plus me révulser que l'abjecte soumission. Je maugréais...Je lui faisais signe de passer son triste chemin.
Un jour pourtant, j'ai tendu la main...Il s'est d'abord effarouché. Il a fui. Une main qui se tendait, apparemment, c'était une main qui voulait frapper...Puis il est revenu, il s'est apprivoisé, il a rampé un peu plus encore et je lui ai caressé l'échine. C'était sans doute une erreur. Le petit clochard s'est pris d'amitié pour moi. Il ne décolle pratiquement plus de mes talons.
Hier, tout l'après-midi, alors que je sciais et fendais du bois, il est resté là, à me regarder, à bayer aux corneilles, l'oeil attendri...Un reste de soupe, un os...Le vagabond a élu domicile entre mes pattes et jeté son dévolu sur ma gentillesse.
J'essaie bien de ne pas sombrer dans l'anthropomorphisme, mais je me dis quand même que cette bête-là a bien de la constance à vouloir encore se faire aimer des hommes. En quoi, physiquement, différé-je de ses bourreaux ?
Je me demande où il dort...
Au printemps, la clémence des cieux redescendue sur terre, peut-être disparaîtra t-il, vers un autre village, vers une autre forêt, vers une autre tentative pour être aimé. Sa quête du Graal à lui.
Je m'attache à sa mélancolique présence.
Sans doute parce qu'il n'est pas un vrai chien. Il n'est rien, pas même une ombre. Il vient du vent.
Et il est aussi une allégorie poilue de toute la lâcheté humaine.
Je lui tends souvent ma main.
08:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.02.2010
Confessionnettes politiques
Les gens qui me lisent, ceux qui m'ont fréquenté, voire aimé, comme ceux qui m'ont croisé de façon tout à fait fugitive, au hasard de tortueux cheminements, savent que je ne suis pas un gars de droite. De là à croire que je suis un gars de gauche, il y a un monde que je n'ai jamais franchi et ne franchirai sans doute jamais. Des gens de droite, j'en ai rencontré de franchement répugnants, des immondes, des salopards, de vrais partisans de l'apartheid social. J'ai mené contre eux la guerre, parfois même physiquement, et ils m'ont bien rendu les quelques coups que j'avais su leur porter.
Des gens de droite, j'en ai rencontré de franchement répugnants, des immondes, des salopards, de vrais partisans de l'apartheid social. J'ai mené contre eux la guerre, parfois même physiquement, et ils m'ont bien rendu les quelques coups que j'avais su leur porter.
Au moins, à ce niveau-là, les rapports ont le mérite de la clarté. Irréconciliables.
J'en ai rencontré d'autres, les plus nombreux, qui étaient carrément insignifiants, tout simplement nigauds, n'ayant pas l'énergie assez puissante pour entamer une critique conséquente du monde et prendre résolument parti pour quoi que ce fût. Des gens qui répètent ce que leur chantent Pujadas ou Claire Chazal, des gens qui croient que ce qu'ils voient en images, réelles ou subtilement camouflées, est forcément vrai. Alors, de droite, dans ces piètres cas-là, ça sert de fourre-tout et ça donne les clefs du pouvoir à n'importe lequel imbécile avec de jolis bracelets et des montres qui brillent. Ne cherchez pas plus loin le mystère de la décadence politique en France et partout en Europe. Ces gens-là relèvent plus de la faiblesse psychanalytique que de l'opinion politique. Je vote à droite parce que je ne supporte pas de m'opposer. Des qui voient des pères fouettards un peu partout.
Des gens de droite, j'en ai même rencontré des gentils, des courtois, d'un agréable commerce. À un de ceux-ci, homonyme d'un de nos plus célèbres camarades du net littéraire, avec lequel j'entretenais des relations de travail très cordiales, j'avais un jour lâché : Putain, t'es sympa, t'es pas con, t'es même généreux dans ta tête, mais qu'est-ce que tu fous à droite ?
On avait bien rigolé. Et on ne s'était pas expliqué plus avant.
Parce que vient un moment où la frontière est trop ténue entre les idéologies qu'on porte en soi. Où elles ne sont, justement, plus qu'idéologies qui fondent comme neiges au soleil sous la chaleur du regard humain. On n'est pas de droite ou de gauche. On se sent. Ça remonte très loin, bien plus loin que notre bagage culturel et notre vision apprise du monde.
Bien avant l'exil de nos mots.
Et qu'on se sente de droite ou de gauche, rien ne nous dispense de la gentillesse quand la contradiction n'est pas trop criante et agressive, comme dit plus haut, pour les philosophes de l'inégalité.
Et les gens de gauche alors ?
Ceux-ci, je les connais mieux, en fait...J'ai baigné dans leurs convictions depuis mon plus jeune âge. Je suis tombé tout petiot encore dans la marmite de leur potion magique, à tel point qu'il m'a été interdit toute ma vie d'en reprendre une dose.
Et beaucoup, beaucoup furent de mon entourage adulte. Alors, je n'avais plus qu'à les regarder s'abreuver de leur élixir magique, celui qui donne bonne conscience, et me tenir à l'écart de leurs différents druides.
Ces gens de gauche, pour la plupart, n'étaient pas plus gentils que certains de droite et même, des fois, franchement plus répugnants dans leur conception étriquée du monde et l'obstination inique, ridicule, petite, mesquine, infantile presque, à vouloir défendre bec et ongles leurs privilèges sociaux, sans aucun souci de fraternité humaine.
En un mot comme en cent, de vrais cons. Mais du bon côté de la connerie. Son côté con déguisé en humanisme.
Allez, rigolons un peu - mais très jaune - avec quelques exemples. Pêle-mêle, même si je commence par le début.
La première fois que j'ai eu à batailler jusqu'à faire le coup de poing avec des gens de gauche, c'était à la Maison du Peuple, à Poitiers...Vous voyez que, avec mes camarades Apaches du moment, on avait bien choisi le terrain de boxe... On avait alors vingt ans et on est très sérieux quand on a vingt ans.
Bref, une manifestation contre la guerre au Vietnam et l'impérialisme américain...On avait, inscrit sur nos jeans dégueulasses, le fameux symbole anti-armement et on portait à bout de bras des drapeaux noirs qui flottaient dans le vent de notre révolte et de notre jeunesse. Des drapeaux noirs qui n'aiment pas le rouge et n'en sont pas aimés. Les gens qui nous ont foncé dessus ne furent pas, comme on s'y préparait, les crânes rasés d'Ordre Nouveau amassés au coin de la rue, goguenards et provocateurs, mais le service d'ordre du PCF, des gros cons staliniens, ceux qui se croyaient seuls, à force de mentir et d'avoir bien appris à le faire, autorisés à manifester leur indignation officielle contre les méchants Américains. Nous, nous n'étions que des provocateurs, des petits bourgeois, des anarchistes payés par le pouvoir et même par les services secrets étrangers. Bref, toute la nauséabonde salade avec laquelle ils ont partout sali dans le monde l'honneur des combattants, en France, en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Amérique du Sud...etc.
Beaucoup plus près de notre sale époque, un jour, voilà t-il pas que les gardiens de prison se mettent en grève. Conditions de travail, salaires, surpopulation carcérale, etc. Vous connaissez la juste rengaine : les prisons de France sont les plus pourries de toutes les prisons d'Europe même si, par essence, une prison, c'est d'abord pourri.
J'avais un copain instituteur. Dois-je préciser « de gauche » ?
La conversation en vint donc sur la grève des matons qui réclamaient la retraite à 55 ans et, lui, le copain, qui avait cet avantage acquis depuis la nuit des temps et comptait bien dessus pour passer de jeunes-vieux beaux jours au frais de la princesse sociale, de s'indigner tout rouge : on se demande ce qui leur pète dans le citron, à ces corniauds !!
Véridique. À vomir ce qu'on n'a pas mangé encore.
Une autre, socialiste jusque dans les poils de son cul, fustigeait les chauffeurs routiers en grève. Que des gros cons, des phallos et des alcooliques qui nous écraseraient si on n'y prenait garde, avec leurs effrayants camions !
Moi, j'ai un frère, un ami et un confident, qui est chauffeur routier. Je connaissais à l'époque, ses conditions de travail et son salaire. L'autre imbécile avec ses convictions de gauche, n'aurait même pas eu de quoi entretenir sa voiture, sa maison de campagne et ses sorties au théâtre, avec les émoluments fraternels et n'aurait même pas eu le temps de dire des conneries, ni même d'ouvrir un livre, avec ses 48 heures de boulot par semaine...Mon frangin, lui, gros con avec son gros camion, avait encore le temps de lire Tolstoї ou Balzac.
Et d'aimer les gens.
Un autre, socialo ou coco, j'en sais rien, une fois, peu avant que je ne quitte la France, alors que j'étais en grève et que je glandais au bistro devant des demis en attendant - c'était contre la réforme Fillon et on devait être dix sur 1200 employés à faire cette grève - cet autre, disais-je, responsable d'une section syndicale, s'était opposé avec succès quelque temps après à ce que j'ai une toute petite promotion lors de la Commission Administrative Paritaire, parce que...je buvais beaucoup et que jallais au bistro pendant les heures de travail ! Un mouchard et un falsificateur, en plus, celui-ci ! Je me suis toujours promis de le retrouver un jour et de le souffleter comme un laquais.
Et puis, il y en a tant encore que j'ai vu discourir sur la justice sociale, la culture avec un C plus grand que leur vide intérieur, et dont les seules préoccupations étaient la sauvegarde d'un gentil confort et le maintien d'un statut brillant comme des couilles de chat, des vacances à tour de bras, des retraites mirobolantes, avec prise en compte des six derniers mois d'activité contre les vingt-cinq meilleures années pour d'autres - hop, on change d'échelon ou de grade juste avant de partir et le tour est joué pour le restant des jours, c'est ce qu'on appelle être un homme ou une femme de justice et de progrès - des congés pour se former, pour passer une licence ratée à la saison, pour peigner la girafe, une mise à disposition près d'une cheminée plus chaude et moins polluante, etc....etc.. et et cætera encore.
Moi, tout ça, moi qui ne suis pas de droite, je le précise encore tant les gens de gauche sont férus des amalgames et prêts à mettre dans le sac réactionnaire tout ce qui s'oppose à leur nombril, ça m'a fait tendre l'oreille des fois vers ce qu'ils disaient, les gens de droite, sur les privilèges sociaux et autres. Pas pour abolir les privilèges en question dans un souci de justice, mais histoire de niveler tout le monde par le bas, qu'ils disaient ça et qu'ils disent encore ça, les gens de droite, bien sûr. Mais ça m'a fait tendre l'oreille quand même et ça m'a fait dire souvent, prenant la mesure des raisons intimes de l'opposition des gens de gauche à ces propos, que, finalement, les intentions humaines, fraternelles, honnêtes, en profondeur, n'étaient pas plus reluisantes du côté gauche que du côté droit.
Il n'y a que des gens ayant quelque chose à sauver de leur peau au détriment d'un bout de peau du voisin, pour croire que l'appartenance, avec ou sans carte, à la gauche soit un engagement fort, citoyen et humaniste. Et c'est même pour l'avoir bien compris que la droite est partout victorieuse aujourd'hui et joue sur du velours.
Immondes foutaises, donc, que tout cela.
La vérité est pour moi dans l'engagement quotidien, sans stratégie, sans espoir et sans allégeance, aucune, faite à qui que ce soit. Se tenir à l'écart des batailles rangées du mensonge et de l'égocentrisme et faire sienne cette devise de Léon-Paul Fargue que me citait, il n'y a pas longtemps, un homme fraternel :
" Espérer beaucoup, attendre peu, ne demander rien..."
Image : Philip Seelen
13:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.02.2010
L'épreuve de la correction

Les corrections d'épreuves sont toujours un grand moment de tension. La dernière ligne droite, le souci et l'angoisse de l'impossible perfection. Lire aussi comme si ce texte était extérieur, avec l'oreille collée au bruissement de la phrase.
Quelqu'un, dont j'aime beaucoup le travail d'écriture, me faisait part il y a quelque temps d'une appréciation qui me fit bien plaisir : « Il y a dans votre écriture une attention au sol, aux paysages, aux hommes que je goûte vraiment. Et dans votre phrasé quelque chose de vif et de jubilatoire. Une voix, plus qu'un style : Cela vous vient sans doute de la chanson.»
Je l'en remercie vivement. Et j'ai repensé à cette critique en relisant mes épreuves, c'est la raison pour laquelle je la mentionne et non par imbécile forfanterie.
Mais qu'ai-je ici à m'en justifier ?
Car besoin parfois de changer un mot pour un autre, au sens pourtant très proche, tant que je fus amené à me demander réellement pourquoi. Et c'est en lisant à haute voix que je me suis effectivement aperçu que je demandais à ma phrase de chantonner, de dire ce que je voulais dire sans fioritures excessives, mais avec du mouvement sonore à l'intérieur.
Un paysage, une saison, des souvenirs, les hommes et les femmes, le monde, je ne conçois rien de tout cela qui puisse être écrit sans une certaine mélodie sous-jacente.
Et puis, par-delà ces considérations - au demeurant très agréables - sont ces règles tordues de la grammaire qui vous piègent, qui vous font douter et froncer le sourcil....Vous aviez pourtant spontanément enjambé les écueils, il y a déjà longtemps, quand vous écriviez votre texte. Maintenant, c'est plus l'artisan que l'artiste qui travaille..Et, tiens, en passant, merci à l'ami que je savais pouvoir solliciter sans vergogne pour requérir son avis sur tel ou tel caprice grammatical. Car vient un moment où le doute est plus fort que la conviction, même avec « Pièges et difficultés de la langue française » à son chevet.
Ne reste donc plus qu'à vous entendre, vous lecteurs, quand vous aurez ce «Géographies» - sous un autre titre sans doute - entre les mains.
Vous entendre me dire si j'ai passé ou non avec succès l'épreuve de mes épreuves.
De toutes façons, le vin est quasiment tiré.
À votre santé, donc, et pour faire plaisir à Solko, un passage supprimé, non pas des susdites épreuves, mais de la source, du manuscrit initial :
" Entre la Rochelle et Niort s’étire sur une quinzaine de kilomètres la forêt de Benon, traversée par la Nationale 11, large et impeccablement droite.
Normal. Elle aboutit directement sur l'île de Ré et les gens qui se proposent de consommer le soleil n'ont que faire de l'ombre imbécile des forêts.
Forêt ingrate, habillée de chênes noirs rabougris et d’érables, aux sous-bois rongés par le noisetier. Forêt ingrate parce qu’ayant eu à payer le lourd tribut de la surexploitation. Son chêne en effet, mais surtout la qualité des fours qui y étaient installés, donnait un charbon d’une valeur calorifique nulle part inégalée. À tel point qu’un historien a noté qu’à La Rochelle, le charbon de Benon se vendait de 25 à 30 % plus cher que tout autre charbon.
Un charbon pour les bourgeois qui ne vont pas au charbon...."
10:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.01.2010
Du réchauffement climatique d'une bande de pingouins ...

14:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.01.2010
Les mots de l'écho, l'écho des mots...
Quand on écrit les pieds au chaud, qu’on a le ventre plein, que les lendemains, ma foi, sans être des promesses d’Eldorado, au moins s’envisagent avec l’essentiel de la survie satisfait, on peut se permettre d’être sévère avec le monde.
On peut en interpréter l’adversité. En faire littérature.
On peut même se pencher sur son propre style, le message étant filtré par la réflexion poétique inhérente à tout art.
Couteau émoussé. Dérisoire. Fautif.
Car il est loin, le monde. On peut dès lors le tarabuster tels des enfants qui taquineraient une bête féroce enfermée derrière les barreaux d'une cage de cirque.
Les tourments et les souffrances ne s’offrent à la littérature que lorsqu’ils ont été dépassés, vaincus, et cette littérature n'est en cela, pour moi, qu'une étoile morte qui renvoie encore sa lumière, par le truchement des lois espace/temps/vitesse.
Directement vécu et image transmise sont irrémédiablement antinomiques.
L’écriture n’a pas d’objet sous les feux d’une tempête.
Aux prises avec la brutalité d’un climat et n’ayant pas les moyens matériels de l’affronter, j’essaie de corriger les épreuves de mon livre, écrit dans le calme et la sérénité, sur les climats, leurs intempérances et leurs douceurs, sur les bonheurs ou les âpretés de la machine ronde.
Impossible pour l'heure.
Sujet trop présent, qui colle à la page.
Comme le capitaine d'un navire en perdition et qui se mettrait en devoir d’écrire un sonnet sur la catastrophe.
L’écriture n’est pas un cri du réel...
Elle n'en est que l’écho.
Un écho peut-il renvoyer exactement ce que disait un cri ?
11:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.01.2010
Un monde de fous au service des fous

Que ce bouffon du pouvoir truque des reportages parlant de l'Iran sur des images de l'Honduras, ma foi, ça finit par passer sans trop de bobo tant la falsification a fait jurisprudence, tous les voyous de la parole spectaculaire de la planète en faisant autant. La stratégie politique de la panique permanente de l'individu et de la démoralisation universelle a maintenant trouvé ses marques et maîtrise parfaitement ses moyens. Les gens n'ont qu'à balancer leur poubelle à la poubelle. Après tout, les tribuns pervers ne sont entendus que par des oreilles complices de les écouter.
Là, pour les effets d'annonce météo, c'est un mail privé qui me le dit, goguenard, et je vérifie....
En Europe centrale, sous la neige et la glace depuis le 15 décembre, où il fait encore en-dessous de moins vingt, où ça va descendre encore, peut-être jusqu'à moins trente ce week-end, où les particuliers sont aux prises avec une lutte quotidienne, harassante, pour se déplacer, chauffer leur maison, envoyer les enfants à l'école, ne pas tomber malades, où les communes, les régions, l'état dépensent des sommes astronomiques pour essayer d'assurer le minimum sur les voies publiques, quand on entend ça, on se demande à quelle communauté on a fait allégeance en entrant dans l'Europe.
On dit que de telles annonces ne peuvent être que l'œuvre d'un fou isolé.
On se trompe lourdement, bien sûr...Pujadas n'est pas un fou isolé. Il est la marionnette, l'employé servile, d'un système qui n'est même plus capable d'annoncer la météo sans dire un mensonge, une énormité, un truc qui se vend, un truc qui fait peur, un truc de misérable comédien.
Bon sang, que la terre, les saisons et tous les paysages seraient beaux à vivre s'il n'y avait le sempiternel tintamarre de tous ces perfides salopards acteurs !
Et le temps passe, inexorable, jusqu'à la fin des horizons. Nous sommes des individus vaincus et nous mourrons dans des agonies de perdants pour avoir passé le plus clair de notre temps à tenter de résister au lieu de nous laisser porter par le bonheur et la chance d'exister.
09:41 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.01.2010
Polska B dans l'étau
Températures, bientôt -25°....Quand la recherche du nécessaire mobilise toute l'énergie cérébrale




09:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.01.2010
Le yo-yo

Le thermomètre accroché à la fenêtre monte, jamais très haut, et il descend, là, on ne sait jamais jusqu'où et surtout très vite. Une soirée à moins cinq peut déboucher sur une aurore à moins vingt. Rien de plus normal. Les hommes vont leur chemin et n'en parlent pas. Simplement dire zimno, il fait froid, en même temps que dzień dobry, bonjour.
C'est là toute la grande rigueur de l'hiver de l'est, ces jeux de yo-yo du mercure. Je me demande souvent quels sont les efforts demandés à l'organisme pour passer avec un minimum de dégâts ces écarts brutaux, imprévisibles, dans un sens comme dans l'autre....De moins trente, on était passé à 0 en une nuit, puis à plus huit le lendemain. Comme si, au mois d'août, il faisait 38 degrés chez vous, là-bas qui fut chez moi, un mois étouffant avec de la poussière qui vole dans le vent d'Italie, et soudain zéro degré, l'eau qui gèle dans la gamelle du chat oubliée sur le pas de la porte.... J'imagine le ministère de la santé débordé, alarmiste, grotesque et ridicule, faisant l'empressé consciencieux. Comme en 2003, quand les vieux avaient décidé de mourir tous ensemble, les coquins !
Ici, on ne dit rien. On va sa vie d'homme sous les latitudes brutales.
Et c'est du silence, du silence sur des villages emmitouflés de blanc et la forêt qui semble baisser les bras sous le poids des neiges, chaque jour un peu plus.
Une envie folle d'écrire tout ça. Exercice difficile tant les mots à la disposition du silence sont insignifiants. Comment dire sans redire cette nuit éclairée de pleine lune, même au travers d'un plafond du ciel très bas, et ces champs et ces chemins et ces bois écrasés sous la blancheur muette et transie ?
Comment dire ce sentiment, cette impression de solitude infinie, de bout du monde. Pas un bruit, pas un pas, pas un souffle, pas une âme qui vive. Si. Un renard qui piétine à une lisière, avec, au dessus un grand corbeau qui passe. Ils ne jouent plus à la fable, ces deux-là, trop conscients que la mort est peut-être à la chute du jour et que chacun son fromage.
Ècrire cette différence fondamentale entre l'ouest tempéré et l'est frigorifié où les routes sont des tapis de glace. La peur souvent accrochée aux mains...
J'imagine le ministère des transports, dans le même état que celui de la santé devant la susdite gamelle du chat...
On ne dit rien ou alors on dit c'est l'hiver....
C'est ce double silence qui me trouble. Un silence sur le silence. Venu d'ailleurs, je débarque sur une lune et je voudrais qu'on me parle de la lune. Il n'y a rien à dire.
Parce qu'on débarque d'abord chez des gens qui savent lire leurs paysages.
C'est cela aussi être étranger. Savoir que dans ces paysages, vous n'avez pas appris vos premiers mots.
Les mots qui désignent le monde ne sont pas universels. Ils se déclinent en amont, loin derrière.
À la source.
Et mes mots à moi ont le goût salé des estuaires venteux .
11:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
31.12.2009
Saturne
 Ça ne m’a jamais trop amusé que les hommes, les femmes et les enfants s'obstinent à se souhaiter à date fixe et prévue depuis un calendrier entier, une bonne année et se contraignent ainsi à être joyeux, bons et soudain généreux.
Ça ne m’a jamais trop amusé que les hommes, les femmes et les enfants s'obstinent à se souhaiter à date fixe et prévue depuis un calendrier entier, une bonne année et se contraignent ainsi à être joyeux, bons et soudain généreux.
D’abord, parce que dans toutes ces bises, ces lettres, ces vœux, ces mots, ces bulles de champagne et ces repas pantagruéliques qui font en même temps remonter le moral et l'indice de consommation des ménages dans les cahiers des intoxiqueurs patentés, comment trier le bon grain de l’ivraie, hein ?
M’a toujours semblé que l’ivraie était plus abondante que le grain là-dedans.
Mais bon, ça n’est pas très grave tout ça. Il s’agit d’un code social et on ne demande pas à un code d’être affectif ou sincère….Comme quand, sur la route par exemple, on fait signe à un quidam qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra sans doute jamais, que les poulets sont en embuscade derrière le prochain buisson.
Alors acceptons ça comme tel. Depuis le temps que nous faisons allégeance aux codes de toutes sortes qui régentent, organisent et conduisent nos vies pour notre bonheur le plus plat, diantre, un de plus ou de moins, quelle importance !? On ne va pas en mourir !
Bien si justement...
Car ce qui m’embête beaucoup, c’est que je pense à chaque fois à cette torture au raffinement des plus exquis et qui consistait à laisser tomber sur le crâne d’un condamné un liquide au compte-gouttes. Au début, ça chatouillait, c'était plaisant, peut-être même le condamné rigolait-il et pensait-il qu'il avait été convoqué à une farce. Chaque goutte cependant accomplissait lentement, inlassablement, régulièrement, cruellement, son travail d’érosion, jusqu’à ce que le chatouillement ne se change en douleur insupportable et que le susdit crâne ne se perce et que...
Condamné moi-même, je n'aurais qu’à demi apprécié qu’on applaudisse à la chute de chaque goutte.
Image : Philip Seelen
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.12.2009
Lettre ouverte
Chères lectrices et chers lecteurs de l’Exil,
…Parce que, où que nous soyons, quelque soit la latitude à partir de laquelle nous nous accrochons à nos rêves et à nos espoirs, nous sommes tous des exilés de quelque part…D’un intérieur perdu ou bradé aux circonstances, d’un monde spontané, quand nous faisions encore corps avec lui.
Les hommes, les femmes et les enfants du monde chrétien viennent donc de célébrer la naissance très hypothétique d'un dieu de plus en plus improbable, à grands coups de flons flons, champagne, bises à la mémé et autres chocolateries.
Ils s’apprêtent désormais, avec les mêmes flons flons, les mêmes chocolateries, les mêmes bises à la mémé et le même champagne, à tourner une page du calendrier accroché à leur mémoire du temps, toujours chrétien et toujours très approximatif par rapport au grand mouvement des choses.
C’est ainsi…
Et comme nous n’avons pas d’autres grands repères, à part nos événements personnels, je sacrifie à l’environnement idéologique du calcul du temps et viens vous remercier de votre fidélité à l’Exil comme de vos divers commentaires, aux derniers desquels je n’ai pas fait écho ces temps-ci, accaparé par d’autres urgences de l’hiver polonais.
Vous m’en voyez fort marri.
Vous êtes, à peu près, 1000 visiteurs uniques pour plus de 3500 visites et plus de 8000 pages feuilletées mensuellement.
J’ignore si c’est beaucoup, moyen, peu ou carrément dérisoire. Je sais néanmoins que ça me satisfait beaucoup et m’invite à continuer à faire vivre l’Exil, vitrine au quotidien d’une activité d’écriture plus générale.
Comme vous le savez sans doute, j’ai participé à Tempête dans un encrier, en compagnie de cinq autres auteurs. Je m’apprête ces jours-ci à abandonner cette part de mon activité, n’y trouvant plus ni l'inspiration ni le plaisir nécessaires à un travail cohérent, sans pour autant que mes compagnons de route y soient pour quelque chose.
Un autre projet en compagnie de Stéphane Beau et Solko verra peut-être le jour en février, une revue dont il reste à définir toutes les modalités, forme et contenu, les deux étant par ailleurs indissociables.
De l’autre côté de l’’écran, j’ai entamé depuis plus de deux mois la rédaction d’un récit, roman, histoire, grosse nouvelle, je ne saurais vous dire, qui me donne beaucoup de plaisir, le plaisir de refaire un bout du voyage à l'envers dans mes paysages et qui pourrait voir le jour en 2011 ou 2012, si le manuscrit trouve preneur, ce qui n’est jamais gagné d’avance, nous le savons que trop, et si je ne suis pas mort, ce qui n'est, non plus, jamais garanti d'avance...
Polska B dzisiaj, chez Publie.net, semble rencontrer audience et le 25 mars, « Géographies » - sans doute sous un autre titre que me proposera Georges Monti - paraîtra à l’enseigne du Temps qu’il fait.
Une nouvelle est parue dans un recueil collectif, chez Antidata et en décembre.
Tout ça, donc, pour vous faire un panorama de mon activité d’écriture.
Pour l’heure, l’hiver polonais a frappé brutalement. Un thermomètre aux alentours de – 30 avec le vent de l’est qui miaule comme une âme errante, les villages engloutis sous la blancheur pétrifiée et les paysages aux visages morfondus...Et s’il faut en croire les spécialistes de la chose météo, ça devrait frapper à nouveau très bientôt et très fort…
Ah, le réchauffement climatique !
Où ça ?
Je ne vous souhaite pas une bonne année, mais 8760 heures, 365 jours, 52 semaines et 12 mois d'espoirs poétiques et de redécouverte intime du monde.
Amitiés à toutes et à tous et encore merci de votre écoute.
À très bientôt
Bertrand
11:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.12.2009
Mise en veille
C'est dans les conditions extrêmes que réapparaît l'essentiel,
Qui souligne d'un double trait la fatuité des bavardages et des convictions de la normalité,
Ramène au premier plan les exigences premières.
L'écriture ne peut affronter la vie que légèrement décalée de la vie,
le reflet étant toujours et forcément en retard sur la lumière.
C'est même la condition sine qua non de son existence...

09:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.12.2009
Il y a
 Une vieille conviction, tantôt latente, tantôt manifeste, tantôt que j’accepte, tantôt que j’essaie de combattre, en tout cas une conviction avec laquelle il me faut vivre et composer, c’est que le bonheur n’existe qu’individuel et sous notre seule responsabilité.
Une vieille conviction, tantôt latente, tantôt manifeste, tantôt que j’accepte, tantôt que j’essaie de combattre, en tout cas une conviction avec laquelle il me faut vivre et composer, c’est que le bonheur n’existe qu’individuel et sous notre seule responsabilité.
Les colères que je pousse, depuis le début, contre un monde de fous furieux, injuste et trompeur, ne seraient que les jérémiades de l'impuissance et les transferts lénifiants de la responsabilité.
Si je m’arrête un peu, le nez au vent, comme quand on s’arrête pour reprendre son souffle, je me dis que ça doit exister, ce foutu bonheur, mais seulement quand on a réussi à résoudre sa propre énigme.
Commencer par là. Ou finir, c'est selon.
Pas facile. Difficile de descendre de vélo pour se regarder pédaler.
Il faut d’abord vouloir abattre la forêt qui fait tant d’ombre à l’arbre, couper des ponts, ravaler au rang de fantasmes aliénés d’autres convictions, qui refusent de se présenter comme telles, qui sont des poisons qui s’adaptent à tous les antidotes, qui, chassés par la porte reviennent en force par la fenêtre, tels le confort, le travail, le fric, les liens ficelés autour de son histoire, la foule, la bagnole, la sécurité sociale, la retraite, la consommation du superflu érigé en nécessaire, les amis qui ne le sont jamais assez pour vous accepter dans votre nudité, les amours vieillissantes planquées sous la tendresse, la complicité et autres astuces de l'immobilisme aventurier, bref, la raison.
Le vouloir..Un monde malheureux ne s'écroule que lorsque les individus ont cessé de lui faire allégeance en s'inscrivant comme "individus de ce monde." Tout autre braîllement contre lui équivaut à mener pisser les poules.
En écrivant une page ? En parsemant la difficulté d’être de mots arrachés aux griffes de l’insomnie ? Non point.
L’écriture vient après la vie, elle en est l’empreinte laissée sur la neige et qu’on aime lire pour mesurer, par joie, le chemin qu'on est en train de faire, celui qu'on a parcouru et l'espace, devant, qu’il nous reste pour cheminer encore, avant la chute des horizons. Le contraire, quand l'empreinte précède le pas, ça ne peut s’appeller qu'exercices de style, voire balbutiements.
Non...Pas le vouloir, tout ça. Le faire sans vraiment savoir qu'on est en train de le faire. Dans ce geste suicidaire qui redonne tous les espoirs à la vie, qui crée ce vide, cet appel d’air, ce gouffre dans lequel elle n’a plus d’autre issue que de s’engouffrer. Quand elle n'a plus de prétextes.
Le nez au vent qui vient des déserts de Sibérie, là, en bousculant les poudres de la neige, on est bien seul, on n'a rien, on n’est pas vu du monde, mais on sait ce qu’on est venu faire là.
Résoudre son énigme. Et après, mais seulement après, dire : je t'aime.
Mais sans absolu.
Les gens qui disent "je t'aime" en signant de l'absolu, seraient bien inspirés d'aller au plus court et de dire tout de suite : je te déteste.
Ils gagneraient dix ans de leur vie. Parfois vingt... ou trente. Voire la vie entière.
Image : Philip Seelen
11:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.12.2009
La Makhnovstchina...
Il neige, il y a du vent...Il fait très froid sur les plaines immobiles de Pologne et d'Ukraine.
Je vous offre aujourd"hui d'écouter cette superbe version de la Makhnovstchina...
Ici.

11:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.12.2009
Nouvelles des nouvelles
Aux alentours du 15 décembre, les Editions Antidata publient un recueil, auquel j'eus l'heur de participer : 10 nouvelles sur le thème de "La maison".
Dix récits et dix écrivains parmi lesquels notre ami Solko, que vous retrouverez au sommaire sous le nom d'emprunt de Roland Thévenet. Ou le contraire....
Cordial salut, donc, aux auteurs et compagnons de route dans cette aventure, magistralement initiée et conduite par Olivier Salaün.

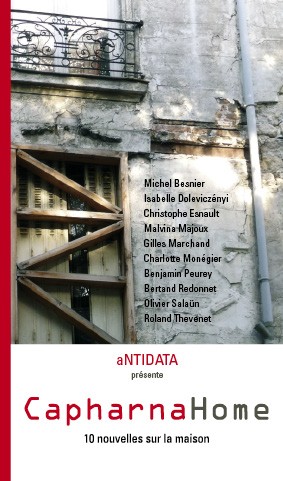
Je trouve, moi, qu'il aurait de la gueule, ce livre, sous votre sapin flairant bon la forêt et le verbe d'antan...
08:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.12.2009
Vacuité
Qu’est-ce qu’il y a d’évident à écrire ? Rien.

Alors, mieux vaut passer outre. Attendre que quelque chose survienne de l'intérieur et qui soit digne d’être dit.
Ouvrir un blog, c’est tellement facile ! Un écritoire à la portée d’un enfant doté d’un QI à peine moyen…
Le faire vivre au quasi-quotidien, c’est ardu, fatigant, dangereux. On peut même y perdre le fil de ce qu’on se proposait d’en faire.
On peut même ne plus trop s'y reconnaître. Est-ce qu'un citron se verrait en citron en ne voyant que sa puple ?
Y’a des moments, comme ça, où tout paraît cruellement vain.
S’énerver contre ce monde injuste, de mascarades et de merde, de petits hommes besognant sur la pointe des pieds et d'esclavage feutré ?
À quoi bon, franchement ? C’est se taper la tête contre les murs …I s’en fout le monde…Comme les murs....Peut-être même s’en nourrit-il, de la colère qu'on lui voue et des cacas nerveux qu'on lui faits…Et puis, vraiment - mais vraiment - si on voulait s’énerver honnêtement sur tout ce qui nous agace, sur tout ce qu’on a perçu de faux et de vulgairement intéressé, on se fâcherait avec tout le monde. Peut-être même avec soi-même.
C'est comme ça, sans doute, qu'on devient tranquillement fou.
Alors, mieux vaut passer à autre chose. Attendre que quelque chose survienne de l'intérieur et qui soit digne d’être enfin dit.
Regarder du vent aux quatre horizons incertains des plaines. Regarder du rien, histoire de regarder du vrai dans les yeux.
Des ailes viendront pourtant qui bien trop tôt le bec nous cloueront.
09:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.11.2009
La beauté des choses

Il y a du vent. Vent de poussière blanche en voltige. Je regarde ce novembre continental qui vient de sonner le glas des jours intarissables. La machine ronde a basculé doucement de l’autre côté de la lumière.
Hier dans la nuit, j'ai pissé sur l'herbe scintillante.
Le nez sur l'anonymat des ombres glacées. Des oies, ou des grues, ont cacardé longtemps leur errance sous la lune en brumes, au déclin. Cap sur l’île de Ré peut-être. Cap sur les plages chatoyantes et les algues, cap sur le clocher noir et blanc d’Ars-en-Ré.
La force des ailes déployée pour la survie, plus forte que nos désirs, plus forte que nos mots, plus forte que nos voyages, plus forte que nos espaces. Chimère sublime de l'instinct !
Il y a du vent. Vent de poussière blanche en voltige.
Et je marche dans la tourmente livide.
Cette phrase si simple et grandiose de Missak Manouchian à sa bien aimée, à l’heure de mourir debout sous le couteau des assassins :
« Toi qui vas rester dans la beauté des choses.. », surgit dans une saute du vent.
Nous sommes dans la beauté des choses. Nous y sommes.
Qu’est-il besoin de tordre la phrase, de subjuguer le verbe, de renverser le propos, de couper le flux des mots pour le dire ?
Hier encore, pour la troisième fois consécutive, j’ai abandonné un livre contemporain. D’un auteur que j’aime, pourtant. Exercice ciselé dune vaine érudition…
Pour qui parle la littérature si elle ne murmure la beauté des choses qu'aux oreilles d'un esthétisme bientôt restreint à l'espace d'une schizophrènie de bon aloi ?
Je dois être d’ailleurs. Je dois être trop tard.
Un loup qui ne hurle pas reste t-il un loup ?
Je vais relire Balzac et Maupassant, encore, au coin des poêles, et laisser les vents éternels soulever la neige des éternels retours.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.11.2009
Stéphane Beau : Le Coffret
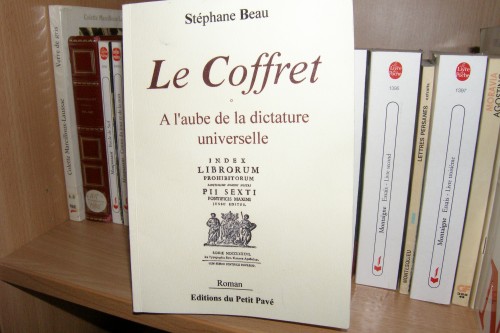
On n’en sort pas intact parce qu’on y rencontre ses propres peurs et ses propres angoisses.
- Qu’est-ce que tu lis, papa ? m’a demandé ma fille. Question récurrente, histoire que j’arrête de lire un peu et que je prête attention à ses dessins, ses peintures et ses images.
- Je lis un livre qui se passe vers 2100, que j’ai répondu, histoire de répondre à peu près.
- Et comment il sait ce qui va se passer en 2100 , ton écrivain ? J’aurai cent ans, moi, et j’en sais rien comment ça sera quand j'aurai cent ans !
Ben oui. Comment il sait ?
Science fiction ? Non. Pas plus que le Nautilus de Jules Verne n’était une science fiction.
Pas plus que Matin brun de Franck Pavloff ne relevait de ce domaine de l’art d’écrire.
Un apologue. Je dirais un apologue, oui. Et écrit avec une élégance et une conviction qui font de Stéphane Beau un véritable écrivain.
Je ne vous raconterai pas le livre. Bien sûr. Un livre se lit avec ce qu’on porte en soi. Je ne vous raconterai pas l’histoire de Nathanaël, de son grand-père et de son ami le libraire. C’est pas une histoire qu’on raconte. C’est une histoire qui se lit de l’intérieur. Un avertissement. Un feu clignotant de la nuit dans laquelle nous nous enfonçons.
En lisant Stéphane Beau on est en présence d'une conscience qui veille à ce qu’une nouvelle catastrophe majeure ne s’abatte pas sur l’humanité. Une catastrophe qui pour l’heure avance masquée, chafouine, drapeau à peine muet brandi par plus de 50 pour cent d’abrutis.
Ce que j’aime dans ce livre, qui porte l’éloquent sous-titre « À l’aube de la dictature universelle », c’est d'abord qu’il existe. Et que son existence même, au cas où, sera et serait un déni à tous ceux et celles qui pourraient dire un jour : On savait pas. On n’a pas fait gaffe. On n’a vu venir le loup….
Car dans cette société de demain que l’écriture de Stéphane Beau explore, beaucoup de similitudes à peine voilées nous sont déjà bien actuelles. On sent bien cette évidence, en écoutant aujourd’hui les discours du pouvoir, en examinant l’évolution des esprits depuis une trentaine d’années, que ce demain envisagé est justement très près de notre pendule. Qu’il n’y a plus que le rideau à soulever, que les trois coups ont déjà été frappés…
Juste une petite phrase, aiguë comme une arme de précision :
« (….) C’est parce qu’ils* avaient oublié que le meilleur moyen de se soumettre un esclave, c’est de l’affranchir.»
Il y a, dans ce Coffret, vraiment, de quoi réveiller tous les zombies, victimes ou consentants, qui peuplent notre monde presque parfait.
On ne sort pas intact de cette lecture parce que, aussi, plus convaincu encore que les loups-garous reniflent à nos portes.
Et Stéphane, qui termine quand même sur une note d’espoir, ne m’en voudra pas de dévoiler un petit bout de la dédicace qu’il me fit de son ouvrage : "Il faut espérer pourtant que tout ceci relève plus de la fiction que de l’anticipation."
Je joins évidemment mes espoirs aux siens.
Mais il n’y a plus vraiment de temps à perdre.
* Les régimes autoritaires d’avant la dictature universelle
10:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.11.2009
Vient de paraître, à l'enseigne de publie.net
POLSKA B DZISIAJ

" (....)Ses parents étaient venus d’Ukraine après la guerre, des environs de Lwów. Poussés vers le nord-ouest, mais pas beaucoup, quelque deux cent kilomètres. Et il se mit à évoquer les grandes plaines de l’Ukraine avec ses yeux bleus qui vacillaient légèrement et le bras vigoureusement tendu qui montrait l’est. Et tandis qu’il racontait, je le regardais, interloqué. Moi l’étranger, j’étais venu voir un autochtone et j’étais assis devant un gars qui ne se sentait pas chez lui, là, à Gnojno, et qui parlait de son déracinement et dont la voix monocorde, je le sentais bien, était tout empreinte de tristesse.
Il inversait joliment les rôles et sans doute avait-il raison. Car moi j’étais tout de même là de mon pauvre chef, tandis que lui, c’étaient les chambardements frontaliers qu’il l’avait échoué dans ce village comme les tempêtes échouent sur les plages, les algues des fonds marins et les objets qu’on jette par-dessus bord des navires. Mais tous ces rejets, ça se ramasse, ça se conditionne, ça s’élimine. Lui, soixante ans après, il était resté tel qu’aux premiers jours, planté sur le même sable.
Il dit encore qu’avec les communistes, il avait trois vaches, un cheval, un cochon et des poules et, par-dessus tout, une paix royale. Personne ne venait fouiner dans ses affaires. Maintenant, il avait une vingtaine de vaches, une trayeuse électrique et il vendait tout son lait à la laiterie. Le lait devait être comme ci et pas comme ça, il avait fallu faire des évacuations, des aérations, des vaccins, des prévisions et il n’entendait rien à la paperasserie qu’on lui demandait. Et puis au final, il n’avait pas plus de sous qu’avant avec des tonnes d’emmerdements en plus. Alors ? Hein ? A quoi ça avait servi tout ça ? Hein ?
Il posait la question en se penchant en avant. D. balbutiait liberté, droit des gens, démocratie…Il haussait les épaules, hautement moqueur mais sans aucune brutalité.
J’ai appris beaucoup de cet homme. J’ai découvert en quoi, peut-être, résidait la force pérenne des dictatures. Pour ce paysan, comme pour bien d’autres qui m’ont tenu le même discours, le communisme tel qu’appliqué à l’est, c’était le droit de faire ce qu’il voulait dans son jardin. Pourvu qu’il ne s’y enrichisse pas de façon trop ostentatoire et ne fasse montre de ses opinions, on ne lui demandait rien. Il avait un gîte, de la pitance et la course du soleil pour éclairer les jours et compter les années. Le reste, la liberté d’écrire, de parler à voix haute, d’écouter, de lire, de voyager plus loin que la rivière, c’était affaires d’intellectuels, de penseurs et de gens des villes parce que leurs maisons, leurs rues et leurs usines étaient trop étroites. Le petit paysan, lui, il s’en fout de ces libertés-là. On ne lui a jamais appris à s’en servir, alors leur privation ne le meurtrit pas. La muselière intellectuelle ne le gêne pas. La vie est ailleurs. Elle se mesure au jour le jour, saison après saison. Elle se joue au printemps avec les labours et les semailles, l’été avec les moissons, l’automne avec le ramassage des pommes de terre et l’hiver avec la lutte obstinée contre le froid, la neige et le vent. Ce qu’il y a par delà ces rideaux quotidiens, il ne faut pas s’en mêler. C’est de la politique et la politique…La politique, ça fait des guerres et des morts.
Je pensais à la Makhnovchtchina. Que des paysans, incultes de notre point de vue, et pourtant vainqueurs de Dénikine. Et s’ils n’eussent été par la suite crapuleusement égorgés par Trotski, qu’auraient-ils fait de l’unique expérience anarchiste au monde qu’ils avaient mise en place en Ukraine ? Jusqu’où les tsars les avaient-ils volés et jusqu’où avaient-ils violé leur droit à l’existence, qu’ils aient pris une part aussi cruciale, intelligente et violente à la grande déferlante de l’histoire ?
Cet homme sec aux mains raboteuses, là devant moi, ce paysan d’origine ukrainienne, s’il était né seulement quelque trente ans plus tôt, aurait-il fait partie de l’épopée et été un compagnon de Makhno ? J’étais sûr que oui, ça me plaisait d’en être sûr et je le regardais décliner ses phrases et ses mots nostalgiques et je me disais que l’histoire, les luttes, les trahisons, les échecs, les vérités, les morts, les prisonniers, les réussites, les idéaux, les tactiques, les alliances, les buts, les systèmes, tout ça, c’était les hasards du réel, les leurres d’un prisme déformant et que les hommes n’entendaient rien, absolument rien à la mise en scène de leur propre destin. Ils étaient des ombres. Des balbutiements.
J’en éprouvai une profonde tristesse."
10:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.10.2009
Spleen
 Le cœur, lui, n’a jamais de stratégie.
Le cœur, lui, n’a jamais de stratégie.
Ni de projets, ni d’anticipation. Il éclate sa lumière ou déverse son venin avec sa logique autonome.
La tête, elle, n’appréhende le monde qu’au travers ses volontés, ses velléités et ses dogmes, ces derniers fussent-ils même libertaires.
J’entends par "monde" aussi bien les rivières, les prés, les fleuves, les forêts, les oiseaux, le temps qu’il fait, les autobus, les gares, les cités, les bouts de ferraille immondes du désordre urbain, les ponts…. que le regard humain qu’on porte à l’autre, l’estime ou l’amour ou l’amitié ou le mépris dont on le gratifie, une femme aimée emportée par des torrents d'orgasmes ou alors, les jours où Cupidon s'en fout, lamentablement échouée sous la tristesse d'une réalité obstinément standard.
J’appelle "monde" le chemin que se fraient ensemble ma tête et mon coeur dans le dédale de la pauvreté des hommes de petite condition, la lâche, pusillanime et prétentieuse fourberie des hommes-collabos de la moyenne, le hold-up permanent de ceux de grande condition et la misère* de tous confondus.
Je ne sais pas où ira ma tête dans ce capharnaüm du déclin universel, admis et consenti par tous, ma pauvre carcasse comprise. Je sais cependant où elle voudrait aller, parce qu’elle est une tête qui ne tient compte du réel que par l’image du coeur qu’elle en reçoit.
Je ne sais pas où va mon cœur non plus parce qu’il est un cœur. Mais je sais où ma tête ne voudrait pas qu’il aille. C’est-à-dire que je ne sais rien, finalement, de leur synthèse : De ce moi entier et qui a commencé de m'être volé par une inscription à l’état civil sous le nom de Bertrand Redonnet, acte de naissance numéro 068, commune 038.
Je ne sais rien. Comme toi, comme vous, comme nous.
Nos cris sont ceux de prisonniers qu'on égorge.
Parce qu'il n’y a que la synthèse qui vaille la peine d'être vécue et si l’une de ses thèses est malade de la peste, l’autre a forcément le choléra.
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, nous faisait-on réciter au catéchisme des initiations philosophiques. Affligeant aphorisme qu’on répète comme un con quand on a vingt ans et pour faire croire qu’on est intelligent mais dont on s’aperçoit très vite, si on l’est devenu un tant soit peu, qu’il renferme les premiers principes de la séparation de l’individu en deux entités contraires et combattantes, c’est-à-dire qu’il en fait un parfait aliéné, un malheureux, un fin prêt à être dominé, gouverné, culpabilisé, christianisé. Un lâche corvéable et taillable à merci.
Mais y a t-il autre chose chez Pascal qui puisse servir aux hommes à se sentir autrement que des larves ?
L’invention de la calculette et des transports en commun, peut-être…
* Considérée sous ses trois aspects, économique, intellectuel et sexuel tels que magistralement mis au jour par la brochure de Strasbourg, 1967.
11:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.10.2009
Pologne, ma bonne amie

The dark side of the moon.
Après, on est content ou on a mal, ça dépend. En tout cas, on croit y voir plus clair.
Ainsi la question s’est-elle posée, à la longue, de savoir pourquoi des gens de là-bas, que j’aime et dont je pense être aimé, hésitent à venir en villégiature chez moi.
Dans l’immédiateté, une foule de raisons prosaïques viennent à l’esprit : La Pologne, c’est loin, les billets d’avion sont chers, l’autobus c’est vraiment trop pénible et en France, c’est la crise, les gens ont de moins en moins de moyens.
Tout ça est indéniable. Et puis chacun a sa vie, ses préoccupations et ses priorités… Un affectueux salut au passage en direction du frangin et de sa compagne venus cet été en bus…Plus de 75 heures aller/retour. Par motivation et manque de finances. L’avion, c’est un truc encore très sélectif.
Quand on se pose une question, il y a donc d’abord l’avalanche des bonnes raisons et après, inévitablement, apparaît la véritable clef, celle qui va plus loin, celle qui ouvre des portes qu’on voulait laisser fermées. Le fameux « mais ».
Mais si j’habitais en Sicile, dans les îles, sous les cieux embaumés de l’Espagne, aux Seychelles, au Canada (pardon François), en Tunisie, au Portugal et même à Zanzibar, ces bonnes raisons, pour une bonne part, ne fondraient-elles pas comme neige au soleil ?
Neige justement, vent froid, l’Est, la plaine, tout ça, ça rime en images avec Pologne. On hésite un peu….Et puis….
Qu’est-ce qu’il y a à voir là-bas, à part toi ?
Pauvre Pologne, je sais tes richesses intimes ! Mais comment les faire aimer ?
Comment déboulonner cet inconscient collectif qui pèse sur ton nom, qui date de très vieux, de tous tes hommes et femmes contraints à l’exil et qui fut, il y a trente ans à peine - 3 secondes à la vitesse historique - ravivé encore par le dictateur aux lunettes noires, l’état de guerre et les longues queues qui grelottaient devant les étalages vides et sur nos confortables écrans de télévision ?
Tenez, Renaud, le chanteur, le rebelle, celui qui était pourtant loin d’être le plus con et le plus méchant de la bande, ne chantait-il pas :
P'tite conne
Tu rêvais de Byzance
Mais c'était la Pologne
jusque dans tes silences...
Deux pôles contraires : Byzance et la Pologne. On ne peut guère être plus clair. Tout est dit.
Et cette abomination, si elle avait quelque maigre excuse dans les années 80, continue ses ravages dans des têtes qui se croient pourtant haut perchées alors qu'elle n'a plus aucun fondement.
Rayée de la carte pendant 123 ans, la Pologne est négativement inscrite dans la plupart des consciences, comme s’il lui fallait encore payer tous les tourments de son histoire.
Et vont bon train les clichés les plus niais. Quand ce n’est ni le froid, ni la neige, ni la plaine, ni le délabrement fantasmé, c’est l’Èglise.
Un ancien copain qui se croyait intelligent – il doit certainement le croire encore à moins qu’il ne le soit réellement devenu – m’écrivait lors de mon premier Noël en Pologne : Noël en Pologne, ça doit être quelque-chose !
Eh ben mon pote, Noël en Pologne, c’est beau comme la neige sous des constellations livides. Et aucune loi, aucun décret, aucune convenance, aucun code ne t’oblige à aller à la messe de minuit.
Je te dirais même plus : La Naissance ici passe beaucoup plus inaperçue, en flonflons luminaires, orgies, cadeaux, champagne, foies gras et autres singeries, que sous les cieux sacrés de ta laïcité.
La Pologne, c’est une plaine qui rêve sous des cieux capricieux et des hivers tenaces en houppelandes blanches. Ce sont de sombres forêts au front altier. Ce sont de grands oiseaux venus des antipodes. Ce sont de grands silences et des rivières et des lacs. Ce sont des arts, tels les chefs-d'oeuvre de Stasiuk. Ce sont surtout des hommes et des femmes longtemps déchirés, séparés, et qui se retrouvent enfin sous le même toit.
Et sous ce toit, l’étranger jamais n’est montré du doigt ni inculpé, comme sous les cieux sécuritaires de la sarkoparanoïa, d’être « d’ailleurs ».
Il est tout bonnement naturalisé ami.
14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.10.2009
Le prix Poitou-Charentes

Je serais bien faux-cul de bouder mon plaisir.
D’autant plus que je ne m'y attendais nullement.
J’ai donc découvert hier, en musardant sur Internet, que mon Zozo s’était glissé dans le peloton de tête de la course au prix Poitou-Charentes… Rusé, le Zozo, sous ses airs de bonhomme paresseux.
Reste le plus difficile cependant : Le sprint.
Et je ne sais pas s'il en a encore sous la pédale après les efforts consentis pour faire partie de l'échappée...
Allez, un dernier coup de reins, Zozo, et ma foi, si tu faillis là, eh bien tu auras failli avec bonheur.
Car tu es, en plus, en très bonne compagnie.
Te sachant fort maladroit, je suis tout de même un peu inquiet. Alors fais gaffe à ça :

09:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.10.2009
L'automne assassiné

" Dlaczego na drzewach są rude liście?
To wiewórki pomalowały je ogonem puszystym."
Pourquoi y a t-il des feuilles rousses sur les arbres ?
Parce que les écureuils les ont peintes de leurs queues duveteuses …
Mais les vents quand ils sont fous n’entendent pas les enfants et poussent les artistes au creux des chemins d’infortune.
Comme ces vents-là.…
Ils arrivaient du sud-ouest, de la Méditerranée via les Carpates de Roumanie peut-être, rageurs et pressés, encore chauds cependant. Ils venaient du sud et l’arche noirâtre d'un ciel brouillon galopait tout droit vers les steppes de Russie.
Qu’ont-ils donc rencontré là-bas, ces vents, bien au-delà de Moscou, qui les ait effrayés au point qu'ils fassent prestement demi-tour et qu'ils reviennent alors dans un galop encore plus débridé, comme fuyant devant une épouvante ?
Demi-tour trop tardif, trop lent sans doute. Fatale hésitation. Les givres déjà s’étaient emparés de leur bagage liquide, l'avait solidifié, appesanti et glacé. Et avant de continuer plus au sud, vers les mers lointaines d’où ils étaient venus, pour fuir plus vite et plus certainement, sur la plaine polonaise ils se sont délestés de leur pénible surcharge.
Octobre enluminé s’est recroquevillé soudain sous ces averses de gel. Au beau milieu de la fête, au plus fort de leurs effets de robe, les arbres ont tremblé et se sont alourdis.
Un arbre, c’est fait pour supporter le poids de ses feuilles et le souffle du vent. Des feuilles, du vent et de la neige épaisse, c‘est bien trop lourd pour leur altière silhouette. Beaucoup se sont penchés alors, résistant encore, ils ont courbé la tête, vaincus par la morsure livide, puis ils ont plié le tronc dans une dernière tentative de survie, et enfin leurs grands moignons gelés ont effleuré le sol.
De guerre lasse, des arbres se sont couchés sur la blancheur du monde.
Je les ai entendus.
Et ce sont ces vents fous et cette neige d’automne, inconcevable en plaine et sous nos climats gaulois, me suis-je dit en rassemblant mes bûches, qui avaient pris dans leurs embuscades mortelles le conquérant ventru au sinistre bicorne…
Affligeante métonymie de nos livres d’histoire !
C’étaient des milliers de pauvres gars en haillons, le pied nu et la faim sur les dents, qui, comme mes arbres d’hier, s’étaient endormis, de guerre lasse aussi, sur l’étendue gelée d’un automne assassiné.
" Dlaczego na drzewach są rude liście?
To wiewórki pomalowały je ogonem puszystym."
Hier, c'était pourtant l'été...



12:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.10.2009
Cigogne qui claque du bec !

- On ne devient pas poète. On naît poète. Pas génétiquement bien sûr, ce serait effrayant et idiot.
On naît poète comme le chiendent pousse sur certains sols et pas sur d'autres.
Après seulement intervient l'être et le devenir : On laisse chanter ce poète ou on lui tord le cou.
- Le poète est souvent amoureux de l'impossible. Il n'est guère payé de retour.
- La poésie c'est le monde sans ses fonctionnalités. Autrement dit, les fleurs sans la botanique, l'amour sans la gynécologie et la mélancolie sans la psychologie.
- La poésie n'a pas de rôle en dehors de celui qu'elle s'assigne elle-même. C'est sa lecture qui a un rôle social.
Et il n'y a là-dedans aucune dialectique de la poule et de l'oeuf, tant il arrive souvent qu'on ne lise pas exactement ce qu' écrit la poésie.
- Le poète aime écrire parce qu'il ne sait guère discuter calmement.
Comme d'autres aiment discuter parce qu'ils ne savent pas écrire calmement.
- Le poète sait trop qu'il n'y a guère que des pigeons n'ayant jamais su voler plus haut que leur perchoir pour croire qu'un seul battement de leurs ailes puisse les projeter jusqu'aux nuages.
- Un ami très proche, un jour aux prises avec les tourments de l'amour resurgi impromptu sous ses pas débonnaires, m'avait ingénument demandé, dans son désarroi, ma conviction du bonheur.
- C'est l'absence de tourments, avais-je assuré.
C'était une réponse de poète et ça ne l'avait pas beaucoup aidé.
- La belle écriture est celle qui a la précision d'une partition, celle qui ne prête pas à la cacophonie des interprétations.
Elle se situe bien au-delà du style.
- Je ne conçois de poésie que subversive.
C'est une lecture de mon parcours. Conception réductrice ?
L'histoire inclinerait en effet à ne me donner que très partiellement raison.
- Le poète qui devient riche ou (et) qui compose avec les douloureuses aberrations sociales n'en cesse pas pour autant d'être un poète.
Qu'il en souffre ou non est du domaine de l'intime et, en dernier ressort, de l'éthique intime.
- La vie d'un poète - dans ce que j'en pressens - est forcément en dents de scie, chaotique, décalée à l'intérieur, voire partout.
Ce qui ne signifie pas que toute vie chaotique soit celle d'un poète. Sans quoi les conditions pitoyables d'existence imposées par le monde n'auraient produit que des poètes.
Ce qui depuis longtemps l'aurait conduit à sa perte.

Encore une évidence qu'on se refuse à brasser. Bien évidemment.
- L'amour qui ne convoque pas chaque matin une muse à son chevet, sombre dans l'institution.
- Quand les poètes se feront des voyous et les voyous des poètes, l'espoir aura peut-être une chance de changer de camp.
Mais pour avoir fréquenté, voire aimé, les uns et les autres, je peux prédire que c'est pas demain la veille !
- Le poète n'entend rien aux chefs-d'oeuvre : Il n'est guère que des imbéciles faisant les intellectuels et des intellectuels faisant les imbéciles pour s'extasier devant un chef-d'oeuvre.
- Mon regard n'a rencontré qu'un seul chef-d'oeuvre de détresse poétique : dans les yeux d'un condamné à mort.
- Un homme qui lit peut se dispenser d'écrire. Fort heureusement.
Mais un homme qui écrit et qui se dispenserait de lire serait comme un muet qui tenterait de s'égosiller.
- Je demande à mon écriture de me ramener chez moi, à mes lectures de me conduire chez les autres.
Mais il arrive souvent que les rôles soient inversés.
- L'éternité est une dimension de la poésie confisquée, dénaturée, désamorcée par les religions et leur dieu totalitaire..
L'éternité, au regard de l'univers, n'admet pas d'être régentée. Admettre Dieu, c'est admettre une fin arbitraire, entendue comme objectif et limite, à l'éternité poétique, au même titre que d'admettre comme souveraine la seule matière connue des hommes comme principe fondamental de l'éphémère.
Pour le poète, Le matérialisme et le déisme sont deux garde-fous complices d'une même tentative de conjuration de l'angoisse de l'impensable.

- Ce que nous appelons le réel n'est que la dimension de nos maigres possibilités.
- Un poète qui aurait toujours raison serait dégoûté, non pas d'avoir toujours raison, mais d'être poète.
- Le poète est sans doute celui qui lit le monde avec le magma qu'il porte en lui. Les mots sont ses lampes de chevet.
Quoiqu'il arrive souvent qu'il lise dans le noir....
- Le fondement de toute idéologie est la poursuite d'objectifs, clairs ou non-dits. La pierre angulaire de toute poésie est de marcher à l'aveuglette.
- Un poète qui séduit tout le monde ne plaît à personne.
- J'ai vécu certaines années dans un monde salarié et nous ne nous comprenions pas. Spontanément, on m'avait affublé d'un sobriquet. Le poète.
Ça n'était pas méchant, ça n'était pas gratifiant, ça n'était pas gentil non plus.
Je crois que ça voulait dire "l'Autre".
- Un poète qui sait dans quel lit il mourra est déjà mort.
15:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.09.2009
Zozo, chômeur éperdu
Voilà cinq mois exactement aujourd’hui que Zozo, casse-croûte et nonchalance en bandoulière, bat le pavé de France et de Navarre, de librairies en librairies et de lecteurs en lecteurs, par quelque temps qu'il fasse.
C'est du moins ce que j'imagine parce que je l'espère.
Un auteur est toujours soucieux du parcours de son livre. Il guette les retours...

Des fois, c'était "oui, bien sûr ", des fois c'était "non, on n'a pas de ça", des fois c'était carrément " qu'est-ce que c'est ?"
Rien n'est pourtant plus cruel que de parler dans le vide. Sensation glaciale d'être soudain parfaitement inutile et néantisé.
L'auteur, donc, a besoin de retours. Mais là, c'est une autre voix que la sienne qu'il veut entendre. Quand il y a de l'écho, est-ce le crieur ou le paysage qui parle ? Alors, il glane de-ci, de-là, les lointaines résonances d’un ou d’une qui donne des nouvelles :
- Hé, t’inquiète, j’ai vu passer ton Zozo ! Il va bien !
Curieusement sur internet, incontournable beffroi de notre activité d'écrivain et où chacun pose le maillon d'un fraternel relais, ce sont les gens vers lesquels Zozo était venu s’offrir bras ouverts, qui, jusqu’alors du moins, n’en ont pas fait état, alors que beaucoup d’autres qui spontanément étaient allés vers lui, l’ont gratifié d’un bel hommage. Comme quoi le livre a cela d'humain qu'il doit être désiré plutôt que de s'imposer.
Ces renvois spontanés font bien plaisir. Oui.
Car l’auteur, je le répète, d'autant plus qu'il est un auteur à peine connu et sans être celui qui attend qu’on lui inonde le nombril de suaves compliments, n’existe bel et bien que par ce que son écriture suscite d'émotion. C'est là tout l'espoir de son plaisir d'écrire.
Parmi ces spontanés, je veux ici remercier avec chaleur et amitié Solko et Feuilly (relayé par le Magazine des livres), Jean-Louis Kuffer et Sahkti, Philip Seelen et Michèle Pambrun dans leurs divers commentaires…et puis Anthony Dufraisse, pour son très bel article du Matricule des Anges.
Il y eut aussi Jean-Luc Terradillos de l’Actualité Poitou-Charentes et sans doute quelques autres que j’oublie et auxquels, humblement, je demande qu'ils m'excusent.
Il y a quelques jours, Stéphane Beau, compagnon de route des Sept mains puis de Tempête dans un encrier, m’avait fait gentiment parvenir deux exemplaires de l'excellente revue aux destinées de laquelle il préside. C'est avec une grande sincérité de coeur que je vous recommande d'ailleurs la lecture de ce Grognard. On en ressort avec le sentiment d'appartenir à cette diaspora des gens qui savent encore penser autrement.
Dans le numéro de septembre, Stéphane Prat signait un article que je reproduis ici, avec l’aimable autorisation des deux Stéphane :
 « Le droit à la paresse, Zozo ne le gagne pas, il le prend. Zozo a beaucoup trop à faire pour travailler. Débordé, Zozo, entièrement pris par la vie, et pour une bonne part par la sieste : « (…) chaque jour consciencieusement consacrée, l’été sous la fraîcheur ombragée de ses noyers, l’hiver sous les couettes en plumes d’oie d’un lit douillet. (…) une nécessité régénératrice après le gros déjeuner où Zozo avalait sans coup férir soupe, pâté, rillettes, volaille, lapin ou goret, fromages gâteaux, fruits, arrosé d’un bon litre et demi de pinard tellement rouge qu’on eût dit qu’il était noir… »(p. 8)
« Le droit à la paresse, Zozo ne le gagne pas, il le prend. Zozo a beaucoup trop à faire pour travailler. Débordé, Zozo, entièrement pris par la vie, et pour une bonne part par la sieste : « (…) chaque jour consciencieusement consacrée, l’été sous la fraîcheur ombragée de ses noyers, l’hiver sous les couettes en plumes d’oie d’un lit douillet. (…) une nécessité régénératrice après le gros déjeuner où Zozo avalait sans coup férir soupe, pâté, rillettes, volaille, lapin ou goret, fromages gâteaux, fruits, arrosé d’un bon litre et demi de pinard tellement rouge qu’on eût dit qu’il était noir… »(p. 8)
Seulement, nous sommes en pleine euphorie gaullienne, début soixante du siècle dernier, et le Progrès pousse à la roue, on va de l’avant dans le Poitou de Zozo, on veut l’eau courante et l’instruction civique. Deux gros chantiers, celui de l’adduction d’eau et de l’école républicaine, que Zozo, s’il n’y coupera pas, devra esquiver coûte que coûte, au moral comme au physique, quitte à s’inoculer lui-même une flemmardite chronique, ou à s’attribuer l’héroïsme du progrès qu’il vomit, pour mieux lui échapper. Non, ce corniaud de maire ne le prendra pas au travail, Zozo a décidément trop à faire : « On était au début février. Un vilain crachin tombait d’un ciel si bas que les cimes des bois disparaissaient dans le brouillard. La campagne se languissait tout le jour dans une morne pénombre mais Zozo, dégoulinant des pieds à la tête, n’en arpentait pas moins les champs et tâchait de tirer des merles qui fuyaient le long des haies. Aucun de ces satanés oiseaux n’était cependant disposé à se laisser abattre. Avec un sifflement furieux, ils déboulaient des buissons en pluie et filaient à tire d’aile en zigzaguant. Malchanceux, Zozo tirait invariablement dans le zig quand le merle était dans le zag et inversement. » (p.16)
Car Zozo a deux amours dévorantes : la chasse (vouant à sa passion une maladresse surréelle) et Pinder, son cochon annuel, perpétuel, qu’il engraisse de discussions et de confidences passionnées avant de lui faire son affaire, invariablement le 2 Novembre, l’équilibre de sa petite famille en dépend. Et les quolibets, les vannes à deux balles que lui valent sa nature lunaire et soliloqueuse, délivrent un fin parfum de consécration, tellement il parvient à s’en moquer comme de Colin Tampon : « Pour un observateur superficiel ou résolument partial, la vie de Zozo évoluait dans une espèce de bohème anarchique, sans repère, au p’tit bonheur la chance.(…) Les années de Zozo cheminaient pourtant selon un ordre bien défini qui, s’il n’était pas réfléchi, n’en était pas moins réglé sur le grand mouvement des choses, en fonction des saisons, les saisons elles-mêmes vécues par rapport aux mois et les mois articulés sur les lunes.(…)Invariablement. » p33.
Et il faut une écriture diablement truculente pour suivre un personnage pareil, passionné des bobards les plus énormes, moins pour leurrer son monde que pour rester lui-même, et continuer à voir, et jouir des cycles entremêlées des gestes, des attentes ou des natures sensibles. Et Bertrand Redonnet a l’art du détail comme des variations célestes, des couleurs, des friches, des traces animales et des sons, et surtout des saisons dans tout ça… Un visionnaire, pour le coup, mais pas dans le sens théoricien ou catastrophiste. Un simple visionnaire, avec l’imprévisible qui va avec. On s’attend à un « Zozo le bienheureux » et on se retrouve avec un drame, on redoute le tragique d’un embrouillamini de clocher et c’est son côté farce qui l’emporte, ou on tombe en pleine intrigue rurale comme au beau milieu d’un tableau ethnographique. C’est le côté indéfinissable de ce livre qui est particulièrement saisissant, et pour tout dire imparable. Avec ce Zozo éperdument terrien, les prémices trop vertes des dévastations humaines du travail de masse à venir, dans l’héroïque sillage des chocs dits pétroliers, sont débusqués dans le regard de gens simples sur un des leurs, rétif à la sueur imbécile, chômeur avant le chômage. Il ne fait que leur opposer la vie, qui n’est pas rose, mais rosse, cocasse et répétitive, à laquelle l’idéologie du travail, en germe dans ce Poitou légendaire, se proposera rien de moins que de tourner le dos, et la saccagera dès qu’il le faudra… Pour le bien de tous, comme de bien entendu, et pour celui d’aucun."
Stéphane Prat
11:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET























