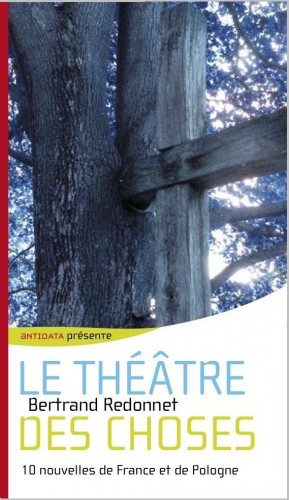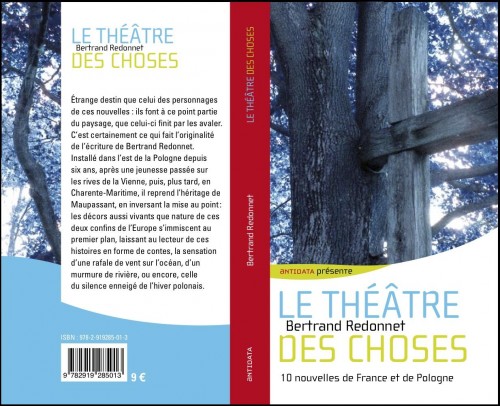15.08.2011
Le petit homme du temps qui passait

Je n’ai pas eu le temps….
Je m’occuperai de tout ça quand j’aurai le temps.
Diantre ! Si nous réfléchissions un tant soit peu à notre langage quotidien, nous aurions toute raison d’en être effrayés.
Avoir le temps.
Avoir une montre, une pendule, des priorités, un train à prendre, être fainéant, ne pas avoir envie, être lent, d’accord. Mais avoir le temps, quelle vanité !
Inversion complète du réel : C’est le temps qui nous a. Et complètement d’ailleurs. Parce que lui, il ne s’arrête qu’une seule fois. Et là, quand il s’est arrêté, on a vraiment tout son temps.
Le temps qui passe. Tout le monde connait les célèbres vers : Le temps s'en va, le temps s'en va, madame, - Las! Le temps, non, mais nous nous en allons - Et tôt seront étendus sous la lame. Dichotomie douloureuse. Et pour la résoudre, autant, finalement, abuser des tournures consacrées qui s’approprient avantageusement cet insaisissable vainqueur.
Dans le genre contraire, on dit aussi : J’ai du temps devant moi….Oui, sans doute, mais cela n’est-il pas présomptueux et ne fait-il pas allègrement fi de l’éventualité d’une peau de banane posée sur ce temps-là ?
Le seul temps à qui je reconnaisse une existence trop véritable, n’est pas devant, mais derrière. Ce temps-là, j’eusse aimé qu’il m’appartînt complètement, mais le nombre de fois où j’ai pu dire « je n’ai pas le temps » me prouve bien qu’effectivement, il n’y eut jamais le moindre temps qui soit à moi, puisque, même sans avoir le temps, je suis arrivé jusque là.
Comme pris en charge par un invisible véhicule, en fait.
Bref, j’ai perdu mon temps à ne pas avoir le temps. Et voilà une bien belle expression de dépit ! Perdre son temps. Enfin reconnaître que le temps est quand même un ami. Comme lui, on ne perd que celui qu’on n’a jamais eu !
Et pendant que je délire, là, sur ce blog inutile, le temps passe...le temps passe…
Le temps s'écoule, comme disait Raoul (1).
Alors me revient en mémoire une image. Une anecdote qui, en dépit de son caractère dramatique, m’avait presque fait mourir de rire, comme on dit sans vraiment penser à ce qu’on dit.
C’était à Mauzé-sur-le-Mignon, le Mauzé-sur-le-Mignon de ce cochon de Morin (2), et c’était par un après-midi froid, bas et gris, de novembre.
Le ciel pesait comme un couvercle. Un après-midi de long ennui. Long comme un corbillard.
J’étais en train de perdre lamentablement mon temps dans un bistro plongé dans une triste pénombre. J’y lisais le journal et j’y buvais des demis.
Derrière le bar, le patron feuilletait un magazine de sport, peut-être de cul, et, à part moi, un seul client était là, debout. Un tout petit client, un petit alcoolo sympathique, bien connu dans le coin, tout petit, si petit que son menton arrivait à peine à la hauteur du zinc.
Il se languissait devant un verre de mauvais pinard, du rouge, et, dans l'obscur silence du petit bistro, on n’entendait par intermittences que sa toute petite voix de fausset qui psalmodiait, tandis qu’il regardait au travers un rideau jauni la rue immobile, morose, vide et muette : O s’passe rin…O s’passe rin… O s’passe vraiment rin…
Il ne se passait rien, effectivement. Le temps - il est coutumier du fait - faisait semblant de s'être arrêté et le petit bonhomme semblait s’en désespérer.
Presque en avoir peur.
Tellement qu’il porta soudain sa petite main à sa petite poitrine, poussa un petit cri strident, comme un couinement de souris, et écroula son petit corps au pied du grand comptoir.
Dans les cinq minutes qui suivirent, les pompiers alertés débarquaient : sirène, crissement de pneus, apostrophes, gyrophare, portes qui claquent, brancard, médecin, infirmier, badauds extirpés de la grisaille, surgis d’on ne sait où, femmes et enfants aux fenêtres.
Un vrai charivari, cette rue absolument morte quelques instants plus tôt !
Le petit homme, sans doute las de perdre son temps devant un verre de mauvais vin et devant les facéties du temps qui faisait mine de ne plus passer, venait de transformer la rue déserte en champ de foire où les gens se saluaient, s’interpellaient, demandaient, constataient, critiquaient, supputaient, plaignaient, commentaient, pronostiquaient et se lamentaient.
Bref, s’amusaient enfin à perdre un temps fou, à peine retrouvé, et qui n’avait jamais été à eux.
1 - Vaneigem
2- Les Contes de la bécasse
Illustration : Sur la frontière ukrainienne, un cheval attend tranquillement son maître qui a pris le temps de s'arrêter boire un coup.
06:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.08.2011
La grand' terre de nos grands-pères

Encore un abus de langage. Un triste abus de langage.
Une métonymie incongrue peut-être. Un raccourci fautif.
Car je n’ai jamais vécu en terre étrangère. Vous non plus d’ailleurs. A moins que vous n’ayez vécu, petits et petites cachottiers (ères), un exil sur Mars ou sur la lune.
Selon mon entourage le plus proche, c’est là que j'habite quand je suis en exil.
Pas en Pologne mais sur la lune.
Je suis souvent dans la lune, paraît-il. Avec mes pieds qui touchent pourtant bien par terre.
Et pas une terre étrangère.
Je la connais depuis mon premier vagissement, cette terre. Elle a les mêmes senteurs humides des fins d'été que dans la Vienne ou le Poitou-Charentes. Au ciel sont les mêmes nimbostratus, les mêmes flocons blancs sur fond d’azur, les mêmes arbres qui se balancent au vent, les mêmes rivières qui coulent dans le même sens sur les mêmes prairies, les mêmes vols d’oiseaux, le même air, la même course du soleil, quoique décalée, les mêmes crépuscules du soir ou du matin.
Cette nuit, je me suis réveillé…La pleine lune frappait aux carreaux et se répandait au sol, se glissait en silence sous la bibliothèque. C’était la même pleine lune que si j’eusse été endormi à Angoulême.
C’est là ma terre, celle que j’aime. C'est mon vaisseau spatial dans le grand mouvement des choses.
Ce sont les gens qui sont étrangers. Parce qu’ils n’ont pas les mêmes sonorités que moi pour dire le monde et qu'une chose toute simple qui me paraît vraie ne leur semble pas forcément exacte, et vice-versa.
Mais ils étaient sous ce coin de ciel bien avant moi.
C’est donc moi l’étranger. De fait.
La notion d’étranger, c’est la loi du premier occupant. C’est peu et c’est énorme.
Et ça le restera tant que les charters et les rafles de Roms, comme toutes les rafles de l’histoire, resteront inscrits dans les cerveaux du monde comme les crachats dégoutants de la loi du premier occupant.
Préhistoire humaine.
Il manque en fait à cette terre la première ligne, les premiers mots, d’un véritable contrat social entre tous les hommes.
Autant dire qu’il lui manque tout pour être dignement habitée.
07:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.08.2011
Entre "Zozo" et Le "Théâtre des choses"
Un article de La Nouvelle République
17/O7/11
Bertrand Redonnet : drôles d'histoires de Zozo
Originaire du Poitou, vivant en Pologne, l'auteur était hier à l'ouverture de Contes en chemin à Sainte-Eanne. '' Le travail salarié bouffe la vie des gens ''.

Jean-Jacques Épron, hier à Sainte-Eanne, interprétant le personnage de Zozo. Une critique sociale pleine de drôlerie et de tendresse.
|
C'est qui, Zozo ? Bertand Redonnet réfléchit deux secondes. « C'est un vieil anar. C'est le plus sincère des rebelles puisqu'il l'est sans le savoir. » Zozo vit à contre-courant. Il est chômeur à une époque - on est dans la France gaullienne - où le chômage n'existe pas.
|
Yves Revert
11:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.07.2011
Sortie dans une semaine environ : Le Théâtre des choses
Bonheur de voir tout le travail mené cet hiver, puis tout celui fourni en collaboration étroite avec l'équipe d'Antidata depuis deux mois, porter ses fruits et se matérialiser dans ce recueil.
Un livre que personne ne réduira en cendres d'un coup de clic caractériel, revanchard, irresponsable et malhonnête !
Bref, un vrai livre chez un vrai éditeur.
16:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.06.2011
Ainsi va le monde

Quand on sait dans quel marasme social l’oxymore du "centralisme démocratique" avait plongé la Russie et, avec elle, une bonne partie du monde, on serait bien évidemment tenté d’affirmer aussitôt, par réflexe culturel et défensif, tout le contraire de la moindre allégation du chef bolchevique.
Le bon mot a pourtant pris un certain sens dans nos sociétés libérales, les deux professions indexées n’étant pas particulièrement réputées pour la finesse de leurs analyses politiques. Mais bon…
Plus tard, beaucoup plus tard, le communisme ayant fait la preuve – pour qui avait bien voulu se pencher un moment sur ce qui se passait réellement à l’est et en Chine comme sur ce qui s’était réellement passé dans l’Espagne de 1936 - de sa duplicité et de son incapacité, voire de sa cruauté, et le drapeau rouge ayant franchement viré au noir, on disait plutôt, goguenard et désabusé : " La situation sera révolutionnaire quand les philosophes deviendront des voyous et les voyous des philosophes."
Ça avait de l’allure aussi…Et on peut effectivement supposer qu’un tel renversement des rôles sociaux eût été de nature à changer radicalement les fondements de toute une société.
Mais c’était de la poésie. Le voyou est forcément philosophe pour son propre compte et le philosophe, depuis le temps qu’il presse le citron sans qu’il n’en sorte aucun jus nouveau, même s’il se faisait voyou, n’arriverait pas à pisser plus loin que son ombre sous le midi d'un solstice d'été.
Donc, les garçons de café et les coiffeurs n’ont jamais décrété la grève insurrectionnelle et les voyous et les philosophes ont toujours fait chambre à part. Au mieux, quand ils se sont retrouvés confrontés dans la même personne, ont-ils fait des ministres.
Alors, vogue la galère…Tout ça, c’est bien du bla-bla et l’histoire va son chemin cahotant.
Mais alors, m'étais-je dit un beau matin en parcourant les nouvelles, comment qualifier un monde où un prêtre se met en devoir de braquer une banque, et ce, dans le pays le plus catholique de notre Europe bien-pensante, ? Là, il y a manifestement un mélange explosif des genres. Un brouillage de cartes tel que n'en avait jamais envisagé le plus farouche des théoriciens de la guerre sociale.
Un Vautrin, alias Jacques collin, alias l'abbé Carlos Herrera ?
Ou alors Jacques Roux.
Dont on sait qu’il fut contraint de se suicider pour éviter que les « révolutionnaires » de l’époque, les Saint-Just, Robespierre et autres Danton, ne lui coupassent le cou parce qu’il dénonçait déjà, et avec quelle force !, une Révolution au service exclusif de la classe sociale qui, depuis, gouverne effectivement le monde.
Pour en revenir à notre malheureux Dillinger polonais et en soutane, sachons donc qu'il s’est évidemment fait sauter, sitôt son forfait accompli.
Il mérite cependant que les poètes se penchent un moment sur son sort et lui consacrent quelques mots fraternels, tant son geste bouleverse les choses communément établies dans les têtes et accuse la solitude et le désarroi dans lesquels sont plongés les hommes et les femmes de ces temps vulgaires.
Le confusionnisme intéressé du sociologue dirait : C'est un cas isolé. Tous les cas sont isolés, mon brave, et, par le fait même, d'une dramatique éloquence.
Quant au parquet de Poznan, il eut des mots qui font sourire, car n’oublions pas que le délinquant est un homme de dieu officiant pour la religion la plus riche du monde :
C'est un vicaire mais sans poste fixe actuellement.
Restrictions budgétaires, peut-être ?
Photo : Sas d'entrée d'une banque en Pologne
11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.06.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
ROGER
La secrétaire de mairie m’avait appelé un matin pour me demander de l’accompagner. Elle n’osait pas aller te voir toute seule. Tu n’étais pas vraiment méchant, mais tu étais quand même connu pour avoir su jouer des poings, à plusieurs occasions. « C’est qu’il n’est pas fin le Roger », qu’elle pleurnichait, la secrétaire de mairie… Mais le maire avait été formel : « on ne peut pas le laisser comme ça. Un jour, on va le retrouver mort et la commune fera la une de Presse Océan ou de Ouest France… Y a mieux comme publicité… »
Il n’embêtait personne, pourtant, Roger. Il avait 63 ans et il vivait à deux kilomètres du bourg, dans une grange en tôles ondulées qui s’ouvrait sur un bel étang entouré de frênes, de bouleaux et de saules pleureurs. Il créchait entre un vieux tracteur hors d’état de marche et quelques balles de paille. Son lit : un matelas crasseux posé à même le sol de terre. De vieux duvets immondes lui tenaient lieu de couvertures. Dans un coin, une magnifique armoire dénotait vraiment. Et, près de l’entrée, une table recouverte de boites de conserve et de litres de pinard plus ou moins vides. Juste à côté, un énorme bidon/brasero, bourré de braises rougeoyantes, servant en même temps de chauffage et de cuisinière. Il faisait deux ou trois degrés dehors, guère plus dedans. Tu nous avais accueillis en nous envoyant tes deux chiens dans les jambes et notre peur t’avait fait marrer : « Vous en faites pas, ils vont vous laisser rentrer… Par contre pour sortir ce sera une autre histoire ».
Tu nous avais fait comprendre que tu te foutais de notre inquiétude et que le maire « ce grand con-là » ferait mieux de s’occuper de ses fesses… Je constatais soudain qu’il y avait une maison, à quelques mètres seulement de ta grange. « Et avec les voisins, t’avais-je demandé, ça se passe bien ? » « Quels voisins, m’avais-tu répondu ? Elle est à moi cette maison ! » « Et vous n’y habitez pas ? Ce serait plus confortable… » « Nan… Elle a de mauvaises ondes… »
Au moment de te quitter, tu t’étais arrêté devant l’étang et tu avais planté ton regard dans celui de la secrétaire de mairie : « Tu sais que pendant la guerre, y a un motard allemand qui s’est foutu dans cet étang avec son side-car ? Et tu sais pourquoi il a fait ça ? » Silence inquiet de la secrétaire de mairie… « Tu sais pas pourquoi ? » « Non », osa-t-elle balbutier… » Roger avait souri : « P’têt qu’y voulait pas voir ta gueule ! »
Et alors que nous nous éloignions, nous entendions ton rire sonore qui couvrait les aboiements des chiens.
Tu étais un sacré emmerdeur, Roger, mais tu avais du cran.
Je ne t’oublie pas.
11:13 Publié dans Acompte d'auteur, Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.06.2011
Si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi
 Le théâtre des choses, recueil de dix nouvelles sur lequel j’ai travaillé tout l’hiver et qui paraîtra fin juin - avec un rendez-vous bientôt pris dans une librairie parisienne - Zozo, chômeur éperdu, Géographiques, trois livres qui m’ont donné, en trois ans, dans leurs moments d’écriture, tout ce que j’attends de l’écriture.
Le théâtre des choses, recueil de dix nouvelles sur lequel j’ai travaillé tout l’hiver et qui paraîtra fin juin - avec un rendez-vous bientôt pris dans une librairie parisienne - Zozo, chômeur éperdu, Géographiques, trois livres qui m’ont donné, en trois ans, dans leurs moments d’écriture, tout ce que j’attends de l’écriture.
Le temps est venu pour moi, en ce qui concerne la pratique numérique, d’identifier l’arbre qui me cache une forêt que je pressens peuplée d’inavouables sournoiseries. De l’abattre le cas échéant.
Le temps de la réflexion est venu. Prendre le temps d’y voir clair. Je ne trouve plus - momentanément sans doute - le plaisir que j’avais à m’exprimer ici.
Standby.
D’autres projets m’attendent qui me passionnent et qui, toujours depuis le grand corps de la littérature, voudraient bien voir le jour. Pour un autrement. Merci aux quelques amis contactés d'avoir répondu présents. Dans le principe.
A plus tard, donc. Cela peut être la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou dans six mois, ou dans un an.
Liberté des désirs et des envies sans échéance.
Merci à tous et à toutes de votre lecture de l’Exil, dont la fréquentation, si j’en crois la rumeur chiffrée des coulisses, s’est toujours maintenue au même niveau depuis un an.
Image : Philip Seelen
Titre : proverbe arabe
10:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.05.2011
Une plume au curare
J'évoquais, il y a quelque temps, Henri calet et je faisais un rapprochement entre son écriture et celle de Georges Darien, en ce que ces deux auteurs ont en commun une plume délectable au service de l'antiphrase permanente.
Une plume ironique, façonnée par une impeccable maîtrise de la dérision.
Plus de trente ans que l'Epaulette me suit partout et plus de trente ans que je relis toujours, de temps en temps, avec le même plaisir et les mêmes sourires, l'ouverture de ce livre magnifique.
Dans le genre, peu, pour ne pas dire aucun, ont fait mieux depuis Georges Darien (1862 -1921).
Céline peut-être.
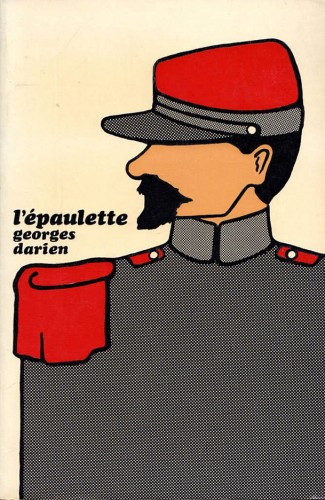 Le colonel Gabarrot racontait de belles histoires.
Le colonel Gabarrot racontait de belles histoires.
Il disait que les Russes étaient des coquins, que les Prussiens étaient des bandits, et que les Anglais valaient encore moins. Quelquefois, il me montrait sa croix d’officier de la Légion d’honneur qu’il avait gagnée à grands coups de sabre, et qu’il gardait dans une belle boîte noire ; si je voulais en avoir une pareille, quand je serai grand, je n’aurais qu’à tuer beaucoup de Russes, beaucoup de Prussiens, et surtout beaucoup d’Anglais.
- Malheureusement, disait-il, on ne tue plus guère, à présent ; on est devenu sentimental.
Et il ricanait.
Mon père lui faisait observer qu’on tuait encore pas mal. La Crimée, par exemple. Le colonel avouait que la Crimée, c’était très bien. Tuer des Russes, rien de mieux ; on n’en éventrerait jamais assez. Mais pourquoi aller s’allier avec les Anglais ? Sans doute, l’Empereur avait eu ses raisons, et des bonnes ; quand on est un Napoléon, on a une cervelle sous son chapeau ; mais enfin, il n’aurait pas dû oublier que les Anglais, c’est des Anglais, et qu’ils avaient empoisonné son oncle. Mon père haussait les épaules ; et le colonel éclatait.
- Tonnerre de Brest ! commandant Maubart, je ne souffrirai jamais !... Ils l’ont empoisonné à Sainte-Hélène, je vous dis ! Sans ça, il serait revenu, mille bombes ! Je l’ai connu, moi, et depuis la campagne d’Egypte, encore ! Et je puis vous le dire, qu’il serait revenu, et qu’il ne nous aurait pas laissés en panne, les bras ballants, à nous manger le sang en demi-solde, sous des gueux de Bourbons qui n’avaient jamais vu le feu qu’au bout des cierges ! Il serait revenu, pour sûr, si les Anglais ne l’avaient pas empoisonné !
Mon père faisait semblant d’admettre la chose, et parlait de la campagne d’Italie.
Le colonel avouait que l’Italie, c’était très bien. Tuer des Autrichiens, rien de mieux ; on n’en éventrerait jamais assez.
- Quoique, à vrai dire, ce ne soit pas la mer à boire que de donner une raclée aux Autrichiens ; nous leur avons flanqué une telle volée à Wagram que, depuis ce temps-là, ils ont le foie plus blanc que leurs tuniques ; vous avez vu, il y a deux ans, comment ils se sont fait battre par les Prussiens. Qu’est-ce que vous voulez ? Quand un peuple se laisse vaincre par des Prussiens, des vagabonds, des cosaques manqués, il n’y a plus qu’à prononcer son de profundis.
Mon père prenait la défense des Prussiens, fort à la mode en 1868 ; mais le colonel tenait bon. Il connaissait les Prussiens, et très bien.
- Je n’ai pas été à Iéna pour le roi de Prusse, peut-être ! Tenez, je vais vous dire ce qu’ils savent faire, les Prussiens : ils savent vous tirer dans le dos pendant que vous bourrez votre pipe. C’est tout. Et pour leur fameux fusil à aiguille, voici mon opinion : avec ce fusil-là, on n’a pas à déchirer les cartouches, et c’est rudement commode pour des gens qui n’ont jamais pu regarder l’ennemi sans claquer des dents.
Nous aimions beaucoup le colonel Gabarrot ; il avait été l’ami intime de mon grand-père, le colonel Maubart ; après avoir fait les dernières guerres de la République et celles de l’Empire, jusqu’à Waterloo, ils n’avaient repris du service, ensemble, qu’en 1830, lorsque le drapeau tricolore remplaça le torchon blanc dans lequel les traîtres de l’Emigration avaient empaqueté leurs goupillons et leurs poignards, avant de quitter Coblentz. Il y avait bien un coq au lieu d’un aigle, à la hampe de ce drapeau-là ; et Gabarrot, pas plus que mon grand-père, n’aimait "les oiseaux qui se laissent manger". Mais enfin, les couleurs y étaient (...)
L'épaulette - Georges Darien -
12:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.05.2011
Les galeries souterraines de la langue

Chateaubriand, dans une œuvre magnifique à bien des égards, Le Génie du christianisme, ambitionnait de prouver l'existence de dieu en s'appuyant sur les merveilles présentes dans la nature.
Je ne me souviens plus exactement de l'intégralité des textes, mais je me souviens des pages parfaitement ciselées sur le chant du rossignol. D'autres pages aussi sur lesquelles il est écrit que les oiseaux et leurs mélodies n'ont d'autre raison d'être que celle de chanter les louanges de la Création.
C'était une sensibilité assoiffée de métaphysique et l'on voit dès lors en quoi elle allait ouvrir la porte à la déferlante romantique.
Un livre superbe, donc, dont certains passages me sont restés comme des références, sur lequel je m'appuyais même, adolescent reniant pourtant, instinctivement, l'existence d'une quelconque puissance céleste et du grand horloger de Voltaire.
Des pages de littérature qui donnaient un sens encore plus intime à mes escapades à travers les champs, les bois et le long des rivières. À mon affection pour les oiseaux aussi, pour leurs mœurs et leur présence partout furtive.
Ici, sur la platitude ouverte ou boisée des saisons qui s'enchaînent, je les ai retrouvés, mes oiseaux. Les mêmes que sous les brises océanes, sauf l'hiver. Dès la mi-août, la plupart à tire-d'aile traversent le ciel en direction de l'ouest, cap sur les tempérances océaniques. Mes sédentaires ou erratiques de là-bas sont ici migrateurs : grives, ramiers et tout le peuple discret des petits passereaux. L'hiver continental est silence.
J'ai retrouvé les oiseaux et, pour beaucoup, ai su les reconnaître à leur chant, sans même les voir dans les feuillages lumineux du printemps ou poussièreux de l'été. Cette langue que chantent les oiseaux n'a ni frontières ni pays. Ces ramages, à la note près, sont les mêmes aux portes du cyrillique que sous les brumes d'inspiration romane.
Ils portent cependant d'autres noms, les oiseaux. C'est ce qui fait d'eux des étrangers, en dépit de l'universalité des trémolos, de la façon de voler, de construire leur nid et d'arborer les mêmes couleurs de plumage. En apprenant leurs noms, il me semble les apprivoiser mieux, les faire poètes complices de mes paysages...
Des noms parfois difficiles, comme celui de ce bel oiseau, orange et turquoise, couleurs veloutées, fureteur des eaux et des ajoncs, le long des rivières ou des eaux dormantes d'un étang. Le martin pêcheur...celui qui hantait les canaux et les chemins de halage du marais poitevin, tout en aquarelles de vert et de jaune.
Le martin pêcheur polonais, c'est zimorodek, littéralement celui qui naît en hiver...
Nous avons longtemps cherché le pourquoi de cette bizarrerie. Les oiseaux naissent au printemps, à plus forte raison sous ces rudes latitudes.
J'ai feuilleté mes grands livres d'oiseaux, leurs textes et leurs images. J'ai consulté les sites consacrés à l'ornithologie...Le martin pêcheur naît bien en mai ou juin...Alors ?
De guerre lasse, j'ai interrogé un ami dont je savais qu'il avait un ornithologue parmi ses proches. Et la réponse, linguistique en fait, est venue éclairer le non-sens.
Le martin pêcheur creuse des galeries souterraines dans les berges des cours d'eau et c'est là, dans ces tunnels, qu'il fait son nid et se reproduit....
Oui, ça je sais ..Mais encore...
Ziemia, c'est la terre...Initialement, l'oiseau avait nom ziemiorodek, celui qui naît sous la terre...L'oiseau souterrain....
Et la lumière fut.
La langue polonaise, comme française, comme toutes les langues du monde, vit. De l'érosion déposée sur elle par des siècles de pratique, d'un emploi fautif un jour glissé entre ses lignes, pour une toute petite voyelle tombée aux oubliettes, elle s'introduit ainsi triomphalement dans les dictionnaires et les manuels, gommant son histoire aux yeux du quotidien inattentif.
Zimorodek. Celui qui naît bien au printemps, mais sous la terre....
Et qui s'évanouit de mes paysages, le grand hiver blanc venu.
Chaleureux remerciements à Aurélien pour ce beau zimorodek
12:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.05.2011
Les pointus
 Là-bas, à l’autre bout du monde, dans la poussière ou la boue des pénitences, on les appelle, par une de ces allégories propres à l'enfermement carcéral, les pointus. Ceux qui sont tombés pour la pointe.
Là-bas, à l’autre bout du monde, dans la poussière ou la boue des pénitences, on les appelle, par une de ces allégories propres à l'enfermement carcéral, les pointus. Ceux qui sont tombés pour la pointe.
Souvent, si toutefois vous parvenez à le saisir, à leur voler plus exactement, leur regard est glauque. Vitreux. Pitoyable. Misérable. Un peu comme ceux des chiens errants, la digne mélancolie des pauvretés en moins. Le long des routes de nulle part.
Ils sont vraiment derrière les murs, les pointus. Juste derrière les murs. Ils les rasent. Ils se perdent dans la contemplation honteuse du bout de leurs godasses. Ils sont méprisés, haïs même, par leurs codétenus. Rejetés par ceux que la société a bannis. Plus bas que la cave. Plus bas que la terre dans laquelle ils semblent vouloir rentrer pour s'y cacher. Alors, ils se rassemblent, les pointus, dans la cour de promenade, comme des oiseaux malades à la plume déchirée. Ils font masse.
Et les insultes pleuvent sur leur lamentable troupeau gémissant. Parfois un crachat.
L’administration aux clefs redoutables les protège, les pointus. Les protège des coups qu’on a envie de leur donner. Comme si on était concerné par la souffrance et la destruction de leurs victimes.
Les pointus. Les erreurs humaines. Les antérieurs au Neandertal. Des chiens fossiles dans un chenil de loups. Aux gamelles rouillées, cabossées. Et qui montrent, quand ils font mine de vouloir sourire en retroussant leurs babines exsangues, des restes de chicots noirs.
Les pointus. Leurs fesses sont maigres et leur membre, leur arme, à la douche commune, d'une pathétique débilité.
11:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.05.2011
L'implacable Saturne
 Nous passons.
Nous passons.
Nous voyageons clandestins. A peine si nous voyons cette parallèle qui nous accompagne et que nous nommons, parfois, sans vraiment y penser, le temps.
Comme sur une règle graduée, des repères s’inscrivent pourtant. C’est en jetant un coup d’œil sur ces repères qu’on voit que tout ça prend dangereusement de la vitesse. Destination l’horizon sans horizon.
C’est tout droit, la route est bonne, toute tracée, pas de souci, vous ne pouvez pas manquer l’objectif, vous êtes programmé pour ça. Il vous attend.
J’ai changé mes lunettes…Tout. Qui veut voyager loin ménage ses montures. Tiens, déjà quatre ans ! Oui, la vue avait encore faibli un peu. Je le sentais bien, mes livres de plus en plus près du nez et la lecture commandant de plus en plus de lumière derrière mon dos. C’est un signe. Un repère sur la règle. Encore quelques fois quatre ans et il n’y aura plus rien à voir.
Est-ce qu’on enterre les gens avec leurs lunettes ?
Et puis, bientôt six ans déjà que je vis hors de France. Six ans qui se sont évaporés, que j’ai vécus pleinement, à fond, et il me semble que c’était hier seulement que j’embarquais mes trois jeans, ma guitare et quelques bouquins pour décider de laisser derrière moi tout un pan de mon histoire.
J’ai perdu mes amis. Pas assez solide comme lien, sans doute. Le mien comme le leur. Les nœuds pas assez serrés pour supporter le fracas des changements de cap à quatre-vingt dix degrés. Crac ! Dommage, tout ça.
Six ans sous cette latitude de l’intempérance. Il y a quelques semaines seulement, je me battais bec et ongles avec des moins vingt- cinq degrés pour que l’eau ne gèle pas dans mes tuyaux et là, je suffoque sous un ciel trop bleu, trop blanc, trop lourd, trop grand avec cette boule de feu plombée sur son visage et qui n’arrête pas de faire ruisseler les peaux.
La canicule, force des étymologies, c’est vraiment un temps de chien !
Le corps morfondu, l’esprit au ralenti.
Mais ce sera un jour l’automne. Les changements de perspective de l’équinoxe. La lumière entraînée de l’autre côté par un poids gigantesque. Lumière oblique, délicieux frissons des brouillards qui trembleront sur les champs.
Une meule qui tourne et qui nous broie, tout ça...Le nombre de fois de trop où nous avons dit vivement bientôt ! Nous croyons attendre des rendez-vous et c'est eux qui nous attendent, goguenards !
Que coule notre beau voyage à bord de ce vaisseau spatial qui se balade parmi toute une flotte désordonnée d’autres vaisseaux !
Qui tourne en rond, comme une espèce de derviche schizo. Des siècles et des siècles après Copernic, je suis toujours émerveillé de voir l’astre rouge disparaître au soir derrière le toit de Paul et resurgir derrière celui de Pierre, à l’opposé, dès trois heures du matin.
Seules les grandes naïvetés nous ramènent sans ambages à notre condition de poètes malgré nous. Soyons naifs, candides, ras les pâquerettes. Le nombre de mensonges vaniteux qui se cachent au fond des grandes questions qui n'en sont pas !
J’aimerais que ça soit comme ça, la fin : qu’on soit surpris à voyager clandestin, sans billet, et qu’on soit balancé par-dessus bord. Dans le cosmos. Avec des poussières d'étoiles comme des lampes de chevet.
Pour faire la pige à Saturne et répéter à l’infini la scène du derviche. Une vraie scène, cette fois -ci.
Car nous avons passé nos vies, notre temps, notre énergie, notre savoir et notre envie, à rejouer des scènes. Saltimbanques sans théâtre et sans public.
Image : Philip Seelen
15:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.05.2011
Connais-toi toi-même
 À l’âge où tous les invisibles remparts de l’enfance et toutes les sensations premières s’écroulent, quand la coquille se lézarde et qu’on se désolidarise du monde pour s’essayer à être un individu à part entière, face à ce monde, quand le corps veut séduire et vivre sa vie, que le désir bout à l’intérieur et que l’esprit a peine à suivre tout ce qui se passe réellement entre l’extérieur et nous, quand l’horizon s’élargit devant, tellement qu’il devient effrayant et qu’on se perd à vouloir s’y repérer, quand il faut commencer à faire parler véritablement ce redoutable je, j’ai souffert toutes les plaies du cœur à dire d’où je venais, d’où je sortais et qui j’étais.
À l’âge où tous les invisibles remparts de l’enfance et toutes les sensations premières s’écroulent, quand la coquille se lézarde et qu’on se désolidarise du monde pour s’essayer à être un individu à part entière, face à ce monde, quand le corps veut séduire et vivre sa vie, que le désir bout à l’intérieur et que l’esprit a peine à suivre tout ce qui se passe réellement entre l’extérieur et nous, quand l’horizon s’élargit devant, tellement qu’il devient effrayant et qu’on se perd à vouloir s’y repérer, quand il faut commencer à faire parler véritablement ce redoutable je, j’ai souffert toutes les plaies du cœur à dire d’où je venais, d’où je sortais et qui j’étais.
A dire mon monde de simplicité et de pauvreté rurales.
J’avais honte de ma tribu, honte de ma racine, honte de ma condition, honte de mes vacances d’été passées au cul des vaches, honte de n’avoir pas de télévision, honte d’avoir une mère et pas de papa, honte de mon village, honte d’être pauvre, honte d’être boursier au collège, honte d’être d’une famille nombreuse, honte de mes vêtements recousus.
Ma seule fierté était d’être premier en latin. Ça fait peu, très peu, pour séduire l’adolescence qui cogne à l’intérieur.
J’ai ainsi vécu cette adolescence sous une fausse identité, rejetant tout de moi, inventant des souvenirs, falsifiant mon parcours, apocryphe de mon histoire.
La révolte et l’intelligence fulgurante des journées de mai sont venues me sauver des abîmes de la schizophrénie.
Comme tant d’autres. Car lorsque j’ai levé mon drapeau et réclamé de vivre mon âme d’apache comme je la sentais à l’intérieur, j’ai bien vu alors qu’à peu près tout le monde en était là et que la poésie mutine de ce printemps ne disait pas autre chose que ce que j’avais à dire pour rester moi-même.
Si j’avais à définir, pour moi seul, ce mois de mai-là, je dirais qu’il fut une révolution en ce qu’il transforma la honte de vivre en fierté d’exister.
Soixante-huitard, moi ? Tout le contraire précisément : on n’éprouve aucune nostalgie - du grec νόστος, le retour, et de άλγος, la tristesse - des moments où l’on s’est réellement rencontré.
Car c’est bien à dix-sept ans qu’on est le plus sérieux. Passé ce cap de la première blessure et des premières contradictions vécues entre nous et le monde, on s’évertue à devenir peu à peu ce qu’on ne sera jamais. Parfois même, on fait des efforts titanesques, douloureux, pour être exactement ce qu’on n’aurait jamais voulu devenir.
Je n’ai dès lors jamais trahi mes premières illusions. Et j’ai fait ça sans stratégie ni courage particulier. Je l’ai fait parce que je ne savais pas faire autrement ; le désordre fut d’emblée mon élément, comme la rivière est celui du poisson.
Ma mère voyait loin, quoique de façon fort approximative, qui me qualifiait parfois de gibier de potence.
Je n’ai jamais vu de potence. Mais ma route a croisé celle de centaines et de centaines de gibiers traqués. Des fuyards du grand bordel social, des hors-la-loi, des méchants. Des condamnés à la nuit.
Et ce sont ceux-là, parfois illettrés, qui m’ont surtout appris à écrire ce que je sais écrire.
11:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.05.2011
Nouvelle
Cette nouvelle n'a pas été écrite pour le recueil Le Théâtre des choses, à paraître fin juin chez Antidata.
Elle a été écrite comme ça. Un clin d'œil au Front russe de Jean-Claude Lalumière, peut-être. En tout cas, toute ressemblance avec des personnnages existant ou ayant existé ne serait évidemment que pure et malencontreuse coïncidence, parce que c'est comme ça qu'on dit toujours.
UNE METAPHORE
 On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?
On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?
On le dit de l’écrivain mais on devrait le dire aussi du hâbleur, quoique pour de tout autres raisons. Le danger le guette en effet de se faire repérer dans des utilisations différentes de ses mêmes forfanteries. Tel est le conseil que je donnai en tout cas un jour à un de mes nombreux chefs de service, qui n’était pas écrivain pour deux sous, du temps où je m’étais fourvoyé dans une administration décentralisée, aux multiples compétences.
Mais comment m’étais-je donc retrouvé petit soldat dans cette armée de généraux ? Commençons par là si vous le voulez bien; juste pour dire que, y étant entré par erreur, je ne pouvais en sortir que par une porte dérobée et en m’essuyant le front comme quand on l’a échappée belle après avoir encouru un sérieux danger.
J’avais préalablement été un peu tout et rien, étudiant, chômeur, promeneur, ouvrier, délinquant plus ou moins actif et, en dernier lieu, bûcheron. Ce fut donc absolument éreinté, les mains abîmées par les intempéries et le contact rugueux du bois, las aussi de fuir les petits papiers blancs, puis roses, puis bleus, d’huissiers sempiternellement lancés à mes trousses pour me soutirer des arriérés de cotisations, des retards de TVA, des échéances d’impôts et autres persécutions légales, que je décidai un beau jour de déposer mes armes sur un bureau de la Chambre de commerce en y signant, dépité, la cessation de mon activité de bûcheron-négociant en bois, entamée quelque dix ans plus tôt.
Fin d’une complicité que j’avais imaginée possible entre une espèce de rousseauisme nigaud, la nature, les p’tits oiseaux, l’air pur et les matins clairets, et un gagne-pain. La faim, c’est bien vrai, fait sortir le loup du bois et je quittai donc l’ombre des allées forestières, des chemins creux et des parcelles boisées en laissant accrochées dans les branches, tels les oripeaux de la défaite, mes dernières illusions d’un travail librement choisi, non salarié et en dehors du convenu social.
Libre, les bras ballants, le nez en l’air, je réfléchis ainsi quelque temps sur la direction à prendre. Réfléchir, c’est bien beau, mais réfléchir à quoi au juste ? Je ne savais pratiquement rien faire, je n’avais jamais appris le moindre métier et il était désormais bien tard pour m’aventurer dans une vie de larron capable de m’assurer la survie : j’étais donc mûr pour tenter de me mettre au vert dans une administration quelconque. Ce que je fis, au grand amusement de mes amis les plus chers. Je passai outre leur gouaillerie, j’étais fourbu, je vous l’ai dit, et j’avais grand besoin de me reposer sur des lauriers putatifs pendant que bouillerait quand même sur mon maigre feu un semblant de marmite.
Je fis donc une dictée, un extrait de Madame Bovary. On me demanda ensuite d’expliquer l’expression faire le philosophe à propos de Bovary-père préconisant pour l’éducation de son fils qu’on le laissât courir nu dans la nature, puis je calculai deux ou trois pourcentages d’une somme empruntée par un quidam, je dégageai le capital, et le coût total du crédit, - ça j’avais appris à le faire à mes dépens -, je répondis enfin avec bonheur à quelques questions de droit - ça aussi, j’avais appris sur le tas car il n’y a pas plus fin juriste qu’un gars qui a longtemps cherché à vivre en contournant les lois -, et hop, je vis comme par miracle s’ouvrir devant moi les portes confortablement capitonnées d’un emploi de fonctionnaire.
Moi qui venais de traîner mes bottes par des chemins fangeux et qui avais besogné dur à soulever des bûches, scier des troncs et entasser des branches, je me retrouvai soudain au paradis quand on m’installa, au quatrième étage d’un immeuble massif, dans un bureau propret et bien chauffé, en compagnie de deux autres bonhommes. Seule ombre au tableau cependant : les fenêtres donnaient en surplomb sur les toits et le chemin de ronde de la prison de la ville. Je ne vis pas cela d’un très bon œil et me surpris à penser que ça n’était pas forcément de bon augure pour la suite des événements. Décidément, ma vie n’arrêtait pas de tourner autour de ces satanés lieux de pénitence, même dans ses résolutions les plus sages et les plus honnêtes.
Je passe sur mes débuts assez cocasses dans un service où il n’y avait pas grand-chose à faire, sinon se montrer poli avec tout le monde, ne jamais avoir l’air de bayer aux corneilles et toujours faire semblant de griffonner de la quelconque paperasse ou d’être absorbé par un écran d’ordinateur.
Je ne puis cependant faire l’économie d’un mot sur ce petit monde découvert derrière les portes de bureau, petit monde souterrain, replié sur lui-même, hors des réalités extérieures, prétentieux, affable avec la hiérarchie, méprisant avec la piétaille du dessous, car on a croit toujours avoir quelqu’un en-dessous de soi en ces lieux où le grade tient lieu de lettres de noblesse, ne serait-ce que la femme de ménage ou, à l’époque, un Contrat Emploi Solidarité. Petit monde aussi ignorant de tout, de la littérature, des arts, de l’engagement personnel, mais expert en tout ce qui ne sert à rien, comme par exemple savoir présenter un budget clair avec des recettes, des dépenses et des tendances, en trois couleurs et sous Power point animé, bien sûr.
En gros, on eût dit un monde inventé par Molière. En dehors des femmes savantes, toute l’œuvre du maître à peu près était en effet représentée ici, des malades et des cocus imaginaires, des précieuses ridicules, des misanthropes, des tartufes, des bourgeois gentilshommes, des étourdis et des fâcheux. Un vrai panel de farces plus ou moins burlesques. J’en eus souvent le souffle coupé.
Ce que j’ai vraiment mal vécu en ces territoires étranges - exception faite pour une vingtaine d’individus sympathiques enlisés là sur un faux-pas de jeunesse- c’est la malveillance. Malveillance à l’égard du joyeux, du différent, de l’original, du décontracté. Malveillance aussi envers le chômeur, l’alcoolique, le décadent, le Rmiste, le SDF, alors que la plupart de ces gens-là, incapables de voler de leurs propres ailes ailleurs qu’à l’intérieur de leurs murs, y avaient, pour les trois-quarts, trouvé refuge par le biais d’un misérable piston d’une vague connaissance, d’un cousin du cousin au beau-frère d’un quelconque hobereau de village. Sans quoi, ils auraient été assurément de ces traîne-savates qu’ils méprisaient avec tant de zèle. En fait, c’est une image refoulée d’eux-mêmes, une sorte de destin auquel ils avaient échappé de justesse, qu’ils vilipendaient chez l’exclu.
Un dernier mot avant de cesser ces vaines diatribes et d’en venir à mon hâbleur sans carnet, pour dire aussi que, aspirés par les rouages puissants, bien huilés, lents et silencieux de la machine administrative, tous ces inoffensifs gredins étaient devenus d’incorrigibles fainéants et, comme tous les fainéants qui n’assument pas leur fainéantise, ils voyaient du laxisme et de la paresse chez tout ce qui n’était pas eux.
Sur la foi d’une plume qu’on jugea en hauts lieux originale et alerte dans les quelques rédactions administratives que j’avais été amené à commettre, je fus cependant nommé rédacteur en chef du journal interne, une publication destinée à promouvoir la grandeur des compétences, des actions et des projets de l’établissement. Un outil de management et de culture d’entreprise pour développer le sentiment d'appartenance, ne cessait de me claironner dans les oreilles mon chef en se balançant sur sa branche, une branche intermédiaire de l’organigramme mais si élevée pour sa cervelle de moineau, qu’on eût dit qu’il était pris de vertiges permanents.
Moi qui n’avais eu à manager jusqu’alors que ma famélique entreprise forestière et gérer mes déficits récurrents avec le banquier, j’aurais bien voulu qu’on m’expliquât en quoi mes élucubrations sur ce satané journal pouvaient servir les autorités et, surtout, donner à tout ce petit peuple piaulant et caquetant, le sentiment d’appartenir à une respectable et gigantesque volière.
On organisa donc force réunions autour de la notion de communication interne. Des flèches multicolores se mirent à voler dans tous les sens sur un tableau, du haut vers le bas, décisions des dieux de l’Olympe, puis du bas vers le haut, remontée des infos vers l’Olympe, puis transversalement, dans les deux sens, ces flèches-là devant faire tomber les cloisons, résoudre les conflits d’intérêts, libérer les rétentions d’informations et mettre de sérieux bémols aux mesquineries dues, un peu partout sur l’organigramme, à l’exercice du petit pouvoir.
Voilà, me dit-on, la communication interne, c’est abolir les différences, créer la transparence et prévenir ainsi les risques de conflits. C’est aussi faire en sorte que chacun des mille cinq-cents agents de notre Collectivité - avec un C majuscule obligatoire - comprenne à quelle grande œuvre il participe et en soit d’autant plus fier et motivé.
Ite missa est.
Mais encore, hasardai-je ? Car si une mission d’une telle noblesse et d’une telle grandeur m’était pour partie dévolue - faire comprendre à tout le monde pourquoi il travaillait et à quoi - la condition sine qua non pour la mener à bien, était que je comprenne moi-même ce que je faisais.
On ricana, goguenard et bonhomme. Rire supérieur de la hiérarchie qui sait et qui du même coup se trouve légitimée par l‘impéritie intellectuelle de son subordonné. Pour un peu on m’aurait tapé sur l’épaule et remercié de faire montre de tant d’ingénuité.
D’abord, bannir le mot travail de mon langage. Ici, on ne travaillait pas, on œuvrait. Bien. Enfin quelque chose qui me plaisait, on prenait soin des mots, quoique je n’aie jamais vu personne dans tous ces bureaux et ces couloirs où dégoulinait une lumière jaunâtre, qui eût un tant soit peu l’air d’un artiste penché sur son œuvre. Mais passons. On œuvrait à un projet commun, grandiose, énorme, celui du confort des contribuables, qu’il était d’ailleurs préférable d’appeler des clients, par qui nous étions payés et, in fine, donc, pour la réélection des élus qui présidaient aux destinées de notre collectivité.
Voilà qui ne me plaisait pas du tout. Je me vis aussitôt dans la peau d’un vil collaborateur mais je repris aussitôt mes esprits et retrouvai tout mon amour-propre en recadrant tout ça comme ça devait l’être, rubrique blabla.
Mais pour faire comprendre sa fiche de poste à un abruti tel que moi, rien de tel qu’une bonne métaphore, n’est-ce pas ?
Ecoutez donc un peu, me dit-on, tout sourire et en se balançant de suffisance sur un large fauteuil. Hier soir, je lisais justement un article dans Le Mensuel du territorial à propos de la communication. On prenait l’exemple d’un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creusait un trou avec une pioche et à qui on n’avait pas dit pourquoi ce trou. Un promeneur venant à passer par là lui demandait ce qu’il faisait. Ah, qu’il geignait le bougre, je besogne, je besogne. J’en bave, j’en ai marre, c’est dur, c’est éreintant. Chienne de vie !
Puis on prenait un autre gars du même tonneau et qui creusait aussi un trou, mais à qui l’on avait préalablement expliqué que c’étaient les premières fondations d’une cathédrale, d’une magnifique cathédrale, qu’il creusait là. A la question du promeneur, le type se relevait, essuyait son front en sueur, se tâtait les reins et s’exclamait, un sourire radieux illuminant tout son visage : mais comment ? Vous ne savez donc pas ? J’œuvre aux fondations d'une prochaine et gigantesque cathédrale, monsieur !
Voilà, avez-vous compris maintenant ?
Oui, j’avais compris.
Seulement, quoique m’évertuant au cours des quelques années qui suivirent à écrire aux endormis qui constituaient mon public qu’ils étaient en train d’élever un monument considérable à la gloire de je ne sais quoi, qu’ils participaient à une œuvre collectif dont tout le peuple contribuable était fier, je ne vis jamais s’allumer dans leur regard l’éclair joyeux du créateur. En fait de trous, ils creusaient chacun le leur, juste aux dimensions de leur fessier, pour s’y caler confortablement et voir ainsi passer l’inutilité des choses.
J’abandonnai très vite l’inexprimable challenge, moi-même me sentant de plus en plus solitaire et schizophrène dans cet univers à l’envers de la vie. Je pris le parti de la désinvolture. Je finis même par passer plus de temps au bistro du coin que dans mon bureau. C’était ma manière à moi de ne pas rompre tout à fait avec la rue, les vivants, les désespérés, les enjoués, les rêveurs à l’élocution pâteuse et tous les désœuvrés qui, sachant bien qu’ils l’étaient, n’avaient cure de le dissimuler.
Quelques semaines seulement avant que je ne rende mon tablier, survint cependant l’anecdote bis du prolétaire bâtisseur de cathédrale. Je ne saurais dire le sujet de cette énième réunion dont étaient parsemés les jours, les semaines et les mois, toutes plus laborieuses les unes que les autres. Ce dont je me souviens très bien, c’est qu’un type demanda au chef de service si…ah, j’y suis, c’était à propos des horaires à la carte qu’on venait d’installer et le gars, sans doute inquiet que de plus futés que lui trouvent sans lui une combine pour détourner les pointages, demandait si on avait mis en place des moyens de contrôle sérieux, service par service. Un truc magnanime dans ce goût-là. En tout cas un truc qui n’avait absolument rien à voir avec le confort du contribuable et l’érection d’un grand monument.
Le chef sourit benoîtement et fit d’abord une assez longue introduction morale, du style, nous sommes des adultes, nous sommes des gens responsables, nous ne sommes plus des lycéens, avant de s’interrompre brusquement, de faire semblant de se souvenir de quelque chose de précis et d’annoncer, que, tenez, hier soir justement, il lisait un article sur les horaires variables dans Le Mensuel du territorial et qu’on y disait que des gens motivés dans leur travail ne cherchaient jamais à truander des horaires, parce que, par exemple, prenez un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creuse un trou et qui…Et ainsi de suite jusqu’au creuseur enjoué.
Cette fois-ci, ma soupape de sécurité trop longtemps mise à contribution n’y tint pas, se grippa soudain et lâcha la bonde. J’éclatai de rire, semant le trouble et la confusion dans la petite assemblée. On s’offusqua, on remua énergiquement la tête en signe d’une vive désapprobation et on murmura que j’avais sans doute encore bu et que c’était honteux à la fin ! Excédé par leurs clabauderies et leurs jérémiades, c’est donc à cet endroit que je conseillai gentiment au maître de la séance de noter sur un petit carnet ses brillantes métaphores, car ça lui éviterait de raconter les mêmes balourdises à trois ans d’écart et sur des sujets complètement différents.
Ou alors, rajoutai-je, c‘est qu’il lisait depuis des années et tous les soirs le même numéro du Mensuel du territorial. Ce qui était quand même fort inquiétant.
Aucune suite disciplinaire n’eut le temps d’être donnée à mon insolence. Je pris la clef des champs quelques semaines plus tard, abandonnant tous ces gens à leur cercueil matelassé de certitudes. Mais j’étais au bord de l’asphyxie, il me fallait de l’air, tant d’air que je courus, courus à en perdre haleine jusqu’à l’autre bout de l’Europe, d’où aujourd’hui je me souviens, sans colère ni rancune. Avec un certain amusement, même.
Car le monde est fait de mondes juxtaposés, parfaitement étanches, sans passerelle de l’un à l’autre. C’est ainsi. J’avais simplement franchi un mur pour pénétrer un territoire qui n’était pas le mien.
L’intrus c’était moi et le pénible quiproquo était de mon seul fait.
Mais j’ai toujours depuis lors un crayon dans la poche de mon veston.
Du papier rarement.
11:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.05.2011
Nouvelle
Seconde nouvelle ayant échoué à son examen de passage dans le recueil Le Théâtre des choses, à paraître en juin à l'enseigne d'Antidata.
Je ne la relis ni ne la remanie, laissant aux lecteurs de l'Exil des mots un texte brut de décoffrage, toujours dans le même esprit qu'ici.
L’ENTERREMENT
 Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.
Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.
De lointains bâtisseurs avaient dû considérer qu’une église digne de ce nom, ça ne devait pas être mêlé au quotidien des ouailles, que ça ne devait pas être mitoyen d’une épicerie, d’un café, d’une mairie, d’un marchand de chaussures, que le parvis ombragé et recouvert d’une fine couche de sable blanc n’était pas destiné à devenir le terrain de prédilection des joueurs de pétanque, mais que ça devait se tenir à l’écart de la vulgarité des préoccupations d’ici-bas, se montrer digne, respectable, hiératique même.
Aussi, pour accéder à cette église, fallait-il sortir du bourg par la rue principale et gravir bientôt un faible mamelon en empruntant une petite route fraîchement goudronnée, souvent maculée de bouses verdâtres, toute droite et qui, sitôt passé le point culminant de ce maigre relief, juste devant l’église, redescendait en de nonchalants méandres jusqu’à la forêt de Benon, chère à Rabelais.
Le saint édifice, élevé en grosses pierres taillées, jaunâtres, qu’enlaçaient par endroits le lierre et la viorne, surplombait ainsi le village et semblait de loin veiller à la bonne moralité des citoyens.
Peut-être même étaient-ils allés jusqu’à penser, les bâtisseurs avisés d’antan, que si on voulait se tourner un tant soit peu vers l’église – ne serait-ce que pour y lire l’orientation des vents qu’indiquait un coq au jabot avantageusement bombé– on serait obligé de se tordre le cou pour regarder très haut vers le royaume des cieux, dans la bonne direction, donc.
Créer une manière de réflexe, en quelque sorte.
Et tant qu’à isoler les abstractions spirituelles du tangible commun, on avait aussi construit là-haut le presbytère, qu’on avait accolé au côté sud du monument. Pour que le tout soit enfin à l’unisson, on avait également choisi d’établir sur ce tertre herbeux l’enclos des repos éternels.
Ce bel et digne ensemble était résolument tourné vers l’ouest et le proche océan. Il était ainsi battu par le grand vent des équinoxes, fouaillé par les brumes de novembre, mais aussi offert aux rayons incandescents des solstices de l’été, sans une once d’ombre pour le venir rafraîchir. Il régnait de fait sur ce modeste monticule une atmosphère de grave et lourde solitude. Trop grave peut-être. Si grave que les gens depuis longtemps ne prenaient plus guère la peine de le gravir pour les offices ordinaires du dimanche. Ils y consentaient encore, quoiqu’en automobile seulement, pour les grandes représentations de la liturgie, Noël, les Rameaux et les Pâques.
Cette lente érosion de la foi avait donc contraint la hiérarchie ecclésiastique à une bien prosaïque compression de personnel. Un seul curé présidait désormais au salut des âmes dispersées aux quatre coins des deux ou trois paroisses alentour et il avait été logé ailleurs, au centre de tout ça sans doute, sur Courçon d’Aunis peut-être, dans un souci évident — et bien de ce monde — de réduction des frais de déplacement, de sorte que le presbytère était inhabité depuis déjà une bonne décennie.
Ses volets de bois de chêne, épais, noirs d’intempéries, frappaient avec furie contre les murs et se disloquaient sous les coups de boutoir des vents, le jardinet était la proie des ronces et de la vermine, son allée avait été engloutie par les halliers, la clôture en était toute de guingois, effondrée par endroits, ce qui ajoutait encore à la mélancolie désolante, un peu mystérieuse, des lieux.
Il n’y avait plus guère que pour les enterrements qu’on daignait encore grimper à pied jusqu’au sommet de l’insignifiant relief, qu’on y accompagne un défunt qui passerait par l’autel ou un qui serait directement conduit en sa dernière demeure sans les lénifiantes fioritures de l’espérance. Une petite assemblée se regroupait alors en bas et y attendait la voiture funéraire, l’hiver en tapant du pied, en se frottant les mains et en soufflant dessus, l’été en cherchant l’ombre des noyers plantés au bord de la route ou celle des grands murs de la dernière ferme du bourg.
Un bref coup d’œil jeté sur ces hommes et ces femmes aurait pu d’ailleurs déterminer avec assez de justesse si le mort qu’on se proposait de suivre là-haut était bien à sa place de mort, dans le cours normal des choses, où s’il s’agissait d’une anomalie, d’une injustice et d’un drame.
Sans pour autant aller jusqu’à la désinvolture, si le groupe semblait décontracté et désordonné, si on y bavardait à son aise, si un ou une s’en détachait un peu pour appeler ou répondre sur son portable, si les hommes avaient les mains dans leurs poches et fumaient des cigarettes, si les femmes portaient des foulards qui n’étaient pas forcément d’une sombre couleur, alors on était, à n’en pas douter, à un rendez-vous prévisible, inéluctable et sans surprise. On enterrait aujourd’hui un ou une qui avait fait son temps.
Presque une formalité.
Si, au contraire, le groupe était absolument muet et compact, si les yeux étaient rougis, si on avait pris ses habits les plus noirs et si on baissait légèrement la tête, les mains croisées derrière le dos, immobiles, alors c’est que la Faucheuse avait frappé dans le désordre, à l’aveuglette, et que celui ou celle qu’on attendait là n’aurait jamais dû y venir de sitôt.
La mort reprenant alors tout son sens, qui est celui d’être un grand malheur, la tristesse et l’effroi imprégnaient les visages et enveloppaient les cœurs d’une austère compassion.
Dans les deux cas cependant, après avoir vu et entendu les lourdes mottes de glaise heurter le bois du cercueil, on redescendait toujours la colline par petits groupes de trois ou quatre, avec la mine fort triste et en hochant la tête de consternation impuissante. On commentait, toujours avec les mêmes mots, la fatalité et que tout ça, hélas, serait le lot de chacun, que c’était inévitable, notre tour viendrait, qu’il valait mieux ne pas trop y penser, mais que quand même c’était bien affligeant de s’en aller comme ça sous les ténèbres de la terre, et sans que personne ne sache vraiment où, et que ce « plus jamais » était absolument terrifiant.
On en avait des frissons. On hâtait alors le pas car on n’avait subitement plus qu’une idée en tête : s’engouffrer le plus vite possible au bistro pour y sentir à nouveau palpiter le chaud brouhaha de la vie.
Survint cependant une exception de taille dont tout le monde éprouva bien de la honte après coup et qui fit grand bruit à des kilomètres à la ronde, colportée peut-être par le prêtre au cours de ses différentes pérégrinations de clochers en clochers ou bien par les quelques derniers fidèles de la paroisse, outrés, à juste titre il faut le dire, par l’énormité du scandale.
On était le 28 décembre de l’année 1999.
La nuit précédente, la région avait été littéralement ravagée par un ouragan d’une épouvantable violence, on s’en souvient sans doute. Des toitures s’étaient envolées comme fétus de paille, des cheminées avaient été renversées, des granges s’étaient écroulées, les lignes électriques avaient été arrachées et jetées à terre en un inextricable désordre, celles du téléphone également, et on avait entendu, recroquevillé qu’on était dans les ténèbres en furie, les hauts peupliers des marais qui se fracassaient avec des craquements épouvantables, tels des coups de fusil tirés par-dessus les mugissements de la tempête.
Au petit matin on avait, les bras ballants, la gorge serrée, contemplé le désastre des paysages massacrés, les haies couchées, les fruitiers déracinés, les clôtures éparpillées, les peupleraies rasées, les chênes qui s’étaient répandus en travers des chemins et des routes, disloqués, lamentables, leurs vénérables troncs lacérés de longues et profondes échardes, comme sous la morsure enragée d’un monstre surgi des enfers.
On avait regardé, atterré, les horizons béant aux quatre coins du monde, écartelés, soufflés, pulvérisés par la terrible tourmente. On avait baissé la tête, on avait levé les poings, des yeux s’étaient humectés et on avait même (on n'avait : coquille corrigée par une lectrice), pour les plus désespérés, craché au ciel et insulté la terre.
Puis, le cœur lacéré, on avait retroussé ses manches et on s’était mis à l’ouvrage. Celui-ci tronçonnait, celui-là maçonnait, cet autre déblayait, un autre encore remettait tant bien que mal les tuiles du toit. On s’entraidait, on se prêtait des outils, on allait de chez l’un à chez l’autre, on se hélait, on se demandait conseil et tout ça en tempêtant, en jurant vilainement et en maudissant, bien sûr, le réchauffement climatique, les engins satellitaires, les Américains, l’aménagement imbécile du territoire avec ses autoroutes, ses rocades, ses ponts et, aussi, quoiqu’à voix plus basse, les irrigants de la plaine à maïs qui vidangeaient la terre de son sang, mais parmi lesquels on comptait quelques voisins.
Les femmes vidaient les congélateurs et cuisinaient des quantités effroyables de viandes, de poissons, d’escargots, de légumes, de fruits, car, c’était certain, ce ne serait pas demain la veille qu’on rétablirait l’électricité au vu des poteaux brisés sur les talus, des lignes enchevêtrées sous les ramures effondrées des arbres, et toute cette nourriture, qu’on avait soigneusement entassée pour l’hiver, allait se gâter et n’être bientôt plus bonne que pour la pâtée des chiens !
Vers le milieu de l’après-midi cependant, alors que le soleil vacillait déjà, très bas suspendu à l’horizon d’un ciel malade, bleu livide comme s’il ne s’était pas encore remis de ses épouvantes de la nuit, on se souvint soudain que la vieille Irène Bertholeau, née Soubise, 91 ans, avait paisiblement tiré sa révérence le 26 au soir, dans son lit, et que c’était aujourd’hui qu’on la portait en terre.
Elle avait été une brave et bonne voisine, elle était une ancêtre respectable et respectée, on l’avait toujours connue là, elle était déjà une vieille femme quand on était soi-même encore en culottes courtes et c’était un nouveau pan de la mémoire communale qui s’en allait aujourd’hui vers les ténèbres. Personne ne pouvait décemment, en dépit des circonstances dramatiques qui venaient de lui tomber sur la tête et en dépit de ses urgences, ne pas l’accompagner jusqu’à la tombe.
Les femmes enlevèrent donc leur tablier et abandonnèrent leurs ragoûts, leurs confitures et leurs rôtis, les hommes remisèrent leurs outils, firent taire les tronçonneuses et jetèrent sur les toits endommagés de larges bâches de protection, pour arriver bientôt par petits groupes silencieux, le visage fermé, au pied de la colline.
Pas un mot n’était échangé, les yeux étaient baissés, les poignées de main molles et distraites. Tout le monde avait manifestement la tête ailleurs, qui à sa grange effondrée, qui à son toit éventré, qui à ses arbres fracassés, qui à ses clôtures chambardées.
Le temps pressait. La nuit tomberait très vite et on allait devoir s’éclairer ce soir à la bougie, comme dans les temps reculés. Certains n’auraient même pas de chauffage ! Pour les producteurs de lait, il faudrait apprendre ou réapprendre les gestes antiques de la traite à la main, comme les générations d’un temps innommable ! Tous ces gens de la côte atlantique, en ces jours mémorables, se retrouvaient donc démunis et anxieux, presque handicapés, soudain privés du confort primaire auquel nous nous sommes tous évidemment accoutumés, quoique nous n’y prêtions plus la moindre attention dans le cours de nos vies quotidiennes.
Alors les regards torves guettaient l'arrivée du corbillard, les hommes tapaient du pied et hochaient la tête, nerveux et de fort méchante humeur, les femmes affichaient un visage hermétique, soucieux, et, de temps à autre, s’inquiétaient dans un murmure auprès de leur voisine la plus proche de l’heure qu’il était.
Bref, le trouble était trop profond pour qu’on gardât les extérieurs de la convenance la plus élémentaire. On s’impatientait sans vergogne.
Et ce fut quasiment au pas de course que le maigre cortège se mit bientôt à arpenter la hauteur derrière le cercueil enrubanné, car les employés communaux, eux aussi sans doute pressés de s’en retourner aux réparations domestiques avant la nuit noire, conduisaient la voiture à une allure peu convenable.
Tout ce beau monde s’engouffra donc dans l’église presque en courant, en se brûlant même la politesse, et s’installa en vitesse dans les stalles humides et froides, sitôt que le cercueil eut été déposé devant l’autel.
La distraite assemblée grelottait et de temps en temps levait ses yeux pleins d’angoisse vers une large déchirure du toit — signe que l’ouragan n’avait épargné absolument personne — et par laquelle on apercevait un bout de ciel de plus en plus sombre, tandis que le prêtre, un gros bonhomme tout de blanc vêtu, court sur ses jambes, tant qu’on n’apercevait quasiment que son visage rougeaud et fort sanguin derrière l’autel, psalmodiait et bénissait, un livre énorme, un vieux livre, grand ouvert devant lui. Les hommes et les femmes expédiaient les signes de croix et les prières à haute voix, quelques mécréants intraitables gardaient ostensiblement les bras croisés et, dans cette posture, tambourinaient nerveusement leurs avant-bras du bout de leurs gros doigts. De pieuses et vieilles femmes s’appliquaient néanmoins, d’un timbre haut et clair, à chanter avec le curé.
Et ce fut justement à la chute d’un de ces chants, alors que tout cela paraissait aux gens de plus en plus interminable et de plus en plus lourd, que l’abbé, les bras levés au ciel en direction de l’énorme brèche de la toiture, prononça la phrase par laquelle survint le scandale.
Dieu, prêcha le brave homme — ou Jésus, je ne saurais l’affirmer — est la lumière qui réchauffe les hommes et éclaire leur chemin.
Une voix puissante, railleuse, surgie de la pénombre des derniers rangs et qu’amplifièrent encore les hautes voûtes du sanctuaire, lui fit immédiatement écho et tonna : Hé ben, le f’rait pas mal de v’nir faire un tour à La Ceriseraie dans la soirée, vot’ citoyen, parce que de la chandelle et du feu, y’en ons pu chez nous autres!
Les nerfs des campagnards, mis à rude épreuve depuis vingt-quatre heures, se détendirent alors tels des ressorts trop longtemps retenus prisonniers et libérèrent tout à coup le tumulte incongru de leur énergie.
Tout le monde s’étant retourné vers le plaisantin, l’église ne fut plus soudain qu’un immense éclat de rire. On s’interpellait, on se tapait sur les cuisses, on se donnait de grandes bourrades dans les côtes, on était plié en deux, on avait des hoquets et des soubresauts frénétiques, on était rouge comme des pivoines, on répétait en hurlant à l’envi l’insolente répartie et on avait de grosses larmes de fou rire qui coulaient sur les joues.
Précipitamment descendu de son autel, le curé courait comme un perdu d’un bout à l’autre de la nef, se fâchait, admonestait, agitait les larges manches de sa chasuble, faisait tinter une clochette, bénissait le cercueil au passage, criait, fulminait, enrageait, se signait désespérément, levait en tremblant les yeux au ciel et tâchait (tachait : coquille corrigée par une lectrice) en pure perte de ramener à la raison tous ces gens brusquement pris de folie.
Quelqu’un prétendit même plus tard, beaucoup plus tard, des années plus tard, l’avoir entendu crier des noms étranges, comme Sodome et comme Gomorrhe.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.04.2011
A paraitre fin juin
LE THEATRE DES CHOSES
10 nouvelles de France et de Pologne
 Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.
Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.
Et ce sera aussi l'aboutissement d'une belle connivence, entamée il y a plus d'un an, entre l'équipe d'Antidata et moi-même.
Sur les dix nouvelles écrites cet hiver et que j'ai proposées, huit ont été retenues. Le recueil incluera donc deux autres nouvelles déjà éditées, Souricière et La Faucheuse n'aimerait pas les aubades ?, respectivement parues en 2009 et 2010 dans les recueils collectifs, Capharnahome et Douze cordes.
Les lieux - les théâtres donc - des récits se partageront équitablement les pages du recueil, tantôt en Poitou-Charentes, tantôt en Pologne.
Première fois que j'écris en complicité préalable avec un éditeur. Si on y trouve un certain confort, celui du sentiment de ne pas travailler pour rien, on y éprouve aussi une grosse angoisse, celle de décevoir.
En tout cas merci à Olivier Salaün et à ses camarades. Je signale d'ailleurs au passage qu'Olivier est aussi musicien, auteur-compositeur dans le groupe de rock Cvantez et que vous pouvez écouter, si le coeur et l'oreille vous en disent, des échantillons de leur dernier opus, ici.
Belle création musicale.
13:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.04.2011
La mémoire toujours en feu d’où dégoulinent des laves incandescentes
 Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.
Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.
Le 10 avril 2010, Smolensk. Outre le drame humain, cette hécatombe où périrent 96 personnes parmi lesquelles les plus hauts personnages de l’Etat, fut le couteau brutalement enfoncé dans la plaie Katyń, une plaie qu’on tentait pourtant désespérément de refermer.
10 avril 2010, Smolensk, 10 avril 1940, Katyń. La concordance des lieux et des dates fait que l’amalgame est devenu réalité très forte et les vieilles rancœurs envers la Russie ravivées au centuple.
10 avril 2011, commémoration - mais commémoration de quoi exactement ? - et la blessure encore qui se répand dans les têtes. Les Polonais déjà fortement divisés sur le sens à donner au drame de Smolensk n’en sortent maintenant plus sur le sens à donner à sa commémoration. D’autant qu’on recommence à murmurer, de l’autre côté du Dniepr, que Katyń fut bien l’œuvre diabolique des nazis.
Alors certains déposent sur les lieux de la catastrophe de l’an passé des plaques qui rappellent, en même temps, le génocide perpétré par les Russes il y a 71 ans. Les Russes d’aujourd’hui, indignés, font subrepticement enlever la plaque dans la nuit et la remplacent par une autre, à leur goût moins équivoque, évoquant uniquement Smolensk.
Censure de la mémoire ou juste recadrage du souvenir ?
Je n’en sais rien.
Courroux cependant de part et d’autre. Rien ne va plus dans le langage de la mémoire et dans la lecture de l'histoire.
Il faut sans doute être Polonais pour prendre toute la mesure de ces drames-là. Dans un monde préoccupé par des guerres multiples, guerres humanitaires tronquées, guerres de ceci et de cela, jeux politiques infâmes partout, le pansement des plaies polonaises et les rancunes envers les Russes, sorte de feu couvert et qu’un seul coup de vent peut embraser, apparaissent comme des broutilles passéistes.
Ce qui me peine pourtant, ce sont les diverses utilisations idéologiques qui sont faites des événements et surtout que cette nation, ces Polonais parmi lesquels je mène ma vie, et qui auraient tant besoin de se serrer les coudes autour d’une chaude fraternité, soient une nouvelle fois dressés les uns contre les autres et manipulés par des chefs et des prétendants jouant, tantôt la corde d’un sage apaisement, tantôt la corde toujours vibrante de la passion.
Le génocide de toute l’élite polonaise sauvagement assassinée d’une balle dans la nuque et cette catastrophe aérienne survenue autour de la commémoration de ce génocide, n’ont pas fini d’engendrer des anniversaires houleux, vindicatifs, obscurs, névrotiques, où, finalement, personne en Pologne ne reconnaît plus le respect dû à sa mémoire de Polonais.
C'est jouer avec un feu terrible.
Car les grands drames de l'Histoire, un jour ou l'autre, rejaillissent toujours d'une mémoire, soit fallacieuse, soit qu'on avait tenté d'étouffer.
Image : Philip Seelen
07:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.04.2011
A vos cerveaux... Prêts ? Votez !
 Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.
Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.
Pure coïncidence ou comme si elle lisait l'Exil : la science me traite ce matin de rigolo. Et elle a raison, la science : je suis vraiment mort de rire.
Oyez plutôt, là. Si, si, cher lecteur, lis jusqu'au bout, même si ton libre arbitre en prend un sale coup.
Les premières réactions cependant ne vont pas tarder à agiter frénétiquement le gotha.
Sarkozy trouvera que c'est pas assez marqué à droite, cette encéphale !
La Le Pen va se plaindre de ne pas voir le sien et va sans doute crier à l'apartheid.
Borloo qui vient de prendre une grande décision va se demander à quel cortex cingulaire de sa mécanique il a obéi et comment est strié le cerveau d'un centriste.
Et Ségolène, ravie, va enfin s'apercevoir que, même elle, en a un.
Image AFP, comme on peut voir.
13:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.04.2011
Le sentiment politique
Ou pourquoi on perd vraiment le peu de temps qui nous est imparti à se préoccuper de politique, stricto sensu. Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.
Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.
Une même logique, une lame de fond, que je me dis alors, doit présider au manque apparent de cohérence. Celle-ci aurait dû commander en effet depuis longtemps que les espoirs formulés au XIXe siècle par exemple, voire par les enragés de 1793, soient aujourd’hui satisfaits, dépassés, et que l’on regarde dans une autre direction.
Mais les puissants gouvernent toujours le monde, le peuple gueule, le peuple s’ébroue, les arts se rebellent parfois, pas souvent, et ces puissants continuent de mener la barque, à contre-courant de ce qui devrait être la poursuite du bonheur du plus grand nombre, voire de tout le monde.
L’histoire, même si on sait qu'elle est lente et surtout pas rectiligne, devrait en tout cas cheminer dans cette direction, au nom même du principe de civilisation humaine. Tous les missels marxistes le prétendaient. Sans la sinuosité cependant.
Le panorama de plus d’un siècle et demi d’histoire s’évertue donc à apparaître tel un gigantesque déni de l’intelligence humaine. Qu'une question, la plus élémentaire et la plus naïve des questions - celle du bonheur social enfin résolu, du bonheur pragmatique, presque élémentaire, afin que chacun soit disponible pour vivre son bonheur individuel, intime, intellectuel et affectif - soit sempiternellement posée aux hommes sans qu’aucun ne sache y apporter le moindre élément de réponse, en dit effectivement trop long soit sur la susdite intelligence humaine, soit sur le degré de civilisation, pour qu'on fasse l'économie du postulat selon lequel le pauvre est bon, juste et honnête et veut que les richesses produites par le travail et le génie humains soient au service de tous, équitablement distribuées, tandis que le riche est mauvais, injuste et malhonnête et veut s’accaparer la plus grosse part de la galette, se goinfrer, se bourrer le fanal et ne jeter que les miettes au pauvre.
Et là-dessus, sur le terrain politique, s’affrontent les idéaux en empruntant tous les dédales possibles et toutes les ruses les plus grossières !
Ah, si seulement elle n'était que ça, la problématique ! Et si la lutte des classes n’avait pas été ce leurre de la rhétorique hégélienne dans lequel se sont engouffrées toutes les idéologies et contre-idéologies sociales de l’époque industrielle et postindustrielle, longtemps que la contradiction dialectique aurait été renversée et qu’on aurait fait de la boule bleue un Eden de fraternité !
Nous sommes donc dans un vaste trompe-l’œil. Celui des idées. Or les positionnements politiques - j’entends maintenant par politique l’envie, le désir plus ou moins flou que l'on a de voir tel ou tel monde apparaître - ne sont pas des épiphénomènes de la conscience, mais du sentiment. On est dans l’affectif intime, dans la conviction fondatrice, dans la base fondamentale, et tous les raisonnements, tous les arguments, toutes les évidences mille fois prouvées, ne peuvent convaincre le sentiment constitutif d’un être. Au risque de le détruire.
On se sent à tribord ou à bâbord, non pas par la raison, par l’idée du juste ou de l’injuste, mais parce que c’est là qu’on est bien dans sa peau. L’opinion politique est un sentiment.
Or le sentiment n’admet pas le jugement de valeur.
Mais d’où naît ce sentiment ?
Je n’en sais foutre rien. Laissons-ça aux mécaniciens du subconscient, aux entomologistes des groupes sociaux, aux géographes de l’urbanisme.
Le fait est.
M’est souvent arrivé de discuter, de me disputer, de gueuler, d’affronter, de mener joutes verbales et même, dans des cas extrêmes, d’en venir aux mains, avec un d'un sentiment contraire au mien. Du point de vue de la raison, tout le monde avait raison. Venait même un moment où les arguments logiques avancés de part et d’autre étaient ridicules jusqu’au grotesque.
C’étaient là deux individus qui se battaient mais c’est une ombre inconnue d’eux-mêmes qui maniait les armes.
Je me sens. Tu te sens. Il se sent. Ma peau, ta peau, sa peau est mieux dans ce sentiment-là que dans celui-ci.
Les mêmes espoirs, fantasmes, oui, on peut dire ça comme ça, de joie universelle et de jouissance non usurpée pour tous m’habitent depuis que j’ai appris à m’habiter moi-même. Je n’ai pas dévié d’un iota dans mon sentiment du monde en dépit de tous les arguments qui me sont tombés sur la gueule et qui auraient normalement dû me ramener à de plus raisonnables rêveries.
Et je ne suis pourtant ni plus juste, ni plus bon, ni plus intègre, ni plus généreux, ni d’une intelligence plus accomplie, ni d’un savoir plus extraordinaire que la plupart des hommes que j'ai rencontrés jusqu'alors et qui m'ont apporté la contradiction.
Je suis. Point.
Né dans une famille pauvre, rurale et adorable à plein de points de vue.
Avec un sentiment général qui ne m’a pas quitté. Comment dire à qui que ce soit que le sentiment qui vous anime est le bon quand on ne sait même pas d'où on le tient ?
D'ailleurs, le bon pour quoi faire ?
La joie d'exister ne s’apprend pas ni ne se réclame aux pouvoirs : elle se vole.
A des millions d’années-lumière de l’idée politique.
Illustration : Les Danaïdes par John William, 1903
12:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.03.2011
Mon artiste prolétaire de frère prend un bide

Chaque jour, l'Aronde prenait la clef des champs. Des routes, oui. Plutôt. Voire des chemins vicinaux non encore goudronnés.
Les voisins, ceux qui n’avaient pas encore de voiture, mais surtout leurs épouses, saluaient avec un respect craintif l’audace de cette femme en pantalon, cigarette au coin des lèvres, cette Georges Sand de l’automobile, cette femme-précurseur qui pavoisait derrière son volant. Les hommes, eux, voyaient plutôt là un signe de débauche et de libertinage : la voiture, c'était une invention pour les hommes, pour les chefs, pour ceux qui ont de la tête ! Ceux qui étaient déjà motorisés, ceux qui savaient tout de la nouvelle époque et comment il fallait se servir d'une automobile, haussaient donc les épaules, narguaient, tordaient le nez et prédisaient que le moteur de cet engin - ils allaient même jusqu'à préciser pour bien faire voir qu'ils savaient de quoi ils causaient : le moteur Montlhéry de cette bagnole - ne ferait pas long feu, à ce régime de sorties quotidiennes.
Mais mon frère, apprenti mécano, veillait au grain. Maintenant que la voiture roulait, elle réclamait qu’il se penchât avec circonspection sur ses organes. Un beau dimanche, il demanda à ma mère combien elle avait fait de kilomètres. Il eût été tout aussi inspiré de lui demander la circonférence de la lune. Elle en resta bouche bée.
Tant d’ingénuité de part et d’autre déclencha chez moi un tel éclat de rire que ma mère se fâcha tout rouge. Elle me traita de foutu chanteur qui ne s’intéressait à rien. Elle montra mon frère en exemple. Lui, au moins, même avec ses questions stupides, s’intéressait à ce qui se passait dans cette maison, et surtout à son automobile ! On pouvait compter sur lui. Que je m’en retourne donc à ma saloperie de guitare et que je les laisse discuter sérieusement.
Evidemment, elle ne savait pas combien de kilomètres elle avait parcourus. Mon frère déclara que ça faisait quand même beaucoup et qu’il était grand temps de changer l’huile du moteur. Il enfila sa camisole d’apprenti prolétaire et se coucha sous l’auto. On l’entendit qui dévissait, qui tapait, qui cognait, qui se plaignait d’un gros boulon rébarbatif. Il devait avoir appris ça dans son atelier ; on ne dévissait pas un boulon sans se plaindre avec force jurons de sa résistance. Il nous montra bientôt l’huile noire qu’il avait récupérée dans un seau. Il en prit quelques gouttes entre le pouce et l’index, les faisant se frotter l’un contre l’autre et, avec une moue de connaisseur un peu catastrophée, nous dit qu’il était grand temps, qu’elle n’avait plus de viscosité, cette huile-là. Vis-co-si-té, hein, répéta t-il en bombant le torse, on connaissait pas le mot nous-autres ? Un mot de mécano, pardi. Comment l’aurions-nous su ?
Il changea l’huile avec les gestes circonspects du savant devant ses éprouvettes.
Nous étions tous autour, admiratifs quoique inquiets. Il cabotinait à son aise. Je ne saurais dire pourquoi mais j’avais l’impression que l’artiste en faisait trop, qu’il s’aventurait un peu loin dans son art et qu’il allait prendre un bide. Il fit pourtant tourner le moteur, en s’essuyant les mains avec un vieux chiffon, plus sale encore que ses mains. Il souriait béatement et donnait des petits coups de pied dans les pneus. Il dit aussi qu’il tournait comme une horloge suisse, ce moulin-là, et il crachota loin devant lui, comme un vrai homme. Ma mère souriait tout aussi béatement : il venait d'annoncer qu’elle était tranquille pour faire trois mille kilomètres ! Autant lui annoncer qu’elle était parée pour faire le tour de la terre.
Elle ne fit même pas le tour du village.
L’auto fit un vacarme épouvantable de bête mortellement blessée, cracha une fumée noire comme l’enfer, sursauta de douleur et fit silence, stoppée net, crucifiée au beau milieu du chemin. Elle démarrait encore, certes, mais elle refusait d’avancer, ma mère s’énervant, criant au secours et de désespoir, torturant dans tous les sens le levier de vitesse, qui finit par lui rester bêtement dans les mains.
Mon frère courait dans tous les sens, affolé, tournait autour de l’engin en levant les bras au ciel et en donnant encore des coups de pied dans les pneus, comme quand il était content.
Dépêché sur les lieux en urgence, le mécanicien, le vrai cette fois-ci, déclara qu’on avait vidangé la boîte à vitesse au lieu du moteur et que tout était en morceaux, là-dedans. Kaputt répétait-il, Kaputt, fier de son mot. Kaputt !
Dans cette pitoyable méprise cependant, la vocation de mon frère avait dû recevoir le coup de grâce. Kaputt. Plus jamais je ne le revis en bleu de travail.
Il se fit menuisier.
11:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.03.2011
Va-t-en-guerre et pacifistes bêlants
 Je crains - mais j’assume - que mon jugement ne soit quelque peu faussé du fait que je vive hors des frontières de mon pays. Je crains que ce jugement ne se fasse plus émotif que réfléchi.
Je crains - mais j’assume - que mon jugement ne soit quelque peu faussé du fait que je vive hors des frontières de mon pays. Je crains que ce jugement ne se fasse plus émotif que réfléchi.
Quand on est loin et qu’on ne rentre finalement qu'une fois l’an, forcément, le pays des racines, celui que, bon gré mal gré, l’on porte en soi comme une espèce de port d’attache, apparaît parfois à travers un prisme déformant et on nourrit à son égard des pensées et des sentiments qu’on n’aurait jamais eus, qu’on se défendait même spontanément d’avoir, quand on vivait avec lui.
Je me suis donc surpris à souhaiter que le monde, et en premier lieu mon pays, celui de Montaigne, Rousseau, Montesquieu, celui qui aux peuples étrangers donnait le vertige, intervienne contre un salopard sanguinaire qui se propose de noyer dans le sang une rébellion et qui, même, a déjà mis à exécution une partie de ses fantasmes assassins.
Humainement, ça coule de source. Mais il n’est quand même pas confortable d’être dans la position du va-t-en-guerre. D’autant que l’idéal humanitaire et démocratique n’est que très rarement la flamme qui met in fine le feu aux poudres. D’autres préoccupations, sans doute, président aux bombardements et à l’ultima ratio regum des canons.
Ce monde est trop compliqué et nous ne percevons que la partie la plus visible d’un iceberg dont nous avons depuis longtemps cessé de comprendre les dérives.
Et je me dis aussi que notre désastreuse incapacité, incapacité avérée, à changer ce monde devrait nous avoir guéri de toute prétention à vouloir l’interpréter sans risque d’erreurs grossières.
Mais il n’empêche que, d’ici, savoir que son pays est entré dans un conflit armé brasse les tripes. Mes tripes n’ont pas de cerveau ni de mémoire.
D’autant que je ne suis quand même qu’à 2000 km de Paris. Je ne suis pas au bout du monde, je suis au sein de cette fable à tétines qu’on appelle Europe. Quelles que soient les ambitions des pays engagés en Lybie, je n'en compte que cinq présents pour faire un effort, sur les vingt-sept qui, régulièrement, s’amusent pourtant à traire copieusement la vache européenne.
Et comme je suis dans un de ces pays-là, je constate une nouvelle fois qu’Europe veut dire dossiers de subvention mais qu’aucun cœur, aucun idéal, aucun intérêt commun n’anime la placidité du gros bovin.
Pire même. On est carrément opposé les uns aux autres.
Une Europe foutaise, donc, une Europe pêle-mêle, sans âme, sans individu et qu’il serait temps que des hommes de bonne volonté, soit l'entraînent vers l’humaine dimension, soit invitent tout le monde à rentrer chez soi afin qu'il y vaque à ses occupations domestiques.
On verrait bien. Mieux vaut être seul que mal accompagné, n’est-ce pas ?
Anti-européen ? Oui. Sous ces auspices-là, oui. Je ne me sens pas du tout de la même famille que la Hongrie d’extrême droite ni de celle du clergé polonais, par exemple, érigé en classe sociale riche et fourrant partout son sale nez de possédant arrogant.
Cette Europe, ce monstre à vingt-sept têtes qui regarde dans vingt-sept directions à la fois, j’en disais dans Polska B Dzisiaj - assis au bord du Bug - ce que j’en prétends encore aujourd’hui :
" Plus de frontières. Plus d’explosion d’artillerie lourde, plus de terreurs incendiaires, plus de sang dégouttant sur les rides de la terre et plus d’épouvante hurlée sous la mort en furie. J’ai devant moi, avec cette rivière qui musarde entre ses gorges sablonneuses, ce pourquoi se sont entre-tués les hommes depuis qu’ils sont des hommes. Tout le débat des tueries tourne autour de l’endroit exact où doit être planté ce poteau rayé blanc et rouge et sur lequel je me repose, les yeux dans l’eau. Ce poteau marque la fin d’une souveraineté et le début d’une autre. Il délimite le champ d’application des vérités et le moindre outrage à son égard ordonne réparation par le massacre. Ça me semble d’une désespérante simplicité.
J’ai pris appui sur la bombe qui a ensanglanté le monde.
Je suis de cette génération qu’on dit bénite des dieux pour être la première depuis que les temps sont humains à ne pas avoir vu déferler chez elle le fracas des armes. Puisque plus de vingt siècles n’avaient pas été suffisants pour déterminer l’emplacement exact de ces satanés poteaux, force fut bien de les mettre enfin au rebut.
De guerre lasse.
Génération bénite des dieux, depuis ta naissance on s’est pourtant égorgé et mis les tripes à l’air sans retenue en Indochine, en Algérie, au Vietnam, en Cisjordanie, en Palestine, en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, au Liban, dans les Balkans et, aujourd’hui même, en Géorgie sans qu’on sache jusqu’où la poudre parlera. Tout ça en soixante cinq ans. Autant dire sans relâche.
(…)
Ça n’est pas agréable à écrire et ni même à penser mais je ne suis pas de ceux qui bêlent à tout vent que l’Europe est à jamais sauvée des cataclysmes guerriers. Parce que derrière les poteaux qu’elles plantent pour marquer sa souveraineté, aussi loin qu’elle puisse étendre ses ailes, il y aura toujours un pays qui ne reconnaîtra pas ces poteaux comme plantés au bon endroit ou une nation qui s’en sentira bafouée. De plus, à l’intérieur même de son enceinte, et ce d’autant plus sûrement qu’elle ne cesse de s’élargir, longtemps des nations seront agitées par leur sentiment équivoque d’une adhésion forcée à une histoire usurpée, sentiment tellement nébuleux qu’il faudra bientôt le taxer de barbare. Peut-être, sûrement même, les générations d’un futur plus ou moins lointain aboutiront-elles à l’effacement de ce sentiment occulte. Lorsque la dissolution liquide des pays dans un même bocal sera devenue plus compacte et plus solide.
(….)
Prévoir que cette Europe est pour l’éternité à l’abri des guerres et des combats, c’est en outre juger que nous serions des hommes bien meilleurs, bien plus accomplis, bien plus intelligents, bien plus humanistes et bien plus généreux que tous ceux qui nous ont précédés.
Et ça, c’est d’une incommensurable vanité partout et fortement démentie par les réalités. "
14:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.03.2011
La frontière, la guerre et l’enfant

Sans le voir vraiment. Mais la fillette a montré du doigt.
- Papa, c’est un Russe !
- Ah oui, ma puce… C’est un Russe. Il arrive bientôt chez lui, le Russe, tu vois. Il doit être content.
- Comment i fait le Russe pour traverser le Bug ?
- Il y a des ponts sur les rivières. Et sur les ponts, il y a des routes pour les voitures et les camions.
- Alors, quand on ira en France, on traversera le Bug aussi, nous?
- Non, le Bug et la Russie, c’est devant nous. Là où va le camion. La France, c’est derrière.
- Oui, mais on traversera un Bug.
- Je ne crois pas. Nous traverserons toute la Pologne, puis toute l’Allemagne, puis toute la France pour aller jusqu’à l’océan, mais il n’y a pas de rivière là où nous passerons.
- Et entre Niemcy (1) et la France, il n’y a pas de Bug ?
- Si, mais c'est pas un Bug. C'est le Rhin.
- Et entre la Pologne et Niemcy ?
- Non. Ou alors un petit. L’Oder, que ça s’appelle.
- Alors, c’est le même pays s’il y’a pas de Bug… Prawda ?
- Prawda. C'est un peu le même pays.
- …
- Si c'est le même pays, y'aura plus de guerre chez nous alors ? Les pays, ils sont tous des copains maintenant.
- Non, plus de guerre. Tous les pays sont maintenant des copains, comme tu dis. Ça s’appelle l’Europe.
- Et les Russes aussi, ils sont en Europe ?
- Heu.. Presque oui. C’est des copains à l’Europe.
- Et pas l’Irak ? T’as dit une fois qu’ils faisaient la guerre en Irak.
- Ah, l’Irak c’est pas l’Europe ! C’est compliqué... C’est à cause du pétrole.
- Et qu’est-ce que c’est le pétrole ?
- Ben, tu vois, là, en ce moment on se promène en voiture, ça roule parce qu’il y a de l’essence dans le réservoir. L’essence, c’est fait avec du pétrole et le pétrole il est sous la terre.
- Et ça fait la guerre, le pétrole ?
- Non, pas vraiment, mais il y a des pays qui n'en ont pas, alors il faut qu’ils en achètent aux autres qui en ont et ça coûte beaucoup, beaucoup de złotys et il y a plein de pétrole en Irak. Tout le monde veut du pétrole parce tous les pays ont des voitures.
- Pourquoi, ils nous en donnent pas alors, du pétrole, s'ils en ont plein ? Nous en Pologne, on pourrait leur donner plein de pommes et des groseilles et des poires et eux, ils nous donneraient du pétrole... Prawda ?
- Prawda... Prawda... Ce serait pas mal, oui, comme idée.
-…
- Papa, roule à cent et double ce.... (2) Russe !
1 - "Allemagne" en polonais
2 - Mot censuré par égard pour le peuple russe
Texte de 2006
10:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.03.2011
Tristesse
 Neige doucement fondue, dernières pellicules de glace qui résistent encore à fleur d’étang, chants encore timides des premières grives, un vol de cigognes, ciel qui n’a plus la couleur attristée de l’hiver.
Neige doucement fondue, dernières pellicules de glace qui résistent encore à fleur d’étang, chants encore timides des premières grives, un vol de cigognes, ciel qui n’a plus la couleur attristée de l’hiver.
On aurait envie de laisser monter en soi toute cette sève des choses, comme à chaque passage à ce point précis du cercle. On aurait envie d’affirmer encore et encore que le temps qui nous est imparti de ce côté-ci des étoiles est un temps merveilleux, qu’on soit Paul ou qu’on soit Jacques, misanthrope ou incorrigible amoureux des hommes.
Mais le cœur n’y est pas. Le printemps a la tenue d’un décor posé sur un monde résolument dramatique.
De l’autre côté de la Méditerranée, tout un peuple que soulevait enfin l’espoir, est abandonné aux couteaux de son étrangleur. Sa gorge ne sera bientôt plus qu’une béance aux chairs pendantes. Honte ! Honte pour l’éternité jetée à la face des puissants ! Ce sont des frères qu’on assassine. Nous ne savons pas leurs vues, leurs sentiments, leurs idées d’eux-mêmes. Que nous importe : ils ont pris les armes contre leur dictateur et devraient mériter notre secours et respect fraternels. Qui qu’ils soient.
Ingérence ? Taisez-vous, abominables que vous êtes ! Taisez-vous ! Vous vous ingérez partout, sans morale ni éthique, sans crier gare et sans état d'âme, quand votre soif de domination, de profit et de puissance monétaire est à étancher !
Et puis, là-bas, sur l’archipel de l’Orient, la vieille terre qui s’est secouée, a tué, et le monde une nouvelle fois menacé par les manipulations scientifiques de l’infiniment petit.
Pour ou contre le nucléaire ? Question idiote s’il en est. Question d'imbéciles. Infantile. Question sans fondement. Question hors-sujet. Question pour faire voir qu’on a des choses dans sa tête alors qu’on est plat comme une limande, face aux complications du monde.
Le nucléaire est dangereux comme l’est - sur une échelle plus grande, plus frappante, plus apocalyptique parce que d’un coup d’un seul fortement meurtrier et qu’il hypothèque alors la santé humaine à long terme - la cigarette que j'ai au bec, la vitesse sur route ou autoroute, la consommation excessive d’alcools.
Je n’aime que modérément les chiffres. Ce qui, in fine, est en partie snob et légèrement débile. Donc : la voiture tue un million et demi de personnes dans le monde chaque année et en blesse quarante fois plus ! Depuis Tchernobyl, la voiture, votre voiture messieurs-dames, la mienne, a donc tué 37 millions d’individus. A titre indicatif, la Pologne compte 38 millions d’habitants.
Vous êtes pour ou contre la voiture ? Ridicule !
Le nucléaire est une énergie fondamentale. Au sens profond, étymologique. Pas grand monde pour se soucier d'ailleurs de sa dangerosité quand il allume au quotidien son convecteur, se branche sur internet, éclaire ses mouvements, se sert de ses outils domestiques, consomme des produits fabriqués par des machines électriques.
Le drame est ailleurs. Le drame est dans la maîtrise des hommes sur cette formidable énergie que leur cerveau a su arracher aux principes mêmes de la matière. Le drame est que la planète est elle-même une force que les hommes ne maîtrisent pas et ne maîtriseront jamais. La planète explosera quand, scientifiquement, elle aura vécu son temps. Qu’elle soit habitée par des hommes ou non.
Or, elle tremble régulièrement, s’ébroue, et les hommes, grimpés sur son dos comme le sont les puces sur celui des chiens, s’en trouvent forcément et fortement bousculés.
Le drame est dans l’instabilité permanente, vivante, de l' habitat humain.
Fallait-il donc construire des centrales nucléaires, plonger au fond de la matière pour en extraire la substantifique moelle et tâcher de doter l’humanité de réserves énergétiques inépuisables ?
Oui. Je dis oui sans une seconde d’hésitation.
A mon sens, ceux qui répondent non sont des babas cools attardés, qui s’ignorent, genre qui diraient qu’il fallait laisser les chevaux attelés aux diligences parce qu’un être qui leur était cher a trouvé la mort dans un accident de la circulation.
Des erreurs monumentales, des contradictions de l’intelligence, des négligences nées de la recherche exclusive du profit, ont-elles été commises dans la mise en place et le maniement de cette énergie ?
Oui. Sans aucune hésitation.
Ceux qui répondent non sont des puissants intéressés par le lucratif et aucunement soucieux du confort de l’humanité.
Reste la tristesse, la détresse, la compassion du cœur et de l’âme face au drame du Japon, drame de l’humanité, drame et catastrophe de la fusion des erreurs humaines, du génie humain et des caprices de la planète, voyageuse du cosmos.
J’habite à deux-cent-cinquante kilomètres, à vol de nuage radioactif, de Tchernobyl.
On m’a raconté un peu.
Je pense aux japonais meurtris dans leur vie.
Je pense aux Libyens bientôt vaincus.
Je ne pense pas au printemps.
10:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.03.2011
Petites annonces
 . Recherche désespérément quelqu’un qui aurait lu Le Docteur Faustus jusqu’au bout afin qu’il me renseigne sur la façon dont il s’y est pris. Troisième fois que j’abandonne, vers la cent-cinquantième page, ce chef-d’œuvre (prononcer avec la bouche en cul de poule et en dodelinant du chef) de la littérature.
. Recherche désespérément quelqu’un qui aurait lu Le Docteur Faustus jusqu’au bout afin qu’il me renseigne sur la façon dont il s’y est pris. Troisième fois que j’abandonne, vers la cent-cinquantième page, ce chef-d’œuvre (prononcer avec la bouche en cul de poule et en dodelinant du chef) de la littérature.
Tel : 00 56 765 444 8000, aux heures des repas
. Ai reçu de nombreux faire-part qui m’annonçaient la mort du roman depuis La Comédie humaine et l’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second empire. Comme je ne m’étais aperçu de rien, ballot que je suis, et que me voilà donc avec un siècle et demi de retard sur le dos, je recherche avec frénésie toute personne susceptible de me renseigner sérieusement sur l’endroit d’inhumation, les causes réelles du décès et, si possible, le nom des fossoyeurs. Parce que j’ai lu aussi quelque part que ces derniers auraient pu être Marx et la sociologie, ce qui, de prime abord, m’avait fait croire à une grosse blague d'apprentis carabins avinés.
Tel : 00 56 765 444 800, aux heures des repas
. Je cherche un éditeur pour un roman vieillot, aux termes surannés, à la syntaxe classique, avec des personnages et des descriptions à la con. Bref, un roman chiant comme un jour sans pain. Un roman dont le sujet n’intéresse pas grand monde. Jugez-en plutôt : un groupe de paysans de la Vienne à la fin des années 60 face à un événement ponctuel, certes, mais surtout face aux chambardements causés par la nouvelle façon de penser les campagnes.
Discrétion assurée. Parole d’honneur.
Tel : 00 56 765 444 800, à toutes heures du jour et de la nuit
. Recherche pour conversation anodine - et plus si affinités mais ça m'étonnerait fort - un ou une auteur de tapuscrits pour ne pas mourir idiot et savoir enfin à quoi ça ressemble.
Tel : 00 56 765 444 800, aux heures les moins pénibles de la journée
. Annonce sérieuse : Aimerait rencontrer quelqu'un qui a tout lu - je dis bien tout - de A la recherche du temps perdu sans jamais avoir eu l'impression de perdre son temps.
Tel : 00 56 765 444 800, à des heures convenables
. L’Exil des mots recrute rédacteur en chef pour sa catégorie critique et contestation car grosse fatigue sur le sujet de la part du rédacteur en poste.
Pas sérieux s’abstenir. Rémunération très incertaine cependant.
Tel : 00 56 765 444 800, aux heures de bureau
. Enfin, alors que j'allais boucler ma rubrique, on me prie d'insérer ceci :
Cette bonne femme, souffrant d'inextricables névroses parmi lesquelles celle de la surenchère répugnante, recherche d'urgence un vétérinaire.
Contact : UMP, Assemblée nationale.

15:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.03.2011
Le temps des cerises en forme de poires
 L’hiver, c’est comme un tunnel dans lequel on s’engouffre aux premiers jours de novembre. Listopad en polonais. Littéralement, la chute des feuilles.
L’hiver, c’est comme un tunnel dans lequel on s’engouffre aux premiers jours de novembre. Listopad en polonais. Littéralement, la chute des feuilles.
C’est ce mot chute qui me plaît bien. Chuter. Les chutes sont toujours plus vertigineuses que les ascensions. Plus sûres de leur trajectoire aussi.
Pour ma part, je m’y glisse donc toujours le cœur léger dans ce boyau des mortes-saisons, plein de bonne volonté et d’idées d’écrire. Dans ma tête, c’est mythique. La décadence de la lumière va de pair avec l’envie d’écrire. Ça finit même par avoir quelque chose d’idiot, cette affaire que j’assume volontiers. Toute idiotie décalée s’assume d’autant mieux qu’on n’a de compte à rendre à personne et si, en plus, on trouve quelque plaisir à être idiot dans un monde d’idiots.
Quatre mois de neige et de gel et de verglas. Cette latitude sans altitude observe scrupuleusement le grand mouvement des choses. Vers la fin mars reviendront les premières cigognes et l’aube, ce trait rose de l'éternel sablier, bien avant cinq heures. Quelque chose change dans le grand basculement. Le tunnel sent comme un soupçon de lumière.
J’aurai bientôt traversé mon sixième hiver en Pologne. C’est ma pendule à moi. Mes douze coups de minuit. C’est là, dans ces traversées des catacombes gelées, que se mathématise ma vie. Mon avancée dans le temps, plutôt. Je ne consacrerai donc jamais à l’expression j’ai X printemps. C’est peut-être parce que je préfère les endormissements aux réveils.
Se réveiller sur quoi, d’ailleurs ? Sur l’état d’un monde qui ne m’inspire plus guère que le dégoût. Et si ce monde est dégoûtant, c’est bien parce que les hommes le veulent ainsi. Il n’y a plus de dialogue possible avec toute cette merde. Les grands de ce monde, portés par les nains affreux, cacochymes, prétentieux, minables, des chaumières du suffrage universel, nous ont volé nos vies. Qu’au moins ils ne nous fassent pas perdre notre temps.
Si je devais exprimer mon plus fort regret, mon immense regret, ce serait d’avoir vécu à une des époques les plus lamentables pour l’esprit humain.
Et je suis encore assez con pour le dire.
Tout ça ne sert strictement à rien.
Notre parole ne vaut que par sa propre logique autonome. Intérieure. Sans incidence aucune sur rien. Un peu comme ces mélopées de prisonniers qui dégoulinent parfois sur le crépuscule des barreaux. Quand il n’y a rien à faire, sinon compter les nuits.
Parfois même les hivers.
13:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.02.2011
Au pied du mur
Je publie un récit que j'avais d'abord projeté d'inclure dans un recueil de dix, récemment terminé et qui sera proposé aux éditions Antidata.
Je m'étais fortement inspiré d'un texte entamé sur le blog Tempête dans un encrier.
Puis j'ai changé d'avis. J'ai supprimé ce récit de mon sommaire, ne le trouvant pas achevé pour traiter d'un sujet aussi casse-gueule.
Il n'aura donc d'existence que sur l'Exil et ce que n'a rien de restrictif, chers lecteurs.
_________________
 Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Si ce Grand Meaulnes-là est resté en nous comme l’ombre un frère, d’un compagnon, c’est qu’il trimballe avec lui quelque chose de notre universalité.
Ma fête étrange à moi, cette fête qui ouvre sur le possible et le désir de vivre, fut tout autre. Je n’en perdis jamais le chemin.
Je connaissais par cœur le sentier sous la forêt qui menait jusqu’à d’étranges décombres car cent fois depuis leur découverte j’avais repris ce layon, en quête d’une redite de mes premiers émois.
En vain. Ces ruines m’avaient pourtant dévoilé les premiers mystères du désir amoureux, en même temps qu’elles avaient été mon premier regard jeté sur le délectable interdit. A partir d’elles, sans que j’en prisse tout de suite conscience, ce regard s’était fait synonyme de plaisir de vivre.
Après bien des visites et des visites, j’avais donc fini par abandonner mes ruines à ses bois et à ses broussailles mais j’ai tenté, tout au long de ma route, de les reconstruire partout ailleurs.
Tout cela ne m’est bien sûr apparu que tardivement. Entre les vieux remparts assiégés de buissons et le présentement dit, il y eut l’histoire ravinée par les marées de la vie et l’enfouissement des premiers troubles sous leurs écumes.
Ecrire cependant, n’est-ce pas vivre deux fois ? N’est-ce pas revenir en amont, remonter l’écoulement du fleuve par lequel on est arrivé jusque là, se pencher sur son lit, le débarrasser des alluvions déposées sur l’inaperçu ou l’à peine entrevu et tenter de ramener en pleine lumière le cours qu’emprunta finalement la fuite du temps ?
Alors maintenant, à l’heure où décline la lumière, à l’heure indécise entre le chien et le loup, à l’heure qui approche et où il faudra se jeter dans les gouffres anonymes, indéchiffrables et chaotiques du néant - tellement qu’on est tenté d’éconduire en même temps le loup et le chien en tâtant du fantasme de l’immortalité par un message agrafé au dos des insomnies - elles ont resurgi, les vieilles murailles des grands bois.
À l’heure d’écrire.
Elles ont resurgi à l’envers. La première fois, elles s’étaient entrouvertes sur les portes de l’avenir. La seconde, aujourd’hui, elles se referment sur le passé.
Telles des parenthèses.
Le mois d’août était opiniâtrement bleu et depuis plusieurs semaines les vents soufflaient du sud-est. Quoique faibles, ils n’en bousculaient pas moins des fétus de paille qui s’envolaient haut, très haut en tournoyant longtemps au-dessus des chaumes à la faveur des courants chauds.
Les paysans appellent ce phénomène des sorcières et disent qu’il est annonciateur d’une sécheresse durable. Je ne sais évidemment pas si cette théorie de l’observation est infaillible, mais je sais qu’elle s’était vérifiée cette année-là. L’été n’avait été rafraîchi que par quelques menues ondées, la terre était poudreuse et les prairies, sauf celles qui bordent la rivière, jaunes comme le sable des dunes.
Mon père, tout endimanché et tout inquiet, était allé ce dimanche-là se promener sur les champs où s’alignaient ses gerbiers d’avoine, d’orge et de blé fauchés aux derniers jours de juillet. Il voulait s’assurer que les grains ne séchaient pas trop rapidement sous ce vent continental et si, libérés de leurs épis, ils ne s’éparpillaient pas au sol. Selon ce qu’il aurait vu, il prendrait alors la décision de rentrer rapidement toute la moisson ou la différerait. Car il était comme ça mon père : pour rien au monde, il n’aurait travaillé un dimanche. Son dieu le lui interdisait formellement. Alors, sous couvert de promenades, il allait, les mains ostensiblement enfoncées dans ses poches, constater ceci ou cela sur ses champs et repérer de la sorte ce qu’il était urgent de faire et ce qui pouvait attendre. C’est-à-dire que sa morale rudimentaire devait considérer que penser, anticiper, projeter, ça n’était pas travailler, du moment qu’on faisait tout ça sans un outil dans les mains.
Ma mère l’avait accompagné et je les avais vus, bras dessus bras dessous, descendre le chemin qui, de notre maison, menait jusqu’à la rivière. Ils avaient ensuite traversé le pont de pierres.
Quand je dis que je les avais vus, ça n’est pas tout à fait exact. Je les avais guettés. Et lorsque j’avais été certain qu’ils étaient maintenant sur les champs de l’autre rive, j’avais pris la poudre d’escampette.
J’étais parti dans la direction opposée, vers les grands bois de chênes qui s’étiraient sur cinq kilomètres au moins, selon les dires de mon père, en face de chez nous, sur le coteau de la petite vallée. Je n’y étais jamais allé que par lui accompagné, encore qu’en proche lisière, où il possédait quelques ares et où il prélevait chaque année notre provision de bois de chauffage.
L’ombre tiède et sans un souffle bourdonnait des mille insectes de l’été et je marchais prudemment en évitant les herbes sèches et les pierres, réputées pour être les lieux de prédilection des serpents. Par d’éphémères éclaircies du taillis, j’apercevais en contrebas la rivière presque mourante et, plus loin au-dessus, les champs accablés de lumière. Bien que je ne sois nullement en peine ni en proie à la peur, cela me rassurait d’entrevoir des lieux familiers et m’invitait à explorer encore plus loin un faible sentier forestier coupant les bois dans le sens de leur longueur.
Je le suivais depuis longtemps déjà, en quête de nids d’oiseaux perchés tout là-haut dans le branchage des chênes ou alors camouflés dans les sombres enchevêtrements du sous-bois, quand ...
Je m’arrêtai, tétanisé.
Devant moi se dressaient de hautes murailles de pierres partiellement effondrées et dévorées par une végétation de lierres luxuriants, de lianes, de viornes et de sureaux. Délabrées, antiques et étrangement retirées au beau milieu des bois, elles obstruaient complètement le sentier.
Mes premières stupeurs à peine estompées, je m’avançai doucement sur la pointe des pieds, comme attentif à ne pas réveiller quelque chose de ces décombres tellement inattendues, quelque chose de lointain, de souterrain et qui n’existait pas dans mon monde. Ces ruines m’apparurent incontestablement extravagantes en ces lieux. Elles étaient vivantes, elles étaient humaines, elles semblaient s’être déplacées là, tant elles n’étaient pas du même élément que les herbes, que les arbres, que les fleurs et que la poussière ocre du chemin.
L’enfant aux portes de son adolescence ne voyait sans doute pas ces vieux murs tels qu’ils étaient en vérité. Leur solitude, leur dégradation majestueuse dans tout le silence et le secret de ces grands bois, lui en imposaient. Il les voyait puissants qui coupaient autoritairement sa route. Ils avaient surgi. Et déjà n’avaient d’importance que ce qu’ils pouvaient bien receler. Dissimuler. Plus loin qu’eux.
C’est bien ce qui différencie foncièrement l’archéologue qui cherche de l’enfant qui trouve. Celui-là veut faire parler les vestiges au passé, celui-ci n’a d’yeux que pour l’éventuelle ouverture que pratiquerait ce passé sur un futur immédiat, qu’il s’approprierait aussitôt.
Ces grands murs sont restés gravés intacts dans ma mémoire d’homme. Je pourrais aujourd’hui dessiner et peindre leurs lézardes béantes d’où dégoulinait la terre rouge de la maçonnerie, leurs sommets ravinés, les plantes et les arbustes qui les broyaient de leurs étreintes, les lourdes pierres taillées, grisâtres et mouchetées de lichens. Je pourrais sans les trahir les reproduire tels qu’ils jaillirent devant moi, spontanément, comme des allégories de ce qu’il faut éviter de franchir, comme des signes, comme des prémonitions à la fois austères et dionysiaques. J’eus la terrible sensation que ces parois marquaient la fin de mon monde. Qu’il y aurait désormais un avant et un après leur rencontre.
Le layon se rétrécissait, pris en tenaille par des genêts, des genévriers et autres broussailles. Il descendait légèrement maintenant et ce n’est que parvenu au pied des murailles, que je constatai que seule la crête en était écroulée. Les bases en étaient encore saines. Je continuai lentement sur le sentier dont la déclivité s’accentuait et qui semblait vouloir contourner le vieil édifice. Il changeait de qualité aussi. Il était à présent revêtu de pierres que recouvrait une mousse bien verte et humide. Il y avait de l’eau par ici. Je le sentais. Et de la fraîcheur. Ça n’était plus la lourdeur bourdonnante, épaisse et poussiéreuse des sous-bois. Quelque chose avait changé, la température, le décor, presque la saison. Je mesurai tout ça d’instinct et en pris pleinement conscience en apercevant entre les cailloux et les herbes rampantes, les minces filets d’eau d’un écoulement limpide.
À force de prudence et de lenteur, je parvins bientôt jusqu’à l’angle de ce qui m’apparut dès lors comme étant des fortifications. Car à cet endroit s’élevait une grosse tour ronde et crénelée, à partir d’où les remparts s’enfuyaient à la perpendiculaire, accompagnés du petit sentier qui descendait encore plus abrupt, toujours pavé et luisant d’humidité.
Une tour ! Je n’en avais jamais vu que sur mes livres d’écolier. Une tour, ça signifiait dans mon esprit bataille rangée, flèches, arbalètes, lances, cris, feu et huile bouillante jetée sur des assaillants tout vêtus de fer…Je levai la tête. Elle était haute, en bon état et sans doute avait-elle été reconstruite car la pierre, quoique loin d’être neuve, était plus blanche et mieux taillée que celle des remparts. Un lierre géant avec un tronc tourmenté par de robustes nœuds, lourds comme des poings, l’escaladait, s’enroulait tout là-haut entre les créneaux avant de continuer sa conquête exubérante tout le long des sommets effondrés de l’enceinte.
Remparts, petit chemin dallé autour, source toute proche, tour. Tout cela désignait un château. Au bout de mon escapade, j’étais donc tombé sur une forteresse des temps anciens, secrètement recluse au fond des bois. Je n’étais plus apeuré ni inquiet : j’étais émerveillé et ma tête se mit à battre la campagne.
Ma maison, mes parents, les interdictions, les recommandations, les morales, étaient soudain à des siècles d’ici et continuaient de s’éloigner encore vers un brouillard irréel. Tout ça, déjà n’existait plus. Un souffle puissant surgi d’un temps révolu venait de balayer ma petite vie de garçonnet au rang des quotidiens moroses, sans rêve et sans issue.
Longtemps je suivis le layon de plus en plus étroit, le long des remparts que le soleil éclairait de jaune clair à travers la cime immobile des arbres, alors que moi j’avançais dans la pénombre verdoyante des arbustes et des broussailles. Impossible d’accéder tout à fait au pied des murs, cernés par la végétation au maximum de sa maturité et de sa densité, jusqu’à ce que mon sentier fût soudainement coupé par un chemin creux beaucoup plus large et nettement plus carrossable. Etonné, je l’examinai. Des empreintes de pneus de voiture en imprégnaient encore la poussière. Il filait à travers bois, droit sur le soleil couchant, pour en sortir bientôt sans doute, le long de la rivière en contrebas.
Mais de ce côté-ci, sous mes pieds, il finissait sa course sur une porte cochère fermée d’une lourde chaîne et que d’épaisses ferrures disposées en diagonale sur chaque vantail rendaient plus massive encore. Un cul de sac. L’accès des hommes au château en ruines. Je n’étais plus seul et les murailles perdaient quelque chose de leur enchantement. Je m’approchai doucement de l’énorme porte. Son bois battu par la pluie, les froids et l’ombre des intempéries, était noir et rugueux.
Je glissai un œil entre les deux battants, mal joints.
Alors je suffoquai littéralement tandis qu’un flot épais de sang tiède envahissait tout mon corps, me faisait ouvrir la bouche toute grande et basculait ma tête dans un vertige jusqu’alors inconnu, d’une violence délicieuse et qui ne devait plus guère me quitter.
Je vis d’abord la femme étendue sur la chaise longue. Elle était nue. Elle était absolument nue. Lascive, elle se prélassait au soleil telle la délicieuse divinité d’une légende antique et sa longue chevelure auburn, saupoudrée d'une lumière qui retombait en poussières scintillantes, se répandait en désordre sur la toile rayée blanc et vert de la chaise longue. Elle tenait un livre à la main et d’épaisses lunettes noires masquaient tout son regard. J’écarquillais mon œil désemparé dans le petit interstice de bois et je fixais, de profil, la touffe ombrée du pubis, les seins mordorés, ronds et lourds, et je frémissais de tout mon corps, en proie à l’extase. Cette beauté de statue, tellement parfaite, tellement limpide et tellement isolée au milieu de tout ce délabrement de pierres et de halliers, ne pouvait être que l’émanation immatérielle d’une déesse, que la manifestation d’un esprit fugitif et malin des bois et des forêts.
Qu'une créature momentanément égarée de ce côté-ci du réel.
Tout mon être tendu demeurait cependant chevillé à l’ombre délicatement crépue de cette étrange toison entre les cuisses et à la poitrine dressée tel un cri d’ivresse, jeté vers le soleil et le grand ciel tout vide et tout bleu. Les jambes négligemment croisées à hauteur du genou étaient longues, beaucoup plus longues que la chaise sur laquelle elles étaient étendues et de temps à autres, seul signe tangible de l’existence charnelle de cet être magique, la main se levait légèrement pour tourner une page du livre.
Elle repoussa bientôt les lunettes sur le haut du front, se leva, féline, éblouissante de souplesse, et se dirigea lentement par une allée de fins gravillons blancs, vers le corps de bâtiments situé juste en face de moi. Elle me tournait maintenant le dos. J’admirai là, l’œil collé contre le bois de la porte cochère à m’en faire mal, les premières fesses féminines de ma vie. J’admirai la réalité vivante de mes fantasmes naissants, j’admirai l’apparition devant mes yeux de toute cette métaphysique du désir qui devait plus tard me servir de phares et de sémaphores pour tracer ma route, et derrière lesquels, de villes en villes, de villages en villages, de routes en routes, d’années en années, de débauches en débauches, de joies en détresses, d’ivresses en ivrogneries, j’ai couru, couru à perdre haleine, comme le prisonnier de l’éboulement court après le soupçon de lumière qu’il a cru entrevoir au bout de sa prison d’obscurité.
J’assistai, médusé, à l’éphémère et première mise en scène d’une éternelle illusion.
Un homme cependant, le torse puissant et nu, était apparu qui venait à la rencontre de la jeune femme. Il sortait de l’aile aux larges baies vitrées située en face de moi, et je me retirai vivement comme s’il pouvait me voir à travers le lourd portail. Je restai quelques instants le dos plaqué contre la porte, effrayé, n’osant plus m’approcher ni faire le moindre mouvement. Lorsque je revins enfin, avec mille précautions, l’œil avide, comme aimanté à cette fente entre les vantaux, le cœur battant, les deux corps n’en faisaient plus qu’un, absurde amas de peau luisante, agité d’ombres et de lumières, et ils se roulaient dans l’herbe comme le font d’ordinaire les enfants et les jeunes chiens fous.
Les larmes aux yeux, la bouche ouverte, j’entendais depuis mon portail, gémir ces deux corps. On eût dit qu’ils étaient en lutte et en proie à la plus vive des douleurs.
J’essaie de retrouver - mais ça n’est pas très facile - le trouble qui m’envahissait. Il me semble que quelque chose d’irréel, de délicieux et de divin, s’était évanoui et, avec ces deux corps confondus, qui se multipliaient, qui se chevauchaient tour à tour, qui roulaient, se redressaient et se renversaient encore, l’adoration du merveilleux.
Je crois que j’étais accablé. Et pour s’être inscrite dans le réel, dans le charnel, l’apparition nue n’en restait pas moins aussi inaccessible pour moi que la lune ou les étoiles de la nuit le sont aux rêveurs éconduits. Mon âge - j’allais avoir treize ans- , l’homme qui pérorait, gloussait et se trémoussait comme un pantin sur ma déesse déchue, ma condition sociale, mes parents, le curé, l’école, le monde entier… Il y avait, entre cette beauté spectrale et moi, entre ce que je voyais se dérouler d’elle devant mes yeux meurtris par le mystère obscène du désir et de la vie, entre les étranges lamentations que j’entendais maintenant jaillir de sa gorge offerte aux immensités du ciel bleu, des abîmes effrayants, absolument infranchissables.
Il y avait tout le poids d’un incompréhensible et soudain désespoir.
J’éprouvai tout à coup une haine féroce contre tout ce qui était. Contre mon âge, contre les hommes, les réalités, contre tout ce qui pouvait m’entourer de tranquille et d’insignifiant bonheur.
Et je versais des larmes de douleur et de dépit quand, la pénombre descendant maintenant de plus en plus profondément sous la touffeur des sous-bois et les deux corps s’étant enfin désolidarisés pour rejoindre l’intérieur des bâtiments après être longtemps restés blottis l’un contre l’autre, inertes, comme terrassés par la violence de leur combat, je me résolus enfin à rebrousser chemin, anéanti.
Je venais de perdre les repères sur lesquels l’enfant guide sa navigation. Je venais d’engloutir dans une vision éblouissante, la foule des petits signes avec lesquels cet enfant se fraie un chemin, difficile et solitaire, entre les commandements, les écueils et les rochers du monde adulte.
À tel point que tout ce qui, jusqu’alors, avait nourri peu ou prou mon initiation au plaisir de vivre devint affreusement insipide.
Je sombrai pour un temps dans l’apathie et le dégoût même de mon existence.
11:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.02.2011
Autocritique

Je mets régulièrement en ligne les chapitres de Brassens, poète érudit, des textes qui ont donc été écrits en 1999. J’intercale entre ces mises en ligne de vieux textes publiés ici en 2008 ou 2009. Ce qui permet de les rafraîchir un peu et d’harmoniser la présentation de L’Exil, qui en a bien besoin.
Point de nouvelles élucubrations là-dedans. Je sors de cet hiver un peu fatigué quand même par ce recueil de dix nouvelles écrit d’octobre à maintenant. C’est une expérience que je n’avais jamais tentée, l’impression de devoir se renouveler toutes les dix pages et aussi, tâcher de satisfaire aux exigences de la forme brève, précision, travail d’épuration et tutti quanti.
J’ignore évidemment si j’ai mené mon projet à bien ou si je m’y suis lamentablement planté. Parfois, je me dis que c’est vraiment réussi. Parfois aussi, un parfois un peu plus têtu que l’autre, je me dis que tout ça ne vaut pas une queue de cerise.
Pas envie, donc, d’entreprendre de nouveaux chantiers, aussi menus soient-ils, d’autant qu’un éditeur que je connais bien me fait poireauter gentiment pour un roman depuis juillet dernier et que poireauter, c’est pas vraiment mon fort.
Las.
Et pas grand-chose à dire non plus sur l’état de plus en plus délétère du monde. Pour ça, un blog n’est pas nécessaire. Il est même tout à fait superflu. Suffit de regarder par la fenêtre et rabâcher ne sert qu’à la production de sa propre bile, sans aucun effet sur la détermination des organisateurs patentés de la misère humaine, parmi lesquels certains montrent des dents de loup et d’autres font reluire une peau d’agneau, chacun dans son rôle pour distraire la chaumière.
Je crois même, de plus en plus, que la critique du monde spectaculaire ne lui sert, in fine, que de panneau publicitaire.
Alors, prendre tout le sens de l’expression populaire et attendre le dégel.
Le dégel de quoi ? On verra bien.
Sous la glace, la plage, peut-être. J'en doute fort et je n'aime pas les plages.
Jamais rien n’est de toute façon achevé de ce qu’on a à peine commencé.
10:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.02.2011
Formica et Télé : la fin d'une époque
 (...) La bouteille de gaz emboîta le pas à l’eau et, suprême avatar, le formica fit son entrée triomphante.
(...) La bouteille de gaz emboîta le pas à l’eau et, suprême avatar, le formica fit son entrée triomphante.Des meubles d’une inestimable facture, des placards de merisier ou de chêne sculptés furent désossés et finirent leurs longs et nobles états de service en casiers à poules ou en portes de clapier.
Toujours experte dans ses observations du monde, ma soeur qui ne savait guère quoi dire de tous ces chambardements, trouva là une ouverture pour faire les louanges de son avocat d’employeur.
Celui-ci en effet ne voulait pas de formica, ni chez lui, ni dans son grand bureau. Sans doute par modestie, parce qu’il avait les moyens de s’en payer, du formica. Le brave homme ne s’était fendu d’un placard que pour sa chambrette à elle. Pour lui faire plaisir. C'était vraiment un beau petit meuble, pratique comme tout. Pour lui-même, il avait bien voulu, certes en rechignant un peu, débarrasser quelques-uns de ses clients de leurs gros meubles, en vieux bois vermoulu, un peu comme ceux passés chez nous par les flammes et par la scie. Ne sachant plus à la fin ou mettre toutes ces friperies, embêté mais incapable de vexer les gens, il avait même fait porter des lits et des buffets dans sa petite maison à la campagne, au bord de la rivière, à l’ombre des peupliers où il aimait à se retirer le dimanche avec sa petite famille. Il y taquinait la carpe ou alors il y recevait des amis, le docteur par exemple, ou bien le vétérinaire, quand ce n’était pas le notaire. Quelquefois, pas souvent, il y allait seul, avec des gros dossiers sous le bras, des dossiers tellement compliqués qu’ils demandaient à être étudiés dans le calme et la solitude champêtres. Interdiction formelle était alors donnée à toute la famille de le déranger, sous aucun prétexte.
A n’en pas douter, voilà un homme qui aimait rendre service aux gens. Ma mère ricana que c’était surtout un homme qui ne comprenait rien à rien. S’il n’achetait pas de formica, c’était normal mais surtout c’était bon signe. Le formica n’était pas fait pour des attardés et des nigauds pareils.
Je revenais d’une longue réclusion trimestrielle quand je pris de plein fouet les effets dévastateurs de cette orgueilleuse et stupide conversion des miens à la modernité. Ma maison ressemblait lamentablement à la salle de sciences du collège et à l’infirmerie. Je sentais bien qu’elle était en train de perdre son âme sous les coups de boutoir des faiseurs de mode et de pacotilles. Je m’insurgeai tout net que c’était laid, que c’était de la camelote et que c’était honteux. Je traitais mes frères d’imbéciles heureux pour avoir osé passer par la hache notre mobilier.
Avec la lumière qu’il ne fallait pas allumer, l’eau courante qui ne courait guère, la bouteille de gaz qui inspirait une peur bleue, le formica qui ne servait à rien sinon à injurier les murs, le clan glissait inéluctablement vers le factice de la corruption sociale.
C’était un homme très affable, les ondulations de ces cheveux bien tenues en place par la brillantine, une fine moustache, très fine, presque un symbole, impeccablement taillée. Il débarqua chez nous en sifflotant et en sautant prestement d’une petite camionnette jaune, haute sur pattes. Ma mère l’avait d’abord reçu en fronçant le sourcil, l’oeil guère encourageant, puis elle s’était laissée peu à peu séduire, par le discours ou peut-être par les vaguelettes brillantes des beaux cheveux, par le costume souple et par ce sourire à peine moustachu dont ne se départait pas le bonhomme.
Comme le formica, tout le monde en voulait. Il ne fournissait pas, il fallait en profiter, il ne pourrait pas en laisser longtemps comme cela chez les gens, à l’essai. C’était sans doute même la dernière fois où il pouvait se permettre cette fantaisie. Nous en avions de la chance !
Je trouvais que cela commençait à faire beaucoup de bonheur d’un seul coup. C’était gratuit, c’était formidable et nous avions de la chance. La fortune ne nous avait pas habitués à tant de sourires à la fois.
Ma mère écoutait, dubitative encore, mais néanmoins subjuguée. Ces dernières, mais bien molles résistances, s’écroulèrent quand la fine moustache, ayant négligemment promené son regard chafouin sur la pile des Nous-Deux qui traînaient devant la cheminée, dit qu’il y avait aussi des feuilletons qu’on pouvait suivre toutes les semaines ou même tous les jours, des romans-photos d’amour qui bougeaient et qui parlaient, quoi, si on voulait aller par là. Est-ce qu’on se rendait compte ?
De Gaulle nous sauva la vie.
Après bien de minutieux réglages, après bien des coups de petits tournevis de-ci, de-là, après bien des crachotements, des éclairs et des bruits sournois de machine infernale qui se propose d’exploser, la longue face et le long nez du Général apparurent à l’écran, tandis que les non moins longs bras, grand ouverts, battaient la mesure de cette voix si singulière et de tous tellement connue.
A ce timbre rauque et fortement ponctué, j’avais vu ma mère se renfrogner, incrédule. Elle avait interrogé le marchand d’images avec cet oeil que je connaissais trop bien et qui ne laissait présager rien de bon. Absorbé par ses boutons, le gars n’avait pas croisé ce regard.
Il était enfin parvenu à faire la synthèse entre le son et l’image.
Il avait dit vrai. Nous avions de la chance. Quant à lui, il ne pouvait pas tomber plus mal. Ma mère s’approcha du poste, regarda De Gaulle dans les yeux, se tourna vers le bellâtre qui avait retrouvé son sourire et, fidèle à elle-même, comme toujours avant la tempête, demanda qu’est-ce que c’était que ça.
Ce devait être un autodidacte. Le pauvre bougre avait dit exactement ce qu’il ne fallait pas dire.
Depuis, je n’ai jamais entendu, malgré tout ce que j’ai entendu sur le sujet et en dépit de tout ce que j’ai pu en dire moi-même, de critique plus radicale du pouvoir politico-médiatique.
Elle priait celui qu’elle traitait désormais de gaulliste de remballer au plus vite sa camelote, avant qu’elle ne l’explose elle-même d’un savant coup de marteau.
La télévision ne parvint jamais jusques à nous. Trop sûr de lui, le progrès arrogant avait voulu outrepasser la mesure.
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.02.2011
Michelet
 J’avais mis ce texte en ligne en août 2009 alors que je venais d'en terminer avec les quelque 4800 pages - texte, notes et annexes - de «Histoire de la Révolution française», de Jules Michelet, ouvrage qui couvre la période allant de la convocation des États généraux à la réaction thermidorienne.
J’avais mis ce texte en ligne en août 2009 alors que je venais d'en terminer avec les quelque 4800 pages - texte, notes et annexes - de «Histoire de la Révolution française», de Jules Michelet, ouvrage qui couvre la période allant de la convocation des États généraux à la réaction thermidorienne.
Je le publie une nouvelle fois aujourd'hui car, quand on voit dans quel ruissseau nauséabond s'est embourbée la République française, avec ses dirigeants amis des régimes les plus pourris et les plus brutaux de la planète, des dirigeants corrompus, vautrés dans leur sale fric et qui font voter des lois pour que le bon peuple aille au charbon jusqu'à 67 ans et tutti quanti, on est en droit - depuis bien longtemps, c'est vrai - de se demander si l'histoire a une quelconque utilité pédagogique face à l'abrutissement des hommes.
On est en droit de s'exclamer : tout ça pour rien, laissons tomber toute critique sociale et vivons en sauvages !
Et quand je pense, parmi tant d'autres choses, qu'un homme pourrit dans leurs sales prisons depuis 25 ans, sans que pas grand monde ne songe à s'en émouvoir, et que même une imbécile comme Ségolène Royal s'en réjouisse, le ressentiment dans mon coeur atteint le niveau du dégoût pour tout ce qui touche, de près ou de loin, à la politique.
Au cas où cela pourrait vous intéresser, je note d'ailleurs que le susdit prisonnier publiera le troisième tome de ses mémoires en septembre prochain, chez Argone.
De la lecture de Michelet, j'ai tiré un tel plaisir que j’aimerais que les gens pour qui j’ai de l’estime – et qui ne l’ont pas encore fait - se plongent à leur tour dans cet océan littéraire, en reçoivent la même jouissance et les mêmes perplexités.
L'admirable de cette lecture, c’est qu’on est en présence d’une œuvre historique, certes, mais en même temps profondément lyrique, étonnamment personnelle, enthousiaste ou désabusée. Engagée.
Derrière les faits transmis, le cœur et l’âme du poète, de l’écrivain, de l’homme de conviction généreuse, palpitent, regrettent, anticipent et souffrent.
Dit autrement, voilà une œuvre historique sans l’ennui décharné de la prose historique. Une écriture qui embrasse le sensible et fait appel aux émotions les plus humaines.
Je comprends alors beaucoup mieux pourquoi les historiens sérieux, les doctes, les scientifiques du décorticage de la grande aventure humaine, refusent à Michelet d’appartenir à leur collège.
C’est un bien grand service qu’ils lui rendent là, finalement.
Nous ne savons pas toujours situer notre écriture dans cette incommensurable prolifération de genres que constitue la littérature. Nous nous interrogeons, nous posons en filigrane les principes de notre esthétisme, de ce que nous portons en nous, de notre confrontation à un monde compliqué. D’aucuns, raccourci fulgurant, affirment que la littérature est morte, mais sans définir précisément la nature du cadavre et les auteurs du crime.
C’est un point de vue. Radical, désespéré peut-être, qui a sans doute quelque raison d’être mais qui a surtout l’affligeante présomption de renvoyer paître, sans les entendre, tous les amoureux de la lecture.
Nous n’avons pas reçu, en ce qui nous concerne, de faire-part.
C’est peut-être une blague style Quat’ z’arts… Une certaine littérature est morte. Sans doute. Disons plutôt désacralisée. L’écriture, quant à elle, est bien vivante.
Le roman est crevé lui aussi, assurent depuis longtemps, d’autres. Je trouve que ça fait beaucoup d’obsèques, tout ça, et que ça s’inspire beaucoup plus du champ de navets que de la salle des fêtes…Une expression du roman, sans doute veulent-ils dire ; Le Balzacien, le Stendhalien, le Maupassantien, que sais-je encore ? Mais c’est quoi un roman ? Un truc qui invente des personnages dans un réel réapproprié par l’écriture ou un personnage réhabilité, l’auteur, dans un réel qu’il s’invente?
Cette digression pour dire que la lecture de Michelet révèle une autre dimension de l’écriture : une transcription pindarique des drames et espoirs humains, la force de l’intelligence sensible prenant à bras le corps le matériau historique, bien documenté, et qui s’en empare pour parler le langage de l’universel, laideur et beauté dialectiquement confondues.
Du point de vue de notre positionnement d’hommes de la Cité, revient aussi cette obscure évidence que les révolutions – en particulier celle dont les acquis constituent aujourd’hui la clef de voûte de notre édifice démocratique et social - sont des cheminements tortueux, inaccomplis, difficiles, et qu’on ne peut nullement appréhender au travers le prisme déformant de l’idéologie, cette fabrique de la pensée prédigérée, ce soporifique de la douleur des faibles, cette bouillie servie pour chats fainéants, qu’ils se vautrent à droite, ronronnent à gauche ou miaulent à l'extrême gauche.
En lisant Michelet, c’est de l’intérieur qu’on lit les acteurs de l’histoire. J’allais dire de la Comédie humaine.
C’étaient pas des anges, c’étaient pas des démons et c’étaient même pas des révolutionnaires au sens enfantin où nous l’entendons.
Des hommes de chair, de passion, d’intérêts, des fourbes, des obscurs, des grands, des illuminés et des mesquins – comme nous tous - mis en présence d’une nécessité de transformation radicale des conditions de la vie.
Pour ne parler ici que des deux grandes figures, les deux icônes de nos premiers manuels d’histoire, Danton et Robespierre, Michelet les enveloppe d’une lumière nouvelle à mes yeux, quoiqu’on devine nettement chez lui le dantoniste, ce qui n’est qu’un reflet de son engagement personnel, dans son époque à lui, à l’aube du Second Empire.
A t-on déjà vu, dans œuvre présentée comme historique, un Danton en bonnet de nuit, à Sèvres, rêveur à sa fenêtre ouverte sur la nuit et uniquement préoccupé de sa jeune femme et de son jeune fils ? Un Danton écœuré du sang versé, peureux, dépassé par les événements, lamentable de contradictions, disant blanc le lundi et noir le mardi, ne sachant plus à quel jeu politique se prêter, et ce uniquement parce qu’il voulait vivre, simplement vivre plus longtemps sa vie d’homme aimant et aimé et qu’il sentait bien sur son cou, déjà, planer le froid et luisant couteau de la guillotine.
Le procès qu’on lui fit – comme celui de la plupart des grands esprits de ce temps - n’eut ni cul ni tête. Quelque cent quarante ans plus tard, Staline n’aura rien à envier au tribunal révolutionnaire de 1793. Parmi les jurés, l’un était un garde du corps de Robespierre - l’instigateur du procès selon Michelet - , un autre était sourd, un autre complètement idiot, tellement idiot qu’il ne comprenait ni les questions posées aux accusés, ni les réponses faites par ceux-ci et qui, du fond de son âme atrophiée, invariablement, demandait qu’on tuât !
La tête de Danton, comme des milliers d’autres têtes, tomba dans le panier d’une absurdité ensanglantée, avec cette logique implacable du crime érigé en institution.
Celle de Robespierre, l’épurateur, le névropathe paranoïaque, le timide et vertueux serial killer, père de Napoléon, de Thiers, de Staline, enfin de tous les putois sanguinaires de l'histoire contemporaine, suivra bientôt, victime de l’épouvante dans laquelle il aura plongé tous les acteurs, illustres ou anonymes, de l’époque.
Michelet assure que toute l’Europe couronnée, réactionnaire et pourtant coalisée contre la France, eut alors un profond respect pour cet homme adulé des uns, honni des autres, parce qu’il avait, par le jeu sournois de la politique, tranché les deux têtes majeures de 93, Danton et Desmoulins, et coupé ainsi le cou de la République, ouvrant un boulevard au 18 Brumaire, à l’Empire, aux Restaurations, à la Terreur blanche et vengeresse des émigrés.
Triste histoire que celle de tous ces hommes et de toutes ces femmes trahis par ceux à qui ils avaient confié leur enthousiasme de liberté.
Triste histoire parce qu’histoire éternelle.
Histoire de la profonde solitude des hommes, de leur inintelligence ponctuelle à comprendre les mécanismes de leur barbarie et les cheminements de leur destin.
Vraiment.
Photo : Wikipédia
10:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.02.2011
Les oiseaux sont-ils tenus à un devoir de mémoire,
là où dieu et les hommes ont, une fois pour toutes, cessé d'exister ? *
* Pierre Michon - La Grande Beune -
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.01.2011
In vino veritas
 Alain Rey et Sophie Chantereau connaissent bien la langue et lui rendent d’incomparables services. Au point de la dispenser d’idéologie. Ils lui font dire ce qu’elle dit. Ni plus, ni moins.
Alain Rey et Sophie Chantereau connaissent bien la langue et lui rendent d’incomparables services. Au point de la dispenser d’idéologie. Ils lui font dire ce qu’elle dit. Ni plus, ni moins.Leur dictionnaire des expressions et locutions, première et deuxième édition, décrit l’origine des tournures, explique, compare, illustre et commente.
Commente ?
Donc suppute. Ah, alors peut-être, après tout, interviennent-ils, nos auteurs. Peut-être qu’ils s’interposent entre nous et le langage.
Mais j’aime beaucoup Alain Rey et Sophie Chantereau.
N’empêche…
Parfois, quand ils ne savent pas trop, ils font comme nous tous, ils terminent leurs phrases en queue de poisson, laissant l’interlocuteur sur sa soif.
C’est le cas de le dire pour les Polonais et leur légendaire ivrognerie. Ne dit-on pas, en effet, « saoul comme un Polonais » ?
C’est vrai que depuis que je vis parmi eux, j’ai vu des Polonais le soir le long des rues que le froid enveloppe, sur des trottoirs livides, qui titubaient sous le poids de la vodka ou celui de piwo.
Mais quand je vivais sous les cieux océaniques de mon pays, j’ai aussi vu pas mal de Français, à commencer par moi-même, des Allemands également, des Finlandais, des Irlandais, des Portugais et des Italiens, la démarche plutôt équivoque et le verbe sinueux.
Des Anglais aussi, beaucoup d’Anglais. Des Anglais gueulards, surtout quand ils sont loin de leurs pénates. Comme si l’ivresse, sur leur île puritaine, était inaccessible. Les Anglais adorent se saouler chez les Gaulois : « Quand t'es à Rome, fais comme les Romains ». C’est délicat.
Bref.
Donc, pourquoi les Polonais, ainsi ravalés au rang du cochon, de la grive, de l’âne, de la bourrique ou du pompier ?
Empressons-nous de consulter nos deux érudits :
« …Cette comparaison n’affecte pas le peuple de la Pologne, probablement moins buveur que les Français, bien qu’il ait partagé avec les Russes, aux XVIIIème et XIXème siècles, une réputation de brutalité dans les mœurs et de sensualité. Il doit s’agir d’une référence aux soldats polonais, mercenaires appréciés sous l’Ancien Régime (les cavaliers dits polacres ou polaques), puis après les guerres de l’Empire. »
Il y en a des choses dans ce bavardage policé !
D’abord, que viennent faire ici les Français ? S’ils sont probablement plus buveurs que les Polonais, pourquoi la conscience collective n’a-t-elle pas retenu « bourré comme un Français» ? Cette petite assertion ressemble plus à une formule de politesse courtoise, une pommade avant intromission, qu’à une explication sémantique sérieuse.
Hors sujet.
Si on veut dire à quelqu’un qu’il est con, il arrive qu’on commence par faire son autocritique, complètement hors sujet aussi, afin que le juron qui va suivre passe avec douceur.
La comparaison au service de l’euphémisme.
Ensuite, ce quoique, conjonction restrictive s’il en est et si parfaite pour semer le doute, insinuer, nuancer le propos…Les Polonais, mais pas seulement eux, les Russes, les gens de l’Est, disons les Slaves, ont eu, deux siècles durant, une réputation de barbares. Si le peuple polonais ne doit pas s’offusquer de la comparaison initiale sur l’ivrognerie, à quoi bon lui rappeler qu’il a eu une bien mauvaise renommée chez les latins, tellement raffinés, eux, comme chacun sait ?
Encore hors sujet…Une bise à droite, un coup de pied à gauche.
L’explication musarde, tarde à venir, balance, prend des précautions de chats de gouttière. S’il ne s’agissait d’aussi talentueux linguistes, on serait tenté de crier : Au fait ! Au fait !
Mais nous y voilà. Il doit s’agir des soldats mercenaires. Il doit s’agir. Comme disait Coluche « C’est même pas sûr ! ».
Bon. D’accord. Mais pourquoi ? Mystère et boule de gomme. Il doit s’agir de soldats mercenaires, polonais et appréciés. On ne voit pas trop la relation de cause à effet. Les soldats qui se saoulent sont-ils donc plus appréciés que les sobres pioupious ?
Au cœur du sujet, la lumière s’éteint.
Terminé.
Autant vous le dire tout de suite : Ma compagne polonaise, aux racines ukrainiennes, bref, une slave, en tout cas aux mœurs fort délicates, n’a apprécié qu’à demi la lecture que je lui fis de cette explication emberlificotée.
Alors elle m’a raconté. L’expression est en fait un éloge.
Napoléon ayant, je ne sais ni où ni quand, peut-être au cours de la campagne de Russie, ou alors avant une marche forcée, je l'ignore, donné quartier libre à ses troupes avant la bataille, celles-ci s’adonnèrent bien évidemment à d’outrancières libations.
A tel point qu’il fut bien difficile aux différents officiers de les remettre en ordre de marche le lendemain matin. Seules les escouades de Polonais étaient sur le pied de guerre à l’heure convenue, frais comme des gardons.
Rentrant en fort courroux, L’Empereur aurait alors lancé à ses soldats :
« Si vous voulez vous saouler, saoulez vous comme les Polonais ! »
Je vous l’ai dit.
Rien n’est plus subjectif que l’explication du langage, de ses tournures, de ses tenants comme de ses aboutissants.
06:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET