07.11.2011
Accueil du texte d'Elisabeth Legros-Chapuis : regrettable malentendu
 Il y a eu une sérieuse confusion des genres et des motivations dans l’accueil que je fis vendredi dernier du texte d’Elisabeth Legros-Chapuis sur la Grèce.
Il y a eu une sérieuse confusion des genres et des motivations dans l’accueil que je fis vendredi dernier du texte d’Elisabeth Legros-Chapuis sur la Grèce.
Cet accueil était amical et de circonstances et n’avait dans mon esprit absolument rien à voir avec les vases communiquants, comme l'annonce Elisabeth sur son blog. Comble de malchance, ces vases-là tombaient vendredi, alors que je ne m’en étais même pas aperçu ! J'en veux pour preuve, que je n'ai fourni aucun texte sur le site partenaire, l'échange étant pourtant le principe même de l'opération.
Je redis donc ici, avec force, que cet accueil était ponctuel et ne peut en aucun cas être confondu avec une participation de près ou de loin à ces vases communiquants, dont je ne veux plus entendre parler, tant ils sont liés à François bon, personnage équivoque avec lequel je n'ai plus aucune affinité, qui m’a honteusement trompé, menti, roulé dans la farine, et qui ne s'est, d’ailleurs, soit dit en passant, toujours pas acquitté de sa misérable dette financière, pourtant d'un ridicule montant de 75 euros.
Quant à sa dette morale, c’est pas demain la veille qu’il aura les moyens de s’en libérer !
Que tout ceci soit donc dit sans dépit et même avec joie. Fermement cependant !
Image : Philip Seelen
11:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.11.2011
La Grèce, de près et de loin
Je l'ai dit par ailleurs : nous ne comprenons pas grand chose au monde ; nous émettons des avis, des colères, des ressentis, mais le monde, désormais séparé des hommes, s'en moque comme de Colin Tampon de nos postillons. A vouloir désormais l'interpréter, nous disons le plus souvent des âneries érigées en doctes sentences.
La Lybie, la Syrie, la Chine, la Grèce...Les échos que nous en distribuent ceux qui sont aux manettes - plus exactement les laquais de ceux qui sont aux manettes - ne sont pas de nature à ce que nous nous servions librement de notre libre-arbitre.
Pour moi en tout cas.
J'avais relevé chez Solko, dans les commentaires, cette phrase de Patrick Verroust : Les Grecs ont un savoir-faire qui remonte à l'Antiquité pour rendre leurs tragédies universelles !
Je me garderais bien de prétendre à la justesse ou non de la belle formule, qui m'a plu en tant que telle. Mais depuis que la Grèce, à la fois si proche et si lointaine, est bien malgré elle au hit-parade des préoccupations et dans le collimateur des financiers, que ne dit-on pas !
J'ai donc demandé à Elisabeth Legros-Chapuis, qui connaît bien ce pays, de venir nous en parler, selon elle.
Par ailleurs, une lectrice, que je remercie vivement, m'a fait parvenir ce lien, édifiant, que je vous recommande vraiment de suivre, juste pour tenter d'effacer un peu les discours sordides de nos politiques, Merkel, Obama, Sarkozy et Lagarde en tête, lesquels, soit-dit en passant, au garde-à-vous devant la haute finance à qui ils doivent tout et pour laquelle, en juste retour, ils sont chargés de nous égorger chaque jour un peu plus, viennent sans doute de choper Papandréou dans un coin sombre, l'ont pris par le col de sa chemise et l'ont convaincu que de recourir à l'avis du premier concerné, le peuple, était d'une indélicatesse insupportable et vraiment d'un autre temps.
BR
 J’ai vécu en Grèce pendant dix ans, il y a bien longtemps : c’était dans les années 70. Années difficiles pour ce pays : les premières de la décennie étaient encore sous le régime de la dictature des colonels (où le grotesque le disputait à l’horrible…), puis il y a eu la crise chypriote et la chute de la junta, la proclamation de la République, l’«accident» ayant provoqué la mort de Panagoúlis… En 1980, grand tournant pour tout le monde, je rentre en France et la Grèce, elle, entre dans l’Union Européenne – ou plutôt, à l’époque, la CEE.
J’ai vécu en Grèce pendant dix ans, il y a bien longtemps : c’était dans les années 70. Années difficiles pour ce pays : les premières de la décennie étaient encore sous le régime de la dictature des colonels (où le grotesque le disputait à l’horrible…), puis il y a eu la crise chypriote et la chute de la junta, la proclamation de la République, l’«accident» ayant provoqué la mort de Panagoúlis… En 1980, grand tournant pour tout le monde, je rentre en France et la Grèce, elle, entre dans l’Union Européenne – ou plutôt, à l’époque, la CEE.
De cette époque, j’ai conservé un lien particulier avec la Grèce ; j’y séjourne régulièrement au moins deux fois par an.
Tout ce préambule pour dire que ce qui se passe actuellement dans ce pays, me touche, me perturbe et m’inquiète.
Je n’ai évidemment pas la compétence, ni politique, ni économique, pour dire ce que pourrait être la solution… Tout ce que je peux exprimer, c’est mon simple point de vue de citoyenne du monde. Du ressenti et du vécu. J’ai passé deux semaines là-bas en septembre. En rentrant, j’écrivais ceci :
« Je connais bien ce pays et je le retrouve toujours avec plaisir. Cette fois pourtant, c’était un peu différent. Je me sentais souvent mal à l’aise devant les problèmes quotidiens que rencontrent les Grecs en raison de la crise. Problèmes de survie tout simplement… comment subsister, comment élever ses enfants, comment se soigner, quand les prix de toutes choses augmentent (ils sont souvent les mêmes, voire plus élevés qu’en France, alors que les revenus sont bien plus faibles), que les impôts sont multipliés et que les salaires ou retraites diminuent. Quand on a la chance d’avoir un emploi, et j’ai entendu un chiffre effarant : plus de 40 % de chômage dans la tranche des 16-24 ans. Dont une bonne partie de jeunes éduqués et diplômés, mais qui ne trouvent pas de premier emploi. Les diktats de la « troïka », les mesures injustes et souvent incohérentes brandies par le gouvernement pour tenter bien tardivement de s’y conformer… Une fois de plus, on pressure de manière révoltante la classe moyenne et surtout les salariés, au lieu d’aller prendre l’argent où il est vraiment : grandes fortunes (dont celle de l’Eglise orthodoxe, riche d’immenses propriétés foncières), grandes entreprises, professions libérales. Le nombre de commerces que l’on voit fermés au hasard des rues est énorme. Les gens s’en sortent tant bien que mal, souvent en exerçant des petits boulots non déclarés (mais qui pourrait leur jeter la pierre ?), et la solidarité familiale, toujours très forte dans ce pays, joue à plein. »
Depuis, la crise s’est exacerbée, des propositions ont été avancées, un accord a été conclu (je parle de celui du 27 octobre), puis le Premier ministre a annoncé son projet de référendum… Réflexions en vrac :
1) Certes le référendum est légitime et constitue une expression de fonctionnement démocratique - mais je ne suis pas emballée par le principe du référendum, en général ; cela peut tourner facilement au plébiscite ; et si on a élu des députés, c’est bien pour qu’ils expriment notre voix ? (qu’est-ce que je suis naïve…) En l’occurrence, je crains bien que ce référendum-là (s’il a jamais lieu, ce qui reste à voir) ne soit pour Papandréou qu’une manière de jouer son va-tout : ça passe ou ça casse. Et si ça aboutit à une sortie de l’euro pour la Grèce, ça peut être catastrophique, pour eux d’abord, mais aussi pour tout le monde (enfin, pour les Européens).
2) Ce n’est certes pas la première fois que le destin des Grecs est dirigé par d’autres puissances ; après 1821, quand ils ont pu enfin se libérer de l’occupation turque, la tentative de république a échoué avec l’assassinat de Capodistria et les puissances européennes ont refusé à la Grèce le droit de se choisir un roi. Ils lui ont parachuté un Bavarois, le nommé Othon…
3) Si la Grèce s’effondre, ou plutôt fait naufrage, ce sera la preuve éclatante que la spéculation financière, elle, a gagné la partie, et, à mon sens, c’est très inquiétant pour l’avenir du monde. Car les spéculateurs font leur miel de tels événements, quelles que soient les conséquences pour les peuples et il n’y a aucun frein pour qu’ils s’abstiennent de recommencer ; c’est pourquoi il faudrait poser des limites à leurs agissements, mais les gouvernements le veulent-ils vraiment ? Le peuvent-ils encore, d’ailleurs ?
Certes, plein de choses m’agacent dans le fonctionnement de la Grèce au jour le jour. Ses politiciens (qu’ils soient de gauche ou de droite) sont des caricatures, corruption constante, clientélisme omniprésent. Sa bureaucratie est un sommet de complexité inefficace (essayez donc d’aller payer une simple facture d’électricité et vous comprendrez très vite). Les services publics coûtent cher et fonctionnent mal. Etc., etc. Il y a aussi un côté exaspérant qui consiste à vivre constamment au-dessus de ses moyens ; qui s’illustre chez les individus par le goût des marques (produits encore plus chers qu’en France, pour des salaires bien inférieurs…) et des grosses bagnoles (voir le nombre de 4x4 à Athènes…), et au niveau de l’État, par exemple, par la conception du métro : certes les stations sont superbes et même carrément grandioses ; mais le coût du projet s’en est ressenti, au moment où déjà l’argent manquait.
Et pourtant, pourtant, il existe encore, à côté et malgré tout cela, la Grèce éternelle, la nature dans une splendeur unique, parfois abîmée (oh, les immeubles en chantier abandonnés dans les villages, avec des ferrailles rouillées émergeant des piliers de béton…) mais souvent encore presque intacte, la mer unique, la montagne, le rocher, la terre grecque, l’odeur de la résine. La musique grecque. Les petits plaisirs simples, être assis à une terrasse de café et regarder la mer, manger des aubergines imam bayildi et du poulpe grillé… Quelque chose qui ressemble encore à la douceur de vivre. Et qui pourra, je l’espère, être préservé.
Elizabeth Legros Chapuis
Merci à Bertrand Redonnet pour avoir donné l’hospitalité à ce texte
11:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.11.2011
Aux lecteurs de L'Exil des mots
 Qui, à part peut-être les schizophrènes et les grands malheureux, écrit dans un but autre que celui d’être lu, immédiatement ou plus tard ?
Qui, à part peut-être les schizophrènes et les grands malheureux, écrit dans un but autre que celui d’être lu, immédiatement ou plus tard ?
Se consacrer à la rédaction d’un ouvrage, dans la solitude, c’est pour une bonne part se projeter dans un futur moins solitaire et plus ou moins proche. C’est s’adresser à, c’est aller à la rencontre de, c’est vouloir dire et être entendu.
En attendre un écho qui ne soit pas que celui des murs est autre chose encore. Un écho étant par définition un renvoi amplifié ou déformé par un obstacle infranchissable, ne saurait en effet prétendre à la fidélité.
Je constate, en regardant les états qui m’ont été fournis sur mes derniers livres, avoir été lu par deux mille lecteurs environ. Je dis bien "lecteurs" et non "personnes", la nuance ne vous échappera pas.
Quel écho en ai-je reçu ? Une vingtaine d’articles en tout et pour tout, des mails privés et des conversations de vive-voix. C’est agréable, c’est indispensable même, c’est gratifiant, mais ça n’est pas suffisant. Il faut pouvoir mettre un nombre sur tous les autres lecteurs que l’on ne connaît pas et qui ne désirent ni parler ni contacter. Tacite complicité établie sans visage, connivence silencieuse. C’est ce que demande l’écrivain, beaucoup plus que les deux ou trois écus non sonnants et non trébuchants de droits, qu’un contrat préalablement établi aura de toute façon déjà réduits à une portion congrue. Savoir si ses livres sont lus. Si le travail fourni intéresse.
Que cela soit vain ou non, d’écrire et d’attendre, est un tout autre problème encore. Car si nous attendions d’être en mesure d’enfanter un véritable chef-d’œuvre pour soumettre notre écriture à la lecture –ce qui serait le gage d’une époque au raffinement des plus exquis – nous ne ferions pas souvent montre de notre art. Peut-être même jamais.
En écrivant ces quelques lignes, je pense avec beaucop de sympathie à la sagesse et à l’opiniâtreté d’un camarade qui eut, il y a quelques mois, la gentillesse de me confier qu’il était sur la rédaction d’un livre depuis cinq ans déjà. Connaissant le talent de ce camarade, la précision de son expression, les fondements sensibles de son écriture, je ne puis m’interdire d’admirer ce qu’il fait dans l’ombre solitaire et de lui envier autant sa patience que la grandeur intime de son projet. Ce camarade, si je m’en réfère à l’écriture que j’en connais, doit être en train de construire une cathédrale. Et je pense en même temps à des pièces maîtresses, telles que Madame Bovary, Guerre et paix ou Le rouge et le Noir, dont les auteurs ont effectivement travaillé des années et des années leur manuscrit avant de le juger digne d’être soumis au jugement et au goût d’un public.
J’aimerais avoir cette résolution, j’aimerais avoir ce sérieux dans la construction, cette confiance, cette discipline et cette fermeté de travail en moi.
Nous écrivons donc pour être lu, c’est une lapalissade, et ce, surtout quand, visant une échéance immédiate, nous choisissons ces vitrines, ces pignons sur rue sans patente, ces expositions permanentes sans brevet que sont les sites et les blogs. Un auteur du net, qu’il soit bon ou médiocre, s’il vous disait qu’il ne consulte pas ses statistiques ou alors très peu, parfois, comme ça, négligemment, dans un moment de désœuvrement, voire de faiblesse, serait d’abord indigne de vous puisqu’il vous mentirait par le biais d’une absurde et enfantine coquetterie. J’en suis certain. A moins, comme dit en première ligne, qu’il ne s’agisse d’un fou ou d’un désespéré, mais là, cette folie comme ce désespoir, auraient forcément déjà dû transpirer dans ce qu’il vous écrit. Si tel n’était pas le cas…
Indigne de vous aussi parce que la consultation des statistiques est, à mon sens, un respect dû aux lecteurs. Le geste qui ne se voit pas, mais qui fait aussi qu’on prend en considération l’existence de ceux qui vous lisent, qu’on attache de l’importance à leurs visites, qu’on leur en sait gré.
Je consulte les statistiques de l’Exil des mots à chaque fois que je dois en ouvrir les coulisses pour y ajouter un texte ou y faire autre chose. Disons alors cinq ou six fois par semaine environ…Savoir si je suis lu et dans quelle proportion -même si ces données n’indiquent qu’une tendance et sont sujettes à caution - ou savoir si, au lieu d’écrire là, je serais bien mieux inspiré d’écrire chez moi et de repousser les échéances. Donc, en même temps que respect, indicateur de navigation personnelle dans la grande forêt écriture.
Je parlais tout à l’heure d’écho, le dissociant de la lecture anonyme. Ici, l’écho, ce sont les commentaires et, pour agréables qu’ils puissent être, pour marques de camaraderie qu’ils soient aussi (je suis, par exemple, touché qu'une lectrice, à deux ans d’intervalle, apprécie avec autant de plaisir le même texte et désire me le faire savoir), ces commentaires peuvent aussi s’avérer être des balises de naufrageurs allumés sur les rochers de la nuit, quand ils sont pollués par le convenu. Depuis cinq ans que je suis régulièrement sur le net, dont quatre sur ce blog, je me suis aperçu que certains auteurs de commentaires, assidus, quotidiens, - très, très, très peu, je vous rassure - en faisaient quasiment profession pour se faire un semblant de nom sur la toile et que la teneur flatteuse de leurs exclamations, que j’aurais pu prendre un moment pour m’étant personnellement adressée, se retrouvait partout où papillonnait leur bavardage, en des termes à peu près identiques. Rien de bien méchant là-dedans, certes, plutôt une erreur d'aiguillage de la misère mais aussi, quoique bien involontairement, un remède efficace, si tant est que nous sachions les identifier pour ce qu'ils sont, contre la vanité dans laquelle nous sommes tous enclins à sombrer. C’est humain.
Je ne commente pour ma part que deux ou trois blogs, dont celui-ci, celui-ci ou encore celui-là, très différents les uns des autres mais les uns et les autres fort à mon goût.
J’en lis beaucoup plus. Je les lis comme vous me lisez, lecteurs : sans éprouver le besoin de me faire connaître ou de mettre mon grain de sel sur les traces de l’auteur.
Et c’est ce dont je voulais vous remercier vivement ici, vous que je ne sais point mais que je sens tout près. Je trouve, en plus, ceci dit avec un certain humour et une légèreté certaine, que vous avez un certain mérite, vu les véhémentes positions que j’ai pu prendre récemment sur les diverses escroqueries d'une certaine boutique numérique et vu, aussi, mon indéniable caractère de cochon. Ou de goret, c'est selon.
Est-ce que c’est personnel ou est-ce une tendance générale ? : ici, plus les commentaires se font rares, plus les lecteurs sont nombreux, sans qu’évidemment je ne puisse me permettre d’établir une quelconque relation de cause à effet qui n’aurait aucun sens.
Ce mois d’octobre, donc, jamais L’Exil des mots ne s'était vu gratifier d'autant de visites et d'autant de lecteurs.
Vous m’en voyez heureux et fier et, surtout, sincèrement, très reconnaissant, d’autant plus que je crois savoir que la fidélité a ceci de contradictoire qu’elle est toujours fragile, jamais acquise.
Image : Philip Seelen
13:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.10.2011
DES IDÉES REÇUES
tamponnées, digérées et recrachées un peu partout...etc.
CHAPITRE II
 Depuis la morne pension Vauquer, Eugène de Rastignac entrevoit toutes les compromissions dont il faut se rendre coupable, toutes les ruses dont il faut user, tous les apparats dont il faut s’affubler et toutes les bassesses qu’il faut se résoudre à commettre pour être admis dans les salons du Tout-Paris, avoir une maîtresse en vue et faire fortune. Vautrin le tentateur lui enseigne quelques raccourcis fulgurants, mais là n’est pas mon propos.
Depuis la morne pension Vauquer, Eugène de Rastignac entrevoit toutes les compromissions dont il faut se rendre coupable, toutes les ruses dont il faut user, tous les apparats dont il faut s’affubler et toutes les bassesses qu’il faut se résoudre à commettre pour être admis dans les salons du Tout-Paris, avoir une maîtresse en vue et faire fortune. Vautrin le tentateur lui enseigne quelques raccourcis fulgurants, mais là n’est pas mon propos.
Ne nous croyons pas, quant à nous, des hommes plus modernes ou plus moraux. Pour tous les groupes sociaux, constitués ou non, il existe des critères d’admissibilité, implicites ou explicites. Le plus souvent implicites d’ailleurs parce que honteux de par la bêtise qui les sous-tend, de par la fatuité qui les soutient, de par le mensonge qui leur donne corps, et de par le misérabilisme intellectuel dont ils sont l’expression.
Dans le fond, pas grand-chose n’a changé depuis Balzac pour être admis, en vrai ou dans sa tête, dans tel ou tel groupe social, même moins huppé que celui auquel prétendait le jeune étudiant charentais. Dans telle ou telle branche de tel ou tel réseau social, si l’on veut.
En un mot comme en cent, prenons par exemple, le soi-disant gotha littéraire, en chair et en os ou sur les blogs et les sites de cette toile. Il y a des critères incontournables. Si, si ! Je l'affirme. Déjà, si vous en doutiez, j’y verrais presque comme un aveu.
J’en prends quatre, presque au hasard, de ces critères, histoire d’en démolir au moins deux :
- Aimer Rimbaud, sinon le comprendre,
- connaître Proust, sinon l’avoir tout lu,
- détester la chasse, sans peut-être n’avoir jamais croisé le moindre chasseur,
- honnir le foot - là, c’est rédhibitoire - sans même savoir ce qu’est un hors-jeu ou un coup franc indirect.
Voilà énoncés quatre éléments déjà constitutifs d’une belle âme et qui vous posent sur la tête d’un imbécile la perruque d’un poète, sur la tignasse d’un vilain la coiffe d’un marquis, sur le front d’une bécasse le duvet d’une colombe, esthète et amoureuse des Belles Lettres.
D’emblée, on ne voit pas trop, sinon par le jeu névrotique d’aliénations diverses bien imprégnées dans les cervelles comme autant de normalités abstraites, ce qu’il y aurait d’antinomique à aimer en même temps Le Bateau ivre et le jeu de jambes de Zinedine Zidane, l’évocation des souvenirs mondains du p’tit Marcel et la frappe de Benzema. Il me semble là qu’on tente de soustraire des lentilles d’un sac de blé pour obtenir des poireaux. Pas vous ?
Et moué alors ?
Moué ? Comment ça, moué ?
Bon.
Je suis touché par certaines œuvres de Rimbaud, bien sûr, pas toutes, mais pas plus profondément que par d’autres qui sont d’Apollinaire, de Richepin ou de Musset, en tout cas moins que par beaucoup signées Brassens.
Proust, pas vraiment ma tasse de thé. Jamais pu rentrer à fond dedans, rebuté peut-être, au mépris de la belle écriture et de la précision des âmes, par tout ce monde parfumé et maniéré.
Enfin, hérésie suprême, j’aime bien le foot, j’aime bien regarder (longtemps que ça ne m’est pas arrivé, remarquez) un grand match. Je n’avais pas loupé beaucoup de confrontations de la coupe du monde 1998, par exemple, ou de la coupe d’Europe qui avait suivi. J’avais aussi suivi d’autres grandes compétitions. Pour le plaisir de voir du jeu. Dans la campagne, il m’arrive encore, pas plus tard que dimanche dernier en me rendant au musée Sienkiewicz, de m’arrêter cinq minutes en traversant un village silencieux où se dispute une rencontre du bas de l’échelle. Sous les moqueries enjouées de mon entourage exclusivement féminin, faut dire !
Ces maillots en même temps flamboyants et crottés qui se disputent un ballon, ces galops, le bruit rugueux des crampons arrachant la pelouse, ces cris rauques, ces souffles courts d’où sortent des brouillards par saccades, le gardien ganté qui cherche ses appuis, se balance et trépigne sur ses jambes qui fléchissent, attentif, tendu, prêt à bondir comme le chat sur la souris, tout ça me ramène très loin, très loin en arrière, chez moi.
Je me souviens… Mes deux grands frères étaient de sacrés footballeurs ! Ils étaient connus au moins à vingt kilomètres à la ronde pour leur dextérité avec un ballon au pied. L’un avait même fini par jouer dans la prestigieuse équipe de Civray, en Division d’Honneur, je crois…Le dimanche soir, ils rentraient quand fuyait le jour, tels des aventuriers s’en revenant d’une glorieuse expédition, fourbus, et ils commentaient, et ils racontaient, et ils montraient même, parfois, un tibia estampillé d'un bleu qui faisait grimacer de douleur. Nous écoutions. C’était l’hiver. Ma mère faisait bouillir de grandes bassines d’eau, et, au savon de Marseille, décrottait les maillots. Ces tuniques du jeu et de la joute, je les admirais alors les jours suivants qui pendaient au soleil du fil à linge et se balançaient au vent, comme des haillons d’orphelin, les bras tendus vers la terre, jaunes quand mes frères jouaient à Brux, violets quand c’était à Chaunay, rouges et blancs à Blanzay, blancs et bleus pour Civray.
Les dimanches de l’été, c’était une fête que d’aller assister aux différents tournois et si, à la fin, un de mes frères avait l’heur de brandir la coupe, alors c’était sur toute ma famille, sur tout mon clan, qu’il me semblait que coulait quelque chose qui ressemblait à de la gloire. Ils étaient mes Kopa à moi, mes Just Fontaine et ils étaient la bravache revanche du pauvre. Car les fils du notaire, du médecin, du pharmacien, les fils des grands bourgeois, ne jouaient pas au football ou, s’ils y jouaient, ils n’y excellaient pas.
Les fils de bourgeois, je les ai retrouvés au collège, avec les versions latines et les thèmes, quand mes frères taillaient la planche à coups de varlope ou tordaient la ferraille à coups de marteau dans un atelier.
Quand j’ai changé de monde, que j’ai mis mes mots d’enfant en exil, que j’ai laissé derrière moi les maillots de football et les crampons crottés, quand j’ai tourné le dos à mon histoire.
Quand j’ai appris Sénèque et Molière, Vigny et Hugo. Tous ces nouveaux venus dans mon jardin, je les ai aimés et je les aime encore. Mais il y a eu, il y a et il y aura toujours de la place pour tout le monde dans un être qui n’éprouve pas la honte d’exister. Rien de ce qui fut constitutif de mes primes archéologies n’a été renié au nom du bel esprit.
La liberté, c’est ça pour mézigue : savoir reconnaître l’odeur de la racine que l'on porte en soi, ne pas la camoufler, même si c’est une odeur qui n’enivre pas forcément les belles âmes des cénacles et des chapelles.
Savoir être fier sans orgueil. N’appartenir à rien, qu’au hasard de soi. Être tantôt blanc, tantôt noir, tantôt gris selon les yeux avec lesquels on veut vous voir. Entier parce que pas toujours égal et n’obéissant à aucun critère de sélection. Et surtout, surtout, ne jamais se forcer à aimer quelque chose ou quelqu’un parce qu’il est de bon ton d’aimer, et ne jamais s’astreindre à détester ceci ou cela parce que ça vous pose son homme de détester ou de mépriser ceci ou cela.
Mais je voulais, en fait, - voyez comme l'écriture est capricieuse - vous parler de la chasse, et je me suis laissé entraîner par le foot, si je puis dire. La chasse, loisir maudit par les bonnes âmes et les savantes consciences ! Plaisir des gros cons avinés, couperosés, du boucher-charcutier du coin et du ringard de service !
Ce sera pour la semaine prochaine ; je vous parlerai donc de la chasse et… de la forêt. Car là aussi, les idées reçues se ramassent à la pelle, comme autant de manifestations d'une intelligence affectée, usurpée, séductrice dont on ne sait plus trop quoi.
09:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.10.2011
DES IDÉES REÇUES
tamponnées, digérées et recrachées un peu partout comme autant d'épiphénomènes de la clairvoyance et de l’intelligence humanistes
CHAPITRE I
 Longtemps nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Ce qui nous a fait dire pas mal d’inepties et même commettre pas mal d’actions comme autant de coups d’épées données en eaux troubles.
Longtemps nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Ce qui nous a fait dire pas mal d’inepties et même commettre pas mal d’actions comme autant de coups d’épées données en eaux troubles.
Le monde se fout des postillons et des postillonneurs comme de Colin-Tampon. Quelquefois même, pour un petit coup reçu, un peu plus appuyé et énervé que les autres, il vous balance un savant uppercut qui vous met K.O pour un bon bout de temps.
Il a sa logique que la logique ne comprend pas, le monde. Il a aussi sa longévité, son immensité et sa complexité que l’éphémère, la petitesse et la simplicité de l’individu n’entrevoient que très partiellement mais, hélas, toujours de façon fort péremptoire.
Le recul et la sagesse commandent donc, - si tant est qu’on ait pris la ferme résolution de ne pas mourir un jour aussi con qu’on a vécu - de revoir toutes ses prétentions révolutionnaires à la baisse et surtout, dans la solitude des petits matins clairets, d’imaginer, sourire aux lèvres, cinq minutes seulement, ce que nous aurions fait de mieux dans un monde supposé meilleur.
Si on n’est pas définitivement pourri au point de mentir même dans un face à face intime, (ou trop con pour se comprendre vraiment tel qu’on est) la réponse tombe, limpide : rien. Absolument rien. Parce que nous ne connaissons rien aux implications, aux engrenages des sociétés et surtout aux désirs profonds des hommes qui cohabitent avec nous sur la grande boule bleue. Nous supposons tout ça. Nous le supposons ex cathedra. Parce que, aussi, notre vide et notre impuissance sont à l’intérieur, notre puissance et notre volonté de vivre également. Accuser le canevas social du monde, son organisation, ses injustices, son immoralité, ses guerres, ses embrouilles, de notre tristesse et de nos échecs, c’est accuser, pour une bonne part, le miroir quand il nous renvoie une gueule que nous voudrions plus harmonieuse. C’est se dédouaner de soi et on comprend bien que ce soit plus facile de chercher la clef de son énigme sur des manifestations extérieures, auxquelles nous ne participons pas sinon par une vaine parole, plutôt que dans ses propres dispositions à vivre, dans sa propre éthique et dans ses propres désirs.
Le comble est alors de briser le miroir. Plus de sale gueule en face ! Mais le passant qui vous croisera dans la rue l’instant d’après vous trouvera toujours aussi disgracieux.
Ainsi m’amusé-je des discours. De tous les discours. De ceux de la rue, de ceux des bouffons politiques, de ceux de la presse comme de ceux des blogs, ces derniers classés au rang des pires sans doute. Car si on peut comprendre l’intérêt immédiat et réel que peut avoir un politique, un journaliste ou un hâbleur légèrement pris de boisson et accoudé au zinc du café du commerce, à interpréter le monde de façon fallacieuse et lapidaire, on ne comprend pas trop bien pourquoi et dans quel but un blog ou un site persiste à vouloir assener ses erreurs d’interprétation et ses vues étriquées comme autant de vérités définitives ? Quel rôle dans le monde ? Quel impact ? Quels et quelles imbéciles, sinon ceux et celles qui lui ressemblent, cherche-t-il à séduire ? Et pourquoi vouloir séduire des gens qui sont tout disposés à prendre vos patins parce qu'ils ne savent pas se chausser eux-mêmes ?
Déjà, donc, l’impropre de l’endroit pervertit le propos.
Une des grandes questions - elles sont légion - qui préoccupe aujourd’hui les Bons Samaritains de la parole sans verbe, c’est l’avenir de ce qu’on a très vite appelé le printemps arabe. Son avenir, excusez-moi du peu, était déjà prisonnier de la métaphore, piètre et usée jusqu’à la corde, un printemps étant, de par la physique universelle du grand mouvement des choses, caduc et même très court. Les tenants du propos spectaculaire manquent vraiment d’imagination poétique. Il y a quarante-trois ans, on parlait déjà du printemps de Prague, dont les premiers rameaux furent broyés comme on sait. Anyway…Un printemps reste un printemps. Un truc qui sent bon mais sur les lauriers duquel il n'est pas sérieux de s'endormir.
Alors je lis sur un site d’information que la presse s’inquiète d’un horizon qui se dessinerait islamiste en Tunisie et en Lybie….On peut décoder ainsi - parce qu’on n’a quand même pas trop le temps à perdre avec ces conneries - : putains d’Arabes de merde, on les libère de leurs dictateurs et ils la ramènent avec leur dieu ! Pouvaient pas s'en choisir un vrai, de dieu, un comme le nôtre par exemple, normal, avec une grande barbe, blanc, démocrate et pas méchant pour un sou (oublions les bûchers, les croisades, les langues arrachées, l’Inquisition, les crimes, l’interdiction des livres, l’asservissement du peuple 10 siècles durant par le clergé, le grain de blé arraché de la bouche du vilain par une dîme assassine, les vierges violées dans d'infâmes couvents etc.) Oublions tout ça ! Ces vils Sarrazins avec leur printemps à la noix sont en train de nous compliquer l’existence avec leur dieu raciste et qui pourrait bien, en plus, leur enjoindre de poser des bombes !
La plupart des aboyeurs, presse et blogs confondus, oublient les arguments constitutifs de leur propre insignifiance. C’est-à-dire qu’ils brandissent le couteau par la lame et se blessent forcément le fond de la main. Ils oublient que ce n’est pas eux qui votent chez les autres, que le mot démocratie n'est pas une recette de cuisine qui, forcément, fait bouillir les carottes qu'on attend, que les peuples ont le droit de disposer de leur destin, celui-ci ne rentrerait-il pas dans les canons idéologiques des cervelles occidentales. Ils oublient, même ceux qui font mine de n’être point porteurs de la morale chrétienne et, peut-être, surtout eux, que leur morale apodictique n’est pas universelle, que ce qui leur semble juste sous cette latitude est peut être perçu comme injuste sous telle autre.
Ce qu’on voit là-dedans, c’est la bêtise crasse qui persiste à se voir comme le nombril du monde sans rien comprendre ni au monde ni à ce qu’est réellement un nombril. Et, de la presse de gauche aux blogs de gauche ou d’extrême gauche, on peut lire ce qu’on entend dégouliner de plus infâmant de la gueule écumante de l’extrême droite : ah, valait mieux les dictateurs, tiens !
Et qu'on ne fasse pas le philosophe en me disant, oui, mais on ne pense pas pareil, nous, et gnan gnan gnan...La parole est une herbe folle qui, quand elle a le même parfum, pousse forcément sur le même terreau.
Et même cette Le Pen-là a plus de courage que tous ces velléitaires de la bonne fausse conscience : car elle le dit au moins avec des mots clairs, sans ambages. Elle annonce la couleur et n'a point honte de ses contradictions. Chez les autres, qui ont pourtant la même cervelle et les mêmes vues approximatives, on avance masqué. Il faut lire du subliminal. Même pas le courage - ou plus exactement l'intelligence de percevoir - les conséquences désastreuses de leur désastreux discours.
Car savez-vous lire ? Connaissez-vous la belle et dansante clarté des mots ? Oui ? Alors lisez cela, paru dans Libération, journal de gogôche : "la fin des dictatures du monde arabe risque d’installer l’Islam politique au pouvoir."
La fin des dictatures = risque…On a risqué la fin des dictatures, imprudents que nous sommes ! Parallèle flamboyant entre dictature et Islam politique…Mais c’est qu’ils seraient prêts à harnacher des destriers, ces cochons-là, pour chevaucher jusqu'aux déserts et raccourcir de l’infidèle !
Connards, journalistes et blogueurs réunis, qui veulent nous dire un monde sur lequel ils ne voient planer que l’ombre misérable de leur misérable nez !
Car de tout ça, auquel je ne comprends pas grand-chose, il faut s'en foutre et s'en contrefoutre complètement !
L’ignorant qui s’en fout est tellement plus attachant et tellement moins dangereux que le faux-savant qui fait le passionné ! Mon voisin malade, mon ami qui souffre d’un déplaisir amoureux, ma fille qui me demande pourquoi Treblinka, me tracassent bien plus et me mobilisent bien plus utilement. Car je peux dire sans public, aider peut-être, éclairer un peu j'espère.
Un autre jour, contre ce même mode de l’aliénation à vouloir dire, avec la parole décharnée du déjà-vu, un monde où manifestement on ne comprend goutte, je vous parlerai d’un tout autre sujet : la chasse, honnie des bien-pensants et des mêmes derviches tourneurs du vide confortable et de la conviction par procuration.
Image : Philip Seelen
08:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.10.2011
Henryk Sienkiewicz

C’est une saison de bascule, qui oscille entre deux partis à prendre, qui fait semblant de diffuser un reste de lumière d’été tout en peignant furtivement les paysages en blanc, sous les gais cristaux des gelées matinales.
C’est une saison entre l’intérieur et l’extérieur, entre le chien et le loup. Il reste encore un peu de temps, avant les grandes réclusions derrière la nuit tombante des milieux d’après-midi, pour explorer des surfaces encore inconnues.
Quiconque aura vécu dans sa chair le déracinement de ses souvenirs, l'ailleurs de son soi, saura cette soif d’habiter les lieux de la transplantation en les arpentant, en les tutoyant des yeux, en fouillant leur mémoire. Habiter, c’est d’abord s’approprier. Faire que son corps, son âme, son être, respirent en même temps que le Grand Tout immédiat.
Combien de gens, hélas, n’ayant jamais fait que le tour de leur jardin, n’ont cependant jamais habité nulle part parce que n’ont jamais fait battre leur cœur à l’unisson de leurs endroits ! Même pas dans leur lit ! Souvent parce qu’ils n’ont pas su revoir leurs ambitions à la baisse, toujours intoxiqués par une identité tronquée et bien sûr de qualité supérieure à celle du facteur, du charcutier ou du paysan du cru ! Quand ils se mettent en devoir d'écrire, ces gens-là, ça ne ressemble en rien à leur vie, on se demande bien du haut de quelle cathédrale ils prennent la parole, il y a affreuse dichotomie, discordance pénible, et, n'écrivant rien sur rien, ils en arrivent à peindre le monde en rien, sur leurs pages autant que dans leur vie, entraînant en même temps leurs proches et leurs lecteurs vers le vertige du vide absolu, qui leur plaît bien et les console à bon compte de leur propre désert.
C'est ce que je pensais hier, en roulant tranquillement sur Radziń Podlaski, Kock et Łuków. A la recherche d’un écrivain célèbre. Une partie du territoire sans grand intérêt du point de vue de l’esthétique, plaines sans forêt, seulement morcelées par des bosquets de grands pins et de vieux bouleaux. Mais, quelque part dans un village qui demande pas mal de détours, de marches arrière et de demi-tours pour y accéder, il y a la maison natale de Henryk Sienkiewicz. Son premier berceau. Toujours émouvant de marcher sur les pas d’un lointain, très lointain compagnon de la plume. Surtout dans un village embaumé par le silence d'automne.
Petit manoir isolé au toit de bardeaux délicats, avec les reliques de l’écrivain, son œuvre, de vieux livres, des manuscrits, des lettres, des photographies, de vieux objets lui ayant appartenu, ramenés de France, d’Afrique ou d’Italie. L’éternelle panoplie un peu morne des musées.
Jagoda connaît Sienkiewicz mieux que moi, Potop, W pustyni i w puszczy, Ogniem i mieczem * n’ont pas de secrets pour elle. C’est assez surprenant ce goût qu’ont les enfants pour Sienkiewicz ! Et elle était aux anges d’apprendre que W pustyni i w puszczy a été rédigé pour tenir une promesse faite à une gosse de 9 ans - qui lui faisait le gentil reproche de n'écrire que pour les adultes - de publier un livre dont elle serait l’héroïne et qui s’adresserait aussi bien aux grands qu’aux enfants.
Intellectuellement, beaucoup plus par une connaissance générale, spéculative, que par une lecture approfondie, je sais que le succès que connut l’écrivain est dû au fait que dans une Pologne étranglée, soumise, rayée de la carte, à une époque d’assassinat de toute la culture polonaise, Sienkiewicz écrivait des sagas sur les moments les plus glorieux de l’histoire de son pays et que ses compatriotes, qu’ils soient sous la botte russe, autrichienne ou prussienne, éprouvaient alors à son égard une profonde reconnaissance.
J’ai corrigé aussi, hier, une erreur que je tenais pour vérité définitive, (une de plus !) et que je vois ce matin donnée par Wikipédia comme étant du bon pain ; Wikipédia qui, quand même, devrait se renseigner plus profondément avant de publier quoi que ce soit sur qui que ce soit, tant cet outil est devenu outil de références pour ceux et celles qui, pressés par l'ignorance et l’à-peu-près, veulent faire mine de tout savoir en faisant l’économie de l’essentiel ** : L’écrivain n’a pas reçu le prix Nobel de littérature pour le fameux Quo vadis, d’abord publié en feuilleton dans Gazeta Polska, mais pour l’ensemble de son œuvre.
Les documents officiels de Stockholm en attestent.
* Le déluge, Dans le désert et la forêt, Par le feu et par le fer.
** Me fait penser à une boutade d’un écrivain de SF contemporain, Polonais, dont j’ai oublié le nom : Si je n’avais pas Internet, j’ignorerais combien la terre est peuplée de crétins !
14:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.10.2011
Ecrire avec le retour des mortes saisons
 L’automne continental ouvre grand les portes de l’hiver. Lui offre un boulevard princier où il pourra s’engouffrer selon son bon plaisir, lui déroule un tapis rouge et or. Déjà les gelées, encore modérées, vers moins six, mais le soleil du matin, qui brûle la tige des feuilles, en précipite la chute.
L’automne continental ouvre grand les portes de l’hiver. Lui offre un boulevard princier où il pourra s’engouffrer selon son bon plaisir, lui déroule un tapis rouge et or. Déjà les gelées, encore modérées, vers moins six, mais le soleil du matin, qui brûle la tige des feuilles, en précipite la chute.
J’ai allumé les grands poêles et la chaleur a fait fondre sur les vitres les premières étoiles de givre. Déjà deux semaines que les grands bohémiens des nues, le cou tendu vers l'ouest et vers le sud, ont traversé mon bout de ciel. Les Polonais disent Klucz, la clef, là où nous disons le V ou le triangle. La clef des grands espaces, de l'espoir de survivre ? La clef des chimères lointaines ? J'ai dans la pénombre d'un soir entendu cacarder leur désespérance.
La forêt, sur l’horizon tout proche, se dépouille un peu vite, avant même d’avoir revêtu convenablement ses habits de lumière. Dans les sous-bois tranquilles, on entend tomber les feuilles, un bruissement, comme celui que ferait une fine ondée. Il pleut des feuilles.
C’est encore la saison des multicolores, comme une sorte de soubresaut de résistance juste avant la bichromie des grandes intempéries. Du noir et du blanc. Le monde imprimé en négatif et l’œil endormi des hommes qui se reposera à errer sans conviction sur cet essentiel, sur cette mort sporadique, éternelle, des paysages.
Ainsi s’inscrivent les saisons au compteur de nos vies. Ecrire ces repères. Les mortes saisons sont les couloirs de l’écriture.
L’hiver dernier, j’avais écrit mes dix nouvelles du Théâtre des choses, ici même, sur ce bureau que la fenêtre regarde. Avec de la neige partout qui reflétait la lumière tantôt grise, tantôt bleue, tantôt gris-bleu du jour. Maintenant qu’elles sont devenues un livre, ces nouvelles, elles ne sont plus de chez moi. Elles ont coupé le cordon ombilical. Mais si je dis : Le Théâtre des choses, je vois toujours leur berceau initial, cette fenêtre, ce bureau, ces livres qui sont notre compagnie, cette chaleur diffuse des poêles, ce silence du village, ces oiseaux qui voltigent sur les branches gelées.
Ecrire, c’est dire. Après, c’est se souvenir de comment on a dit.
Pour la première fois, j’écrivais l'an passé avec la certitude que ce que j’étais en train d’écrire serait publié. Etait attendu. C’était d’un confort à la fois exquis et un peu angoissant. Même sans échéance précise, savoir que le fruit d’un travail qui, par essence, est profondément solitaire, est attendu, vous soulève un peu de votre chaise. Vous extrait un peu de vous-même, de la confrontation d’avec vous, comme si un regard en même temps que le vôtre suivait par-dessus votre épaule le fil de vos récits.
Cette année, avec la chaleur du grand poêle dans mon dos et toujours la même fenêtre devant moi, bientôt les mêmes mésanges se disputant un bout de lard aux noisetiers suspendu, la certitude que mon travail fera un livre est encore plus grande, et la difficulté aussi. Donc. Plus grande aussi parce que je ne pensais pas qu'un jour je signerai un contrat en bonne et due forme avant d'avoir terminé, voire à peine commencé, mon livre.
Car réécrire des contes et légendes pour le compte d’un éditeur qui n’est pas du tout un éditeur de littérature n’est pas chose très facile. L’embarras naît du refus de sombrer dans la vulgarité du salariat, dans l’alimentaire exclusif. Dénicher, quelque part, dans ce travail de commande stricto sensu, le plaisir de réécrire une histoire, une légende. Convoquer des mémoires ataviques et faire qu’elles se sentent bien chez moi. Et comme les modèles sur lesquels je m’appuie ont voulu rester le plus près possible de la transmission orale, trouver la juste mesure entre le coeur de l’histoire légendaire - car c'est ça la commande- et la liberté, quand même, de faire de la littérature qui me soit personnelle.
Presque une gageure. Mais écrire, simplement, n’est-ce pas déjà un pari avec soi-même?
13:18 Publié dans Acompte d'auteur, Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.10.2011
Stéphane Beau : Voyage au bout d'une nuit
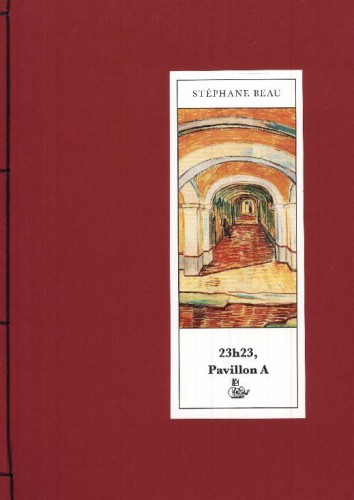
C‘est un univers où l’angoisse règne en permanence. Je veux dire normalement, de fait et de raison d’être, ceux qui ont eu le mal heur d’y être un jour gracieusement invités à faire un petit séjour de rééducation autour des normes sociales comprendront au centuple.
C'est donc un tel univers et c'est celui du dernier opus de Stéphane Beau, 23h23, Pavillon A.
Mais l’écrivain est assez subtil pour nous introduire en ces hauts lieux de l’irréalité permanente avec une dimension supplémentaire d’irréalité. D’onirisme même.
A la faveur d’une étrange panne d’électricité, panne d’autant plus immatérielle qu’elle touche même les appareils qui ne puisent pas d’ordinaire leur énergie aux compteurs EDF, tels que les lampes solaires, les portables ou les radios-réveil, trois détenus se retrouvent soudain complètement seuls. Une solitude effroyable : plus un « malade », lits vides mais défaits, plus de personnel, plus rien, plus âme qui vive, sinon eux, et tous les objets du quotidien comme pétrifiés dans un instant de leur utilisation, un peu comme à Pompéi.
On prend peur. On se rappelle qu’au début, Georges, un des rescapés du silence et de l’obscurité, a entendu comme un sourd bourdonnement. On craint alors que le récit ne s’enlise dans une dimension convenue de fin du monde, soudain anéanti par des voyageurs intersidéraux.
On prend peur mais on est vite rassuré. Stéphane Beau a le talent de faire semblant de nous emmener vers un poncif, juste pour que son récit prenne corps et, déroutant, nous ouvre soudain des portes que nous n’attendions pas, celles de la profonde humanité de ces trois êtres mis en présence les uns des autres à la faveur d’un événement qui, d’essentiel, est en train de passer astucieusement au second plan.
Le personnage principal, ici, c’est le noir total, l’obscurité. Car c’est grâce à cette obscurité que se révèlent les personnages, aussi bien à eux-mêmes qu’à celui qui les suit, de pages en pages. Le négatif se fait photo, l’inerte se fait vivant, l’inhumain du début, malade, claudiquant, un peu misérable, prend toute sa dimension humaine, si forte, si désemparée et si chère à Stéphane Beau.
Récit désespéré ou message d’espoir ? Celui qui n’aime plus les hommes parce qu’ils les a trop aimés sans retour, oscille - forcément - toujours entre ces deux pôles contradictoires de l'impossible synthèse.
Comme dans Le Coffret. Il ne tranche pas la question. Il n’y a pas de question à trancher, d'ailleurs...Il y a, par-delà les faits, les lieux et les contingences, la quête toujours puissante d’un bonheur à notre dimension aléatoire.
On sourit aussi avec 23h23, Pavillon A. Dans une situation où tous les comportements peuvent être de mise, sauf peut-être le rire, Stéphane Beau écorche plaisamment les hit-parades de la littérature contemporaine…
Mais je ne peux vous en dire plus sans risquer de me fourvoyer… Parce que, in fine, l’écrivain nous quitte avec un petit air narquois qui semble dire : tout ça, mon vieux, tu vois bien que c’est ton imagination qui vient de le construire.
Il ne s’est rien passé.
Une invite à ne toujours dormir que d'un œil, à peine voilée, en tout cas réussie.
11:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.10.2011
Qu'est-ce que j'en sais, moi, de tout ça ?
 Une guêpe s’est fourvoyée entre les plis et les replis du rideau de la fenêtre. Prisonnière, elle s’affole, cogne la vitre, bourdonne, vrombit, s’agite, s’arc-boute, enrage et tempête.
Une guêpe s’est fourvoyée entre les plis et les replis du rideau de la fenêtre. Prisonnière, elle s’affole, cogne la vitre, bourdonne, vrombit, s’agite, s’arc-boute, enrage et tempête.
L’enfant pousse un cri, repousse ses cahiers et ses livres, se lève d’un bond et appelle au secours :
- Une guêpe, viens vite ! Y’a une guêpe dans ma chambre ! Une grosse guêpe !
Je suis en train d’écrire un conte, de le réécrire plutôt. C’est l’histoire d’un enfant du Poitou, Jean, qui est si bête et qui fait tellement d’innommables conneries, qu’on le surnomme partout Jean le Sot…J’abandonne donc Jean le Sot à ses frasques et me dirige vers la chambre.
- Où ça ?
- Là. Tu vois pas ? Sur la fenêtre…
L’enfant est vraiment effrayée. Je tue l’insecte avec un chiffon. L’enfant pousse un soupir de soulagement, me remercie, se rassoie derrière son bureau et reprend livres et cahiers. Je jette un œil par-dessus son épaule : przyroda, la nature, l’environnement…
Bon.
Jean le Sot…Je me rassois aussi derrière mon bureau, dans l’autre pièce. Je regarde par la fenêtre. Il fait gris, les feuilles déjà marron se balancent entre deux coups de vent. Certaines viennent mourir sur la vitre où ruissellent les premières ombres du soir.
Jean le Sot a reçu l’ordre de sa mère d’aller à la foire de Lussac-les-Châteaux…
- C’est un peu dégueulasse ce qu’on a fait.
Je me retourne sur ma chaise pour voir l’enfant plus loin, dans le prolongement, par la porte ouverte de sa chambre.
- Comment ça ? Qu’est-ce qu’on fait ?
- On tue les animaux, comme ça, sans souci, d’un coup de chiffon… Hop ! C'est fini ! Mais on n’a pas le droit, en fait.
- Ben fallait la laisser dans ta chambre, alors, cette guêpe.
- Oui, peut-être.. Mais on tue et on n’est même pas punis… On n’a pas le droit, je te dis. Les animaux, c‘est des êtres vivants comme nous...
- Oui, bon, d’accord…Mais si elle t’avait piquée cette guêpe, hein ?
- Non … Je ne crois pas…Elle avait pas l’air méchante. T’aurais pas dû la tuer.
-T’en as de bonnes, toi ! Fallait pas m’appeler !
- C’est vrai…
L’enfant regarde dans sa poubelle à papiers où sans vergogne j’ai jeté l’insecte.
- Hé, imagine un peu qu’on aurait vécu à l’époque des dinosaures…On tue les animaux parce qu'on est les plus forts, les maîtres de la terre. Mais à l’époque des dinosaures, on aurait été comme des mouches et ils nous auraient bouffés tout crus, on aurait eu peur de tout… On aurait moins fait les malins. Tu crois pas ?
Je souffle, un peu agacé.
- Oui. Enfin, j’en sais rien.. C’est pas grave tout ça. Allez, fais tes leçons… Et puis, tu sais, les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, alors...C’est ça qui fait la différence, tu vois. Nous, on sait qu’on mourra un jour, alors on s’inquiète, on compte, on voit le temps qui passe vite...Mais les animaux, eux, ils vivent peinards, I s'en foutent de la mort parce qu’ils ne savent rien de tout ça.
- Qu’est-ce que t’en sais, toi ?
Oui au fait, qu’est-ce que j’en sais, moi ? Je me dérobe…
- J'ai lu ça un jour chez un écrivain.
- Lequel ?
- Malraux. Tu connais pas.
- Et il en savait quelque chose, ton Malraux ? Il parlait aux animaux ?
-Non, bien sûr que non. Il supposait.
L’enfant est perplexe.
- Alors, comme ça, les écrivains disent des choses qu’ils ne savent même pas ? J’espère que tu sais, toi, que c’est vrai ce que tu écris...Que tu racontes pas des bêtises comme ça.
- Heu…Bon, faut que je travaille.
Jean le Sot se rend donc à la foire de Lussac-les-Châteaux… Je n’y suis plus. Il m’ennuie, à la fin, ce Jean le Sot ! Je sors fumer une cigarette.
La nuit tombe sur les toits du village.
Y’a comme un brin de tristesse dans ce crépuscule brumeux. Mais c’est un brin de tristesse qui me fait sourire.
13:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.10.2011
Le Théâtre des choses
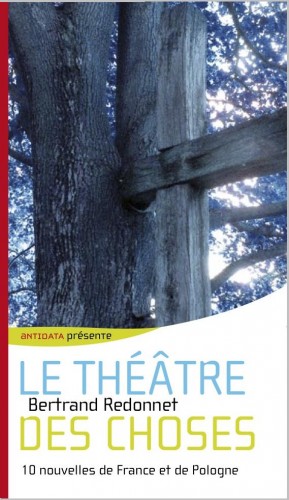
Plaisir d’être lu et plaisir d’en recevoir un nouvel écho, après ceux de Marc Villemain, d’Armelle Domenach, de Roland Thévenet et de Stéphane Beau.
C’est peu, vous me direz, quantitativement parlant. Mais ils sont de qualité, ces échos, ce qui est beaucoup et surtout essentiel.
Par ailleurs, Roger Vailland étant un de mes auteurs de prédilection, en particulier avec Les Mauvais coups, 325 mille francs et Ecrits intimes, je signale qu’Elisabeth Legros-Chapuis collabore à un excellent site dédié à cet auteur. Ici.
Et je saisis cette occasion pour dire brièvement que si Vailland est aujourd’hui quelque peu délaissé par les fines bouches de la littérature, c’est, en partie, parce qu’il a su déplaire aux libertins en étant communiste et aux communistes en étant libertin.
Deux redoutables antinomies sans doute.
Il n’en reste pas moins que la force humaine, désespérée, de ses textes conserve toute son intégralité.
Et puis, là-bas, dans mon lointain Poitou où, peut-être dansent comme ici les brouillards indécis de l'automne, Yves Revert me consacre également ce matin un article dans La Nouvelle République.
L'image envoyée par un ami vigilant étant peu lisible, l'article est disponible sur le site du journal, ici.
Me demande quand même si le jeu de mots du titre est fortuit. Car, dans tous les métiers que j'ai pu faire, j'ai quand même su éviter celui peu ragoûtant de gigolo ou, plus anodin, celui d'employé EDF.
En tout cas, merci à Yves Revert.

13:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.10.2011
Considérations non intempestives, récurrentes et dans un désordre organisé
MÉZIGUE
 - Considérations bien ordonnées commencent toujours par mézigue.
- Considérations bien ordonnées commencent toujours par mézigue.
- Je me méfie des êtres cohérents. Ils sont immobiles. Tétanisés par l'effort.
- Chaque fois que j'ai voulu être cohérent, je me suis contredit. Comment pourrait-il en être autrement ? La totalité d’un être est d’abord chaotique.
- Un ami très proche, un jour aux prises avec les tourments de l'amour resurgi impromptu sous ses pas débonnaires, m'avait ingénument demandé, dans son désarroi, ma conviction du bonheur.
C'est l'absence de tourments, avais-je assuré.
Tout un programme. Mais ça ne l'avait pas beaucoup aidé. Au contraire.
- Un homme qui ne boit que de l'eau a des secrets à cacher à ses semblables" écrivait Baudelaire dans Les Paradis artificiels. Certes.
Mais un homme qui ne boit que du pinard dit tellement de conneries que c'est lui-même et tout entier qui se fait énorme secret, une sorte d'énigme parfois déroutante, parfois plate comme une limande.
Pour avoir longtemps et alternativement pratiqué les deux extrêmes, je sais de quoi je cause.
- Le désespoir ne frappe que ceux qui espèrent. Voilà une évidence que j’ai mille fois brassée dans mon cœur.
- Quand je séduis tout le monde, je suis certain de ne plaire à personne.
- La relation qu'on a à soi ne diffère pas de celle qu'on entretient avec le monde.
A moins que les deux ne soient fausses.
- Aucune valeur au monde ne peut exiger que nous nous endormions dans l'ennui.
Vient un moment où il faut, avec joie, larguer les amarres.
Même celles, et peut-être surtout celles, que nous pensions être ancrées le plus profondément en nous et par nous.
- Je vis dans une organisation humaine qui ne me convient pas. Cela suffit pour que je puisse affirmer sans erreur qu'elle est mauvaise.
Mon bonheur est alors forcément subversif.
Un parti pris.
- Je ne suis pas anarchiste : je me sens profondément anarchiste et je m'aime anarchiste.
- Les seuls gens avec lesquels je ne me suis jamais disputé sont ceux à qui je n’ai jamais adressé la parole, ni même le moindre écrit. Ces derniers étant de très loin les plus nombreux, j’en déduis mathématiquement que je dois avoir un très bon caractère.
Ce dont je me félicite.
- La fourberie consiste à ne dire vraiment ce qu’on pense que lorsqu’on ne pense vraiment rien.
- Ce qui me tourmente toujours : cette mathématique de notre modernité éclairée où l'espérance de vie qui n'en finit pas de s'allonger est inversement proportionnelle à l'espoir de vivre.
- Toute ma vie, j'aurai eu peur de la mort....
Me reste plus qu'à espérer n'avoir pas peur de la vie toute ma mort…
- Mes amis me comprennent mieux quand j'abonde dans leur sens.
Mes ennemis aussi.
- La laideur pour moi c'est quand l'éphémère dure.
- Quand les poètes se feront des voyous et les voyous des poètes, l'espoir aura peut-être une chance de changer de camp.
Pour avoir longtemps fréquenté les uns et les autres, je peux prédire cependant que ce n’est pas demain la veille !
POÉSIE
 - Il n’y a que des pigeons cloués sur leurs perchoirs pour croire qu'un seul battement de leurs ailes puisse les projeter jusqu'aux nuages.
- Il n’y a que des pigeons cloués sur leurs perchoirs pour croire qu'un seul battement de leurs ailes puisse les projeter jusqu'aux nuages.
- La poésie c'est peut-être le monde sans ses fonctionnalités. Autrement dit, les fleurs sans la botanique, l'amour sans la gynécologie et la mélancolie sans la psychologie.
- S'il convoite de belles chaussures, hélas trop grandes pour lui, le poète est celui qui accusera la petitesse de ses pieds.
L'émoi est d'autant plus fort que la contrariété est insurmontable.
- Le poète est sans doute celui qui lit le monde avec le magma qu'il porte en lui. Les mots sont ses lampes de chevet.
Quoiqu'il arrive souvent qu'il lise et écrive dans le noir.
- On ne devient pas poète. On naît poète. Pas génétiquement bien sûr, ce serait effrayant et idiot.
On naît poète comme le chiendent pousse sur certains sols et certaines ruines et pas sur d'autres. Après seulement intervient le devenir : on laisse chanter ce poète ou on lui tord le cou.
- Le poète est souvent amoureux de l'impossible. Il n'est guère payé de retour.
- Je ne conçois de poésie que subversive.
C'est la lecture d'un parcours personnel. Conception réductrice ? L'histoire inclinerait en effet à ne me donner que très, très, partiellement raison.
- Le poète qui devient riche ou (et) qui compose avec les douloureuses compromissions sociales n'en cesse pas pour autant d'être un poète.
Qu'il en souffre ou non est du domaine de l'intime et, en dernier ressort, de l'éthique intime.
- La vie d'un poète est forcément en dents de scie, chaotique, décalée à l'intérieur, voire partout.
Ce qui ne signifie pas que toute vie chaotique soit celle d'un poète. Sans quoi les conditions pitoyables d'existence qui nous sont imposées n'auraient produit que des poètes.
- Je ressens la poésie comme étant très accessoirement une écriture et essentiellement un art de vivre. Encore une évidence qu'on se refuse à brasser. Bien évidemment.
ÉCRITURE :
 - Je demande à mon écriture de me ramener chez moi, à mes lectures de me conduire chez les autres.
- Je demande à mon écriture de me ramener chez moi, à mes lectures de me conduire chez les autres.
Mais il arrive que les rôles soient inversés.
- Les imbéciles faisant les intellectuels et les intellectuels faisant les imbéciles se rejoignent souvent pour s'extasier devant un chef-d’œuvre.
- Un homme qui lit peut se dispenser d'écrire. Fort heureusement.
Mais un homme qui écrit et qui se dispenserait de lire serait comme un muet qui tenterait de s'égosiller.
- Il y a déjà quelque temps, à l’époque de mon Zozo, chômeur éperdu, j’avais reçu la lettre d'un éditeur qui disait vraiment : "J'ai parcouru votre manuscrit avec beaucoup d'attention..."
Y'a quand même des lapsus-oxymores qui mériteraient véhémentes corrections.
- L'écriture n'a pas de rôle en dehors de celui qu'elle s'assigne elle-même. C'est la lecture qui a un rôle social.
Et il n'y a là-dedans aucune dialectique de la poule et de l'œuf, tant il arrive souvent qu'on ne lise pas exactement ce qui est écrit.
- La belle écriture est celle qui a la précision d'une partition, celle qui ne prête pas à la cacophonie des interprétations.
Elle se situe donc par-delà le style, mais avec style.
- La littérature qui a des prétentions érotiques se met deux fois le doigt dans l'cul. Elle n'est en général ni littéraire, ni érotique.
- On ne nourrit pas de noirs desseins sur un écran blanc.
- Beaucoup d'écrivains, ou (et) d'artistes d'autres disciplines, ont un rapport baudelairien à l'environnement urbain. Interprétation distanciée de sa laideur et lecture poétique du désordre névrotique de la ruche.
Je ne conçois rien de la ville qui puisse m'émouvoir.
Mes sentiments sont essentiellement champêtres.
Néolithiques, presque.
- Un écrivain qui s'ennuie peut-il écrire autre chose que des choses ennuyeuses ?
- Certaine modernité toujours encline à câliner la langue dans le sens du bon goût, celui qui privilégie l'apparent au détriment de l'essentiel, commande que l'on dise désormais un tapuscrit.
Ira-t-elle jusqu'à qualifier quelqu'un de beau clavier ?
Je verrais bien aussi un écrivain déclarer qu'il a tapé son livre en un an.
Combien de livres a tapé Machin ? Qui a tapé tel roman paru chez un tel ? C’est un beau clavier, ce tapeur-là !
Une écriture tapée. Sans doute ne croit-elle pas si bien dire, la modernité.
- On écrit parce qu’on ne supporte pas de penser, d’aimer et de souffrir sans que tout le monde le sache.
L’écrivain n’est peut-être , in fine, qu’un bavard vaniteux.
- J’ai eu le malheur, il y a une trentaine d’années d’être détenu quelques jours dans une HP - après altercation avec les forces de l'ordre - dont je me suis évadé, la nuit, avec la complicité de quelques amis de mon acabit.
J’ai pensé à Kafka. Pour rien au monde je ne l’aurais lu à ce moment-là. On ne lit pas sa souffrance dans la souffrance, on n’écrit pas non plus sa souffrance dans la souffrance.
Inutilité et vanité du témoignage littéraire. L’écriture est un art à contretemps. Séparé de son propos.
ART
 - Une étude sérieuse - je ne dis pas qu'elle fut utile - en est arrivée à conclure que quatre-vingt-dix pour cent des gens, dans l'intimité et par un réflexe encore inexpliqué, contemplaient les souillures laissées sur le papier après défécation.
- Une étude sérieuse - je ne dis pas qu'elle fut utile - en est arrivée à conclure que quatre-vingt-dix pour cent des gens, dans l'intimité et par un réflexe encore inexpliqué, contemplaient les souillures laissées sur le papier après défécation.
Difficile de trouver art plus primitif et plus unanime.
- Le cinéma est un art tributaire de la musique. Il ne sera donc jamais fidèle à ce qu'il prétend vouloir dire.
Dans vos situations - que vous ayez à les affronter ou à en jouir - avez-vous une musique derrière vous pour les faire plus authentiques et plus fortes encore ?
Que diriez-vous d'une musique qui aurait forcément besoin d'images pour transmettre son émotion ?
- Il ne me déplaît pas d'être considéré comme béotien.
Je n'ai jamais su vraiment ce qu'était un chef-d’œuvre.
Certains monuments jugés incontournables de la littérature m'ennuient profondément tandis que des hors-d’œuvre ont su me transporter.
En peinture, une croûte peut m'inspirer alors que je trouve la Joconde carrément moche.
En musique, je n'ai jamais pu écouter jusqu'au bout un grand classique, sinon peut-être Vivaldi.
En archi, sorti du gothique flamboyant, et encore, je ne connais rien.
En cinéma, c'est la catastrophe. Outre que je déteste la promiscuité des salles, ma prédilection irait aux westerns série B, avec des fourbes et des justes qui se canardent à qui mieux mieux.
AMOUR
 - L'amour qui ne convoque pas chaque matin une muse à son chevet, sombre dans l'institution.
- L'amour qui ne convoque pas chaque matin une muse à son chevet, sombre dans l'institution.
- Dans le couple, quand un, ou une, décide de s'envoler vers des horizons plus grands, c'est un mort inachevé qui prend la parole. Un, ou une, qui "ne reconnaît pas le bien-fondé de son trépas".
- Quand on refait sa vie, selon l'expression bien mal consacrée, on ne refait strictement rien du tout qu'on aurait déjà tenté de faire. On ne fait que ce qu'on avait oublié de faire.
- Je ne hais personne, même pas mes ennemis, ça rend trop malheureux.
Je n'aime pas grand monde non plus, ça ne rend pas assez heureux.
- La fidélité en amour ?
Toutes les grandes passions amoureuses naissent pourtant d'une infidélité. Tout cela n’est donc que repères personnels sur parcours personnel.
POLITIQUE ET IDÉOLOGIE
 - Je ne cherche pas à démonter les mécanismes et buts d'un système pour le plaisir intellectuel de démonter ou parce que j'aurais une certaine idée morale de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. C’est beaucoup plus simple, moins méritoire et plus ambitieux.
- Je ne cherche pas à démonter les mécanismes et buts d'un système pour le plaisir intellectuel de démonter ou parce que j'aurais une certaine idée morale de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. C’est beaucoup plus simple, moins méritoire et plus ambitieux.
Je cherche à dénoncer, pour ma gouverne et en tant qu'acteur-témoin de cette époque, en quoi les multiples ramifications de ces mécanismes et de ces buts, sont des obstacles à vivre pleinement ma vie, telle de plaisir que j'estime qu'elle vaille la peine d'être vécue.
- Il ne s'agit pas pour nous-autres d'énoncer des choses nouvelles, d'annoncer une nouvelle théorie qui éclairerait la vie d'une lumière jusque là inconnue.
Il s'agit d'administrer un rappel obstiné contre l'aliénation ambiante, de faire savoir, ne serait-ce qu'en murmure, que nous sommes encore quelques-uns à ne pas être dupes et à ne pas vouloir mourir de notre défaite.
Il s'agit de dire encore et encore, après des milliers d'autres hommes, que la fumisterie ambiante est essentiellement caduque et non, comme voudraient le laisser bêtement croire tous les tenants du pouvoir et ses aspirants, l'histoire achevée.
A ce titre, nous n'avons ni adversaires ni amis préconçus. Nous n'avons que faire des soi-disant classes sociales. Car nous savons pertinemment qu'il y a partout des charognes et partout des hommes et des femmes préoccupés de l'intégralité de l'existence.
- L'Europe est une idée qui s'est imposée au capital de même que l'abolition des anciennes provinces de la royauté s'était imposée aux intérêts de plus en plus exigeants de la bourgeoisie révolutionnaire.
Je ne perçois donc dans tout ça aucune grandeur de vue dont puissent se targuer les hommes : est-ce que le berger conduit son troupeau dans un pacage plus dru et plus vaste pour faire plaisir aux brebis ou pour qu'elles lui soient d'un meilleur rapport ?
- L'idéologie est ce prisme déformant qui appréhende le réel de telle sorte qu'il puisse apparaître comme la preuve a priori du bien fondé de sa propre existence. Pour ce faire, le prisme s'évertue à remplacer la vie par l'abstraction non-vécue de la vie, à inverser tour à tour les causes et les conséquences, à maquiller les postulats en conclusions, bref à changer le magma en fumée.
- Le fondement de toute idéologie est la poursuite d'objectifs, clairement énoncés ou non-dits.
Ces objectifs une fois atteints, l'idéologie continue de bénéficier pour un temps de l'élan qui l'a portée jusque là. Elle atteint ainsi le point extrême de surbrillance au-delà duquel elle ne peut plus faire illusion.
Ce après quoi elle s'écroule d'elle-même sous les effets dévastateurs de son propre triomphe.
Si elle n'est auparavant clairement dénoncée et combattue, l'idéologie n'avoue donc son caractère fallacieux que dans sa réalisation.
- Le mot peuple est un mot en mouvement, un concept de l'irruption.
Il désigne des gens lassés des conditions faites à leur existence, de quelque horizon social qu'ils viennent et à quelque strate de la hiérarchie qu’ils appartiennent. Des gens qui prennent d'assaut les palais du mensonge, par les armes et par la voix, renversent les statues, brisent les interdits, voire coupent des têtes, parce qu'ils exigent que leur soit restituée la poétique initiale de leur vie.
En période de révolte, le mot peuple désigne l'instigateur et l'acteur de la mutinerie sociale.
En période de modus vivendi, il ne signifie qu'un terreau vague, un tas de fumier sur lequel guignent les politiques pour y ensemencer à bon compte et dans l'endormissement général les graines de leurs misérables ambitions.
- Au stade où nous en sommes du brouillage des cartes dans la conduite de nos vies, l'inversion est quasiment consumée entre le superflu et le nécessaire.
- Les grands bouleversements sociaux sont intuitifs. Leur pérennité, tout comme leur caducité, est discursive.
- Mai 68 : La honte d'exister soudain transformée en fierté d'être.
Le reste est verre d'eau dans lequel se noie l'affrontement discursif d'idéologies diverses.
- Le mensonge est bien sûr la vérité falsifiée, mais pas seulement.
L'évolution du pouvoir spectaculaire l'a conduit du subtil non-dit au mensonge délibéré, puis du mensonge délibéré à l'affabulation pure et simple.
Sous les applaudissements nourris, l'ignorance, la complicité ou la résignation intéressées.
L'affabulation allant crescendo, bientôt sera le délire.
- L'image, telle que critiquée par Debord et les situationnistes, atteint les dimensions de sa plénitude dans le discours officiel du pouvoir comme dans celui de tous ses complices, aspirants ou contemplatifs intéressés. On peut dorénavant assener des contre-vérités accablantes, des aberrations grotesques, des contresens ridicules à la barbe du monde entier et ne risquer pour autant qu'un petit murmure éphémère et indigné des chaumières.
Le spectacle à ce très haut degré d'insolence suppose que le mensonge soit tacitement admis de tous, dirigeants et dirigés, comme règle du vaste jeu de l'inversion du réel et comme projet commun d'une disparition de la vie au profit de sa représentation.
- Je ne compte pas assez de doigts aux mains, quand bien même les affublerais-je de mes orteils, pour dire le nombre de courtisans, d'imbéciles, de staliniens repentis, voire d’idéologues de la vieille droite, que j'ai pu croiser et qui, sans vergogne, faisaient l'éloge de la Société du spectacle ou du Traité de savoir-vivre, allant même jusqu'à se réclamer de la justesse de leur analyse.
Comme quoi la grenade situationniste est bel et bien et définitivement dégoupillée.
Comme quoi aussi la justesse d’une théorie devrait toujours être tue, tant elle éclaire le chemin de ses adversaires pour qu'ils la combattent et la tuent.
- Un politique qui serait pris de la fantaisie soudaine de ne pas mentir se retrouverait exactement dans la situation du coureur du Tour de France qui refuserait les intraveineuses. Peinant dans l'ascension, relégué en queue de peloton, zigzaguant lamentablement puis finalement contraint à l'abandon en dépit des encouragements pour la forme de deux ou trois excités Kronenbourg.
- Depuis Nietzsche et dieu, Les surréalistes et l'art, les situationnistes et le vieux monde, les numéristes et le livre traditionnel, je me méfie comme de la peste de ceux qui dissèquent prématurément les cadavres !
- La coexistence pacifique entre la planète, comme lieu de résidence des hommes, et l'idéologie de la croissance est absolument incompatible.
La lutte est permanente et ne peut s'achever que par la mise à mort de l'une des deux combattantes.
Le développement durable est un lapin exhibé de leur chapeau par les escamoteurs du capital en guise de modus vivendi capable de distraire l'attention et pour tâcher de camoufler un temps les douleurs de plus en plus stridentes de la contradiction.
Le développement du râble est un langage qui devrait être réservé aux éleveurs de lapins.
- Ce qu'on appelle écologie n'est que - mais c'est énorme - le reflet idéologico-politique, récupéré et réducteur, d'une exigence première : l'occupation humaine de la planète.
- La mondialisation, concept savamment flou pour le contribuable et pratique quotidienne du banquier, désigne en fait dans ses dernières extrémités, le jardin indispensable à l'âge triomphal du capital.
Cette ultime mainmise sur la planète pourrait s'avérer être le point de basculement, tout comme chez Clausewitz l'effort consenti par le conquérant lors de l'offensive à son point culminant, conduit à l'épuisement de ses forces-ressources, bientôt à son effondrement.
La survie d'un conquérant est cependant toujours fonction de ses nouvelles conquêtes, comme la sauvegarde d'un mensonge est toujours au prix d'un nouveau mensonge.
Les diverses tentatives de conquête de l'espace peuvent être lues comme la recherche de nouvelles richesses à extorquer au cosmos, de nouvelles poubelles à exploiter, voire d'intelligences à asservir.
En un mot comme en cent, comme le projet d'un recul encore plus lointain des clôtures de la croissance répugnante.
- Le rat est un commensal de l'homme, l'homme un commensal du capital.
Des richesses, des miettes et des poubelles.
Equilibre alimentaire trompeur : supprimer le capital ne supprimera ni l'homme, ni le rat. Supprimer le rat, tout le monde s'y attache. Supprimer l'homme, c'est en très bonne voie.
- Pris d'une douloureuse crise existentielle, le site Internet d'une collectivité départementale a titré un jour : A quoi servons-nous ?
Les vraies questions sont souvent posées par inadvertance.
- Même peu reluisante, la crise de foie d'un alcoolique est toujours moins grotesque que la crise de foi d'un catholique.
- Nietzsche est mort.
Signé Dieu
- Si nous vivons le triomphe des idéologies libérales capitalistes, le regain de vigueur de la calotte et le répugnant retour de toutes les valeurs les plus aliénantes pour l'intelligence et la liberté humaines, ce n'est pas au génie des pouvoirs en place que nous le devons mais bien aux systèmes - aujourd'hui déchus - qu'on avait installés un peu partout, principalement en Europe, sous le nom usurpé de "communisme".
C'est en mettant en avant ces faux exemples, en taisant leur sédiment historique et en les introduisant ainsi dans la tête de leurs moutons comme ayant été la réalité du communisme, que le capital et la finance font perdurer leur domination et continuent d'étrangler la vie des hommes par amalgame.
Et pour très longtemps encore : tant qu'il restera un seul de ces communistes-là et un seul de ces prétendus adversaires de ce communisme-là, amusant la galerie chacun avec son usurpation d'identité.
Après, c'est inéluctable, les générations réécriront le mot tout neuf.
Mais pour tout dire, je m'en fiche.
Longtemps que je serai ailleurs.
De l'autre côté des pissenlits.
- Les pommes sont les fruits de la discorde, les poires ceux de l’ordre libéral.
- Depuis quelque temps, des nouvelles enfin humaines et rassurantes sur le front de la crise financière : Strauss Khan avait sauté, en levrette et en chaussettes paraît-il, une soubrette du FMI, ce après quoi, il fut accusé d’avoir violenté sexuellement une dame, femme de chambre de son état, et, dans le même temps, une écrivaine qui, à mon avis, d’écrivaine n’a que le nom - et encore faut-il mépriser profondément la profession pour affubler cette bonne femme de ce titre - assure qu’il a tenté de la violer.
Ça fait beaucoup, tout ça… Les contribuables, eux, s’amusent névrotiquement des faits divers, espèrent de tout cœur que les orgasmes volés ou qu’on a voulu voler seront remboursés au prix fort, ce après quoi, tranquilles et débonnaires, ils baissent le nez et s’en retournent à leur occupation favorite : renflouer les banques.
MÉTAPHYSIQUE ?
 - L'impensé n'est pas l'impensable. Mais je comprends que beaucoup de monde puisse être intéressé par l'amalgame.
- L'impensé n'est pas l'impensable. Mais je comprends que beaucoup de monde puisse être intéressé par l'amalgame.
- Ce qui n'existe que dans mon imagination existe bel et bien et participe de ma vie réelle et des moyens que j’ai pu choisir pour la vivre.
- L’imagination est une autre dimension du réel. Par-delà cette imagination sont les inconnues que j’appellerais volontiers, n'ayant pas d'autres concepts à ma disposition, les abstractions vécues.
- Ce que nous appelons le réel n'est qu'une dimension de nos possibilités.
- L'éternité est une dimension de la poésie confisquée, dénaturée, désamorcée par les religions et leur dieu omnipotent.
L'éternité, au regard de l'univers, n'admet pas d'être régentée. Admettre Dieu, c'est admettre une fin arbitraire, entendue comme objectif et limite, à l'éternité poétique, au même titre que d'admettre comme souveraine la seule matière connue des hommes comme principe fondamental de l'éphémère.
Le matérialisme et le déisme sont deux garde-fous complices d'une même tentative de conjuration de l'angoisse de l'impensable.
- Si notre galaxie compte des millions et des millions d’étoiles, qu’elle est elle-même accompagnée de millions d'autres galaxies qui comptent chacune des millions et des millions d’étoiles et qu'à son tour chacune de ces millions de millions d'étoiles nourrit un système équivalant à notre système solaire, alors j’imagine que cette grandeur, même purement physique, touche de près à l'éternité, telle que je la conçois. Supposer ou admettre que l'homme, en tant que composant de l'univers, participe forcément de cette éternité est cependant du strict domaine de l'idéologie de la mort-tabou.
- Les synonymes sont les faux culs du langage. L'intangible n'est pas l'immatérialité tout comme la matérialité n'est pas forcément tangible.
- Je ne prétends pas que la pensée possède une logique autonome dans son rapport à la vie. Je ressens confusément qu'il y a une abstraction vécue, de l'intangible dans la vie et vice-versa, que les matérialistes redoutent et qu'ils qualifient de mysticisme, d'idéalisme, de religiosité, de métaphysique et autres plaisants euphémismes/dérobades.
- Que vaut un penseur matérialiste qui ne sait dire, sinon par une suite de spéculations d'ordre clinique et cervicale, l'organe de sa pensée ?
Au mieux, il vaut un gourmet sans papilles, au pire un libertin sans orgasme.
- Ce qui me repousse, me révulse et me révolte dans les religions, principalement dans celle que je connais la moins mal - la chrétienne -, c'est cette association instinctive, constitutive, avec la mort.
- Dans le fonds de commerce de toute religion, la mort est l'article de luxe.
- Si les refrains religieux me dégoûtent, les couplets tout aussi péremptoires des matérialistes athées ne me satisfont pas.
La chanson est sans doute d'une écriture plus complexe.
DIALECTIQUE
 - Aucun homme au monde ne peut acquérir l'habitude de la misère, alors qu'à peu près tous composent dans la misère de l'habitude.
- Aucun homme au monde ne peut acquérir l'habitude de la misère, alors qu'à peu près tous composent dans la misère de l'habitude.
- Dialectiquement considéré, le faux est un moment du vrai.
En politique aussi mais avec cette nuance que le faux est un cabotin qui tarde à passer le micro.
- Faire l'idiot n'est pas sans risque : on ne sait jamais à quel moment précis le renversement dialectique s'opère.
Quand c'est l'idiot qui vous fait.
INTERNET
 - La blogosphère, comme on dit, est un microcosme bien nommé. Elle tourne en rond sur elle-même, on y lit de belles choses, vraies, humaines, et d'autres grotesques. On y prend du plaisir, on s'y ennuie, on y noue de fragiles amitiés et on s'y attire de solides inimitiés.
- La blogosphère, comme on dit, est un microcosme bien nommé. Elle tourne en rond sur elle-même, on y lit de belles choses, vraies, humaines, et d'autres grotesques. On y prend du plaisir, on s'y ennuie, on y noue de fragiles amitiés et on s'y attire de solides inimitiés.
- Un copain de France m'a écrit un jour un mail qui disait avec force que jamais il n'écrirait sur Internet. Fort inquiet, j'ai par retour et parce que je l'aime bien, pris des nouvelles de sa santé.
- L'état actuel de la pratique numérique a poussé plus loin encore, au point de les contredire, les affirmations de la théorie situationniste selon laquelle " le directement vécu s'est éloigné en images."
Il n'y a en effet pas eu de conflit d'intérêt entre l'image et le vécu où la destruction de l'un eût été la condition sine qua non de la pérennité de l'autre.
Le directement vécu ne s'est pas éloigné au sens de mal-vécu et d'anéantissement de la présence humaine dans les activités humaines. Il s'est fait image à part entière et inversement.
L'image et le vécu, au lieu de s'engager dans une lutte à mort, ont pactisé dans la synthèse.
L'erreur consistait encore, même chez les situationnistes, à préjuger d'une certaine qualité de la vie, prédéfinie, posée comme postulat et point de ralliement de la critique.
Que la synthèse s'engage à son tour ou non dans un autre conflit qui la dépasserait ou la vérifierait, n'est pas mon propos.
Parce que je ne sais pas encore si cette synthèse est humaine ou si elle est la victoire totale de la séparation de l'homme d'avec lui-même.
Je prends donc simplement acte d’un état de fait qui, tantôt m’enthousiasme, tantôt me semble dangereux et ne cesse de me turlupiner.
CONCLUSION
Il y a une chose que vous ne pourrez pas me contester dans toutes ces pensées : c'est que je les ai eues.
De là à prétendre qu'elles sont justes...
Toutes les images, sauf la première, sont de notre ami des Hautes Terres, Philip Seelen
13:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.10.2011
aie aie ouille ouille !
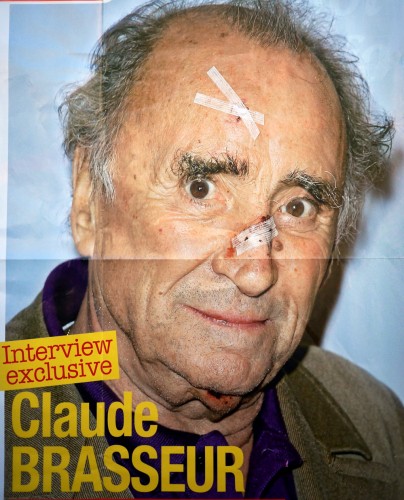 La langue, parfois, n’est pas traduisible scientifiquement parlant, étymologiquement, sinon par les sons qu’elle a entendus pour dire le monde et qu’elle a récupérés pour son propre compte, au cours de sa longue histoire.
La langue, parfois, n’est pas traduisible scientifiquement parlant, étymologiquement, sinon par les sons qu’elle a entendus pour dire le monde et qu’elle a récupérés pour son propre compte, au cours de sa longue histoire.
Maladroit et distrait, pensant à tout sauf à ce que j’étais en train de faire, je me suis entaillé le doigt en fendant des bûches. La vindicative hachette a glissé sur un joli nœud récalcitrant, a dérapé sournoisement le long de l'écorce et fini sa course assassine sur mon pauvre doigt… Aie ! Aie ! Une assez profonde blessure à l’index gauche.
N’étant évidemment pas à jour avec les vaccins antitétaniques et me demandant s’il fallait recoudre, me voilà donc parti aux urgences de l’hôpital. Papiers, explications, direction vers la salle d’attente par de longs corridors baignés de lumière jaune, avec, comme toujours et dans toutes les urgences du monde quand tombe la nuit, l’alcoolique de service, chronique ou d’un soir, qui rouspète contre le monde entier, qui saigne un peu, qui s’est blessé en tombant, soit la tête, soit le genou, soit…Bref, là, c’était la tête, déjà largement bandée. Une gueule un peu comme celle de Brasseur maquillé par l'ami Philip...
Mais je m’égare.
Rien d’autre à faire, donc, dans cette attente, qu’à lire les différents panneaux d’information accrochés là et à maugréer sur ma gaucherie et ses conséquences immédiates, par exemple, pas question d’empoigner la guitare avant une bonne quinzaine de jours. Peux plus faire la vaisselle non plus....Mais ça, hein, c'est quand même une aubaine. A toute chose malheur est bon, dit-on.
Je cherche, pour me distraire un peu, le nom du médecin qui va me recevoir. Voyons voir, ah, c’est là : Lekarz dyżurny. Lekarz, le médecin…ça, d’accord. Mais dyżurny ? Je prononce dans la langue polonaise : dé journée. Médecin du jour.
Renseignements pris plus avant, ça ne veut rien dire, stricto sensu, ce dyżurny, sinon phonétiquement, en souvenir d’une expression française.
C’est beau la langue. Avec un son chopé à la volée, ça conçoit une orthographe et de cette orthographe naît un mot officiel. Ça a des mémoires inattendues, la langue.
Oui, et alors ? Un parking, un week-end, un crumble, ça ne veut rien dire non plus en français, que je me suis dit. On n'a même pas pris le temps de changer l'orthographe nous autres. En plus !
Bref. Il était au demeurant bien sympa le Lekarz dyżurny. Nie ma problemu, assez superficiel, qu’il a dit.
Me reste une poupée pour montrer le monde de la main gauche. Et ne voyez là, je vous prie, aucune allégorie désobligeante en direction de Monsieur Hollande.
Image : Philip Seelen
10:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.10.2011
Les quatre saisons
Dans un monde qui n'arrête pas de faire semblant d’être bousculé par des préoccupations faussement modernes, tant du point de vue de sa science que de son art, je suis sans doute d’une sensibilité obsolète, d’une texture désuète, d’une émotivité surannée.
C’est un monde intelligent mais qui ne sait plus trop quoi faire de toute cette intelligence. Un monde avec une telle conscience abîmée de son présent qu’il ne le conçoit plus que dans le futur ; conception qui sous-tend elle-même, obligatoirement, un certain mépris du passé.
Je ne vis pas les choses sur ce mode-là. Je me soucie aujourd’hui de l’évolution des hommes, de leurs sociétés et de leurs éthiques, comme d’une guigne. Longtemps je me suis soucié de tout ça, depuis mes plus jeunes années et même jusqu’à fort tard dans la nuit. Je fomentais de l’espoir, je réunissais des conjurations, je tirais des plans pour l’avènement d’une belle, égalitaire et jolie société. Sans classes ! ? ? Oui, au tout début, pendant le catéchisme intellectuel et juste après la première communion des mutineries. Après, il m’est apparu qu’un concile s'avérait absolument nécessaire pour adapter la leçon ingurgitée à la réalité des non-événements.
Alors ça a évolué, ça a tergiversé, ça a dérivé, ça a vu autrement, d’autres espoirs sont venus, mieux ancrés, mais toujours dans un réel se dérobant constamment sous les pas.
Tout ça, il faut du temps, beaucoup de temps pour s’en débarrasser, pour décoder le discours, débusquer le mensonge, écarter les voiles obstruant la lucarne ouverte sur le monde et reprendre les illusions de la liberté à son propre compte. Une liberté totale. Qui ne supporte pas le jugement chronologique. Le temps compté à travers l'idéologie du temps. Il faut du temps, trop de temps, autant, presque, je le suppose, que ceux qui ont débuté leur course vers la lumière sous l’ombre des crucifix de l’excité de Nazareth. Quoique j'en ai vu de ceux-là, et j'en vois encore beaucoup, qui, nés à genoux, n'ont jamais réussi à vivre pleinement debout.
Je suis donc, du point de vue de ce qui m'émeut encore, certainement un réactionnaire. Si on veut. Ça ne me dérange pas d’être réactionnaire au milieu d’innovateurs de tous poils qui, depuis longtemps, ont fait la preuve de leur impuissance, de l’inexactitude de leurs vues et, bien souvent, de leur duplicité intellectuelle.
Je m’intéresse donc quasiment plus aux paysages qui m'entourent qu’aux hommes qui les habitent. Ma grille de lecture, ce sont les saisons qui tournent, le grand mouvement des choses et le visage de ces paysages qui changent avec toujours la même et sereine éternité.
J'entends déjà aller bon train les commentaires des sages dialecticiens. Mais les paysages, c’est humain, c’est l’empreinte des pratiques humaines qui les sculptent aussi, c’est.... ! Oui, oui…Chassés par la porte, les matérialistes de la pensée pure s’empressent de revenir par la fenêtre. Mais je m’en fous, moi, de ce que l’activité humaine transforme des paysages ! Je vis ce que je lis. Je bois ce que je vois, je me détourne de ce que je ressens comme laid.
Parce que tourne la roue, dent après dent, inéluctablement, vers son fatidique terminus. Cette roue, c’est au travers des saisons que je la vois. Plus clairement que dans mon miroir. Plus clairement que par les gesticulations des hommes.
Je tourne dans l’espace et dans le temps, au même point à la même date, même jour, même heure, même minute, même seconde que la saison dernière…Je me promène sur la boule bleue qui se promène et mes pas qui vont là-bas, que je les presse ou que je les somme de s’arrêter, vont leur chemin.
Les seuls paysages me parlent. Des sentiments qui vont de pair surgissent. Des souvenirs enfouis, à peine entrevus parfois. Le bleu pâle du printemps, le jaune poussiéreux de l’été, la pagaille bariolée de l’automne, le blanc glacé de l’hiver, tout ça ce sont des pages qu’on tourne, d’un cahier où nous n’écrivons rien, que de solitaires balbutiements.
Des balbutiements sans témoin. C'est là sans doute la grande faiblesse de la littérature : elle ne peut se développer que pour elle-même et devant témoins. Sans témoin, elle n'est rien.
Je regardais, je furetais, je fouinais, je farfouillais encore vendredi sur ce territoire d’Internet consacré à la littérature, à l’écriture plus exactement, territoire dans lequel s’inscrit aussi ce blog. J’ai mesuré, un instant, un instant seulement puisque je suis revenu, parmi les textes, les félicitations des uns, les diatribes des autres, les m’as-tu-vu dans mon joli projet d’autres encore, tout le sérieux amusement d’une époque effondrée sur elle-même. Qui s'étouffe de sa propre pesanteur.
Maupassant, Flaubert, et l'intelligence artistique avec laquelle ils donnaient un sens, un rôle aux paysages, une humanité au tangible, me manquent terriblement.
13:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.09.2011
Coup d'cœur
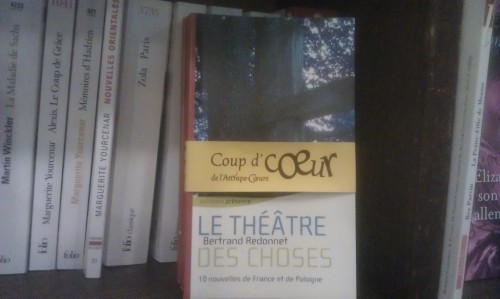
La librairie L'Attrape-cœurs de la Place Constantin Pecqueur, sise à Montmartre, éprouve un coup d'cœur pour Le Théâtre des choses.
Voilà donc un coup d'cœur qui m'évite un coup d'blues.
08:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.09.2011
L'Exil des mots, au poids et au goût
 Je viens d’en déterminer, enfin, avec la sauvegarde intégrale de tous les textes de L’Exil des mots, réunis dans un seul fichier de 2.311.618 caractères et de 862 pages calligraphiées en Bookman old Style, 12.
Je viens d’en déterminer, enfin, avec la sauvegarde intégrale de tous les textes de L’Exil des mots, réunis dans un seul fichier de 2.311.618 caractères et de 862 pages calligraphiées en Bookman old Style, 12.
L’Exil des mots a été ouvert en juillet 2007 en reprenant quelques textes d’un premier blog, Exil volontaire, ébauché, lui, en 2006.
Et c’est un voyage étrange que de remonter pas à pas tout ce qu’on a pu soi-même écrire pendant cinq ans. On arpente sa propre histoire en écriture, on suit à l’envers le cours d’une rivière dont on a patiemment creusé le lit et on ne reconnaît pourtant pas toujours les sons cristallins de l’eau. On se surprend même parfois à aborder un méandre fantaisiste, on ne sait pas, aussi, pourquoi le cours d’eau s’attarde à tel endroit pour se répandre bientôt en cascades, plus loin…On y rencontre des textes qu’on n’écrirait plus comme ça, on y lit des affirmations qu’on n’affirmerait plus, on y croise des gens qu’on avait oubliés, des commentateurs qu’on a bien aimés et qui se sont envolés, parce que ça ne collait plus, parce que ceci ou bien parce que cela...On se souvient. On sourit…On le regrette et on passe à autre chose.
Sur ces 862 pages, j’en vois, au final, comme ça, sans avoir comptabilisé, d’un simple coup d’œil, 400 dignes d’intérêt.
Et tout cela, loin de me dépiter, me réjouit. Parce que je me rends bien compte que l’écriture est vivante, faite de cette matière qui voyage avec nous, de sang et de chair, d’espoir et de révolte et de soumission et de rêves et d’amitiés et de colères, et, qu’ainsi, elle ne peut être figée comme momie dans sarcophage. Le blog est fait pour inscrire des pas au bord du temps qui passe, un peu comme un journal. Il n’est - peut-être - pas œuvre inscrite dans la pierre mais cette dichotomie n’est pas dépréciatrice à son égard. Il est autre chose. Indispensable au reste. Et peut-être que c’est le reste qui ne compte pas.
On se dit tout ça en remontant le cours de la rivière…
J’ai mesuré, effaré, que voilà bientôt sept ans que je suis un exilé. Volontaire. Qu’y-a-t-il derrière ce volontaire ? Quitte-t-on souverainement le pays qu’on aime ? Qu'on aime parce c’est le pays référence de tout ce qui nous fut constitutif ? S’arrache-t-on l’œil gauche pour mieux voir du droit ? J’en doute… Nos actes essentiels nous sont certainement imposés par l’histoire que nous avons construite en amont, une histoire elle-même subordonnée à une nébuleuse de rêves, de désirs, d’utopies, de joies de vivre, d'amères déceptions, de visions fulgurantes de bonheur … Il y a longtemps, avec la voix lactée des berceaux innocents : quand nos mots n’étaient pas encore en exil, quand la musique s’écrivait encore avec les labours de septembre, les vents de novembre et les rideaux de pluie de décembre. Sans partition. Sur des prairies nonchalantes ou le pavé crasseux des rues.
Rien de ce que nous écrivons n’est alors inutile. Dérisoire parfois. Inutile jamais.
Et, tout en creusant cette rivière qui coule je ne sais où, pendant ces quatre ans, j’ai en même temps donné naissance à Zozo, Géographiques, Chez Bonclou, Polska B Dzisiaj, Le Théâtre des choses et un autre roman actuellement en lecture à Paris. Puis à d’autres essais encore, que je n’ai pas encore présentés. Qui ne sont ni pour un blog ni destinés à l’édition papier. Qui meublent les tiroirs.
Pour l’heure, puisque je suis quand même toujours et toujours compagnon fidèle de la bourse plate, j’ai accepté de réécrire pour un éditeur qui tire à 5000 exemplaires mais qui ne donne pas du tout, du tout, dans la littérature, une trentaine de contes et légendes du Poitou. Un travail stricto sensu. Alimentaire. Suffira de savoir rendre plaisant la contrainte, en y distillant le plaisir d'écrire malgré tout. De s'isoler dans une autre dimension du pourquoi.
Et puis, on verra…L’automne et l'hiver donnent des idées qui ressemblent à des envies.
Avec tout ça, nous nous en allons trop vite vers le Grand Peut-être. Nous sommes des antinomies qui cheminons à toute vitesse. Le temps m’attriste. On ne devrait jamais remonter le cours des rivières qu’on a creusées de ses mains.
Merci à vous, lecteurs fidèles de l’Exil…Je ne vous entends pas, mais je vous sens bien là. Tout près. Chaque mois, vous êtes plus de 2000 maintenant à venir promener votre lecture sur mon écriture.
Peut-être, êtes-vous, vous aussi, en exil de quelque chose qui ne serait pas forcément un pays.
Nous nous accompagnons. Avec le respect de ceux qui ont tellement de choses à se dire qu'ils ne se parleront sans doute jamais.
Image d'un fidèle ami et lecteur : Philip Seelen
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.09.2011
Passage supprimé
 Les gens d’hier, surtout ceux des champs et des bois, ne vivaient que ce qu’ils vivaient.
Les gens d’hier, surtout ceux des champs et des bois, ne vivaient que ce qu’ils vivaient.
Ils n’existaient pas encore comme décalcomanies. On ne les assommait pas chaque soir avec les tumultes des antipodes mis à feu et à sang, on ne leur disait pas de se bien couvrir le bout du nez parce qu’il allait faire froid, de se vacciner vite au risque d’être bientôt malades, sinon pour des fléaux d’antan comme tuberculose et variole, de penser comme ci plutôt que comme ça, de faire de leur argent ça plutôt que ça, de prendre bien garde à ce qu’il y avait dans leur assiette parce qu’un récent congrès de scientifiques venaient de découvrir que…
On ne leur disait pas non plus que la terre sur laquelle ils se promenaient était malade, avait la fièvre et serait tantôt inhabitable, la proie de tempêtes apocalyptiques, de cataclysmes et de naufrages titanesques s’ils ne prenaient garde à ce qu’ils faisaient chaque jour de leur poubelle, de leur auto, de leurs cartons, de leur chauffage, de leur papiers de bonbons. On ne leur disait pas que leurs enfants risquaient de mourir en vivant leurs amours ou alors qu’ils seraient peut-être des clochards, des trimardeurs, parce qu’on n’avait plus besoin d’eux pour construire, produire et imaginer un avenir bouché comme un ciel d’ouragan. On ne dressait pas chaque année la liste macabre de milliers de gens écrasés sous leur automobile, chaque commune, chaque village, chaque lieu-dit, chaque maison n’avait pas encore à déplorer un que la route avait cueilli à la fleur de l’âge.
On ne leur disait pas grand chose, aux gens d’hier. Que des broutilles. L’organisation méthodique de la peur et de l’angoisse n’était pas encore en place. Tout au plus, s’inquiétait-on vaguement, depuis que les hommes parlaient de monter voir la lune, des soucoupes volantes qui sillonneraient le firmament et d’êtres hideux débarquant des espaces sidéraux. Des inquiétudes à la Jules Verne.
Leur vie était encore sous leurs pieds, aux gens d’hier, à portée de mains, directement palpable. Nous ne disons pas qu’elle était plus belle ; nous laissons bien volontiers ce genre d’appréciation à la morale et à la sociologie. Nous disons qu’il la voyait de leurs propres yeux, cette vie.
Ces gens d’hier voyageaient donc seuls, comme les marins avant la boussole. Au flair, aux caprices des étoiles, au gré des vents, à la force du vouloir. Face aux tempêtes, ils serraient les dents ; avec un bon vent arrière, ils tâchaient d’en profiter pleinement.
Tout ça, bien moins longtemps qu’aujourd’hui, c’est vrai. Parvenu à quatre vingt ans, on n’était plus un vieillard anonyme dans une foule anonyme de vieillards, on était un fossile, une exception, un monument, presque un contre-nature. Car on ne traînait pas son semblant de vie jusqu’à des âges sans nom. On mouchait la chandelle beaucoup plus tôt et bien plus fatigué. Bien sûr… Mais le chemin parcouru n’avait pas chaque jour été habité par la mort, on ne l’avait pas soupçonnée d’être planquée en embuscade derrière chaque buisson, derrière chaque touffe suspecte de la végétation, derrière chaque virage à prendre.
On ne craignait le tranchant de la faux que la saison venue de la moisson.
Plus tard viendraient les temps où, pour asservir le monde, on brandirait la Camarde dans tous les instants de la vie, les serfs devant désormais considérer que respirer encore constituait le bonheur.
Passage supprimé d'un récit achevé, actuellement en cours de lecture
Image : Philip Seelen
07:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.09.2011
Le grand sablier

On dit en Pologne que ce changement est sensible dès la Sainte-Anne, le 26 juillet.
Reste tout de même qu'au 26 juillet, le jour est toujours le grand triomphateur de la guerre éternelle. Un mois seulement qu’il est sur le trône et il est encore tout drapé de ses habits de sacre ! C’est un conquérant à l’apogée de sa conquête, qui la savoure, qui en jouit, qui en abuse, tant que déjà, tels les soldats de Capoue, il s’assoupit dans la luxure, s’amollit, et, par négligence, concède même aux ombres fuyantes une toute petite partie des espaces/temps conquis de si haute et longue lutte.
Il faiblit. Il ne lutte plus. Son histoire lui semble achevée. Il s'installe dans l'habitude.
Au sol, pourtant, les premiers stigmates de cet abandon des ambitions sont déjà visibles : les floraisons s’achèvent, elles se font graines, les arbres et les arbustes ne font plus de nouveaux rameaux, les tiges nouvelles brunissent, les blés sont mûrs, bientôt fauchés, l'alouette ne monte plus à l’assaut des zéniths, les migrateurs en ont terminé de leur devoir de conservation de l'espèce, ils étudient la carte, immobiles, l’œil attentif, tendu vers les étoiles de la nuit.
Puis vient l’heure de la franche reculade. L’heure, non pas encore de la défaite totale, mais l’heure où elle est de plus en plus envisageable. Tangible même. La lumière fait amende honorable et croit pouvoir sauver son royaume sur un compromis : elle cède la moitié du ciel aux ténèbres. Chacun son territoire.
L’équinoxe est cet équilibre fragile, magnifique, mélancolique, qui oscille, qui hésite, qui tremble, qui a peur de basculer et qui tout à coup bascule.
Car l'égalité acquise par la reculade et non par la victoire, c'est déjà la défaite. Les ombres sont enivrées par leur succès, et, après quelque temps d’un statu quo vêtu d'or et de sang, un statu quo stratégigue, réfléchi, pesé, soporifique, elles donnent l’assaut final.
Le coup de dent mortel.
Le rire sardonique des ténèbres dégouline soudain du ciel refroidi. Le conquérant d’hier n’est tantôt plus qu’un fuyard désemparé, ses habits de lumière jetés au vent, maculés de nuit et maculés de brumes. Dans la panique, il abandonne derrière lui armes et bagages : les ténèbres-Attila font le désert sous leurs ailes triomphantes et interdissent à l'herbe qu'elle ne repousse.
Les ombres bientôt imposeront leur diktat. Foin des verts et des rouges et des jaunes et des pourpres et des bleus et des nuances subtiles des déclins, des ascensions et des mouvements !
Le monde sous leur règne se déclinera en noir et blanc. Du noir au ciel et du blanc sur la terre. Pas de fioritures. La vie réduite à l'essentiel et la loi nouvelle qui s’écrit sur du silence, sur de l'absence, sur des civières immobiles.
De l’autre côté de la terre cependant, emprisonnée, humiliée, la lumière panse ses blessures, analyse sa déroute et reprend peu à peu ses esprits. Elle compte ses troupes, dresse des cartes du ciel et envisage la revanche... car déjà la nuit s'endort sur ses lauriers.
Trop sûre de l'éternité dont elle a les tristes couleurs, elle va en défaillir. S'évaporer.
Les hommes, eux, suivent des yeux l’éternelle empoignade des deux gigantesques Sisyphes.
Ils suivent les mouvements de balancier de leur fatal sablier : leur nuit à eux, ils le savent, ne reverra pas la revanche de la lumière.
11:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.09.2011
Solko et mon théâtre
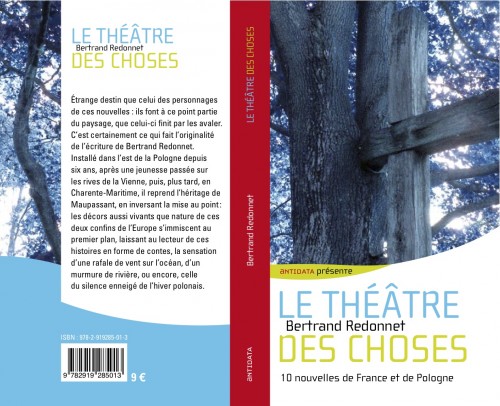 Solko offre ce matin une critique de mon livre, Le Théâtre des choses, et je l'en remercie.
Solko offre ce matin une critique de mon livre, Le Théâtre des choses, et je l'en remercie.
Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il dit sa lecture, personnelle, de l'intérieur, tout comme Marc Villemain le fit, sans complaisance et sans emportement. Une critique sérieuse d'un lecteur sérieux.
Ce qu'il s'en dégage - en substance : les cataclysmes du XXe nous ont définitivement rendu inutilisables les clefs de la littérature du XIXe - va au cœur de mon problème - de ma passion aussi - en écriture.
J’avais d’ailleurs, dès les premières phrases de mon recueil, prévenu de mon malaise : Mais, dans notre époque vautrée sur un tas d’or qui ne sert à rien sinon à s’y vautrer, écrire ce qu’il (Maupassant) écrivait, je le crains fort, ne plairait plus à grand monde, me répondit mon ami, sur un ton proche de la consolation.
J'avais même prévenu bien avant la sortie de ce receuil.
Une gageure d’écrire ainsi, oui. On ne gage que sur ce que l’on aime. Même à contre-temps. A contre-époque. Au risque des solitudes de l'ombre.
Si Thomas Vinau a pu écrire "la poésie encule le rendement", je lui ferais volontiers écho, à l'ami Thoams, en écrivant : "Elle doit surtout enculer les héritages désastreux de son époque, au risque de se faire par eux enculer ."
10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.09.2011
L'Anagnoste : une critique de Marc Villemain

Sur L’Anagnoste d’Eric Bonnargent et de Marc Villemain, ce dernier donne une critique du Théâtre des choses, qui m’a ému.
On me dira qu’une critique n’est pas spécialement faite pour ça. Si, justement, quand elle a su lire l’invisible partition, dans ses limites comme dans ses espaces, sur laquelle s’écrivent les textes.
La critique, si elle est sensible et sans complaisance excessive, saura ainsi éclairer autant le lecteur sur ce qu'on lui propose de lire, que l’auteur sur ce qu'il s'est proposé d'écrire.
Et c’est bien là toute sa raison d'être.
L'hypothèse, plaisante, que fait Stéphane Beau n’est pas non plus de nature à ce que je boude ce matin mon plaisir à être lu par deux lecteurs de ce tonneau-là.
15:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.09.2011
Ménage d'automne
 En reprenant un par un les quelque 600 textes qui constituent L’Exil des mots, en les remettant en pages et en les sauvegardant sur un même fichier avant qu’un imbécile ou un bug ne viennent tout saccager, je m’aperçois, mi-figue mi-raisin, de leur qualité inégale.
En reprenant un par un les quelque 600 textes qui constituent L’Exil des mots, en les remettant en pages et en les sauvegardant sur un même fichier avant qu’un imbécile ou un bug ne viennent tout saccager, je m’aperçois, mi-figue mi-raisin, de leur qualité inégale.
Plus du quart, et je suis indulgent avec moi-même, ne mérite guère de retenir l’attention, participe même, parfois, du bavardage ponctuel.
C’est sans doute un des symptômes de cette maladie infantile des blogs qui exige que l’on y soit régulièrement présent. Les empreintes alors laissées par cette assiduité ne sont pas toujours concluantes, tant on sait bien que la qualité ne peut être évaluée qu’une fois les épreuves du temps subies.
Ce qui, souvent, paraît pertinent fraîchement écrit, se présente insipide quelques années plus tard...
Les commentaires, parfois dithyrambiques, de certains lecteurs n'aident pas non plus l'auteur en quête de reconnaissance à prendre quelque distance vis-à-vis de lui-même. Ce ne sont pas toujours de bonnes boussoles pour choisir une direction, pour refaire à neuf, remanier, reconstruire, travailler. .. Ce sont même parfois, dans les cas extrêmes, de faux amis qui peuvent vous emmener très loin dans l'erreur.
Aujourd'hui j’assume, et même revendique, le virage à 180 degrés que m’a fait prendre la tartuferie de F. Bon - qui s'emmêle les crayons dans les fils de sa mégalomanie et se voit en pape de l'internet - sur la question de l’écriture numérique. Je n’y crois plus vraiment après y avoir mis beaucoup de sympathiques espoirs. J’en suis même à considérer désormais que cette écriture ne peut être une fin en soi, mais seulement un moyen, un outil pratique pour écrire publiquement presque au quotidien et ne pas laisser reposer sa plume, tant une bonne raison de ne pas se mettre au travail ne manque jamais à personne.
S’agit donc, pour moi, de sauvegarder ce qui, à mon sens et dans mes dispositions d’esprit actuelles, mérite de l’être. C’est-à-dire, ce qui mériterait, si l’envie me prenait de le poposer un jour, d’être imprimé et inscrit dans la durée.
Aux lecteurs de L'Exil des mots, je dois cet aveu : si j’étais un homme connu, je veux dire si j’étais un écrivain dont les livres auraient assez de substrat littéraire pour être reconnus et lus en nombre suffisant, je quitterais ce blog et je m’attacherais dans l’ombre à des travaux d’importance.
Pour ceux qui aiment encore cet Exil des mots cependant, il n’y a point péril en la demeure : l’hypothèse ci-dessus formulée n’est pas pour demain !
D’ailleurs, soit dit en passant, j’ai plaisamment noté : un certain nombre de braves valets, avec lesquels je ne suis pas fâché, ont supprimé le lien qui, de chez eux, les reliait à L’Exil des mots. Histoire de bien faire voir, sans doute au pape, que leur allégeance était sans faille.
Je les en remercie.
Parce que depuis juin, depuis que j’ai mis les pieds dans ce sale plat, le nombre de mes lecteurs est resté tout à fait stable. Ce qui souligne l'inutilité de la misérable démarche des serviles censeurs.
Pour l'heure, je retourne en coulisses. Faire mon ménage. Serein.
11:46 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.09.2011
Les livres, tels le carbone 14

On parle ici polonais, bien sûr. C’est une langue que je bredouille alors qu’elle se chuinte. On parle en cyrillique aussi, biélorusse ou ukrainien.
Avec derrière moi plus d’un demi-siècle de sommeil dans la pierre ou le béton, la nuit, j’ai toujours l’impression que je campe, en fait. D’autant que je dors sous une fenêtre et si je soulève le rideau, sans rien perturber de ma position allongée, je vois les étoiles quand le vent est au froid ou les nuages qui galopent si la nappe océanique m’a poursuivi jusque là.
De tout ça j’ai rêvé. En plus.
Mais point d’interprétation tirée des cinq leçons de la Petite Bibliothèque Payot. Tout au plus ce cours récit cousu d’incohérences et sans doute imparfaitement retranscrit. On ne dit que la silhouette d’un rêve.
Quand on ne le voit plus de l’intérieur.
Je ne sais quelle genre de catastrophe avait eu lieu, humaine ou naturelle.
Ceci dit en passant, je ne suis pas certain qu’il y ait une différence qualitative entre ces deux notions, comme si ce qui était humain n’était pas naturel et vice-versa.
Mais c’est une autre histoire. Presque de la politique. Et on s’éloigne toujours du directement vécu et de ce qu’il contient encore de poésie dès qu’on s’approche de la politique.
Catastrophe donc.
Plus rien. Que de la forêt et la clairière. Plus de maisons. Plus une âme qui vive. Que du vent glacé et qui gémit dans les pins et qui fait craquer les bouleaux.
Seule et debout au milieu de ce désert enveloppé de silence neigeux, ma bibliothèque.
Une bibliothèque nettement dessinée. Le meuble est intact mais les livres abimés, déchirés, souillés, humides, maculés, sont dispersés. Beaucoup sont enfouis.
Quoique indéterminée, l’époque est très lointaine dans le futur et des archéologues se perdent en conjectures sur la présence de tous ces livres écrits en français, au milieu d’une forêt désolée de la frontière biélorusse.
La premiere thèse est avancée d’un militaire russe et francophone en résidence ici. Elle s’appuie sur le Clausewitz, le premier livre clairement identifié. La région était russe, en effet, et il était de bon ton, tant dans les milieux militaires qu'à la cour du tsar, de parler français.
Cette hypothèse ne tient cependant que peu de temps. Car on fouille alentour et on tombe sur Rimbaud et Baudelaire gisant côte à côte, dans une édition qui a dû être de luxe.
D'aucuns affirment alors que ces livres auraient appartenu à un riche. Peut-être même un membre lointain de la famille du beau-père de Louis XV.
Ils sont moqués sans retenue. On se tape sur les cuisses. Qu’est-ce que du sang bleu serait venu faire dans ce désert ?
On remonte encore dans le siècle, toujours le 19ème….Hugo est retrouvé. Une couverture lacérée. Puis des morceaux de Maupassant, Darien...On s’accorde pour dire, en opinant doctement du chef et en se caressant la barbe, que l'oiseau qui a niché là était bel et bien du 19ème.
Une exclamation retentit alors. On accourt. On presse l’exclameur de montrer ce qu’il tient dans les mains. Pour peu, on le secouerait. Des poèmes qu’on dirait écrits en vieux françois. On identifie un poète du 15ème et on arrive même à en extirper le nom, Villon.
On se gratte derechef la barbe et on entend les ongles salis qui en interrogent les poils.
On s’égare, on tergiverse, on se contredit, on s’interpelle.
Du vieux françois ici ?
Et puis on découvre sous un amoncellement de neige et de bouts de bois mêlés, des morceaux de Mallarmé, de Vailland... Un Vaneigem aussi...
Vingtième siècle. On en est maintenant certain. Pour Villon, on verra plus tard. On officialise la thèse. On la publie. Un Français du vingtième a campé dans cette forêt.
On cherche dans les grandes migrations, ça colle pas. C’était dans l’autre sens à l’époque.
Un proscrit ? Non. Vingtième siècle. L’Europe est faite. Plus de proscrits. Mais vers la fin du siècle seulement. On ne retrouve rien qui serait postérieur aux années mil neuf cent quatre-vingt, disons quatre-vingt dix…
Le fait est acquis.
Mais on ne s’explique toujours pas la présence du Villon. Attendez, dit un gars… Vous croyez qu’ils faisaient des parchemins plusieurs fois, je veux dire qu’un parchemin du 15ème ou du 19ème pouvait être refait au vingtième, par exemple ?
On hausse les épaules. On n’en sait rien. On dirait. Mais ça paraît une drôle d’idée. Comme de coller deux fois le même texte sur un même écran.
On arrête là les suppositions. L’important était de dater la trouvaille...
Jusqu'à ce qu’un jeune enthousiaste, poussant plus loin la pelle et les râteaux, mette au jour le Bleu Cerise de Denis Montebello et Atelier 62 de Martine Sonnet.
Vingt-et-unième !
La chose est entendue mais tout reste à faire.
On abandonne la clairière à son silence lunaire.De peur, peut-être, d'en arriver à 4075 et de s'effrayer de la proximité de ce lecteur, français et exilé dans les bois.
Et je me réveille en douceur. Les livres sont là qui s’en foutent des fantasmagories catastrophiques.
Reste plus qu’à en prendre un et lire.
Ce sera Le Corbeau blanc, Biały Kruk, Stasiuk.
Du polonais traduit.
Histoire d’ajouter à la confusion.
07:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.09.2011
Ce que François Bon a détruit
En fusillant sans sommation mes deux livres, Chez Bonclou et Polska B dzisiaj, dans l’endormissement général, dont la tacite complicité de ses thuriféraires et de ses courtisans, François Bon a détruit beaucoup plus que deux livres. Il a détruit toute une déontologie de l’édition et la confiance que je pouvais avoir dans internet.
Ce fut un acte voyou et d’abus de pouvoir. Si j’étais un mouchard, je veux dire un qui se mouche à l’hermine du chat fourré, aucune juridiction digne de ce nom ne lui aurait donné raison, d’autant que des clauses précises sur le sujet sont prévues dans ses contrats.
Ceci dit, François Bon ne respecte aucune clause de ses contrats. Il au-dessus de ça, au-dessus de la parole donnée ou écrite. Bref, il est en dessous de tout !
Et c'est là le bel élément positif de cette histoire : il a été obligé de jeter bas le masque. Qui sait lire, a lu ou lira les commentaires dignes d'une cour de récréation qu'il me donna en guise de réponses sous les différents textes dénonçant ses pratiques ( catégorie : publie.net une étrange coopérative), saura à qui il a à faire.
Tout ça pour dire que je m’attache ces jours-ci à reprendre tous les textes publiés sur L’Exil des mots, à homogénéiser leur mise en pages, à les trier et à les sauvegarder en ordre sur un fichier.
N’importe lequel imbécile mal intentionné et un peu malin peut en effet tout détruire ou, au mieux, réutiliser pour son propre compte ce que vous écrivez sur cette toile, qui ne m’inspire plus désormais que de la méfiance.
J’y reste parce qu’une présence y est, hélas, maintenant incontournable. Mais tant que des voleurs et des menteurs de cet acabit y feront illusion - et ça risque de durer très, très longtemps, bien plus longtemps que moi-même - je ne m’y sentirai pas en sécurité.
Je publie donc ci-dessous un extrait de Polska B Dzisiaj, sauvegardé sur ce blog, comme beaucoup d’autres, car, comme déjà dit, les livres sont comme les pays, on peut les faire brûler, mais on ne peut en détruire l’âme.

La Méditerranée, les Pyrénées, l’Océan Atlantique, la Manche, la Mer du Nord, les Alpes. Une forteresse aux frontières inexpugnables. Il n’y a guère que le Rhin pour lui avoir causé de lourdes déconvenues. Les fleuves, c’est plus discutables que les mers et les montagnes. C’est étroitement liquide et ça tord ses caprices dans tous les sens.
Je ne crois pas alors qu’on puisse avoir la même vision du monde selon que l’on soit à bord d’un navire bien calé sur les flots où sur un que les tempêtes ont ballotté au gré des houles et qui finalement a trouvé refuge dans le creux d’une vague qui passait par là.
Le Bug est la frontière. En deçà de ce Bug, 27 pays se sont nécessairement dilués dans une même solution d’avenir. Mais plus profondément ancré que celui de pays, est le sentiment confus de la nation. Quoique l’ayant toujours désavoué pour le savoir dangereux à manier, je n’ai pris la pleine conscience de ce concept fumeux, mais combien réel, qu’en exil.
Un pays, c’est une géographie avec des bornes imposées ou sauvegardées au gré de la fortune des armes. Un pays, c’est un paysage, la planète virtuellement cousue de pointillés. Une nation, c’est des gens qui vivent avec des repères communs. Avec des douleurs et des chants communs. Des gens qui sont tels qu’ils sont et qui se reconnaissent ainsi parce qu’ils ont parcouru un même chemin, qui remonte à la nuit des temps et que rien ne peut effacer.
Une tribu.
En Pologne, après bien des divagations, le pays est acquis. Mais la nation est disloquée. Elle s’étend bien plus loin que la rivière Bug et, à l’autre bout, n’a jamais prétendu aux rives de l’Oder. De ce divorce entre la nation et le pays est né ce je-m’en-foutisme tantôt souriant, tantôt nerveux, qui entoure tous les détails de la vie quotidienne. On est d’accord avec le monde mais en sourdine on n’admet pas ce monde. L’homme de Gnojno était un Polonais exilé en Pologne. Tout comme ces milliers de Polonais transplantés à l‘ouest, dans l’ex-Allemagne.
Je me souviens d’un concert que je donnais à Wałbrzych, ville minière dans les Sudètes, à l’extrême sud-ouest du pays. Une trentaine de personnes étaient venues au rendez-vous. C’étaient tous des gens d’un certain âge, voire d’un âge certain, et d’une sympathie exquise.
Ils m’ont raconté avoir passé toute leur vie en France. Puis l’heure étant venue de mettre les outils au clou, le devoir de survivance en quelque sorte accompli, ils étaient revenus s’installer au pays. Ils avaient bouclé la boucle et dans leurs yeux tremblants, on voyait bien qu’ils savaient pertinemment ce qu’ils étaient revenus y faire, au pays. Au timbre de leur voix, on entendait aussi chuinter les mélancolies du double exil. Ces hommes et ces femmes avaient vécu leur vie en regardant sans cesse vers la Pologne, très loin, comme une promesse. Ils vieillissaient maintenant en regardant vers la France, comme vers leur vie trop vite enfuie.
Ils n’étaient pas partis de Wałbrzych. Wałbrzych était allemande, Wald burg, la ville boisée. Aucun polonais de leur génération n’y est né. Leur berceau était à l’autre bout, ici peut-être ou bien plus à l’est encore, mais le retour au pays s’était arrêté là, au confluent des frontières allemande et Tchèque. Ils ne pouvaient guère revenir moins loin. Comme s’ils n’eussent pas pu se résigner à retourner au début de leur histoire, de peur peut-être d’y perdre totalement de vue le parcours accompli. Peut-être aussi pour re-déguerpir à nouveau au plus vite, au cas où…
On ne s’installe que moitié rassuré à l’ombre des volcans.
L’un deux me dit avoir la double nationalité. Sur un ton si humble, tellement triste, comme s’il s’excusait de n’avoir pas su choisir vraiment, comme s’il avouait une sorte de bâtardise, que j’en éprouvai un pincement douloureux à la poitrine.
Ces hommes et ces femmes avaient regagné leur pays. Pas leur nation. Et ils vivaient à Wałbrzych les uns contre les autres serrés, de peur de se perdre peut-être.
Une tribu.
Ça n’est pas agréable à écrire et ni même à penser mais je ne suis pas de ceux qui bêlent à tout vent que l’Europe est à jamais sauvée des cataclysmes guerriers. Parce que derrière les poteaux qu’elles plantent pour marquer sa souveraineté, aussi loin qu’elle puisse étendre ses ailes, il y aura toujours un pays qui ne reconnaîtra pas ces poteaux comme plantés au bon endroit ou une nation qui s’en sentira bafouée. De plus, à l’intérieur même de son enceinte, et ce d’autant plus sûrement qu’elle ne cesse de s’élargir, longtemps des nations seront agitées par leur sentiment équivoque d’une adhésion forcée à une histoire usurpée, sentiment tellement nébuleux qu’il faudra bientôt le taxer de barbare. Peut-être, sûrement même, les générations d’un futur plus ou moins lointain aboutiront-elles à l’effacement de ce sentiment occulte.
Lorsque la dissolution liquide des pays dans un même bocal sera devenue plus compacte et plus solide.
Mais les hommes aiment lire le chemin dallé par leurs ancêtres pour arriver jusqu’à eux. Les hommes aiment réveiller les fantômes de leur généalogie parce qu’ils murmurent ainsi au plus profond de leur identité. Les hommes déracinés laisseront alors un vide, un trou béant, une incompréhension à leurs enfants des siècles futurs, soucieux de leurs premiers Edens. Et tant qu’il y aura ce manque de traçabilité de l‘histoire individuelle, subsistera ce sentiment d’appartenir à de lointains vaincus, la nation exterminée par le pays.
Prévoir que cette Europe est pour l’éternité à l’abri des guerres et des combats, c’est en outre juger que nous serions des hommes bien meilleurs, bien plus accomplis, bien plus intelligents, bien plus humanistes et bien plus généreux que tous ceux qui nous ont précédés. Et ça, c’est d’une incommensurable vanité partout démentie par les réalités.
POLSKA B DZISIAJ
12:41 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Dubitatif
11:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.08.2011
Est-ce qu'on appelle ça un poème ?
NON CREDO
Je ne crois ni à dieu ni à diable ni à hue ni à dia
Ni en haut ni en bas
Ni aux oiseaux ni aux demains
Qui chanteraient
Je ne crois plus aux nuits d’ivresse
Aux mots du philosophe aux phrases de l’écrivain
Au verbe du poète
Je ne crois pas n’ai jamais cru aux gens publics
Je ne crois ni aux hommes ni aux femmes ni même aux enfants
Je ne crois ni à la langue ni aux systèmes
De quelque côté des océans qu’ils se trouvent
Fussent-ils même de la lune des espaces intersidéraux
Je ne crois pas aux épaules des amis où appuyer ses doutes
Je ne crois pas aux larmes d’un frère
Mêlées aux miennes
Aux petits matins
Des grandes douleurs
Je ne crois pas à l’univers
Que des yeux éberlués dans la nuit voudraient
Infini
A la symbiose des esprits
A la vérité aux mots d’amour
Aux serments par le vent dilapidés
Je ne crois pas à la puissance des armes
Aux mémoires affligées des vaincus
Aux cris des vainqueurs
Aux guerres justes aux croisades
Aux idées
Aux démocrates
Je ne crois ni à l’argent ni à l’or
Je ne crois pas aux voleurs aux pilleurs aux vandales
A la bonté à la morale à l’éthique
Aux chiens perdus aux gens heureux aux repentants aux honnêtes gens
Je ne crois en Rien
Sinon en Toi
Alors je crois en Tout
Puisque je crois en Nous
Ton cul est une étoile
Janvier 2009
10:37 Publié dans Acompte d'auteur, Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.08.2011
Ce fut un bien bel échange - 2 -
C her Bertrand,
her Bertrand,
Depuis Rimbaud, nous sommes modernes. Résolument modernes. Et nous avons déréglé les sens, si bien déréglé et dans tous les sens du terme (sensualité, signification, direction) que voilà, voilà : n’importe lequel d’entre nous a acquis le droit de se proclamer poète, s’étant au préalable, reconnu voyant. Poète, voyant, c'est-à-dire révolté par essence, inspiré par nature, et libéré de toute forme, cela coule de source.
Il est, dans cette fameuse lettre dite du Voyant, non pas celle d’abord parvenue à Izambard, mais celle écrite à Demeny le 15 mai 1871, un terme peut-être trop souvent oublié, que je pose en italiques afin que chacun s’y arrête quelques secondes : Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Raisonné : Voilà qui donne tout son poids à la formule magique rimbaldienne, au sésame ouvre-toi de la modernité.
Raisonné, le mot ne signifie-t-il pas guidé par la raison ? Oh voilà qui flaire vilainement son Boileau, voire son Racine (le divin Sot !) et son Port-Royal, pour tout dire son classicisme honni par ceux qui, tout juste sortis de l’enfance, vomissent leur révolte nécessaire et abhorrent toute forme d’ordre, même langagier, même prosodique, même syntaxique : Raisonné : certains trouveront qu’il s’accommode mal du voyage fluvial puis maritime d’un certain bateau auquel on aura fait dire tant et tant de choses qu’il a fini lui aussi par devenir salement institutionnel. Et pourtant, il se trouve bel et bien sous la plume d’Arthur.
Comme René Char le souligna, il a bien fait de partir, Arthur Rimbaud, « d’abandonner les estaminets des pisse-lyres » - car ils raisonnaient peu, suis-je tenté d’ajouter. Aujourd’hui, plus que les pisse-lyres, ce sont peut-être davantage les pisse-révoltes que Rimbaud devrait laisser dans leurs estaminets. Slameurs, slameuses et autres voyants (voyantes) à trois francs six-sous pour printemps des poètes démocratiquement post-modernes. Car la révolte n’est ni un engouement passager ni une posture ; la révolte, ça ne se pisse pas, ça s’argumente. In fine, la poésie est-elle l’art le mieux armé pour le faire ?
La poésie, « l’art idiot », jadis, possédait ses règles, ses mètres et ses maîtres, ses rythmes et ses rimes, son projet intrinsèque à lui-même, lesquels, j’en conviens, avaient moisi pour reprendre la métaphore rimbaldienne. Mais n’ont-ils pas moisi également, ce lyrisme beuglard de la révolte, ce conformisme inoffensif de la provocation, et surtout, surtout, ce non-sens asséné comme une règle par tant d’imbéciles qui se proclament auteurs dans un pur et infécond suivisme, propre de la société de masse qui est la nôtre ?
« Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe Rollaque ; tout séminariste emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un carnet.», s’exclamait Arthur en son temps. A présent, « tout banlieusard rappeur et métissé est en mesure de slamer une apostrophe arthurienne, tout lycéen boutonneux de centre ville emporte les cinq cent rimes dans le secret d’un DVD. »
Sommes-nous pour autant à l’ère des « démultiplicateurs de progrès » ? A celle des apôtres d’un « langage universel » ?
La question, franchement, reste pendante…
Amicalement,
Roland
PS. On vient de découvrir une prétendue nouvelle photo de Rimbaud. Coup éditorial ou véritable scoop ? Comme je n’en sais fichtrement rien, je vous joins celle-ci, plus connue, celle du fameux bon élève de Charleville qui dans le rêve de chacun d’entre nous, a eu son heure de gloire, je présume.
 Cher Roland,
Cher Roland,
Je commencerai par une sale image qui m’avait donné la nausée, il y a de cela une quinzaine d’années, sur un parking de supermarché, un Intermarché très exactement, à Mauzé-sur-le-mignon plus précisément, vous savez, le Mauzé de ce cochon de Morin des Contes de la Bécasse.
Bref, c’était aux alentours de Noël. Les livreurs s’affairaient à remplir les rayons de peluches, de barbies, de chocolateries, de champagne plus ou moins frelaté et autres cochonneries de la fête obligatoire autour de l’improbable naissance d’un dieu encore plus improbable.
Et voilà que voici qu’un livreur perché sur son Fenwick se met à transbahuter parmi les rayons fortement achalandés - au sens juste et au sens fautif de ce mot -, des palettes entières de livres pour ceux qui voudraient fêter la naissance de leur dieu en cultivant leur jardin. Des livres de Rimbaud réédités dans une collection minable, sur un papier minable avec une couverture minable.
Ça n’est point que je tienne rigueur à la consommation de masse de se pencher sur Rimbaud…Mais j’étais certain que pour la clientèle de l’Intermarché de Mauzé, il y avait là beaucoup, beaucoup trop de Rimbaud pour être décemment lus.
Rimbaud, donc, est par le fait un produit de masse, une idée de cadeau, un présent au même titre qu’une bague, un portable, une tronçonneuse ou je ne sais quoi encore.
C’est une image réelle, vécue, mais je vous la sers en guise d’allégorie…
Rimbaud est devenu ce que les gens en ont fait et en premier lieu les discoureurs les plus abscons de la littérature. A force de dire qu’il était un découvreur, un déstructurateur du langage poétique, on a fini, ça a pris du temps mais on a fini quand même, par en faire une mode obligatoire, le nec plus ultra de la finesse en poésie mutine en même temps qu’une institution forcément à fréquenter au risque de passer pour un vil béotien.
C’est un poncif : on dit qu’il aurait ouvert la porte à toute la horde surréaliste. Qu’il est à cette école ce que Bernardin de Saint-Pierre fut au romantisme. Soit. Ne dénions pas à Arthur Rimbaud sa vision autrement du monde et l’intelligence sensible, douloureuse, avec laquelle il nous fit part de cette vision autrement.
Mais, comme toutes les grandes choses mises à la portée des trivialités marchandes et de leur confusionnisme intéressé, il a évidemment sombré dans la vulgarité de ses exégètes. Et je vous suis bien Roland, quand vous semblez vous agacer de tous ces poètes autoproclamés qui pensent qu’écrire difforme et cul par-dessus tête en torturant la langue dans tous les sens suffit à livrer du monde la vision chaotique de la poésie et à brandir le drapeau toujours sympathique et échevelé de la révolte.
Pourtant la déstructuration du verbe est une chose des plus ringardes. Dès 1956, Debord écrivait dans son rapport sur la construction des situations : « L’erreur qui est à la racine du surréalisme est l’idée de la richesse infinie de l’imagination inconsciente. La cause de l’échec idéologique du surréalisme, c’est d’avoir parié que l’inconscient était la grande force, enfin découverte, de la vie. C’est d’avoir révisé l’histoire des idées en conséquence, et de l’avoir arrêtée là. Nous savons finalement que l’imagination inconsciente est pauvre, que l’écriture automatique est monotone et que tout un genre « d’insolite » qui affiche de loin l’immuable allure surréaliste est extrêmement peu surprenant .»
On ne peut mieux dire et ces mots d’un demi-siècle d’âge sont hélas d’une brûlante actualité.
On m’a souvent fait le gentil reproche d’user d’une langue classique…
J’assume évidemment, et ce, pour au moins deux raisons .
La première est que je suis persuadé que le miel est plus délectable que l’étiquette du pot.
La seconde, plus essentielle, c’est que c’est de cette langue écrite et entachée d’un certain classicisme, que je tire le plus de plaisir. Mon approche du monde, ma friction à son âpreté, dans ce qu’elle a d’authentique et de vécu, a besoin du sujet, du verbe et du complément pour être dite sans ambages.
Si nous sommes en révolte contre un monde structuré de telle manière qu'il ne nous plaît pas, ça n'est pas en mettant du désordre raisonné dans notre écriture que nous le mettrons en danger. Cette façon de procéder, encore une fois, fissure l'image en laissant intact le réel et lâche la proie pour l'ombre.
Et j’en termine, cher Roland, sur ce vieil adage : Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse !
Certes. Encore faut-il qu’il y ait de quoi se mouiller les amygdales dans le susdit flacon.
Amitiés sincères et polonaises
Bertrand
12:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.08.2011
A vot'bon cœur
 Il me faut prendre quelques précautions avant d’écrire ce que je me propose d’écrire là.
Il me faut prendre quelques précautions avant d’écrire ce que je me propose d’écrire là.
Redire, quoique de nombreux textes de ce blog abondent dans ce sens et notamment la correspondance que j’eus un temps avec Philip Seelen, que je suis à des années-lumière d’être un thuriféraire du système collectiviste défunt qui sévit à l’est et en Europe centrale, cinquante longues et pénibles années durant.
Bien avant de venir vivre en Pologne, d’ailleurs, j’étais un adversaire résolu et convaincu des staliniens de tout poil, des gros cons du PCF aux imbéciles gauchistes maoïstes, trotskistes, en passant par tous les autres, planqués sous des attitudes et étiquettes diverses.
Mon propos est ici un détail. Un détail amusant. Qui m’a bien plu. Et encore une fois, dire que rien n’est jamais tout noir ni tout blanc dans les différents avatars que traverse l’histoire, même si certains sont beaucoup plus foncés que d’autres...
J’affirme parfois, par exemple, que le meilleur allié historique de l’église catholique en Pologne, fut son ennemi déclaré, le communisme. En effet, du combat que se livrèrent ces deux idéologies, c’est bien la première qui est ressortie nettement vainqueur et qui, par une sorte de revanche, par réaction, est devenue l’idéologie dominante et dominatrice, présente dans tous les secteurs de la vie sociale.
A bien des égards, plus envahissante sans doute que ne le fut le marxisme- léninisme. Je pense à son enseignement dans les écoles publiques et je pense à cette enfant, pénalisée l’année dernière pour ses mauvais résultats dans cette matière honnie, alors qu’excellente partout ailleurs, dans les vraies disciplines dignes de figurer au planning de formation et d’ouverture d’esprit d’un môme.
La honte. Ne suis pas certain qu’un enfant du communisme aurait pu être pénalisé s’il avait mal ânonné quelques poncifs du Manifeste ou de l’Idéologie allemande.
Mais je suis très optimiste. L’idéologie dominante, comme partout et comme toujours, trop sûre de sa victoire, de sa pérennité, de son pouvoir, s’évertue à creuser sa propre tombe par une succession d’abus qui finissent par la dénoncer et la convoquer manu militari sur le banc des accusés.
Et dans un livre honteusement assassiné par François Bon (tiens, on parlait de stalinisme ?), Polska B Dzisiaj, je disais déjà et je dis encore :
« Bien sûr que je suis heureux que la Pologne soit débarrassée de l’ignoble système dit communiste. Mais si c’était pour en arriver là, au règne absolu de la marchandise au détriment de toute autre valeur, règne béni par les onctions obsessionnelles de la soutane, vraiment, ça me semble d’une hygiène douteuse, genre qui aurait traité des charançons avec une poudre propice à la reproduction des cancrelats. »
Mais je m’éloigne de l’initial et plaisant détail dont je voulais parler.
Aujourd’hui, dans les pays dits riches - disons endettés jusqu’au cou pour être plus exacts - nombre de décideurs ou (et) de candidats à cursus honorum n’en ont que pour le développement durable et l’écologie. Normal : « continuez à souiller votre lit, et une belle nuit vous étoufferez dans vos propres déchets.* » L’avertissement avait été clair. On ne l’a cependant entendu qu’une fois profondément englué dans les poubelles.
Au programme de ce développement durable, figure quelque part, sous des tonnes d'autres recommandations, l’incitation au covoiturage. Histoire de réduire les exhalaisons des pots d’échappement. Je doute fort que la mesure soit efficace, mais au moins comporte-t- elle un soupçon, une apparence, de fraternité.
A l’époque communiste les décideurs devaient se soucier de la santé de la planète comme d’une cerise. Il existait pourtant une incitation institutionnelle en direction des automobilistes pour qu'ils prennent à leur bord les auto-stoppeurs. Ceux-ci étaient munis d’une sorte de carnet authentifié, dont il signait et détachait un feuillet qu’il remettait au conducteur complaisant. Fort de ces attestations, l’automobiliste portait les billets je ne sais où et recevait je ne sais quel avantage.
Vous voyez que j’en sais peu, mais assez quand même pour regretter que les pays capitalistes n’aient pas eu, à l'époque, la même idée pour m’éviter des heures, voire des journées d’attente Porte d’Orléans ou ailleurs.
Certes, cette mesure était certainement une mesure de gestion de la misère, peu de gens étant dotés d’une automobile, mais son esprit reste un bon esprit.
Avec le temps, bien sûr.
* Le chef indien Seattle devant l'Assemblée des tribus d'Amérique du Nord en 1854
11:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.08.2011
Ce fut un bien bel échange - 1 -
C'était sur Non de Non, blog que nous partagions alors avec Stéphane Beau et Stéphane Prat, et c'était un échange entre Solko et mézigue.
J'en reprends ici deux échantillons qui me sont revenus en mémoire, suite au commentaire laissé par JLK sous le texte précédent et parce que Roland y abordait un sujet crucial dans le domaine de la création littéraire. Bonjour Bertrand
Bonjour Bertrand
On retient souvent, comme ça, des idées, des bribes d’idées même, dont on a oublié la provenance. Qui a dit qu’un grand livre n’est qu’une conversation tenue par un vivant avec un autre grand livre, écrit par un mort ? Ne sais plus trop. En tout cas, si les lecteurs ont souvent l’impression de se repérer dans un texte qu’ils découvrent grâce à leurs lectures antérieures, ne serait-ce pas parce que les écrivains leur en ont donné l’habitude en rendant souvent hommage, dans leurs textes, à ceux qui les ont précédés, et dont ils portent la trace ?
Dans Zozo Chômeur éperdu, j’avais relevé des allusions explicites à Raboliot et à La dernière harde, romans de Maurice Genevoix.
Dans Géographiques, vous citez plusieurs auteurs, mais c’est sur la figure de Roger Vailland, dont vous évoquez deux titres, La Fête et Les Mauvais coups que je voudrais m’arrêter. Il y a dans ces deux cas un doigt pointé vers, une invitation de lecture, même. Certes. Mais les liens que vous établissez entre vos textes et ceux de Genevoix ou Vailland ne cachent-ils pas autre chose ? N’ont-ils pas pour raison une image intime que vous avez de ces auteurs, voire de ces figures humaines ? Une image intime, aussi, qu’ils vous ont tendue de vous, ou encore une image de vous que vous souhaitez porter jusqu’à vos lecteurs ? Une image, pour aller jusqu’au bout de ma pensée, liée à un certain refus, et à une certaine joie de vivre ?
Oh, je sens bien que je deviens indiscret. Mais l’indiscrétion n’est-elle pas la raison d’être de toute correspondance ?
Je vous dis tout cela parce que je me suis pour ma part fabriqué une sorte de père idéal en littérature, et puis aussi quelques frères ou sœurs de routes, et puis quelques bons copains, et mêmes toute une pléiade d’oncles, de tantes et de cousins.. Et ces formes d’empathies, si chimériques fussent-elles, se sont toujours révélées, à l’examen, plus signifiantes que je ne le croyais de prime bord.
Ce Genevoix, ce Vailland, dont je ne résiste pas au plaisir de vous glisser une photo dans l’enveloppe, Zozo et Géographiques auraient-ils existé pareillement en vous si vous ne leur aviez pas explicitement rendu hommage ?
Je vous autorise, et avec moi tous ceux qui liront cette lettre, à nous parler d’autre chose si vous le souhaitez. De l’euro qui fait du yoyo, de la coupe du monde qui pointe le bout de son nez, ou de l’intérim présidentiel en Pologne dont pour vous dire la vérité nous ne savons pas grand-chose en France. Cependant, entre nous, qu’y-a-t-il de plus intéressant, quand on s’intéresse de près à l’écriture, que ce type de relations – et de motivations profondes -, par lesquelles nous nous mettons, d’une certain façon, au monde ?
Mes amitiés lyonnaises, mon cher Bertrand.
Au plaisir de vous lire.
Roland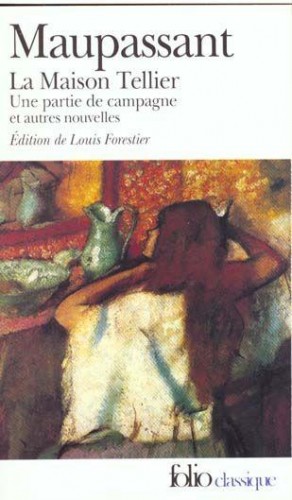 Cher Roland,
Cher Roland,
J’ai lu votre lettre avec beaucoup de joie ( en voilà une introduction qu’elle est bien courtoise et fort originale, ma foi ! ) car les sujets que vous y abordez sont effectivement essentiels pour qui se mêle d’écrire.
Vous mettez le doigt sur l’historique d’une écriture et dévoilez ainsi que nul, en ce domaine comme dans tous les autres, ne se fait soi-même mais trimballe dans ses valises (dans son encrier, en l’occurrence) des références, toute une famille qui depuis longtemps ne le quitte plus et qui murmure dans l’ombre, sans pour autant que l’auteur ait conscience d’entendre ces murmures.
Car, dès que le couvert est mis, cette tribu sympathique s’invite régulièrement et sans vergogne aux plaisirs d’écrire. Je n’avais en effet jamais prévu d’introduire Genevoix ou Maupassant au départ de Zozo, pas plus que Roger Vailland au départ de Géographiques. Mais, à un certain moment, quand la fête battait son plein, ils sont accourus d’eux-mêmes tels de vieux fantômes et parce qu’ils avaient sans doute entendu qu’on se livrait en ces lieux à leur débauche favorite d’antan. Ils se sont imposés. Sans eux, la fête eût été un peu bancale.
Genevoix, je l’ai rencontré adolescent. Au milieu des champs et des bois et quelle merveilleuse sensation que celle d’éprouver soudain qu’on est en train de vivre dans un livre, avec des mots qu’on voudrait soi-même avoir ciselés, ce qui vous entoure en réalité et que vous aimez, du chant du merle noir à la buse qui plane en haut du ciel, jusqu’à la fraîcheur de la prairie en passant par les pénombres des sous-bois.
Forcément alors, penché sur mon manuscrit, tout cela s’invite, tant l’émotion d’écrire et celle de lire jouent sur les mêmes partitions.
Il en va de même pour Vailland, quoique j’aie fait sa connaissance beaucoup plus tard.
À un âge un peu plus désabusé. Quand le parcours est déjà abîmé. Ce n’étaient plus les paysages qui étaient présents mais l’obstination à vivre pleinement sa vie, mêlée à un certain désespoir et à un goût prononcé pour l’ivresse et les jeux de l’amour.
J’ai tout lu de vailland, jusqu’au volumineux et inachevé « Ecrits intimes » qu’une de ses anciennes amies, que j’ai eu la chance de rencontrer à Paris, m’avait gentiment offert. Cependant, Roland, en dépit de tout ce que j’ai pu lire et de tout ce que je lis encore de livres et d’auteurs, s’il est un seul livre que j’eusse aimé écrire, un livre qui m’a profondément marqué, ému, bouleversé, c’est bien Les Mauvais coups.
Nul autre n’est venu à ce jour me procurer la sensation de lire un frère. Plus qu’une oeuvre, un miroir, même si ça n’est pas ce qu’on demande à un livre, mais je me situe là plus sur le domaine du « sensiblement personnel » que sur l’échelle toujours un peu pourrie de la cotation littéraire.
Bizarrement, je n’ai jamais osé remettre le nez dedans. Je l’ai refermé, voulant sans doute garder intacte ma première sensation. Il reste pour moi le chef-d’œuvre de mon équinoxe de la quarantaine.
Alors, vous avez vraiment vu très juste en posant la question si , en citant un tel ouvrage, de façon inopinée, anodine, ça n’était pas une certaine image de moi, fugace, que je voulais transmettre. Je n’en avais pas pris l’exacte mesure et je vous dois cet éclaircissement.
Cependant, j’ai un père plus incontesté encore en écriture. Le maître. Celui qui me poursuit partout et duquel j’essaie cependant de calmer les ardeurs. Oui, il s’invite souvent sous ma plume et je dois quelquefois l’en chasser. Il me ferait trop d’ombre.
Vous l’avez sans doute deviné, il s’agit de Maupassant, d’ailleurs également nommé dans Zozo… Et j’ai été ému, touché, à l’époque, par la critique de Jean-Louis Kuffer qui disait, sans ne rien savoir de cette filiation, qu’il y avait dans mon livre un goût de Maupassant. Comme quoi, quand on a à faire à des lecteurs de cette envergure, il n’y a pas de secret qui ne puisse être mis au jour.
Et à propos de Jean-Louis Kuffer, je m’éloigne un peu, cher Roland, pour vous dire que je suis en train de lire un de ses livres Le viol de l’ange , un livre étrange, troublant, très, très original.
J’en reparlerai sans doute sur l’Exil des mots.
J’aurais voulu vous entretenir également d’un tout autre sujet mais j’ai été un peu long. Ce sera donc pour la semaine prochaine.
En tout cas, merci pour cette correspondance et la qualité de votre lecture.
Portez-vous bien et amitiés polonaises.
Bertrand
10:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.08.2011
Nouais ou, même, Nooouuuaaais...
 Nouais, ou Noouuuaais, répondait plus sobrement et sur son état civil au prestigieux prénom de la dysnatie, Louis.
Nouais, ou Noouuuaais, répondait plus sobrement et sur son état civil au prestigieux prénom de la dysnatie, Louis.
Mais ses ricaneurs de voisins préféraient nettement l’appeler Nouais, voire Noouuuaais.
Noouuuaais, qu’on disait derrière son dos, en tordant beaucoup le nez et la bouche, dans le même sens, en fermant bêtement les yeux, en prenant un air franchement idiot et en accentuant très exagérément la première syllabe. Noouuuaais.
On prétendait par ce sobriquet émis comme il se doit, singer sa nonchalance débile, son accent graisseux et l'incurable bêtise dont il était censé souffrir.
Le personnage possédait, il est vrai, cette prodigieuse faculté des gens dont la vie est simple comme bonjour, d’avoir son mot savant à dire sur tout. Sur la politique qui était dégueulasse avec De Gaulle, sur la détérioration de la météo, sur la façon dont il fallait travailler, opposée au modernisme qui pointait à l’horizon le bout de son sale nez, sur l’école qui ne sert pas à grand chose après quatorze ans sinon à former des merdeux prétentieux, sur ceux qui sont honnêtes parce qu’ils préfèrent aller au bistrot qu’à l’église, sur ceux qui sont mauvais parce qu’ils ont beaucoup de terre et une automobile pour aller prier, sur la qualité du pinard d’un tel ou d’un tel, sur la guerre qu’il était le seul au village à avoir fait, les autres étant soit trop jeunes, soit trop vieux, soit…et là ça finissait par un murmure grinçant, un juron et un crachat épais. Dans l'ordre.
Ah sur la guerre ! Sur la guerre, Louis était intarissable. Un puits de science. Il en savait tout. Il la portait dans sa chair. Il la décrivait comme si on y était et pour nous autres en culottes courtes de pubère, il était un vrai grand livre ouvert sur ces cataclysmes que nous n’avions pas vus, que ma mère évoquait souvent et qui semblaient avoir traîné jusques dans mes chemins, aux portes de ma maison, avec des soldats gutturaux, casqués, armés jusqu'aux dents et rapinant tout ce qui leur tombait sous la main.
Nouais parlait de la guerre beaucoup mieux que l’instituteur qui généralisait, qui montrait des cartes et qui donnait des dates qu’il fallait apprendre. Ce que disait Nouais, lui, ne réclamait pas qu’on l’apprît par cœur et qu’on le récitât. Ça ne réclamait rien, tant c’était beau et inquiétant à écouter ! Comme au théâtre.
Il décrivait le feu, le sang et la terre qui volait en éclats et les copains tombés dans la boue, avec une précision épouvantable qui nous donnait la chair de poule.
Mais, hélas, hélas, il décrivait toujours aux mêmes heures. C’est ça qui était curieux pour nous, les mômes qui travaillions chez lui au ramassage du tabac durant les mois d’été. C’était toujours après le repas de midi, juste avant la sieste de quatorze heures, quand Noouuuaais s’était goinfré beaucoup et avait bu comme un vrai Gaulois. Ou alors après la petite collation de seize heures, avec pâté, fromage, rillettes, saucissons, poulet froid, gâteau et deux litres bien frais, épais, parfumés, tirés à la barrique. Ça le rendait mélancolique, ces repas, qu'on se disait nous autres. Mélancolique et grand narrateur.
Si, avides et curieux, nous tentions de l’interroger dans la matinée ou alors assez longtemps entre deux prises, Nouais, agacé, soufflait, gonflait son gros nez et disait qu’il avait pas de temps à perdre avec des conneries pareilles.
On était là pour travailler, miladiou !
Image : Philip Seelen
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.08.2011
D'assourdissants silences
L’histoire est ainsi faite : des évènements, des désastres et de hauts faits connus de tous depuis les premiers bancs d’école, des subtilités plus profondes appréhendées des seuls universitaires, des tenants et des aboutissants occultes, délices des historiens et des chercheurs, puis enfin des fragments épars totalement ignorés, victimes d’un étrange silence et sur lesquels on tombe par hasard, au détour d’un vagabondage.
Tel fut bien ce qui m’advint à Sarnaki, charmante petite bourgade coulant des jours paisibles et verdoyants à 140 km à l’est de Varsovie.
Un monument surprenant
La campagne alentour évolue de forêts en vergers, de prairies indolentes en bosquets éparpillés, de chemins de traverse en ruisseaux herbeux. Les branches des fruitiers plient sous le poids des griottes, poires et autres pommes, tel qu’au jardin des Hespérides.
C’est un peu vous dire si, arrivant à Sarnaki, les dispositions d’esprit sont au calme, au charme et au bucolique, à des années-lumière des cataclysmes guerriers.
C’est aussi vous dire si le sourcil se fronce, incrédule, en apercevant au beau milieu de la petite place, un énorme engin de guerre, le nez planté dans la terre et élevant haut dans les airs son fuselage et ses ailerons.
Bien que n’étant pas un grand passionné de la chose militaire, je me suis approché et j’ai lu, interloqué : « Oni ocalili Londyn, They saved London »
Diantre !
Qui ça ?
Et quel est donc ce monstre échoué là, queue en l’air, comme s’il tentait désespérément de rejoindre les redoutables entrailles de la terre ?
Sarnaki. Pologne de l’est. Sauvé Londres.
Des pages essentielles avaient dû être escamotées de mon manuel d’histoire.
L’arme quasi absolue
En matière de conquête de l’espace, il est communément admis que les pionniers furent les Soviétiques et les Américains.
C’est aller un peu vite en besogne en occultant carrément le programme du IIIème Reich de mise au point de tout un arsenal de fusées, et ce, depuis 1937.
Lancée le 3 octobre 1942 depuis la base de Peenemünde, port d’Allemagne sur l’estuaire de la Peene, une fusée de plus de 14 tonnes, s’est élevée à une altitude de 83 kilomètres et à la vitesse de 1340 mètres/seconde, soit près de mach 4.
Pour la première fois, un objet conçu et fabriqué par des hommes avait donc pénétré dans l’espace, ce qui avait fait dire à Walter Dornberger, officier responsable jusqu’en 44 du projet V2 :
« Nous avons envahi l’espace et nous avons utilisé cet espace comme pont entre deux points situés à la surface de la terre. Nous avons prouvé que la propulsion par fusée était utilisable pour se déplacer dans l’espace …. » Et d’ajouter « Aussi longtemps que durera la guerre, notre première mission sera de perfectionner rapidement la fusée pour qu’elle devienne une arme. »
C’est donc logiquement au général en chef des SS, Heinrich Himmler, que sera confié le programme allemand de développement des armes nouvelles, jusqu’à ces terribles bombes volantes, ces missiles balistiques, les V1, puis les V2.
V comme Vergeltungswaffe, arme de représailles qui, selon Hitler, devait assurer au IIIème Reich une hégémonie de 1000 ans.
S comme silence, S comme Sarnaki
Dans tout ce que j’ai pu lire, entendre ou voir sur la question, nulle part ne figure le nom de Sarnaki, sinon à Sarnaki même.
Et pourtant…
C’est bien dans cette campagne environnante de Sarnaki qu’étaient effectués, pour une bonne part, les tirs d’essai du V2.
C’est bien ici que des résistants polonais de l’AK se sont évertués, au péril de leur vie et de celle des leurs, à collecter les débris des explosions. Ils les faisaient ensuite transporter à Lublin, puis à Varsovie ou d’autres résistants, ingénieurs et techniciens, les analysaient et envoyaient les conclusions de leurs recherches à Londres.
C’est bien grâce à ces hommes de l’ombre, à ces Polonais anonymes à qui aucun honneur n'a été rendu, que les Alliés furent bientôt convaincus que l’Allemagne nazie était sur le point de se doter d’une puissance de feu redoutable.
C’est bien ici qu’en mai 44 un missile tombe sans exploser et c’est bien sa réplique exacte, dans la position où il fut retrouvé, qui a été érigée sur la place en 1995 et sur lequel je suis tombé, effaré de réapprendre l'histoire, au hasard d’une promenade.
Moisson de matière grise
Après mai 1945, les Alliés époustouflés devant les réalisations technologiques des Allemands, se livrent à une véritable curée.
La plupart des missiles sont embarqués sur des navires, direction les USA en même temps que 122 ingénieurs capturés, dont Walter Dornberger lui-même, sont priés de traverser l’Atlantique.
Les soviétiques récupèrent des débris en Pologne, ici même à Sarnaki, et prient gentiment, eux aussi, les ingénieurs nazis de bien vouloir les accompagner jusqu’à Moscou.
Les Britanniques s’attachent également les services d’une vingtaine d’ingénieurs.
La France, quant à elle, obtient, au bout d’âpres négociations avec le commandement américain, de récupérer 250 ingénieurs. Parmi eux, Heinz Bringer, qui inventera le moteur Viking des Ariane.
... Et vous dire ce que je pense réellement de tout ça, nous prendrait un temps que je n'ai pas.
B.REDONNET
Article publié dans "Les échos de Pologne", numéro 89 de septembre 2008.
09:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.08.2011
Lettre à mézigue
 A toué mon ami des lisières, arpenteur des rondes frontières et d’ailleurs…
A toué mon ami des lisières, arpenteur des rondes frontières et d’ailleurs…
De retour de la Creuse, après une mise au vert et des « mériennes régénératrices », je t’écris cette bafouille depuis mes champs derrière et ce petit bout du Poitou qui nous rassemble et nous ressemble… où les pierres usées des chemins creux murmurent des histoires d’hier et d’aujourd’hui.
Des nouvelles des bouts de chandelle qui arpentent les venelles avec un peu d’humanité au bord des cœurs en bandoulière.
Juste envie de mettre en partage nos talus vagabonds où poussent les coquelicots frêles et résistants.
Une petite bafouille pour tisser cette histoire, qui par-delà frontières et barrières, fait rimer joliment ces mots tant de fois galvaudés, fraternité et humanité.
T’en souviens-tu de ces premiers courriels où je te parlais de cette envie de mettre en voix ton « Zozo » ?
Et puis, guitare en bandoulière, tu es venu l’automne dernier pour la création de cette lecture à haute voix, « Zozo, chômeur éperdu ».
Avons parcouru le Poitou-Charentes, de village en village et depuis « Zozo » va son chemin…
Cet été, le « Zozo » a même été programmé au « festival au village » à Brioux-sur-Boutonne et au festival « Contes en chemins » à Sainte- Eanne (avec en prime, ta présence avant que tu ne repartes vers ton « exil », là-bas…)
Et dans « la grande et belle chaîne du livre… », loin des beaux discours, en artisan de la lecture, en semeur de paroles aux quatre-vents, je continue à semer mes petits cailloux… non… nos petits cailloux… sans toué mon ami des lisières, cette lecture de « Zozo » n’aurait pas emprunté les routes vicinales et improbables, loin des lieux institutionnels de la culture et de la littérature…
Et sais-tu qu’en colporteur, j’ai toujours dans ma valise à histoires et à mémoires, tes livres que je vends en marchand des quatre-saisons… ?
Et sais-tu que nous n’avons pas fini notre ouvrage ?
De nouveaux projets, de nouvelles rencontres, fleuriront nos saisons à venir…
En attendant de te revoir, toi et ta p’tite famille, et de te donner des nouvelles d’ici,
Je t’embrasse en braconneur de paroles,
je te salue en arpenteur de livres,
je te serre la pogne en passeur de mots
je t’envoie de grandes brassées fraternelles…
Jean-Jacques
10:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET




















