24.08.2010
Des poissons, des cochons, des auges et des rivières
Il ne peut pas être malsain de s’interroger un peu sur ce que l'on fait et, l’examen à peu près terminé, d’en tirer, les moyens et l’envie aidant, quelques conséquences.
L’écriture est d’abord plaisir de ce cordon vital qui nous rattache au dessin du monde. J’entends par monde la combinaison vivante, contradictoire ou non, de celui qui nous est propre, surgi de nos archéologies respectives, et de celui dans lequel nous baignons objectivement, l’un n’étant quasiment rien sans l’autre, liés comme le poisson l’est à la rivière.
L’écriture, c’est d’abord affaire de solitude qui veut être confrontée au langage.
La raison sociale de cette écriture – au sens strict et non, bien évidemment, au sens d’un Siret d’entreprise – c’est donc d’ambitionner que soit distribué, offert, un autre plaisir, qui est celui de la lecture. Un partage humain.
Dire que l’un peut aller sans l’autre, dire par exemple qu’on peut prendre plaisir à écrire sans souci d’une quelconque audience, me paraît désormais comme une sorte de déviance romantique de l’échec de mauvaise foi. Plus simplement, comme le renard de la fable et ses raisins verts.
De même que n’écrire que pour l’audience, n’est pas écrire mais vendre pour payer son loyer. Du Marc Levy, par exemple ,ou, comme le signale Roland Thévenet, de la putasserie politique.
Ceci étant dit comme valant pour toutes les époques, même si un monument comme Stendhal faisait en 1835 le pari de n’être lu, compris et aimé qu’en 1935. Pari gagné et bien au-delà, mais je ne suis pas Stendhal, ni par la virtuosité, ni par le flegme des monuments.
Pour toutes les époques donc, sauf, peut-être, la nôtre qui a quand même ceci de bien particulier dans le domaine, d’avoir à affronter une révolution avec l’écriture et la lecture numériques d’une part, et l’inextricable foisonnement des productions d’autre part, traditionnelles ou numérisées.
Depuis cinq ou six ans, la profusion des blogs et sites sur la toile offre un panel ahurissant de choix de lecture. Et de plaisir d’écrire, j’espère.
Mille voix veulent être partagées, mille préoccupations du monde veulent être dites en même temps, mille poésies particulières veulent se faire entendre et il serait tout à fait incongru de parler ici d’une hiérarchie de la qualité, mon propos tenant du procès-verbal d’un comportement social et non du procès tout court.
Qu’on ne se cache donc pas, d’abord, la réalité, condition première à une interrogation sincère sur soi-même : Ecrire au numérique, tenir un blog ou un site, un atelier, c’est pousser son cri dans un brouhaha déjà assourdissant, même si certains crient plus fort que d’autres et qu’on entend mieux, dans cette cacophonie tonitruante, leur présence.
Vous est-il arrivé de somnoler dans une foule, dans un train bondé, un autobus, une fête qui s'éternise ou une salle d’attente ? Vous entendez alors le vacarme, comme déjà un peu loin, mais ça n’est pas un vacarme uniforme. C’est un bruit de fond permanent, sourd, obstiné, avec de temps en temps, des notes qui se distinguent mieux, des aspérités du bruit qui viennent jusqu’à vous et enregistrent une présence humaine, plus particulière que les autres.
Tel est le bruit des blogs, des sites et des livres sur internet. Etre entendu devient difficile et nul n’a le droit et le pouvoir, fort heureusement, de prendre son clavier par le fil connecteur et de le frapper sur l’écran pour réclamer un peu de silence et une minute d’attention, s’il vous plaît.
Même ambiance de foirail pour l’écriture couchée sur papier. Les rentrées littéraires - il faudrait commencer par cesser d’être trompeurs pédants et ridicules et par apprendre à dire désormais plus simplement l'ouvertutre de la foire d'empoigne - balancent sur les étalages plus de 7oo romans, outre des kyrielles d'analyses du monde politico -médiatique, plus fines les unes que les autres et et caetera. Des semi - remorques, des trains, des convois entiers de productions cérébrales et artistiques sont livrés chaque année à la voracité désordonnée des lecteurs, comme à la voracité des marchés sont livrées chaque année dans des silos les tonnes de céréales moissonnées dans l'été.
On assiste donc, et je ne dis là rien de nouveau mais j’ai besoin de le dire, à une débauche presque répugnante d’expression écrite dans une époque où les gens, ces niais, ces béotiens, ces abrutis, sont, nous rabâche-t-on, censés de moins en moins lire.
Hiatus qui, si ça n’est déjà fait, risque fort de tordre le cou à ce qu’on appelle la littérature, mais là encore, le mot est tellement flou, intime, subjectif, blanc chez Paul et noir chez Pierre, que je ne sais même pas s’il signifie encore quelque chose de palpable pour l’esprit.
Hiatus parce si vous mélangez dans une auge, des carottes, de belles feuilles d’ormeau, de la bonne farine de blé, des patates bouillies, de la lessive, de l’acide sulfurique, du plâtre, du ciment, de l’argile, du carton, de deux choses l’une : ou le goret, sagement, va cesser de manger, trop dangereux et trop dur de trier le bon grain de l’ivraie, ou alors il va tout avaler et en crever à coup sûr.
Mais laissons là le cochon, ça a toujours mauvaise réputation, un cochon, présenté sous sa forme initiale, autre que charcuterie, et revenons-en à mon poisson et à sa rivière, à la complicité nécessaire établie entre le plaisir d’écrire et celui d’être lu.
Assis sous les aulnes sereins, pêchez donc un poisson et, l’ayant décroché du cruel hameçon, mettez-le sur l’herbe fraîche de la berge. Voyez comme il ouvre la gueule et voyez ses ridicules soubresauts ! Le changement de monde lui est insupportable et ces soubresauts sont l’effet de mouvements qu’il impulse à son corps et qui, normalement, s’il était dans la rivière, créerait un déplacement.
Prenez un écrivain - pêchez-le si vous voulez - changez-le de monde, privez-le de celui des lecteurs, et il fera les mêmes mouvements désespérés que le poisson. Ses grotesques soubresauts ne le feront pas évoluer d’un pas.
D’une nageoire, oui, si l’on veut. Et s'il ne veut pas en crever, autant alors qu’il abandonne sa condition d’écrivain et que, trop longtemps échoué sur la berge, il se fasse tout, sauf poisson.
Il existe plein d'autres agréables conditions.
Devant cette désacralisation du langage littéraire par l'abondance, la surenchère et l'amoncellement, tel est bien le dilemme auquel sont confrontés, qu’ils le sachent ou pas, qu’ils l’admettent ou non, qu’ils le disent ou pas, qu'ils soient muscadins du sérail ou non, tous les gens qui participent du brouhaha des blogs, dont je suis, comme tous ceux, et ce sont parfois les mêmes, qui se retrouvent sur les palettes discount de l’ouverture de la foire d'empoigne.
En juillet-août, la fréquentation de « l’Exil des mots » est devenue presque risible. Pas mille visiteurs uniques par mois. Une chute que je n’attribue pas forcément aux plaisirs de la plage ou de la randonnée montagnarde.
Une chute que j’attribue à la concurrence de plus en plus multiple, comme à mon incapacité à renouveler ce blog, dans sa forme et dans son contenu. Mon incapacité, donc, à élever un peu la voix par-dessus le vacarme.
Il me faudra donc revoir tout ça, m’investir plus, travailler mes cordes vocales, ou me taire.
« Géographiques », paru en mars à l’enseigne du Temps qu’il fait, serait, si j’en crois une communication de l’éditeur, un « bouillon ». 400 exemplaires vendus en juin…
Il y a donc, si je ne veux pas me croire, par amour propre ou simple vanité, la lessive, l’acide sulfurique, le plâtre, le ciment ou l’argile, de l’auge évoquée tout à l’heure, une certaine désespérance à écrire.
Et aussi cette trop évidente non-passerelle entre le numérique et le papier, aucun, en ce qui me concerne, ne se nourrissant de l’autre. Mais il faut dire que la prétendue solidarité internet, son amical partenariat, exception faite pour trois ou quatre amis de franche proximité, a brillé par son silence.
Parce que le vacarme - et je ne parle pas là que pour ma petite personne - ça génère aussi beaucoup de silence.
Dans le domaine du livre papier donc, comme je n’ai jamais éprouvé trop de plaisir à soliloquer, il me faudra conjuguer mon plaisir d’écrire d’une autre manière ou me faire mégalomane : Faire le pari d’être lu vers 2110.
Charmante perspective, ma foi. Mais qui me dit qu’en 2110, l’auge aura été assainie et que le brouhaha se sera fait audible ?
Rien n'est moins certain. Trop de retours en arrière et de bonds en avant à faire.
En attendant 2110, je vais quand même me rendre, peinard, bientôt en Deux-Sèvres, vers ses marais et ses campagnes indolentes, pour voir Zozo vivant dans un spectacle qui, je l'espère, le sera tout autant.
Illustration de Martine Sonnet : Librairie du faubourg Montparnasse, Géographiques en vitrine.
13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.08.2010
Titres


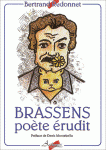

 Je n’ai jamais su trouver le moindre titre qui vaille pour un de mes livres. Sauf un.
Je n’ai jamais su trouver le moindre titre qui vaille pour un de mes livres. Sauf un.
Vous me direz que l’important est de trouver, préalablement, la matière première. Le titre, c’est l’affiche, l’emballage, l’état civil…Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse !
Pourtant un titre, c'est primordial. C'est avec lui que le livre voyagera ou ne voyagera pas. C'est comme ça qu'il se présentera devant ses juges, qu'il sera dit s'il n'est pas tu, qu'il sera répertorié dans une bibliothèque et etc..
Il arrive même que le titre efface le nom de l'auteur...C'est dire.
Pour Brassens, poète érudit, mon titre était : "Les Mots du Cygne". Je trouvais que c’était bien, moi, ce titre…Un peu pompeux…Référence au Cygne de Cambrai, quoique Brassens n’ait pas grand-chose à voir avec Fénelon, mais bon…
Et à propos de Bon, justement, François Bon, j’avais proposé, pour chez Bonclou et autres toponymes, "Mots hameaux"..Mot à mot…Bof…
Oui, il y a toujours des mots dans mes titres…François a choisi plus sobre. Avec bonheur.
Ah, pour Polska B dzisiaj, là j’avais rusé…Un titre en polonais. Vlan ! Accepté…
Quant à Zozo, le titre du manuscrit était on ne peut plus elliptique : "Zozo".
Ça n’a pas été…Georges Monti a choisi de qualifier Zozo comme on sait. Pas mal finalement.
Passons à Géographiques…Là, j’avais fait fort…Quand j’écrivais le manuscrit, le tapuscrit diront certains, le fichier s’appelait "Climats"…J’ai longtemps gardé ce titre, puis, après le point final, j’ai choisi "Géographies"…Je brûlais, là…Je brûlais…Je brûlais tant que je me suis éloigné et ai intitulé mon manuscrit « Couleurs du monde »…Un peu lourd, ça...
J'ai bien pensé à "Terre des hommes", mais c'était déjà pris. Et avec quel brio !
Je suis donc revenu à mes premières amours et j’ai envoyé le manuscrit sous le titre « Climats »…
Georges a tranché : Ce sera Géographiques, avec le genre Divagations, référence, flatteuse pour ma pomme, à Mallarmé.
Si je vous dis tout ça, c’est parce que je lis, sous la plume de Michel Crouzet, préfacier de Lucien Leuwen :
« Stendhal n’a pas eu à régler le problème du titre* de son roman, ou plutôt des sept titres envisagés et dont il faut dire un mot. Si la tradition a retenu le nom commode et banal de Lucien Leuwen, que Stendhal a lui-même employé, si bien que le meilleur titre serait sans doute le premier qu’il ait envisagé pour le manuscrit de Madame Gaulthier, Lucien Leuwen, ou l’élève chassé de l’Ecole Polytechnique, les autres titres, successifs et souvent contemporains (1) et associés, sont révélateurs de la complexité de l’œuvre, de la multiplicité de ses sens, et significatifs de la difficulté de Stendhal à la maîtriser, à en proposer une désignation unificatrice…. »
Complexité de l’œuvre et multiplicité des sens ? Rien de tel chez moi... Trop petit.
En revanche, difficulté à proposer une désignation unificatrice, certainement.
Toute proportion gardée.
* Lucien Leuwen est un manuscrit inachevé (Note de l’Exil des mots )
1 - Le 25 novembre 1835, dans sa lettre à l’éditeur possible, Levasseur, il propose au choix Le Chasseur vert ou Les Bois de Prémol (Note du préfacier)
12:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.07.2010
Bye....
Un à un, les blogs et sites amis baissent le rideau estival...
Normal. La présence sur le net, pour gratifiante qu'elle soit, demande beaucoup de disponibilité d'esprit.
Prendre l'air fait du bien.
Ce que je me propose de faire. Reviendrai vers vous d'ici une dizaine de jours.
Bon été à tous et toutes.
On se quitte sur un "classique" des années soixante-dix...
Amicalement
Bertrand
13:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.07.2010
A Monsieur le Président de la Chose publique
Bohémiens en voyage

La tribu prophétique aux prunelles ardentes
Hier s'est mise en route, emportant ses petits
Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits
Le trésor toujours prêt des mamelles pendantes.
Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes
Le long des chariots où les leurs sont blottis,
Promenant sur le ciel des yeux appesantis
Par le morne regret des chimères absentes.
Du fond de son réduit sablonneux, le grillon,
Les regardant passer, redouble sa chanson;
Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures,
Fait couler le rocher et fleurir le désert
Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert
L'empire familier des ténèbres futures.
Charles Baudelaire - Les fleurs du mal (1857)
Lire absolument ici les témoignages de François (1998) et ici, mes propres souvenirs d'enfance.
Avec ça qui swingue dans la tête :
09:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.07.2010
Considérations non intempestives
Je continue mon ménage d'été et ouvre les fonds de tiroir de L'exil.
Avec plus ou moins de bonheur.
Déjà publié en juin 2008
1 - Certaine modernité toujours encline à câliner la langue dans le sens du bon goût, celui qui privilégie l'apparent au détriment de l'essentiel, commande que l'on dise désormais un tapuscrit.
Ira-t-elle jusqu'à qualifier quelqu'un de beau clavier plutôt que de belle plume ?
Je verrais bien aussi un écrivain déclarer qu'il a tapé son livre en un an.
- Combien de livres a tapé Machin ? Qui a tapé tel roman paru chez un tel ? C’est un beau clavier, ce tapeur-là !
Une écriture tapée.
Sans doute ne croit-elle pas si bien dire, la modernité.
2 - Il ne me déplait pas d'être considéré comme un tantinet béotien.
Je n'ai jamais su vraiment ce qu'était un chef-d'oeuvre.
Certains monuments jugés incontournables de la littérature m'ennuient profondément tandis que des hors-d'oeuvre ont su me parler.
En peinture, une croûte peut m'inspirer alors que je trouve la Joconde vraiment moche.
En musique, je n'ai jamais pu écouter jusqu'au bout un grand classique, sinon peut-être, Vivaldi.
En archi, sorti du gothique flamboyant, et encore, je ne connais rien.
En cinéma, c'est la catastrophe. Outre que je déteste la promiscuité des salles, ma prédilection irait aux westerns série B, avec des fourbes et des justes qui se canardent à qui mieux mieux.
3 - Je ne hais personne, ça rend trop malheureux.
Je n'aime pas grand monde non plus, ça ne rend pas assez heureux.
4 - Je ne cherche pas à démonter les mécanismes et finalités d'un système pour le plaisir intellectuel de démonter ou parce que j'aurais une certaine idée morale de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas pour une société. C’est beaucoup plus simple, moins méritoire et plus ambitieux.
Je cherche à dénoncer, pour ma gouverne et en tant qu'acteur-témoin de ce monde, en quoi les multiples ramifications de ces mécanismes et de ces buts, sont des obstacles à vivre pleinement ma vie, telle de plaisir que j'estime qu'elle vaille la peine d'être vécue.
5 - Sarkozy, en tant que personnage réifié de la décadence politique et usurpateur de l'intelligence publique, est un espoir historique incomparable : Après lui - et quelle que soit la suite des non-évènements - ça ne pourra pas être pire.
6 - La coexistence pacifique entre la planète, comme lieu de résidence des hommes, et l'idéologie de la croissance est absolument incompatible.
La lutte est permanente et ne peut s'achever que par la mise à mort de l'une des deux combattantes.
Le développement durable est un lapin exhibé de leur chapeau par les escamoteurs-valets de la grande finance, en guise de modus vivendi capable de distraire l'attention et pour tâcher de camoufler un temps les douleurs de plus en plus stridentes de la contradiction.
Le développement du râble est un langage réservé aux éleveurs de lapins.
7 - Ce qu'on appelle écologie n'est que - mais c'est énorme - le reflet idéologico-politique, récupéré et réducteur, d'une exigence première, fondamentale et atavique : l'occupation humaine de la planète.
8 - La mondialisation, concept savamment flou, désigne en fait dans ses dernières extrémités, le jardin indispensable à l'âge triomphal de la grande finance.
Cette ultime mainmise sur la planète pourrait s'avérer être le point de basculement, tout comme chez Clausewitz l'effort consenti par le conquérant lors de l'offensive à son point culminant, conduit à l'épuisement de ses forces-ressources, bientôt à son effondrement.
La survie d'un conquérant est cependant toujours fonction de ses nouvelles conquêtes, comme la sauvegarde d'un mensonge est toujours au prix d'un nouveau mensonge.
Les diverses tentatives de conquête de l'espace peuvent être lues comme la recherche de nouvelles richesses à extorquer au cosmos, de nouvelles poubelles à exploiter, voire d'intelligences à asservir.
En un mot comme en cent, comme le projet d'un recul encore plus lointain des clôtures de la croissance.
9 - Si les refrains religieux me dégoûtent, les couplets tout aussi péremptoires des matérialistes athées ne me satisfont pas.
La chanson est sans doute d'une écriture plus complexe.
10 - Le rat est un commensal de l'homme, l'homme un commensal du capital.
Des richesses, des miettes et des poubelles.
Equilibre alimentaire trompeur : Supprimer le capital ne supprimera ni l'homme, ni le rat. Supprimer le rat, tout le monde est d'accord.
Supprimer l'homme, c'est en bonne voie.
11 - Lorsque je fais mon archéologie, les bribes et les tessons mis au jour finissent par faire un tout chaotique mais cohérent.
C'est une satisfaction, je le dis tout net.
12 - Quand on séduit tout le monde, c'est qu'on ne plaît à personne.
Et comme disait le poète sétois avec des moustaches : Il ne me déplait pas de déplaire à certains.
13 - La relation qu'on a à soi ne diffère pas de celle qu'on entretient avec le monde.
Au risque de fausser les deux.
14 - Aucune valeur au monde ne peut exiger que nous nous endormions dans l'ennui.
Vient un moment où il faut, avec joie, larguer les amarres.
Même celles, et peut-être surtout celles, que nous pensions être ancrées le plus profondément en nous et par nous.
15 - Je vis dans une organisation humaine qui ne me convient pas. Cela suffit pour que je puisse affirmer sans erreur qu'elle est mauvaise.
Mon bonheur est alors forcément subversif.
Un parti pris.
16 - Je ne compte pas assez de doigts aux mains, quand bien même les affublerais-je de mes orteils, pour dire le nombre de bas courtisans, d'imbéciles, de staliniens repentis, voire d’idéologues de la vieille droite, que j'ai pu croiser et qui, sans vergogne, faisaient l'éloge de La Société du spectacle ou du Traité de savoir-vivre, allant même jusqu'à se réclamer de la justesse de leur analyse.
Comme quoi la mêche situationniste a définitivement fait long feu.
17 - L'état actuel de la pratique numérique a poussé plus loin encore, au point de les contredire, les affirmations de la théorie situationniste selon laquelle " le directement vécu s'est éloigné en images."
Il n'y a en effet pas eu de conflit d'intérêt entre l'image et le vécu où la destruction de l'un eût été la condition sine qua non de la pérennité de l'autre.
Le directement vécu ne s'est pas éloigné au sens de mal-vécu et d'anéantissement de la présence humaine dans les activités humaines. Il s'est fait image à part entière et inversement.
L'image et le vécu, au lieu de s'engager dans une lutte à mort, ont pactisé dans la synthèse.
L'erreur consistait encore, même chez les situationnistes, à préjuger d'une certaine qualité de la vie, prédéfinie, posée comme postulat et point de ralliement de la critique.
Que la synthèse s'engage à son tour ou non dans un autre conflit qui la dépasserait ou la vérifierait, ça, j'en sais bougrement rien.
18 - Pris d'une douloureuse crise existentielle, le site Internet d'une collectivité départementale titre enfin : A quoi servons-nous ?
Les vraies questions sont souvent posées par inadvertance.
19 - Toutes les grandes passions amoureuses naissent d'une infidélité.
20 - Est-ce que les chats mangent du caviar ?
Non !
Alors cessons de nommer gauche-caviar ce qui n'est que bouillie pour les chats.
21 - Les Français sont vraiment versatiles dans leur tête :
Giscard avait une tête de noeud,
Mitterand une tête de Machiavel,
Chirac n'avait pas d'tête.
Ce après quoi ils ont élu une tête de con.
22 - Aucun homme au monde ne peut acquérir l'habitude de la misère, alors qu'à peu près tous composent dans la misère de l'habitude.
23 - Dialectiquement, le faux est un moment du vrai.
En politique aussi mais avec cette nuance que le faux est un cabotin qui tarde à passer le micro.
24 - Faire l'âne n'est pas sans risque : on ne sait jamais à quel moment précis le renversement s'opère.
Quand c'est l'âne qui vous fait.
25 - Un voyageur qui sait dans quel lit il mourra est déjà mort.
26 - Mathématique de notre modernité éclairée : L'espérance de vie qui n'en finit pas de s'allonger est inversement proportionnelle à l'espoir de vivre.
27 - Toute ma vie, j'ai eu peur de la mort....
Me reste plus qu'à espérer de n'avoir pas peur de la vie toute ma mort…
28 - Tous les catholiques que j'ai pu rencontrer abusaient de la syllepse : ils étaient de mauvaise foi.
29 - Même peu reluisante, la crise de foie d'un alcoolique est toujours moins grotesque que la crise de foi d'un catholique.
30 - Nietszche est mort.
Signé Dieu
31 - Si nous vivons le triomphe des idéologies libérales et de la grande finance, le regain de vigueur de la calotte et le répugnant retour de toutes les valeurs les plus mensongères et les plus aliénantes pour l'intelligence, le bonheur et la liberté humaines, ce n'est pas au génie stratégique des pouvoirs en place que nous le devons mais bien aux systèmes - aujourd'hui déchus - qu'on avait installés un peu partout, principalement en Europe de l'est et centrale, sous le nom usurpé de "communisme".
C'est en mettant en avant ces faux exemples, en taisant leur sédiment historique et en les introduisant ainsi dans la tête de leurs moutons comme ayant été la réalité du communisme, que le capital et la finance font perdurer leur domination et continuent d'étrangler la vie des hommes par amalgame.
Et pour très longtemps encore...
Tant qu'il restera un seul de ces communistes-là et un seul de ces prétendus adversaires de ce communisme-là, amusant la galerie chacun avec son usurpation d'identité.
Après, c'est inéluctable, les générations réécriront le mot tout neuf.
Mais pour tout dire, je m'en fiche.
Longtemps que je serai de l'autre côté de l'horizon.
32 - Quand on tombe amoureux, on perd l'équilibre...
Ça tombe sous le sens.
16:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.07.2010
Rêve
 Je dévalais la colline et ne maîtrisais plus mes pas.
Je dévalais la colline et ne maîtrisais plus mes pas.
En bas, il y avait un rideau de grands peupliers et, juste derrière ce rideau d’ombre tremblotante, la rivière qui bousculait des eaux transparentes et en cascades.
Je la reconnaissais, la rivière. C’était celle dans laquelle je pataugeais enfant. Celle de tous les opprobres quand je rentrais les chaussettes noyées de ses eaux froides. La Bouleure. On disait alors, par métonymie spontanée sans doute et quand chaque pas gargouillait dans les galoches, qu’on avait boulé.
Pour l'heure, il me fallait éviter la rivière à tout prix, donc tamponner un peuplier. Je n’avais pas le choix. La peur des punitions était plus forte que la peur du choc frontal. Je préférais, je m’en souviens nettement, m’écraser contre l’arbre plutôt que d’affronter le courroux maternel.
Je visai donc un arbre énorme, je fermai les yeux, mon galop s’accéléra encore et mon corps sembla prendre du poids.
Je trébuchai, heurtai tangentiellement le tronc et dans le choc une profonde blessure s’ouvrit à l’arcade sourcilière qui dégoulina tout rouge.
Tel un ricochet, je sombrai corps et âme dans le cours d’eau.
Ce fut étrangement chaud et ma plaie se referma aussitôt en une large cicatrise qui barrait mon visage, de l’œil jusqu’au menton. Je n’étais pas mouillé comme si mon corps se fût soudain revêtu des plumes d’un cygne.
Je me hissai sur l’autre berge, très à l’aise. Des gens que je reconnus pour avoir habité les mêmes chemins que moi, applaudissaient et riaient aux éclats.
D’autres, sinistres, que j’avais croisés pêle-mêle dans ma vie, des femmes ou des hommes que j’avais oubliés même, des passants insignifiants de ma mémoire, interchangeables, me montraient du doigt et semblaient vouloir me livrer à je ne sais quelle vindicte.
Il faisait un soleil éclatant au zénith et les prés bas sentaient fort la menthe sauvage.
J’étais en culottes courtes. Ma chemise était déchirée, de la morve me pendait au nez et j’avais chaud. Très chaud.
Quoique cautérisée et comme déjà ancienne, l’indélébile blessure me défigurait et me donnait l’air patibulaire d’un tueur.
Je n’ai pas aimé ce rêve.
Je n’aime pas les rêves qui, comme les rivières, sont trop limpides.
Texte publié en juillet 2007
16:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.06.2010
Chemins patoisants
 Quoique dépourvue de toute instruction scolaire, Marie n’en parlait pas moins la langue des bons élèves, le latin.
Quoique dépourvue de toute instruction scolaire, Marie n’en parlait pas moins la langue des bons élèves, le latin.
Pas le latin marmonné sur les genoux tous les dimanches matins. Non. Celui-ci était réservé aux grandes élévations spirituelles et tenter d’en percer le mystère eût relevé de la profanation, comme de vouloir emprunter un raccourci, une tricherie, pour parvenir jusqu’au céleste empire.
En fervente bigote, Marie n’entendait donc goutte à ce latin-là, mis à part, peut-être, le rassurant Dominus vobiscum, et le Ite missa est, grossièrement traduit par les paroissiens par "vous pouvez reprendre vos vélos. »
Marie - la mère Marie comme on disait - parlait donc latin sinon couramment, du moins dans la vie courante. Langue dont on célébrait régulièrement les obsèques à grands renforts de déclinaisons entre les murs de mon collège et néanmoins bien vivante au village.
Du latin presque classique,
- Cur que tu fais tieu ? Pourquoi fais-tu ça ?
En passant par le latin populaire,
- Y’a pu d’eve au puais. Il n’y a plus d’eau au puits.
Jusqu’à l’ancien français du 16ème :
- L’a cheu. Il est tombé.
Voire celui du 11ème :
- Mes bots sont restés de fors. Mes sabots sont restés dehors.
On disait « la mère Marie » parce qu’on en était déjà au début des années soixante alors qu’elle arrivait, elle, de temps beaucoup plus reculés, presque fictifs. Mille neuf cent. L’âge du siècle. Toujours de noire vêtue quoique je ne sus jamais de qui elle portait ainsi le deuil.
Peut-être de sa propre vie ballottée du cul des vaches à l’auge du cochon en passant par le bourbier nauséabond de la basse-cour.
Pierre, son mari – je n’invente hélas rien des prénoms mais on peut tout aussi bien les rattacher à Curie et Skłodowska si on veut éviter à tout prix l’apôtre et sa vierge – ne parlait pas le latin. Ou alors beaucoup moins bien. En tout cas, il avait une sainte horreur de celui du dimanche matin. A aucun prix, il ne voulait l’entendre balbutier.
Sa passion était beaucoup plus raisonnable, moins ambitieuse et beaucoup plus tangible : les femmes. Celles du village.
- Vous m’avez fait grand pou, hier souèr, Pierre, derrière mes contrevents quand que y’allais m’coucha….
C’était dit avec une telle bêtise que ça ne pouvait être que vrai. Et ça venait d’Alice, une veuve, depuis si longtemps veuve qu’on n’avait jamais vu son mari et que ses habits n’avaient jamais été noirs.
- Et to qu’tu vas guetter Tié lé fumelles quand a s’couchant ? s’effarouchait la pieuse Marie.
- Ma foué non. I m’en souvindrais, qu’il ricanait, le Pierre.
Pour sûr qu’il faisait l’âne. Personne n’était dupe et sa réputation de coureurs de bonnes femmes n’était plus à faire. Á la tombée de la nuit, surtout l’hiver quand les gens désœuvrés se couchent comme les poules, il était en effet fréquent qu’un retardataire le vît traîner par les chemins en pluie et en vent, furetant derrière les volets mi-clos, à la recherche d’un coup d’œil polisson.
Il était aussi l’homme riche du village.
Á tel point qu’il était le seul à posséder une automobile. Une 203 Peugeot, grise et rutilante. Il ne s’en servait que pour aller au marché du lundi ou alors pour rendre service si d’aventure une bonne femme avait besoin de se rendre au chef-lieu du canton pour affaires.
Les mauvaises langues prétendaient alors que le prix du voyage se soldait par l’octroi de quelques caresses incongrues.
- I veut ben qu’vous m’conduisiez, mais t’chau cop, i veux payer l’essence, déclara un beau jour l’affligeante Alice, laissant entendre par là que l’autre fois, Pierre avait, sinon réussi, du moins tenté de se payer sur la bête.
La mère Marie ne devait plus savoir en dispenser, de telles caresses. Car jamais Pierre ne consentit à la conduire à l’église. Elle s’y rendait en vélo, que le temps soit clément, que les pluies en rafales cinglent la campagne ou que la pierre des chemins se fende sous la morsure du gel.
Je ne suis donc pas certain qu’elle ait été une seule fois passagère de la belle 203 de son bonhomme de mari puisqu’elle dédaignait aussi le marché du lundi. Quant au chef-lieu de canton, dix kilomètres, c’était le bout du monde et la pensée qu’elle puisse s’y aller fourrer ne l’effleurait sans doute même pas.
D’ailleurs, sur l’automobile émergente, elle nourrissait un sentiment des plus cruels. Un sentiment aux antipodes des enseignements dont le latin du dimanche matin était censé la nourrir.
Nous en étions, sinon au début de l’automobile, du moins au début de sa vulgarisation.
Sur la nationale 10, la grande route, la mythique grande route de la conquête de l’Espagne par Napoléon, celle sur laquelle passaient tous les mois de mai les forçats en vélo du Bordeaux/Paris, les premières DS, les 403, R8 et autres dauphines commençaient à rivaliser de prouesses techniques.
Il advint alors que des gens de très loin, de Paris peut-être, ou de Bordeaux je ne sais pas, ou de plus loin encore, donc pas vraiment de réels gens, s’écrasèrent sur le talus et y périrent cruellement. Une famille entière. Le drame fit grand bruit par les chemins perpendiculaires à la nationale et qui ramifiaient entre les haies jusqu’aux chaumières les plus antiques. Les hécatombes routières n’étaient pas encore entrées dans les mœurs, ni comptabilisées par un ministère.
Le jugement de la pieuse Marie sur son vélo qui n’allait pas plus loin que l’ombre du clocher, fut donc sans appel :
- N’aviant qu’à rester dans ieux cabanes….Ils n’avaient qu’à rester chez eux.
Pierre, le mari libertin donc, avait par ailleurs une drôle de façon de confondre le verbe se taire et le verbe s’écouter, si nous venions, nous les mômes ignares, à émettre le moindre avis sur quoi que ce fût.
- Qui’qu tu racontes, écoute te don…Tu connais rin…. et il se dandinait sur ses pattes ridiculement courtes, et il dodelinait du chef, qu’il avait chauve et toujours protégé d’un large chapeau qu’on eût dit celui d’un vieux cow-boy.
Quoi ou qui écouter si on se tait ? Si on se tait, on n’écoute que soi-même. A l’intérieur. C’était pas si bête dans le fond…Se taire pour mieux s’écouter.
Un jour, faudra que je réfléchisse à tout ça.
Que je me fasse une idée plaisante d’où ils tenaient tant de savoir oral. De quels flambeaux passés de chemins en chemins, de bois en bois, de champs en champs, de rivières en rivières, de berceaux en berceaux, ils détenaient usage de cette parole-là.
Les érudits, les linguistes, les historiens et les spécialistes de la sémantique, quand ils ne seront pas tout ça à la fois, ne manqueront pas de me faire plaisamment remarquer que je cherche tout bonnement à défoncer là des portes ouvertes. Ils voudront dire sans doute des portes que nous, hommes savants qui nous sommes penchés sur la question, avons ouvertes depuis des lustres et des lustres. Ils diront que la langue française prend racine dans le latin classique devenu bas-latin, puis latin populaire et médiéval, lui-même changé en vieux français et abouti à notre français moderne, jusqu’à plus ample transformation.
Le tout assaisonné d’un reste de racines celtes, de-ci, de-là.
Comme toutes les langues, la nôtre a donc son histoire, un chemin qu’elle s’est frayé à travers les âges. Ce chemin, il y a belle lurette, mon bel ami, que nous en avons débroussaillé tous les tenants et tous les aboutissants.
Certes. Certes, messieurs les érudits, mais là n’est pas exactement mon propos. Je sais bien l’importance et le juste fondé de vos travaux. Ils me sont d’ailleurs souvent précieux.
Mais ce qui me préoccupe, c’est l’inversion complète des rôles sociaux dans cette affaire de vieux français, de latin écorché des campagnes et vos doctes disciplines. Ce qui me préoccupe, c’est que justement, mon enfance sur les chemins de pierre et les hivers en bruines, a été bercée par ces sons, par ces signifiants spontanés qui disaient le monde et que, plus tard sur les bancs respectables de l'instruction publique, on m’a interdit de les prononcer, tous ces vocables, comme s’il se fût agi de vilenies, frappées du sceau de l’infamie.
C’est parce qu’ils étaient les marques de l’ignorance. Les marques d’une conceptualisation du monde qui aurait loupé une marche haute de plusieurs siècles, celle qui va du vieux français à notre langue soignée.
Je disais donc inversion des rôles parce que ce sont les marques d’une telle ignorance qui sont la matière même sur laquelle s’exerce votre érudition.
L’ignorance comme source de savoir. Un bel oxymore.
Vous moralisez, monsieur du poète ! Vous moralisez ! L’étude des langues et des jargons est scientifique et n’a que faire de votre attachement à des chemins patoisants. Voyez-vous, nous pouvons tout expliquer par la recherche tandis que vous ne pouvez effleurer votre propos que par l’émotion.
Nous ne parlons pas exactement la même langue, effectivement.
Je parle des nuages gris fuyant sous l’automne, d’un vent humide sur de sombres guérets et des grives en vols saccadés sur les vignes de novembre.
Je parle d’un monde condamné à mort et dont on a d’abord tué les mots.
Je parle d'un monde qui a fui sous ma vie.
Mais je le porte en moi, ce monde. Le deuil n’en est pas entièrement accompli et ne le sera sans doute jamais. Seuls les gens qui se renient par ambition d’épouser autre chose qu’eux mêmes, font deuil de leurs premiers mondes. Quoique en apparence seulement. Ce monde leur colle toujours à la chaussure, qu’il soit glèbe ou poussière. Ils secouent alors vainement cette chaussure, pour tenter de le faire tomber, de le laisser en chemin. Aussi claudiquent-ils le plus souvent et ne trompent-ils ainsi que d’autres trompeurs de leur acabit.
Ce qui me tarabuste, donc, c’est comment la transmission. Vous savez expliquer la genèse établie du langage mais ne sauriez décrire son cheminement vivant, comment il a su éviter les écueils d’une modernité conquérante.
De l’obligatoire parler.
Comment il a usé de ruses pour rester clandestin dans les campagnes, comment il a su se travestir en marques de l’inculture pour arriver, de bouches à oreilles, de la fin du Moyen-âge jusques à nous. Vous faites donc l’histoire d’une musique en occultant l’histoire de sa tonalité. La tonalité, c’est la transmission.
Je veux dire qu’un monde qui dit « mes bots sont de fors » a été transmis par un monde autre que celui qui a transmis « mes sabots sont dehors.»
Et à d’autres fins aussi.
Et alors ? Vous vous préoccupez de musique et nous de partitions, voilà tout. Marie, la fervente Marie dont vous nous parlez, disait de fors et vous trouviez sans doute ça tout naturel jusqu’à ce que l’instituteur et les livres ne vous enseignent dehors.
Vous connaissez les transmetteurs parce que vous avez vécu une transformation, une mutation de l’oral au graphisme. Je dis cela parce que jusqu’à ce jour, vous n’aviez sans doute jamais écrit ni lu de fors, n’est-ce pas ?
J’en conviens. Je découvre même. Ce linguiste latiniste est en outre un homme d’une exquise urbanité. Un pédagogue serein. Il arbore petites moustaches tranquilles sous un long nez pointu et ses yeux brillent comme des sourires humides.
Musique, oui. Les mots n’existaient qu’en musique. Des mots qui ignoraient l’écriture, des mots pour la voix seulement, des mots auxquels il manque une dimension. Des mots condamnés à mourir dés lors que la nécessité d’apprendre autre chose que des gestes adaptés à des saisons, des directions du vent, des profondeurs de labour, des couleurs de nuages, s’est faite incontournable.
C’était là le monde de l’immédiateté. De l’urgence. L‘immédiateté est toujours orale, elle est descriptive.
Tandis que l’écriture est prospective. Elle anticipe.
Vous l’avez dit : un monde qui meurt n’a plus besoin des mots qui le désigne. Vous les voulez vivants, ces mots, alors que nous en avons depuis longtemps terminé avec leur dissection.
Me voilà donc au fait.
Ecrire les mots, c’est anticiper le réel. Pas le décrire.
Mon écriture, pour une bonne part descriptive de mes paysages - car vivre sans paysages est indigne de vivre – est donc une écriture surannée.
Vouée aux silences des chrysanthèmes.
Texte publié en novembre 2008
09:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.06.2010
Quand le doute croît
 Tu ne me crois pas ?
Tu ne me crois pas ?
Je vois bien que tu ne me crois pas, allez ! Ne fais pas semblant…
C’est pourtant la vérité vraie que je te raconte là…Enfin, du moins telle que je l’ai vécue. Parce que, en soi, la vérité, ça ne veut pas dire grand chose.
Pascal aurait mieux fait de nous laisser comme maxime de sagesse, vérité dans cette tête-là, fumisterie dans cette autre. Avec ou sans les Pyrénées. Pour donner crédit à d’immondes conneries qui sont pour les autres de lumineuses exactitudes, les hommes n’ont pas besoin d'être séparés par une montagne, voyons !
Une cage d’escaliers y suffit. Que dis-je ? Un palier tout court.
Si on y regarde de près, on passe finalement sa vie à croire. Donc, dans une large mesure, à nier l’autre du même coup.
Mais on dit aussi, plus innocemment : Il croit en lui, elle croit pouvoir être là à huit heures, tu ne crois pas en dieu, je crois en ses chances, je crois qu’il va faire beau et tutti quanti.
On voit bien que ce traitre mot, ce mot de l’affrontement, ce mot de l’idéologie pure, de la différence aussi, est double. Sournois comme pas un. On croit à dieu, par exemple, ça veut dire qu’on le suppose intellectuellement. Dans les cas les moins graves, bien sûr.
Croire en dieu, là, pas de détail, on est dans le spirituel, la morale pure, si j’en crois – et je n’ai pas de raison particulière de ne pas l'en croire – le Robert, dictionnaire historique de la langue française.
Voyez comme il chipote, ce verbe ! Pourtant, on ne dit jamais croire en Père-Noël… Les enfants seraient-ils des intellectuels intéressés ? C’est bien possible, après tout.
Plus intelligemment, on croit en ses chances, là, c’est de l’espoir, ou de la présomption, ça dépend du niveau qualitatif de l’erreur de soi-même.
Je le crois coupable, on verse ici dans le soupçon. Parfois dans le préjugé. Souvent même. Et quand on sait que c’est là où on sait le moins qu’on arrive à faire soupçonner le plus, comme ils disaient, ben, faut croire que ce verbe croire, c’est aussi l’antinomie même de la connaissance.
Je crois que je vais y arriver...On en vient à la conjecture, avec un grand aveu d’impuissance en filigrane. Du doute.
Et il peut faire horriblement peur, le verbe croire quand il enfile ce costume-là. Il y a quelques années, un copain ayant séjourné à Madrid et se proposant de revenir à Paris, me racontait qu’au départ de l’aéroport, l’avion avait dû faire demi-tour. Petit problème technique. Vraiment tout petit. Si petit que les passagers n’avaient même pas été débarqués pendant que les techniciens bricolaient au niveau de l’aile et qu’il les entendait palabrer entre eux. La réparation terminée, il y en a un qui a dit à l’autre, en rangeant ses divers clous : je crois que ça devrait coller…Décoller, en l’occurrence. Mon copain, il ne savait plus quel sens donner à ce foutu je crois. Il eût aimé qu’il n’exprimât qu’une franche certitude, presque un aveuglement, un fanatisme, et, à cause de ce mot malfaisant, ambigu, il a passé deux heures horribles dans les airs.
Non, vraiment, s’il faut lire ce foutu vocable sans les nuances, il est illisible. Il se mange d’ailleurs à toutes les sauces. Pire. Il peut servir à maquiller son exact contraire, un menteur faisant en effet tous les efforts du monde - ne faisant quasiment que ça d’ailleurs - pour qu’on le croie.
Par un bref coup d’œil jeté sur l’état du monde, on voit bien comme les grands menteurs, les champions de la dissimulation, y parviennent : ils occupent pratiquement tous les podiums de la cité. Ils sont même arrivés à vous faire croire que la lune était une crêpe ! Lorsqu’on croit fermement à son mensonge, faut croire qu’on possède donc une redoutable force de persuasion.
Il sert surtout à ça le « croire », en fait. Á persuader les autres de la justesse de ses propres erreurs ou du bien-fondé de sa duplicité.
La liturgie chrétienne, c’est dire, l’a même conservé dans sa forme première, latine, pour ne pas l’abîmer, pour le servir bien en l’état de sa dangerosité initiale, pour qu’il frappe encore plus fort. Qu’il frappe les hérésies, selon le Concile de Nicée. Le credo, la profession de foi, la certitude aveugle, l’anéantissement du sens critique, l’hallucination, l’étau meurtrier du dogme, la force hystérique de l’auto-persuasion.
Terrible, ce mot. Une épée aux multiples tranchants. Une épée à manier avec précautions.
Tu me crois. T’es un gars bien. Tu ne me crois pas. De deux choses l’une : Ou tu ne comprends rien ou t’es malhonnête.
Finalement, mieux vaut, comme moi, ne plus croire en (ou à) rien, tiens !
Ah, pas si vite ! Parce que quand je dis ça, me parant évidemment du désabusement philosophique, de celui qui sait tout parce qu’il ne sait rien, prenant la hauteur superbe du sage et l’attendrissant désespoir du romantique, le mot ne l’entend pas de cette oreille, lui. Il n’aime pas qu’on le manipule, qu’on inverse les rôles, qu’on lui vole la vedette.
Tel un serpent sur la queue duquel j’aurais marché, il se retourne alors et me pique sévèrement.
Je ne crois plus en rien. C’est-à-dire que je crois que tout est possible, que tout peut advenir. Je crois en tout, quoi.
J’ai connu une dame dans le temps jadis, comme ça. Elle croyait à tout et comme on l’en brocardait sans ménagement, elle s’est mise tout à coup à ne plus croire en rien.
Du coup, elle avait l’air d’une fausse sceptique.
Voyez comme il est vindicatif, méchant, ce mot !
Je crois bien que je le déteste.
16:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.06.2010
Le lettré et le douanier

Surtout si c'est toi l'étranger.
On s'y perd et c'est tant mieux. Parce que rien n'a jamais été sans doute aussi stupide que le concept d'étranger. C'est un concept ignorant de la dialectique, à tel point que l'étranger, c'est toujours l'autre.
Cette impression, donc, de sortir de toi. Comme si tu te regardais voir.
Tu dessines le monde avec un crayon difficile et qui t'est pourtant aussi naturel que l'odorat, l'ouie ou la vue. Tu ne croyais pas détenir tant de savoir parler.
Et l'élève te regarde. Admiratif, il dit que c'est beau, le sourcil cependant froncé par l'effort pour tenter de capter cette cascade bouillonnante qui sort de ta bouche, trop vite, trop vrai. Il faut alors prendre le temps de la faire s'écouler, la faire extérieure à toi.
En fait, tu asperges l'élève du lait dont tu as été nourri, et c'est là l'essence même de ton art.
Ton talent, c'est un berceau et une voix lactée.
Alors tu l'invites à boire avec toi ce lait. Qu'il raconte une histoire avec les mots de ta mère. L'aventure est risquée. Il lui faut se faire orphelin de la sienne. S'extirper.
« J'ai été en frontière rrrousse avec Pologne alentour quinze années passées...A Kaliningrad. Oui ? Bon. J'avais revenou de voyager à Saint Petersbourg...»
Mais les mots se cherchent et les conjugaisons trébuchent. Tu le corriges, bien sûr. Mais doucement, pas tout à fait, juste un peu, pour ne pas troubler l'accouchement qui s'opère et ne pas altérer ce plaisir évident qu'il a de jouer les premières gammes de cette musique baroque. Il chante une histoire et, avec tes mots atrophiés, il te la donne.
Toi, tu te fais soudain indulgent avec la grammaire, pardonnes les glissements de sens, laisses passer les synonymes intempestifs et les homonymies douteuses, ne relèves pas les pataquès.
Et l'histoire se sculpte. Devant toi, l'homme construit un château. Un château qui branle, certes, mais un château quand même, un château que tu vois, que tu entends, que tu comprends et, même, ô bonheur, que tu aimes.
Ta langue, tes mots, sont à lui.
Incorrigible natif, tu as rebâti cependant le château dans ta tête, au fur et à mesure qu'il l'élevait, pierre après pierre :
« Il y a une quinzaine d'années environ, je revenais d'un voyage à Saint-Pétersbourg, par Kaliningrad à la frontière russo-polonaise. C'était juste après la chute du mur, en 1992, je crois. Saint-Pétersbourg est une ville magnifique, une ville de rêveur, sillonnée par les eaux. Une Venise septentrionale.
J'avais fait le tour des librairies. Elles n'étaient hélas plus qu'un grotesque déballage de livres de science fiction américaine et de lamentables romans anglo-saxons à gros tirages. J'ai regardé, curieux et déçu.
J'attendais autre chose des vents de l'Ouest.
Le prix était aussi trop élevé pour moi. Beaucoup de roubles pour un seul de ces bouquins et je n'avais pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai musardé parmi les rayons obscurs de l'arrière boutique et là j'ai découvert, abandonnés, mis au rebut, de vrais livres, Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, Tchekhov. De vieux livres méprisés, abandonnés dans leur pousssière.
J'ai pu en remplir un plein sac à dos tant ils étaient bradés.
A la frontière, les douaniers étaient vigilants et fort soupçonneux de tout. Devant moi, ils ont arrêté un homme qui portait un sac semblable au mien. Ils ont ouvert ce sac qui s'est avéré receler beaucoup de vodka et de cigarettes.
J'observais leur manège. L'un d'eux surtout avait un comportement étrange, poussant du coude le contrevenant, plaisantant avec lui, goguenard.
En fait, il traitait une affaire. Quand il fut subrepticement payé en tabac et en alcool, e voyageur put enfin rentrer sans plus d'encombres en Pologne.
Vint mon tour.
Le fonctionnaire déjà se délectait à la vue de mon sac à dos aux coutures martyrisées, aux lanières douloureusement bandées par la surcharge. Et puis, il y avait ma gueule, cheveux longs, barbue. Une sale gueule de fumeur et de buveur.
La stupéfaction et le désappointement furent tels qu'il recula d'un pas et montra du doigt, révulsé, demandant ce que c'était que ça.
Je dis des livres.
Des livres ! Pour quoi faire ?
Pour lire, enfin.
Lire ? Pour quoi faire? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Les frères Karamazov, Anna Karénine, La Mouette, Raskalnikov et autres récits d'un chasseur....
Rien à fumer là-dedans. Rien à boire non plus. Que de l'ésotérique.
La colère avait succédé à l'étonnement. La vindicative botte du fonctionnaire dépité maltraita les livres. Il me fit violemment signe de déguerpir avec ma poubelle et sa bouche n'était plus qu'insultes et mépris. »
Epuisé, l'homme te regarde. Il voit que tu as compris son aventure. Alors il exulte.
Il sait parler.
Sans appeler le conditionnel passé deuxième forme à son secours, l'élève vient de te raconter l'universalité de la connerie humaine.
Texte publié le 1er juillet 2008
10:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.06.2010
Une grande dame polonaise au Panthéon
 Je parcourais, dernièrement et distraitement, une rétrospective de l’année 1995. En principe, quand on fait ça, on perd magistralement son temps. Pas la peine d'avoir sous les yeux ce dont on se souvient trop bien et sans grand enthousiasme.
Je parcourais, dernièrement et distraitement, une rétrospective de l’année 1995. En principe, quand on fait ça, on perd magistralement son temps. Pas la peine d'avoir sous les yeux ce dont on se souvient trop bien et sans grand enthousiasme.
Mais là, je n'ai pas regretté car un petit article m’a bien fait sourire et hausser les épaules.
Le 20 avril de cette année-là en effet, François Mitterrand, en même temps très proche de la sortie et de la tombe, faisait entrer Pierre et Marie Curie au Panthéon.
Oui, et alors ? Alors on se souvient que le gars Mitterrand avait commencé quatorze ans plus tôt son premier septennat par une visite aux grands hommes de la Nation et que donc, à la fin de son deuxième, il avait absolument voulu conclure aussi par le Panthéon. La boucle. Comme une sourde obstination.
Connaissant, quoique de très loin, l’oiseau, je subodore fortement que c’étaient-là deux signes forts, histoire de dire à l’Histoire de ne pas l’oublier et, dans quelques décennies, de le faire lui-même dormir aux côtés des illustres gisants.
Comme un gars qui tournerait la cuillère autour du pot, sans avouer son véritable dessein.
Mais revenons à Pierre et Marie Curie.
Ce qui m’a fait sourire, c’est qu’on mentionnait dans cet entrefilet, que c’était la première fois qu’on portait les cendres d’une femme en ce sanctuaire ….Et on disait aussi que cette dame avait élevé l’esprit scientifique français très haut vers les sphères du prestige…
Oui, c’est vrai, sauf que Marie s’appelait, avant d’avoir contracté mariage, Maria Skłodowska, qu’elle était polonaise - alors que la Pologne n'existait plus - et qu’au frontispice de ce célèbre foutoir est écrit : Aux grands hommes la Nation reconnaissante...
Et Maria, dans tout ça, Maria qui toute sa vie, en tant que femme et immigrée, a lutté contre les préjugés agressifs du sérail scientifique et politique, devra t-elle faire montre d'une dernière et posthume révolte indignée en soulevant les lourdes dalles de son tombeau pour demander qu’on mette au goût du jour la célèbre inscription ?
15:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.06.2010
Voleur de paysages

De ma fenêtre ouverte sur les champs qu’interrompt brusquement la forêt, je regarde juin aux déclins de lumière.
Et je me demande : Est-ce que ce paysage ainsi découpé par une seule ouverture, la mienne, pourrait être celui de mon pays ?
En quoi est-il une carte de voyage ? Un autre regard ?
En quoi est-il un paysage que je peux m'approprier pour être véritablement chez moi, quand il n’y a plus, pour le percevoir sous sa juste latitude, ni neige au sol ni glace suspendue aux branches telles les stalactites des grottes profondes ?
Mentalement, je gomme ce que je ne verrais pas d’une fenêtre au pays d’où je viens.
Je le lis avec les yeux d'un étranger.
Je dissèque.
Un champ de seigle, aussi vert que bleu par les bleuets qui s’y balancent au vent.
Pas de désherbant encore. Ou alors moins meurtrier que sous les fenêtres de France. Et puis ce seigle est épars, long et tremblant. La céréale des terres maigres et du sable.
Pas d’engrais miracle qui nient l’effort de la plante et de sa survie.
J’efface.
Des bouleaux. Beaucoup de bouleaux, de grands bouleaux blancs et plus loin, derrière eux, la tête toujours sombre des pins. Forêt déjà septentrionale.
Je raye.
Sur la prairie une cigogne, ses grandes pattes maladroites qui claudiquent, sa démarche de clown, sa silhouette gauche, elle qui traversera bientôt l’Europe et l’Afrique à la seule force de ses ailes. L’Albatros des continents. Point de marins ivres pour agacer son long bec.
Je supprime.
Me restent les nuages blancs, un bout de bleu, un ciel pas différent mais décalé. C’est la seule chose que les hommes partagent à peu près, que je me dis. Le ciel comme un mouchoir de poche. Chacun son bout. Une vision étriquée par la géographie.
Et le soleil qui s’en va d’où je suis venu.
Où mon amour d’aller s'estompe mais demeure.
Chapitre II, scène 2.
Bonheur d’être ailleurs quand on sait, in fine, n'avoir été nulle part chez soi.
Un port sans la mer, une ancre sans navire, une traversée sans cap.
Texte (légèrement modifié) mis en ligne il y a un an, jour pour jour
10:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.05.2010
Petit agenda d'un petit écrivain
 Peu d'échos encore de mon dernier livre, paru au Temps qu'il fait le 25 mars dernier.
Peu d'échos encore de mon dernier livre, paru au Temps qu'il fait le 25 mars dernier.
Les copains du Net, toujours présents : Philip, l'ami Solko et Brigetoun.
Je les en remercie vivement.
Et puis le vieux camarade François, qui me fit gentiment parvenir l'article de Serge Airoldi paru dans le Matricule des Anges du moi de mai.
Bientôt, sans doute aussi, une critique de l'ami Feuilly, dans le Magazine des livres.
Et puis, un mail de Marie-Claude Rossard qui m'informe que le livre est sélectionné pour le prix Ptolémée de Saint-dié-des-Vosges, plus exactement le prix Amerigo Vespucci s'intéressant aux ouvrages littéraires et "géographiques dans des langages différents de ceux des professionnels de la géographie".
Voilà. Y'a plus qu'à..."espérer beaucoup, attendre peu, ne rien demander."
Et l'agenda dans tout ça ?
L'agenda, c'est que je serai le samedi 29 mai l'invité de l'Institut Français de Varsovie pour le lancement public de Publie.net.
J'y suis invité à titre d'auteur Publie.net et d'auteur tout court, de langue française résidant en Pologne.
Mon propos y sera complémentarité de l'oeuvre numérique et de l'oeuvre sur support papier. Entendons par complémentarité, un propos qui se propose de tordre le cou à la déjà trop vieille idée selon laquelle les œuvres numériques allaient tuer sans vergogne et sans pitié les œuvres (dignes de ce nom) éditées sur papier (qui n'ont pourtant pas, pour ce faire, besoin qu'on leur donne un coup de pouce.)
Je ferai également, si connexion en live, un tour d'horizon du site et des auteurs présents sur Publie.net
J'y ferai aussi lecture de quelques pages de Chez Bonclou et autres toponymes et de Géographiques. Je laisse à une troupe francophone de théâtre de Varsovie, la BenOui Compagnie, le soin de lire du "Zozo, chômeur éperdu."
Et justement, à propos de théâtre, le susdit Zozo, toujours nonchalant, sera le héros d'un spectacle monté en Deux-Sèvres au mois d'octobre prochain, avec l'aide précieuse, amicale et professionnelle d'un artiste des Matapeste.
Où je suis invité, donc.
Je vous en reparlerai.
Pour l'heure, il fait beau alors je file couper du bois, tondre la pelouse ou, peut-être, peigner la girafe.
Image : Ma dernière intervention publique, le 5 mai 2009 à La Rochelle avec Denis Montebello ( comme ça, à ce rythme, j'ai le temps de reprendre mon souffle et de rassembler mes quelques idées )
11:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.05.2010
Grandeur d'âme de la métaphysique doctrinaire
 Le professeur Bartoszewski, vieux monsieur respectable et respecté, figure emblématique de l'intelligentzia polonaise, ancien déporté des camps d'Auswitch, ancien ministre des affaires étrangères, aujourd"hui conseiller du gouvernement pour les relations avec l'Allemagne, a rappelé récemment les paroles d'un prélat haut placé sur les marches de l'organigramme ecclésiastique et qui, dans un sermon tonitruant, avait pris dieu lui-même à partie en des termes on ne peut moins équivoques :
Le professeur Bartoszewski, vieux monsieur respectable et respecté, figure emblématique de l'intelligentzia polonaise, ancien déporté des camps d'Auswitch, ancien ministre des affaires étrangères, aujourd"hui conseiller du gouvernement pour les relations avec l'Allemagne, a rappelé récemment les paroles d'un prélat haut placé sur les marches de l'organigramme ecclésiastique et qui, dans un sermon tonitruant, avait pris dieu lui-même à partie en des termes on ne peut moins équivoques :
« Si tu voulais faire tomber un avion, que n'as tu fait tomber celui qui volait sur Smolensk trois jours auparavant ? »
Entendez par là l'avion de la délégation officielle polonaise* invitée par les Russes aux cérémonies officielles du massacre de Katyń et réunissant à son bord de nombreux membres du gouvernement, sous la conduite du premier ministre, Donald Tusk.
Surpris par la magnanimité de la question, il paraît que dieu en est resté bouche bée.
Et le journaliste de Polytyka qui relate ces propos criminels de dire qu'il se sent lui-même, pour la première fois de sa vie, tel un dieu, tant il ne sait que répondre à une telle ignominie.
Il en reste bouché bée.
Ce fait divers pas si divers que ça, pour dire qu'en Pologne, fort du concordat, le clergé se mêle évidemment de politique, le plus souvent côté PIS (Droit et Justice), le parti populiste du président défunt et de son frère jumeau, l'actuel candidat à la succession, et que, fidèle à son histoire partout dans le monde, le susdit clergé n'y va pas avec le dos de la cuillère pour servir les inepties les plus dégueulasses et flatter les instincts les plus vils.
Mais je veux vous rassurer quant à l'intelligence et la clairvoyance du peuple polonais. Vous rassurer quant à la douceur de ce pays. La Pologne, c'est vraiment autre chose et de plus en plus nombreux sont les Polonais qui en ont par-dessus la casquette de l'omniprésence chafouine de la soutane.
Comme dit dans 'Polska B dzisiaj', les jours de gloire de la sournoise institution, qui doit , in fine, tout à la dictature communiste, sont derrière elle.
Gare au retour de bâton ! L'histoire nous enseigne que dans ce pays, quand la coupe est pleine, elle est vraiment pleine et qu'on ne la laisse pas déborder trop longtemps.
Image : Philip Seelen
* Les autorités russes avaient organisé, quelques jours avant le drame, des cérémonies auxquelles ils avaient convié les Polonais. Le 10 avril, il s'agissait d'une cérémonie privée, voulue par le Président défunt.
10:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.05.2010
La conjuration du sablier
 La plaine qui n’ondulait jamais était humide, d'une humidité moelleuse, et la forêt tout au bout mettait brutalement fin à son destin de plaine.
La plaine qui n’ondulait jamais était humide, d'une humidité moelleuse, et la forêt tout au bout mettait brutalement fin à son destin de plaine.
C’était un mur de pins sombres où bataillait le vent, la forêt, et c’était vers ce mur que je cheminais, cependant que le soleil tout pâle glissait sur les dernières plaques de neige.
Derrière moi, il n’y avait rien.
Que du souffle invisible sur le silence de mon histoire.
J’ai levé les yeux au ciel. J’y cherchais un oiseau, j’y cherchais un voyage qui pût me rassurer du mien, me chuchoter tu n’es pas si seul dans la désespérance, pas si perdu dans tes errances, regarde la blessure fatiguée de mes ailes, regarde l’immensité des nuages à l’assaut desquels me porte cette blessure, regarde le sang par les vents injecté dans mon œil, vois l’impossibilité de mes chimères ataviques et vois la chute au bout, sans qu’aucun vide, nulle part, ne s’inscrive sur la face impassible du monde.
Mort anonyme. Sépulture introuvable. Néant dérisoire. Inutilité du passage.
Mais le ciel était muet. Pas même un nuage en forme d‘allégorie, de ces nuages qu’on lit, comme des monstres ou comme des jouets, quand on a refermé tous ses livres.
Je marchais vers la forêt parce que j’y avais cru voir la silhouette chancelante d’un homme. On ne voit pas beaucoup d’hommes par ici. On ne voit que la plaine et sa toile de fond, le rideau sombre des pins.
Que viendraient faire ici les hommes ? Depuis longtemps mon pacte avec eux avait été rompu. À tel point que même là, sous le vent, sur la neige éparse et sous le ciel immaculé, la forêt semblait reculer devant moi, comme si elle refusait que je la rejoigne, comme si sous mes pas s’allongeait la plaine et comme si l’intrus échoué là-bas, à la lisière, s’obstinait à repousser l’échéance de la rencontre.
C’est alors que j’ai vu l’oiseau. Non. J’ai d’abord vu son ombre qui se déployait sur le sol. Après seulement, j’ai reconnu un corbeau. Un vrai corbeau. Pas une de ces corneilles ou autres freux qui habitaient là-bas, autrefois, sur les marais et les labours paisibles des brises océanes. Un grand corbeau. Un lointain consanguin des nettoyeurs d’Austerlitz. Tellement noir qu’il m’en a semblé bleu.
Il a plongé sur la lisière et je me suis arrêté tout net. C’était un signe. Je devais m’arrêter là. Il y avait quelque chose de la mort blottie sous l’envergure puissante de ses ailes.
Et c'est la forêt qui est venue jusqu’à mes pas. Un nuage est passé et le soleil s’est tu, effrayé par la pénombre.
L’oiseau picorait avec force délectation les yeux de l’homme sur le sol étendu. Le mort n’était pas mort et se prêtait au jeu. Il embrassait le bec et caressait la plume à chaque lambeau de chair arraché à sa vie.
Quelqu’un a frappé. J’ai cru. C’était le vent qui secouait violemment les volets.
En sursaut, j’ai regardé par la fenêtre. La lune dormait encore entre deux branches accrochant ses moignons gelés sur le blafard du ciel.
Je me suis levé. J’ai bu la dernière eau-de-vie de mon histoire et me suis mis à écrire.
Je n’ai depuis lors jamais cessé de tenter de remonter le temps.
Faire reculer la forêt et effrayer les corbeaux.
Texte (modifié) publié en mars 2009
Image : Aurélien Audevard
09:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.05.2010
De la case départ à la case départ
 Ce que je ressens du monde a la douceur apaisante d'une vaste rondeur. Mais pas comme un cercle élégant tracé par le compas d'un écolier studieux. Une boucle plutôt. Une circonférence dessinée par un cancre.
Ce que je ressens du monde a la douceur apaisante d'une vaste rondeur. Mais pas comme un cercle élégant tracé par le compas d'un écolier studieux. Une boucle plutôt. Une circonférence dessinée par un cancre.
Je vis sur une boule bleue qui tourne autour d'une boule rouge ou jaune, suivant des saisons qui tournent en rond... Et quand je regarde le ciel sur la plaine, il plonge en arc de cercle sur cette plaine, laquelle courbe elle-même l'échine, fait le dos rond, là-bas sur le brouillard des horizons infléchis.
L'horizon. Terme ambigu. Incertain. En même temps terme d'espoir et de chute. Mirage trompeur de la ligne droite. Point de mire du marcheur fatigué. Infranchissable. Sans cesse reculé. Dansant.
C'est ainsi que les bâtisseurs d'horizons ne vont jamais au bout de leurs rêves.
L'horizon. Ligne circulaire, variable en chaque lieu, dont l'observateur est le centre et où le ciel et la terre semblent se joindre. C'est Le Littré qui le dit. Et je vois le Littré partout au bout de mon chemin. L'horizon est donc circulaire et les lignes horizontales ne sont jamais droites puisque par définition astronomique, elles sont des parallèles à cet horizon.
Je marche vers l'horizon. À la verticale, que je marche. Perpendiculaire à une courbe.
Comment dès lors marcher droit vers un point final ?
Tout a la rondeur des espaces qui commencent et finissent en même temps, sans qu'il n'y ait de trajectoire linéaire.
Quand je regardais l'océan, il était aussi comme une sorte de sphère liquide dont je n'apercevais qu'un pôle qui miroitait sous la lumière d'une grosse étoile ronde.
Si j'imagine l'univers dont une des théories le décrit comme encore en expansion, j'imagine une sphère incommensurable et chaude qui gonfle encore sous l'impulsion d'une force titanesque qui lui viendrait du centre. Les limites où se meurt le rationnel et où trébuche l'imagination, c'est la définition, l'existence même du vide sur lequel se répandrait cet univers en mouvement circulaire, projeté à l'infini.
Car pour qu'un corps se distende et prenne de l'ampleur, il lui faut forcément rencontrer du vide. Et le vide, le néant, par définition, ça n'existe pas. Prétendre à une existence du néant, c'est implicitement poser le postulat de sa négation.
Je vis, nous vivons, dans cette rondeur chaotique. Nos états d'âme, nos pulsions, en sont forcément déterminés pour une part. Nos prétentions aussi, hélas !
Et du hasard d'une naissance à la dernière pelletée du fossoyeur, ce que nous appelons la fuite du temps et qui n'est que l'éphémère de notre marche vers l'horizon intangible, me semble donc un cercle imparfait, musardant du point zéro au point zéro.
La vision commune de cette fuite est une trajectoire. Le temps rationnel, vécu comme corps unique à sens unique. C'est la vision capitaliste du temps. Le temps marchandise. Le langage, que les hommes ont quelque peu désappris à lire, ne s'y trompe d'ailleurs pas. Il dit : perdre, gaspiller, récupérer, avoir ou gagner du temps.
Si tel en était, pour nous nous souvenir, il faudrait nous retourner. Or, nous ne nous retournons pas. Nous nous voyons en un point donné du cercle imparfait. Là où nous sommes déjà passés et où nous avons déposé comme gages de notre voyage, des rêves d'enfant, des larmes, des visions fulgurantes de la mort, des amours et des amitiés...
Seuls les gens qui pensent leur vie comme une ligne à parcourir pensent qu'on patauge quand on est dans la nostalgie. Nostalgie. Se souvenir avec douleur. Sur une boucle, on a une vision d'ensemble. On se voit partout à la fois. Le présent regarde le passé sans nier sa qualité de présent irrémédiablement entrainé dans sa chute vers le futur.
Nous croise nous, en fait. En même temps ici, ailleurs et déjà là bas.
Aimer vivre sa vie, c'est donc être quantique. Multiple. Plusieurs. Et comme son propre horizon, impalpable.
Le grand mouvement des choses.
J'aime les saisons, le retour et leur fuite. L'éternel retour des mêmes gestes de la terre dans sa complicité avec le reste du monde.
Nous-mêmes, dans cette incendie qui tourbillonne, nous reproduisons des scènes à l'infini de notre espace fini Des scènes qu'on a déjà vu se jouer...Quelque part. Sous les lampions d'un théâtre qui n'était pas encore mûr.
Particule de ce bal infini, je ne suis rien sans l'exode des oiseaux vers le nord, puis vers le sud, puis vers le nord encore. Rien sans la nuit qui engloutit le jour et ce jour à son tour qui dévore la nuit. Qui l'épluche d'est en ouest.
La pendule universelle.
Jusqu'à l'horizon courbé, défaillant mais jamais vaincu. Phénix sans cendres, éternel brasier.
C'est nous, hommes qui marchons et dont la marche est forcément fatale, qui sommes des vaincus. Du premier vagissement au dernier râle.
Et c'est quand nous en avons la conscience joyeusement sensible, que nous sommes littérature.
09:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.05.2010
La Podlachie, marche de l'Orient
L'église uniate
Sur le sujet, une fois ne risquant pas d'être coutume ici, j'ai envie de remonter, historiquement s'entend, jusqu'à Jésus.
Selon son commandement aux apôtres, « Allez et enseignez à toutes les nations », il paraît que ceux-ci se seraient dispersés à travers le monde pour y semer la bonne parole.
Saint-Pierre prêcha à Rome et c'est donc là que la liturgie fut célébrée en latin et selon la culture romaine. C'est ce qu'on nomme le rite latin.
Son frère aîné, Saint-André, porta ses enseignements en Grèce. L'ancienne culture grecque servit alors de fondement au rite grec, que l'on dit aussi rite byzantin.
Pendant 1000 ans, le christianisme s'est donc développé dans toute l'Europe sur la base de ces deux rites, sans que l'église ne connaisse de dissension, le successeur de Saint-Pierre, le pape donc, ayant pour mission de sauvegarder l'unité. Rappelons d'ailleurs que beaucoup de papes étaient alors d'origine grecque, en guise de consensus...
La première grande nation slave à se convertir au christianisme, en 863, la Grande Principauté de Moravie, avait pour apôtres Saint-Cyrille et Saint-Méthode. Membres du clergé grec, issus d'une grande famille gréco-slave de Thessalonique, ils ont composé un autre alphabet pour la langue slave et ses amoncellements de consonnes et traduit la Sainte Ecriture et les livres liturgiques en slavon. Les Slaves adoptèrent donc, en l'honneur de Saint Cyrille, l'alphabet cyrillique.
En 868, Adrien II, évêque de Rome, ratifia l'usage de la langue slave dans la liturgie. Dès lors, la chrétienté louait son dieu en trois langues : le latin, le grec et le slave.
C'est en 1054 que la division est consommée. L'église orientale et l'église occidentale rompent leur union et fondent deux centres ecclésiastiques indépendants, l'un ayant son siège à Rome et l'autre à Constantinople.
L'orthodoxie qualifie dès lors l'église qui est dans le vrai, ben voyons, et désigne les chrétiens de l'Orient. Le catholicisme désigne les liturgies de l'Occident et qualifie ce qui est universel et ne peut être discuté, re-ben voyons.
Le problème de fond n'est donc pas un problème de déviance spirituelle à une foi commune, mais un problème politique, Rome et Constantinople se disputant, depuis l'empereur Constantin et la fondation en 330 des deux empires romains, d'Orient et d'Occident, les zones d'influence géopolitiques.
Les différences de culture et de célébration de la liturgie ont ainsi servi de tremplin historique à la désunion.
Des siècles après le schisme, des efforts furent faits par la communauté gréco-byzantine pour rétablir l'unité entre Rome et Constantinople. Cette église orthodoxe ayant choisi de s'unir, pour des raisons politiques, à l'église romaine, s'est alors appelée l'église uniate.
C'est donc aux frontières de l'Orient et de l'Occident, là où cohabitaient les deux églises et les deux liturgies, que cette union s'est réalisée, comme imposée par les nécessités, comme « un passage en douceur » entre les deux grandes zones d'influence.
Sur le territoire de la Pologne de l'Est, les deux Polognes, puisqu'il y avait la Pologne dite de la « couronne » et la Pologne de « la Grande Principauté de Lituanie », cette union a été célébrée entre les évêques russes et les évêques de l'église catholique romaine à Brest Litovsk, en 1596, aujourd'hui en Biélorussie, juste de l'autre côté du Bug.
En abusant de raccourcis tant historiques que religieux, disons que cette union de Brest est aussi significative que le fut en France le fameux édit de Nantes.
La paroisse néo-uniate de Kostomłoty, à une trentaine de kilomètres de chez moi et où, quoique indomptable mécréant, j'aime aller flâner, est la descendante directe de cette union historique de Brest.
Sous l'occupation russe, au troisième partage de la Pologne, l'union de Brest a été abolie par le tsar et les uniates massacrés sans autre forme de procès.
Et ce ne fut qu'a la renaissance de la Pologne, le 11 novembre 1918, que cette union a été rétablie en Podlachie en prenant le nom de néo-uniate. Mais sur les dix paroisses existant avant la répression tsariste, une seule a survécu au régime communiste, celle de Kostomłoty.
Le site
C'est donc là l'unique paroisse uniate de toute la Pologne. De quelque confession que l'on soit, et même sans confession du tout d'ailleurs, Kostomłoty vaut la balade du point de vue de cette singularité, du point de vue de l'histoire comme de celui des charmes de la place.
Au bord du Bug, Kostomłoty est un minuscule hameau sous la verdure.
Le sanctuaire occupe un grand jardin d'arbres et de plantes au milieu duquel sont l'église, le presbytère et une chapelle, le tout en bois.
Les premiers documents historiques relatifs à Kostomłoty mentionnent l'année 1412, date où le Grand Prince de Lituanie, Witold, a rattaché le village au couvent des Augustins de Brest.
La paroisse uniate y a été créée en 1631, peu après Brest Litovsk.
Extrait d'un projet (plus de 200 pages et 100 photographies) abandonné faute de moyens et d'oreilles pour nous écouter :
" Vade mecum de la Podlachie du sud" par Dorota et moi-même
11:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.05.2010
Alchimie sommaire de l'écriture

Toute la problématique de l’écriture réside dans cette confrontation entre l’intérieur mal maîtrisé, mal connu même, et l’extérieur fortement matérialisé, codé à l'extrême et d’apparence rigoureusement organisé. Un extérieur qui poursuit ses buts autonomes, qui se soucie comme d’une cerise d’être écrit et un intérieur qui doit composer avec lui, au risque de périr.
Mais qui vient d’ailleurs, décalé.
On n’écrit le présent que sous la dictée, même très discrète, d’un passé.
On écrit au passé décomposé du subjectif.
Ce monde d’enchevêtrements mécaniques où se distordent nos efforts pour rester humains, ne pourra jamais être pensé sensiblement, donc écrit, par moi sans que ma plume n’ait trempé au préalable dans l’encrier où sommeillent mes premiers paysages. Une rivière, des frères, une mère, des chemins d’école valsant sous des brouillards, des équinoxes aux odeurs de champignons et de troupeaux mêlées, de vieux récits de trappeurs dans des livres jaunis, de premiers camarades, d'affrontements douloureux avec l'ordre et la discipline, d'amours inachevées, vaincues, parfois bâclées, d'amitiés sans lendemain.
Nous avons tous, sans doute, des paysages, une voix brisée d’aïeule, un coin de terre, une forêt initiale, un indéfini de nous et que nous avons quittés trop brusquement.
Sans prendre congé.
Nous avons basculé, chaviré, dans une espèce d’époque secondaire qui niait nécessairement notre primaire. Et nous n’en étions pas peu fiers, de changer d’époque, de notre mue !
La révolte capillaire, le rock, la pop, la découverte du plaisir sexuel - encore que celui-ci soit sous -tendu (sans jeu de mots facile) par d'innombrales autres accès aux plaisirs de vivre - la guerre du Vietnam et la révolution. Le tout sous les volutes bleues d’une herbe capricieuse, dont les graines crépitaient parfois sous la chaleur du mégot, entre amis du même tonneau.
Ce n’est qu’après, en se faisant frotter l’un contre l’autre l’intérieur et l’extérieur, du moins en pensant la friction, que les véritables étincelles sont venues. Celles de l’abandon des chimères, vaincues par la fuite et la réalité du temps
Ecrire, c’est poétiser la souffrance. Quels que soient les effets d’annonces, les formes, les prétentions et les exigences de l’écriture.
On n’écrit cependant jamais aux prises réelles avec la souffrance. Quand on est sous les rafales d’un cyclone, on pense à sauver sa peau, pas à décrire le vent.
J’ai passé un an dans une souffrance morale des plus aigues. Quelque chose qui, à force, passait au physique, formait dans le ventre une boule et me faisait hurler de douleur, le matin au réveil.
Le corps obligé de prendre en charge une part de la souffrance afin que l’esprit ne sombrât pas totalement. Le corps comme une soupape de sécurité, justifiant ainsi les cris qui, sans lui, eussent assurément passés pour les manifestations d’une démence accomplie.
Un nom donné au mal de vivre : il a mal au ventre. Ah, c’est pas grave alors…Faut voir un médecin.
Aucune envie d’écrire, ne serait-ce la moindre chansonnette. Les seules échappatoires, l’alcool et la marche sous la pluie, le visage inondé sur des chemins fangeux. Les trois conjugués, le vin, beaucoup de vin, la pluie et la marche, transportent la souffrance dans les sphères plus lénifiantes de la pensée pure.
Après seulement est revenue le goût d’écrire. Ce plaisir sans égal d’inscrire les mots qu’on redoutait tant à dire. Après la cassure.
Le schisme consommé, le raz de marée, la lame de fond ayant tout détruit sur leur passage, l’écriture est venue reconstruire le paysage.
C’est ça, pour moi, écrire. Reconstruire les paysages perdus.
L’écriture, c’est pas fait pour comprendre. Y’a des divans pour ça. Au pire, des philosophes.
L’écriture, ça existe pour bâtir des mondes de l’intérieur. Quand ces mondes sont rentrés en une telle contradiction avec l’extérieur qu’il leur a fallu livrer une bataille mortelle et que c’est eux, les intérieurs, qui en sont sortis – momentanément du moins- vainqueurs.
Je n’invente alors rien. Ni le trouble des beautés anonymes d’un pays où je vis en étranger, ni les « je » narrateurs, ni les personnages d’un récit.
Ils sont tous des fantômes de ma vie enfuie, dilapidée.
Et conviés aujourd’hui à venir goûter une part de mon bonheur d’exister.
C’est quand je reconnais dans une écriture ce mélange détonant de fantômes, de bonheur d’exister et de souffrance, que je sais être en présence d’un frère.
D'un compagnon de route.
D'un qui sait que la beauté de l'écriture - comme celle de la littérature même si elle ne la rejoint pas toujours - réside dans son incontournable non-nécessité.
Texte mis en ligne en septembre 2008, modifié.
10:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.05.2010
J'attends des mutants !
 Nous changeons d'année tous les trois cent soixante cinq jours, trop souvent donc à mon goût et sans doute au vôtre également, à grands renforts de petits fours et autres flonflons et... de petites rides insidieuses, de petits rhumatismes espiègles, par ci par là....
Nous changeons d'année tous les trois cent soixante cinq jours, trop souvent donc à mon goût et sans doute au vôtre également, à grands renforts de petits fours et autres flonflons et... de petites rides insidieuses, de petits rhumatismes espiègles, par ci par là....
Nous avons même eu le privilège, voici neuf ans, de changer de siècle !
C'est pas donné à tout le monde d'arroser un changement de siècle au cours d'une vie. Vieillir de cent ans en une seule nuit !
Je ne vois pas trop ce qu'il y a de désopilant, mais bon...
J'en fus fourbu, d'autant qu'il m'en souvienne.
Si vous aimez ça, arroser les basculements du temps mathématique, ce temps qui imite la durée universelle qui nous creuse le trou froid du néant, alors préparez votre budget, vos caisses de champagne, et vos tonnes de chocolateries ! Commencez d'engraisser le veau gras, engrangez les confits et les foies de canard !
Car, très prochainement, dans les trois prochaines années exactement, nous allons passer de la période Holocène du quaternaire, dans laquelle nous pataugeons depuis seulement 11 710 ans, à la période Anthropocène.
Je vous sens bouche bée.
Je n'invente pourtant rien. C'est ce qu'affirme un groupe de vingt neuf représentants des différentes sciences, réuni sous la houlette du directeur de l'Institut de l'environnement de Stockholm. Le changement de période - on aurait plutôt besoin de changement d'air, avec ou sans homonymie et dans toutes les acceptions de l'expression, mais bon on prend ce qui nous est servi - sera donc officiellement et très prochainement proposé à l'union internationale des sciences géologiques.
Et c'est une catastrophe....Jamais une période géologique n'aura été aussi brève....11 000 ans ! Même pas le temps de lacer ses chaussures !
Bon, soyons sérieux cinq minutes ...Parce que tout ça l'est effectivement...
Des neuf indices sur lesquels se basent les scientifiques (pas ceux qui boivent du vin hongrois dans « Géographiques », mais d'autres beaucoup plus sévères et qui n'ont pas le temps de badiner avec les poètes), trois sont au rouge écarlate et c'est ce qui motive la décision des respectables et susdits savants :
- Disparitions d'espèces végétales et animales. Cent par an, ce qui constitue un danger énorme pour la biodiversité et a chamboulé complètement l'écosystème de la boule bleue. Plus de quatre cents sites dans le monde ont été répertoriés d'où la vie, tant végétale qu'animale, a d'ores et déjà complètement disparu, notamment en Baltique.
Retour, donc, au chaos originel...Des millions d'années avant les dinosaures.
- La circulation d'azote dans la nature complètement détériorée par suite d'introduction artificielle par l'homme. Ces gros connards d'agriculteurs industriels en premier lieu.
Là aussi, la vie se meurt sur de nombreuses zones repérées par les scientifiques.
- Le réchauffement climatique enfin, mais je crois qu'il s'agit là d'une conséquence des autres monstrueux avatars.
Vous voilà donc prévenus(es). Nous sommes les derniers lézards terribles d'une époque géologique qui s'achève.
Et tout ça, parce que l'humain est un imbécile des plus accomplis avec son système de production à la con et son idée complètement faussée du bonheur de vivre dans un habitat planétaire.
À ce propos, d'ailleurs, je fais remarquer que les verts, les rouges, les bleus et tout le Saint-Frusquin de la parole militante et politique se mettent le doigt dans l'œil ( et je suis poli) jusqu'au coude avec leurs pleurnicheries genre « Sauvons la planète ».
Parce que la planète, elle, elle en a vu d'autres, des cataclysmes, des pluies de feu, des émanations titanesques de gaz, des explosions apocalyptiques, des soulèvements épouvantables de son écorce, des vies et des espèces s'éteindre....Elle n'est plus à une révolution radicale près. Elle a encore les reins solides pour continuer sa promenade dans le cosmos, en l'état ou dans un autre, avec des humanoïdes à son bord ou sans.
Un train sans voyageur, ça roule quand même...
Ce sont donc les hommes, qu'il s'agit de sauver, bandes de cornichons aux yeux plein de m..... ! Pas la planète !
Et, ma foi, puisque pas grand monde ne semble pressé ou disposé à me faire de grands compliments, je vais m'en faire tout seul et avouer n'être pas trop mécontent de moi pour avoir écrit dans "Géographiques" :
" (...) la terre, les climats et leurs paysages tels que nous les avons vécus depuis des siècles sont irréconciliables avec le niveau d'activité atteint aujourd'hui par les hommes. Le divorce est consommé entre l'espèce humaine et son habitat. Tout le monde le pressent, personne ne le dit clairement. Pour inverser la tendance, il faudrait bouleverser radicalement le comportement des sociétés à l'échelle planétaire, abandonner totalement la prédominance de l'économie sur tout le reste et, ça, c'est hélas complètement inconcevable. Aussi inconcevable que si homo habilis eût désiré un beau jour redevenir homo erectus. L'esprit humain est bloqué depuis des siècles sur l'idée que production de richesses et bonheur sont indéfectiblement liés et cette idée inlassablement mise en œuvre s'est nourrie au détriment des principes fondamentaux de la vie sur terre. Les soubresauts pour tenter de le libérer de ce postulat suicidaire se sont tous montrés inopérants et je ne vois pas poindre à l'horizon de tumultes de nature à bousculer le désordre des choses. » Géographiques - TQF - Page 77
La question que je me pose, quand même : est-ce que les hommes seront aussi cons en période Anthropocène qu'en période Holocène ?
Il y a, hélas, de grandes chances que oui.
La connerie se s'éteindra qu'avec l'extinction des cons et c'est pas un changement de période géologique, changement prématuré au regard de l'histoire de la planète, changement dicté par leurs comportements de cons, qui va les convaincre d'être un peu moins cons.
14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.05.2010
Non de non !
Nous sommes quatre. Comme les trois mousquetaires.
Mousquetaires sans cause ni roi et nous nous retrouverons régulièrement, à partir du lundi 10 mai, pour croiser le fer avec ce monde où le mensonge permanent tient lieu d'autorité morale.
En tout cas bien décidés à ne pas en être les beni-oui-oui.
Les béni-non-non, plutôt...
Ce sera comme ça et ce sera avec lui, lui, lui et moi-même :

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.04.2010
Dialogue de sourds

« C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit, dès le seuil, que je ne m'y suis proposé d'autres fins que familiales et personnelles. Je n'y ai nul souci de ton intérêt ou de ma gloire : je n'ai pas assez de force pour concevoir un tel dessein : j'ai destiné ce livre à la commodité personnelle de mes parents et de mes amis, afin que...» blablabla blabla...
Michel Montaigne
Les Essais

«Je ne connais qu'un écrivain que, sous le rapport de la probité, je place au rang de Schopenhauer et même plus : Montaigne.
Qu'un tel homme ait écrit, vraiment le plaisir de vivre sur cette terre a été augmenté...C'est à son côté que j'irais me ranger s'il fallait réaliser la tâche de s'acclimater sur cette terre.»
Frédéric Nietzsche
Le gai savoir
« Doit y avoir une erreur quelque part.... »
Bertrand Redonnet
09:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.04.2010
Vitrine
Depuis mes lointaines contrées, ayant pour l'heure peu d'échos de "Géographiques" - mais il est bien tôt et comme me disait François Bon qui en sait quelque chose, "quand on est auteur, apprendre la patience" - c'est avec grand plaisir et sans fatuité aucune que je rends publique cette amicale et délicate attention de Martine Sonnet, qui m'adresse la photo, joliment faite, de la librairie Tschann, boulevard du Montparnasse, où le livre est en vitrine.
Je me dis que si il y a un passant sur dix mille qui le lit, il sera vite épuisé.
Mais un sur dix mille, en littérature, ça tient de l'incorrigible utopie....

10:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.04.2010
Mais fermez-la donc un peu !
 J'avais plus ou moins décidé de rester muet sur les événements tragiques qui ont frappé ces derniers temps la Pologne.
J'avais plus ou moins décidé de rester muet sur les événements tragiques qui ont frappé ces derniers temps la Pologne.
Pour une foule de raisons personnelles, la première étant que ce sont là des événements dus au hasard et que, tout à une écoute consciencieuse du monde que nous prétendons être, les embrouilles a posteriori de sa mise en scène font que nous ne comprenons pas grand chose à ces salades, en Pologne comme partout ailleurs.
Gardons-nous bien de vouloir faire les doctes analystes si nous voulons en même temps nous garder de dire des conneries.
Mon premier sentiment a été évidemment l'affliction, d'un point de vue strictement humain, sans que cette affliction n'ait pour objet plus précis « les têtes d'affiche » disparues dans la catastrophe. La mort est partout épouvantable. Elle l'est d'autant plus quand elle prend un caractère collectif, qu'elle frappe des symboles ou des quidams.
J'avais donc plus ou moins décidé de rester muet sur ces événements, qui ne sont les effets ni d'une stratégie, ni d'une morale, ni d'une idéologie. La somme d'inepties et d'ignorances que je lis cependant, sur eux et sur ce pays en général, m'oblige quand même à en dire un mot de révolte.
Je lis, par exemple, dans le Figaro pour ne citer que lui, que Kaczyński représentait la Pologne profonde....
Et que représentent donc en France - le pays que je connais le moins mal - Sarkozy, Royal, Bayrou, Cohn Bendit, Le Pen, les plus chéris du suffrage universel de la donneuse de leçons ?
La France des Lumières peut-être ?
Que Kaczyński ait été un président réactionnaire, obscur dans sa tête et qu'il ait donné à l'extérieur une image peu reluisante de la Pologne, personne ne vous a attendus, surtout ici, pour le savoir...Chirac ne donnait pas non plus de la patrie de Voltaire et de Rimbaud une image des plus futées....
La Pologne profonde, je la connais un peu.
En son sein sont des hommes et des femmes qui ne sont ni homophobes, ni nationalistes, ni partisans de la peine de mort, ni grenouilles de bénitier, ni brutaux, ni actionnaires de Radio Marya.
Bref, avant de noyer un pays dans une potion gluante et globale, pensez un peu, messieurs-dames du journalisme de masse, que si la Pologne existe enfin, c'est qu'il y a des Polonais qui n'entrent pas dans vos tiroirs de folliculaires.
Commencez donc par balayer devant votre porte.
Ça devrait vous occuper un moment...
Photo Wikipédia : Maria Skłodowska (Marie Curie)
10:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.04.2010
Sacré Debord, va !
 " Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises."
" Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises."
Bon, ben, moi j'ai pas d'opinions politiques précises sur l'échiquier spectaculaire. J'ai juste un truc viscéral, humain, qui me tarabuste et m'empêche de goûter pleinement le monde à son injuste valeur.
Alors, critiques bourgeois, vous gênez surtout pas, hein, félicitez de vos critiques affinées et sans retenue mes quelques et bien maigres opus.
Le pire serait votre silence dédaigneux... Là, je me demanderais bien quelles fautes j'ai pu commettre.
Mais une faute suppose une orthodoxie...Il eût fallu commencer par là !
Et l'orthodoxie, de nos jours, elle en a des kyrielles, de visages !
11:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.04.2010
La malédiction Katyń
D’autres l’ont déjà souligné : ce qu’il y a de terrible et de traumatisant, par-delà le drame strictement humain, dans cette catastrophe où un état est littéralement décapité, c’est le lieu…
La première réaction des Polonais, dès samedi matin, fut bien : Non, ça n'est pas vrai ! Ce lieu nous poursuit de sa malédiction !
Difficile en effet de ne pas faire un parallèle, fût-il osé et sans objet, entre les 22 000 officiers et intellectuels polonais assassinés en avril 40 par la police communiste à Katyń et le drame de samedi matin.
Tout cela résonne au centuple dans le cœur de chaque Polonais et je crois sincèrement qu’il fait être Polonais pour vraiment le comprendre autrement qu’avec la tête.
Les Polonais sont croyants. Pour la plupart...Ne faisons pas fi de ceux qui ne le sont pas. Ils sont tout aussi Polonais.
Mais ils sont aussi superstitieux…Et puis, tout ça se passe chez les Russes…Alors, ça n’aide pas vraiment à garder son sang froid.
 Les imaginations les plus folles, les délires les plus inconséquents et les suppositions les plus scandaleuses se murmurent ou, même, se disent à voix haute.
Les imaginations les plus folles, les délires les plus inconséquents et les suppositions les plus scandaleuses se murmurent ou, même, se disent à voix haute.
On peut comprendre : cette nation est régulièrement soumise aux épreuves les plus dures…
Mais on ne peut évidemment pas cautionner.
La première question à poser, à mon avis, serait :
Comment un pilote des plus expérimentés, trié sur le volet, qui a entre ses mains la responsabilité de l’élite d’un Etat, peut-il, de son propre chef, passer outre les conseils de sécurité que lui prodiguent les aiguilleurs du ciel de Minsk et de Moscou, à savoir de ne pas atterrir à Smolensk, trop difficile, trop risqué, vu les conditions météo ?
Le bon sens le plus élémentaire ne peut être que perplexe.
Quand on aura bien voulu répondre à cette question autrement qu’à l’aide du traditionnel, lapidaire et bien commode « erreur de pilotage », on aura la clef du drame et les suppositions les plus folles s'écrouleront d'elles-mêmes.
Pour l’heure, respect et émotion devant le drame humain et une pensée toute particulière pour ces membres des familles assassinées à Katyń et qui, se rendant ce 10 avril pour un hommage historique, ont trouvé, comme leurs ascendants directs, une effroyable mort dans la forêt maudite.
10:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
31.03.2010
Erreurs d'aiguillage : attention un bonhomme peut en cacher un autre !
 Si on n'a vraiment rien à faire, mais alors là vraiment rien, que l'après-midi s'étire comme un long et noir corbillard, qu'on s'ennuie terriblement devant son ordinateur, qu'il pleut, qu'il fait froid ou qu'il vente et qu'on ne peut décemment pas batifoler au jardin, qu'on est peut-être fâché avec sa compagne ou son compagnon, que sais-je encore, alors il peut arriver, je dis bien "il peut", qu'on tape sur Google «Bertrand Redonnet.»
Si on n'a vraiment rien à faire, mais alors là vraiment rien, que l'après-midi s'étire comme un long et noir corbillard, qu'on s'ennuie terriblement devant son ordinateur, qu'il pleut, qu'il fait froid ou qu'il vente et qu'on ne peut décemment pas batifoler au jardin, qu'on est peut-être fâché avec sa compagne ou son compagnon, que sais-je encore, alors il peut arriver, je dis bien "il peut", qu'on tape sur Google «Bertrand Redonnet.»
Rien de grave là-dedans.
On trouvera alors des mots en leur exil, des commentaires sur tiers-livre ou d'autres sites amis, on trouvera Publie.net, Chez Bonclou, Polska B dzisiaj, Zozo éperdument chômeur, des critiques de ces trois livres, Brassens et son érudition et... tout récemment, Géographiques, la critique de Nauher, mais très loin, très loin.
On en est déjà à la page je ne sais plus combien.
Si, en revanche, comme je l'ai fait - oui, je l'ai fait, misérable Narcisse qui voulais voir si ce « Géographiques » trouvait quelque écho sur des sites que je ne connais pas - on affine sa recherche par « Redonnet Géographiques », là on s'y perd un peu. Normal. Il est un peu tôt.
On trouve quand même Nauher en première page et ça m'a bien fait plaisir.
Soit-dit en passant, il y a un site de vente directe, je ne sais plus lequel, et c'est bien parce que je ne veux point lui faire du tort, qui classe mon livre dans « Dictionnaires, atlas, voyages... »
Glups !
Vont être contents les gens qui vont l'acheter sans lire la quatrième, si ça existe, des gens comme ça.
Toute proportion gardée, ça me rappelle ce film où je n'avais rien compris mais à la séance duquel un ami cinéphile m'avait traîné en me tirant par la manche, à Paris : « L'angoisse du gardien de but avant le penalty ».
Au fur et à mesure que défilaient les images et que lambinait un ésotérique scénario, la salle se vidait avec des brouhahas sourds et des mouvements d'humeur non contrôlés...Il n'y avait pas un traître mot de football dans ce merdier et nous nous sommes retrouvés, mon ami et moi, à deux dans cette salle !
Mais revenons à nos moutons.
Ce que je voulais dire, c'est qu'avec "Redonnet Géographiques" on trouve surtout ça, et que ça ne m'a pas fait rigoler du tout, du tout, du tout...
C'est quand même pas de pot, un Bertrand Redonnet qui s'occupe (ou s'occupait ) du trafic de drogue, justement en Pologne !
Et c'est comme ça, ma foi, qu'on ramasse un coup ou une balle perdue...
Donc, pas d'affolement. Je tenais à vous prévenir qu'en 2001, je n'avais pas encore mis les pieds en Pologne...Au cas où, par un après-midi gris, avec du vent, de la pluie, et une brouille (que j'espère passagère) avec votre compagne ou compagnon, vous auriez cette idée saugrenue et qui ne sert à rien.
Me rappelle quand François Bon, victime d'une fâcheuse homonymie, avait été élu en 2008, photo à l'appui, au Conseil général de Vendée.
Il avait été content, le p'tit père François, promu en conseiller général !
Il avait bougonné dur...Là.
Moi, ça m'avait bien fait rire, cette histoire. Parce que François Bon, l'autre, le vrai conseiller général, c'était mon supérieur hiérarchique à Niort. On était devenu des copains et, en venant à parler de littérature et de François, l'autre, le vrai écrivain, il m'avait raconté que déjà, attaché culturel à l'ambassade de France en Norvège, une belle dame était venue un jour le féliciter pour son livre. Je ne sais plus lequel.
C'est à lui que j'avais dit un jour : Putain, t'es sympa, t'es pas bête, t'es pas méchant, qu'est-ce que tu fous à droite ?
12:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.03.2010
Géographiques : critique
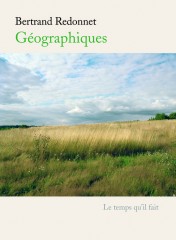
Une première critique formulée ici.
Je crois qu'un auteur est content de la critique lorsqu'il reconnaît, sous la plume de l'autre, la lecture de sa lecture du monde.
Merci à vous, Nauher.
12:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.03.2010
C'était au bord de la Vistule...

Le fleuve était gris et roulait des flots ombrageux.
Je m’étais assis sur les berges en hauteur et je le voyais en contrebas, très large. Il musardait sur des plages de sable et des arbres se penchaient qui noyaient leurs bras maigres dans les eaux, entre lui et moi.
Il y avait là des tourbillons d’écume.
Le fleuve préparait son entrée dans Varsovie, à une vingtaine de kilomètres derrière des dunes boisées. Je le regardais qui s'enfuyait et je pensais à la Sirène Sawa, sortie de ses profondeurs pour fonder la ville.
Je n’ai pas vu arriver la femme.
Elle était assise à mes côtés et, elle aussi, regardait fixement les mélancolies du fleuve. Peut-être même était-elle là avant moi.
Je n’en sais plus rien à présent. Qui, d’elle ou de moi, avait choisi le premier de venir s’asseoir ici, si loin de tout, au bord de la Vistule ?
Elle tourna lentement son visage vers moi. Je sursautai et poussai un cri.
Car elle était vieille, immensément vieille, en même temps que d’une effroyable beauté. L'éclat d'une intelligence et d'une jeunesse exquises dansait dans ses vieux yeux et le contraste entre la peau telle un palimpseste mille fois raturé et la jeunesse presque vierge du regard était terrifiant.
Elle souriait aussi. Je n’avais jamais vu de sourire avec autant de sérénité inscrite au bord des lèvres.
- Je t’ai fait peur. Voilà des années et des années que tu cours dans mon sillage et je t'ai fait peur. Fallait pourtant bien que je finisse par venir m’asseoir à tes côtés.
A quoi rêves-tu donc ici, au bord de ce grand fleuve ? Les mots te manquent et tu ne sais dire le monde que par des émotions agitées que semble préfigurer cette eau qui s'enfuit.
Tu ne perds pas ton temps. Les mots qui manquent sont toujours les mots essentiels. Tu ne les ramasseras qu’au bord des fleuves que tu as imaginés, qu’au long des chemins où tu as cru marcher, sur des grèves en furie que tu n'as jamais vues, sous les forêts les plus sombres qui soient et que tu as fuies.
Tu ne les écriras jamais, ces mots. Sitôt cueillis, ils t’échapperont. Tu écriras des mots qui leur ressemblent. Quand tu veux écrire l’homme et son monde, écris d’abord leur absence.
Il faut me croire. Car je suis une vieille créature qui ne vit que par les mots. Mon destin et mon rôle interrogent tous les mots. Mais les mots qui m’interrogent sont morts-nés.
Mes enfants alors se disputent tous le droit de parler en mon nom, parce qu'aucun d'entre eux ne me veut encore adulte. Adulte moi, eux seraient morts.
Car je suis perverse. Tous ceux qui me consacrent leurs mots pensent trouver en moi un refuge d’élection quand c’est moi qui suis nourrie de leur sang. Et je suis éternelle et pourtant meurs souvent. Je meurs chaque fois qu'un poète se prosterne à mes jupes, chaque fois qu'il travestit ses mots et trahit son voyage à seule fin de me plaire.
Je suis vieille. Tu le vois. Aussi vieille que le premier cri du premier être pensant.
Regarde encore le fleuve et les nuages qui baignent sur son eau. Je suis aussi ces nuages. Tu ne me trouveras que dans un monde reflété.
Il faut, pour parvenir jusqu'à moi, savoir lâcher la proie pour l'ombre.
- Mais qui êtes-vous, madame, pour me tant dire et pour parler ma langue, si loin d'où je viens ?
- Qui je suis ? Mais je viens de le dire. Ne m’as-tu jamais vue auparavant ? Regarde-moi bien...
- ......
- Oui, peut-être. Il me semble à présent....Quel est ton nom, madame ?
- Les tiens m'appellent Littérature.
Texte publié en octobre 2008
12:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.03.2010
Géographiques, aujourd'hui
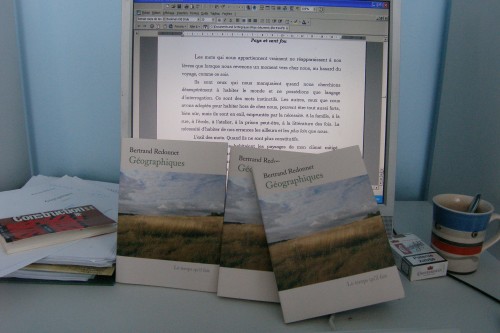
C'est donc la fin d'une belle aventure et le début d'une autre tout aussi passionnante, mais où l'auteur ne maîtrise plus grand chose. Pourtant, du déroulement de cette seconde aventure dépend exclusivement la vie de son livre et c'est vers elle qu'il a formulé ses espoirs, bientôt accompagné de son éditeur.
Amical salut à Georges Monti et Marie-Claude Rossard, dont le professionnalisme n'a d'égal que leur gentillesse et leur goût pour une complicé fraternelle.
C'est la fin d'une aventure entamée en novembre 2008, par un premier mot jeté sur une feuille muette, aux premiers frimas d'un automne continental, tout de pourpre et de jaune bruissant.
À partir d'aujourd'hui, lectrice et lecteur, les flots qui porteront mes mots appartiennent à ton seul océan...
Je te les confie et n'en prends surtout soin que s'ils trouvent en toi quelque chose de nous.
Amicalement
10:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.03.2010
Classique contemporain
 Serais-je un égaré ? Un obsolète ? Un décalé de la lecture ? Un poussiéreux de l'intellect ? Un lycéen demeuré demeuré demeuré contre vents et marées ?
Serais-je un égaré ? Un obsolète ? Un décalé de la lecture ? Un poussiéreux de l'intellect ? Un lycéen demeuré demeuré demeuré contre vents et marées ?
C'est fort possible, tout ça.
Plaisantes interrogations qui se sont imposées quand, mettant un peu plus de désordre que de coutume dans ma bibliothèque - en jetant par endroits et par la fenêtre un regard sur la neige qui recouvre encore les halliers tout près - j'ai fait le constat de ce que j'avais lu, (relu, rassurez-vous, et, concernant certains livres, au moins pour la troisième fois) disons, à peu près, au cours de l'année qui vient de s'écouler.
Oyez plutôt comment ça fleure bon le passéiste :
Michelet et son histoire de la Révolution française, Le Grand Meaulnes, Splendeurs et misères des courtisanes, les Paysans, Lamiel, Manon Lescaut, Colomba, Jacquou le Croquant, Bouvard et Pécuchet, Boule de suif, Madame Bovary....
Je suis à peu près certain que j'en oublie quelques-uns, du même tonneau...
Et puis, évidemment, des visites régulières chez Mallarmé, Villon, Baudelaire, Rimbaud et Maupassant.
Hé ben, me suis-je murmuré, si la chaîne du livre est en crise parce que les gens ne lisent plus assez, tu y es un peu pour quelque chose, mon bonhomme : Tu ne lis que des morts !
Ce qui peut quand même paraître contradictoire et pas très généreux de la part d'un homme qui « vend sa pensée et qui veut être auteur.»
Mais quel plaisir ! Non pas qu'ils soient morts, ces gens-là, mais de relire tous ces grands livres. Lire pour ce qui concerne « Lamiel » de Stendhal ( livre inachevé, parfois à l'état d'ébauche), « Jacquou le Croquant », qui n'est pas un grand livre, et le volumineux Michelet, qui tient du chef-d’œuvre.
Quel plaisir parce qu'il y a sans doute autant de lectures d'une oeuvre véritable qu'il y a de saisons dans la vie d'un homme. Ou d'une femme, il va sans dire. Et que sans doute, ces saisons ont besoin comme d'un goût d'éternité.
J'ai même dans la tête de relire, pour la troisième fois, Guerre et paix...Lu d'ici, de la frontière biélorussse, je suis certain que ce sera encore une découverte.
Je me suis tout de même offert quelques heureuses incursions dans le présent... Riches heures de Jean-Louis Kuffer, Stasiuk, son Corbeau blanc et Fado, le premier roman de Stéphane Beau, le Coffret, Atelier 62 de Martine Sonnet, le manuscrit d'un ami du net...Quelques autres aussi, sans doute...
Mais quand même...Quand même...
Trois raisons peut-être à mes épouvantables archaïsmes : J'ai toujours été plus ou moins classique - un classique révolté, c'est pas facile à porter-, je suis loin des librairies françaises, je suis d'une autre latitude, et, surtout, je lis tous les jours sur le net, de l'excellent, du bon, du passable et du très mauvais.
Et ça, c'est du contemporain en live.
Mais quand même, que je répète.
Parce que j'ai un livre qui sort en librairie jeudi prochain et si tout le monde attend que j'aie passé le clavier à gauche pour le lire...
Bref...
Image d'un contemporain : Philip Seelen
12:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.03.2010
La vie s'écoule

Jean Ferrat est mort.
C’est samedi qu’un copain attristé, francophone et francophile, me l’a appris, sitôt l’avoir lui-même su.
Je me suis dit que Ferrat aurait été content de savoir que des Polonais l’avaient aimé...Ferrat compagnon de route des communistes, mais très critique vis à vis de Moscou et de l'écrasement de Prague de 1968.
Sobres hommages rendus à Ferrat, ici, ici, et ici.
Moi, Ferrat, il m’évoque tout de suite un petit tourne-disque que ma mère avait eu la fantaisie d’acheter, une excentricité ramenée de la ville. Les voisins goguenards venaient voir le curieux instrument et tordaient leur gros nez, bouche bée vers le bas.
Ça ne les étonnait pourtant pas outre mesure qu’une femme en pantalons, avec du rouge aux lèvres, des talons hauts, qui fumait ostensiblement la cigarette, conduisait son aronde et prenait volontiers l’apéritif, se fût acheté une espèce d'inutilité pareille.
Un tourne disque et deux 45 tours. La Montagne et Le Gorille. Le début d’une longue amitié, pour le second titre.
Il m’évoque aussi l’écrivain Raymond Bozier, avec qui je fus un temps copain, pions que nous étions dans un lycée technique d’Angoulême. Il aimait beaucoup Ferrat, Bozier. Aragon plutôt, je crois.
Il m’évoque surtout des chansons poignantes, quelques vers puissants :
« Je twisterais les mots s’il fallait les twister »
et
« Celle dont monsieur Thiers a dit qu’on la fusille ! »
La France, reconnaissante envers les bourreaux de son peuple et de ses enfants, orne encore ses rues, ses places, ses avenues du nom infâme de cet ignoble sanguinaire versaillais.
C'est en dire assez long sur les orientations perverses de sa mémoire.
La France, lointaine, qui vient de repousser la bouillie que lui servent régulièrement ses politiques, lesquels n’en tireront aucune leçon, mais se convaincront qu’il leur faut être plus mauvais encore, plus fourbes, plus dissimulateurs, pour ramener au bercail les citoyens égarés dans un mutisme assourdissant.
Ce gros con de Le Pen réapparaît. Gageons que pour les fins analystes qui se goinfrent à l'auge du spectacle, ce sera la faute aux abstentionnistes plutôt qu’à la déliquescence de mentalités fourbues.
La campagne est blanche avec du soleil au-dessus. Trois mois maintenant de paysages blafards. Il manque du vert qui s'accrocherait aux talus. Et du jaune timide aussi, tremblant aux berges d'une rivière.
Géographiques est imprimé. Il prépare sa métamorphose, du manuscrit au livre posé sur la table d'un libraire.
Je vais relire mon récit paysan, achevé il y a quelques semaines. Ira t-il jusqu'au bout de sa métamorphose, celui-ci ?
C’est marrant : Il y a dans ce récit un domestique agricole né en 1930 et qui, face aux radotages d’un poilu de 14-18, se dit que lui, il n’était pas né à la première guerre, trop jeune à la deuxième et trop vieux à la troisième…Il en éprouve comme une sorte de solitude qui n'a rien à raconter de dramatique.
Mêmes réflexions, donc, que l’ami Solko.
L’écriture aurait-elle quelque chose d'une tacite complicité ?
Mais le temps s’écoule vers les horizons promis...
Salut l'artiste ! Maintenant, toi, tu sais...
14:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET



















