06.03.2012
Guitare et clavier
 Quand j’écris, chez moi, entre deux pages, voire deux paragraphes, et même parfois entre deux ou trois lignes, cela dépend de beaucoup de choses, de la spontanéité du flux d'écriture par exemple, je me lève et je prends ma guitare.
Quand j’écris, chez moi, entre deux pages, voire deux paragraphes, et même parfois entre deux ou trois lignes, cela dépend de beaucoup de choses, de la spontanéité du flux d'écriture par exemple, je me lève et je prends ma guitare.
Là, je fais une suite d’accords ou des gammes. Des gammes de blues le plus souvent. Ou alors, un vieux Brassens. Sur la pompe classique ou selon ma propre définition.
Pour moi seul. Et je me dis dans ces instants, qu’il y a une différence fondamentale, dans ma vie du moins, entre la musique et l’écriture.
Je n’ai rien présenté sur une scène depuis plus d’un an et demi et ça ne me manque pas du tout. La musique se satisfait donc d’elle-même, elle tire son plaisir d’elle-même, d’une confrontation à sa propre solitude. L’écriture, non. Celle-ci se veut à tout prix message, elle veut à tout prix être exposée, vue, connue, et même reconnue. Et elle n’est pas grand-chose, sinon rien du tout, sans cette perspective, ici, immédiatement sur ce blog, ou, bien plus hypothétique et dans bien plus longtemps, dans un livre. Elle poursuit un but social et existentiel, un but sine qua non, dont la suite d’accords ou les gammes n’ont que faire !
Et je pense souvent que si j’ai pu vivre de longs espaces de ma vie sans écrire, je n’ai jamais pu vivre sans une guitare à mes côtés, sans saisir le manche au moins une fois par jour. Partout. La première fois que je suis monté dans un bus place de la concorde, pour rejoindre Varsovie, je n’avais pas grand bagage, mais j’avais ma guitare. Comme une protubérance.
Je n’ai jamais appris non plus quelqu’un à écrire, jamais donné de conseils. J’en ai bien trop besoin moi-même, pensez donc ! En revanche, j’ai initié de nombreux jeunes à la guitare, dans un centre socioculturel. C’étaient de jeunes enthousiastes, certains ont vraiment continué très bien, jusqu’à dépasser, comme c’est souvent le cas, la dextérité réelle ou supposée de leur professeur.
Et j’ai un souvenir attendri pour l’un d’entre eux, Mathieu, à qui j’ai enseigné les fameuses gammes pentatoniques, le hammer, le pull-off et autres slides. Un féru de blues. Un doigté extraordinaire, sensible, romantico- spleen, mais un ado qui se rebellait à chaque fois que je voulais lui parler un tant soit peu de solfège. Tout au feeling.
Ce gosse-là m’avait fait deux cadeaux. Des Etats-Unis, il m’avait ramené le coffret intégral, précieux, unique, de Robert Johnson. Une bible. Des morceaux d'anthologie. Presque d'ethnologie. Je l’ai toujours, posé dans ma bibliothèque, parmi les livres comme s’il en était lui-même un… Et puis, une autre fois, Mathieu est venu à son cours avec les œuvres complètes de Rimbaud dans la pléiade. Et avec cette dédicace : tu m’as donné le blues-feeling. Merci.
Emotion en écrivant ces quelques lignes. Car ce pont, ce trait d’union, qu’il avait spontanément établi entre Rimbaud et ce qu’il ressentait du blues - Mathieu avait dix-sept ans à l'époque - je ne l’ai jamais vu ailleurs. Ah, Mathieu, tu m’as donné bien du bonheur avec ces deux cadeaux-là !
Ton Rimbaud, notre Rimbaud, trône également dans la bibliothèque aux côtés de Robert Johnson.
Et je n’ai pas souvenance que l’écriture m’ait un jour donné autant de retour humain.
C’est pourtant avec elle que je compose chaque jour. En elle que je mets de bien dérisoires espoirs. En elle que je m'efforce de croire, bien plus qu'en la musique.
Vanité, sans aucun doute.
Illustration : Le modèle exact sur lequel s'exercent mes velléités.
10:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.03.2012
En d'autres termes et le roman
 "L’analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me suis avisé que l’homme éprouve ce qu’il imagine éprouver. De là à penser qu’il imagine éprouver ce qu’il éprouve… Je le vois bien avec mon amour : entre aimer Laura et m’imaginer que je l’aime - entre m’imaginer que je l’aime moins, et l’aimer moins, quel dieu verrait la différence ? Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l’imaginaire. Et, s’il suffit d’imaginer qu’on aime pour aimer, aussi suffit-il de se dire qu’on imagine aimer, quand on aime, pour aussitôt aimer un peu moins, et même pour se détacher un peu de ce qu’on aime - ou pour en détacher quelques cristaux. Mais pour se dire cela ne faut-il pas déjà aimer un peu moins ?"
"L’analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me suis avisé que l’homme éprouve ce qu’il imagine éprouver. De là à penser qu’il imagine éprouver ce qu’il éprouve… Je le vois bien avec mon amour : entre aimer Laura et m’imaginer que je l’aime - entre m’imaginer que je l’aime moins, et l’aimer moins, quel dieu verrait la différence ? Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l’imaginaire. Et, s’il suffit d’imaginer qu’on aime pour aimer, aussi suffit-il de se dire qu’on imagine aimer, quand on aime, pour aussitôt aimer un peu moins, et même pour se détacher un peu de ce qu’on aime - ou pour en détacher quelques cristaux. Mais pour se dire cela ne faut-il pas déjà aimer un peu moins ?"
"On parle sans cesse de la brusque cristallisation de l’amour. La lente décristallisation, dont je n’entends jamais parler, est un phénomène psychologique qui m’intéresse bien davantage. J’estime qu’on le peut observer, au bout d’un temps plus ou moins long, dans tous les mariages d’amour."
"Tant qu’il aime et veut être aimé, l’amoureux ne peut se donner pour ce qu’il est vraiment, et, de plus, il ne voit pas l’autre - mais bien en son lieu, une idole qu’il pare, et qu’il divinise, et qu’il crée."
André Gide - Les Faux monnayeurs -
Ce que Nietzsche avait tranché d’une formule lapidaire : L’amour, c’est du sensuel qui passe au spirituel.
Et ce qu’un vieil ami, aujourd’hui hélas dormant de l’autre côté des pissenlits, avait encore résumé en ces termes galants : Conjurer son angoisse dans la métaphysique d’une touffe de poils.
***
 "Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste souvent se fait gloire. Les événements extérieurs, les accidents, les traumatismes, appartiennent au cinéma; il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point appartenir proprement au genre. Oui vraiment, il ne me paraît pas que le roman pur (et en art, comme partout, la pureté seule m'importe) ait à s'en occuper. Non plus que le fait le drame. Et qu'on ne vienne point dire que le dramaturge ne décrit pas ses personnages parce que le spectateur est appelé à les voir portés tout vivants sur la scène; car combien de fois n'avons-nous pas été gênés au théâtre, par l'acteur, et souffert de ce qu’il ressemblât si mal à celui que, sans lui, nous nous représentions si bien. - Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du lecteur."
"Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste souvent se fait gloire. Les événements extérieurs, les accidents, les traumatismes, appartiennent au cinéma; il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point appartenir proprement au genre. Oui vraiment, il ne me paraît pas que le roman pur (et en art, comme partout, la pureté seule m'importe) ait à s'en occuper. Non plus que le fait le drame. Et qu'on ne vienne point dire que le dramaturge ne décrit pas ses personnages parce que le spectateur est appelé à les voir portés tout vivants sur la scène; car combien de fois n'avons-nous pas été gênés au théâtre, par l'acteur, et souffert de ce qu’il ressemblât si mal à celui que, sans lui, nous nous représentions si bien. - Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du lecteur."
André Gide - Les Faux monnayeurs -
Voilà, à mon sens, une profession de foi artistique qu’avaient dû mal lire les écrivains adeptes du Nouveau roman et, loin après eux, ceux de la littérature contemporaine, qui, d’un seul coup d’un seul, ont décrété la mort du roman.
Quand on ne se sent pas le talent de la rénover, d’innover en son sein, on décrète la chose obsolète. Et on la tue. Du moins on dit qu'on a vu son cadavre. Quoi de plus simple ?
Pour moi qui me plaît encore à décrire les paysages et les hommes évoluant dans ces paysages, qui me plaît même à ne pas dissocier ces hommes-là de leurs paysages, l'affaire est évidemment beaucoup plus compliquée.
Car il en va de mon amour d'écrire.
11:05 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.03.2012
1984
 1984. A force d’avoir lu Orwell dans nos lycées, on en avait presque peur, de cette année là. Qu’il nous tombe encore une calamité sur le coin de la gueule qu’on avait déjà pas mal cassée. Bon sang, qu’on se disait, où peut-il bien se cacher, le Big Brother ? Hein ? Où il est ? Quel sale coup il nous prépare, le fumier ?
1984. A force d’avoir lu Orwell dans nos lycées, on en avait presque peur, de cette année là. Qu’il nous tombe encore une calamité sur le coin de la gueule qu’on avait déjà pas mal cassée. Bon sang, qu’on se disait, où peut-il bien se cacher, le Big Brother ? Hein ? Où il est ? Quel sale coup il nous prépare, le fumier ?
On ne savait pas encore qu’il était en train de se mettre partout en place, doucement et sans effet d’annonce, sans bruit de bottes ni cliquetis de culasses automatiques. Matois. Sûr de lui au chevet de l’endormissement humain.
1984 bis. Pour nous, c’était surtout le retour de l’ennui après les joyeuses effervescences des années soixante-dix. On avait eu beau courir vite et à travers la montagne, on avait eu beau semer sur notre fuite Rimbaud, Vaneigem, Lautréamont et autres élixirs empoisonnés pour que le vieux monde en nous pistant en crève, il nous avait une nouvelle fois rattrapés par la peau du cul et on s’était arrêté sur le bord de la route, le cheveu encore long, l’œil encore un peu rêveur, mais essoufflé quand même, l’espoir en berne.
La social-démocratie au ventre replet battait son plein, pétait dans la soie et rotait du bourgogne grand cru. Les plus cons d’entre nous rosissaient de plus en plus et entraient un peu partout à reculons. C’est comme ça, le drapeau blanc des renoncements : la marche arrière. A votre bon cœur, tapez où bon vous semble !
1984 ter. Maurois I est mort. Lui a succédé Maurois II, par la volonté de Mitterrand Ier au faîte de sa gloire mais dans une France qui patauge dans la crise, le chômage, la politique de rigueur, bref, tout le merdier habituel depuis que les hommes ont choisi la dictature de la marchandise sur toute autre manifestation terrestre.
Les derniers Apaches se radicalisent, prennent le maquis... Quand le désespoir de construire n’a plus que le choix des armes pour détruire.
Nous, on leur fait un signe de la main, on leur souhaite bonne chance quand même, on les aime mais on ne les suit pas de ce côté-ci de la défaite.
Et on se retrouve dans des cafés à nous. Tu pouvais boire un coup à Amsterdam avec un gars comme toi que tu croisais par hasard, la main sur l’épaule, et le retrouver huit jours plus tard au Marsella, à Barcelone, devant une absinthe, toujours par hasard. Ça voulait dire que notre territoire était de plus en plus balisé et nos chemins de plus en plus étroits.
On s’en foutait des boniments de la crise. Je ne les répète même pas là, ces boniments. Vous les connaissez par cœur, parce que ce sont exactement les mêmes qu’aujourd’hui. Suffit juste d’ouvrir un journal ou une télé, si vous en avez une. Moi, j’en ai pas, de télé.
Les chroniqueurs politiques ont ça de génial quand même : Intemporels. Quantiques presque.
Un monde en crise, pour nous, c’est comme quand les loups se dévorent entre eux. On ne va pas les séparer, hein, risquer un coup de dents, donner notre avis, ramener le calme et négocier. Non, on reste sur notre cul et on attend - espoir bien vain - qu’ils s’égorgent jusqu’au dernier.
Nous, on se distille jusqu’au dernier. On n’arrête pas de vider des bouteilles et on fume des fumées qui devraient nous redonner de l’espoir, élargir notre champ de vision et réaiguiser notre sens critique. Mais finalement on s’endort un peu plus. Trop fatigués. Trop chimérique, tout ça…Le coeur n'y est plus.
Alors on se lève un à un dans un bâillement, on se salue, on s’embrasse et on dit qu’on rentre chez nous. Qu’il est tard.
Où ça chez nous ?
On a la trentaine bien sonnée, la tempe déjà un peu grise et on n'a jamais eu de chez nous. Les autres, les renégats, ceux qui ont mis leurs rêves en bandoulière et le pantalon sur les chevilles, ils sont déjà installés aux commandes. Les couilles molles ont tous couche molle.
Bon, ben, chez nous, on va trouver. Au hasard.
C’est comme ça qu’on s’est séparé.
On ne s’est jamais revu. Ou alors quelques-uns et longtemps, longtemps après.
On n'a parlé d’aucun souvenir. Comme si tout ça avait été un ailleurs.
Les vaincus ne parlent jamais de leur guerre perdue entre eux.
2012. Pas de nostalgie. Aucune. Bien au contraire. Un certaine jouissance de l'ironie face à la parole humaine, vide, chafouine, et qui prétend encore dire un monde qui s'est fait indicible.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.03.2012
Se confier ou faire un nœud coulant ?
 Lorsqu'un phraseur, pataugeant hors des limites d'un propos sérieux, se met, par inadvertance ou de plein gré, en tout cas fort impudiquement, en scène, les autres, sagement goguenards, un peu gênés aussi, s'inquiètent et l'invitent gentiment à se taire : Tu ne vas pas nous raconter ta vie ?
Lorsqu'un phraseur, pataugeant hors des limites d'un propos sérieux, se met, par inadvertance ou de plein gré, en tout cas fort impudiquement, en scène, les autres, sagement goguenards, un peu gênés aussi, s'inquiètent et l'invitent gentiment à se taire : Tu ne vas pas nous raconter ta vie ?
Une vie, ça se raconte pourtant par petites bribes au hasard et au moment où l'on veut. À une femme dont on pense que l'on en est épris, à un ami dont on se figure, honteuse vanité s'il en est, avoir gagné l'entière confiance, ou alors à n'importe qui. Si on est fin saoul, si on est devenu fou, si on est un sot ou alors si l'on n'est rien de tout cela mais qu'on est perdu, déchiré par la solitude, la souffrance et le chagrin.
J'ai toujours en mémoire cet exemplaire et pathétique fait divers relaté par les situationnistes. À dire vrai, je ne me souviens que de l'essentiel...
Un jeune homme était en proie à la mélancolie, à la désespérance et au mal de vivre, traînant par les ruelles ses souffrances solitaires. Par une nuit d'errance, dans un bar, pris de boisson, il en vint à confier ses désolations et ses tourments à un homme également solitaire, qui l'écouta et qui lui parla aussi comme jamais personne jusqu'alors ne l'avait fait. Le jeune homme sentit sur son épaule la douceur d'une main fraternelle et dans son âme la chaleur de l'amitié enfin trouvée brilla comme un espoir aperçu au bout de son douloureux tunnel.
Toute la nuit durant, les deux hommes échangèrent.
Et quand l'aube se dessina sur un nouveau jour, une aube qui aurait dû être plus claire et plus rose que tous les matins de sa vie, le jeune homme assassina son confident d'un violent coup de poignard.
S'en voulant retourner à ses ouailles, celui-ci venait en effet de confesser qu'il était prêtre et que d'écouter les échos de la souffrance était de la compétence de son divin office.
À ce stade suprême de la trahison, le geste est exemplaire. Le meurtre est une infamie. Certes. Je n'ai besoin de personne pour le savoir. Mais le mensonge exercé à un tel degré de perversité revêt lui aussi la violence déchirante d'un assassinat. S'il n'eût été connu et compris que de quelques-uns, voilà un geste qui aurait apporté à l'humanité plus d'intelligence et plus de matière à réfléchir que toutes les philosophies et toutes les morales du monde ne lui en ont jusqu'alors suggérées.
Je pense souvent à ce jeune homme - puni de la chaise électrique ou pendu - parce qu'il me plaît de croire qu'affrontant son mal de vivre par l'écriture plutôt que par la confidence orale - toujours hasardeuse et pour lui si malencontreusement choisie - peut-être n'eût-il pas sombré jusqu'à cette extrémité criminelle.
Peut-être. L'écriture qui se respecte n'attend pas d'échos affectifs à ses confidences. Elle se nourrit d'elle-même. Après, quand son message est lu, quand elle prend socialement la parole, l'auteur est déjà ailleurs. Loin parfois. Dans un autre désordre.
Mon désordre à moi, me semble t-il aujourd'hui, a suivi comme une sorte d'ordre logique pour être au bon endroit dans un monde à l'envers.
Image : Philip Seelen
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.03.2012
Misère de l'évidence, évidence de la misère
 Cela faisait des lustres, disons une bonne quinzaine d'années, que je n'avais pas remis véritablement le nez dans un livre des situationnistes.
Cela faisait des lustres, disons une bonne quinzaine d'années, que je n'avais pas remis véritablement le nez dans un livre des situationnistes.
Normal. La théorie situationniste, comme toutes les théories qui combattent le pouvoir sans le rechercher pour elles-mêmes, et qui ont donc plus de liberté et d'intelligence à leur disposition pour être justes, s'est volontairement sabordée, sitôt perdue sa complicité avec la réalité.
Une théorie qui ne se suicide pas quand les conditions faites à la vie ne lui offrent plus la possibilité d'exprimer la joie d'une mise en pratique, ça s'appelle de l'idéologie. Communiste, anarchiste, socialiste, chrétienne, fasciste, libérale et tutti quanti.
Bref, un mensonge, un puissant écran posé entre l'homme et l'homme.
M'étant cependant fait expédier un vieux livre qui, avec d'autres publications situationnistes, avait été depuis longtemps relégué sur des étagères désertées de ma bibliothèque, j'ai re-feuilleté ces derniers jours le "Rapport sur la construction des situations" de Guy Debord.
Nous lisions ça en 1970 et nous avions déjà quelque sept ans de retard.
Et, quarante ans après, sourire jaune et désabusé - pour éviter de sombrer dans le désespoir de l'inutilité permanente - en constatant que depuis ces quelques lignes d'une simplicité déconcertante et d'une évidence farouche, qui que nous soyons, nous n'avons fait que bavarder, balbutier, bégayer, crachoter, papoter, claudiquer, donquichotter, tergiverser, jouir mollement, répéter, ânonner, maquiller, baisser la tête, avancer à reculons, mentir, composer, prétexter et fuir :
« Le principal drame affectif de la vie, après le conflit perpétuel entre le désir et la réalité hostile au désir, semble bien être la sensation de l'écoulement du temps. L'attitude situationniste consiste à miser sur la fuite du temps, contrairement aux procédés esthétiques qui tendaient à la fixation de l'émotion. Le défi situationniste au passage des émotions et du temps serait le pari de gagner toujours sur le changement, en allant toujours plus loin dans le jeu et la multiplication des périodes émouvantes. Il n'est évidemment pas facile pour nous, en ce moment, de faire un tel pari. Cependant, dussions-nous mille fois le perdre, nous n'avons pas le choix d'une autre attitude progressiste. »
Mis en ligne le 8 mars 2010
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.02.2012
Blogomanie
 Quand je fais le tour des blogs et relis mes dernières parutions, je me dis tous les matins que, soit je suis complètement décalé, soit il n’y a là, partout en vérité, que tristes enculages de mouches.
Quand je fais le tour des blogs et relis mes dernières parutions, je me dis tous les matins que, soit je suis complètement décalé, soit il n’y a là, partout en vérité, que tristes enculages de mouches.
J’ai cette affligeante impression que nous vivons sur une planète qui a pris feu, dont la fumée étouffe les esprits, brouille les yeux, fourvoie les hommes vers de fausses sorties de secours et que les gens - dont je suis - écrivant sur leurs écrans de la communication séparée, s’amusent tout simplement à compter les moutons au plafond.
Je ne retrouve rien des questions fondamentales et humaines posées par les urgences de l’époque. Et si ces urgences sont parfois présentes, c’est toujours par des mots dont la résonnance n’arrive plus jusqu’à mes oreilles.
Je ne trouve rien d'enthousiaste, d'envie de vivre à fond, d'envie de renouveau fondamental.
Le monde appartient à de la racaille, économique, intellectuelle et morale. Le fait même de le dire ne fait qu’éclairer encore plus l’impuissance fondamentale de l’onanisme plumitif. Nous sommes des ados qui n’avons même pas su dépasser le cap de l’amusement solitaire et se prennent néanmoins pour des créateurs accomplis.
Ce que je dis là, c’est peut-être un moment, une sensation passagère.
En tout cas, je l’espère.
Mais un blog n’est pas une fiction. Un blog de pure fiction n’est plus que le parent pauvre de la fiction livresque, son substitut bancal faute de mieux, presque l'aveu public d'une frustration. Mais après tout, pourquoi pas ? Il n'y a, hélas, rien de déshonorant à s'exprimer dans la frustration ! Ce qui serait infâmant, ce serait de vouloir donner le change.
Le blog, selon moi, doit avoir prise sur la réalité de son auteur. C’est même là son originalité qualitative et sa dimension la plus humaine.
Il m’était dès lors nécessaire de transmettre ces impressions, fussent-elles fugaces.
Image : Philip Seelen
08:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.02.2012
Une nouvelle
ENTRE CHEVAUX ET BOURRIQUES
( suite et fin)
 [...] Un après-midi de la mi-novembre – et c’est ainsi que nous en arriverons au football - j’avais décidé de venir photographier les chevaux lorsqu’on les libère et qu’ils jaillissent des écuries en troupeaux serrés vers les prairies bordées d’arbres antiques. Une revue francophone éditée à Varsovie m’avait en effet demandé un article sur le célèbre haras et je pensais que quelques photos de ces ruées quotidiennes seraient très indiquées pour illustrer mon propos. Car c’est un beau spectacle, ces hordes de soixante à soixante dix pur-sang qui détalent au galop le long des clôtures, et qui, pour dégourdir leurs muscles impatients, ruent, hennissent, font des pétarades, sautent, cabriolent, se mordent et chahutent en faisant voltiger autour d’eux des mottes de pelouse et des nuages de poussière, avant de se mettre tranquillement à paître, leur surplus d’énergie une fois canalisé.
[...] Un après-midi de la mi-novembre – et c’est ainsi que nous en arriverons au football - j’avais décidé de venir photographier les chevaux lorsqu’on les libère et qu’ils jaillissent des écuries en troupeaux serrés vers les prairies bordées d’arbres antiques. Une revue francophone éditée à Varsovie m’avait en effet demandé un article sur le célèbre haras et je pensais que quelques photos de ces ruées quotidiennes seraient très indiquées pour illustrer mon propos. Car c’est un beau spectacle, ces hordes de soixante à soixante dix pur-sang qui détalent au galop le long des clôtures, et qui, pour dégourdir leurs muscles impatients, ruent, hennissent, font des pétarades, sautent, cabriolent, se mordent et chahutent en faisant voltiger autour d’eux des mottes de pelouse et des nuages de poussière, avant de se mettre tranquillement à paître, leur surplus d’énergie une fois canalisé.
Mais les horaires sont stricts. Les chevaux sont sortis à treize heures pétantes et, poussés par les cris des palefreniers, rentrés à quinze heures pile.
Il faisait déjà froid. Une espèce de crachin bâtard, mêlé de neige et de pluie, hachurait la grisaille des campagnes, quand je pris la route de Białystok, cap sur Janów. Je traversai plusieurs villages aplatis sous le silence désert de ce début d’hiver et, à Zabrowiec, situé à une dizaine de kilomètres du haras, je dus soudain ralentir car tout un alignement de voitures, stationnées n’importe comment sur l’herbe du bas-côté, rétrécissait considérablement la chaussée. Je roulai au pas, craignant qu’il n’y eût là quelque accident de la circulation, et j’aperçus bientôt sur ma droite, à travers la bruine et la buée des vitres, des silhouettes bariolées qui zigzaguaient, allaient et venaient, se couraient les unes derrière les autres, se croisaient, se télescopaient parfois. C’était orange et c’était vert. J’entendis des cris aussi et un puissant coup de sifflet, décliné de toute évidence à l’impératif. Je compris qu’on disputait là, dans le froid et la neige, un match de football. Je rangeai donc tant bien que mal ma voiture parmi les autres, car ces joutes footballistiques inter-villages m’ont toujours beaucoup amusé et je n’avais jamais eu l’occasion d’en voir une en Pologne. Et puis, cela aussi me ramène à mes primes aurores, tout môme, quand mes grands frères étaient de vaillants footballeurs. Je me souviens surtout des dimanches soirs où ils rentraient fourbus, l’échine en compote, les mollets tavelés de bleus ou le genou sanguinolent, quand ce n’était pas les orteils tuméfiés sur lesquels ils montraient, indignés, les stigmates douloureux d’un crampon adverse. Dans une grande bassine d’eau bouillante, ils déposaient des lacets longs de deux mètres au moins, leurs maillots maculés, leurs chaussures crottées et, d’autant qu’il m’en souvienne, pestaient à peu près toujours la même chose : ils avaient perdu à cause d’un arbitre félon, mais gare à la revanche !
A Zabrowiec cependant, les joueurs couraient comme des dératés et des bouffées épaisses de vapeur s’échappaient par saccades de leur bouche entrouverte. On eût dit de petites locomotives énervées. On entendait aussi le souffle court de leur respiration et le contact brutal de leurs crampons avec la pelouse gelée. Parfois même avec le tibia d’un gars, qui aussitôt se roulait par terre comme un grand blessé mortellement atteint et en poussant un hurlement de douleur, immanquablement suivi des protestations vindicatives des spectateurs emmitouflés dans de lourdes pelisses, cigarette au bec, et qui tapaient du pied et qui gueulaient sans cesse, exhortant ou gourmandant, ceux-ci les verts, ceux-là les orange.
Je ne m’attendais certes pas à un match de légende ! Mais tout de même à quelques belles phases de jeu, à une ou deux passes astucieuses et à un ou deux tirs au but qui auraient fait mouche ou qu’un gardien aurait bloqués d’une savante roulade. Je patientai longtemps et plus je patientais plus je sentais vaguement qu’il y avait quelque chose d’insolite dans la façon dont se déroulait cette partie. Je jetai un coup d’œil alentour et pris soudain conscience que tout le monde ici, les joueurs, les arbitres, les spectateurs et moi-même avions le plus souvent la tête levée vers les nuages et les intempéries ! Je ne pus dès lors retenir un grand éclat de rire, qui fit à mon plus proche voisin faire une moue interloquée.
Le clou du spectacle était pourtant bien là : dans tous ces gens qui regardaient en l’air, comme s’ils bayaient aux corneilles, qui frétillaient du chef, en avant, en arrière, à gauche, à droite, comme des pantins, et qui allongeaient le cou, le cabraient, le rentraient et le faisaient pivoter d’un côté sur l’autre, le tout dans un ensemble parfaitement synchronisé. On eût juré qu’ils suivaient des yeux, là-haut dans l’averse grise, un objet volant qui aurait fait des loopings et des acrobaties en risquant de leur tomber à tout moment sur le coin de la figure, et tout ça parce que, en bas, aucun des valeureux gladiateurs, qu’il arbore tunique verte ou tunique orange, ne réussissait jamais à garder la balle au pied !
Elle s’obstinait donc à voltiger en l’air, la bougresse, et, telle une baudruche gonflée à l’hydrogène, semblait refuser avec acharnement les lois de la pesanteur. Dès qu’elle avait quelques velléités de toucher le sol, on frappait dedans à la sauve-qui peut, comme pour s’en débarrasser au plus vite, et elle s’envolait à nouveau dans les airs, elle tournoyait, elle voltigeait, elle toupillait, elle s’élevait très haut et elle retombait bientôt sur la tête d’un gars, voire sur son échine, lequel gars, presque effrayé de la voir déjà là, la réexpédiait aussitôt dans les airs, parfois d’une ruade absolument grotesque et ainsi de suite... De toute évidence, on rivalisait ici d’ingéniosité à qui ferait la chandelle la plus lumineuse ! J’observai ce manège cinq minutes encore et m’esclaffai derechef. Cette fois-ci, mon voisin se tourna carrément vers moi et prit également le parti d’en rire :
- Barany !
Littéralement des moutons ! Mais, traduit au plus près de la sémantique, des bourriques ! C’était bien sûr un peu sévère. J’opinai néanmoins d’un mince sourire et décidai sur-le-champ de reprendre ma route vers Janów et ses chevaux.
C’est alors que survint l’impensable.
Trois violents coups de sifflet retentirent, comme je marchai déjà vers la sortie, la tête rentrée dans le col relevé de ma veste pour éviter les morsures du froid crachin et du vent. Sans doute la mi-temps ou la fin de cette partie mi-football, mi volley-ball, mi badminton au pied, mi-je ne sais trop quoi, pensai-je.
Je me retournai.
Stupéfaction. L’homme en noir, un énorme et grand gaillard porteur d’une moustache broussailleuse que ne lui aurait assurément pas désavouée Nietzsche, faisait aligner tous les joueurs en rang d’oignons, les verts d’un côté, les orange de l’autre et, assisté de ces deux arbitres de touche, les… comptait ! Il y eut alors de vives clameurs, des huées, des bras levés, des crachats expédiés au sol. Des spectateurs accoururent, aussitôt chassés par tout ce qui portait maillot, on se bouscula, on se prit par le colbach et, un brin voyeur, je revins sur mes pas, certain qu’on allait cette fois-ci en venir aux mains.
Le sifflet rageur émit à nouveau une très longue injonction, stridente à vous briser les tympans. Le colosse fortement moustachu, en sautillant sur de gros et glabres mollets tout en reculant pour, sans doute, se bien démarquer de la cohue verte et orange et être ainsi vu et compris de tous sans ambages, montrait de son bras tendu les vestiaires et les bancs de touche à tout le monde.
On quittait maintenant le terrain, certains la tête basse, les orange, suivis des verts, la tête haute et le poing levé sur leur dos. On eût vraiment dit des vaincus pousser par leurs vainqueurs sous les fourches caudines. Les spectateurs, eux, regagnaient leurs voitures en fulminant et en gesticulant. Je m’enquis alors de quoi il en retournait exactement auprès de l’un d’entre eux, un petit pépé qui semblait un peu plus calme que les autres et qui hochait simplement la tête en signe de déconvenue. J’appris alors que l’équipe locale, ces sournois, évoluaient à douze depuis le début et que le match était annulé !
Notant que le robuste moustachu avait quand même mis plus d’une heure pour découvrir la supercherie, j’allais rigoler comme un sot quand le pépé sympa me précisa, avec le sourire, que ça n’était là qu’un match amical, hors championnat, pour l’entraînement quoi…Alors...
Alors je ravalai mon rire car, avec cette manie que j’ai de vouloir toujours tout interpréter à la lettre, jusqu’à l’extrapolation, me vinrent soudain de bien tristes pensées. C’était ce amical, et la façon dont l’avait prononcé le pépé, qui me turlupinait. Ainsi, ce qui était amical, ce qui était gratuit, ce qui n’était que jeu sans enjeu, pouvait être tronqué sans vergogne et, le cas échéant, être jugé avec indulgence. A désespérer des hommes. A désespérer que, dans des situations bien plus conséquentes que celle à laquelle je venais d’assister, sans épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, ils ne se conduisent autrement qu’en fourbes.
Je m’empressai de déguerpir.
Il neigeait vraiment à présent, sans pluie, et la route était déjà blanche. Le vent soufflait plus fort et les arbres noirs des talus s’agitaient sous des nuées de flocons épais, obliques et serrés. Je roulai donc très doucement et arrivai bientôt aux portes du haras…
Fermé !
Il était quinze heures passés de quelques minutes ! J’hasardai un œil à travers les lourdes grilles. Les prairies ensevelies sous la neige étaient silencieuses et désertes et, de chaque côté des allées, les belles écuries blanches et vertes, posées sur toute cette froide immobilité, étaient verrouillées à double tour.
Je me traitai de triple idiot et restai planté là tout un moment, les bras ballants, mon appareil photo de reporter à la ramasse dans les mains, désappointé, sous la neige qui me picotait le visage et devant l’inutilité complète de ce dimanche après-midi !
Tristes et froides, rampaient déjà les premières ombres de la nuit.
09:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.02.2012
Une nouvelle
Il n’y a que les imbéciles qui n’écrivent que des mauvais textes, pour se croire infaillibles et s’offusquer de ce qu’on leur en fasse la critique. Des gens qui n'existent que lorsque dégoulinent les compliments. Peu importe, dès lors, que ceux-ci soient sincères ou pas.
Le texte que je publie là, donc, s’est vu refusé par un éditeur que je connais bien et avec lequel j’entretiens d’amicales relations, Antidata, sans que la qualité de son écriture soit mise en cause. Ils ont jugé que je traînais trop et que j’étais un peu hors sujet, le récit étant destiné à être intégré dans un ouvrage collectif dont le thème était «Le football ».
Bon, tant pis... Ça ne fait pas forcément plaisir, mais écrire c’est aussi casser beaucoup d’œufs pour faire bien peu d’omelettes et cela n’altère en rien ma collaboration avec Antidata. Olivier Salaun, qui préside aux destinées de cette maison d’édition, m’écrivait avec juste raison, je crois : «en te lisant, j'ai eu l'impression que ce thème-là n'était pas pour toi, comme les précédents, une source d'histoire et d'émotion très exploitable. »
Je vous offre donc ce petit texte, que j'ai fragmenté en deux épisodes, et je m’en retourne à la rédaction d’un autre manuscrit, entamé, lui, il y a quelques semaines à peine. Forcément plus dans mes cordes, puisque j’en ai choisi le thème.
Ce qui, hélas, ne signifie pas qu'il sera bon.
Mais, auparavant, sur un tout autre sujet et avant de vous laisser à votre lecture, je ne puis résister au plaisir de vous inviter à rire ici, même jaune, car le fond du problème y est énoncé sans ambages, et ici, le texte très bien documenté d'Yves Letort, suivi de la magistrale démonstration de Grégory Haleux quant aux qualités de traducteur de ce foutu François Bon.
Dans cette misérable affaire, le scandale de la voracité n'est donc pas forcément du côté qu'on voudrait bien nous le faire croire. Il n'y a que les disciples de la fausse conscience qui, comme d'habitude, s'effarouchent dès que le maître à agiter sa clochette : Effarouchez-vous !
ENTRE CHEVAUX ET BOURRIQUES

La bourgade, qui compte aujourd’hui un peu plus deux mille âmes, fut autrefois une ville, une ville florissante même, si l‘on en croit le torse légèrement bombé de quelques historiens locaux. C’est sans doute vrai puisqu’elle qu’elle fut donc un évêché, en témoigne, outre son nom, l’église dressée sur la place dite centrale et qui est, en fait, une cathédrale.
Mais il faut que ce soit le dit. Parce que de prime abord pas grand-chose, ni dans son architecture ni dans ses dimensions, ne la distingue d’une église paroissiale ordinaire. Cette mémoire-là est donc essentiellement catholique. Si vous arrivez ici en visiteur et si on commence par vous faire l’éloge de La ville de Jean, celui qui fut évêque et qui dota la ville d’une cathédrale, c’est bon, vous êtes en présence d’un pour qui l’histoire, c’est d’abord l’histoire de l’Église. Ce qui n’est pas faux du tout du tout et ce qui vaut, d’ailleurs, pour à peu près l’histoire de l’Europe toute entière.
Un autre cependant, tourné vers un passé plus récent ou animé de dispositions un tantinet plus laïques, vous parlera d’abord de la première constitution née en Europe et inspirée des idées révolutionnaires françaises. Mal gré qu’il en ait, il ne pourra cependant pas contourner Rome : Adam Naruszewicz en effet, philosophe, poète, historien, qui fit – c’est important de le souligner puisque vous êtes un visiteur français - ses études chez les jésuites de Lyon, était un évêque et participa, ici même, oui monsieur, ici à Janów Podlaski, à la rédaction de la constitution du 3 mai 1791, tellement importante dans l’esprit du peuple polonais que ce 3 mai est aujourd’hui notre 14 juillet à nous.
Votre hôte, ou votre guide, vous conduira alors, c’est quasiment certain, par un sentier de sable musardant sous de vénérables tilleuls plusieurs fois séculaires, devant un petit monument de pierres en forme de dôme, plus grand mais malgré tout comparable à ceux qu’on voit encore, quoique de plus en plus rarement, le long des vieilles routes de France, et qui jadis servaient d’abris aux cantonniers. Adam Naruszewicz avait fait bâtir là cette minuscule retraite pour venir y méditer, écrire et réfléchir aux malheurs de sa patrie asphyxiée, la gorge prise entre les serres du tsar de toutes les Russies.
Janów était alors russe, vous renseignera votre guide, en montrant d’un geste vague la Biélorussie, de l’autre côté de la vallée du Bug, au-dessus de laquelle vous verrez sans doute tournoyer avec élégance quelques vanneaux huppés ou, avec un peu plus de chance, un aigle pomarin.
Mais peut-être tout ceci vous ennuiera-t-il un peu, alors peut-être réprimerez-vous, par pure courtoisie, un petit bâillement. Car vous êtes venu jusque là, non pas pour marcher sur les pas d’une ancienne célébrité de Janów, mais pour rencontrer sa célébrité présente. C’est votre amour pour les chevaux de race, les pur-sang arabes aux galbes princiers, au port altier à nul autre comparable, qui vous a conduit ici.
Des chevaux ? Mais qu’est-ce à dire encore ? Que viennent faire ici des chevaux ? Ne sommes-nous pas dans un récit censé se dérouler peu ou prou autour du football ? Peut-être l’auteur a-t-il mangé la consigne, comme on dit, et s’est-il emmêlé les crayons dans une partie de polo ?
Non point. Minute, minute, aimable et bouillant lecteur ! Nous y viendrons en temps voulu, au football. Pour l’heure, le visiteur de Janów se dirige par une fière allée bien ombragée, vers le haras le plus coté de Pologne et peut-être même d’Europe. Il aperçoit déjà, à travers le feuillage épais des buissons, un peu à l’écart de la bourgade en descendant vers la rivière-frontière, l’alignement des écuries blanches et vertes, les enclos et les prés où caracolent de superbes chevaux, l’encolure hautaine, la queue relevée en arc de cercle et d’un trot si léger qu’on dirait que leurs sabots ne touchent pas terre.
Oui, Janów est connu dans toute la Pologne, et bien au-delà, pour ce haras et c’est là qu’affluent, chaque année au mois d’août, les éleveurs et les amateurs les plus fortunés du monde, pour deux journées d’enchères, aux montants vraiment astronomiques. Le Président de la République en personne honore souvent la manifestation de son auguste présence et si Janów et sa cathédrale vous ont un peu agacé, trop tournés vers l’histoire religieuse à votre goût, vous apprendrez de la bouche de votre accompagnateur que le haras a lui aussi son pape, mais du rock and roll celui-là, en la personne de Charlie Watts. Chaque année, le célébrissime batteur vient en effet ici pour y acquérir, parmi les spécimens les plus élégants et les plus recherchés, quelques pur-sang arabes.
Je soupçonne même certains visiteurs de se rendre à ces journées d'enchères non pas pour les chevaux, aussi magnifiques fussent-ils, mais en nourrissant l’espoir d'apercevoir - ne serait-ce que de loin et très brièvement - dans la foule des connaisseurs ou sur les gradins réservés VIP du manège où toutes ces splendeurs chevalines sont présentées, la crinière blanchie sous le harnais du Rolling Stone, véritable icône des années soixante-dix.
Personnellement, je ne suis jamais allé à cette grande kermesse annuelle du haras de Janów. Charlie Watts, je le vois tous les ans en photo sur les catalogues édités immédiatement après la vente aux enchères, dans le journal local, sur le site internet du haras, et, toute l’année s’il m’en prenait fantaisie, je pourrais le contempler à mon aise sur les murs du restaurant où il a dîné, comme dans les couloirs de l’hôtel où il a dormi… Il caresse toujours les naseaux d’un splendide étalon ou il flatte une croupe. Et il sourit. Les légendes sourient toujours quand elles sont occupées à leur entretien.
Je ne vais donc pas à la kermesse, parce que je n’aime ni l’anonymat tapageur des foules, ni les lieux de rendez-vous des grosses fortunes, ni les étoiles quand elles brillent ailleurs qu’aux firmaments… En revanche, j’aime les chevaux. Non pas que je sache les monter ou conduire un attelage, non plus que je sois un enthousiaste des courses ou des prouesses techniques des concours hippiques, encore moins un amateur de polo ! Non, rien de tout cela. Je les aime de loin, les chevaux, quand ils ne servent à rien, sinon à brouter un morceau de paysage. Par pur esthétisme. J’aime la puissance gracieuse de leurs mouvements, j’aime l’orgueil de leur maintien, surtout là, à Janów, où naissent et grandissent les plus raffinés d’entre eux. J’aime ce qui peut surgir d’impétuosité quand ils s’élancent au grand galop et j’aime aussi leur odeur, sauvage, l’odeur du foin, de la paille, du crottin, de la sueur animale. L’odeur des râteliers aussi, qui me ramènent très loin, vers les fermes poitevines de mon enfance, aux premiers matins du voyage…
Et c’est surtout l’hiver, saison où les paysages ne sont revêtus que de l’essentiel, que je viens rêvasser ici, parmi les chevaux, les allées, les prairies et les écuries d’une irréprochable tenue. Ce haras, en outre, est lié - même si c’est de façon peu glorieuse - à l’histoire de mon pays. La construction en fut en effet ordonnée par le tsar en 1817 car, après les invasions successives du conquérant au célèbre bicorne, l’est de l’Europe n’avait pratiquement plus un seul canasson debout. Et une région sans canasson, à cette époque-là, c’était une région ouverte, à découvert, sans défense, à la merci de la moindre agression.
A ce propos d’ailleurs, je suis assez perplexe devant les détours inopinés qu’emprunte parfois l’histoire : on voulait ici remonter une armée, s’occuper de défense nationale, et on en est venu à faire œuvres d’art, à soigner, bichonner, sélectionner, améliorer la silhouette et l’allure, jusqu’à la perfection, d’animaux qu’on destinait d’abord à être réduits en charpies sanguinolentes sous les coups de sabres et le feu nourri des canons.
La suite demain...
10:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.02.2012
Mes deux textes chez Publie.net
En téléchargement gratuit
Lecteurs de L’Exil des mots, je vous offre avec plaisir de télécharger gratuitement en fichiers PDF, les deux textes : Chez Bonclou et autres Toponymes, ainsi que Polska B dzisiaj, respectivement publiés par Publie.net en mars 2008 et octobre 2009 pour la vente desquels François Bon refuse de procéder au versement des droits d'auteur.
Je précise que cette initiative n'avait, au départ, aucun lien avec les démêlés de Bon et Gallimard, ni surtout avec la foule des commentaires et articles de vierges effarouchées qui s'en est suivie. Mon initiative date de vendredi, elle avait été mise en ligne dès vendredi, et, comme le savent mes lecteurs depuis maintenant quatre ans, je suis absent du net et présent sur terre, tous les week-end.
J'ai ce matin lu quelques commentaires, dont ceux de la foule des moutons de Panurge à propos de cette affaire... Je me marre bien : l'indicible Bon, qui n'honore ni sa parole ni les termes de ses contrats - avec la lâche complicité de ses auteurs et de ses abonnés - et dont l'inavouable but est de monter "une grosse boîte" à la hauteur de sa mégalomanie, se voit mis en demeure par plus malin et plus vorace que lui. Il faut savoir que Bon est distribué par Amazon pour savoir à quel "militant de la littérature autrement" on a à faire.
Dans tous ces postillons amphigouriques, pas grand monde, si ce n'est ici, pour oser parler en vérité : c'est là le combat de deux commerçants, dont un assume avec brio son essence de commerçant et l'autre la dissimule misérablement !
Qu'ils aillent se faire foutre et je suis fier, quant à moi, dans mon petit coin, d'avoir été un précurseur dans la dénonciation publique - voir ci-contre la catégorie "Publie.net, une étrange coopérative - de ce qu'il convient d'appeler "un mensonge permanent." Peut-être même une escroquerie.
Vous me direz, oui, mais quel rapport avec ce conflit sur une traduction ? Je questionnerais alors : Nous tient-on pour aussi cons que ça pour essayer de nous faire avaler que Bon n'était pas au courant de la législation en vigueur sur les droits d'auteur d'un texte aussi célèbre que "Le vieil homme et la mer" ?
Mais il est vrai qu'il a déjà déclaré : "Les droits d'auteur sont obsolètes".
Dans la bouche d'un éditeur, même virtuel, ça fait assez félon quand même. Genre qui annonce" si les faits disent le contraire de ce que je dis, modifions les faits".
Le rapport est donc dans la tromperie.Toujours la tromperie...
Un dernier point. Bon annonce qu'il a foutu cent cinquante six livres, collection de luxe La Pléiade, à la benne à ordures...Quel geste magnanime ! Le geste d'un fou, oui. D'un goret au groin désabusé. Que ne les a-t-il offerts, ces beaux livres, à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des Pléiade ? Que ne les a-t-il offerts à une bibliothèque de quartier, lui le "coopérateur ", l'homme de gôche ?
Il n'y a pas pensé ?
Moi, je n'ai pas détruit mes fichiers, suite à mon conflit avec lui : je vous les offre !
Cliquez donc sur les couvertures, en marge gauche.
Et bonne lecture à tous !


12:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.02.2012
Le grand mouvement des choses

Je vis sur une boule bleue qui tourne autour d’une boule rouge ou jaune, suivant des saisons qui tournent en rond… Et quand je regarde le ciel sur la plaine, il plonge en arc de cercle sur cette plaine, laquelle courbe elle-même l’échine, fait le dos rond, là-bas sur les derniers brouillards de l’horizon.
L’horizon. Terme ambigu. Incertain. En même temps terme d’espoir et terme de chute. Mirage trompeur de la ligne droite. Point de mire du marcheur fatigué. Infranchissable. Sans cesse reculé. Dansant, tel le mirage des sables.
C’est ainsi que les bâtisseurs d’horizons ne vont jamais au bout de leurs rêves.
L’horizon. Ligne circulaire, variable en chaque lieu, dont l'observateur est le centre et où le ciel et la terre semblent se joindre. Oui. C’est Le Littré qui le dit.
Et je vois le Littré partout au bout de mon chemin. L’horizon est donc circulaire et les lignes horizontales ne sont jamais droites puisque par définition astronomique, elles sont des parallèles à cet horizon.
Je marche vers l’horizon. A la verticale, que je marche. Perpendiculaire à une courbe.
Comment dès lors marcherais-je droit vers un point que je redoute pour être « final» ?
Tout a la rondeur des espaces qui commencent et finissent en même temps, sans qu’il n’y ait de trajectoire linéaire.
Quand je regardais l’océan, là-bas d'où je suis venu, il était aussi comme une sorte de sphère liquide et tremblotante et dont je n’apercevais qu’un pôle qui miroitait sous la lumière d’une grosse étoile ronde.
Si j’imagine l’univers dont une des théories le décrit encore en expansion, j’imagine une sphère incommensurable et chaude qui gonfle encore sous l’impulsion d’une force titanesque qui lui viendrait du centre.
Les limites où se meurt le rationnel et où trébuche l’imagination même la plus audacieuse, c’est la définition, l’existence même du vide sur lequel se répandrait cet univers en mouvement circulaire, projeté à l’infini.
Car pour qu’un corps se distende et prenne de l’ampleur, il lui faut forcément rencontrer du vide. Et le vide, le néant, par définition, ça n’existe pas. Prétendre à une existence du néant, c’est implicitement et absolument poser le postulat de sa négation.
Je vis, nous vivons, dans cette rondeur chaotique. Nos états d’âme, nos pulsions, en sont forcément déterminés pour une part.
Et du hasard d’une naissance à la dernière pelletée du fossoyeur, ce que nous appelons la fuite du temps - et qui n’est que l’éphémère de notre marche vers l’horizon intangible - me semble donc un cercle imparfait, musardant du point zéro au point zéro. D'un hasard à l'autre. Avec entre les deux la vanité pensante.
La vision commune de cette fuite du temps est une trajectoire. Le temps rationnel, vécu comme corps unique à sens unique. C’est la vision bourgeoise du temps. Une vision métaphysique du mouvement.
Si tel en était, pour nous souvenir, il faudrait nous retourner. Nous ne nous retournons pas. Nous nous voyons en un point donné du cercle imparfait. Là où nous sommes déjà passés et où nous avons déposé comme gages de notre venue, des rêves d’enfant, des larmes, des amours, des visions fulgurantes de la mort.
Seuls les gens qui pensent leur vie comme une ligne droite à parcourir pensent qu’on patauge quand on est dans la nostalgie. Nostalgie. Se souvenir avec douleur. Sur une boucle, on a une vision d’ensemble. On se voit partout à la fois. Le présent regarde le passé sans nier sa qualité de présent irrémédiablement entrainé dans une chute vers le futur.
En cheminant notre bonhomme de vie, nous nous croisons en fait. En même temps ici, ailleurs et déjà là-bas.
Aimer sa vie, c’est être quantique. Multiple. Et comme son propre horizon, impalpable.
Le grand mouvement des choses.
J’aime alors les saisons, leur retour et leur fuite. L’éternel retour des mêmes gestes de la terre dans sa complicité avec le reste du monde et, en un zoom intime, secret, sa complicité avec ma peau et mon désir de vivre.
Particule de ce bal où tournoie la valse enchevêtrée des choses, je ne suis rien sans l’exode des oiseaux vers le nord, puis vers le sud, puis vers le nord encore. Rien sans la nuit qui engloutit le jour et ce jour à son tour qui dévore la nuit. Qui l’épluche d’est en ouest. Rien sans mon affection pour les paysages peints, modelés, parfumés par une latitude et un climat. Par un mouvement.
La pendule universelle.
Jusqu’à l’horizon courbé, toujours défaillant. Jamais vaincu.
07:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.02.2012
Passager clandestin
 « … Je l'ai souvent descendue, cette rue des Pyrénées, très belle car très commerçante, je me suis souvent arrêté à la brasserie place Gambetta face à la mairie du XXème, et je me suis souvent promené dans les allées du Père Lachaise où j'ai aussi beaucoup lu puisque j'habitais non loin de là. »
« … Je l'ai souvent descendue, cette rue des Pyrénées, très belle car très commerçante, je me suis souvent arrêté à la brasserie place Gambetta face à la mairie du XXème, et je me suis souvent promené dans les allées du Père Lachaise où j'ai aussi beaucoup lu puisque j'habitais non loin de là. »
Cette petite phrase est de l’ami Solko, en réponse à un commentaire que j’avais laissé chez lui. Si je la reprends ce matin et si même je me propose d’y consacrer un petit texte, c’est qu’elle m’a évoqué une anecdote plaisamment restée gravée dans ma mémoire et qui m’advint, il y a de cela trente ans environ. Sans cette petite phrase, elle n’aurait sans doute jamais donné naissance à un texte, mais l’envie de raconter par l’écriture vient toujours - ou du moins très souvent - d’une image inopinément remontée à la surface du temps.
J’habitais donc en Charente-Maritime, aux lisières du Marais poitevin, à deux pas du paisible canal du Mignon. Je me rendais souvent à Paris, en stop ou en train. Là, c’était en voiture. Une Ami 6 déjà vieille, exactement. J’étais parti vers le milieu d’un après-midi d’automne, pour visiter des amis et aussi pour me rendre à un rendez-vous pris avec un éditeur, excellent éditeur au demeurant, disparu aujourd’hui, Plasma, et qui avait pignon sur une rue qui n’existait pratiquement plus, pour cause de «trou des halles.»
Allez, je digresse un peu, là : cet éditeur était intéressé par un manuscrit que je lui avais laissé, «Echecs». Un roman qui avait pour cadre le Marais poitevin, qui n’a jamais été publié mais, quand même, qui a beaucoup, beaucoup circulé entre Paris et Toulouse et qui a franchi les Pyrénées, traduit par un camarade espagnol. Une petite carrière sous le manteau, quoi ! Un roman violent, d’inspiration anar. C'est que j’y croyais encore, à l’époque, aux lendemains sans dieu ni maître !
Las ! Las ! C’est un chanteur, d’inspiration anar justement, qui me coupa l’herbe sous le pied chez "Plasma". Ils étaient à deux doigts de prendre mon fichu manuscrit, quand ils eurent soudain l’opportunité de publier les œuvres complètes de Léo Ferré ! Un gros livre noir. Alors, entre un illustre inconnu et un illustre connu, le choix a été vite fait et mézigue s’est retrouvé Gros Jean comme devant ! Fin de la digression.
Intéressant, non ?
Mais revenons vite à mon voyage à Paris, parce que Solko doit bien se demander ce qu’il vient faire là-dedans.
Aux environs de Poitiers, je prends donc à mon modeste bord un auto-stoppeur. Dans mes âges, à peu près. Un jeune homme donc. Un homme jeune plutôt. Il avait de longs, de très longs cheveux, très beaux et très blonds, une tête sympa comme tout.
Paris ? Oui, Paris…Ça roule… Et nous voilà partis ensemble, discutant de choses et d’autres, disant beaucoup de bien de la vie et beaucoup de mal de Giscard D’Estaing. Peut être de Mitterrand.
A Orléans, je prenais toujours la Nationale 20. Je la suivis sur une cinquantaine de kilomètres avant d'aviser une sorte de restaurant-auberge-bistrot, genre «Routiers», complètement isolé sur la plaine et sur cette ligne droite indéfinissable, noyée d’un soleil déjà oblique… Là, nous sirotâmes un demi. Deux peut-être. Plus sûrement trois. Mon compagnon réclama alors un sandwich au pâté de campagne…
Bien. Et voilà que, là, debout devant le bar, il se met à émettre des petits bisous, comme quand on appelle son chat, et qu’il trifouille délicatement, en retournant légèrement la tête, sous sa longue chevelure, dans la région du cou. J’étais intrigué, bien sûr… On l’eût été à moins. Le gars fourrait des morceaux de pain graissés de pâté sous ses longs cheveux et retirait sa main… vide ! Il continuait ses petits bisous, je m’approchai du cou et vis alors un énorme rat, avec un museau pas possible et des moustaches affreuses, qui grignotait là, peinard.
Je reculai vivement. Les rats et les serpents, c’est ma phobie. Le gars aussitôt éclata de rire et se joua de mes peurs. Il m’expliqua que c’était son compagnon, son ami, et qu’il dormait toujours là, au chaud sur son cou. Il me dit son nom, je ne m’en souviens plus, je n’écoutais plus : je venais de faire trois cents kilomètres avec un gros rat dans ma voiture ! J’étais un peu estomaqué.
Nous reprîmes néanmoins la route. Je n’avais désormais plus d’œil que pour le cou de mon compagnon où sommeillait la bestiole. Lui, il continuait à discuter, à babiller, toujours sympa.
Nous rentrâmes par la Porte des Lilas. Je rentrais toujours par là, parfois à Bagnolet, car j’allais en haut de la rue des Pyrénées. La nuit tombait sur la ville. Je proposai à mon passager de le laisser place Gambetta. Il dit OK, mais je vous offre un coup. Le genre d’invitation que je n’avais jamais appris à refuser.
Et c’est dans une brasserie où j’avais l’habitude d’aller chaque fois que j’étais à Paris, en face de la mairie du XXème arrondissement, tout près du père Lachaise, que nous choquèrent à nouveau nos verres, installés à une petite table.
Il commanda aussitôt un croque-monsieur et se mit en devoir de faire dîner discrètement son copain.
Nous nous quittâmes.
Je me souviens ne pas avoir souhaité le bonsoir au rat.
Et je m’amuse aujourd’hui à imaginer que, peut-être, Solko était à côté et n’a jamais soupçonné la présence d’un Gaspard, tout près de lui, à la table d'un voisin fort chevelu.
13:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.02.2012
Vers et pages réflexes

Bizarrement, j’en conviens.
Un amical salut et grand merci, donc, à Jean-Jacques qui, depuis plus un an, donne sa voix et son jeu d’artiste à Zozo, le fait individu de chair, le transmet.
Sur un tout autre sujet - quoique - ce matin j’évoquais in petto ces vers classiques acquis sur les bancs de l’école pour certains, retenus plus tard pour d’autres, qui me collent à la peau et qui, de façon récurrente, reviennent tournoyer dans ma tête, devant les mêmes paysages ou dans les mêmes situations.
En traversant les champs, aplatis, blancs, muets, inertes, sans le moindre mouvement de vie, ni sauvage ni humaine, des champs qui se déroulent jusqu’à ce que le ciel enneigé les rejoigne en leur tombant dessus, toujours me revient :
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Sans doute parce que j’ai envie de dire ces champs, cette solitude résignée, cette plaine enfouie sous les endormissements de l’hiver, de les dire au plus près, et que, après ce vers, il n’y a dans ma tête pas d’autres évocations plus sensibles, plus proches du réel imagé, plus proches de l’imaginaire des mots. Alors, parfois, c’est vrai, mieux vaut marcher sur les pas de ceux qui nous ont précédés, emprunter leurs musiques plutôt que de tenter de reformuler le monde.
Il y a aussi les soirs, assez souvent, où je regarde le ciel qui s’enfuit déjà devant la nuit. Quand la lumière diffuse un discret mélange d’orange et de bleu, comme une aquarelle indécise, et où, juste au-dessus du toit de mon voisin, un premier clin d’œil aussi ténu que le reflet d'une tête d’aiguille, réclame l’obscurité :
Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
Dont le front sort brillant des voiles du couchant,
De ton palais d'azur, au sein du firmament,
Que regardes-tu dans la plaine?
Là encore, les mots mettent parfaitement en musique la sensation. De façon presque non perfectible. Je ne m’explique - si tant est qu'il faille expliquer - ça que comme ça.
Il m’est arrivé, plus rarement il est vrai, d’avoir à me rendre dans une maison de retraite. Pour quelle que raison que ce soit, en France ou en Pologne. En France, c’est chaque fois que je vais saluer ma vieille mère, à Lusignan. Ma vieille mère, quatre- vingt onze ans au printemps, la tête encore pleine de souvenirs cohérents, des petits et des grands, le cheveu bien peigné, l’habit soigné, le verbe toujours un peu rebelle. Elle me prend par le bras et elle fanfaronne devant ses voisines : C'est mon fils de Pologne ! ... De... ? De Pologne ! Ah oui ? De Sologne ? Parce que j'vous l'dis !
La Pologne, c'est pas un pays. C'est un mot qui veut dire "loin". "Ailleurs". Pour ma mère, j'ai toujours vécu dans d'incompréhensibles "ailleurs".
En ces lieux-là, donc, plus de paysages, plus de lune, plus de neige et plus d’étoiles. Que de la peur et du désarroi. Dans les longs corridors - dont on sait trop bien où ils mènent - ces vieillards immobiles sur des fauteuils improbables, ces lèvres qui tremblent, qui bavent parfois une goutte en suspens, qui semblent marmonner des mots qui ne viennent plus du cerveau, et ces yeux qui ne voient plus d’horizons que le blanc du mur blanc ; qui semblent s’étonner, interroger, s’inquiéter du moindre mouvement, comme déjà résolus à la simplicité immobile et absolue, et ces mains bleuies, décharnées, posées sur des genoux cagneux, ces jambes douloureuses repliées sous le siège, ces braguettes mal refermées.
Immanquablement, Rimbaud s’invite à ma tristesse :
Et leur membre s’agace à des barbes d’épis !
Des vers - il y en a d’autres - qui sont devenus des réflexes, sans pour autant perdre, du moins dans l’instant où ils sont dits en silence, toute la force de leur évocation.
Il y a des pages aussi.
Fut un temps où j’allais souvent à Rouen. Au sens propre comme au sens argotique.
Longtemps avant Chartres, sur la Nationale 10, j’apercevais les toits vert cuivré de la cathédrale, étrangement esseulés sur le dos rond de la Beauce. Comme posés là par accident. La Terre, Zola, immanquablement me revenaient en mémoire.
Mais je crois l’avoir déjà dit plus longuement dans "Polska B Dzisiaj. "
"Polska B Dzisiaj", dont le contrat avec Nuplie.pet n’a jamais été dénoncé, et que je me fais donc fort de vous offrir prochainement en téléchargement gratuit, avec mise en pages estampillée Nuplie.pet. Histoire de vous être agréable et, en même temps, de faire chier le renégat-menteur et son distributeur mastodonte, Amazon, tueur de libraires et de petite distribution.
Tenez, là, avec cette digression, c'est une petite strophe qui me revient soudain en mémoire.
My attendais vraiment pas. C'est la première fois.
Lâcher ce terme bas, Dieu sait ce qu'il m'en coûte,
La chose ne me gêne pas mais le mot me dégoûte,
J' suis désolé d' dire : Enculé !
G. Brassens - S'faire enculer -
12:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.02.2012
Ite missa est
 C’est quand on prend la mesure des indignations, luttes, révoltes, mutineries, sarcasmes, souffrances et dénonciations intellectuelles, dans leur époque respective, des hommes et des femmes qui nous ont précédés au cours des siècles, qu’on prend en même temps la mesure de l’affligeante inutilité à se rendre malheureux du malheur de son époque et de projeter, comme le bon chrétien vers la problématique du ciel, ses espoirs de bonheur dans l’avènement - toujours remis aux calendes, - de sociétés plus justes et plus fraternelles.
C’est quand on prend la mesure des indignations, luttes, révoltes, mutineries, sarcasmes, souffrances et dénonciations intellectuelles, dans leur époque respective, des hommes et des femmes qui nous ont précédés au cours des siècles, qu’on prend en même temps la mesure de l’affligeante inutilité à se rendre malheureux du malheur de son époque et de projeter, comme le bon chrétien vers la problématique du ciel, ses espoirs de bonheur dans l’avènement - toujours remis aux calendes, - de sociétés plus justes et plus fraternelles.
On n’attend pas la guerre sociale comme on attend l’autobus. Parce qu‘elle n’est jamais à l’heure, d’une part, et que, d’autre part, une guerre sociale n’a de sens individuel que si l’on se propose d’y être autre chose qu’un passager. En outre, à la grosse différence du bus qui, lui, sait exactement où il va, la guerre sociale n’est jamais certaine de sa destination. Toutes celles qui nous ont devancés ont été désorientées au premier carrefour rencontré, ont pris à droite quand il fallait prendre à gauche, à gauche quand il fallait aller à droite ou alors, ne sachant de quel côté s’engouffrer, ont bêtement filé tout droit. Bref, non seulement aucune n’a su atteindre le terminus mais toutes se sont retrouvées dans l'impasse où nous croupissons encore.
En admettant - ce qui est fort improbable - que les hommes du futur aient en effet réalisé, par rapport à nous, quelque progrès substantiel dans leur marche vers la réalisation d’un monde humain, leurs historiens jugeront alors forcément notre époque comme une époque de décadence, d’appauvrissement des arts et des lettres, de déchéance de la dignité et de la solidarité humaines et préoccupée par des problèmes qui n'auront été gigantesques que parce que le courage à les résoudre aura honteusement fait défaut. Une époque d’asservissement de l’esprit devant un monde qui n’est compliqué qu’en apparence et qui, pourtant, se résumera en quelques mots à l’esprit des futurs historiens : dictature feutrée de la finance.
Toute dictature a son discours, séparé de la réalité de ses sujets. Et c’est dans ce discours aux multiples dédales que s’est fourvoyée et même vautrée avec luxure et complaisance l’intelligence humaine à tous les niveaux, de l’ouvrier à l’artisan, en passant par le paysan, l'employé de bureau, l'agent de police, le maquereau, la putain et l’intellectuel, de service ou non. Car même le discours anti-discours n’est que réification d’une contradiction que, pratiquement, les hommes n’arrivent pas à mettre dans leur cerveau pré-formaté. Comme si, par un exemple naïf et qui tiendra ici lieu de poncif, des pompiers s’évertuaient à combattre la fumée, à l’aspirer, à la dissiper, sans faire le moindre cas des flammes, jugées tout à fait inoffensives et secondaires dans le déroulement du drame.
Cet état léthargique des zombies humains est un état non douloureux. Presque rassurant. On ne sommeille jamais mieux que lorsqu’on a vraiment envie de dormir. Quand une société, donc, n’a pour point de mire qu’une seule valeur pour chacun de ses protagonistes, la richesse pour les dictateurs et leurs suppôts et l’apparence d’une liberté sans usage humain pour les sujets, les choses sont d’une clarté déconcertante. Tout conflit est donc forcément «spectaculaire» et ne vise pas à renverser la «dichotomie consensuelle» mais à la consolider dans ses désastreux bienfaits.
Cette clarté nous amène alors à des prises de parole du pouvoir qu’aucun homme digne de ce nom vivant au XIXe siècle n’aurait laissées sans violente réponse. Par exemple, mais on pourrait en citer des kyrielles : une blondasse, une insignifiante de premier choix, néanmoins ministre putassière, en France, d’un budget virtuel, pétasse qui émarge sans doute mensuellement à 15 ou 20 000 euros peut déclarer devant les citoyens dont beaucoup ne se voient gratifiés chaque mois que de 1500 à 2000 euros, endettés, essoufflés, misérables et petits : «il ne faut pas que les chômeurs et les autres ne dépensent plus qu’ils ne créent de richesses…»
On voit donc que dans la bouche du dictateur, tout propos insultant, méprisant, ordurier, dominateur, est permis sans que ne se dessine à l'horizon une once de représailles, et ce, parce que le dictateur sait très bien que le consensus terrible est établi : "laisse moi m’enrichir et te voler à ma guise et je te donne la permission d’écrire ce que tu veux, de penser ce que tu veux, de gueuler ce que tu veux, d’aller où tu veux, de consommer ce que tu peux. D’être esclave affranchi, somme toute.
Voilà, en quelques mots, notre époque simplifiée. Très simplifiée. Car il faudrait examiner les subdivisons, dénoncer tous ceux qui font mine d’être du parti des sujets affranchis, mais dont l’existence de pseudo-constestataire ne dépend que de la pérennité de la dictature qu’ils font mine de honnir.
Faut-il alors espérer une époque meilleure ? Voire y œuvrer ? Ma conviction profonde est que non, à moins qu'on ne veuille donner le change. Parce que rien ne rend plus malheureux et atrabilaire et malade que les espoirs immanquablement déchirés sur les champs de bataille.
La véritable subversion est individuelle. Existentielle. Intime. Secrète. Elle consiste à être heureux, à bâtir du bonheur dans une société qui a fait du malheur des gens la cheville ouvrière de son maintien. Elle consiste à signer l'échec de cette société par l'insolence de son propre bonheur.
C’est cela, pour moi, être un homme debout. Envers et contre tout. Et c’est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que de gueuler, que de vilipender, que de s’inscrire à, que de voter, que de faire semblant de penser des choses.
Car il faut alors avoir refusé de laisser mourir son imagination et n’avoir pas renoncé à mettre à profit sa chance d’exister, pour être le vilain petit canard boiteux d’une basse cour de clones lustrés.
Que m’importe, dès lors, les pauvres et les riches et les mensonges et les abominations ! Cette société est celle du syndrome de Stockholm : les victimes sont amoureuses et complices des bourreaux.
Qu’ils et qu’elles crèvent !
Oui, monsieur D’Axa, je fais mienne votre sagesse en révolte :
«Que nous importent les lendemains qui seront dans des siècles ! Que nous importent les petits neveux ! C'est en dehors de toutes les lois, de toutes les règles, de toutes les théories — même anarchistes — c'est dès l'instant, dès tout de suite, que nous voulons nous laisser aller à nos pitiés, à nos emportements, à nos douceurs, à nos rages, à nos instincts — avec l'orgueil d'être nous-mêmes. »
Que nous importent en effet des lendemains qui chanteraient ! La messe est dite : les hommes ont définitivement échoué dans leur tentative d'une occupation humaine de la planète. Ils seront disparus avant même d'avoir compris le sens de leur aventure collective.
Image : Philip Seelen
11:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.02.2012
Livres, guitare et incident de parcours
 On ne le découvre bien souvent qu’après coup, au bout du voyage, un soir de désoeuvrement, devant sa bibliothèque où l’on fouine pour prendre un livre indéfini : il en est qu’on trimballe partout avec soi.
On ne le découvre bien souvent qu’après coup, au bout du voyage, un soir de désoeuvrement, devant sa bibliothèque où l’on fouine pour prendre un livre indéfini : il en est qu’on trimballe partout avec soi.Des livres qui sont plus gros que les autres parce qu’en plus de leur texte propre, ils contiennent aussi les étapes de votre histoire. Quand vous les prenez dans les mains, sans même les ouvrir, ils racontent des choses à vous seul accessibles.
J’en possède quelques-uns comme ça. Deux surtout, du même auteur et qui occupent le dessus du panier. De vieux livres. Des 10/18 qui plairaient bien à notre ami Le Tenancier. Mais il les connaît sans doute depuis belle lurette.
Je les avais à Poitiers, je les avais à Toulouse, je les avais à Paris, je les avais en Allemagne, je les ai eus les vingt cinq ans que je suis resté en Charente-maritime, je les ai emmenés avec moi en Pologne.
Georges Darien. L’épaulette et Le voleur, avec une grande préférence pour le premier. Un chef-d’œuvre qu’en ces matins de peste brunâtre, on devrait relire comme une piqûre de rappel contre l'endormissement.
Il en est bien d’autres encore qui ont pris la clef des champs chaque fois que j'ai hissé les voiles ou qui m’ont rejoint plus tard, levant les bras au ciel comme des orphelins laissés un instant au bord de la route, des qui me collent aux basques : des Maupassant, des Dostoïevski, le Villon, les Baudelaire et Rimbaud dans la Pléiade, des Céline, les publications situs, des Vailland aussi.
Il me manque, celui-là. Rarement un livre ne m'avait autant secoué.
Sont-ce des miroirs, ces livres ? Ils sont noyés parmi les autres, ils peuvent se taire des années, fondus dans le décor des étagères.
Mais à la moindre velléité de tremblement du bateau, ils sautent d’eux-mêmes dans une valise. Comme des chats.
Je ne parle pas des livres-partitions de Brassens. Eux, ils sont vieux comme mes matins d’adolescent, ils ont voyagé par tous les temps, en tous les lieux, même très brefs, aussi fidèles que l’air qu’on respire.
La guitare, elle, c’est plus une protubérance organique qu’un objet. Ma Takamine a fait six fois le trajet aller/retour Paris-Varsovie dans une soute de bus.
Une mutante aussi.
De ma première, un dinosaure de trois kilos, fossile endormi, rétif à faire vibrer et fabriqué par un frère, jusqu’à mon actuelle en passant par bien d’autres, des bonnes et des moins bonnes, partout l’instrument s’est promené de mes promenades.
Des fois, c’était pas nécessaire du tout. Voire pas recommandé.
La couchette au-dessus de moi était libre au départ de la gare du nord. Une aubaine. J’y mis mon Epiphone, hors de sa housse et bien à son aise sur les oreillers.
Il advint cependant qu’en gare de Cologne une belle, grande et blonde dame réclamât dans un anglais que je compris aussitôt puisqu'aussi approximatif que le mien, la couche molle qu’elle avait préalablement louée.
Norvégienne et artiste peintre de son état, elle était empêtrée dans des toiles, des dessins, des tableaux et un chevalet qu’elle portait sous les bras.
Je l’aidai à grimper tout ça là-haut, virai ma guitare et, ce faisant, maladroit très à l'étroit, malotru, je transperçai de part en part la plus grande de ses toiles avec le manche de l’Epiphone.
Ce ne fut plus dans le petit dortoir assoupi que cris et lamentations haut perchés de l’artiste en crise, tandis que je me confondais en excuses aussi plates que vaines.
Les six couchettes étaient cependant en émoi, celle-ci goguenarde, celle-la joliment offusquée, cette autre encore froidement compatissante.
J’accusai, moi, l’étroitesse de ces wagons-lits, le rapport frelaté qualité-prix, le stalinisme honteux des moyens de transport, mauvaise foi qui ajoutait encore à la confusion bruyante des sentiments contradictoires.
09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.02.2012
Matin

Un coup d’œil sur celui suspendu à la bibliothèque. + 17. Bon, c’est pas bon du tout.
Je pense soudain qu’entre cette nuit que j’entrevois derrière le carreau, juste devant mon nez, et mon corps, il y a 43 degrés de différence. Sortir serait engouffrer la tête dans un congélateur. Un congélateur mal réglé en plus. Trop puissant.
Je m'amuse soudain du père du narrateur du Front russe : dix sept, c’est bon pour la planète ! Et bien fi de la santé de la planète, ce matin ! Il faut rallumer les chauffages. Prendre un petit déjeuner confortable.
La pénombre du dehors est blanche de neige et pleine de lune. Le village immobile encore. Aucune fumée aux cheminées qui semblent implorer de leurs silhouettes noircies des étoiles de glace. Bientôt je surveillerai celle de ma voisine, la mémé de plus de quatre vingt ans et qui marche à pas courbés sur le bout de la piste, pavée de la plus cruelle des intentions... Dès que les petits nuages de son maigre feu monteront vers le ciel, ils me diront, " Pas de problème. Nuit vaincue. Je vois ce jour nouveau."
Un coup d’œil au calendrier. 10 février…Ça ne me dit rien, le 10 février. Qu’une goutte supplémentaire tombée sur la fuite du temps.
J’aimerais écrire aujourd'hui quelque chose qui dise silence, paysages congelés, bonheur d’exister, grand mouvement des choses et lutte incessante contre les rigueurs du climat, depuis bientôt un mois maintenant.
Et quand je regarde toute cette froidure statufier l'énergie et anéantir le mouvement, j’imagine un instant, là, devant les flammes qui ronronnent maintenant et le café qui fume, la grande solitude de la vie sauvage. Le renard qui rentre, la queue basse sur le désert des champs après une nuit de maraudage inutile et glacial, les quelques oiseaux amaigris qui attendent l'aurore pour se mettre en quête d’une improbable pitance.
Il y a quelques soirs de cela, m'en revenant d’un village voisin, deux masses énormes se sont soudain dressées en travers de ma route, encore plus gigantesques sans doute dans la lumière des phares. J’ai pilé, sans savoir pourquoi je pilais. Comme on pile par instinct de conservation. Deux élans nonchalants, sombres et hauts tels des chevaux sauvages, traversaient. Ils ont tourné leurs grosses têtes vers cet intrus, briseur de silence et d’ombres. J''ai vu leurs yeux globuleux allumés comme de muettes remontrances.
Là-bas, derrière les arbres et les toits, au dessus de la Biélorussie, s’allume le rose équivoque d’un pas de plus vers l’équinoxe des éternels retours, les orages de l'été, les feuilles de l'automne, les neiges de décembre et les tombes promises.
11:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.02.2012
Guy Debord illustré
54
Le spectacle, comme la société moderne, est à la fois uni et divisé. Comme elle, il édifie son unité sur le déchirement. Mais la contradiction, quand elle émerge dans le spectacle, est à son tour contredite par un renversement de son sens ; de sorte que la division montrée est unitaire, alors que l’unité montrée est divisée.
 55
55
C’est la lutte de pouvoirs qui se sont constitués pour la gestion du même système socio-économique, qui se déploie comme la contradiction officielle, appartenant en fait à l’unité réelle ; ceci à l’échelle mondiale aussi bien qu’à l’intérieur de chaque nation.
56
Les fausses luttes spectaculaires des formes rivales du pouvoir séparé sont en même temps réelles, en ce qu’elles traduisent le développement inégal et conflictuel du système, les intérêts relativement contradictoires des classes ou des subdivisions de classes qui reconnaissent le système, et définissent leur propre participation dans son pouvoir. [...] Ces diverses oppositions peuvent se donner, dans le spectacle, selon les critères tout différents, comme des formes de sociétés absolument distinctes. Mais selon leur réalité effective de secteurs particuliers, la vérité de leur particularité réside dans le système universel qui les contient : dans le mouvement unique qui a fait de la planète son champ, le capitalisme.
GuyDebord, La Société du spectacle
Photo AFP
11:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.02.2012
Bzzzzzz...Bzzzzzz...

Car quand je dis «les gens sont bêtes», je m’exclus bien évidemment de ces gens-là. Je ne fais pas partie des gens, moi. Joli tour de passe-passe, ma foi ! Car si je ne fais plus partie des gens, alors de quelle partie fais-je donc partie ? Des bêtes ? Des plantes ?
Si les animaux ne sont pas si bêtes que l’on croit, ils doivent se dire : "Les bêtes sont gens"…Et ce serait bien là le parti des bêtes songeant.
Et les plantes, celles qui agrémentent notre espace de leurs couleurs, de leurs parfums, de leurs formes ? Celles qui nous disent que le printemps est de retour ? Si elles ne sont plus plantes, pensent-elles « les plantes sont gens» ou «les plantes sont bêtes» ? Sais pas. Jamais entendu une plante penser. En revanche, certaines m’ont fait penser à des choses bizarres. Hilarantes. Mais c’étaient là des plantes taboues, interdites, que la police serait même venue vous voler si elle les avait trouvées dans votre jardinet ou dans un pot de fleurs suspendu au balcon… Des plantes qui s’envolaient en fumée. Rien, quoi. Du vent.
Les gens sont donc bêtes de dire que les gens sont bêtes. Les gens sont les gens. Point.
Quoiqu’il faudrait quand même faire attention… Sans certaines bêtes, plus de gens ! Plus de plantes ! Rien. Le chaos originel… Oui, sans ces petites bêtes qu’on appelle les abeilles, un désert mortel solderait notre destin.
Je lisais ces jours-ci - et je crois que c’est Einstein qui l’a affirmé le premier - que si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l’humanité disparaîtrait dans les trois ans, tout au plus. Plus de plantes, donc plus d’herbivores, plus de viande à bouffer, plus de fruits, donc plus de sucre naturel, plus de légumes, donc plus de fibres alimentaires, plus de fleurs, donc plus de fleuristes… Non. Ça, ça n’est pas très grave…Plus de fleurs, donc plus de je ne sais quoi, plus d’arbres, plus d’eau, plus de rivières... L’Apocalypse, la disparition des dinosaures humains.
Plus de marchandises, donc, il va sans dire, plus de marchés, plus d’agences de notation, plus de banques, plus de riches, plus de pauvres… Plus rien.
Alors, si j’étais candidat à l’élection présidentielle en France, moi, j’axerais mon propos là-dessus : Sauvons les abeilles et nous sauvons tout !
Ça serait un raccourci fulgurant, mais ça irait droit au but… En une phrase, le candidat qui aurait cette idée lumineuse - je ne dis pas qu’il lui faille un programme, non, ça, c’est quand même beaucoup demander - en dirait autant et même plus que tous les autres en dix millions de phrases. Et s’il y a un militant qui passe par là, sans doute égaré par un moteur de recherche facétieux, qu’il y pense ! Qu’il souffle ça dans l’oreille de son timonier… Promotion assurée à l’arrivée. Si le timonier arrive, bien sûr.
Parce que j’ai l’air de rigoler, mais les abeilles, elles sont en voie, sinon d’extinction, du moins de diminution… Oui, les pesticides, les engrais, les nitrates, bref, tous les poisons violents que vous avez chaque jour dans votre assiette aux délicats fumets.
Et les Chinois, eux, pas bêtes, conscients du problème, conscients de cette épée de Damoclès qui butine insolemment au dessus de leur tête besogneuse, ont essayé de faire des plantes auto pollinisatrices. Ça a marché ! Mais pas trop bien. Trop de temps pour féconder un hectare de pistils et trop de main d’œuvre. Même les Chinois ne sont pas assez nombreux pour prétendre remplacer les abeilles ! C’est dire pour les autres !
Donc, les gens sont bêtes de penser que les gens bêtes sont comme les bêtes. Il manquerait une seule bête sur notre belle terre, et plus de gens !
Tout le monde le sait et personne ne pense à fermer les usines d’où sortent tous les trucs qui tuent les butineuses.
Sont vraiment cons, les gens !
12:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.02.2012
Où l'on reparle de " Géographiques"
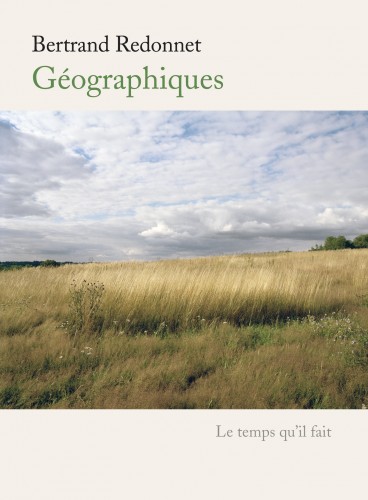
Je suis assez amusé - et même plus - par mes propres conclusions lapidaires.
Je terminais en effet mon billet précédent par : "Tout ceci pour dire qu'il faut lire avec recul, à toutes les époques et bien sûr à la nôtre, les jugements émis par les écrivains sur les écrivains."
Et quelques instants plus tard, je découvre une belle critique de Géographiques, par Marc Villemain.
Alors faites comme si vous n'aviez pas lu le billet précédent.
De toutes façons, Marc ne dit pas, comme Hugo à propos de L'Assommoir, que "mon livre est mauvais" !
15:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.02.2012
L'offensive

Dans mes yeux fermés valse une lumière orange peuplée de petites figures, des traits comme des bacilles avec des trous, et qui tournoient… Il fait bon. J’imagine entendre pépier un oiseau. Il faut rentrer très vite, l’air bleu est un glaçon qui vous momifierait sur place !
Le soleil d’ailleurs bascule très vite. Déjà, il effleure les premières cimes…Il a joué son rôle d'illusionniste, il fout le camp dans la nuit... La neige ne scintille plus et le thermomètre dégringole.
Le matin même, j’avais convoqué deux joyeux gaillards pour qu’ils colmatent une légère fissure, par où s’engouffrait un peu d’air. Mais un peu d’air à moins 25, c’est déjà une tempête !
Ils étaient arrivés vers dix heures, mes gars, tranquilles comme Baptiste. Ouf, que je m’étais réjoui, les voilà enfin ! En un quart d’heure l’affaire sera réglée ! Mais les deux joyeux lurons étaient transis…Oui, qu’ils ont dit, pas de pot ! Le chauffage de la voiture est en panne… Aie, aie ! En effet…Faire une quinzaine de kilomètres à moins 28, derrière un volant et sans chauffage, il y a de quoi être pétrifiés! Alors ils se sont installés près du grand poêle et de leur caisse à outils ont d’abord exhibé… deux bières ! Qu’ils ont sirotées, là, peinards, en blaguant…Je me suis demandé combien ils auraient sifflé de canettes si on avait été en juillet avec 35 degrés à l’ombre et j’ai ri : cette désinvolture sympathique avait soudain tout relativisé des conditions climatiques. Ils avaient l’air de s’en soucier comme d’une guigne, de l'hiver, et ils plaisantaient !
C’est leur climat, sévère, sans concessions. Ils portent en eux une latitude du berceau, que je n’ai pas encore acquise…N’empêche qu’ils ont bien fait leur boulot, qu’ils ont bouché le bec à ce petit courant d’air de rien - mais en forme de couteau - qu’ils ont sifflé une deuxième bière, parce qu’ils avaient eu chaud sans doute, et sont repartis, joyeux, sur la neige glacée et dans leur petite voiture sans chauffage.
Quand on habite ces latitudes énervées, l’essentiel est donc de ne pas geler...Un camarade autochtone me disait : « L'hiver polonais, c’est la guerre, Bertrand. Il n’y a pas d’autre issue que de la gagner ! » J’espère bien. J'en ai gagné d'autres. Même si j'en ai perdu bien plus que je n'en ai gagné !
Alors, je n'ai plus fait que ça, faire reculer derrière mes murs les troupes venteuses de l'est sibérien, leur opposer une barricade, les faire fondre au contact de ma maison, les décourager ! Quand l’essentiel réside dans la conservation du confort initial du corps, tout le reste est parfaitement dérisoire.
Je l’ai souvent dit pour l’avoir bien souvent constaté : l’écriture est un amuse-gueule de gens peinards dans leurs bottes -je n’ai pas dit heureux - qui parlent de la vie et du monde quand tout va bien, mais en disant que tout va mal, parce qu’une écriture qui se respecte ne veut jamais se faire l'écho d’un imbécile heureux… C'est comme les chansons, les tristes sont souvent belles, les joyeuses sont le plus souvent culcul la praline.
On n'écrit un vécu extraordinaire que lorsqu’on est de retour dans l’ordinaire. C’est l’art du décalage, l'écriture.
Et c’est pourquoi, aussi, L’Exil des mots s’est tu pendant une semaine.
Il semble cependant qu’avec moins 20 degrés ce matin, l’adversaire en soit à la recherche de son second souffle. Un peu de répit. Mais... Mais, il refait ses forces sans doute, il recharge ses batteries et annonce pour bientôt une nouvelle offensive.
La terre est passionnante, me disais-je ces jours derniers. La terre me passionne. Les petits voyageurs prétentieux qui sont à son bord, englués dans leur modernité misérable, courbent la tête et l’échine devant ses sautes d’humeur. Tant qu’il en sera ainsi, nous garderons en nous quelque chose de profondément humain, d’originel, quelque chose du Grand Pan.
Huit jours, donc, que je n’avais mis les pieds sur internet. Si je puis dire… Je lis alors qu’un imbécile de mes congénères, de mes compatriotes même, un qui pète dans la soie, roule sur un salaire mensuel de plusieurs mille d’euros, déclare que les civilisations ne sont pas toutes égales. Je pense alors qu’on est bien, quand des moins 30 degrés vous ferment les portes d’accès au monde…Dès qu’on les rouvre, ces portes, une odeur de merde, d’égouts et de charogne s’engouffre par une fissure. Une fissure qu’aucun de mes deux joyeux bierophiles ne saurait obstruer.
Je me dis que je m’en fous que les civilisations soient égales ou pas. Je n’en connais qu’une, et encore qu’à grand peine. Comme l’imbécile auteur de cette immondice, d’ailleurs. Ce que je sais, c’est que les hommes ne sont pas égaux devant les rigueurs des latitudes. Ils ne sont pas égaux selon la position qu’ils occupent par rapport à l’inclinaison de la terre. Ils sont plus ou moins pénalisés selon le point où ils sont nés.
J’imagine les Grecs - dont on fait grand cas - ou les Italiens, ou les Portugais, et même les Français, devant dépenser le budget chauffage, entretien et dégagement des routes, des canalisations, des écoles, des lieux publics, secours aux populations, que dépensent chaque hiver les Polonais ! J’imagine mal… Ne leur resterait même plus de quoi se payer un paquet de clopes ! Est-ce que ce truc difforme qu’on appelle l’Europe a pensé à équilibrer ces foutues subventions en fonction des colères climatiques de la terre, devant lesquelles ses contribuables ne sont pas tous logés à la même enseigne ?
Mais il est vrai qu’une Europe qui penserait à autre chose qu’aux marchés et aux ventres replets de ses banquiers, ne serait déjà plus un truc, mais une communauté.
Mieux vaut attendre le dégel, du coup, que d'attendre ce genre d'approches !
Et puisque je suis bavard ce matin, je vous confie que j'ai une pensée attendrie pour mon Zozo, chômeur éperdu qui s’est envolé vers le Québec aujourd’hui, sous les traits du camarade Jean-Jacques Epron…Cela me fait énorme plaisir d’être lu là-bas… De l'autre côté, quasiment, de la Machine ronde.
C'est peut-être ma vanité qui, envers et contre tout, refuse de geler !
12:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.01.2012
L’œil de glace

Disons alors, en ce qui nous concerne, là, que le ciel est bleu. Point. Immense ? Oui, bien sûr immense. Mais vous avez déjà vu un ciel, je suppose, et vous n’avez point besoin qu’on vous écrive, en plus du bleu, qu’il est immense.
Le ciel est donc bleu, en dessous de lui la forêt est sombre et les paysages sont blancs, non pas comme neige, mais de neige. Surtout ne pas dire cette neige comme un linceul… On ferait tout le monde éclater de rire, ce qui n’est quand même pas très courtois quand on parle de linceul… Ne pas dire non plus l’immobilité et le silence et le froid qui cingle… Ils en ont ras la casquette, les gens, de ces images à la noix…
La forêt est sombre et les villages, les champs, les routes, les chemins sont blancs.
Il fait moins vingt, moins vingt deux degrés, et tout ça va dégringoler dans les jours prochains jusqu’à moins trente.
En fait, fi du bleu ! Du niaisement bleu ! Le ciel est un œil, un œil de glace, cruel, vitreux, cyclopéen, posé sur le monde.
L’œil d’un anticyclone qui, d’ordinaire, a ses quartiers sur la Sibérie et qui, là, a décidé de venir faire un petit tour en Pologne de l'est. De s’y installer même. Il irradie de l’air irrespirable, ensoleillé et congelé.
Qui fait presque peur.
12:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.01.2012
Le livre de Marc Villemain
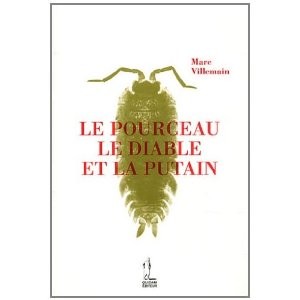 Je ne suis pas - très loin s’en faut - critique littéraire, au sens où je pourrais me permettre de faire une fine analyse et conseiller ou déconseiller tel ou tel livre à un public de lecteurs. Il faut du talent bien spécifique pour ça et surtout beaucoup d’honnêteté intellectuelle. Si je pense être pourvu de cette dernière qualité, ma foi, pas moins qu’une foule de gens parmi lesquels sont aussi ceux qui font profession de la critique, je crois en revanche être dénué de la première.
Je ne suis pas - très loin s’en faut - critique littéraire, au sens où je pourrais me permettre de faire une fine analyse et conseiller ou déconseiller tel ou tel livre à un public de lecteurs. Il faut du talent bien spécifique pour ça et surtout beaucoup d’honnêteté intellectuelle. Si je pense être pourvu de cette dernière qualité, ma foi, pas moins qu’une foule de gens parmi lesquels sont aussi ceux qui font profession de la critique, je crois en revanche être dénué de la première.
Je peux évidemment dire à des amis et à des proches ce qui me plaît dans tel livre et ce qui me déplaît dans tel autre, ou encore trier le bon grain de l’ivraie d'un même ouvrage, tout ça au subjectif intégral.
Ce que tout le monde est en mesure de faire.
Je vous propose ainsi de vous traiter ici en amis en vous livrant une part de ma lecture du dernier opus de Marc Villemain, Le Pourceau, le diable et la putain.
J’entretiens par ailleurs avec cet écrivain des relations fort amicales qui m’autorisent à parler publiquement de ce qu'il fait, d'autant qu'il eut la gentillesse, sur ma demande, de me faire parvenir son livre.
Je l’ai lu avec gourmandise. D’un trait.
Je vous disais hier que je me posais pour moi-même une question qui se mord la queue, à savoir, dans quelle mesure l’écrivain n’est-il pas lui-même écrit ? C’est un défaut récurrent chez moi que de chercher toujours peu ou prou la part investie de l’auteur en personne derrière le verbe du narrateur. Trouver, donc, la clef du traitement littéraire, plutôt que de lire l’ensemble comme un véritable tout, ces deux parts devant fusionner dans l’œuvre réussie, au point d’y être difficilement identifiables.
D’emblée, on ne cherchera donc pas Marc Villemain, sémillant quadragénaire, dans son personnage central, octogénaire grabataire et à l’agonie.
On dévorera dès lors le monologue d’un misanthrope en bout de piste, maculant ses couches de ses incontinences - que l’infirmière Géraldine Bouvier lui change régulièrement avec un sourire écœurant de maternalisme - sous perfusions permanentes, physiquement assez lamentable mais intellectuellement d’une richesse très au-dessus de la moyenne. Un homme d’une finesse exquise même ; un homme qui toute sa vie aura été un misanthrope presque sublime et qui reprend à son compte la formule lapidaire de Chamfort en la prêtant malicieusement à Balzac : «Tout homme qui à quarante ans n’est pas misanthrope n’a jamais aimé les hommes. »
J’ai retenu cette phrase-choc et ce passage, parmi bien d’autres, car j’écrivais il y a quelque temps, à propos du livre de Stéphane Beau, La semaine des quatre jeudis : «La misanthropie naît d un amour excessif des hommes, mais d’un amour déçu. »
Je ne sais pas si Léandre l’octogénaire signerait cette affirmation, mais il me semble qu’il en épouse parfois l’esprit.
Le vieillard cacochyme élève la misanthropie au rang d’un humanisme et c’est d’ailleurs le titre de l’ouvrage qu’il a produit quand il enseignait les lettres à l’université, Le misanthropisme est un humanisme. Facétieuse allusion au pape de l’existentialisme, compromis, lui aussi, tout comme Balzac, par une déclaration d'une dialectique fracassante en faveur de la misanthropie. Ça devrait pas mal grincer des dents du côté des nostalgiques de Saint-Germain-des-prés…Ça devrait aussi tousser un peu, sur un autre sujet et à un autre endroit du livre, du côté de l'épicurisme primaire.
Le récit que l’octogénaire en perdition fait de sa vie et le regard qu’il jette sur sa chambre d’hôpital, sur ses voisins de lit comme sur le personnel infirmier - au centre duquel règne l’incontournable Géraldine - feront découvrir au lecteur que sa position n’est pas une position purement intellectuelle, une position de muscadin en mal d’existentiel, mais une longue, une joyeuse et cohérente disposition de tout son être dans sa confrontation au monde. Un jeu. A quelqu’un qui lui conseilla jadis le suicide, Léandre encore relativement jeune avait rétorqué : Pourquoi diable me suiciderais-je, quand mon bon plaisir tient précisément au spectacle de réjouissante bêtise que vous me procurez ?
Le Pourceau, le diable et la putain, en dépit de l’allégresse intérieure du moribond, est un livre noir, servi par un style qui m’a surpris et que je rapprocherais volontiers de celui dont usait avec brio un certain Henri Calet. Style pur chauffé au feu de l’ironie, parfois du sarcasme. Style distancié, un peu gouailleur aussi, mais style qui coule et vous emmène dans les méandres de Léandre avec beaucoup de tact. Un style en parfaite adéquation avec l’état d’esprit de l'agonisant.
Le seul bémol que je mettrais serait dans la recherche, en de rares endroits, d'un vocabulaire un brin précieux, qui accroche la lecture un peu comme quand on joue une note ou deux hors gamme, pour enrichir un phrasé mais en détournant un court instant l'auditeur de son écoute. Mais il est vrai aussi que c’est Léandre qui parle, qui pense plutôt, et que, tout misanthrope qu’il soit, il est aussi un homme éminemment cultivé.
En tout état de cause, je vous souhaite à tous la lecture de ce livre et, ce faisant, d’en retirer le plaisir que j’y pris.
Quand je dis plaisir, je ne parle pas de plaisir de distraction volé entre la poire et le fromage…Je parle du plaisir à faire un pas de plus sur le terrain de la littérature.
14:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.01.2012
Une légende du Poitou : La louve blanche
Ce qui m'intrigue dans cette légende, censée être du Poitou, c'est qu'elle est la réplique d'un fait divers réellement survenu à Riom, où Arline de Barioux fut jugée et brûlée en place publique le 12 juillet 1588.
Alors qui, du fait divers ou de la légende, a donné naissance à l'autre ? Mystère et boule de gomme, même si Riom se situe à la fin du XVIe siècle et que la légende prend pour cadre historique la fin du XIIe.

En l’an de grâce 1192, par une belle matinée du mois de mai, Géraud de Toufou, seigneur du comté, s’en revenant enfin de croisade après cinq longues années d’absence, reçut un accueil triomphal de tous ses vassaux et de tout le peuple des lieux, hommes, femmes, jeunes gens, enfants et vieillards rassemblés sous les murs de son château, le long des prairies qui descendent en ondulant de la colline jusqu’à la rivière.
Ce fut d’abord un long cortège de chariots et de tombereaux tirés par de splendides bœufs rouges et regorgeant des trésors les plus divers, meubles d‘ébène, diamants, bijoux, émeraudes, ivoires, tapisseries, victuailles, parfums et fines épices d’Orient, armes et fanions pris à l’ennemi, avant que le jeune seigneur, la peau hâlée par les vents du désert, ne ferme la marche, le port majestueux sur son destrier à la robe pommelée, impeccablement harnaché, tel qu’au combat.
Il portait son armure complète, sans le heaume cependant, et de sa main lourdement gantée de fer saluait la foule qui l’acclamait, tombait à genoux, se signait et jetait sur son passage des bouquets échevelés de fleurs multicolores.
Géraud de Toufou, svelte, puissant, beau comme une statue antique, n’eut pas même un regard pour toutes les pucelles du Comté venues sur les prairies, se pressant aux premiers rangs dans l’espoir que son choix de prendre épouse se portât sur l’une d’entre elles.
C’est que juste devant lui cheminait avec élégance un chariot sur lequel une tente de soie blanche avait été dressée et que le jeune seigneur ne quittait pas des yeux. Des hommes noirs, gigantesques, aux muscles luisants, escortaient ce chariot. Arrivé à la poterne du château, Géraud de Toufou fit un geste impératif en leur direction. L’étoffe de soie fut alors déchirée et la foule retint soudain son souffle : une jeune princesse volée à son père, héritier des rois de Thèbes, noire de peau, une lourde et sombre chevelure aux reflets bleutés qui lui retombait sur les épaules telles des houppelandes, d’immenses yeux couleur des ténèbres et qui semblaient lancer des flammes furibondes, était assise sur un trône incrusté d’or et de diamants étincelants comme les astres du firmament. La jeune femme était d’une beauté saisissante, farouche, inaccessible, sauvage. A son annulaire gauche brillait l’anneau que les épouses des Comtes de Poitiers se transmettent depuis Clovis.
La foule mit le genou à terre, se signa encore et laissa échapper un long murmure d’admiration.
Et la vie reprit bientôt son cours au château de Toufou. Tous les soirs y étaient donnés des bals, des fêtes grandioses et des ripailles sans nom. Des tournois et des joutes nautiques étaient organisés sur la Vienne. Des tonneaux de vin et de cidre étaient chaque nuit mis en perce et jusqu’au petit matin, le Comte de Toufou dansait et tournoyait au bras de sa resplendissante épouse, sous les yeux d’une cour subjuguée. Des quatre horizons du royaume, jeunes princes et seigneurs accouraient pour voir flamboyer cette délicieuse étoile noire, venue des lointaines contrées d’Orient. Ils s’en revenaient dans leurs terres avec leurs blondes et grasses épouses aux bras laiteux et se surprenaient alors à appeler de leurs vœux une nouvelle croisade.
Entouré de ses fidèles chevaliers, le Comte Géraud de Toufou s’adonnait également à la chasse dans les grands bois alentour du château. Chaque soir, il déposait aux pieds de sa bien-aimée ses trophées encore tout chauds, cerfs, chevreuils, sangliers ou goupils. Elle recevait les offrandes avec bonheur, assise sur son grand trône d’ébène, entourée de ses demoiselles et en riant de tout l’éclat de ses dents éblouissantes.
Plus d’une année s’écoula ainsi dans l’effervescence des fêtes et des joies et le Comte était chaque jour plus amoureux de sa princesse. Un seul souci cependant venait parfois rider son large front : elle n’attendait toujours pas d’enfant en dépit des ébats passionnés dont il l’honorait.
C’est alors qu’au beau milieu de toute cette insouciance tapageuse, survint l’alarmante nouvelle de la prise de Vouillé par les Wisigoths. On était à l’automne de l’an de grâce 1193. Le Duc de Poitiers envoya des messagers et donna l’ordre à tous ses vassaux de marcher au combat. Le Comte de Toufou leva donc une armée et par un matin bleu du mois de septembre, embrassa tendrement son épouse, salua ses gens et s’en fut porter ses armes contre les envahisseurs barbares.
Commença alors un hiver des plus terribles que la région n’ait depuis longtemps eut à subir. Dès novembre, les blizzards soufflèrent des jours et des jours sans jamais perdre haleine, le gel pétrifia les campagnes endormies et la neige vient tout ensevelir de sa lourde pelisse, qui durcissait aussitôt sous la morsure du froid.
Se languissant de son amant, la belle princesse cessa tout à coup de prendre les repas qu’on lui servait. Elle ne mangea plus. Pour se distraire, elle se mit alors à parcourir tout le désert gelé des campagnes, sur sa jument d’Arabie lancée au grand galop, traversant les plaines, sautant les ruisseaux de glace et dévalant les collines. Elle chevauchait inlassablement, les cheveux au vent et les éperons déchirants les flancs de sa monture. Aucun garde, aucun domestique ne parvenait à la suivre tant elle filait à toute allure, semant son escorte pour disparaître bientôt dans l’épaisseur des grands bois et des fourrés.
Elle revenait au crépuscule, gaie, rieuse, ses grands yeux noirs allumés d’éclats radieux et sa jument dégoulinante de sueur, en dépit du froid qui ne cessait de sévir.
On s’alarma bientôt de la voir ainsi chaque jour passer le pont levis car une autre nouvelle, terrifiante, arriva : des bandes de grands loups gris attaquaient paysans, colporteurs, voyageurs, bûcherons, cavaliers, enfants, et venaient jusque dans les granges et les écuries égorger le bétail. Ils étaient conduits par une splendide louve blanche qui galopait à leur tête, les dirigeait et désignait les proies. C’était elle, disait-on, qui déchiquetait et dévorait tout ce que la meute encerclait et égorgeait. C’était elle qui menait la curée avec une cruauté démoniaque.
L’effroi gagna tout le comté. Des femmes et surtout des enfants furent affreusement mutilés et abandonnés sur la neige, à moitié dévorés, les entrailles béantes. De nombreux paysans avaient trouvé refuge sous les murs du château. On ne dormait plus. Pour effrayer et tenir à distance la meute diabolique on allumait la nuit de grands feux qui crépitaient et lançaient jusqu’aux étoiles glacées des étincelles rougeoyantes.
Et quand le comte Géraud de Toufou s’en revint sur ses terres, en février, il trouva tous ses gens en proie à une folle terreur, ainsi que tous les vilains et manants de la contrée. Il retrouva aussi son épouse adorée dans tout l’éclat de sa beauté, resplendissante de vie et de santé. Ce qui ne manqua pas de le remplir de joie et de bonheur, car il s’était imaginé la retrouver malade et cruellement amaigrie, tant les messagers qu’on lui avait envoyés du château l’avaient à chaque fois informé que la délicieuse princesse observait un long jeûne de tristesse depuis son départ.
Après qu’on lui eut fait le récit des terribles ravages des grands loups gris conduits par une louve blanche féroce, il donna une fête et un bal, tournoya toute la nuit, s’enivrant du parfum délicieux de son épouse et des vins les plus exquis, avant de jurer au petit matin qu’il partirait lui-même à la recherche de cette louve redoutable et qu’il déposerait bientôt sa dépouille au pied de sa princesse. Ce n’est pas une vulgaire louve, fût-elle blanche et terrifiante, qui fera affront à un chevalier ayant vaincu les Cheiks Sarrazins et les rois Wisigoths, tonna-t-il !
A partir de ce jour, le Comte Géraud de Toufou sillonna sans relâche toute la région, les ravins gelés, les fourrés et les grand bois, à la recherche de la meute et de sa louve. Maintes fois, il surprit les bêtes féroces et vit à leur tête leur formidable guide, haute, souple, puissante, les crocs acérés et la rage écumant de ses babines retroussées. Chaque fois cependant, elle déjoua ses pièges et prit l’avantage sur lui dans la poursuite. Le Comte revenait tous les soirs au château, fourbu, de fort méchante humeur et traînant derrière lui les dépouilles ensanglantés des loups abattus, mais jamais celle de la louve blanche, promise à son épouse.
Le Comte en était ulcéré et dès l’aube repartait de plus belle, la rage au ventre…Enfin, dans les tout premiers jours du mois de mars, alors que le soleil déjà plus haut sur le ciel amorçait le dégel, que des gouttelettes d’eau commençaient à pendre aux branches des arbres comme des pleurs, il débusqua la grande louve et ses loups gris, au creux d’un profond ravin. Les fauves étaient en train d’ouvrir sauvagement le ventre d’un bûcheron qu’ils avaient surpris aux aurores et leurs gueules ruisselaient du sang du malheureux.
Le Comte, hurlant de colère et de haine, se lança à la poursuite de la meute, pointant son redoutable épieu sur la louve blanche. Il réussit ainsi à l’isoler de ses loups et, vociférant toujours, il parvint même à l’acculer au fond du ravin. Là, il descendit promptement de cheval et courut sur la bête. La louve lui fit résolument face, se jeta sur lui, cherchant à ouvrir la gorge, et il eut le temps, dans un geste de survie, de faire tournoyer sa hache dans l’air et de la rabattre, coupant tout net une patte avant de l’animal.
La louve poussa un long, un très long cri de douleur, sauvage, horrible, qu’amplifia encore l’écho des parois rocheuses du ravin. D’un bond prodigieux, elle réussit cependant à contourner son adversaire et à regagner, toujours rapide malgré sa patte atrophiée d’où pendaient des lambeaux de chair meurtrie, l’autre bout du ravin, où elle disparut dans l’épaisseur des halliers.
Mais le Comte ne la suivit même pas des yeux, épouvanté. Il avait reconnu ce cri, cette voix enflammée par la haine et la douleur et quand il se pencha pour ramasser la patte de l’animal, il vit une main de femme qui gisait là sur la neige ; une main avec, à l’annulaire gauche, la bague aux armes de Clovis.
En proie à une terreur démentielle, Géraud de Toufou fonça vers le château, hurla qu’on ouvrît les portes, sauta de son cheval encore lancé au grand galop, s’engouffra dans les escaliers du donjon, monta en courant jusqu’à la chambre de son épouse et défonça la porte...
La princesse aux longs cheveux noirs était couchée sur ses oreillers et son bras gauche, amputée de sa main, pendait lamentablement dans le vide, dégoulinant de sang.
Le Comte brandit très haut son épée et, avant qu’il ne lui plonge dans le cœur en poussant un hurlement monstrueux, il entendit la Princesse murmurer :
- Oui, Tue ! Tue-moi ! La vie n’a plus aucun parfum pour moi si je ne puis plus courir la campagne à la tête de mes grands loups gris !
Lorsque les gens du château accoururent, effrayés par les cris du Comte, ils trouvèrent, étendu sur la couche ensanglantée de la Princesse, le cadavre de la grande louve blanche.
Géraud de Toufou interdit sous peine de mort qu’on parlât désormais de sa princesse. Il fit fermer les portes du château, ne reçut plus aucune visite, cessa de complètement s’alimenter, congédia enfin tous ses domestiques, tous ses gardes et tous ses soldats et mourut quelques mois plus tard, terrassé par la folie, la solitude et le chagrin.
13:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.01.2012
Donne-moi plutôt ta main...
En janvier 2010, la température chuta jusqu'à - 33 degrés. Dans ma maison, toutes les tuyauteries avaient sauté. Nous nous étions repliés à l'hôtel, où j'étais, comble de malchance, tombé malade. La fièvre.

Son geste est las et mécanique. Sa cotte de travail verte est foncée. Son bonnet de laine est saupoudré de blanc, ses sourcils ombrageux, ses yeux sombres, les yeux du travailleur des petits matins.
C'est l'heure de ma première clope. L'heure de dire bonjour au ciel.
De translucide, aigu, inexistant qu'il était presque sous moins trente degrés, il est devenu épais sous moins vingt degrés et la neige tombe, tombe, en plumes glacées sur la ville.
Les fumées de charbon se mêlent aux flocons, le blanc contre le noir.
L'homme balaie pour que les messieurs-dames de l'hôtel puissent sortir bientôt sans risquer de glisser et sans trop maculer leurs belles chaussures.
Je le salue.
Il me salue aussi. Mais de loin, sans sourire, sans civilité excessive inscrite sur son visage. Distant.
Je regarde son geste las et mécanique. Je secoue la tête. J'écrase ma cigarette.
Je suis un de ces messieurs pour lesquels il balaie dans le froid gris d'un matin gris d'un hiver des plus gris et des plus redoutables.
Il y a entre cet homme et moi une zone profonde, un no man's land, un océan de préjugés bien plus infranchissable que la langue et ses sonorités contraires.
Une fausse zone, comme toutes les zones qui séparent le regard des hommes.
Ces zones-là sont des alibis pour les feignants du cœur et les menteurs de partout.
Car lui, le balayeur à la cotte verte, le balayeur taciturne, il a dormi chez lui, dans son lit. Ce matin il a fait le feu, il a regardé les flammes danser et il a entendu se fendre le bois sous la chaleur épaisse. Il a bu un café fumant et dégusté des toasts grillés. Sa confiture, rouge, pourpre, sentait bon les fruits de son jardin enfui...
Moi, je suis échoué ici, comme une algue marine sur l'ocre des plages. Réfugié. J'ai quitté mon navire assiégé par des couteaux glacés.
Je regarde le ciel qui se déplume.
Le mauvais sort n'est pas du côté que donnent les apparences sociales, tant les hommes aux hommes sont devenus étrangers .
J'ai souri à celui qui balayait les marches de l'hôtel.
J'eusse aimé lui dire que pour moi, ça n'était pas la peine. Que j'avais déjà glissé et que la neige sur les marches, les culbutes et les chutes, ne me faisaient plus peur depuis longtemps.
Que son geste las et mécanique n'était pas pour moi.
Dans le hall de l'hôtel, j'ai regardé tout un moment une grande et vieille image sous verre, qui trônait là sur le mur. L'équipe de foot polonaise, médaille d'argent de la coupe du monde 1974.
Je me suis demandé ce que je faisais en 1974 et j'ai vu que j'avais alors les mêmes espoirs qu'aujourd'hui. Que les hommes se serrent fraternellement les mains.
Il n'y a pas d'âge pour être idiot. Les utopies ont la peau dure.
Et, lui, le balayeur pour pas que je glisse, moi, un monsieur qui sommeille dans les hôtels, qu'est-ce qu'il faisait, en 1974 ?
Où en est-il de ses espoirs et de ses défaites ?
Il neige sur les fumées du charbon... Le blanc contre le noir...
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.01.2012
Les fourches caudines de nos existences - Echo à Stéphane Beau -
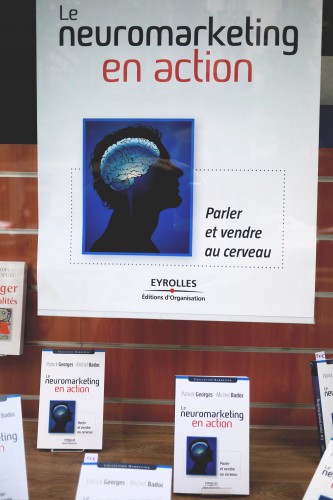
Stéphane :
"Je travaille tous les jours avec des hommes et des femmes qui vivent avec trois fois rien. Un couple et un enfant avec 700 € par mois, par exemple. Quasi rien pour bouffer sans l'aide des restos du cœur ou des colis alimentaires, une fois toutes les charges déduites. Et pourtant, ces familles là dépensent assez régulièrement entre 80 et 100 € de téléphonie (internet, deux ou trois portables...) par mois. Parfois même ils payent encore des forfaits pour des téléphones qu'ils ne possèdent plus depuis plusieurs mois. J'en rencontre même de plus en plus souvent qui ne peuvent plus payer leurs factures d'eau ou d'électricité tant ils dépensent dans ce poste budgétaire. Je ne critique pas : ils sont pris dans un système qu'ils ne contrôlent pas plus que nous, prisonniers comme nous de cette illusion de communication libre qui nous enveloppe tous. Mais si on leur disait demain : "au lieu de dépenser tant de fric dans ces dépenses virtuelles, pourquoi ne le dépenseriez vous pas en achetant une demi-douzaine de livres ou de disques par mois", ils crieraient tous au fou ! Au gaspillage !
Quand je dis que tout cela n'est pas gratuit, c'est aussi à eux que je pense. Et quand je lis ta citation joliment revisitée de Debord, c'est encore à eux que je songe et à qui profite le crime de cette soumission totale aux dieux de l'internet et de la téléphonie.
Quand je vois qu'aujourd'hui la campagne électorale des prochaines présidentielles se joue pour une part sur Twitter et pour l'autre part sur les ordinateurs qui gèrent le cours des bourses je me dis que j'ai peut-être un début de réponse..."
Mézigue
"Ton témoignage-commentaire m’est cher. Pour beaucoup de choses.
D’abord parce que je connais tes convictions et qu'elles sont, si je puis ainsi dire en péchant par raccourci, en adéquation avec ton salariat.
Car parler de la misère sans ne l’avoir jamais vu pointer le bout de son nez à sa propre fenêtre, c’est un peu comme parler de la merde sans jamais n’en avoir respiré l’odeur, avoir peur du loup en sachant bien que nos jarrets ne seront plus jamais à la portée de leurs crocs. Dans cet esprit-là, je me demande souvent, très souvent, d’où parlent tous ces gens qui écrivent de-ci de-là, quand je lis les témoignages et les révoltes par le verbe et les prises de positions critiques, pour sympathiques que tout cela puisse paraître.
Tu dis ces pauvres hères perdus dans la forêt des consommations insensées et tu dis leur désarroi à ne plus retrouver le chemin vers eux-mêmes et vers les autres. Vers la priorité humaine. Le drame de ce début de siècle, et de la fin du précédent, est là.
Là seulement.
La victoire de l’apparence sur l’essentiel est absolument totale et si j’ai cité Debord, c’est que le propos de La Société du spectacle (Buchet/Chastel 1967) n’était autre, pas plus que n’était autre le propos du Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations (Gallimard 1967) de Vaneigem.
Mais pour méritoires qu'aient été ces deux livres, pour grande qu'ait été leur intelligence à démontrer au monde la véritable identité du monde, cela n’a servi strictement à rien.
De Vaneigem, je citerai une phrase phare : Refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de crever d’ennui. Il s’agissait donc de la critique de la misère intellectuelle, morale et sexuelle, misère de plus en plus prégnante au fur et à mesure que la richesse matérielle - l’absence de pauvreté miséreuse plutôt - se «démocratisait», en rupture avec les misères du XIXe et de la première moitié du XXe.
Les choses sont allées depuis de pire en pire, la dictature du spectacle - entendu comme la colonisation de tous les aspects quotidiens de la vie par les apparences et l’image - a peaufiné son assise au point que misère intellectuelle et misère matérielle n’en ont bientôt plus fait qu’une, MAIS, ceci sans abandonner, et même en la renforçant, l’illusion de pouvoir se procurer les biens les plus sophistiqués de la société marchande, parmi lesquels internet, téléphone portable multifonctionnel, télé multichaînes etc…
Du pouvoir d’achat ou de l’achat d’un peu de pouvoir ? Telle est la question que Capital et Finances ont posé à la chaumière, laquelle chaumière a consenti à se vider de sa substance historique et humaine pour goûter aux friandises du grand râtelier. Elle s’y est goinfrée sans retenue et jusqu'à l'empoisonnement. C'est bien fait ! C'est là le lot de tous ceux qui vendent leur âme au diable.
Vaneigem devrait donc reformuler aujourd’hui : Refuser un monde où la certitude de ne pas crever tout à fait de faim, s’échange contre la promesse de se procurer les instruments nécessaires à l’illusion de ne pas crever d’ennui.
Parce qu'il n'y a chez les hommes que deux motivations pour qu'ils se mettent en devoir d'étrangler les puissants et pour qu'ils se décident à brûler les châteaux : la faim et l'ennui. Avec deux miettes de pain pour l'estomac et des amuse-gueule pour contourner l'ennui, le tour est joué ! Les puissants peuvent dîner au champagne et sauter toutes les putes de la terre, tranquilles.
Je dirai alors que tous ces dits instruments de communication sont arrivés comme les chiens de garde chargés d’entraver les hommes, s’il leur prenait tout à coup fantaisie de rétablir entre eux une véritable communication. C’est par la réification de la communication que le système a asservi les citoyens à sa cause et nous sommes, comme les gens que tu cites, partie prenante dans cette réification. Nous avons abandonné la priorité de communiquer, laquelle n’est pas aisée car mettant en scène et en péril, pour pris de la véritable joie, tout le substantifique humain. Nous avons abandonné tout ça pour l’illusion de la communication tenant lieu de véritable communication. Une communication qui ne mange pas de tripes mais se nourrit de bavardages inoffensifs, d'indignation superficielle, quelles que soient les dents que "font montre de montrer" ces bavardages.
Résultat : hommes séparés d’eux-mêmes, séparés de la condition humaine et marchandises au top niveau… Ah, faites-nous encore rigoler, chiens puissants des organigrammes sociaux, misérables politiques et syndicalistes à la ramasse avec votre crise ! La crise, Stéphane, c’est comme si tu avais un voisin ennemi, une ordure finie, qu’il y aurait le feu chez lui et qu’il te demanderait de te jeter dans les flammes pour sauver son or. Si le populo pouvait comprendre que ça n’est pas là son affaire et qu’il serait bien mieux inspiré d’achever la bête, de lui plonger la tête sous l’eau jusqu'à ce que mort s'ensuive plutôt que de négocier sa survie, on aurait une chance de revoir briller le soleil. Mais ce n’est pas demain la veille ! En tout cas, si une telle prise de conscience venait enfin à bouleverser le monde, nous serions toi et moi - et bien que tu aies la chance d’être nettement plus jeune, (disons moins vieux) que moi - crevés depuis longtemps. Alors…
J’ai, comme toi, connu des gens capables de balancer tout leur RMI dans des billets de loto. J’ai connu, voire aimé, des voyous capables de risquer cinq ans de taule, pour détourner des trucs inutiles, farfelus, n’ayant d’autre utilité qu’un ridicule message social d’intégration au grand bazar. J’ai moi-même, à une époque où je ne vivais que d’expédients et d’autres choses, été capable de tout balancer dans le pinard et l’ivresse plutôt que de chercher à me refaire «une santé sociale». Plus tu es pauvre, Stéphane, plus tu es acheteur d’illusions. Normal. Plus tu es pauvre, plus tu as besoin de téléphone portable, d’internet, de télé, parce que plus tu es pauvre, plus tu es seul, plus, donc, tu as besoin des instruments qui mettent socialement en place l’illusion de ne pas l’être.
Et plus tu es nul, plus tu es incapable de faire une œuvre conséquente, puissante, originale, révolutionnaire, de sang et de chair, qui arracherait les tripes par sa beauté, mettrait en pleine lumière la désastreuse nudité du monde en même temps que l’immense potentiel humain retenu prisonnier - c’est grave pour nous tous ce que je dis là, mais tant pis ! - plus tu as besoin d’écrire en public, de dire, de rabâcher, de faire voir que tu es sensible, de niaiser, de faire le beau, d'émettre des vérités à quatre sous, de faire celui qui comprend, qui, qui et qui.
Bref, moins tu es homme, plus tu as besoin d’être bouffon !
Cette nullité scribouillarde qu‘on voit s’étaler partout sur les blogs et les sites, même sur ceux qui se croient très intelligents et peut-être même sur ceux-là d'abord, ces poèmes à la mords-moi l'noeud, ces pages d'une littérature contemporaine qui n'a de contemporain que ses propres efforts à ne pas se montrer archaïque, c’est simplement l’humanité qu’on nous a volée en nous "vendant gratuitement" un champ d’expression afin que se tue, chaque jour un peu plus, l’expression elle-même.
Tout comme on a volé la dignité de vivre à ces pauvres hères désemparés que tu vois tous les jours, sorte de Lumpen sacrifié aux intérêts sordides d'un monde qui, du point de vue de la richesse humaine, ne vaut pas l'allumette qui le réduirait en cendres.
Bien à Toi. "
Image : Philip Seelen
14:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.01.2012
Pour compléter le texte précédent
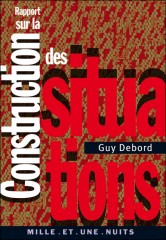
Guy Debord écrivait dans son Rapport sur la construction des situations :
" Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises."
Et moué je dis tout bonnement :
"Les hommes restés un tant soit peu intelligents, quand une structure de la société marchande leur offre des services gratuits, devraient d'abord se demander ce qu'on attend d'eux."
14:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Les filles de joie du verbe

Dans ces milliers de frémissements - auxquels je participe - d'insectes nerveux pris au piège, on entend toutes les musiques, tous les genres et toutes les générations. Des misères quotidiennes, des poissons rouges, des alouettes, des mères au foyer, des vieillards, de jeunes pubères, des imbéciles en mal de philosophie, des élucubrations, des fantasmes, des textes qui veulent être de la littérature, des frustrations, des érudits de la critique, des champions de la subversion, des partisans du système coercitif et financier, des pauètes…
On ne peut décemment tout identifier. C’est le grand bazar, la foire, le zouk, la planète au verbe multiple, entremêlé ! Le champ d’expression libre et c’est...gratuit !
Gratuit ! C’est en cela que réside le génie de l’idée ! On écrit gratuitement, on est publié dans les vingt secondes et, en plus, tout le monde lit gratuitement, publie son avis, se met en colère, critique, cite, congratule, renvoie à et etc. La révolution achevée…
Viva l’anarchia !
Sauf que, quand même, on est en droit de s’étonner que dans un monde de merde pataugeant dans la dictature économique et financière, dans un monde où les âmes et les sensibilités en sont réduites à ne plus guère réagir qu'aux cliquetis des tiroirs-caisses, on trouve, comme ça, des oasis rafraîchissantes, à l’abri de toute aliénation marchande.
On voit alors, si on se pose une ou deux questions, que les blogs ne sont que les putains abusées, inconscientes, d’un système bien en place.
Bon. Pourquoi pas ? Il n’y a pas de sot métier, il n’est que de sottes gens ! Mais alors, déclinons notre identité véritable, ne faisons pas, lecteurs comme blogueurs, croire au mensonge que nous entretenons…Cessons de faire, par notre parole lustrée, les beaux ! Modestie, modestie, profil bas…
La gratuité, je suis pour, absolument pour…Pour tout le monde. Mais…
Voici ce qu’en disait Stéphane Beau dans un commentaire :
« Je crois qu’il y a là encore une illusion d’optique très trompeuse et un partage des richesses très discutable. Car contrairement à ce que tu écris, nos blogs ne sont pas gratuits, ils sont payants. Sauf que les sous ne tombent pas dans nos poches, mais dans celles des fournisseurs d’accès à internet, dans celles des sites d’hébergement, dans celles des fabricants de logiciels, dans celles des fabricants de matériel informatique, dans celles de ces grosses boîtes qui font que, maintenant, plus rien ne fonctionne chez toi (télé, téléphone, internet... à quand l’électricité et le gaz ?) si elles décident de te stopper la fourniture...
Pour accéder (entre autres) à ton blog tous les jours, je dois dépenser (si on fait une moyenne de tous les coûts cités plus haut) 30 ou 40 € par mois... Et ouais... A multiplier par le nombre d’internautes, ça fait combien de milliards ?... Mais qui fait vivre le web sinon ceux qui alimentent les blogs et les sites ? Si demain tous les blogueurs et tous ceux qui ont un site (et qui payent même, parfois, en plus, pour avoir un nom de domaine ou une formule un peu plus fonctionnelle) décident de faire grève et de retirer toutes leurs billes, ils deviendront quoi tous ces fournisseurs d’accès, tous ces fabricants de micro, tous ces magouilleurs de mp3, de ebooks ou de divX ? Tu ne crois pas qu’il y a des droits d’auteurs (et des baffes) qui se perdent, là aussi ?
L’idée de la gratuité d’internet est une grossière et scandaleuse illusion ! »
09:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.01.2012
Adieu camarade !

Nous avions bien ri quand il eut des velléités de se faire installer internet. Avant l’eau courante. Question de priorité dans un monde qui n’en a plus. Monde inconnu des puissants, monde des humbles et qui de leur simplicité, qu'ils ignorent en tant que telle, font littérature. Comme les paysages. Simplicité qui n'est simple que par l'orgueil de notre complexité surperfétatoire. Monde que j’aime, décalé. Sans prétention, que celle d'exister un moment. Monde dont la marche frontalière est en soi une violente diatribe.
Il m’avait raconté les loups. De son enfance. Il parlait comme mon grand-père alors qu'il avait six ans de moins que le petit fils. Sauf que ses loups, à lui, de vrais loups, c’était l’été qu'ils hurlaient. Dans un pays recouvert de neige trois ou quatre mois par an. Il brisait ainsi l’image éternelle que je portais dans ma tête.
Il m’avait beaucoup aidé quand j’avais tout démoli de ma maison et qu’il avait bien fallu reconstruire, ciment au sol, plafond, plancher, cloisons, et tutti quanti. Il m'avait porté du bois aussi, sans que je lui demande, pour que je me chauffe. Mon Auvergnat en Pologne. Main tendue du pauvre.
Après, il s’en était retourné à ses lisières, soigner ses quatre ou cinq cochons et planter ou ensemencer ces trois ou quatre hectares de terre sablonneuse. Il m’avait laissé faire les finitions. Les finitions…Depuis l’été dernier, je le savais, il en était aux siennes. Jest na wykończeniu.
Il neigeait. Il neigeait très fort, une neige oblique et puissante, balayée par les souffles du nord, samedi, quand je l’ai accompagné jusqu’au trou final. L’ouverture du paradis pour lui, les portes d’une absurde métamorphose pour moi.
Il neigeait. Il faisait froid et si triste ! Les gens courbaient l’échine sous l’intempérie et leurs dos accablés, devant moi, se saupoudraient de blanc, la neige accrochée aux poils de leurs lourdes pelisses.
La terre s’est refermée et sur le monticule se sont amassés les flocons. Je fus décontenancé, une nouvelle fois, par la simplicité du terrible rendez-vous qui sous-tend pourtant tous les autres. Leur donne un sens.
La terre n’est qu’une parenthèse entre zéro et zéro.
Adieu camarade ! Et puisque, toi, tu croyais en lui :
Qu'on te conduise à travers ciel,
Au père éternel !
Illustration : mon village, samedi..
12:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.01.2012
Une légende du Poitou
LA FÉE MÉLUSINE
 Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait sa chaumière.
Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait sa chaumière.
Ainsi, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, villages et hameaux, aujourd’hui séparés entre eux par les terres et les routes, étaient-ils reliés, comme partout ailleurs, par les sentiers de la forêt ancestrale. Toute cette province et tous ces grands espaces forestiers appartenaient en ce temps-là au seul Comte de Poitiers, seigneur passionné de chasse et, en même temps, seigneur érudit, gourmand des livres de la science qu’il dévorait en latin ou en grec, et, principalement, ceux qui traitaient de l’astrologie. Il savait, du moins sa cour le prétendait-elle, lire la course des étoiles. Pris d’une affection toute filiale pour son neveu Raymondin, jeune homme vigoureux et d’une superbe tenue, il lui dispensait tous les rudiments de son savoir et, partout, l’emmenait avec lui, quand il lui prenait fantaisie de forcer le cerf, le loup ou le renard dans les vastes forêts de son domaine.
C’est à cette époque que vivait également, aux lisières des futaies, une dame de sang bleu, du nom de Pressine ; une dame redoutée de toute la province et même au-delà, car elle était douée de pouvoirs capables de distribuer autant le bien que le mal. Elle avait trois filles d’une beauté hors du commun, qu’elle élevait seule et auxquelles chaque jour elle répétait:
- Votre père vit loin de nous parce qu’il a trahi sa parole et bafoué les lois sacrées du mariage. Ainsi, mes filles, pour ne pas suivre son déshonorant chemin, faites en sorte que dans votre vie, toujours vous restiez fidèles à la moindre parole que vous aurez donnée.
Ce discours ne manqua pas d’impressionner beaucoup les jeunes filles à la fleur de l’âge, qui fomentèrent bientôt le dessein de se venger de ce père ingrat qui les avait abandonnées pour suivre son plaisir. Elles se rendirent donc chez lui, à une dizaine de lieux de là, se firent introduire sous de fausses apparences et le rouèrent de violents coups de bâtons.
Leur mère entra en un vif courroux quand elles lui racontèrent leur expédition punitive.
- Qu’avez-vous donc fait, malheureuses créatures ? s’écria-t-elle. Suivant les lois immuables du ciel et de la terre, jamais un enfant, au risque d’être maudit pour l’éternité, ne doit porter une main vengeresse sur l’auteur de ses jours !
Et les trois filles subirent aussitôt la malédiction maternelle. L’aînée fut confiée à la garde d’un abominable géant, dans une forteresse humide et sombre des Carpates, la puînée dut couver un œuf d’aigle et toute sa vie durant nourrir l’insatiable aiglon, la benjamine, quant à elle…
Sur ces entrefaites-là, le grand veneur du Comte de Poitiers vint un beau jour avertir son maître qu’un redoutable sanglier, un vieux mâle épais, aux cruelles défenses, imposait sa loi parmi ses congénères et y semait la terreur. Le Comte de Poitiers fit donc sonner le rassemblement et, entouré de sa cour et de ses chevaliers en armes, se déplaça jusqu’à Coulombiers. Bientôt les piqueurs et les chiens débusquèrent en effet le vieux solitaire de sa bauge et les chasseurs, le Comte et son neveu en tête, donnèrent la charge à grands cris. Mais la bête était si violente qu’elle éventra bientôt les chiens, évita les pieux et finit par disparaître à vive allure dans les halliers profonds de la forêt.
- Ce n’est tout de même pas un fils de truie qui va ainsi nous tenir la dragée haute ! s’écria le Comte, hors de lui et en s’élançant à la poursuite de l’animal sauvage.
Le train était cependant si vif que seul parvint à le suivre son neveu, tandis que tous les autres chasseurs se trouvaient distancés, empêtrés dans les fourrés épais et les breuils. Les deux hommes pourchassèrent ainsi le sanglier tout le jour, le repérant ici, le harcelant là, tentant de l’acculer plus loin, mais rien n’y fit. Les chevaux écumaient, étaient fourbus et la nuit tombait, quand ils se résolurent à mettre pied à terre et à bivouaquer autour d’un grand feu de bois mort. Ils étaient au plus profond de la forêt, sans même savoir où exactement. Le comte se retira donc dans les sous-bois, hors du halo de lumière que faisaient danser autour d’eux les flammes, pour se repérer aux étoiles du firmament.
Il revint bientôt, l’air accablé, tant que son neveu s’en alarma.
- Mon, oncle qu’avez-vous ? Sommes-nous donc à ce point égarés que vous ayez si triste mine ?
- Non, mon neveu, nous ne sommes pas perdus, nous avons seulement beaucoup bifurqué vers le nord-ouest, mais j’ai lu dans les astres scintillants, une bien étrange chose. Il est écrit là-haut que celui qui tuera bientôt son Seigneur aura un destin hors du commun, parsemé de gloire et de richesses.
- Oh, mon oncle, l’homme capable d’accomplir un tel forfait ne mériterait rien d’autre que l’enfer et la damnation éternelle !
Mais comme ils étaient là à palabrer devant le feu, les broussailles autour d’eux se mirent soudain à frémir, s’écartèrent brutalement, et l’énorme sanglier, sans doute intrigué par ce feu qui trouait l’épaisseur de la nuit, apparut en pleine lumière.
Le comte se rua sur lui, son grand couteau de chasse prêt à le mortellement frapper. La bête esquiva le coup et fit rouler le chasseur par terre d’une violente charge dans les jambes. Elle allait se ruer sur lui et lui labourer le ventre de ses féroces défenses, déjà elle était dessus lui, quand Raymondin brandit son épée et voulut le transpercer. Mais l’animal esquiva encore le coup d’une roulade et l’épée du jeune homme alla se planter dans le corps de son oncle, le traversant de part en part. Raymondin hurla de douleur. Il tomba à genoux près du gisant et se tint la tête dans les mains, pleurant toutes les larmes de son corps. Le Comte, quant à lui, vidé de son sang, agonisant déjà sur les mousses de la forêt, eut le temps de murmurer, avant de rendre son âme à dieu :
- Les étoiles, Raymondin…Le destin… Accomplis le destin inscrit sur les étoiles…
Au comble du désespoir, le jeune homme enfourcha sa monture et longtemps galopa à travers la forêt, cherchant une issue. Il sauta des fossés, enjamba des broussailles, pénétra des halliers et cent fois se cogna le front aux branches les plus basses des arbres. Enfin, n’en pouvant plus, son cheval se mit à marcher et Raymondin le laissa faire, perdu dans ses pensées et ses remords. Il ne revint à lui que lorsqu’il sentit l’animal tirer fortement sur les rênes en baissant l’encolure pour s’abreuver à un ruisselet qui sourdait à la base d’une énorme roche. Raymondin s’extirpa de sa rêverie et regarda autour de lui : le ruisselet s’épanchait plus loin en une nappe d’eau prisonnière d’un amas de rochers ; une eau claire, où se miraient déjà les premières et pâles velléités de l’aube.
Il écarquilla les yeux, croyant être en proie aux hallucinations de sa souffrance : une jeune fille, très grande, nue, les cheveux ruisselant jusqu’au creux de ses reins, se baignait, fredonnait et dansait en tournant en rond, le visage levé vers le ciel. Elle vit Raymondin et, sans cesser de tournoyer et de fredonner, vint à lui, l’eau de la fontaine aspergeant autour d’elle des cascades limpides :
- Raymondin, dit-elle, je sais ton malheur et je sais ton inconsolable chagrin. Tu viens de tuer bien malgré toi ton oncle et seigneur adoré…Les pas de ton cheval l‘ont ensuite guidé jusqu’ici, jusqu’à cette fontaine que l’on nomme dans tout le Poitou, la Font d’la sé, la fontaine de la soif. Je t’attendais, Raymondin, pour que s’accomplisse le destin que lut ton seigneur sur la course des étoiles. Je ferai de toi l’homme le plus riche, le plus puissant et le plus heureux de tout le royaume de France, mais il faudra auparavant m’épouser et me faire un indéfectible serment, Raymondin.
Subjugué, dans un état encore second, se souvenant aussi des dernières paroles de son oncle, le jeune homme murmura seulement :
- Je veux bien, Princesse. Que me faudra t-il jurer ?
- Il te faut jurer maintenant, en levant la main et en la portant ensuite sur ton cœur que, lorsque nous serons mariés, jamais au grand jamais tu ne chercheras à me voir le samedi et, où que j’aille ce jour-là, tu ne chercheras à me suivre.
- Je le jure, dit Raymondin. Sois ma femme, console-moi de tous mes maux et de toute ma tristesse, et je jure devant dieu que jamais je ne chercherai à trahir mon serment.
Et Raymondin, sur les indications de la belle jeune fille, retrouva l’allée qui mène à Coulombiers, puis celle qui conduit à Poitiers, où il arriva bientôt et déclara que son oncle bien aimé s’était égaré lors de la poursuite du sanglier fabuleux et qu’il ne l’avait jamais retrouvé. Il pleura, sa peine était sincère, on le crut. On alluma des cierges immenses et tout le jour on pria pour le salut de l’âme du bon comte de Poitiers, disparu en donnant la chasse à un sanglier sorti des enfers.
Raymondin cependant brûlait de revoir la céleste jeune fille de la fontaine. Il y retourna donc et manqua de tomber alors de stupéfaction. Il n’y avait plus la roche d’où s’échappait une source, mais il y avait là une chapelle dorée d’où sortait une tendre musique. La demoiselle en sortit bientôt, toute vêtue de blanc, elle prit Raymondin par la main, le conduisit à l’intérieur où tous les deux, devant un vieux prêtre à la barbe si longue qu’elle balayait les objets sacrés de l’autel, s’agenouillèrent. Le saint homme les bénit et les maria, après que Raymondin eut sur la croix renouvelé son serment déjà fait à sa magnifique épouse.
Alors, heureux et légers comme le sont toujours tous les jeunes mariés de la terre, ils s’en revinrent à Poitiers dans un carrosse resplendissant tiré par quatre forts chevaux. Ils vinrent en premier lieu saluer le successeur du Comte, fils du précédent et cousin de Raymondin, pour lui faire allégeance.
- Cousin et cher Comte, lui dit le jeune homme, répétant en cela le discours que lui avait préalablement prié de dire sa jeune femme, voici mon épouse…Vois comme elle est belle et vois comme elle est jeune ! Etre riche d’elle, me suffit, mon cousin, alors je ne demande pour m’établir sur tes terres que la Font d’la sé et, autour d’elle, un territoire si petit qu’une seule peau de cerf serait capable de le recouvrir.
-Tu es bien modeste, mon cousin ! Ta bonté et ta loyauté méritaient assurément bien plus que cela. Mais puisque tel est ton désir, va, Raymondin, ton étrange demande est accordée.
Mais la jeune et belle dame de la fontaine entreprit alors la nuit suivante de découper la peau d’un cerf en fines, très fines lanières, aussi fines que les fils de la toile que tisse une araignée. Elle les mit ensuite soigneusement bout à bout, de telle sorte que le territoire ainsi encerclé fut immense, englobant des forêts, des prairies, des villages, des vallons, des rivières, des champs et des villes. Le Comte de Poitiers ressentit bien là comme une tromperie, mais comme il était un homme d’honneur et de parole, il accorda ces territoires à son cousin et enjoignit à ses tabellions et à ses commissaires d’enregistrer dûment les édits de propriété.
Aussitôt, un château superbe, avec ses donjons, ses tours, ses remparts et ses parcs, fut élevé au beau milieu de ce territoire. En une nuit seulement. Raymondin s’interrogea. Mais d’où vient tout cela ? Et sa belle épouse lui répondit en riant. Bientôt, lui dit-elle, je couvrirai toute la province de châteaux, de villes, d’églises et de places fortes. Il me suffira d’avoir une bouteille d’eau et trois tabliers.
- Mais comment ? s’inquiéta encore Raymondin. Et le même rire, gai, léger, cristallin, lui fut donné en guise de réponse.
Le château de Raymondin et de sa femme est élevé sur une colline déboisée. Raymondin, oubliant ses questions, fou de bonheur au milieu de ses richesses, de ses soldats, de ses gens, de ses serviteurs, voulut lui donner un nom mémorable, que retiendrait l’histoire.
- Ce sera le château de Lusinème, car il y a dans ce nom toutes les lettres éparpillées de mon prénom, lui déclara sa femme, toujours gaie, toujours rieuse.
En une nuit cependant, une ville sortit de terre tout autour du château, une ville avec ses places, ses étals, ses rues, ses maisons, ses marchés, ses églises et ses habitants joyeux qui choisirent de la nommer Lusinème, en hommage au château des maîtres des lieux. Mais comme ils parlaient vite, fort, tous à la fois et de sourde façon, on entendit et on transmit Lusignan.
Si vous passez par là, par Lusignan, vous apercevrez encore, sur la colline, les restes du donjon que le temps a effrité et puis, si vous êtes curieux, si cette histoire vous a plu, vous approcherez encore, vous écarterez la broussaille et les ronces, et vous verrez à vos pieds s’ouvrir un souterrain.
Mais les prodiges ne s’arrêtèrent pas à Lusignan... Comme promis, la belle Lusinème - c’est ainsi que la nommait Raymondin en son cœur, faute de n’avoir su mettre les lettres dans un autre ordre, - sema en toute la région, villes, palais et monuments. A Melle, à Vouvant, à Mervant, à Taillebourg, à Fontenay, à Soubise, à Brouage, à Surgères, à Mirbeau…partout. Et puis, sur les rives de la Sèvre niortaise, un peu plus loin que Lusignan en partant sur l’océan, elle éleva une ville avec des tours, des châteaux, des hôtels, des promenades. C’est aujourd’hui Saint-Maixent et c’est l’œuvre de Lusinème.
Survolant bientôt la Vendée, elle construisit encore une abbaye majestueuse, à Maillezais…Et Raymondin, émerveillé, se disait toujours, mais comment fait-elle ? Comment ma femme, mon adorée, si frêle, si délicate et si fragile, construit-elle tous ces trésors aux charpentes si lourdes et aux pierres si volumineuses ?
Mais ces questions étaient vite occultées par son bonheur, d’abord, mais aussi par une autre interrogation, qui le plongea bientôt dans de sévères et douloureuses inquiétudes.
Sa jeune femme lui donnait en effet régulièrement un fils. Elle lui en offrit dix au total. Mais tous, hélas, souffraient d’une horrible malformation. Ils étaient laids, ils étaient même hideux, repoussants. Le premier, Guy, n’avait qu’un œil. Le second, Urian, possédait bien ses deux yeux mais ils n’étaient pas placés au même niveau, ce qui lui donnait l’air sauvage de la démence. Odon avait des mains très fines, presque transparentes et couvertes d’écailles rugueuses et froides, Raymond disparaissait sous une épaisse fourrure de poils hirsutes, tel un ours, Geoffroy, le plus terrifiant, le plus brutal, le plus fort, anormalement fort, avait une défense de sanglier qui lui sortait de la bouche en lui déchirant les lèvres, et il écumait et il vociférait sans cesse. Thierry n’avait pas d’oreilles, seulement deux larges trous en lieu et place, Froimond était chauve et sa face était ronde, rouge, large, avec des yeux énormes, sans rétine, et qui semblaient lui sortir de la tête. Regnault, chétif, n’avait qu’une jambe et il sautillait comme un passereau, Antoine avait des griffes de lion, acérées et longues de plus dix centimètres à chaque doigt de pieds. Le dernier, enfin, était tellement difforme, tellement bossu, sans bras, sans nez, sans yeux, qu’on le tua au berceau.
Toutes ces monstruosités effrayaient leur père et le plongeaient dans un profond désarroi, surtout celles de Geoffroy, méchant, violent, et qui, malgré tout, était le fils préféré de la belle et douce Lusinème. Raymondin, lui, se consolait avec Regnault, l’unijambiste. Celui-là était d’un caractère doux, rêveur, attendri. Il voulait, dit-il à son père, se faire moine à l’abbaye de Maillezais, s’y retirer et étudier les livres.
Tous les autres garçons, en dépit de leurs atroces infirmités, épousèrent la carrière militaire et s’y couvrirent de gloire et de lauriers. Quand Geoffroy cependant apprit la vocation de son frère Regnault, il entra dans une colère terrifiante, frappa et hurla que dans une famille de guerriers, un moine était une honte. Revenu précipitamment d’une campagne militaire, il fonça donc à toute allure sur Maillezais, seul, il y étrangla tous les moines, supplicia son frère et mit le feu à l’abbaye.
Raymondin fut au désespoir. Son fils préféré, tué par le plus horrible et le plus taré de sa descendance ! Il voulut exiger que sa femme répudie ce monstre, qu’elle le chasse sur-le-champ. Et il se mit à la chercher partout, dans les cours, les donjons, les tours, les chambres…Il ne la trouva point. Il l’appela, elle ne répondit point. Alors, il se souvint soudain qu’on était un samedi et il se souvint en même temps de son serment, deux fois donné…Mais la peine était trop grande, le chagrin trop lourd, il s’engouffrait déjà dans le souterrain du donjon, où il lui semblait avoir perçu une voix : une voix qu’il avait cru reconnaître comme étant celle qui avait fredonné, jadis, la mélodie de la Font d’la sé.
Il marchait maintenant à pas de loup…Une faible lumière vacillait, là-bas, dans le noir lointain. Il approcha et il vit, horrifié : sa femme était nue, plongée dans une sorte de fontaine souterraine…Elle était nue, ses seins resplendissaient et se dressaient, sa taille était fine et, juste après cette taille…Raymondin poussa un cri de douleur. Après cette taille, ce n’était plus une femme mais un serpent, avec une longue, une très longue queue qui fouettait avec violence et furie l’eau de la fontaine.
- Horreur ! Une fée ! s’écria Raymondin. J’ai épousé une fée !
- Lâche ! hurla Lusinème, tu viens de trahir ton serment ! Sois maudit à jamais autant que je le suis et, soulevant la terre, la faisant craquer et jaillir en l’air en même temps que les pierres des remparts et du donjon, elle s’envola dans les airs, sa longue queue d’écailles ondulant derrière elle. Alors un hurlement, une plainte épouvantable, démentielle, d’un désespoir sans nom, déchira les airs, plana longtemps au-dessus des villes et des forêts. On l’entendit, épouvanté, de Poitiers jusqu’à La Rochelle.
Car telle avait été la malédiction maternelle portée sur Mélusine, la benjamine de la fée Pressine. Malédiction terrible la condamnant à une métamorphose régulière, mi-femme, mi-serpent ; une métamorphose qui ne devait jamais être vue d’aucun humain, sous peine de malheurs et de désastres.
Et depuis des siècles, maintes fois épousée, jamais Mélusine, n’a eu l’heur de rencontrer l’époux capable de tenir son serment de ne point assister à la monstrueuse mutation. Alors, depuis des siècles et des siècles, la fée court les bois, les chemins, et les fontaines, à la recherche désespérée de l’impossible époux.
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.01.2012
Quand ça tourne en rond sans vraiment tourner rond
 - Allô ?
- Allô ?
-Oui, j'écoute. Marie Tezniès, Editions La Perle rare, j'écoute...
- Bertrand Redonnet, bonjour madame.
- Bonjour monsieur.
- Voilà : j’ai écrit un livre et je cherche un éditeur.
- Bien. C’est votre premier roman, je présume.
- Comment savez-vous que c’est un roman ?
- Parce que ça doit être votre premier livre et on commence toujours par un roman… En général.
- Ah bon ? Mais comment pouvez-vous savoir que c’est mon premier livre ?
- Parce que sinon vous ne me téléphoneriez pas. Vous auriez vos entrées.
- Ah bon ? C’est assez fulgurant comme raccourci, je trouve. Non, en fait, ce sera mon neuvième livre.
- Ah bon ? C’est curieux. Et pourquoi me téléphonez-vous alors ? Que voulez-vous exactement, monsieur ?
- Je vous l’ai dit, madame : j’ai écrit un livre et je cherche un éditeur.
- Vous venez de me dire que vous en aviez écrit déjà huit.
- Bon…Recommençons depuis le début. J’ai publié huit livres et, là, je viens d’en écrire un neuvième qui n’est pas encore publié et que je voudrais vous proposer.
- Votre éditeur n’en veut pas ?
- Je ne lui ai pas présenté.
- Ah bon ? Et pourquoi donc ? Il a fait faillite ?
- Non. En tout cas pas à cause de moi, si ça peut vous rassurer. Disons que je suis fâché avec lui. C'est bête, mais c'est comme ça.
- Ah bon ? Tiens…tiens… C’est curieux. Et pourquoi ?
- Est-ce bien nécessaire de vous en informer ?
- Ben, c’est que je trouve ça très curieux…C’est rare.
- A cause des droits d’auteur, des contrats, du silence et de tout le merdier…
- Ah bon ? C’est vraiment très curieux…En général, les auteurs ne s’occupent pas de ce merdier-là, comme vous dites. Ça n’est pas leur affaire. Ils écrivent, point.
- I sont vraiment cons à ce point-là, justement ?
- Pardon ?
- Rien…Veuillez m’excuser. Je causais à mon bonnet
- Bien. Et de quoi est-il censé nous parler votre…voyons voir, neuvième livre ?
- De quoi il parle ? Ben, comme ça, à brûle-pourpoint, c'est délicat...Heu... De vous, tenez !
- Ah, ah, ah, ah, vous êtes un comique, vous ! De moi ?
- Oui, des éditeurs qui posent des questions stupides.
- Au revoir, monsieur !
Crac !...tut…tut tut…tut tut…tut tut…tut tut…tut
Illustration:Philip Seelen
12:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.01.2012
Ceci n'est pas un coup d'gueule
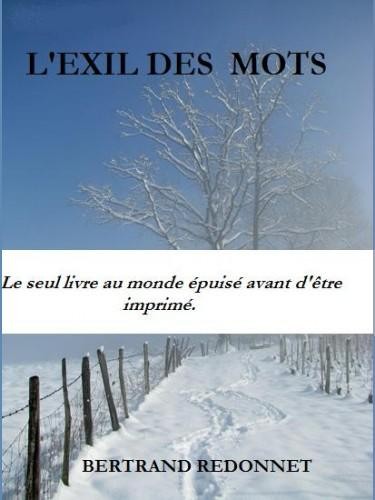
Je vais vite voir et, comme dirait l’autre, en effet ! Je supprime illico la couverture incriminée et en bricole une autre.
Que voici.
J’éclate de rire aussi parce que ça fait du bien, parfois, d’être pris en flagrant délit de mauvais goût, surtout par quelqu’un dont on juge qu’il en a, du goût.
Et cette remarque tombait à pic parce que je voulais justement vous en parler de cette souscription lancée le 17 décembre. Une idée comme ça, un pavé dans la mare.
Vous avez été, jusqu’à aujourd’hui, 21 à souscrire…Le chiffre cacochyme m’oblige à vitement remballer mes gaules et à conclure à l’erreur d’aiguillage : nous sommes bien dans une société systématique où la marchandise est reine sans partage et où l’échange, le troc, sont vaincus, au point d’en être devenus quasiment scabreux.
Et puis comme ces temps derniers il semblerait que mes idées soient plus souvent mauvaises que bonnes, ça n’en était certainement pas une lumineuse que de vouloir vous soutirer 20 euros pour que vous lisiez un livre que vous aviez déjà lu gratuitement. Quel sot !
L’argument pourtant donné par La Zélie était vraiment encourageant ; je l’en remercie vivement : « J'aime les livres, je veux avoir ce livre sans chercher midi à quatorze heures, c'est normal que celui qui écrit (blog ou autre support) ait envie de rassembler ses écrits dans un livre! »
Envie ? Oui. Alors qu’il se débrouille ou passe par le système par tous décrié et néanmoins par tous contresigné !
J’annule donc cette souscription, sans dépit aucun je vous l'assure, un peu amusé même, et m’attache désormais à trouver une autre voie à mon projet d’édition. Il est trop tôt pour que j’en parle maintenant dans le détail car d’autres camarades proposent de s’y investir, qui n’ont pas encore pris publiquement la parole sur le sujet. Ça tournera évidemment autour de l’édition et du livre, mais plus jamais, je ne tendrai mon chapeau.
D’ailleurs, je n’ai jamais eu de chapeau et mes poches ont des trous.
Merci aux 21 souscripteurs putatifs*. Ils verront sans doute, quand même, leur choix se matérialiser, mais sous un autre jour, un autre angle de vue. C’est presque une dette que j’ai contractée envers eux.
En attendant, je signale que Le Manchot a mis en ligne la première partie de Pan Trésor Kowalski, chapitres alternés avec ceux de son roman, Le Parallèle du Sosie.
* Je précise qu’il s’agit d’inscriptions préalables, de principe, et non de sous envoyés. Précision inutile peut-être ?
12:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET


















