09.12.2010
Propos délirants du début 2007 et d'un réactionnaire en écriture
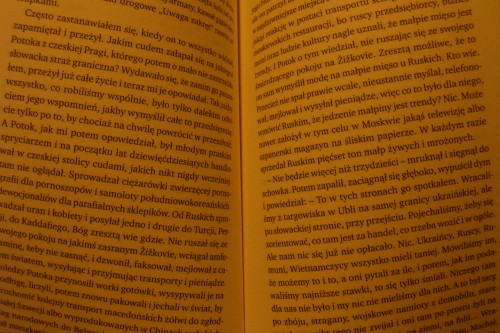 Ils ont dit que le monde avait changé mais ça n’a pas beaucoup de sens parce que quand on dit que le monde a changé c’est qu’on dit qu’il faut faire autre chose très vite pour vivre sinon « dans » du moins « avec » ce monde et qu’on est déjà foutrement en retard, qu’on est en train de courir après un train qu’on n'avait pas vu passer ou qui n'était pas à l’heure, ou alors à celle d’hiver alors qu’on était en avril, ou bien qui allait trop vite, ce train.
Ils ont dit que le monde avait changé mais ça n’a pas beaucoup de sens parce que quand on dit que le monde a changé c’est qu’on dit qu’il faut faire autre chose très vite pour vivre sinon « dans » du moins « avec » ce monde et qu’on est déjà foutrement en retard, qu’on est en train de courir après un train qu’on n'avait pas vu passer ou qui n'était pas à l’heure, ou alors à celle d’hiver alors qu’on était en avril, ou bien qui allait trop vite, ce train.Je veux dire que la manière de penser le monde était sclérosée tandis que le monde, concept effrayant tant c’est métaphysique, il mouvait, lui.
Toujours au profit des mêmes, mais il bougeait.
On peut aller loin comme ça, c’est-à-dire à peu près nulle part. En tout cas jamais où on avait prévu d’aller mais où le monde veut aller, dans une logique étrangement autonome. On l’accompagne en quelque sorte comme un cavalier qui ne maîtriserait pas son cheval. Si je veux dire un monde que je ne vois pas bouger, quoi écrire qui puisse être compris et lu avec plaisir par ceux qui ont couru avant moi, qui ont déjà sauté dans le wagon alors que je m’essouffle, moi encore, à courir sur le ballast et en agitant les bras pour signifier qu’ils ont oublié un voyageur qui voulait bien faire le tour du problème avec eux ?
Ça m’étonne toujours, moi, que le monde change de rue sans prévenir les hommes.
Je me dis depuis que je suis tout petit que les hommes doivent bien y être pour quelque chose tout de même, comme quand j’étais môme et que mon voisin se lamentait qu’on allait saigner son cheval à l’abattoir parce que maintenant c’étaient des tracteurs qu’il fallait pour semer du pain et si on voulait rester un paysan comme l’avaient été son père et son grand-père et tous les autres avant lui.
Comme aussi les mineurs de Longwy, un beau matin on leur a dit de circuler, qu’il n’y avait plus de place dans le monde qui avait changé pour leurs pioches et leurs sales gueules noires et hop, à la rue, vidés, bons à rien, vos maisons vos femmes et vos enfants démerdez-vous, nous on s’en fout on s’en va dans le monde. Les Lantier et autres Maheu se sont bien extirpés de leur trou, ont tapé du poing et lancé des pierres contre les changeurs du monde, mais rien n’y a fait.
Un monde qui change c’est comme un rouleau compresseur et c’est toujours plus fort que les gens qu’il tue. Evidemment.
C’est cruel un monde qui va son p’tit bonhomme de chemin sans demander leur avis aux hommes.
Ou alors c’est qu’on est déjà morts et on ne voit rien venir. Ça serait normal pour des morts de ne rien voir qui bouge, mais nous qui mangeons des bonnes recettes de viande en sauce ou des poissons frits extirpés de la mer océane, nous qui pensons des trucs, buvons du vin, nous promenons dans les sous-bois et les chemins que les ornières de décembre ravinent, jouons au ballon avec les enfants, on n’est pas morts, tout de même.
Ou alors c'est qu'on naît mort.
Ça n'est pas compliqué : quand on ne voit pas tout c’est qu’on est sot comme un âne ou mort. On n'est rien de tout ça à ce que nous prétendons. Alors il faut comprendre que nous comprenons le monde d’abord avec les satisfactions du ventre et que la tête suit, mais après, en décalage, un peu comme ces étoiles d’été, couchés qu’on est après dîner sur l’herbe où naviguent des aoûtats et qu’on contemple là haut des lumières qui sont mortes depuis trois mille ans ! Faut surtout pas essayer de remonter la lumière. On n'est pas équipés pour ça dans nos têtes et ça donnerait des vertiges tels que nos vies en sombreraient assurément dans la folie. Et puis qu’elle soit morte ou vivante cette lumière, elle n’en garde pas moins son bel éclat mystérieux.
Ne nous agaçons pas de réalité !
C’est pas un grand livre mais la réflexion est bien aiguisée.
J’ai lu quelques pages de ceux qui galopent jusqu’à la source des rayons lumineux, ceux qui ont vu aussi qu’un nouveau train était né et qui allait vite et qu’il fallait se dépêcher de grimper dedans si on voulait continuer à faire des pages qui tiennent la route.
J’étais en train de rêvasser comme un couillon avec Maupassant et Stendhal et les autres que vous connaissez aussi bien que moi, mieux sans doute. Enfin, autrement. Un peu de Giono aussi. Je voulais chanter comme eux, pas aussi bien évidemment, mais chanter avec leurs partitions. Des vieux trains à vapeur tout ça, tout propres, trop brillants pour circuler dans un monde poussiéreux, des trains avec des phrases et des virgules partout, qui coupent la conversation et des paragraphes aussi pour bien caler la pensée descriptive. Des points itou pour reprendre son souffle et le temps de digérer l’immédiat posé en amont. Parfois, vicieux, malin comme une belette, un passé conditionnel deuxième forme, pas facilement dissociable d’avec un imparfait du subjonctif, c’est vrai, mais qu’importe, on s’en fout du coup de pinceau, pourvu que la toile soit belle.
Ces vieux trains-là, c’était la préhistoire du déplacement.
Ils ont eu leur glorieuse utilité et ont transporté des hommes bien loin, cheveux aux vents par la fenêtre qu’on pouvait encore ouvrir à condition de ne pas passer sa tête au dehors au risque de la perdre et ils étaient si paisibles ces trains que les vaches s’arrêtaient de brouter pour les regarder passer.
Mais i sont foutus.
Toujours aussi beaux mais sur des voies de garage où batifole le chardon entre les rails et ils ont encore, c’est bien, beaucoup de visiteurs pour venir caresser leur vieille échine. On se promène là-dedans et on discute avec Sorel ou Rastignac, des fois dans un wagon un peu plus moderne avec Bardamu. Toujours quelque chose à raconter, des amours, des crimes, des avarices, des parties de chasse ou de jambes en l’air - plutôt suggérées celles-ci - des complots, des belles femmes, des arrivistes, mais surtout en prenant son temps de dire, en digressant à l’envi, en musardant sur la syntaxe et le verbe, où et comment ça s’est passé, la saison, la couleur des nuages, l’histoire des aïeux de celui qui a trahi ou qui a été trahi, voire qui est mort.
C’est ça qui les a essoufflés, ces gars là, et c’est là que le foutu monde a changé sans le dire, en catimini.
Le monde a filé à l’anglaise, à la française disent les Anglais, mais ne chipotons pas sur les gamineries vexatoires, le monde a glissé entre nos gros doigts.
Plus d’histoire à dormir debout. Avec des oiseaux qui pépient là, dans les lauriers en fleurs. Qu’est-ce qu’on s’en fout des oiseaux et des lauriers en fleurs à l’heure qu’il est ! Est-ce que ça ajoute quelque chose à l’histoire dont on est déjà rassasié ? Plus d’histoire ! Ou alors racontée vite fait, brossée à l’essentiel avec des mots rapides et bien aiguisés comme des lames qui peuvent couper des deux côtés.
Si on veut plaire à tout le monde il ne faut séduire personne.
Avec des fautes si possible, parce que l’orthographe ça entrave le libre cours de la pensée poétique, les mots sont parfois des murs infranchissables tant ils sont lourds de lettres inutiles, muettes, des ph aux éléphants, par exemple, quelle ringardise scolaire !
Le verbe à l’infinitif, pathétiquement seul entre deux points, ça c’est une trouvaille, le point d’orgue d’une pensée trop riche pour ne pas être mystérieuse. Là, la lecture s’affole, tâche de saisir au vol une émotion sublime qui lui échapperait. Le fond de l’art est frais. Ça me donne des frissons parce que je suis un gars qui suit pas bien le fil et que j’arrive pas toujours à saisir la douleur, la peine, l’espoir, l’angoisse ou la jubilation de celui ou de celle qui essaie de me parler comme ça. J
Je ne critique pas, je n’en ai ni l’envie ni le goût ni la compétence. Je discute. Je dis comme il faut penser vite et bien dans ce désordre impeccablement construit et que j’ai du mal.
Ça n'est pas de la critique : Un gars qui se noie il appelle au secours, il ne remet pas forcément l’existence de l’eau en cause.
Je n'aime pas le cinéma. Je n'aime pas lire sur un fond musical incitatif qui n’existe pas dans mes situations directement vécues, avec une émotion qui a un visage et qu’il faudrait que je m’approprie tout ça sur mon siège, avec un gars qui tousse à côté de moi . C’est vieux ce que je raconte là mais c’est comme ça qu’ont commencé à mourir les vrais raconteurs. J’ai connu un tas de gars qui n’ont jamais voulu lire Octave Mirbeau parce qu’ils avaient vu le journal d’une femme de chambre et d’autres qui n’ont jamais ouvert Darien pour avoir regardé Louis Malle.
Les raconteurs ont essayé de suivre un moment le train en causant comme des images mais ils n’y sont pas arrivés parce que des images il y en a beaucoup et elles défilent trop vite. Une plume ou des doigts sur un clavier ça peut pas créer l’illusion fugace d’une image ou alors il faut être sacrément véloce et qu’un seul mot puisse en signifier en même temps trois cent au moins.
Ben alors, qu’est ce que ça te fout de pas tout saisir dans un texte ? Mets y ce que tu veux. Ben oui, mais je n'ai pas besoin de lire pour ça. Ou plutôt, l’autre n'a pas besoin de m’écrire…Pourquoi me décrire une vision du monde aussi sensible et intelligente soit-elle si j’ai la mienne et que je ne décrypte pas la sienne ? Un train, c’est fait pour que des voyageurs montent à l’intérieur et c’est un peu comme en musique un accord inlassablement répété ça peut être une source d’une vive émotion pour celui qui joue parce qu’en même temps il y a des images et des souvenirs ou des espérances qui défilent dans sa tête, visibles que de lui-même. Mais celui qui écoute ?
Si j’veux construire un monde illusoirement à moi tout seul, j’vais à la pêche dans le Bug et je mets ce que je veux dans ces remous frontaliers aux couleurs qui changent tout le temps et où s’agitent des gros poissons blancs que capturent les moines orthodoxes.
Ceci dit en passant, ils m’ont invité une fois à en goûter, les moines, de leurs poissons, parce que j’étais là à rêver le cul par terre et que je me disais qu’il suffisait d’un remous de rivière pour séparer des mondes et déclarer des guerres. Un régal, n’eût été leurs marmonnements métaphysiques à l’heure du déjeuner que j’eusse, oui, j’eusse, j’use du j’eusse à ma guise parce qu’il s’impose à moi comme un outil qui est là à sa place pour dire ce que je dis, j’eusse donc collationné avec un plaisir décuplé.
Voilà bien une phrase qui est inquiétante parce que ça manque de coupures et de virgules et on dirait bien, plus haut là-bas, que ce sont les poissons qui ont marmonné des métaphysiques. En fait les incorrections de la syntaxe, de la construction et le déficit de ponctuation, c’est des anacoluthes, comme Baudelaire avec son albatros exilé sur le sol au milieu des huées avec des ailes de géant qui l’empêchent de marcher, cité par tous les théoriciens coupeurs de poils de cul en quatre de la métalangue.
C’est ça que j’essaie de dire.
J’ai essayé de voyager dans des pays littéraires avec des vieux trains qui roulaient au charbon et en construisant une histoire qui commençait par renseigner qu’il pleuvait ce matin-là ou qu’on était au mois de janvier et que Pierre ou Paul étaient des cordonniers ou des instituteurs. Pour un peu j’aurais poussé la niaiserie à les commencer par il était une fois, mes histoires qui avaient une chronologie linéaire et qui s’inscrivaient dans le temps qui passe, temps qu’on croyait qu’il était comme une flèche, un trait, disons un vecteur orienté toujours dans la même direction. On croit ça encore parce qu’on se voit vieillir à coups d’hiers d’aujourd’huis de demains et surtout de peurs ; Mais on sait maintenant, enfin on croit savoir, que le temps et l’espace c’est pas comme ça du tout et si on va en avant on peut aller aussi en arrière et même que ça n’est plus stupéfiant du tout de considérer qu’un corps peut être à deux endroits différents à la fois, avec un don d’ubiquité donc si j’exagère un peu, qu’un corps puisse s’emparer de ses rêves et superposer son réel et les disposer comme des sédiments de la mémoire.
Le passé et le présent, le futur un peu moins, ne sont pas si opposables l’un à l’autre qu’ils en ont eu l’air.
Alors si on veut vraiment raconter une histoire, car quoi raconter sinon une histoire même si c’est une histoire qui n’existe que par une vision fulgurante contraignante et désordonnée du monde, un roman, tranchons le mot qui rebute tant les abonnés du TGV remonteurs de lumière, il faut aussi qu’elle soit dans cet esprit-là et non tout imprégnée des erreurs du passé qui ne comprenaient de la fuite du temps qu’une expérience unilatérale et dirigée dans le même sens, celui de l’angoisse du saut final. Je trouve qu’un roman qui ne suit pas la chronologie est un roman qui colle à la chair dont il est fait. Comme un poulet de grain. Nos émotions, nos peurs, nos joies, nos désirs racontables comme indicibles, n’ont pas non plus à être subordonnés au présent. Il arrive qu’on soit dans le sens des aiguilles de la montre, mais il arrive seulement et des fois ce que nous ressentons de profondément vrai en cet inconnu qui nous habite, et que nous considérons comme digne d’être transmis, est un volcan à l’irruption actuelle mais aux racines tellement anciennes, alternant tour à tour leurs places dans l’instant, s’éloignant, revenant, se mariant pour faire un présentement vécu.
Je tâchais - j’ai bien dit je tâchais - donc d’écrire un peu comme mes glorieux modèles parce que je trouve ça beau. J’aurais tout de même dû considérer que ce qui était beau à la fin du 19ème et au début du 20ème reste bien entendu beau mais ne peut pas prétendre dire notre ère et en flatter l’esprit.
Pourtant j’ai toujours été un moderne. Je ne l’ai jamais trouvé ni beau ni humain le monde qu’on nous proposait et j’ai grillé une bonne partie de ma vie à gueuler qu’il fallait le changer, en agissant dans ce sens-là aussi, ce qui comporte de gros risques, et en refusant de faire longtemps le même métier et en traînant dans tous les milieux, des couloirs jaunes de la fac aux fréquentations les plus interlopes de la violence et de la nuit et jusqu'aux verrous crasseux de la force républicaine.
C’est quand même désolant de passer sa vie à vouloir changer le monde et que ça soit les autres qui vous disent : eh, coco, oh, oh, le monde a changé !
C’est comme ça.
Et je suis bien content qu’on m’ait alerté parce que j’allais continuer avec mes histoires à la noix de coco, en automne dans le marais poitevin ou je n’sais où avec des frênes qui tremblent dans des brouillards et des corneilles qui picorent les labours, et mes souvenirs fantasmés ou réels dont à juste titre personne n’a cure. Y’a un copain en France, un écrivain, tiens, je peux bien vous dire son nom après tout, on est pas là pour se faire des cachotteries et il ne m’en voudra pas, Denis qu’il s’appelle et on s’est tenus bras dessus bras dessous vingt-cinq ans durant avant que je ne quitte la France et il m’écrivait un jour que les ateliers d’écriture étaient bourrés de gens qui voulaient écrire mais qui ne lisaient jamais. Tout pour ma gueule, c’est la morale des temps modernes, qu’il a conclu Denis !
Pour écrire des choses c’est vrai que y’a pas besoin d’avoir lu des bibliothèques entières mais quand même là comme partout ailleurs y’a un minimum de complicité qui s’appelle l’échange. Il a raison Denis. Tout pour ma gueule. Ecoute ce que j’ai à raconter. On discutera après si on a le temps.
Ça doit être le changement de monde. Pourtant Denis, je sais qu’il est ponctuel et il n'aime pas louper son train mais celui-là va peut-être plus vite que ses yeux. En tout cas il n'a pas aimé et moi j’ai aimé qu’il me fasse part de son cruel sentiment.
Qu’il ne s’inquiète pas, Denis, ateliers ou pas, même dans les blogosphères du changement de monde c’est tout pour ma gueule. J’ai écrit un tas de textes là-dedans et j’en ai lu beaucoup, beaucoup, ponctuant ça et là mon passage d’un petit commentaire. Y’en a là qui écrivent, écrivent, noircissent du blog à qui mieux mieux, des logorrhées de considérations parmi lesquelles des choses bien, et qui jamais, jamais ne viennent foutre un coup de clic pour savoir ce qu’écrit le voisin. J’ai fait l’expérience. Du m’as-tu-vu dans mon joli blog et si tu viens à étouffer dans le tien tu peux crier au secours là-dedans personne ne viendra t’entendre.
Du changement de monde ça ? Allons, allons je n’y vois là que les vieux sentiments qui régissent la nuit des temps.
Tout pour ma gueule.
Non. En vérité, le monde n’a pas changé parce son propre justement c’est de changer tout le temps. Le monde changerait s’il s’immobilisait tout à coup et c’est nous, décalés, qui réclamons plus d’inertie et la question qui obsède en cet instant le clavier sur lequel je m’excite bêtement est de savoir si j’ai envie, si je sais, ou si je suis capable de l’accompagner plutôt que de rester à rêvasser à mon obsolète convenance, car quand même par-delà le plaisir d’une écriture il y a aussi ce qu’on veut de son devenir. Est-ce que la façon dont on écrit est subordonnée aux virtualités changeantes d’un monde que l’on comprend et avec lequel on fait corps ou est-ce que cette façon de dire les choses est une manière de survivre en dépit des manières lunatiques de ce monde ? La liberté totale s’impose là comme partout du moment que celle des autres n’en est point altérée : que chacun chante comme il le veut et que chacun écoute ce qu’il lui plaira d’écouter.
STOP !
Ça, ça n’est bougrement pas vrai parce que l’écriture est une marchandise, délicieuse j’en conviens, mais une marchandise et vous me pardonnerez - ou non peu importe - ces notions marxistes lycéennes éculées, une marchandise où la valeur d’échange a supplanté depuis belle lurette la valeur d’usage avec la bénédiction onctueuse de quatre-vingt dix-neuf pour cent des éditeurs, des distributeurs, des libraires et in fine des écrivains et en dépit de quelques-uns parmi les meilleurs qui ont organisé la résistance et ont pris le maquis en se servant intelligemment des outils de ce qu’il convient d’appeler l’adversaire médiatique.
La plupart des écrits marchands ne sont pas des écrits du cœur mais bien du cul, ce dernier même très discret.,mais un cul discret reste un cul. Je veux dire des trucs bien mis en évidence pour que le monde marchand puisse y rentrer à son aise et y faire son marché, une écriture prostituée à une demande vaguement sociale puisque fabriquée, mais même la prostitution peut s’exercer avec talent et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne digresse point car seulement la moitié de ma susdite revendication selon laquelle tu écris comme tu veux et je lirai comme j’ai envie est juste puisque côté lecteurs, il y en a encore beaucoup, mais peut-être n’ai-je connu aimé et fréquenté que des ringards, qui ne peuvent pas rentrer dans les nouvelles modalités de l’écriture du monde. Le côté lecteur est donc bien obligé de lire ce qui est publié de littérature s’il ne veut pas sombrer dans l’archaïsme comme moi ou pire encore, si, si, mais je crois qu’il est armé pour cela, dans les romans à quatre sous, de la cervelle de grimauds et grimaudes servie comme du foie gras.
A ce propos, j’avais beaucoup aimé la réponse que fit François Bon à un de ses visiteurs du Tiers Livre qui contestait à Tumulte sa qualité de roman, mais que si bien sûr avait dit l’écrivain parce que justement il ne fallait pas se laisser déposséder du concept roman en le laissant à l’exclusivité des faiseurs de trois cent cinquante pages d’une vague histoire de cul où s’agitent deux ou trois personnages. J’ai cité de mémoire bien sûr, juste pour illustrer d’un trait la réalité des rayons de librairies. Ils sont tellement mazoutés par une marée de parutions intellectuellement obscènes mais aux quatrièmes de couvertures alléchantes et au bourrage de crâne tellement assommant qu’il faut, si l’on aime lire encore et qu’on n'est pas bien renseignés, soit qu’on n'a pas le temps ou soit que, bien que grand lecteur, on ne suive pas les circonvolutions du petit monde littéraire et de ses enjeux, qu’il faut, disais-je, être vigilant sur ce qui est proposé…
Ou alors - et c’est ce qui se passe le plus souvent - on en revient aux valeurs sûres, aux vieux trains qui ont vu du pays et qui ne décevront pas. C’est que le jeu est inégal et j’affirme tout de même qu’écrire abscons à tout prix parce que le monde serait abscons, hé bien ça n'est pas gentil pour une foule de lecteurs parce que ce qu’ils aiment lire, archaïque certes mais de qualité, ne verra plus le jour que dans des manuscrits passés sous le manteau.
Il va sans dire, mais je le dis quand même, que mon propos élimine d’emblée la pédanterie de ceux qui croient qu’ils aiment tels ou tels livres parce qu’il sont sortis d’un milieu qui a la réputation de faire de belles œuvres hors champ d’application de la pollution exclusivement marchande ou qui disent détester, parfois dans les deux cas sans avoir lu, tels autres parce qu’ils sont des narrations stricto sensu ou qu’ils ont été publiés par des éditeurs à la réputation douteuse. Le bon goût est plus exigeant et plus compliqué et ça ne marche pas comme le tri sélectif des déchets du développement durable et il arrive que la littérature au sens noble produise de véritables merdes et qu’un diamant s’égare par inadvertance ou ignorance dans une poubelle.
C’est rare mais ça peut arriver.
A propos d‘archaïsme je m’arrête une seconde sur Brassens qui reste un de mes poètes de prédilection boudé par une bonne partie des muscadins de la poésie parce qu’il était un chanteur alors que justement l’astuce était de faire passer la poésie sur le mode populaire afin que le plus grand nombre y ait accès. Un internet avec des moustaches et une guitare. C’est un poncif mais sans Brassens Villon serait resté inconnu de beaucoup plus de gens qu’il ne l’est en vérité même si un seul poème ne suffit pas à qualifier une rencontre avec une œuvre, j’en conviens. A un journaliste qui lui disait donc qu’on le taxait en coulisses de passéiste il répondit d’abord en forme de syllepse qu’il n’aimait pas le mot avant de préciser : avec ce hiatus au milieu. A un autre qui formulait à peu près la même critique un peu plus littéraire puisqu’il s’agissait cette fois d’archaïsme il dit que oui bien sûr mais que ceux qui lui reprochaient d’employer un vocabulaire suranné étaient ces mêmes qui fouillaient les brocantes à la recherche de vieilles lampes, alors tout est absolument relatif, n’est-ce-pas et écrivons comme nous le voulons chaque lecteur y reconnaîtra bien le sien, moderne, archaïque, poétique, vulgaire ou politique, un jour ou l’autre.
Mais
Confronté à cette incapacité à comprendre totalement les nouvelles formes autant qu’à les écrire, nouvelles formes qui pourtant j’en suis certain sauveront un moment l’écriture et la littérature du naufrage de leur époque, mais seulement de leur époque qui n’est point éternelle et dont les choix ne sauraient être universels , parce qu’elles sont en harmonie avec des hommes virtualisés et de plus en plus complexes et surtout parce qu’elles détournent intelligemment vers l’intérieur poétique les abstractions matérielles de l’empire exclusivement marchand, il ne faut pas le perdre de vue un seul instant même si de faux puristes écervelés revenus de tout sans avoir jamais mis les pieds nulle part trouvent que ça fait ceci ou que ça fait cela. Je fais donc mienne l’observation publiée chez Corti selon laquelle l’écrivain sachant qu’il n’a plus aucun enjeu médiatique à attendre de son travail peut enfin se consacrer à l’absolu intime de son écriture. J’en suis et je remercie ce Georges Picard de l’avoir énoncé avec force. Sans enjeu la littérature redevient un art à part entière, une activité plus humaine et plus haute que toute autre puisque débarrassée des préoccupations de la reconnaissance immédiate et éphémère du plus grand nombre.
Elle est là, la résistance des écrivains, écrire en dépit des créneaux des éditeurs à l’affût des coups juteux, des faux libraires en carton bouilli et des monopoles de la distribution cybernétisée à outrance. Ecrire pour entrer en guerre contre ceux qui tirent les ficelles et les cordons des bourses, même dans notre propre camp où ils sont nombreux et avancent masqués. Le pouvoir doit changer de mains, de l’absolu du marketing glisser à la relativité de la plume, et je suis certain que les écrivains, ceux dont la seule ambition est l’écriture, sortiront vainqueurs de la confrontation même si beaucoup, dont je suis sans doute, y mourront en soldats inconnus, sans même avoir vu le point du jour.
Mais l’enjeu est de gigantesque taille. Nous verrons bien car, reprenant ce que je disais au tout début de ces intempestives cogitations, le monde est un concept métaphysique, un fourre-tout du flou, un prétexte bâtard et exempt de toute intelligence concrète.
Le monde n’est rien sans les hommes et les hommes, jusqu’à preuve d’un contraire fort hypothétique, c’est quand même nous.
Points. De suspension bien sûr.
12:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET

















Commentaires
je me demande si en restant immobile, ou du moins en bougeant à notre guise, en ne suivant le monde que quand il nous y oblige pour assurer le minimum vital, on n'a pas des chances qu'il se désintéresse de nous ou qu'il revienne au point où nous sommes, ou s'en approche
Écrit par : brigitte Celerier | 09.12.2010
Lu avec deux pauses. Merci!
Écrit par : Natacha S. | 09.12.2010
"écrire en dépit des créneaux des éditeurs à l’affût des coups juteux"
Certes, mais n'est-ce pas aussi une manière de se rassurer? Se dire qu'on est tellement bon que le milieux commercial de l'édition ne veut pas de nous? Seul un écrivain publié et reconnu pourrait jouer ce jeu-là. Refuser d'être publié et écrire pour lui et les lecteurs de son site. Mais les autres?
Écrit par : Feuilly | 10.12.2010
Tout ça dépend de ce que tu mets derrière "coups juteux" et "milieu commercial de l'édition".
Toute édition est commerciale, mais certaines ne sont pas que ça. Et c'est à celles-ci que nous nous intéressons et que nous voudrions qu'elles s'intéressent à nous.
Il ne s'agit pas de se croire bons. Il s'agit de ne pas prostituer son écriture.
Écrit par : Bertrand | 13.12.2010
Les commentaires sont fermés.