15.03.2013
Au pied des murs - Fiction en 3 épisodes - 2 -
 Mes premières stupeurs à peine estompées, je m’avançai doucement sur la pointe des pieds, comme attentif à ne pas réveiller quelque chose de ces décombres tellement inattendues, quelque chose de lointain, de souterrain et qui n’existait pas dans mon monde. Ces ruines m’apparurent incontestablement extravagantes en ces lieux. Elles étaient vivantes, elles étaient humaines, elles semblaient s’être déplacées là, tant elles n’étaient pas du même élément que les herbes, que les arbres, que les fleurs et que la poussière ocre du chemin.
Mes premières stupeurs à peine estompées, je m’avançai doucement sur la pointe des pieds, comme attentif à ne pas réveiller quelque chose de ces décombres tellement inattendues, quelque chose de lointain, de souterrain et qui n’existait pas dans mon monde. Ces ruines m’apparurent incontestablement extravagantes en ces lieux. Elles étaient vivantes, elles étaient humaines, elles semblaient s’être déplacées là, tant elles n’étaient pas du même élément que les herbes, que les arbres, que les fleurs et que la poussière ocre du chemin.
L’enfant aux portes de son adolescence ne voyait sans doute pas ces vieux murs tels qu’ils étaient en vérité. Leur solitude, leur dégradation majestueuse dans tout le silence et le secret de ces grands bois, lui en imposaient. Il les voyait puissants, qui coupaient autoritairement sa route. Ils avaient surgi. Ils étaient un mouvement. Et déjà n’avaient d’importance que ce qu’ils pouvaient bien receler. Dissimuler. Plus loin qu’eux.
C’est bien ce qui différencie foncièrement l’archéologue qui cherche de l’enfant qui trouve. Celui-là veut faire parler les vestiges au passé, celui-ci n’a d’yeux que pour l’éventuelle ouverture que pratiquerait ce passé sur un futur immédiat, qu’il s’approprierait aussitôt.
Ces grands murs sont restés gravés intacts dans ma mémoire d’homme. Je pourrais aujourd’hui dessiner et peindre leurs lézardes béantes d’où dégoulinait la terre rouge de la maçonnerie, leurs sommets ravinés, les plantes et les arbustes qui les broyaient de leurs étreintes, les lourdes pierres taillées, grisâtres et mouchetées de lichens. Je pourrais sans les trahir les reproduire tels qu’ils jaillirent devant moi, spontanément, comme des allégories de ce qu’il faut éviter de franchir, comme des signes, comme des prémonitions à la fois austères et dionysiaques. J’eus, sans la définir évidemment, la terrible sensation que ces parois marquaient la fin de mon monde. Qu’il y aurait désormais un «avant» et un «après» leur rencontre.
Le layon se rétrécissait, pris en tenaille par des genêts, des genévriers et autres broussailles. Il descendait légèrement maintenant et ce n’est que parvenu au pied des murailles, que je constatai que seule la crête en était écroulée. Les bases étaient encore saines. Je continuai lentement sur le sentier dont la déclivité s’accentuait et qui semblait vouloir contourner le vieil édifice. Il changeait de qualité aussi. Il était à présent revêtu de pierres que recouvrait une mousse bien verte et humide. Il y avait de l’eau par ici. Je le sentais. Et de la fraîcheur. Ça n’était plus la lourdeur bourdonnante, épaisse et poussiéreuse des sous-bois. Quelque chose avait changé, la température, le décor, presque la saison. Je mesurai tout ça d’instinct et en pris pleinement conscience en apercevant entre les cailloux et les herbes rampantes, les minces filets d’eau d’un écoulement limpide.
À force de prudence et de lenteur, je parvins bientôt jusqu’à l’angle de ce qui m’apparut dès lors comme étant des fortifications. Car à cet endroit s’élevait une grosse tour ronde et crénelée, à partir d’où les remparts s’enfuyaient à la perpendiculaire, accompagnés du petit sentier qui descendait encore plus abrupt, toujours pavé et luisant d’humidité.
Une tour ! Je n’en avais jamais vu que sur mes livres d’écolier. Une tour, ça signifiait dans mon esprit bataille rangée, flèches, arbalètes, lances, cris, feu et huile bouillante jetée sur des assaillants tout vêtus de fer… Je levai la tête. Elle était haute, en bon état et sans doute avait-elle été reconstruite car la pierre, quoique loin d’être neuve, était plus blanche et mieux taillée que celle des remparts. Un lierre géant avec un tronc tourmenté par de robustes nœuds, lourds comme des poings, l’escaladait, s’enroulait tout là-haut entre les créneaux avant de continuer sa conquête exubérante tout le long des sommets effondrés de l’enceinte.
Remparts, petit chemin dallé autour, source toute proche, tour. Tout cela désignait un château. Au bout de mon escapade, j’étais donc tombé sur une forteresse des temps anciens, secrètement recluse au fond des bois. Je n’étais plus apeuré ni inquiet : j’étais émerveillé et ma tête se mit à battre la campagne.
Ma maison, mes parents, les interdictions, les recommandations, les morales, étaient soudain à des siècles d’ici et continuaient de s’éloigner encore vers un brouillard irréel. Tout ça, déjà n’existait plus. Un souffle puissant surgi d’un temps révolu venait de balayer ma petite vie de garçonnet au rang des quotidiens moroses, sans rêve et sans issue.
Longtemps je suivis le layon de plus en plus étroit, le long des remparts que le soleil éclairait de jaune clair à travers la cime immobile des arbres, alors que moi j’avançais dans la pénombre verdoyante des arbustes et des broussailles. Impossible d’accéder tout à fait au pied des murs, cernés par la végétation au maximum de sa maturité et de sa densité, jusqu’à ce que mon sentier fût soudainement coupé par un chemin creux beaucoup plus large et nettement plus carrossable. Etonné, je l’examinai. Des empreintes de pneus de voiture en imprégnaient encore la poussière. Il filait à travers bois, droit sur le soleil couchant, pour en sortir bientôt sans doute, le long de la rivière en contrebas.
Mais de ce côté-ci, sous mes pieds, il finissait sa course sur une porte cochère fermée d’une lourde chaîne et que d’épaisses ferrures disposées en diagonale sur chaque vantail rendaient plus massive encore. Un cul de sac. L’accès des hommes au château en ruines. Je n’étais plus seul et les murailles perdaient quelque chose de leur enchantement. Je m’approchai doucement de l’énorme porte. Son bois battu par la pluie, les froids et l’ombre des intempéries, était noir et rugueux.
Je glissai un œil entre les deux battants, mal joints.
A suivre
10:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.03.2013
Au pied des murs - Fiction en 3 épisodes - 1 -
1
 Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Si ce Grand Meaulnes est resté en nous comme un frère, un compagnon, c’est qu’il trimballe avec lui quelque chose de notre universalité. Enfant, je connaissais par cœur un sentier sous la forêt qui menait jusqu’à d’étranges décombres, car cent fois depuis leur découverte j’avais repris ce sentier, en quête d’une redite de mes premiers émois.
En vain. Ces ruines m’avaient pourtant dévoilé les premiers mystères du désir amoureux, en même temps qu’elles avaient été mon premier regard jeté sur le délectable interdit. A partir d’elles, sans que j’en prisse conscience, ce regard s’était fait synonyme de plaisir de vivre.
Après bien des visites et des visites, j’avais donc fini par abandonner mon château à ses bois et à ses broussailles et j’ai tenté, tout au long de ma route, de le reconstruire partout ailleurs.
Tout cela ne m’est bien sûr apparu que tardivement. Entre les vieux remparts assiégés de buissons et le présentement dit, il y eut l’histoire ravinée par les marées de la vie et l’enfouissement des premiers troubles sous leurs écumes.
Ecrire cependant, n’est-ce pas vivre deux fois ? N’est-ce pas revenir en amont, remonter l’écoulement du fleuve par lequel on est arrivé jusque là, se pencher sur son lit, le débarrasser des alluvions déposées sur l’inaperçu ou l’à peine entrevu et tenter de ramener en pleine lumière le cours qu’emprunta finalement la fuite du temps ?
Alors, maintenant, à l’heure où décline la lumière, à l’heure indécise entre le chien et le loup, à l’heure qui approche et où il faudra se jeter dans les gouffres indéchiffrables et chaotiques du néant - tellement qu’on est tenté d’éconduire en même temps le loup et le chien en tâtant du fantasme de l’immortalité par un message agrafé au dos des insomnies - elles ont resurgi, les vieilles murailles des grands bois.
À l’heure d’écrire.
Elles ont resurgi à l’envers. La première fois, elles s’étaient entrouvertes sur les portes de l’avenir. La seconde, aujourd’hui, elles se referment sur le passé.
Telles des parenthèses.
Le mois d’août était opiniâtrement bleu et depuis plusieurs semaines les vents soufflaient du sud-est. Quoique faibles, ils n’en bousculaient pas moins des fétus de paille qui s’envolaient haut, très haut en tournoyant longtemps au-dessus des chaumes à la faveur des courants chauds.
Les paysans appellent ce phénomène «des sorcières» et disent qu’il est annonciateur d’une sécheresse durable. Je ne sais évidemment pas si cette théorie de l’observation est infaillible, mais je sais qu’elle s’était vérifiée cette année-là. L’été n’avait été rafraîchi que par quelques menues ondées, la terre était poudreuse et les prairies, sauf celles qui bordent la rivière, jaunes comme le sable des dunes océanes.
Mon père, tout endimanché et tout inquiet, était allé ce dimanche-là se promener sur les champs où s’alignaient ses gerbiers d’avoine, d’orge et de blé fauchés aux derniers jours de juillet. Il voulait s’assurer que les grains ne séchaient pas trop rapidement sous ce vent continental et si, libérés de leurs épis, ils ne s’éparpillaient pas au sol. Selon ce qu’il aurait vu, il prendrait alors la décision de rentrer rapidement toute la moisson ou la différerait. Car il était comme ça mon père : pour rien au monde, il n’aurait travaillé un dimanche. Son dieu le lui interdisait formellement. Alors, sous couvert de promenades, il allait, les mains ostensiblement enfoncées dans ses poches pour bien faire montre de ce qu’il n’avait pas d’outil, constater ceci ou cela sur ses champs et repérer de la sorte ce qu’il était urgent de faire et ce qui pouvait attendre. C’est-à-dire que sa morale rudimentaire devait considérer que penser, anticiper, projeter, ça n’était pas travailler, du moment qu’on faisait tout ça sans se baisser.
Ma mère l’avait accompagné et je les avais vus, bras dessus bras dessous, descendre le chemin qui, de notre maison, menait jusqu’à la rivière. Ils avaient ensuite traversé le pont de pierres.
Quand je dis que je les avais vus, ça n’est pas tout à fait exact. Je les avais guettés. Et lorsque j’avais été certain qu’ils étaient maintenant sur les champs de l’autre rive, j’avais pris la poudre d’escampette.
J’étais parti dans la direction opposée, vers les grands bois de chênes qui s’étiraient sur cinq kilomètres au moins, en face de chez nous, sur le coteau de la petite vallée. Je n’y étais jamais allé qu'accompagné de mon père, encore qu’en proche lisière, car il possédait là quelques ares sur lesquels il prélevait chaque année notre provision de bois de chauffage.
L’ombre tiède et sans un souffle bourdonnait des mille insectes de l’été et je marchais prudemment en évitant les herbes sèches et les pierres, réputées pour être les lieux de prédilection des serpents. Par d’éphémères éclaircies du taillis, j’apercevais en contrebas la rivière presque mourante et, plus loin au-dessus, les champs accablés de lumière. Bien que je ne sois nullement en peine ni en proie à la peur, cela me rassurait d’entrevoir des lieux familiers et cela m’invita à explorer encore plus loin un faible sentier forestier coupant les bois dans le sens de leur longueur.
Je le suivais depuis longtemps déjà, en quête de nids d’oiseaux perchés tout là-haut dans le branchage des chênes ou alors camouflés dans les sombres enchevêtrements du sous-bois, quand ...
Je m’arrêtai, tétanisé.
Devant moi se dressaient de hautes murailles de pierres partiellement effondrées et dévorées par une végétation de lierres luxuriants, de lianes, de viornes et de sureaux. Délabrées, antiques et étrangement retirées au beau milieu des bois, elles obstruaient complètement le sentier.
A suivre
10:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.03.2013
Maupassant, Brassens
Ils ont plein de choses en commun, ces deux-là : ils arboraient de fortes moustaches, ils avaient le talent fulgurant des étoiles filantes - l'un est mort à 43 ans, l'autre à 60 - ils étaient de grands pourfendeurs de soutanes, et ils sont, dans l’art de manier la langue, d’inégalables références pour mézigue.
Alors, l’un - le moins loin de nous - s’est-il inspiré de l’autre ? Ce qui ne me déplairait pas.
Est-ce la rencontre fortuite de deux esthètes de génie ? Et ça me réjouirait, que de tels esprits aient pu concevoir une même tournure de langage, à un siècle d’intervalle, sur deux mots tabous, l’un pour « cocu », l’autre pour « enculé. »
Est-ce tout simplement une expression figée que j’ignore ? Ce qui me décevrait beaucoup.

M.DE GARELLE : Ne jouons pas sur les mots et avouez-moi franchement que j’étais…
MME DE CHANTEVER : Ne prononcez pas ce mot infâme, qui me révolte et me dégoûte.
M. DE GARELLLE : Je vous passe le mot, mais avouez la chose.
Maupassant - La Revanche -
Gil Blas le 18 novembre 1884 - Recueils Le Rosier de Mme Husson et Contes grivois

Lâcher ce terme bas, dieu sait ce qu'il m'en coûte,
La chose ne me gêne pas mais le mot me dégoûte,
J' suis désolé d' dire « enculé ».
Brassens - S’faire enculer -
Titre posthume -
Mis en ligne en août 2011
10:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.03.2013
Renart et Jean Le Bon
 Ils sont légion les villages anciens que les banlieues ont dévorés sans vergogne ! L’urbanisme tentaculaire avec ses lotissements style accession à la propriété pour trois sous et trente ans d’emmerdements à la banque, ses rocades, ses sorties d’autoroutes, ses zones commerciales où pavoisent les maîtres de la marchandise, Rallye, Conforama et autres Carrefour, les ont rayés de la carte, supprimés des géographies réelles. Ils ne sont plus que des noms et sont dès lors comme les étoiles mortes que nous voyons encore briller au ciel de nuit. Comme les couches géologiques aussi, qui s’accumulent les unes sur les autres sans pour autant parvenir à effacer le dessin des couches inférieures que nous montre le flanc de la falaise.
Ils sont légion les villages anciens que les banlieues ont dévorés sans vergogne ! L’urbanisme tentaculaire avec ses lotissements style accession à la propriété pour trois sous et trente ans d’emmerdements à la banque, ses rocades, ses sorties d’autoroutes, ses zones commerciales où pavoisent les maîtres de la marchandise, Rallye, Conforama et autres Carrefour, les ont rayés de la carte, supprimés des géographies réelles. Ils ne sont plus que des noms et sont dès lors comme les étoiles mortes que nous voyons encore briller au ciel de nuit. Comme les couches géologiques aussi, qui s’accumulent les unes sur les autres sans pour autant parvenir à effacer le dessin des couches inférieures que nous montre le flanc de la falaise.
Les villages engloutis, leurs panneaux indicateurs ne les indiquent même plus, noyés qu’ils sont dans le désordre des architectures schizophrènes. On les passe sans les voir, les deux signalisations, celle qui voulait initialement dire qu’on entrait dans le village, comme celle qui indiquait qu’on en sortait. Que du brouillard en béton.
Parmi ces villages, certains, pourtant, de par leur situation géographique à l’écart d’un grand axe routier, ont été pour l’heure sauvés de l’anéantissement. C’est le cas de Nouaillé-Maupertuis que guette Poitiers tout proche et qui l’engloutira sous peu. On entendra alors :
- Vous êtes passés par Nouaillé-Maupertuis ?
- Non, non, pas du tout. Nous sommes passés par Poitiers… Où est donc ce Nouaillé-Maupertuis ?
Ce joli nom force pourtant l’imagination. Il est une invite sans ambages à l’archéologie de la sémantique.
D’abord ce Nouaillé, explique un Nobilien - c’est le gentilé qui désigne l’habitant des lieux -, ce Nouaillé, donc, est l’appellation initiale, gallo-romaine, qui nous dit bien que là étaient des terres indécrottables, des déserts de pagaille, des friches dont on ne pouvait rien tirer mais que le paysan, à force de zèle, a su rendre fécondes. C’est ce que signifiait le nom de baptême de notre village, Novalia, terre que l’on a débroussaillée, défrichée. Terre rénovée. D’ailleurs - le Nobilien fait une moue, hausse les épaules et bat l’air de sa main comme s’il chassait une mouche importune - on ne dit jamais Nouaillé-Maupertuis, allons, allons, on dit Nouaillé, tout simplement.
Ha, ha, ha ! Ricane un curieux. Tiens donc !? Et pourquoi cela ? Ce Maupertuis, il existe pourtant bel et bien, hein ?! Sur les cartes, sur les documents officiels ? Que vient-il donc faire là ? Une fantaisie pour faire joli ?
Et il a quelques lettres, ce curieux-là, alors il fait aussitôt le rapprochement avec le rusé et malfaisant goupil, maître Renart. Maupertuis était bien son château souterrain, quoique surmonté de remparts crénelés, mais château malodorant, honni, bien à l’écart de la cour du roi Noble. Le château de la marge et, tranchons le mot, le trou du mal, le repaire du diable, oui, voilà ce que signifie Maupertuis. Alors ?
Alors ce sont des histoires de littérature anonyme ! C’est tout ! Se fâche tout rouge le Nobilien, outré de ce que l’on fasse un rapprochement entre le diable et son village verdoyant.
Monsieur Godard assiste, amusé, à la conversation. Il est Nobilien de souche et… historien de formation. Il hoche donc la tête et sourit, car il a de quoi fermer le bec à ce fouineur de mots. Il pousse du coude son compatriote, lui fait signe qu’il prend le relais et se lance.
Est-ce que le 19 septembre 1356, ça vous dirait quelque chose, par hasard ?
Le curieux lettré - le lettré curieux plutôt - est bouche bée. Voilà une date qu’il n’a point retenue de ses manuels d’histoire. Non, ma foi. 1356... 1356… Non, je ne vois pas du tout.
Hé bien, apprenez, monsieur le féru de littérature, que ce jour-là, notre roi Jean le bon, fut défait par ces satanés Anglois ! Et cela s’est passé, ici, à Nouaillé. Il était à la tête de plus de douze mille hommes, là, chez nous, mais les combattants du Prince de Galles, dit le Prince Noir car toujours tout de noir vêtu, étaient plus nombreuses encore Et savez-vous seulement quelles furent les conséquences de cette défaite ?
Ma foi, non, concède le questionneur. Je connais très mal cette partie de l’histoire, je l’avoue.
Hé bien, ce fut le traité de Brétigny, mon brave !
Le curieux tend l’oreille, cherche dans les brouillards de sa mémoire et n’y trouve précisément que du brouillard.
Mais encore ?
Suite à ce traité catastrophique, le royaume de France est amputé du Poitou, de la Saintonge, de l'Angoumois, du Limousin, du Périgord, du Quercy, et du Rouergue. Autant dire qu’il ne lui reste quasiment rien. Bandits d’Anglois, va ! Lâche l’historien.
C’est vrai ! s’exclame l’indiscret soudain enthousiaste. Mais… Mais je ne vois toujours pas le rapport avec Maupertuis. Il ricane. Peut-être n’y en a-t-il pas d’ailleurs…
Que si, que si, monsieur le littéraire ! Ne soyez donc pas insidieux de la sorte, je vous prie. Maupertuis veut dire, en latin, mauvaise passe, mauvais passage. Voilà. Etes-vous satisfait ?
Ah, tout à fait ! Maupertuis en latin comme Dire straits en… Pardon. En musique pop-rock…
J’ignore, monsieur, fait l’historien en pinçant le bec.
Et les trois sympathiques bavards de s’en aller, bras dessus, bras dessous, visiter, un peu à l’écart du village, le champ de bataille fléché pour le touriste, là où Jean Le Bon fut vaincu, fait prisonnier et par le désastre duquel la perfide Albion s’empara de la moitié du Royaume.
Et moi qui vous raconte tout ça, j’aime les villages et leur mémoire ensevelie sous le béton des amnésiques. Même controversée. Surtout, peut-être, même, controversée.
13:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.03.2013
Toponymie suggestive ?
 Je me souviens très bien de l’évènement - du moins de son impact dans les conversations, les peurs, les articles de journaux, les fantasmes divers - qui survint dans la nuit du 1er au 2 mai 1975 à Lezay, en Deux-Sèvres.
Je me souviens très bien de l’évènement - du moins de son impact dans les conversations, les peurs, les articles de journaux, les fantasmes divers - qui survint dans la nuit du 1er au 2 mai 1975 à Lezay, en Deux-Sèvres.
Ce même Lezay qui s’est doté aujourd’hui d’un coquet et paisible ensemble rural à vocation culturelle, Le Moulin du marais, et où, en octobre 2010 j’ai assisté et participé à la première lecture publique de Zozo, chômeur éperdu. Ce même Lezay où j'étais en résidence d’auteur à l’automne dernier pour le spectacle de mise en musique : Villon, Apollinaire, Couté, Baudelaire et autres poètes.
Cette nuit-là, donc, deux gendarmes en patrouille, pistolet en sautoir, la moustache guillerette et l’œil gaillard, voient, discernent, repèrent, observent, regardent, entrevoient, remarquent, avisent, distinguent, perçoivent, puis finalement constatent à travers des haies, direction ouest, à environ 3 ou 4 mètres du sol, un scintillement lumineux. Ils estiment que ce singulier phénomène se situe dans un pré, en bordure du chemin départemental 105, à 400 mètres de la sortie ouest de Lezay.
Les vaillants pandores descendent diligemment de leur noire estafette et de plus près vont voir de quoi il en retourne, certains sans doute de mettre la main au collet de quelque malfaisant.
Las ! las ! Voilà ce qu’il advint aux dignes représentants de la loi :
Presque aussitôt nous entendons un léger bruit, genre froissement d'ailes et nous constatons qu'un engin, dont nous ne pouvons déterminer la forme exacte et la couleur, s'élève rapidement suivant une trajectoire est-ouest, laissant apparaître deux lumières rouges de faible intensité, genre dispositif réfléchissant, distantes horizontalement l'une de l'autre d'environ 50 à 60 centimètres.
Les deux brigadiers en ont le souffle court et le képi en émoi. D’autant que la forme lumineuse, narquoise, se stabilise dans le ciel, frétille de l’aileron et semble les narguer. Outrage à agents ? Ça ne va pas se passer comme ça ! Ils se rendent donc très vite sur la place de Lezay où se déroule un concours de circonstances. Non ! De pétanque, ai-je voulu dire. Ils accourent donc là-bas, les gendarmes, pour faire constater par des témoins.
Oui, ils sont vraiment bouleversés. Car d’ordinaire, les gendarmes constatent ce qu’ont vu des témoins mais l’inverse ne leur prend jamais fantaisie d’aller faire constater par des témoins ce qu’ils ont vu. C’est la République du roi Pétaud, ce soir-là, à Lezay ! Mais les deux hommes, tout gendarmes qu’ils sont, là, même assermentés, se rendent bien compte qu'il faut que d'honnêtes citoyens attestent qu’ils n’ont pas eu la berlue. Il en va peut-être de leur déroulement de carrière, cette affaire-là !
Le quincaillier, l’adjoint au maire et je ne sais qui encore, trois ou quatre paisibles bonhommes, quittent donc le cochonnet des yeux pour les lever au ciel. Sidérés, ils observent alors la même chose : une forme lumineuse exécute des pas de danse sur l’horizon du ciel. Observé à la jumelle, l'objet laisse voir des points noirs et orange et même une queue.
Un oiseau peut-être ?
Allons, allons, soyons sérieux, je vous prie ! L'heure est grave et les joueurs de pétanque, quoique sous la protection des hommes de la loi, sont livides.
L’observation dure une demi-heure avant que l’apparition ne rejoigne enfin les sphères intersidérales.
On revient au point de départ, au point initial où avait atterri le truc, le machin, l’étrange chose, et on constate que l’herbe y est couchée sur une assez large surface. Pas de traces de brûlures cependant.
- Canular ?
- Oh, oh, ce sont des gendarmes, quand même !
- Oui, mais les joueurs de pétanque… Hum, hum… A un concours de pétanque, j’en ai fait beaucoup, il y a toujours des buvettes, non ?
- Oui, d’accord, mais…
- Peut-être aussi qu'ils n'ont pas osé contredire les gendarmes... Un outrage à agent, c'est si vite arrivé !
- Taratata ! Quelque chose d’anormal a été observé par les forces de l’ordre. Ce serait par le curé, là, bon d’accord… On pourrait discuter, émettre des réserves de type métaphysique, car on sait bien que les curés fabulent toujours quand ils parlent de ce qu'ils ont cru voir dans le ciel. Mais des gendarmes ?! D’ailleurs, les dépositions des susdits gendarmes - décidément, ils étaient vraiment de l’autre côté de la barrière cette nuit-là - ont été officialisées par leur hiérarchie et jusqu’au Ministère. Tout comme l’apparition de Bernadette Soubirou le fut jusqu’à Rome.
Donc, il s'est passé des trucs couillons, du côté de Lezay.
Ah ! Un fait important, très important même, noté dans tous les procès verbaux…
Le lieu-dit où les deux braves gendarmes ont initialement observé le phénomène, là où l'engin mystérieux s’est posé, s’appelle depuis la nuit des temps Le Bois-de-la-Drouille.
Mais, par un lapsus coupable et, ma foi, bien compréhensible si on a les dents qui claquent quand on rédige un rapport sérieux, les gendarmes avaient écrit Le Bois-de-La Trouille, et, par le fait, le bois a été rebaptisé.
C'est ici.
Trop marrant !
14:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.03.2013
Cabots
 J’aime les chats, disait Brassens, parce qu’il n’y a pas de chats policiers. Ce qui, par-delà la boutade, pourrait laisser à penser qu’il n’aimait pas les chiens. Je l’ignore. Le fait est cependant qu’on ne l’a jamais vu en compagnie de cet animal, dont un adage aussi éculé que stupide dit pourtant qu’il est le meilleur ami de l’homme. Peut-être Brassens n’y connaissait-il rien en amitié, allez savoir !
J’aime les chats, disait Brassens, parce qu’il n’y a pas de chats policiers. Ce qui, par-delà la boutade, pourrait laisser à penser qu’il n’aimait pas les chiens. Je l’ignore. Le fait est cependant qu’on ne l’a jamais vu en compagnie de cet animal, dont un adage aussi éculé que stupide dit pourtant qu’il est le meilleur ami de l’homme. Peut-être Brassens n’y connaissait-il rien en amitié, allez savoir !
Pour ma part, les chats m’indiffèrent complètement. Quant aux chiens, je ne peux pas dire que je ne les aime pas : je les déteste ! Qu’ils soient policiers ou non, bâtards ou de race, encapuchonnés de petits manteaux ridicules ou tout crottés, gentils ou méchants, gros ou faméliques, campagnards ou d’appartement, de chasse et quand bien même seraient-ils de pêche !
Dans mon village, la nuit est peuplée par les chiens. Si je sors un peu sous les étoiles, ils me brisent mon plaisir ; on n’entend qu’eux. Qui traînent, qui aboient, qui ronchonnent, qui geignent, qui fouillent une poubelle, qui grattent, qui se battent… Soit ils sont des chiens errants abandonnés par leur meilleur ami à la solitude de la forêt - ce qui est une constante humaine que de jeter les amis à la rue quand ils ne plaisent plus ou ne sont plus d’aucune utilité -, soit ils sont des chiens de ferme car, comme la divagation est interdite, leur maître consciencieux les attache le jour, au cas où la police viendrait à faire comme les chiens, à vadrouiller par là, et les détache la nuit. Pour qu’ils prennent l’air.
Parfois, ils sont mi-de-ferme, mi-errants. Celui-ci, par exemple, rachitique et le poil en désordre, qui est venu m’emmerder pendant des semaines, qui a été abandonné cet hiver sous la neige et le froid et qui, depuis, parcourt inlassablement le village. Il se glisse sous les clôtures, demande pitance, passe sa nuit dans des granges ou alors vagabonde sous la lune avec des compagnons de fortune. Des paysans doivent de temps en temps le gratifier d’un joli coup de pied dans le cul, mais des mémés lui donnent aussi un reste de soupe ou de bigos, un os, un bout de pain rassis. Ça compense. Moi-même lui ai servi deux ou trois repas, lassé de le voir me tourner autour dans une attitude qui a le don de me hérisser le poil - le mien, pas le sien - et caractéristique de cette espèce de quadrupèdes, implorante et geignarde.
Car avec les chiens, c'est simple : soit ils sont bassement génuflecteurs et rampants, soit méchants comme la gale et toujours prêts à vous déchirer le mollet si vous mettez seulement le bout d’un orteil sur le territoire de leur seigneur. Je crois que c’est ce qui me les rend si exécrables, ces canidés ! Esclaves zélés, domptés et sournois en échange d’une pâtée quotidienne. Ces cabots-là cabotinent, en font plus qu’on leur en demande et, en plus, le font sans élégance !
Au printemps qui s’annonce, les mi-ferme, mi errants, se reniflent sans vergogne le trou de balle, essaient de se grimper dessus, échouent, roulent à terre, recommencent, parviennnent soudain à leurs fins, font trois ou quatre petits mouvements coïtaux et restent là, collés fesses à fesses, les yeux dans le vide, l’air parfaitement idiot et la langue qui pend. Grotesque. Avec eux, l’image rabelaisienne de la bête à deux dos n’a jamais été aussi fidèle à la réalité.
Ils peuplent la nuit, oui. Tant que hier soir, m’en revenant d’un village voisin, j’ai soudain vu surgir dans mes phares un molosse hirsute à la dent baveuse, qui s’est jeté sur ma voiture comme un imbécile. Choc brutal et gros bobo à la portière. Le chien ? Pas de mal, non. Il est parti, peinard, dans sa nuit de chien stupide.
Et il me revient en mémoire une anecdote qui me ferait volontiers penser que le chien et l’homme sont effectivement faits pour s’entendre, tant ils ont en commun l’arrogante bêtise de la propriété.
Un ami et sa compagne faisaient une randonnée en vélo, en Charente-maritime. Dans la traversée d’un village, ils prennent un raccourci étroit, une venelle comme on dit par là-bas. Mais voilà qu’une saloperie de chien, énorme, hargneux, se met en travers de leur route, babines retroussées, les obligeant à s’arrêter, à descendre de vélo et à se servir des bicyclettes comme des boucliers.
Le propriétaire, lui, regarde la scène, l’air amusé. La compagne de mon ami l’interpelle alors furieusement et lui enjoint de venir calmer son p… de chien, de libérer le passage !
Le gars, sanguin, sot dans son crâne, hoche alors la tête et énonce cette imparable sentence :
- L’est chez li ! (Il est chez lui )
Sous-entendu, Vous, non, donc, lui, il a tous les droits. Même celui de vous déchiqueter.
Décidément, si je déteste les chiens, je ne ressens pas beaucoup d’amour pour leurs maîtres non plus.
12:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.03.2013
Pré-printemps

Les routes, elles, accusent le coup. Le gel et cette longue période d’ensevelissement ont creusé de profondes ornières car chaque printemps ramène ici son lot de constatations désastreuses. Ce qui avait été replâtré tant bien que mal l’an passé, cède à nouveau ; c’est l’éternel recommencement, le mythe de Sisyphe de l’asphalte.
Et je me demande souvent ce que peut bien en penser la communauté, celle qui vote des budgets à tour de bras et selon les besoins de vingt-sept pays réunis sous la coupole du bien commun. Prend-elle en considération que les latitudes les plus exposées sont des gouffres financiers ? Qu’un budget départemental grec ou français pour l’entretien des routes, c’est du pipi de chat en comparaison de ce qui doit sans cesse être ici réparé ? Que les infrastructures soumises à rude épreuve engloutissent chaque année en Europe centrale les salles des fêtes, les terrains de sport ou de jeux, les crèches, qu’on construit ailleurs, en tendant la main, quand même, pour que le contribuable européen mette la main au porte-monnaie ?
Une communauté qui a la prétention de s’étaler des rivages de l’île de Ré aux portes des Russies, devrait quand même, si elle en était vraiment une autrement que pour la libre circulation de ses marchandises et de ses capitaux, savoir qu’un Finlandais ou un Polonais n’a pas exactement les mêmes chances face à son climat qu’un Italien, un Portugais ou un Grec. Mais, enfin, moi, ce que j’en dis, hein…
Ce que j’en sais, c’est qu’après avoir longtemps roulé à quarante à l’heure pour cause de glace et de neige et pour m’être promené hier dans la campagne qui dégèle, j’en suis toujours réduit à la même vitesse pour éviter dorénavant les nids de poule et les crevasses. De peur qu’une roue ne se casse et ma figure du même coup.
Je rigole ? L’autre jour, entre Parczew et Lubartów, un automobiliste, après avoir roulé pendant une vingtaine de kilomètres et soumis son véhicule à des soubresauts de plus en plus violents et de plus en plus rapprochés, a vu devant lui s’enfuir une de ses roues… Sympa, comme émotion.
Sur un tout autre sujet, mais toujours lié à ce que les Polonais appellent le przedwiośnie, le pré-printemps - qui peut encore vous offrir des nuits à moins dix degrés quand même - je connais un monsieur qui, à contre-courant des espoirs printaniers de tout le monde, voit avec tristesse les cieux se bleuir et l’intempérie blanche s’éloigner.
C’est un homme de peu, de bien peu, un balayeur qui n’aurait jamais l’idée de se faire appeler technicien de surface par les cochons du langage cache-misère, parce qu’il est gai et qu’il n’a pas honte de son humble condition. Tout l’hiver durant, il déblaie, à la pelle, la neige sur le parking d’un petit supermarché. Il balaie, il entasse, il s’applique. Je le vois tous les matins, je le salue, car c’est là que je fais mes courses au quotidien. Il me gratifie d’un large sourire et d’un signe amical de la main, fier de lui, fier d’être utile, fier d’être reconnu comme participant à quelque chose.
Il y est depuis fin novembre. Depuis plus de trois mois, une petite pièce vient donc mettre un peu de beurre dans ses épinards et il a l’air tout content, le brave homme ! L’été, parfois, je le vois sur ce même parking, sous la canicule et le ciel désespérément bleu, les mains dans les poches, tout triste, le chapeau sur ses yeux rabattu… Il semble attendre là, immobile, le retour des rigueurs hivernales. Je le salue, il me répond, mais de façon beaucoup moins enjouée. Comme quelqu’un qui aurait perdu goût aux choses.
Hier, je lui ai montré le coin de ciel dégagé et la neige qui fondait au caniveau. Je lui ai fait signe d’une moue significative que ce n’était pas bon du tout, ça… Il a rigolé. Parce qu’il y avait aussi des nuages et un vent froid qui venait du nord, alors il m’a dit avec une grande gaité ce que les autres disent avec lassitude :
- Moze będzie padać ! Il en tombera peut-être d’autre !
Brave homme ! Je serai heureux de le retrouver avec sa grande pelle, au tout début de l’hiver prochain, quand les cieux recommenceront à saupoudrer de blanc son chapeau et lui d’un peu de reconnaissance sociale, fût-elle illusoire.
14:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.01.2013
Marions les ! Marions les !
 En introduction de mon véritable propos, j’en remets une petite couche sur ce qui fait bander les socialistes - qui ont sans doute grand besoin de stimuli pour ce faire - depuis leur avènement au pouvoir et aux forceps.
En introduction de mon véritable propos, j’en remets une petite couche sur ce qui fait bander les socialistes - qui ont sans doute grand besoin de stimuli pour ce faire - depuis leur avènement au pouvoir et aux forceps.
Il faut tout d'abord dire que ces socialistes-là ne l’étant nullement dans les faits se voient contraints de l’être dans les idées. Le mariage homosexuel est donc une idée qui présente pour l’épicerie socialiste l’avantage incomparable de briller telle une enseigne hautement progressiste, voire révolutionnaire. C’est l’abolition de la peine de mort de Mitterrand, qui, elle, était vraiment une sortie du Moyen-âge par le haut de la loi.
Une idée révolutionnaire qui arrive à se frayer un chemin pour rentrer jusque dans la tête des imbéciles, forcément, cesse de l’être au risque qu’explosent ces têtes. Et alors que le véritable courage, la révolution des mœurs, consisterait à abolir cette infâme procédure d’Etat civil qui renferme l’amour et la jouissance des caresses dans un carcan de droits et de devoirs, ces cons-là proclament l’enfermement pour tous et surtout pour ceux qui jusqu’alors s’aimaient différemment.
Si, depuis plus de quarante ans que nous jetons un regard critique sur la politique et sur l’évolution du monde, nous n’étions aguerris intellectuellement aux tours de passe-passe des pouvoirs capables de vendre une merde pour une orange bien parfumée, les bras nous en tomberaient. Ils ne nous en tombent pas. Nous sommes presque amusés de les voir mentir par gesticulations, comme des gosses de récréation pris la main dans le sac.
Ce qui nous amuse moins, quand même, c’est cette jeune femme joliment court vêtue, au minois de poupée Barbie, qui, elle, porte-parole de surcroît de tout un magma d’indécisions, prétend rayer de la carte des trottoirs de France toutes les putains et abolir une fois pour toutes le plus vieux métier du monde. Décidément, les socialistes n’arrivant pas à faire la pige au grand capital et aux diktats de la finance - si tant est qu’ils en aient eu l’intention ailleurs que dans leurs fiches publicitaires -, impuissants qu’ils sont à juguler la misère et l’ennui des gens, sont très préoccupés de ce qui se passe dans les profondeurs de leurs pantalons et de comment leurs administrés ont le plaisir de vivre leur plaisir !
Je n’aimerais pas faire l’amour avec une socialiste ! J’aurais bien trop peur de commettre une faute punissable!
Car on croît rêver ! Bientôt, le pauvre bougre esseulé dans une ville sans âme et sans humains à qui tendre la main, en plein désarroi d’humanité et qui ira acheter l’illusion d’une demi-heure de tendresse dans les bras d’une professionnelle, sera un délinquant aux yeux de la prude ministre et devra répondre de son intempestive bandaison devant un chat fourré somnolent, le coude négligemment appuyé sur un code pénal.
Elle se fout du monde, hein ? Est-ce que par hasard ces filles ne lui rendraient pas une image négative, pas propre pour un sou d’elle-même parvenue au pinacle du spectacle politique à peine sortie de l’œuf et n’ayant jusqu’alors rien prouver sinon un certain talent à grenouiller dans les coulisses, au point qu’elle veuille les supprimer du champ social ? Ça n’est pas impossible, après tout. Supprimez mon image, vous supprimerez mon fait !
Misère !
Et comment vendre cette bouillie à un électorat béat ? C’est fort simple, en se faisant, en bonne socialiste de l’amalgame, l’avocat de la veuve et de l’orphelin : les putains sont toutes des filles tombées dans le ruisseau et sous la coupe d’immondes proxénètes qui les exploitent, les battent et tirent profit d’un infect commerce.
Si le fait existe, madame, c’est que vous n’arrivez pas à faire respecter la loi et que, conséquemment, vous n’avez rien à faire là et surtout vous êtes incompétente pour prétendre en pondre de nouvelles, lois. Car le proxénétisme - délinquance effectivement abjecte - est interdit et fortement puni par la justice.
Mais vous ne connaissez absolument rien, sinon ce que vous savez de vous-même, aux filles que vous voulez supprimer et vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Et celles qui exercent leur petit métier de marchandes de plaisirs éphémères vous envoient certainement, avec toute l’éloquence populaire dont elles font parfois montre, les cinq lettres.
Mais soyons rassurés, nous autres, les méchants et les pervers. Les filles de joie existeront bien après que cette ministre de la feinte pudeur aura disparu du champ magnétique des mascarades et compromissions politiques.
Elle ne sera passée par ici, somme toute, que pour se couvrir de ridicule aux frais de la République.
Et gageons dès à présent que si les filles produisaient au fisc des déclarations en bonne et due forme, avec factures détaillées et nature des prestations fournies, le missionnaire à 5,5 % de TVA, par exemple, la fellation et la levrette à 20%, le cunnilingus et la sodomie, produits de luxe, taxés à 33%, madame la toute jeune ministre laisserait tomber le masque, mettrait sa morale dans sa poche et se retrouverait la première proxénète du royaume.
11:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, politique, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.01.2013
La violence historique - 4 -
 Plutôt que de titrer La violence historique, j’aurais sans nul doute été mieux inspiré de parler de violence insurrectionnelle, celle qui intervient quand les contradictions des intérêts sociaux ne peuvent plus trouver résolution que dans l’affrontement direct.
Plutôt que de titrer La violence historique, j’aurais sans nul doute été mieux inspiré de parler de violence insurrectionnelle, celle qui intervient quand les contradictions des intérêts sociaux ne peuvent plus trouver résolution que dans l’affrontement direct.
J’étais parti d’une phrase imbécile lue sur Robespierre, donc de la Révolution française et, plus précisément, de la Terreur, dont je demandais - et ce quel que soit le degré d’aversion qu’on puisse éprouver à son égard - qu’elle soit lue avec les yeux de l’époque révolutionnaire, c'est-à-dire le temps des coalitions militaires de toute l’Europe, des menaces d’invasion du territoire par ces coalitions, du soulèvement de la Vendée, de l’entrée en dissidence d’une dizaine de grosses villes, dont Lyon, Nantes et Bordeaux, du manque de farine et de pain et cætera, et non avec les yeux "apaisés", éteints, morts, de la nôtre.
La violence historique ne s’exprime donc évidemment pas que sur des barricades et par le renversement manu militari des pouvoirs en place. Elle s’exprime dans les attentats, les actes individuels, les lois liberticides, la brutalité du système financier, l’iniquité permanente du système économique, la pauvreté du plus grand nombre.
En entamant ce sujet que je vais sans doute clore aujourd’hui, il m’apparaissait évident que je me situais hors du champ politique tel qu’il est investi depuis l’instauration du suffrage universel, c’est-à-dire par des gens qui ne peuvent que trahir leur discours sitôt leurs fesses installées dans les fauteuils moelleux de la République. Ça me semblait évident car je ne m’adresse ni à des naïfs, ni à des militants pour une gestion sociale de la misère. Je m’adresse à des gens qui voient plus loin que le bout de leurs possibilités à terme, à des rêveurs, des poètes, des révoltés, des utopistes, des coléreux, des pour qui le masque du carnaval politique est définitivement tombé et qui réclament néanmoins encore le droit de vivre leur vie et d’émettre des opinions hors du cercle vicieux, mensonger, falsifié, des oppositions traditionnelles gauche, droite, centre et autres labels de la décomposition démocratique qui, depuis plusieurs siècles, ont fourni les preuves de leur vilenie.
Je pense et redis donc que la violence insurrectionnelle est le marque-page du grand livre de l’histoire, que c’est elle qui indique à qui veut bien lire ce livre sans les lunettes de ses intérêts immédiats, de ses peurs et de ses engagements dans la comédie politique, où nous en sommes réellement de la course de l’histoire.
Cette violence ne s’est pas exprimée en France depuis la Commune de Paris, que l’idéal démocratique noya dans le sang, le meurtre, les viols, les exécutions sommaires et de masse, les déportations.
Depuis, n’en déplaise aux démocrates progressistes qui se croient à la page parce qu’ils ont cessé de lire le monde, nous n’avons pas avancé d’un pouce et j’en veux pour preuve qu’aucun pouvoir, qu’aucun gouvernant, qu’aucune République, qu’aucun réformateur à la gomme n’a même songé, ne serait-ce qu’à titre symbolique, à débaptiser les avenues, les parcs et les rues des grandes villes qui honorent la mémoire infâme de cet infect boucher que fut Adolph Thiers.
Parce que la dernière grande déroute du peuple est là et que tout le reste s’est construit sur et grâce à cette déroute, avec l’aval de tous les opposants aux divers gouvernements.
D’ailleurs, si j’étais certain de les avoir encore à mon crédit, devant moi, je parierais 20 ans de mon existence que la violence insurrectionnelle, quand elle refera immanquablement surface, trouvera devant elle, pour la conjurer dans le sang, des Thiers issus aussi bien de l'église Copé, Hollande, Mélenchon, Le Pen que de tout autre accapareur de la parole décadente. Toute cette clique se croise, se rencontre et se flagorne aux hasards des couloirs de parlements, des loges maçonniques, des remises de décoration, des commémorations et autres grandes kermesses républicaines.
Je l’ai déjà dit : la violence est incontournable si l‘on veut changer de chapitre. Le reste n'est que tergiversation intéressée à la pérennité du désastre.
Le dilemme est dans le souhaitable ou non de cette violence et je me suis exprimé sur le sujet.
Et c’est parce qu’ils la croient définitivement muselée que les escrocs de la parole politique se croient du même coup autorisés à singer cette violence et à proposer dans leurs discours publicitaires les motifs mêmes sur quoi elle éclatera certainement.
Mais, comme dit l’autre, il y a déjà longtemps que je verrai le monde par en-dessous, côté racines des fraisiers.
Alors, j’en parle à mon aise… et il me reste surtout à vivre en dehors des controverses de salon. Profiter de la vie sans avoir à endosser la soutane et le goupillon de causes qui, à force d'être remises aux calendes, ne sont plus que causes de causeurs.
14:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.01.2013
Fontenelle et mézigue
 Fontenelle, alors quasiment centenaire, eut ce trait d’humour noir et de quasi triomphe qui m’est resté à l’esprit : Je n’ai plus d’ennemis, ils sont tous morts !
Fontenelle, alors quasiment centenaire, eut ce trait d’humour noir et de quasi triomphe qui m’est resté à l’esprit : Je n’ai plus d’ennemis, ils sont tous morts !
J'angoisse fortement, quarante ans avant d'avoir atteint l’âge canonique du philosophe, d’être bientôt contraint de lui emprunter son sarcasme en parlant de mes amis…
En attendant ce jour noir, je reprendrai lundi mes élucubrations sur La violence historique.
Je vous souhaite à tous un week-end bien vivant à tout point de vue !
10:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.01.2013
Chagrin, chagrin, chagrin !
 Je vous parlais de violence historique… Qu’en ai-je à foutre de la violence historique ?
Je vous parlais de violence historique… Qu’en ai-je à foutre de la violence historique ?
Ce matin, la violence, la violence du cœur, la vraie violence, la violence de la mort, vient de me frapper de plein fouet et je n’ai que des larmes à offrir au désespérant inconnu .
Un mail de sa compagne m’apprend que Patrick Clémence, mon premier éditeur, mais, bien au-delà, mon copain, mon camarade, mon ami, mon frère de l’anarchie joyeuse est décédé alors que j’étais en France pour la musique, le 26 octobre.
Il avait 64 ans.
Je ne savais pas. Je suis si loin !
Cet homme, ce poète, ce combattant, ce cœur ouvert à tous vents, je l’avais rencontré en 1999. Nous avions un livre en commun et un amour partagé pour Brassens, l’anarchie, la poésie, la joie de vivre…
Nous en avons éclusé des demis de bière ensemble et des petits vins de comptoir ! Un matin d'été à Mauzé-sur-le-Mignon, nous nous étions engouffrés dans un bistro pour une première petite bière (dixit) avant de nous rendre à une signature de livres au Centre culturel et, là, nous avions eu toutes les peines du monde à convaincre la tenancière que nous n'étions pas des frères jumeaux ! Je ne suis même pas certain qu'on ait réussi, à la convaincre...
Le monde vient de se vider d’un de ses chants les plus chers à mon oreille.
Lecteur, toi qui ne l’as pas croisé, tu peux, ici, pour moi, lui rendre un dernier hommage en regardant sa si bonne bouille et en écoutant son sourire voler aux rendez-vous du temps qui passe et qui tue. Tu peux également lire ici, quelques mots sur cet homme qui fut cher à mon coeur et qui, par-delà l'implacable camarde, le reste.
J’aimais cet homme d’une grande fraternité.
Chagrin.
Je hais la mort !
10:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.01.2013
La violence historique - 3 -
 Les hommes qui ne doutent jamais de leurs convictions - intellectuelles, mais aussi sensibles et viscérales - ne sont pas des hommes mais des réservoirs d’idéologie. Des ersatz de libre arbitre.
Les hommes qui ne doutent jamais de leurs convictions - intellectuelles, mais aussi sensibles et viscérales - ne sont pas des hommes mais des réservoirs d’idéologie. Des ersatz de libre arbitre.
Je suis bien, je suis à l’aise, avec certaines de mes idées, de mes visions de l’homme et du monde et pas vraiment convaincu de certaines autres qui, bien que je les sente très vivantes en moi depuis les primes aurores, ne me semblent pas toujours à leur place.
Profondément séduit par la pensée anarchiste dès l’adolescence, puis, un peu plus tard, par ses lumineuses remises à jour situationnistes, celles de Vaneigem bien plus que celles de Debord parce qu’ayant plus directement prise sur le sensible, j’ai parfois l’angoisse d’avoir toujours interprété le monde, ses contradictions et ses coercitions avec un compas réglé sur une théorie. D’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé.
Ceci étant dit, j’ai trouvé exprimé dans le Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations tout le sentiment du monde que j’exprimais moi-même confusément quant à la vie quotidienne, l’ennui, l’amour, l’amitié, le désir d’affranchissement des aliénations. Ce livre m’a enseigné que mon mal de vivre, que l’on a tendance à prendre adolescent pour une disposition individuelle à un romantisme de bon aloi, était partagé par des milliers de jeunes gens chez lesquels il avait à peu près les mêmes causes et les mêmes effets. Même découverte de ce sentiment dans La Société du spectacle, plus théorique et d’un abord beaucoup plus difficile, puis, des années plus tard, dans Le livre des plaisirs aussi bien que dans le Chevalier, la Dame, le Diable et la mort, bien après La Véritable scission dans l’internationale situationniste, donc, de 1972.
Mais je viens d’écrire une grosse bêtise en affirmant […] d’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé. Car le nombre d’individus, parmi les pires ennemis de la pensée et de la pratique situationniste et anarchiste, qui se sont abreuvés à la source tarie du situationnisme, est absolument incalculable et les progrès de plus en plus inhumains du spectacle (soit la représentation de la vie vendue et vécue comme étant la vie elle-même) grand prédateur de l'authenticité de l’existence que nous connaissons aujourd’hui - du moins pour ceux qui savent encore ce que veut dire connaître - sont décrits quasiment mots pour mots dans La Société du spectacle, publié en 1967.
On n’attend pas la révolution comme on attend le car, disait-on. Ben non… Mais s’agissait-il vraiment de révolution ? La révolution n’est-elle pas, d’abord, la mise en pratique individuelle de sa vie en la protégeant autant que faire se peut des grandes obligations sociales d’un monde renversé plutôt qu’un échange de coups de fusil ? Si des millions d’individus se mettaient en devoir de vivre leur vie, leurs désirs, leurs espoirs, tout ce qu’ils portent en eux de profondément personnel, au lieu de se calquer sur une survie prédéfinie par un système dont tout le monde sait, chaque jour un peu plus, qu’il est, à tout point de vue, aussi bien moral qu'intellectuel, entièrement fondé sur le faux, la révolution n’aurait-elle pas les moyens de se dispenser de la violence historique ?
Les situs ne disaient pas autre chose en écrivant sur les murs : Ne travaillez jamais !
Ce fut sans doute une erreur. Car la phrase culte de Vaneigem, refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de mourir d’ennui, a été entendue à sa juste profondeur, telle une bombe à retardement posée dans la cervelle anesthésiée des hommes. Elle a été entendue et les tenants spectaculaires du pouvoir spectaculaire, pour désamorcer la bombe, ont depuis quarante ans érigé la pire des aliénations, le travail, en valeur absolue, incontournable, puissante, unique, sans laquelle l’homme n’est plus un homme capable d’accéder au bonheur de vivre.
Ce qui, par essence, est antinaturel, contraignant, contraire à l’amour et à la jouissance, est présenté et vécu comme le plus grand des bonheurs. Les luttes sociales, du même coup, ne sont pas des luttes pour l’existence, mais contre l’existence. Et sur la scène spectaculaire où se joue la misère d'un monde, on assiste à un de ses actes les plus grotesques, celui où les esclaves réclament à grands cris le fouet que les maîtres n'ont même plus les moyens de leur donner, tout occupés qu'ils sont à faire fructifier pour eux seuls et autrement les cargaisons engrangées par plus de deux cents ans d'exploitation forcenée de la galère sociale.
C’est tout ce que le monde renversé attendait des hommes pour continuer son renversement sur ce chemin qui, résolument, tourne le dos à la vie et s’en éloigne chaque jour un peu plus.
Avec la bénédiction de tous, maîtres, gardes-chiourmes et esclaves.
Dans de telles conditions, engager sa vie dans la violence historique pour remettre les choses à l’endroit, et ce envers et contre tous, me paraît aujourd’hui relever de la détresse du desesperado.
Il me semble beaucoup plus fructueux de protéger cette vie propre en lui faisant prendre les chemins de traverse et de solitude qui la préservent, jusqu'à son dernier souffle, des affres de la résignation.
14:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.01.2013
La violence historique - 2 -
Hier, je terminais mon texte en citant deux représentants de la parole spectaculaire, Mélenchon et Zemmour. C’était une erreur de le clore ainsi car il eût fallu préciser tout de suite ce que j’entendais par «aboyeurs inconséquents».
C’est là un des grands dangers, dont j’ai souvent parlé, de l’écriture numérique en direct qui, souvent, ne prend pas le temps de fixer avec recul les tenants et les aboutissants de la pensée. J’entends donc par aboyeurs inconséquents des gens qui font montre d'une certaine radicalité dans leurs propos ou leurs écrits et ne mesurent absolument pas le degré de violence historique que commandent ces propos ou ces écrits pour épouser une réalité. Ces aboyeurs inconséquents sont donc inconscients, ou, plus certainement, discoureurs irresponsables, c’est-à-dire qu’ils usent de la parole comme d’un acte en soi, comme d’une entité abstraite, séparée du monde qu'elle prétend critiquer.
J’entends donc par aboyeurs inconséquents des gens qui font montre d'une certaine radicalité dans leurs propos ou leurs écrits et ne mesurent absolument pas le degré de violence historique que commandent ces propos ou ces écrits pour épouser une réalité. Ces aboyeurs inconséquents sont donc inconscients, ou, plus certainement, discoureurs irresponsables, c’est-à-dire qu’ils usent de la parole comme d’un acte en soi, comme d’une entité abstraite, séparée du monde qu'elle prétend critiquer.
Mélenchon ne dit pas que des choses fausses ; bien au contraire. De même pour Zemmour. Mais ils mentent aussi bien l’un que l’autre car l’un et l’autre, chacun sur des positions qu'ils veulent contraires, mettent en scène les prémisses de la violence historique, tout en étant farouchement opposés à cette violence et en se réclamant profondément légalistes et grands partisans du jeu démocratique. Ce sont des gens de la réification en ce que le sujet vivant de l'argument ne poursuit pas d’autre but que de réduire ce sujet à un objet mort ; des gens comme il en existe des milliers sur la scène de la représentation politique.
Quand Mélenchon, ou Poutou, ou tout autre pseudo radical, dit qu’il faut en finir avec la finance, que de la dette publique on s’en fiche, qu’il faut s’occuper d’abord du bien-être des gens, que les créanciers prédateurs attendront et que le système de l’argent est à rayer de la carte parce qu'il asservit le monde, je ne pourrais qu’adhérer à fond s’il y avait derrière tout ça un désir ardent, autre que celui de la carrière politique, qui me dirait clairement, sans fioritures, comment l’aboyeur compte s’y prendre pour réaliser son discours.
Je n’adhère donc pas parce que la nature de la pierre angulaire est tue, refoulée, taboue : ces idées généreuses ne peuvent en effet dépasser le stade des idées que par l’affrontement direct, violent, jusqu’à ce qu’un vainqueur se dégage clairement de cet affrontement. Faire croire aux gens que par la seule puissance de leur bulletin de vote, ils vont changer la face du monde, que les banquiers vont venir docilement déposer aux pieds des vainqueurs de la consultation électorale leurs privilèges et leurs coffres-forts et qu'ainsi sera abattu un système inique, parfaitement rôdé, puissamment armé, doté d'une police à son entière discrétion, participe de l’escroquerie pure et simple. Tellement pure et simple qu'elle en est grotesque.
Quand intervient la violence historique, les aboyeurs, au mieux, se taisent, au pire, se terrent. Parce que l’histoire démontre que cette violence, dont ils avaient pourtant fait, mais sans jamais la nommer, leur haridelle de fausse bataille, leur éclate au nez sans qu’ils l’aient vu venir et, niant la totalité de l’époque qu’elle se propose de dépasser, les nie en tant qu’éléments à part entière de cette époque. S’ils s’en tirent et restent sur scène, comme c’est souvent le cas, ce n’est qu’au moment du reflux de la violence, par cet art de la récupération de la colère qu’ils connaissent tous et savent manier à merveille.
Personne, à moins d’être un voyou ou un désaxé, ne peut appeler de ses vœux que les hommes s’arment les uns contre les autres et entreprennent de s’égorger. C’est pourquoi les espoirs d’une société humaine où serait reine la seule jouissance d’exister, est un espoir résolument torturé par une douloureuse contradiction. Quand on aime la vie, quand on aime sa vie, cet amour passe, commence même, par un respect chaleureux de la vie des autres.
Respect, qu’hélas, n’ont pas, n’ont jamais eu et n’auront jamais les grands maîtres argentiers de ce monde et tous leurs misérables valets.
Là encore réside toute la difficulté humaine qu’il y a à vouloir parler avec sincérité, aussi bien intellectuelle que viscérale, de la violence historique.
A suivre
11:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.01.2013
La violence historique - 1 -
C’est un vaste sujet que celui ayant trait à la violence historique. Le cadre étroit d’un texte ordinairement couché sur un blog ne saurait donc satisfaire à l’exigence de clarté que commande sa gravité, si tant est qu’on veuille le sérieusement traiter. De plus, je n’ai sans nul doute pas tous les éléments en ma possession pour en faire une analyse complète et quand bien même les aurais-je, que je n’aurais ni la compétence, ni le temps et ni la patience pour mener à bien un tel dessein.
De plus, je n’ai sans nul doute pas tous les éléments en ma possession pour en faire une analyse complète et quand bien même les aurais-je, que je n’aurais ni la compétence, ni le temps et ni la patience pour mener à bien un tel dessein.
Depuis longtemps, j’ai néanmoins sur la question une idée assez précise, et, contradictoirement, fort complexe, pour avoir envie d’en brosser quelques traits tirés de l’histoire, de ma lecture du monde contemporain et de mes expériences personnelles.
Le déclic de cette réflexion embryonnaire fut une phrase lue dans un livre en deux volumes que l’on m’a récemment offert et que je parcourais en diagonale il y a quelques jours. Un livre dont je n’avais jamais entendu parler et dont l’auteur m’est complètement inconnu, Les 76 jours de Marie-Antoinette à la Conciergerie, de Paul Belaiche-Daninos.
Il arrive bien souvent qu’on lise des stupidités qui font grincer des dents. Qui hérissent le poil, comme on dit. Et puis c’est tout... Mais là, ce fut comme une goutte d’eau qui aurait fait déborder un vase patiemment rempli par le goutte-à-goutte de l’intoxication permanente de la parole et des écrits depuis des décennies. J’ai formulé tout haut la vanité suivante : non, il ne faut pas laisser passer ça ! Car ce fut bien une des plus grosses absurdités qu’il m’ait été donné de lire depuis longtemps. Une grossièreté, un contresens, une ineptie sans bornes étalée sans vergogne dans les toutes premières lignes d’un livre qui, à en croire sa quatrième de couverture, se veut pourtant un récit historique :
De nos jours, au vu des lois qui régissent les droits des prisonniers, Robespierre et ses acolytes, seraient condamnés pour crime contre l’humanité.
Même en passant sur le terme bas «acolytes», c’est en dire assez long sur la vision de l’histoire de cet auteur et l’angle d’attaque de son propos en dit également assez sur sa partialité, sur son idéologie et sur le but poursuivi, pour avoir envie de refermer l’ouvrage aussitôt. Ce que je fis.
Qu’on me comprenne bien. Je ne suis pas du tout disposé à me faire l’avocat du célèbre avocat trancheur de têtes. Je suis en revanche tout disposé à le lire historiquement et non pas en le ressuscitant, pas plus lui qu’aucun autre, dans un cadre juridique né près de deux cents ans après sa mort ! Quelle indigeste idiotie !
Avec cette dialectique étroite, on pourrait dire aussi qu’un tribunal international jugerait aujourd’hui Jules César sous le même chef d’inculpation pour avoir traîné, enchaîné et pieds nus, Vercingétorix depuis l’Auvergne jusqu’à Rome. Que ce même tribunal poursuivrait pour crime contre l’humanité Néron, Caligula, Napoléon, Adolf Thiers, Charlemagne, les catholiques de la Saint-Barthélemy et de l’Inquisition, bref, la liste est trop longue, chaque épisode historique, chaque pas fait depuis la fin de la préhistoire jusques à nous, serait à même de fournir au tribunal son lot de criminels contre l’humanité. Ce qui est certainement vrai, mais ce qui n’a aucun sens si on considère les hommes sans les extraire de leur époque.
Dans le même esprit, en amalgamant le temps, les esprits, les nécessités, l’avancée des consciences et les technologies, bref en jugeant et pensant le passé à travers le prisme commode du présent, on pourrait dire, et, pire, même écrire comme le fait cet auteur, que si cet imbécile naïf qu’était Napoléon avait pensé à se doter d’une flotte d‘avions de chasse, il aurait bombardé Moscou avant d’y entrer et que si Jules César, autre grand candide, avait eu l’idée de mettre sur orbite des satellites de surveillance le renseignant sur les tribus gauloises, leurs mœurs exactes et leurs mouvements, la guerre des Gaules aurait duré beaucoup moins longtemps.
On le voit. Phrase stupide qui mène à des stupidités à se tenir les côtes. Livre qui ne l’est sans doute pas moins, bien que, ou peut-être parce que, couronné par l’Académie. Mais laissons cela. Ce n’était qu’un déclic.
S’il fallait répertorier toutes les idioties qui s’écrivent et toutes les malversations des argumentations employées, on y perdrait son chemin.
Les époques, c'est comme les humeurs de la météo : chacune succède à celle-là et précède infailliblement celle-ci. Mais la comparaison - abusive je vous le concède - s'arrête là car chaque changement d’époque mijote d’abord dans un chaudron de haine et de frustration avant d’être servi aux convives de l'histoire, libres ou manipulés, avec une violence plus ou moins exacerbée.
Chaque fois que les hommes ont sérieusement pensé à la nécessité de changer radicalement d’époque, la poudre a parlé et le sang a coulé. Aucune page du grand livre n’a été tournée sans que les hommes ne s’entre-tuent. Et c’est bien ce que voudraient nous faire oublier les réformateurs atones qui accèdent chacun à leur tour, telles des marionnettes sur le cirque, ici ou ailleurs, au pouvoir. Pour eux, la violence historique, celle qui ne s’éteindra qu’avec l’humanité, c’est chez les autres. Aux antipodes. La Syrie, la Lybie, le monde arabe… Chez nous, rien de tel, voyons ! Les hommes grondent mais ne mordent plus ; comme si, tel un chien, l’histoire s’était définitivement couchée à leurs pieds, en avait fini de ses courses folles et ronronnait maintenant sur leurs pantoufles, et ce jusqu'à la nuit des temps. Du moins de le leur.
Nous ne partageons évidemment pas la même vision, candide, intéressée, mensongère et abrutissante des choses. La société des hommes est un magma qui, toujours, un jour ou l’autre, trouve le cratère pour jaillir hors de l'écorce qui la retient prisonnière.
Le monde ne se change qu’à condition de violence.
C’est pourquoi, n’ayant aucun goût pour la violence armée et éprouvant un incommensurable dégoût pour la mort volontairement distribuée, même à nos pires adversaires, sommes-nous amenés, si nous voulons être autre chose qu'un blogueur coléreux ou qu'un aboyeur inconséquent tel que Mélenchon ou Zemmour par exemple - ou que tout autre marchand d'idées pseudo-radicales - à réfléchir sincèrement à nos désirs de changement de société, sachant que les pacifiques urnes sont mis en place non pas pour changer le monde et les conditions faites à la vie mais bien pour conserver les deux en l’état.
A suivre
13:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.01.2013
André Hardellet, Julien Gracq, Brassens...
 Face aux poètes et aux grands écrivains, la justice avec un j minuscule, celle des grands de ce monde, de la propriété privée, de la magouille légale justifiée et cautionnée par la morale coercitive judéo-chrétienne, s’est souvent ridiculisée.
Face aux poètes et aux grands écrivains, la justice avec un j minuscule, celle des grands de ce monde, de la propriété privée, de la magouille légale justifiée et cautionnée par la morale coercitive judéo-chrétienne, s’est souvent ridiculisée.
Deux cas d’école viennent évidemment directement à l’esprit, Les Fleurs du mal, condamné pour «offense à la morale religieuse, outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs» et Madame Bovary, également poursuivi pour «outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs».
Retenons tout de même que Flaubert fut relaxé, en grande partie grâce à ses appuis politiques. Comme quoi, du XIXe au XXIe siècle, vraiment rien de nouveau sous le soleil de la combine…
On connaît donc ces deux cas parmi d’autres, multiples, mais peut-être connaît-on moins celui d’André Hardellet, condamné aux mêmes motifs en 1973 pour son roman Lourdes, Lentes, un livre généreux et tendre sur les phantasmes sexuels d’un jeune garçon, très bien écrit, dans un cadre campagnard bien dit.
Ce fut une condamnation honteuse, sous le regard indifférent d’un Président de la République à la gomme, qui se faisait pourtant gloire d’avoir écrit, ô misère, une Anthologie de la poésie française !
Hardellet, dont Breton, Pierre Mac Orlan et son ami Julien Gracq disaient le plus grand bien, ne se remit pas de cette condamnation infâme, déplacée, injustifiable : il mourut l’année suivante. Même amnistié par l'arrivée du Président tête de noeud.
Hardellet et Georges Brassens éprouvaient l’un pour l’autre une très grande estime. Compagnon de ce dernier, Mario Poletti (que j’eus l’heur de rencontrer deux fois à Vaison-la-Romaine), raconte dans son livre très bien documenté Brassens me disait :
« […] en juin 1974, André Hardellet me rend visite aux éditions Plon. Son visage est marqué par sa condamnation. Il me demande de lui fournir le livre La Vie après la mort, en vogue à l’époque. Quelques jours plus tard il disparaissait… »
Là, la justice ne s’était donc pas seulement ridiculisée : elle avait tué par procuration. Mais il est vrai que le ministre de l’intérieur à l’origine de la procédure, un grand salaud de première catégorie, Raymond Marcellin, avait été salué par De Gaulle à son arrivée au ministère de l’intérieur en mai 68 - en remplacement de Christian Fouchet - par un retentissant : Enfin Fouché, le vrai ! En référence à l’abominable ministre de la police de Napoléon Bonaparte.
Pas toujours très fin, «l’homme providentiel», surtout dans ses conceptions de l’Etat policier.
Il est vrai aussi qu'un peu plus tard, ce Marcellin, cette ordure élevée au pinacle politique, sera pris la main dans le sac à installer des micros au Canard enchaîné. La fameuse affaire des faux plombiers de Marcellin.
A ce procès honteux, donc, d’André Hardellet, étaient venus pour lui témoigner amitié, solidarité et soutien, de nombreux amis, dont Julien Gracq et Georges Brassens.
Rien n’y fit. Pour Marcellin, père spirituel de Charles Pasqua, la poésie et la littérature n'étaient qu'affaire d'anarchistes subversifs et sans doute le fait d’être soutenu par des olibrius pareils était à ses yeux un aveu encore plus fort de culpabilité et de perversité totale de l’esprit.
Avant qu’André Hardellet ne soit appelé à la barre, un autre justiciable avait à répondre de ses actes devant les chats fourrés. Il s’agissait d’un homme qui était intervenu chez une dame en instance de divorce sous une fausse identité d’agent de police, mandaté par son ami, le mari, pour y soutirer je ne sais quoi ou y exercer je ne sais quelle contrainte.
A l’énoncé des motifs de poursuites par le juge, Brassens s’était penché sur l’épaule de Mario Poletti et lui avait murmuré : Ce n’est déjà pas glorieux d’être un flic, mais se faire passer pour tel, c’est bien pire encore !
Les flics, la justice, les poètes, les hommes de cœur et d’esprit ne faisaient pas bon ménage, en ce temps-là... Et quand je vois aujourd’hui les poètes à la ramasse, les artistes de pacotille, les philosophes à la noix, les hommes d’esprit qui ont de tout à revendre sauf de l’esprit, fricoter avec les imbéciles au pouvoir, national ou local, ça me donne envie de gerber ce que je n’ai même pas encore bu.
Ça me donne surtout envie de n'avoir jamais rien de commun ni rien à partager avec tous ces vendus au plus offrant.
Illustration : Hardellet et Brassens pour la sortie en librairie du recueil de poèmes Les Chasseurs deux
10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.01.2013
Chemineaux 52

L’entrée est libre et, si le cœur vous en dit, c’est par ici.
Ce sera un blog à durée déterminée, cette durée déterminée étant le pari que j’ai fait (et proposé à mes deux acolytes) sur sa pérennité. Il voguera pendant les douze mois de cette année avec un texte par semaine, le mercredi, avant de se saborder en décembre.
Si toutefois il ne fait pas naufrage avant. Sait-on jamais… Même quand on pose à sa promenade une limite dans le temps, il arrive qu’une tempête vienne en contrarier la route, n’est-il pas ?
Si vie me prête vie jusque là, je devrais de mon côté venir à votre rencontre encore cette année sur l’Exil des mots, un rendez-vous qui aura six ans en juillet prochain, quand le soleil sera un peu plus haut sur l’horizon du temps qui passe.
Regroupés, les textes mis en ligne en 2012 sont au nombre de 148- remises en ligne exclues - et constituent un fichier de 608 790 caractères répartis sur 211 pages.
Je ne sais pas si c’est beaucoup ou peu. C’est en tout cas ce que j’ai fait et je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être en avez-vous rien à f….
Mais bon…
Cette activité blog est toujours pour moi une source d’interrogation. Je ne sais pas exactement quel en est le but, je ne sais pas quelle est la nature réelle du plaisir que j’y trouve. Existentielle ? C'est toujours ce qu'on dit quand on ne sait pas trop quoi dire. Parce qu'il ne veut rien dire du tout, ce mot. Un raccourci d'imbécile pour faire intelligent.
Il faut pourtant bien que ce plaisir existe quelque part puisque le blog existe. Sans quoi, il y a longtemps qu’il aurait été expédié d’un savant coup de clic dans les poubelles du nul et non avenu. Dans ma vie, je n’ai jamais rien fait longtemps qui m’ait été pénible. J’ai toujours fait le tri et pris la tangente dès que quelque chose devenait un peu lourd à porter.
J’aimeraiS bien, d’ailleurs, que d’autres blogueurs me fassent part de la nature du rapport qui les lie vraiment à leur blog. Je mets évidemment un S gigantesque et conditionnel à mon verbe, car je sais très bien qu’aucun ne se livrera, en tout cas pas à moi ni en public. Et ce, non pas parce qu’ils sont comme ci et comme ça, en tant qu’hommes et femmes - que je ne connais ni des lèvres ni des dents - mais parce qu’un blogueur, c’est comme ça : ça cause mais ça ne se livre point, tout occupé que c’est à alimenter son tonneau des Danaïdes.
Un blog fonctionne comme s’il n’avait pas d’auteur réel, en fait. Pas d’auteur de chair et de sang, avec des joies, des tourments, des détresses, des espoirs, des haines et des amours. Humainement, je veux dire, de cœur, d’être en profondeur, parce que je n’appelle ni haine ni espoir ce qui se situe sur le discours déplorable de la politique ou sur la critique désincarnée, un peu pédante, de tel livre ou de telle autre production de l’art.
Un blog, c’est parfois un nom, une signature. Dans le meilleur des cas, une photo et dans le pire, un à propos aussi lapidaire que bateau, aime la littérature, la musique, la randonnée, le cinéma… Jamais les femmes, ou les hommes, par exemple. Tabou, tout ça. Un à propos, c’est comme une cuillérée de poudre balancée aux yeux pour éloigner les curieux de la vie. Regardez comme j’écris bien, mais je ne vous dirai pas qui je suis. Ça remplit la fonction exactement contraire de sa raison d’être. Et c’est bien normal dans un monde à l’envers, n’est-ce pas ?
Bref, c’est comme ça. A vrai dire, je m’en fiche un peu. Mais c’est la raison principale pour laquelle je ne lis plus que deux ou trois blogs et n’intervient plus guère que sur deux.
Car j’ai désappris à discuter avec les fantômes qui ne m’ont pas été chers de leur vivant.
13:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
31.12.2012
Un conte de noël polonais
 Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison recouverte de neige et balayée par les vents de la plaine ; une maison pauvre, avec des parents pauvres.
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison recouverte de neige et balayée par les vents de la plaine ; une maison pauvre, avec des parents pauvres.
Il croyait au père-noël. Dur comme fer. Une vraie foi du charbonnier, qu’il avait le petit garçon pauvre.
Ainsi chaque année s’appliquait-il à écrire une belle lettre au mythique barbu, une lettre bien tournée, pleine de tendresse. Il décrivait sa maison, la neige, le froid et demandait des jouets, des chocolats, des bonbons. Tout ce qui peuplait ses rêves de petit garçon.
Il partait alors par les chemins ouverts sur les grands champs tout blancs et allait, bravant les blizzards et les tourbillons de flocons, jusqu’à la poste de la ville la plus proche pour y poster sa lettre. Puis il attendait, il attendait… Rien jamais ne venait.
Alors il regardait les nuages, interrogeait le vent et, chagrin, versait des larmes de solitude.
Cependant les employées de la poste, chaque année ouvraient la lettre dont elles savaient bien qu’elle ne trouverait aucun écho. Attendries jusqu’aux larmes, elles décidèrent enfin de se cotiser et d’envoyer dans un joli colis toute la liste des friandises et des jouets auxquels rêvait le petit garçon.
Hélas, hélas ! Inhumaine misère des administrations, le colis mirifique se perdit dans un tri quelconque et ne parvint jamais à son petit destinataire.
Alors l’enfant une fois encore pleura et, l’année suivante, il prit sa plus belle plume, écrivit sa missive et, toujours bravant la neige et le froid, partit la poster :
Mon petit papa noël chéri,
Je sais bien que tu es bon, que tu m’aimes de tout ton cœur et que chaque nuit de noël tu penses à moi. Je n’ai jamais douté de Toi. Mais ce sont ces salopes de la poste qui ouvrent les colis et volent mes friandises et mes jouets. Je le sais bien…
10:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.12.2012
J'veux des vœux !
2012. Et voilà que se termine une année qui n’a pas tenu la plus fantasmagorique de ses promesses !  Merde alors ! On pensait en effet, bien qu'en sourdine, en finir le 21 décembre avec toutes les complications de l’existence - le rhume du chat, les impôts, les factures impayées, la morosité de la littérature, les grotesques fillonnades et copénades, les tergiversations sauce hollandaise, la croissance cacochyme, le chômage qui va de pair, les amours qui s’érodent, les amitiés qui s’envolent, le robinet de la chasse d’eau qui fuit, le prix de l’essence et plein de choses encore - et voilà que le premier de l'an arrive sans que le moindre frisson n'ait encore fait trembler la moindre branche du moindre arbuste. Le jugement dernier est remis aux calendes et le calendrier maya n’est plus qu’un ramassis de couillonnades !
Merde alors ! On pensait en effet, bien qu'en sourdine, en finir le 21 décembre avec toutes les complications de l’existence - le rhume du chat, les impôts, les factures impayées, la morosité de la littérature, les grotesques fillonnades et copénades, les tergiversations sauce hollandaise, la croissance cacochyme, le chômage qui va de pair, les amours qui s’érodent, les amitiés qui s’envolent, le robinet de la chasse d’eau qui fuit, le prix de l’essence et plein de choses encore - et voilà que le premier de l'an arrive sans que le moindre frisson n'ait encore fait trembler la moindre branche du moindre arbuste. Le jugement dernier est remis aux calendes et le calendrier maya n’est plus qu’un ramassis de couillonnades !
Quand même, on ne respecte plus rien en ce monde qui n’en finit pas de finir !
Mais ce fut quand même une belle réussite, allez, cette galéjade de l’esprit de néant relayée par les sectes, les mystiques, les paranos, les désespérés, et, même, certains astronomes et revues à délires scientifiques. Ce chapitre de la stratégie générale de la peur, celle qui plaque au sol n’importe quel esclave aux velléités de Spartacus, même s’il n’a pas fonctionné à fond, a quand même su ajouter un peu de piment fantastique à la sauce.
Deux choses gouvernent aujourd'hui le monde d’une main de fer : la peur et la peur de la peur.
Peur du réchauffement climatique et des cataclysmes météorologiques qui s'ensuivront, peur d’un virus cruel, effroyable et nouveau, d’une bactérie aguerrie à tous les antibiotiques connus, peur d’aimer à l’improviste cause sida, peur des aérogares où rôdent de méchants terroristes, peur de la grippe, peur de la guerre, de l’explosion d’une centrale nucléaire, d’un nuage de cendres échappé d’un volcan, de se retrouver comme un con sur le trottoir avec plus rien à vendre de son corps, de son âme et de son temps, et, in fine, même quand on est un gars fort, équilibré et raisonnable comme moi, peur d’être obligé un jour d’avoir peur de toute cette peur.
On pleure donc avant d’avoir mal. On verse, en quelque sorte, en tout domaine, un acompte à une catastrophe putative dont le rôle est de faire oublier que les conditions faites à la vie sont déjà catastrophiques. Pendant ce temps-là, les banques, qui, comme chacun le sait, n’ont peur de rien, font leurs choux gras. Elles vendent des mouchoirs pour que les gens essuient leurs larmes préventives. Bientôt elles trouveront que tout ça ne pisse pas assez dru, alors elles vendront des oignons, vous verrez…
Ah, misère ! Mais rassurez-vous, chers lecteurs, l’année qui vient sera bonne. Ce sont les rimes qui le disent et les rimes, c'est pas comme les calendriers, ça rime à quelque chose :
Deux mille douze,
Année du blues,
Deux mille treize,
Année de la baise.
Quoique cette rime, la dernière, soit pauvre et quand même tendancieuse, à double tranchant.
Enfin, on verra bien. On prendra ce qui viendra, hein ? Comme d’habitude.
Mais ça me fait quand même plaisir de vous souhaiter la santé et le bonheur pour les huit mille sept cent soixante heures qui s’annoncent néanmoins, à peu de choses près, tout comme les mille sept cent soixante qui viennent de s'écouler et, surtout, de Nous écouler
07:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.12.2012
Edito d'une quatrième expérience
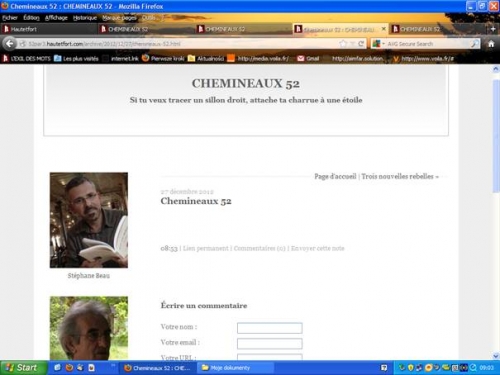 Encore un nouveau blog ! Collectif en plus ! Popopopopopo… !
Encore un nouveau blog ! Collectif en plus ! Popopopopopo… !
Il me semble t’entendre d’ici, lecteur.
Et tu as quelque part un peu raison : dans l’océan multiple, cloisonné, composite, obscur, étal, d’un blog monde où chacun surfe avec plus ou moins de délectation et de bonheur sur sa vaguelette, quelle prétention à l’existence peut bien avoir cette nouvelle goutte d’eau ?
L’ambigüité de la réponse est assez claire : nulle et immense.
Nulle parce que ce nouveau blog, comme tous les autres au demeurant, n’aura jamais l’envergure d’un acte capable d’intervenir favorablement ou défavorablement sur la marche générale des choses.
Immense parce qu’il est un blog né du bon plaisir de ses trois auteurs et que si ce plaisir est assez transparent pour t’en offrir un brin, alors il aura pleinement assumer sa raison d’être.
Les Sept mains, Tempête dans un encrier et Non de non, ont eu cela de commun : les auteurs s’y sont succédé mais deux seulement ont participé aux trois expériences, Stéphane Beau et moi-même.
Aussi avions-nous depuis longtemps l’envie de tenter une quatrième complicité. Mais laquelle ?
Dans ce genre d’entreprise, nous avons pu l’un et l’autre le constater, le prime enthousiasme fait vite place à la lassitude, les textes se font plus rares et plus courts, sont moins originaux, moins travaillés, au fur et à mesure que passe le temps. Un blog collectif meurt souvent de l’épuisement collectif des motivations individuelles.
J’ai donc soumis à Stéphane l’idée suivante : ouvrir un espace à durée déterminée et le faire vivre avec des textes aux fréquences elles-mêmes relativement espacées. J’ai ainsi proposé comme espace temps l’année 2013 et comme fréquences un texte par semaine.
De cheminer, donc, sur les 52 semaines par 52 textes. Le blog portera donc le titre de Chemineaux 52.
Stéphane a émis la réserve, avec juste raison sans doute, selon laquelle ce cheminement tout au long de cette année effectué à deux voix seulement courait le risque de la monotonie. Il m’a alors proposé que notre compère des Trois nouvelles Rebelles, récemment parues aux éditions du Petit Véhicule, Philippe Ayraud, se joignent à nous.
C’est donc les trois auteurs de ce petit recueil qui, l’un après l’autre, du jeudi 3 janvier au jeudi 26 décembre 2013, viendront ici offrir leur écriture en partage.
J’ouvrirai le bal le 2 janvier, jour de la mise en ligne, suivra Stéphane le jeudi 7, puis Philippe le jeudi 14 et ainsi de suite.
A très bientôt, donc, si cela te chante, lecteur. En tout cas, bonne année 2013 à toi, plein de vie, de désirs accomplis et de déboires évités, où que tu sois, qui que tu sois et quels que soient tes sentiments et jugements à mon égard !
Bertrand
12:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.12.2012
Le bonheur, une idée primaire
Dans un monde et une époque - indissociables- où la peur, la tristesse et le malheur des gens sont planifiés en arguments de vente de la politique, seule la volonté, affirmée, réelle et vécue, d'être heureux est subversive.
Le bonheur, c'est le vers dans la pomme.
Hélas quand je regarde en arrière - et c’est souvent - j’aperçois une foule d’incohérences, des kyrielles de non-sens, des tonnes d’absurdités qui encombrent cette recherche primaire, élémentaire, du bonheur.
Et j’en suis, conséquemment, chaque jour plus  amoureux de mon présent. Ce qui, contradictoirement, n’est ni fat ni confortable, la substantifique moelle d’un présent étant son caractère forcément éphémère.
amoureux de mon présent. Ce qui, contradictoirement, n’est ni fat ni confortable, la substantifique moelle d’un présent étant son caractère forcément éphémère.
Quand je regarde en arrière, je ratisse très large : dans ma propre vie d'abord. Dans celle de ceux que j’ai pu croiser et aimer ensuite. Puis, élargissant considérablement le champ de vision, dans ce qui se dit et écrit et s’est dit et écrit, partout depuis des lustres et des lustres quant à la marche aliénée du monde. Disons, grosso modo, au cours des deux siècles d’histoire qui viennent de s’écouler.
En zoomant, je vois le coin de monde que j’habite, la vieille Europe, exprimée dans ma langue, la langue française.
Alors j'entends un inextricable chaos de discours et de déclarations des plus belles intentions ! Je vois et j'entends des combats au corps à corps, des assemblées, des élections, des guerres, des morts, des barricades, des trahisaons, des incendies, des empoignades, des polémiques, des crimes, des attentats, et des livres, des milliers et des milliers de livres.
Tout ça pour un résultat absolument nul : mécontentement toujours aussi général quant aux conditions faites à la vie. Malheur à tous les étages ! Jérémiades à chaque coin de rue !
Il me semble parfois que le hiatus est tellement énorme qu’il ne peut pas être. Trois alternatives s'offrent ainsi à mon âme perplexe :
- soit les hommes sont des impuissants, des larves n’ayant aucune prise sur leur destin,
- soit ils ne sont que des discoureurs sans aucune volonté d’agir,
- soit la recherche du bonheur consiste à être ou à paraître malheureux.
Car comment expliquer autrement l’éternelle défaite du bonheur face au monde réifié ?
Moi, qui ne vaux pas mieux qu’un autre, loin, très loin s’en faut, si je devais ne voir ce monde que laid, qu'injuste et que vilain, si je ne devais pas y vivre pleinement des moments de bonheur intense et être heureux, heureux de vivre avec tout ça, je me suiciderais. Je me tirerais une balle de 9 mm dans la tête. Pas dans le pied, comme le font les désespérés du malheur spectaculaire. Non. Dans la tête. Ce serait une vraie défaite, sans tambour ni trompette. Une défaite courageuse que bien d'autres avant moi ont assumée.
Quelques livres parmi les plus fins de ces deux derniers siècles, l’ont dit : si on veut changer radicalement le monde - car le monde, celui dont on parle, n’est fait, jusqu’à preuve du contraire, que de nous-autres et de nos différences - il ne faut pas s’attaquer par le postillon aux murs de ce monde, il faut se transformer soi-même en combattant.
C'est-à-dire se montrer capable d’exister. Être à la hauteur, dans sa propre vie, dans sa propre chair, dans ses propres désirs, et dans ses propres instants, de l'idée qu'on a de son propre bonheur.
Détruire ainsi l'idée même du bonheur, l'idéologie du bonheur, en étant heureux. Par tout moyen à sa convenance.
Mais il faut pour ce faire être ou devenir vraiment juste avec soi-même, volontaire, désirant, passionné, pas envieux pour deux sous, ni de gloire, ni d’honneurs, ni d’argent et…courageux, le courage étant d’abord celui de refuser d’avoir pieds et poings liés par les misérables acquis de la survie, ce réservoir où sont planifiés les malheurs, la tristesse et la peur.
Le courage. C’est bien cela qui fait défaut aux hommes pour être de sincères chercheurs de bonheur. Il y en eut, des gens comme ça. Trop peu pour que la fourmilière change de sous-bois et cesse sa laborieuse industrie.
Si les hommes arrêtaient de se complaire dans les chaînes de leurs illusions et désillusions quotidiennes, les jetaient aux orties, la fourmilière s’écroulerait d’elle-même. Ils le savent, les hommes.
Mais c’est tellement confortable, des chaînes ! C'est comme des rails pour le train ! Un prisonnier n'a pas d'initiative à prendre : il y a le lever, le café, la toilette sommaire, l'attente de la promenade, le déjeuner sommaire, la promenade encadrée, la sieste, le dîner et la nuit et le lever encore... Rien ne peut arriver de fâcheux à un prisonnier puisqu'on lui a confisqué le courage d'être libre.
Et combien en connaissez-vous, de ces prisonneirs du dehors, qui, pour les seules causes justes qui vaillent et qui sous-tendent toutes les autres, le bonheur, l'abolition de l’ennui, la redécouverte de la jouissance, seraient capables de prendre un train, un avion, la route, le bus, et de foncer loin de leur misère, vers la liberté d’être soi-même, en laissant derrière eux la maison payée à crédit, le p'tit bout de jardin, la bagnole, le quartier, le pays, les amis, la famille, les habitudes, les cotisations-retraite et d’assurances sociales, le chat, le chien, le p’tit bureau peinard et le p'tit salaire qui va avec ? Combien ?
Un ? Deux ? Trois ? Ce serait déjà un miracle. Alors je demande : mais que vaudrait donc une société reconstruite par des hommes qui n'auraient même pas eu le courage d'eux-mêmes, sinon le prix que vaut une société de zombies ?
Et le monde ainsi vilipendé par les chrysalides, toujours avec les mêmes idées, toujours avec les mêmes mots, toujours avec les mêmes slogans, toujours avec la même et fatigante générosité superfétatoire, toujours avec les mêmes peurs, va son bonhomme de chemin en écrasant les bonhommes d'humains...
Qu’il aille ! Je vais le mien. Dans, avec et sans lui.
Image : Philip Seelen
09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.12.2012
L'hiver
Les autochtones eux-mêmes en conviennent, c’est dire ! Avant noël, la neige ici est rarement aussi abondante et aussi constante, quotidienne, que cette année. Mon voisin regarde le ciel toujours prometteur de nouvelles chutes blanches et dit, les mains sur les hanches, hé ben on n’est pas arrivé au mois de 
Et oui, c’est bien ça qui tarabuste l’autochtone pourtant aguerri aux rigueurs de sa latitude. Les grandes intempéries, les couches de neige sans cesse renouvelées, les mercures qui descendent tellement bas qu’on dirait que les thermomètres ont été sabotés, tout cela, quand c’est en janvier, voire en février, on a quand même l’impression que l’on a entamé sa remontée vers le soleil. On a le grand mouvement des choses et ses jeux de lumière dans la tête.
D’accord, dit-on, c’est l’hiver, mais on remonte quand même la pente à chaque aurore qui se dessine en rose au-delà du Bug.
Mais là, on n’en a pas encore terminé de la descente, qu’on a déjà presque un mois de grand hiver dans le dos. Alors, on fait montre d’un certain pessimisme pour la suite de la traversée du tunnel. On craint de n'en voir le bout qu'épuisé.
Le pays se dessine en deux couleurs, noir en haut et blanc en bas. Le vent nous vient de Russie et, sur les routes, ramène la poudre neigeuse qui se faufile entre la forêt gelée et la plaine grande ouverte. Gare aux virages où elle s’entasse, cette neige, gèle et n’est bientôt plus que glace ! Pas trop de place pour la rêverie au volant.
Autour de ma maison, c’est un peu le mythe de Sisyphe. Je creuse, comme tout le monde, chaque matin des allées pour pouvoir vaquer à mes quelques occupations du dehors, je dégage le portail pour pouvoir bien l’ouvrir et accéder à la voie publique, et, au matin, je recommence car la nuit a tenté de tout effacer à la gomme blanche. Les talus de chaque côté de mes allées et venues s’élèvent un peu plus chaque jour. Bientôt, je marcherai entre deux remparts de neige.
J’avais toujours vécu sous les cieux chargés d’embruns, d’iode et de souffle marin. Dès lors, parfois je me dis que même si mes 2500 Km d’exil ne sont pas grand chose au regard des distances planétaires, je ne pouvais pas mieux contraster les climats.
Et j’ai toujours cette impression que tant de neige partout, sur les routes, les champs, les forêts, les sentiers, les maisons, les granges, les cours, les fermes, les trottoirs, les talus, n’arrivera jamais à se dissiper. Que le monde est définitivement livide.
Je sais pourtant la fragilité de cette couverture. Je l’ai vue. En deux jours, tout peut disparaître, comme si cela n’avait été qu’une illusion et la plaine se recouvrir soudain de larges étangs.
Pour l’heure, la blancheur est maîtresse. Pour deux ou trois mois, selon les humeurs à venir des masses d’air et des anticyclones.
La plus longue période enneigée qu’il m’a été donné de vivre ici, avait couru du 28 novembre au 15 mars. Presque quatre mois. Le quart de l’année.
Hum… Même si je trouve ça beau parce que je viens des plages, des algues et des rochers, vient un moment - là comme partout ailleurs et pas seulement en parlant des paysages et des climats mais aussi des hommes, de leur art, de leurs amours et de leurs propos - que le beau qu’on ne voit plus se transforme en laid.
Illustration : photo prise à treize heures, c'est-à-dire soleil au zénith
11:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.12.2012
Pêle-mêle

Son opposant principal, le nationaliste, populiste, réactionnaire Jarosław Kaczyński, déclarait hier qu’il y a certaines similitudes entre le 13 décembre 2012 et le 13 décembre 1981, jour de l’état de guerre décrété en Pologne et dont je vous parlais dans mon billet précédent.
Un journaliste demandant à Donald Tusk ce qu’il pensait de cette nouvelle extravagance mentale de son adversaire, celui-ci a répondu en substance :
- Il a raison. J'y vois une grande similitude. Le 13 décembre 1981, Kaczyński n’a été ni inquiété ni arrêté (comme le furent tous les gens engagés fermement contre l’ordre communiste, ndlr) et il ne sera pas arrêté non plus ce 13 décembre 2012.
Voilà qui devrait calmer l'orgueil patriotique du populiste, champion de la décommunisation, grand chasseur de sorcières et qui, depuis la catastrophe accidentelle de Smolensk, voit des traîtres et des agents de la Russie partout ! Jusques dessous son lit...
Un camarade polonais me disait une fois, alors que le thermomètre descendait à - 30 : Chez nous, l’hiver, c’est une guerre de tous les jours.
J’ai retenu la leçon et aujourd’hui, même s’il ne fait que -16, mon souci principal est de circuler sur la glace et la neige en prenant le minimum de risques, de chauffer la maison, faire ronronner les feux, boire du thé brûlant et, tout ça étant fait et bien fait, de me plonger dans la lecture de quelque livre en regardant, parfois, par la fenêtre, l’hiver tout blanc, tout givré et tout vaincu jusqu’à cette fenêtre, dressée devant lui comme une barricade.
Je n’attends pas le printemps. J’espère que c’est lui qui m’attend. Le grand mouvement des choses se vit dans le mouvement des jours, chacun ayant sa raison d’être, sa raison de s’enfuir et de recommencer.
J’ai lu une phrase dans un livre de l’écrivain à succès Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, qui m'a choqué. Peut-être ai-je eu le tort de la prendre au premier degré. Quoique… Je ne vois pas trop à quel degré de l'esprit elle peut être autrement prise.
En septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. On sait tout ça et on sait comment. Yashmina Khadra écrit : On s’attendait à une résistance, à des combats farouches, à une opposition forte et il n’y eut que quelques escarmouches.
Scandaleux. Cet homme, qui fut haut gradé dans l’armée algérienne avant de se tourner vers l'écriture où il glane également pas mal de médailles, ne connaît rien du déroulement de cette partie de l’histoire, des sacrifices faits par l’AK, des morts, des massacres, des crimes et de l’état de la Pologne en 1939.
De toute façon, son livre, outre cette bourde, est ennuyeux et écrit de façon fort approximative. Je ne le mènerai pas au bout. J’ai trop à faire avec d’autres livres, soit qui ont passé avec brio l'épreuve du temps, soit dont la qualité première n'est pas la recherche du succès de librairie.
Bon week-end à tous... et à toutes, ça tombe sous le sens !
Les halliers qui jouxtent ma maison
11:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.12.2012
13 décembre 1981 : la Pologne sous les couteaux
 Il y a trente et un an aujourd’hui, à six heures du matin, la voix du général Jaruzelski annonçait sur toutes les radios et à la télévision :
Il y a trente et un an aujourd’hui, à six heures du matin, la voix du général Jaruzelski annonçait sur toutes les radios et à la télévision :
"Citoyennes et citoyens, grand est le poids de la responsabilité qui m’incombe ce jour…"
La Pologne se réveillait ainsi sur un cauchemar qui allait durer deux ans : la proclamation de la loi martiale et la déclaration de l’Etat de guerre dans tout le pays.
Six mille syndicalistes et opposants actifs avaient été jetés au cachot dans la nuit, toutes les garanties légales suspendues, les lois fondamentales comme celle protégeant (officiellement) la liberté de circuler anéanties, les frontières et les aéroports fermés, le couvre-feu décrété.
Le pays était sous la botte. Exsangue.
A la vitesse historique, c’était donc hier et les Polonais aujourd’hui vaquent à leurs occupations, rient, chantent, s’aiment, souffrent comme tout le monde des maux de la mondialisation libérale.
Mais ils se souviennent. L’air pur, plus de trente ans après, semble encore, parfois, leur donner le vertige. Il y a quelque temps, alors que je garais insolemment mon automobile sur un espace normalement réservé aux piétons, un vieux monsieur, les mains dans les poches, la cigarette au bec, l’œil goguenard, qui me regardait manœuvrer et auquel je demandai si je pouvais me permettre parce que je n’en avais que pour quelques minutes, m’avait répondu - comprenant dès ma première syllabe que j’étais étranger - avec une pointe de fierté amicale allumée dans ses yeux :
- W Polsce wszystko wolno ! (En Pologne, tout est permis)
Paroles anodines qui, ici, ne le sont pas.
Tous ceux qui ont plus de quarante ans se souviennent donc aujourd’hui de ce 13 décembre.
Leur pays a été meurtri dans les profondeurs de sa chair. Pour une foule de gens de l’Ouest définitivement enfermés dans les clichés les plus crasses, il est encore le pays des longues files d’attente devant les magasins, sous la neige et le vent, le pays où il n’y a ni viande, ni produits laitiers, ni pain convenable, ni routes, ni services publics, ni vêtements décents. Que de la vodka et des militaires armés jusqu’aux dents au coin des rues. Bref, leur cervelle, à ceux-là très nombreux encore (j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte à chaque fois que je suis revenu en France) s’est scotchée sur des titres de journaux et des images télé, comme si, après, vu qu’on n’en parlait plus, ou beaucoup moins, l’histoire s’était arrêtée.
Mais que faire d’autre quand la nature vous a doté d’un cerveau d’imbécile, sinon arrêter l’histoire aux dernières informations saisissantes reçues ?
Le vieux général Wojciech Witold Jaruzelski, aujourd’hui âgé de 90 ans, a toujours assumé devant l’histoire et devant ses compatriotes la responsabilité de ce matin de décembre. Il répond présent à toutes les convocations au tribunal qui lui sont régulièrement adressées depuis trente ans. Le vieillard ne se dérobe pas, ne se cache pas : il habite un appartement connu de tous les Varsoviens.
Je ne suis pas certain du tout, du tout, qu’une telle situation serait possible à Paris.
L’état de guerre fut, si on peut dire ainsi, le dernier coup de bluff du communisme détruit sur ses bases, pour donner encore l’illusion de sa vitalité première. Jaruzelski savait très bien qu’il n’endiguerait jamais les aspirations à la démocratie du peuple polonais, que le vent de l’histoire avait définitivement tourné, que l’Union Soviétique elle-même en train de se dévorer les entrailles avec un système qui n’était plus viable et ne l’avait d’ailleurs jamais été autrement que par le mensonge, la ruse et la force, embourbée de surcroît en Afghanistan, ne pouvait se permettre, comme à Prague vingt ans plus tôt, de venir rétablir l’ordre communiste à coups de chars.
Et quand bien même en eût-elle montré quelques velléités, que Jaruzelski sauvait la face et tentait de l’en dissuader en lui montrant qu’il avait la situation en main.
Car les tensions étaient telles, les contradictions avaient atteint un tel point de non-retour, qu'il a aussi voulu éviter, par la loi martiale et la démonstration de force, l’affrontement direct et les bains de sang de la guerre civile.
Sur toutes ces questions relatives aux responsabilités du vieux chef communiste, le sentiment des Polonais est encore très contrasté. J’écoute ceux qui ont vécu les tumultes, voire qui y ont participé, et je me garde bien d’émettre un jugement qui, de ma part, serait tout à fait indécent. Ils ne sont pas d’accord entre eux, les Polonais, sur le déroulement de cette époque dramatique, mais, sinon peut-être pour les catholiques populistes du PIS (Droit et justice) menés par le dangereux conservateur Jarosław Kaczyński, il n’y a pas de haine, pas de chasse aux sorcières, pas de goût de revanche.
Qu’un immense soulagement d’être sortis du tunnel.
Rendons un honneur, mesuré car tout discours politique est fait de paroles convenues, au Président Hollande - on n’en a pas tous les jours l’occasion - qui, en visite à Varsovie le 16 novembre dernier, a su déclarer devant le parlement polonais que ce peuple avait, bien avant la chute du mur, souffert le martyr pour avoir pris l’initiative victorieuse* de soulever le joug totalitaire qui depuis cinquante ans accablait toute l’Europe centrale et de l’est.
*après les cuisantes défaites de Bucarest en 1956, de Prague en 1968 et de Varsovie elle-même en 1970.
Pour avoir une certaine idée des véritables victorieux et des vaincus oubliés - pourtant du bon côté de la barricade - de cette lutte historique, voir ici un autre témoignage.
11:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.12.2012
Ils faisaient lundi
 Lundi était jour du marché, c’est-à-dire, pour tous les paysans des environs, un jour de fête beaucoup plus joyeux que l’austère dimanche où les bicyclettes et quelques carrioles attelées s’agglutinaient sur le parvis de la vénérable église du XIIe siècle et où se faufiler au bistro faisait plutôt mauvais genre.
Lundi était jour du marché, c’est-à-dire, pour tous les paysans des environs, un jour de fête beaucoup plus joyeux que l’austère dimanche où les bicyclettes et quelques carrioles attelées s’agglutinaient sur le parvis de la vénérable église du XIIe siècle et où se faufiler au bistro faisait plutôt mauvais genre.
Mais le lundi dès potron-minet, autour des halles au sommet desquelles veillait la vieille sirène du tocsin, sur toute la Grand-Place, des camelots de toutes sortes bonimentaient sur toutes sortes de guenilles, sur leurs outils, sur leurs fruits, sur leurs broutilles. Les gens des campagnes environnantes, eux, apportaient dans des paniers grillagés tout ce qu’ils avaient espoir de vendre ou de troquer, lapins, canards, poulets, pintades, pigeons, œufs, légumes. Une forte odeur de fientes et de plumes chaudes se mêlait ainsi à celle des tissus neufs et des fruits sucrés.
Certains cependant n’amenaient rien du tout. Ils s'amenaient, ce qui n'était déjà pas si mal, pour causer de tout et de rien, comme seul savait le faire le paysan, au café du commerce, toute la matinée durant. Arrivés aux aurores, ils repartaient sous le soleil au zénith, la voix pâteuse, l’œil torve et le vélo très incertain.
C’était le cas de Gaétan, le propriétaire chez lequel ma mère avait eu l’idée lumineuse de me louer chaque été pour prix du gîte et du couvert. Il arrivait sur le coup de quatorze heures, la démarche passablement chaloupée, son indéfectible chapeau bien rabaissé sur le front, les yeux mi-clos, l’haleine inondée de vin blanc sec et, toujours, un demi-sourire suspendu à ses lèvres pincées, comme si le monde l’amusait, l’agaçait mollement ou lui semblait tout simplement hors de propos.
Tout de noir vêtue, sa vieille mère depuis longtemps revenue du marché et lassée de l’avoir attendu pour le déjeuner, levait les yeux au ciel, les poings serrés, en grinçant d’inintelligibles paroles. Des prières? J’en doute fortement. Je ne l’ai jamais surprise à genoux et au-dessus des grands lits à baldaquin, jamais je n’ai vu la divinité du Golgotha exhibé son supplice sur les murs grossièrement peints à la chaux.
Peut-être proférait-elle des colères aux mots si crus qu’elle ne voulait pas qu’on les entendît. Je subodorai, bien plus tard, qu’en ces circonstances elle vilipendait plutôt la mémoire de son mari pour avoir légué une aussi funeste passion au fils. Le bonhomme s’était en effet prématurément évaporé vers les vignes du Seigneur après avoir trop goulûment prisé celles d’ici-bas.
Le Gaétan en question ne quittait donc le foirail que le dernier. Tranquillement accoudé au comptoir, il attendait que le garde-champêtre eût débarrassé la place de la paille, des fientes, des ficelles, des papiers gras et des emballages. Ceci étant fait et bien fait, tous les deux prenaient le coup de l’étrier. Chacun le sien bien entendu : un cheval se monte avec deux étriers.
Enfin rentré, Gaétan s’asseyait devant son assiette en ricanant bêtement. Il avalait en un tour de main tout ce qui tombait sous sa dent avinée, miget, pâté, cuisses de poulet ou de canard, moutarde, cornichons, haricots, fromages, fruits, gâteau, le tout inondé de grandes lampées de vin, histoire de faire durer la fête.
Fermement occupé à engloutir, il faisait mine de ne pas entendre les sourdes vitupérations maternelles. Puis il se levait, il pétait un grand coup, énorme comme un tonnerre du ciel et comme pour signifier la fin des jérémiades, avant de s’aller coucher pour une longue sieste réparatrice à l’ombre du paillé ou du poirier du jardin.
Dès le lendemain, les choses reprenaient alors leur cours normal, la mère à ses casseroles, ses conserves, ses poules et ses cochons, le fils à ses chevaux et ses champs, moi au cul des vaches avec des livres et des casse-croûtes et la mémoire du grand-père en paix sur ses nuages.
Jusqu’au lundi suivant.
Extrait du Silence des chrysanthèmes, remanié et jamais mis en ligne
13:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.12.2012
Quatre lettres dans la nuit

L’ordre des quatre lettres est un diktat sans lequel vous n’entendriez qu’un désordre vide de sens, trom, ortm, romt, mrot, torm. Une seule émotion est admise. La suprême.
Tant que, même à les prononcer, on pourrait parfois être saisi d’effroi.
Cette nuit, quatre bougies les faisaient danser à la fenêtre minuscule d’une minuscule maison. Elles éclairaient faiblement, un peu plus loin, en face, le givre des carreaux et leur lueur timorée se répandait en tremblotant sur la neige, comme un sillon de tristesse. De la fumée sur le toit virevoltait à la rencontre des flocons tombant du noir. Il faisait froid, aussi froid que les quatre lettres sont froides.
A la chaleur d’un vieux poêle, des gens veillaient une vieille dame dans la nuit d’hiver.
Avant, elle cheminait le long des haies, un foulard enveloppant toujours ses cheveux, été comme hiver. Elle arrêtait son pas étroit, malhabile, pour dire deux ou trois mots, des mots qui signifiaient toujours que la vie était dure, seule au bout de la piste. Elle suintait très fort ce sombre désarroi des vieilles gens qui, depuis longtemps, ne sont plus réellement sur terre mais à l’intérieur des fantômes qui les habitent. Loin en eux-mêmes.
Elle avait pour la première fois, m’a-t-on dit, vu le monde en 1928 et ce reflet blême sur la neige marquait donc le point final d’une course de 84 ans à travers l’histoire. Elle avait 11 ans quand les chars de Staline avaient traversé le Bug pendant que ceux d’Hitler accouraient à tombeau ouvert, venant de Varsovie. Sans doute l’enfant avait-il entendu le grondement, au-dessus des champs de septembre et dans les profondeurs de la forêt, de la terrible tenaille qui se refermait sur son pays.
Puis une jeunesse écrasée sous le poids les crimes qui se perpétuaient plus tard dans la forêt toute proche, des crimes de sang et de fumées. Une vie de jeune femme bientôt immobilisée sous la poigne sans issue de Staline, avec une ferme bien plus que modeste, tant qu’elle n’intéressait même pas la collectivisation. Deux cochons, deux vaches, des poules, deux ou trois champs…
Survivre dans la neige et le vent, par-delà l’incendie des barbaries de l’histoire.
Elle cheminait sans doute, la vieille dame fatiguée, dans ce début du XXIe siècle comme on chemine au sortir d’une nuit d’insomnie labourée par les cauchemars.
Hier, elle a rejoint les terres où il n’y a plus d’hommes, plus d'Histoire, et inscrit au bout de son destin de femme les quatre lettres qui l’avaient, sans doute, si souvent fait frissonner, l'effleurant de leur souffle glacé.
Dans la nuit neigeuse, dans le vent qui balançait les pins et bousculait les flocons, vacillaient quatre bougies au givre des carreaux et un sillon de tristesse sur la neige tremblotait.
Tel un petit mouchoir blanc agité à la fenêtre du temps qui s’en va, en route vers l'éternité du temps.
12:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.12.2012
Quand les vieux démons reviennent, côté coulisses

Texte mis en ligne le 1er décembre 2009
Introduction:
C'est comme une histoire de fous, mais vécue par des gens censés ne pas l'être, fous.
Elle est véridique, cette histoire, et nous avons eu l'heur de la lire, passablement éberlués, dans les colonnes du numéro 48 de Polityka.
Elle s'est déroulée à Poznań.
Plus précisément, dans un grand théâtre de Poznań, et plus précisément encore, en coulisses.
Ce grand théâtre accueillait ces jours-ci le Théâtre Polonais de Danse, institution remarquable qui se produit dans différentes salles du pays et qui, depuis quelques mois, s'est adjoint le talent d'un danseur israélien émérite.
L'histoire :
Alors que le susdit danseur s'entraînait à rideau fermé avant la répétition générale, il a soudain senti sur lui peser un regard insistant, qui l'a dérangé et troublé dans sa concentration au point de s'interrompre et d'aviser effectivement dans les coulisses un employé qui le fixait, immobile, avec une mine assez sévère, et peut-être, même, qu'il le toisait, moqueur, méprisant, ce salaud d'employé !
Rien de grave, me direz-vous. Mais attendez que je vous décrive le machiniste scrutateur et soi-disant goguenard. Petit, nerveux, l'œil noir, une mèche de cheveux lui barrant le front et une petite moustache fournie, bien taillée en balais de chiottes, juste sous les narines...Vous y êtes ?
Non ? L'artiste israélien, lui, est formel : cet ouvrier ressemblait à s'y tromper à Hitler, lequel artiste a pris peur et s'en est ouvert à une responsable du Théâtre Polonais de Danse, lui demandant de dire à cet employé de déguerpir.
Las ! Las ! Les choses n'en sont point restées là. L'employé courroucé - je vous laisse deviner à quoi peut ressembler un employé qui ressemble à Hitler quand il est courroucé - a porté plainte auprès de la directrice pour.... discrimination.
C'est là que l'anecdote tourne au cauchemar et que, comme dans tous les cauchemars, elle permute les rôles du réel. Car un homme qui ressemble à Hitler à s'y méprendre et qui porte plainte contre un homme de confession juive, un artiste en plus, pour discrimination, ça fait grincer des dents dans la mémoire collective.
Et ça n'est pas tout ! Les camarades de l'employé-fantôme, outrés de la mesure prise à l'encontre de leur collègue, ont menacé de faire grève pour la Première si on ne le remettait pas à son poste.
À l'occasion d'une autre discussion orageuse avec la directrice artistique du Théâtre, pour tout autre chose que cette lamentable affaire, quelque chose ayant trait à l'organisation du spectacle, le danseur traumatisé, quant à lui, en est arrivé à évoquer une nouvelle fois l'incident : il a maintenu avec force qu'un employé-Hitler l'avait nargué et regardé de façon très agressive.
Hélas encore, trois fois hélas, la directrice était déjà mal disposée envers le danseur car, paraît-il, depuis quelque temps, le bruit courait que ce dernier se plaignait à qui voulait l'entendre que ce spectacle était une galère et qu'il était décidément impossible de travailler convenablement avec "ces connards de Polonais !"
Mal disposée, donc, au point de lâcher dans l'altercation qui ne manqua pas d'éclater : Espèce d'enculé de juif !
Aie! Aie ! Là, ça s'est vraiment gâté .
Et l'artiste aussitôt de se lever et de hurler : Espèce d'enculée de nazie !
Et voilà l'affaire portée diligemment à la connaissance de l'ambassade israélienne en Pologne et voilà la directrice artistique virée sur le champ !
Et qu'en est-il, dans tout ça, advenu du machiniste sosie ?
Des journalistes ont fini par le dénicher, tout penaud, dans les vestiaires. Lui, il dit qu'il a toujours eu la moustache et s'est toujours coiffé de la sorte, qu'il n'est pas fasciste pour un sou, que la guerre c'est du lointain passé, qu'il est embêté avec cette histoire qui fait grand bruit dans le Landerneau et que, s'il est viré de son emploi, il se demande bien ce qu'il va devenir et comment il va nourrir sa famille.
Conclusion :
Et le journaliste de Polityka de poser la question : où commence le délit de sale gueule*et l'inconvenance quand on a le malheur congénital de ressembler à Hitler en présence d'un artiste israélien ?
Au regard ? Au fait d'exister ?
Annexes :
- *NDLR Exil des mots
- Le spectacle préparé portait sur : La chute du mur et la tolérance. Hé ben, c'est raté !
Image : philip Seelen
12:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.12.2012
Décalage...

Pour être certains que notre brève apparition avait bien imprégné la réalité.
Les empreintes, larges et profondes, escaladaient le petit talus, fuyaient dans les sous-bois, hésitaient en se multipliant, et se glissaient enfin sous les broussailles. Nous les avons suivies sur une dizaine de mètres, comme si nous nous attendions à ce que le grand prédateur nous attende là, sous les halliers recouverts de neige. Mais il devait être, à ce moment là, à l’autre bout de la contrée ! Enfui vers son destin de loup.
Et le soir venu, je me suis dit que j’étais vraiment situé hors du monde. Israël assassine sous le regard complaisant d’Obama et de ses Etats valets ainsi que sous les courbettes malsaines de Hollande, la Syrie sombre dans le chaos, les hommes y meurent sous le feu nourri des armes, l’Europe ressemble de plus en plus à un sac de nœuds ficelé par des traîtres, des menteurs et des insignifiants, les gens sont à côté de leur vie, ne trouvent plus rien qui alimente en vrai leur plaisir de vivre leur vie, des milliers d’hommes et de femmes perdent leur gagne-pain parce que la banque - ses tiroirs bien remplis quoiqu’elle prétende le contraire - ne les trouve plus rentables, les intellectuels de service n’émettent plus que des vulgarités engraissées à la sève du spectacle marchand, les ministres et les présidents ne sont que les piètres gestionnaires fantoches du pouvoir occulte d’une poignée d’insatiables financiers, aucun idéal ne s’élève qui voudrait dépasser les sphères étriquées de la survie, et moi, benêt, je suis dans la forêt la piste laissée sur la neige par un loup de hasard.
Je ne sais pas si j’ai vieilli - sans doute que si - mais en tout cas, je crois une chose : je n’ai pas grandi !
Parce que je m’en fous, du malheur social des gens : Combien d’entre eux ont accordé crédit aux voix qui leur disaient, depuis si longtemps, à s'en faire mal, l’inéluctable pourriture d’un système ?
Ce monde qui les tue, c’est le leur. Celui auquel ils ont fait allégeance. Ce n'est pas le mien.
J’aimerais bien encore suivre la piste d’autres loups.
Mais l’exceptionnel est, par définition, d'abord solitaire.
11:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.12.2012
Fantastique et furtive rencontre

Dans le temps, oui, mais maintenant...
Les habitants du village, eux, avaient été moins catégoriques. Certains avaient prétendu que, parfois, l’hiver, il pouvait arriver que des individus isolés poussent leur course jusqu’ici, venant de la grande forêt de Włodawa ou d’ailleurs…
Un soir de neige et de vent, il y a un ou deux ans de cela, j’étais planté au milieu de ma cour, la forêt face à moi avec un bout de lune accrochée à ses cimes. Pour tout vous dire, j’étais planté là pour y gratifier la neige d’une miction libératrice, car que peut-on faire d’autre, la nuit, l’hiver, sous la neige et dans le vent, planté au milieu de sa cour ? Je vous le demande bien.
J’avais cru entendre, donc, au loin, dans les sombres profondeurs, la voix étouffée, rauque, caractéristique, légendaire. Comme un gémissement errant de la solitude.
On m’avait allégrement moqué. Surtout Jagoda. Un chien perdu, qu’elle avait pouffé. Tu veux tellement qu’il y en ait chez nous, que tu les entends.
Sur ce, fort possible, en tout cas fort bien dit, j’avais abdiqué. J’avais fait mine d’oublier la plainte dans la nuit gelée. Mais je suis têtu.
Et ce matin, dans la forêt, sur la route ensevelie de blanc et de glace, alors que je roulais au pas, il a surgi. La gamine, à côté de moi, babillait que c’était bien d’avoir des responsabilités, que ça obligeait à penser à autre chose qu'à ses petites affaires, car un prof l’avait déléguée pour récolter des pièces de monnaie, jaunes, qui seraient offertes aux enfants de la Maison de l’Enfance.
Je me suis fait aussitôt sarcastique. Te voilà bientôt rendue comme la mère Chirac, que j’ai rigolé. Elle s’apprêtait, sourcils froncés, l’œil vexé car subodorant que ça n'était pas forcément un compliment, à me demander plus ample explication...
Mais l’animal est sorti des fourrés, très vite, juste devant la voiture. Magnifique allure, queue droite dans le prolongement du corps, course puissante, tête tendue vers la fuite. Il a pénétré dans le sous-bois d'en face, s’est arrêté une seconde, a regardé en arrière et a repris sa course sauvage sous les broussailles alourdies de neige.
Un loup ! Nous sommes-nous écriés en même temps.
Nous étions époustouflés et nous en avons parlé pendant les trente kilomètres, oubliant le verglas et la glace. Je le reverrai longtemps bondir, là, tout près, ce redoutable inconnu que l'on dit invisible.
Et maintenant je sais que la forêt, celle qui encercle ma maison, celle que je vois tous les jours et à toutes saisons, celle où je me promène, celle des myrtilles, des chevreuils, des grands corbeaux, des élans, peut être aussi habitée par des loups.
Ce n’est peut-être rien du tout pour toi, lecteur. Pour moi, ça la fait accéder, cette forêt, au statut de grande forêt, au rang de la légende, du conte, du fantastique.
Cet après-midi, quand la nuit l’aura enveloppée de silence, de froid et de neige, je sais que je la regarderai autrement.
Avec plus de respect encore, mêlé à une peur délicieuse. Je tendrai l'oreille et je n'entendrai, sans doute, que du vent glissant entre les grands pins et les bouleaux.
Pourtant, c’est l’idole redoutée des hommes, haïe, chérie, fantasmée, tantôt diable et tantôt ange, qui, ce matin sous une aube de neige, a croisé ma route et sur mon imaginaire laissé son empreinte du réel.
10:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.12.2012
Réel imaginaire

Maisons de bois aux formes incertaines sous la blancheur de l’aube, fumées qui montent sans conviction vers un ciel sans issue, forêts qui croulent sous le poids de la blanche humidité, routes aux profils confondus avec le champ ou le talus forestier, silence comme un recueillement devant l’inéluctable retour des grands engourdissements.
Ma voisine, la mémé, toute menue, que j’ai conduite ce matin jusqu’à Łomazy en roulant au pas à travers la forêt, semble s’angoisser de toute cette neige. Pourtant, elle en a vécu, de terribles saisons ! De très dures, toute jeunette alors, sous la botte infâme de tyrans assassins. Je la regarde toujours comme je regarde toutes les vieilles gens d'ici : comme témoins anonymes et émouvants des tumultes les plus dramatiques de l'histoire du XXe siècle. J’aimerais écrire le livre que renferme leur mémoire devenue muette. Pour contredire tous les autres.
Plus on est vieux, plus l’hiver est dur, dit-elle. Elle redoute son quatre-vingt troisième hiver, on dirait. Mais il est vrai que vient une saison où l’on redoute toutes les saisons. Rien n’est sans doute plus terrifiant, pour terrifiante que soit l’histoire de ces villages, que la présomption du dernier grand froid.
Elle marche de façon fort irrésolue, ma vieille voisine. Mon escalier de bois, que j’ai pourtant dégagé trois fois depuis l’aurore, est de nouveau enseveli. Il est glissant. Je retiens la mémé par le bras. Elle descend avec une extrême prudence, trois marches, longtemps, et, cruelle, la neige, pressée de vaporiser le monde, inonde son fichu.
Je crois savoir pourquoi l’hiver en Pologne m’impressionne encore. C’est parce que, sans n’avoir jamais mis les pieds en Pologne, avant, c’est comme ça que j’imaginais ce pays. La forêt, la plaine, la forêt, la plaine et toute cette succession balayée par le vent neigeux, sous un drap gris, presque noir là-bas, à la fin, quand il vient border l’horizon mélancolique. Des chevaux en armes pourraient y apparaître, dans un brouillard de voltiges. Montés par les hommes de Nestor Makhno, leurs drapeaux noirs qui pavoiseraient au vent froid. Ephémère victoire des plaines d’Ukraine toutes proches.
Mon imagination rejoint ses images.
En juillet, quand le thermomètre suffoque par quarante degrés, je suis dans un pays plus inconnu. Presque plus lointain. Je n’y avais jamais pensé de la sorte. Je n’y avais jamais pensé en géographie, en climat ; je l’avais fait grande plaine d'une saison blanche. Et même les plus monstrueux épisodes de l’histoire dont ce pays a été le témoin, le billot, l’acteur et le théâtre, se déroulent toujours encore, dans mon imaginaire abusif, dans ma compassion qui tente de remonter le temps, sous la neige que soulèveraient des tourbillons venus des steppes et de Sibérie.
L’imagination du monde acquise par l’histoire, la lecture, l’oralité ou tout moyen autre que le voyage, donne lieu à bien des stéréotypes, même si, parfois, ils rencontrent la réalité.
Pour illustration, un metteur en scène - je ne me souviens plus lequel - de Crime et châtiment faisait ouvrir sa pièce sous la neige et le froid, alors que l’œuvre, comme on sait, débute sous la fournaise poussiéreuse d'un mois de juillet.
12:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.11.2012
Rigolade à pas cher
 Je pense que Copon et Fillé ne sont pas des grands sensibles aux messages historiques : organiser un scrutin le 18 brumaire aurait dû leur inspirer la crainte d’un coup fourré.
Je pense que Copon et Fillé ne sont pas des grands sensibles aux messages historiques : organiser un scrutin le 18 brumaire aurait dû leur inspirer la crainte d’un coup fourré.
Qui ne manqua pas d’arriver.
Mais bon, moi ce que j’en dis c’est que le linge sale se lave en famille, même si là, il s’agirait plutôt d’oripeaux crasseux et qu’il faudra pour arriver au blanc, une grande famille… Au moins jusqu’au troisième degré.
Blague à part, ce qui est quand même déroutant pour l’esprit quand on prend un peu de recul, - oh, pas beaucoup, juste un ou deux millimètres ! - c’est de considérer que ce sont ces apôtres-là, à peine plus adultes que des mômes de CM1 et en tout cas beaucoup moins honnêtes que bon nombre de voyous croupissant dans des cellules, qui veulent monter au pinacle, diriger un pays, donner la leçon citoyenne et redresser le tout à coups de lois.
Qu’ils apprennent donc d’abord à redresser le peu de tête qui leur reste. Ça devrait les occuper un moment !
Et là n’est pas le spectacle exclusif des bandits situés sur ma droite ! A Reims en 2008, le champagne n’avait pas coulé à flots non plus et les mêmes tripotages malsains avaient bien eu lieu, semble-t-il, derrière le sacro-saint rideau des burnes des urnes.
Misère ! Comment ne pas en rire, vieux camarade qui fut mon ami, si nous ne voulons pas avoir à en pleurer ?
En fait, je dis ça comme ça, je semble m’en affliger comme un honnête homme que je ne suis pas forcément, mais, dans le fond, ça me réjouit fortement, toute cette dépravation. Ça me réjouit parce que c’est quand même un plaisir - je vous laisse en apprécier la qualité - que de voir des gens qui ne vous inspirent que mépris et colère, se rouler dans la boue comme des gorets dans leur lisier ! Je ne serais pas très à l’’aise avec mon sentiment du monde - un sentiment qui m’est apparu dès lors que j’eus trois poils sous le menton - si ces pourceaux s’avéraient avec le temps être des seigneurs de la probité, des magnanimes, des hommes d'esprit et de bien.
J’en ferais une bobinette ! Obligé de me remettre en cause de fond en comble et je n’ai plus trop le temps de faire ce grand ménage !
Alors, messieurs, continuez donc à vous ébrouer dans la fange et à donner joliment du groin. Pendant ce temps-là, au moins, vous ne ferez pas de grosses bêtises et ne souillerez que vos costumes !
Et puis, je le répète, c’est quand même pour le libertaire, l’alcoolique, le réprouvé, le sans foi ni lieu, un sacré cadeau.
Las ! Las ! Las ! Depuis le temps qu’il y a des hommes et qui vous regardent, peu sont venus pour en tirer la leçon qui s’impose!
12:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET

















