12.11.2013
11 novembre polonais
En septembre 1992, pour tout dire le dimanche 20, jour d’un certain référendum sur le traité de Maastricht et deux-centième anniversaire de Valmy, j’écrivais sur ma guitare une chanson :
Qu’il soit noir, qu’il soit rouge,
En berne ou qu’il pavoise,
Quand bien même s’rait-il bleu et parsemé d’étoiles,
Un drapeau dans ses plis a toujours en réserve
Une salve pour ceux qui ne veulent pas saluer.
Pour peu qu’on se souvienne des charniers de l’histoire
Là où les étendards glanent leurs jours de gloire
Sur les corps en charpies de soldats inconnus
Quand la connerie humaine s’est faite une vertu
Pour peu qu’on se souvienne… etc., etc.…
 Minuscule œuvrette d’un moment d’humeur, la chanson est bien sûr tombée aux oubliettes avant même d’être peaufinée, tant il est vrai que ce qu’on écrit comme ça, au pied levé, sur trois ou quatre accords, vous semble, une fois le temps écoulé et l'humeur sensible retombée, d’une naïveté déconcertante.
Minuscule œuvrette d’un moment d’humeur, la chanson est bien sûr tombée aux oubliettes avant même d’être peaufinée, tant il est vrai que ce qu’on écrit comme ça, au pied levé, sur trois ou quatre accords, vous semble, une fois le temps écoulé et l'humeur sensible retombée, d’une naïveté déconcertante.
Blague à part, ceci vaut sans doute également pour la moitié des textes de ce blog. Car il ne faut pas croire que ce qui s’inscrit en pattes de mouches volatiles dans ce vaste souk que constitue la foison des blogs et sites ne s’envole pas aussitôt dit dans les nuages du dérisoire et du nul et non-avenu. D’ailleurs, digression pour digression, quand on parle de blogosphère, le seul élément à peu près véritable, métaphorique, qu’il faudrait retenir du concept, c’est qu’effectivement ça tourne en rond sur soi-même. En 24 heures souvent. Ça donne le tournis, ça grise un peu ; c’est peut-être pour ça qu’on y reste. Mais il ne faut pas pour autant se vider la tête au point de croire qu’on fait œuvre de quelque chose. Il n’y a rien de pire, si ce n’est la maladie mortelle qui soudain vient à vous frapper, que de prendre les effets de son ivresse pour ceux du réel.
Donc, la chansonnette…
La parole sans le cerveau rétorque à ces couplets approximatifs : c’est justement pour faire en sorte que les drapeaux ne soient plus les emblèmes des catastrophes guerrières et du sang versé que l’Europe s’est regroupée sous une seule bannière.
C’est là voir le monde comme le voit le pigeon, à l’aune de sa seule volière. Car depuis que l’Europe est Europe, dans combien de champs de bataille a-t-elle trempé le glaive ? Pour moi, la mort, qu’elle soit distribuée en Syrie, en Lybie, au Mali, en Afghanistan, en Bosnie, en Irak ou devant ma porte, reste la mort. Et ce n’est pas parce que l’on ne s’étripe plus guère sur les rives du Rhin ou sur les plaines d’Europe centrale et de Belgique, que le drapeau bleu aux étoiles jaunes n’est pas déjà souillé par le sang.
Ce n’est pas un hasard si cette Europe s’est affublée d’un drapeau avant même d'avoir dépassé le stade de l’Idée ailleurs que dans une monnaie, des marchés et la distribution tous azimuts de subventions, avant même que n’émerge chez les individus dont elle est peuplée une once de sentiment citoyen et européen.
Il ne me viendrait pourtant pas à l’esprit de mettre en place le toit de ma maison avant d’en avoir creusé les fondations et élevé les murs.
Comme quoi un drapeau, c’est d’abord une vitrine qui camoufle le désert d'un fonds de commerce.
Cette ébauche de chansonnette et cette histoire de drapeau me reviennent donc toujours en mémoire, ici en Pologne, aux alentours du 11 novembre. Dans les campagnes en effet, aux portes et aux fenêtres d’une maison sur trois ou quatre, flotte au vent brumeux le drapeau blanc et rouge.
Cela me met mal à l’aise. Il y a, dans un drapeau qu’on arbore comme ça, chez soi en plus, toute l’arrogance d’une appartenance à quelque chose dont ceux qui n’arborent pas sont exclus. Il y a de l’agressivité. De la fierté hargneuse. J'ai toujours ce sentiment et je fredonne alors la mélodie de la chansonnette avortée.
Pourtant, là, je fais des efforts pour relativiser mon aversion : car il me faut intellectuellement passer en revue une histoire qui ne m‘appartient justement pas. Il me faut repenser au 11 novembre 1918 en tant que date de l’écroulement des Empires centraux et de la renaissance de la Pologne rayée des cartes depuis 1795. Il me faut dès lors bien prendre conscience que je suis ailleurs, que cet ailleurs se veut ce jour-là ostensiblement rouge et blanc parce qu'il a été décrété Fête nationale.
Que, par-delà la fin de la plus sanglante guerre de l’histoire, on veut célébrer ici la fin d’une occupation de plus de 120 ans et la résurrection de la notion même de Pologne.
Alors, je fais une exception et je me dis que ces drapeaux qui flottent sont ceux de la fin d’une souffrance et le bout d’un interminable tunnel.
Mais, apercevant en même temps sur les champs, des paysans qui travaillent, qui hersent, labourent ou roulent du fumier, eux qui n’oseraient seulement pas toucher à un manche de binette ou de fourche un quelconque dimanche, jour du Seigneur, car le curé le leur défend fermement du haut de sa chaire, je me dis aussitôt que tout ça, la mémoire, la célébration, les couleurs, le souvenir, l’honneur des patriotes-résistants polonais tués aux cours des insurrections de 1830 et de 1863, la diaspora du IXe siècle et du début du XXe, c’est du pipeau, du chinois, dans la caboche du paysan qui n’a d’yeux que pour ce qu’il ne verra jamais : le ciel que lui vend l'abominable clergé !
Toujours, donc, cette vitrine sur un fonds de commerce non achalandé. Une couverture.
12:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.11.2013
Le mythe décisif
Albert Camus aurait eu cent ans aujourd’hui même.
Cet anniversaire fictif m’inspire cette pensée apparemment absurde et tout à fait personnelle :
L’esprit humain patauge dans l’erreur et la confusion parce que depuis des siècles et des siècles les hommes qui croient en dieu et l'honorent le font d’aussi grotesque façon que ceux qui le rejettent et le conspuent.

09:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.11.2013
L'éducateur éduqué
 Elle dit comme ça, en refermant son cahier :
Elle dit comme ça, en refermant son cahier :
- On a fini les chapitres sur la Préhistoire. Lundi, on va commencer à étudier l’Antiquité.
Ça m’intéresse, ça. Je suis tout ouïe.
- Et qu’est-ce qui différencie les deux périodes ?
- L’art.
Je hoche dubitativement du chef en pinçant le bec, un peu à la manière sérieuse et suffisante du professeur qui engage l'élève à développer son propos :
- J’aurais dit l’écriture, plutôt...
- Pffft ! C’est parce que tu écris, qu’elle moque.
- Pas du tout. Car dis-donc, on ne vous a pas parlé de Lascaux au cours de tes leçons sur la Préhistoire ?
- Si. De Lascaux et des grottes d’Altamira en Espagne. Du Mexique aussi.
- Et ce n’était pas de l’art, ça ?
- Pas vraiment.
J'ouvre des yeux scandalisés.
Ce que voyant, elle enfonce joliment le clou.
- Parce que ce n'est qu'à partir de l’Antiquité que les hommes ont commencé à faire consciemment, volontairement, de l’art. C’est comme ça qu’on sépare la Préhistoire de l’Antiquité.
- Ah bon ?
- Dans la Préhistoire, les hommes n’avaient pas conscience d’être des artistes. C’est nous, de très loin, qui appelons cela de l’art, mais pour eux, ça n’en était pas. Ils faisaient ça pour autre chose. Regarde Lascaux, justement : que des animaux. De la nourriture, quoi.
- Et l‘art c’est quoi, alors ?
- C’est faire de l’art pour le plaisir et la beauté de l’art.
Je réfléchis. Ce n’est pas bête du tout, ça…
Et je me demande tout à coup si je n’ai pas un début de réponse à une question qui me turlupine depuis toujours. Comment des hommes qui n’avaient pas de liens entre eux, qui n’étaient fédérés ni par un langage, ni par une religion, ni par un Etat, ni par une idéologie, ni par une autorité quelconque, pouvaient-ils peindre à peu près les mêmes choses, en Dordogne, au Mexique et en Espagne ?
Parce qu’ils étaient fédérés par la nécessité primaire ? Par le langage de la survie ? Par les exigences universelles du ventre ?
C’est toute la définition de l‘art que remet en cause ce satané cahier d’histoire !
L'art, ce serait d'abord une intention.
Dira-t-on, par exemple, dans quelque 20 000 ans - s’il est encore debout - que le viaduc de Millau qui enjambe la vallée du Tarn, c’était de l’art ?
Alors qu‘il s’agissait de faire circuler plus rapidement les marchandises entre Clermont-Ferrand et Béziers.
Un investissement. Ni plus, ni moins.
09:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.11.2013
Les Paysans
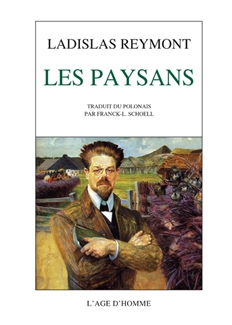 Les deux livres - sur environ soixante lus ces dernières années - qui m’auront le plus impressionné (dont un est encore en cours de lecture) portent le même titre : Les Paysans.
Les deux livres - sur environ soixante lus ces dernières années - qui m’auront le plus impressionné (dont un est encore en cours de lecture) portent le même titre : Les Paysans.
Coïncidences ?
Il n’y a pas de coïncidences dans nos amours de lecture, pourtant.
L’un est de Balzac, l’autre de Reymont, prix Nobel 1924, titre polonais original Chłopi.
Et pourtant ce sont deux livres de style et d’approche fondamentalement différents.
Ils ont cependant en commun d’être, sous une fausse identité romanesque, des études de mœurs et de société d’une époustouflante acuité et telles qu’un sociologue, un philosophe, un romancier, un ethnologue ne pourront jamais en produire.
Ces deux livres sont d’une autre dimension de la littérature ; dimension à laquelle peu de plumes ont su, savent et sauront sans doute atteindre.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.10.2013
Requiem
 Parfois la nuit à mon oreille murmurent des noms et des visages.
Parfois la nuit à mon oreille murmurent des noms et des visages.
Celui-ci était un frère. Il avait entre mes bras posé l’harmonie d’une guitare rustique.
Ma main sur son épaule.
Celui-ci était un oncle. Il avait de son monde tranquille fait un jardin de fleurs, d’arbustes et de parfums multicolores.
Ma main sur son épaule.
Celui était un ami, un grand ami, un lecteur acharné, un bouquiniste, un qui levait le poing, qui toujours marchait sur les bas-côtés mais dont le cerveau exaspéré finit par s’assombrir jusqu’à la confusion.
Ma main sur son épaule.
Celui-ci était Le grand ami, celui qu'on ne rencontre qu'une fois, bouffeur de curés et pourfendeur du monde, combattant, intègre, solide, courageux jusqu’à la folie suicidaire et…
Ma main sur son épaule.
Celui-ci était un camarade, un prolo révolté, un joyeux fêtard, un noctambule, un généreux.
Ma main sur son épaule.
Celui-ci fut mon premier éditeur, un anar de la vieille école, un barde, un moustachu gaulois.
Ma main sur son épaule.
Celui-ci imprimait et, quand il n’imprimait pas, noyait son éternel chagrin dans des verres qui tremblotaient de plus en plus entre ses maigres doigts.
Ma main sur son épaule.
Celui-ci ne parlait pas ma langue, revenait de loin, souriait et blaguait, m’avait accueilli bras et cœur ouverts pour que son pays de neige et de vent soit également un peu le mien.
Ma main sur son épaule.
Celui-ci, d’une autre langue aussi, m’avait guidé pour reconstruire ma maison, enfoncer des clous et aligner des plafonds.
Ma main sur son épaule.
Je soulève un pan de rideau au-dessus de ma tête. Je vois la nuit et la grande ourse et, un peu plus haut, juste au-dessus des toits incertains de la ferme d’en face, l’étoile du Nord.
Alors leurs noms et leurs rires se bousculent sur le silence de ma mémoire.
Ils sont là où je vais. Ils ont fait ce que je redoute tant de faire et le monde continue de tourner sur son absurde temporalité.
Ils ont dans mon cœur rendu envisageable l'inenvisageable grand saut.
Pourtant, eux aussi, redoutaient. Je me souviens…
Maintenant, ils savent.
Mais sans doute - épouvante suprême - ne savent-ils pas qu'ils savent.
13:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.10.2013
L'exil et le pognon

Le regard que l’on porte sur soi n’est bien évidemment jamais le bon.
Et comme je n’ai plus guère de vie sociale, je ne reçois plus guère de regards portés par la ruche sur mon individu.
C’est donc par l’écriture que je communique avec le monde. Une communication à sens unique.
Le regard que l’on jette sur le monde est compliqué. Il cherche midi à quatorze heures. Il bafouille, suppute, spécule, s’indigne et j’en passe.
En vivant un exil, j'ai appris que ce regard critique est souvent un exutoire, un subterfuge pour éviter d’avoir à en jeter un véritable sur soi-même. Il faudrait commencer par se dire que le monde objectif n’existe que par le regard que nous lui portons et par ce que nous portons en nous. Qu’il n’existe aussi, dans sa force coercitive, que par les multiples concessions contraires à notre désir que nous lui faisons.
Car combien de méchants réclament-ils un monde qui soit bon ? Combien en ai-je vu, connu, côtoyé, de ces criards contre le monde injuste, de ces défenseurs de la veuve et de l’orphelin et qui, dans leur propre vie, se montraient radins, mesquins, âpres au gain, gagne-petit et pas généreux pour un traître sou !
Qui s’intéresse à ses sous, ne s’intéresse guère à l’humain et vice-versa, c'est bien connu. Et pourtant ! Combien de généreux poètes, de désabusés du dimanche, de désinvoltes de la plume ou de la parole, ne comptent-ils pas leurs sous, dans leur coin, avec la fièvre de l'angoisse du manque et l'hystérie d'Harpagon ?
Ah, les sous ! C’est comme la météo, les sous : un sujet futile. Pfft ! Recouvert, en plus, d’un fort tabou. Demander à quelqu’un combien il gagne, c'est aussi indiscret et malpoli que de lui demander avec qui il couche.
C’est d’ailleurs en dire beaucoup sur le comment il couche…
C’est, je m’en suis rendu-compte, une des raisons pour lesquelles je me sens bien en exil, malgré l’incontournable appel des racines.
Le regard que je jette aujourd'hui sur la France, côté finances, côté porte-monnaie, est exécrable jusqu'au dégoût. C’est le mien. Lié à ma propre histoire.
Toute ma vie, j’avais été tracassé par les sous. Plus exactement par leur absence. J’avais toujours emprunté dix sous à Pierre pour en rembourser neuf à Paul et ainsi de suite. Une suite d’expédients de plus en plus étrangleurs. Jusqu’à l’angoisse.
A tel point que les dernières années passées en France, épouvanté, je n’ouvrais même plus mes lettres officielles, banque, procès verbaux de stationnement ou autres, arriérés d’imposition, notes de téléphone et tutti quanti. J’avais un tiroir qui regorgeait de courriers tout neufs, vierges, aux tampons tous plus vindicatifs les uns que les autres et que je réduisais au silence et à l’impuissance en poussant le mépris jusqu’à ne les plus décacheter.
Alors, dans mon souvenir, c’est ça aussi, la France. Une horde de chacals toujours à mes trousses ! Des vols sinistres de vautours au cou décharné toujours prêts à becqueter les derniers lambeaux de mon portefeuille en décomposition. Un pays chafouin, avec toujours un avorton autorisé par la loi ou le règlement pour vous faire les poches.
J’ai tout envoyé valdinguer.
Et je me suis retrouvé tranquille, apaisé. Dans un pays où je ne dois rien, où on ne me demande pas ce que je fais, comment je vis, la largeur de ma maison, le nombre de pièces que j’habite, la superficie de ma cour, comment je me chauffe, si je rends tel ou tel service rétribué ou non, si j’ai une télévision, un poste de radio et quelle était la profession de ma grand-mère.
Qu'on me comprenne bien : je ne dis pas que la Pologne et les Polonais sont plus détachés des "coercitions argentières" que la France et les Français. Je dis que c'est ainsi que je les vis. Point.
Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas de souci d’argent. On ne me harcelle pas. Je n’y pense jamais. J’en ai pour manger, m’habiller, acheter des clopes, me promener et vivre avec ma famille. J’en ai assez pour vivre en bonne intelligence avec le monde qui m’entoure.
J’ai réduit les sous à leur impuissance congénitale. Je les ai remis à leur juste place d’outils, même si, par principe, j’ai publiquement fait la guerre à un mesquin qui m'en devait deux ou trois, me les doit encore et me les devra sans doute toujours, parce que ce mesquin-là tenait un discours public contraire à ses pratiques privées.
Le facteur ne vient jamais salir ma boîte aux lettres de feuilles roses, vertes, marron avec en bas l’impérieuse sommation avant poursuites : SOMME A PAYER.
Oui, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, la France, mon pays, notre pays, est un pays de racketteurs avides. Racketteurs de pauvres, un pays de pousse-à-la-misère, un pays de chicanes. Avec des légions de roquets aux dents pointues, toujours prêts à vous mordre le mollet si vous ne déliez pas bourse dans les huit jours qui suivent.
Tout cela pour votre bien, évidemment. Pour votre sécurité et pour que la nation soit en bonne santé. Exactement comme le gangster qui rackette un établissement de nuit en échange d’une protection contre d’autres éventuels bandits ou petits malfrats sans scrupules !
L’exil, là-dessus, est un havre de paix. Côté argent, on ne se sent concerné que par ce qui nous concerne vraiment.
C'est-à-dire par pas grand chose.
08:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.10.2013
Humains trop d'humains...

C’est pénible.
Tout y truqué, artificiel, combiné, mensonger, inconfortable, pollué, agressif, - angoissant même -, comme si les hommes en avaient marre d’exister et ne trouvaient rien de mieux pour exprimer cette lassitude que de s’enfoncer un peu plus dans le sinistre et la parole forcément désespérante.
Je me demande souvent pourquoi.
Certes, toutes les époques ont eu leurs difficultés, leurs terreurs, leurs épidémies et leurs guerres dévastatrices, mais justement, quelles leçons et quelles connaissances a retirées l’humanité de cette kyrielle de malheurs et d’infortunes ?
Un esprit sain serait en droit de se dire que l’expérience des siècles aidant, l’humanité devrait poursuivre sa route de progrès en progrès et s’acheminer depuis la nuit des temps vers un avenir de plus en plus radieux.
Il apparaît donc qu’il n’en est rien. Que plus les connaissances s’aiguisent sur tous les sujets de tous les domaines, que plus le droit s’étend aux populations, plus les libertés sont exigibles par chacun et pour chacun, plus la masse difforme des bipèdes colonisateurs de la planète glisse vers le non-sens et que le malheur des gens est de plus en plus prégnant.
Un scientiste me rétorquera, sans doute en faisant fièrement trembloter sa barbichette et en se poussant du col, que l’espérance de vie de Cro-Magnon était de trente ans à peu près et qu’en 2013 les centenaires sont légions. Que la connaissance, l’hygiène, la médecine, la chirurgie et tout et tout, font la mort sans cesse reculer !
J’en conviens.
Mais que vaut un monde où l’espérance de survivre est inversement proportionnelle à celle de vivre ? Le progrès se résumerait-il à une fabrique de vieillards de plus en plus vieux sans les faire passer par les allégresses de la jeunesse ?
L’avancée humaine en serait vraiment une si l’espérance de survie était en constante progression, naturellement accompagnée du bonheur d’exister. C’est ça qui lui donnerait un sens. Et seulement ça. Ce n’est pas vers l’espoir de plus en plus probable d’être vieux que devraient regarder les hommes, mais vers celui de rester jeunes de plus en plus longtemps.
Espérance de vie ? Mais qu’il y a-t-il d’espérance dans ce que j’entends ? Tout n’y est que tricheries et lamentations !
Ou alors, - car comme vous sans doute j’espère bien vivre le plus longtemps possible et qu’aucune maladie ne vienne interrompre brutalement mon voyage - c’est que l’individu diffère radicalement du groupe et que le bonheur individuel n’a de commun que le mot avec le bonheur collectif.
Ce qui est fort envisageable.
Et ainsi tourne en rond la boule bleu habitée - très récemment en considération de son âge - par ses fauves qui, eux aussi, tournent en rond.
Le généticien Jack Harlan, spécialiste de la biodiversité, affirme qu’une des causes de la révolution néolithique - abandon progressif de la cueillette, généralisation de la sédentarisation, domestication des animaux et des plantes et essor de l’agriculture - fut une surpopulation soudaine.
Avec le néolithique, survint le groupe, le village, la communauté, et enfin l’Etat et son inévitable corollaire, la guerre. C’est-à-dire la mort.
Et cela ne laisse guère d’espoir à l’espoir. Car pensez que nous étions 1 milliard en 1815 et que nous sommes à présent sept milliards à réclamer de cette petite boule bleue qu’elle nous nourrisse et nous fasse vivre.
Six milliards en deux cent ans ! Une reproduction aussi époustouflante que celle de ces bactéries qui se coupent en deux, se multiplient ainsi de manière exponentielle et jusqu’à l’infini…
Je ne suis pas certain, moi qui ne suis ni ethnologue, ni paléontologue, ni sociologue, ni archéologue, ni « humanologue », qui ne suis rien et qui ai donc la liberté de penser sans que mon imagination ne soit bridée par les rigueurs des paramètres et l'exigence de la démonstration, que la planète puisse contenter longtemps cette frénésie de la multiplication.
Elle a, elle aussi, ses limites.
Et c’est peut-être aux approches vaguement pressenties de ces limites que l’humanité s’affole, se contredit, s’espionne, s’angoisse, se ment, triche, se tord dans toutes espèces de tourments, sentant l’incompatibilité grandissante entre elle et son habitat planétaire.
La révolution qui attend ceux qui nous succéderont risque d’être cataclysmique ou sera la dernière.
Comme pour les dinosaures. Ce n’est peut-être finalement ni leurs gigantesques flatulences bourrées de méthane, ni un météorite surgissant des fins fonds des espaces universels qui leur signifia leur congé, mais, la surpeuplant au point de la fatiguer à l’extrême, la planète elle-même.
Qui sait ?
Pas vous ?
Moi non plus, remarquez bien…
Illustration : Maison que j'ai prise à la sortie de mon village, aux lisières de la forêt, et qui m'évoque beaucoup l'habitat néolithique
12:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.10.2013
Voyage

Même si plus d’un, l’’aile rompue et du sang plein les yeux, mourra, ils savent que le leitmotiv des saisons qui chavirent les ramènera au point d’un éternel départ.
Ils naviguent entre les nuages et sur un demi-cercle du temps et de l’espace.
Perchés sur les bosquets de la Pologne orientale, à quelques coups d’ailes des steppes de Russie, se souviennent-ils des rivages ocre jaune de l’océan ou de la luxuriance d’une forêt tropicale ? Se rappellent-ils ces climats comme des ports d’attache ou comme les points de chute d’un exode forcené pour la survie ?
Je peux les regarder et les écouter des heures et ne puis alors éviter de leur prêter mes songes, à des siècles de la critique facile de l’anthropomorphisme, dont je me fous, dans ces instants-là, vraiment.
Et mon esprit navigue alors d’eux à moi et aux autres. Aux gens que j’ai croisés et qui de leur vie avaient fait un vagabondage perpétuel, de l’espoir à l’angoisse, du bonheur à la détresse. Comme à ceux, hélas beaucoup plus nombreux, dont le seul horizon, réduit à un point vide d’émotions, tenait lieu de vérité définitive.
Ceux qui savent tout et mieux que quiconque.
Il y a des passerelles inconnues entre la vie et la vie. Poétiques encore. J'appelle "poétique" ce qui laisse rêveur par-delà les froides contingences d'un monde scientiste et convaincu de sa justesse.
J’ai beaucoup de respect pour ces voyageurs ailés, par-delà tous les froids arguments de l’ennuyeuse raison.
J’ai repéré le rouge-queue. Chaque année, il revient en avril et se glisse dans le même tout petit trou de mon vieux bâtiment. Chaque année, il se perche là, sautille là-bas, pérore ici, gazouille plus loin, picore un bourgeon du même sorbier. D’où vient-il et quelle mémoire l’anime ? Sa mémoire s’appelle-t-elle paysages ou conservation de l'espèce ?
Mon pays à moi, ce sont d’abord des paysages et un chant. Une langue. Des mots. Douceur et tendre mélancolie. Du vent sur les marais, des peupliers qui frémissent le long de lourds canaux, des livres lus, emportés avec moi ou reçus depuis.
Quand ce sont des hommes, ce n’est déjà plus un pays.
C’est un lieu.
Commun, jusqu’à la «dépoétisation» de l’éternel retour des petits voyageurs posés sur mon jardin.
08:34 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.10.2013
La langue

La parole qui ne maîtrise pas le langage a les charmes trébuchants de la parole enfantine.
Pour mettre à profit ce que je sais exprimer en polonais, il me faut des sujets simples, immédiats, pratiques, des sujets qui ne sont pas sous-tendus par de grandes préoccupations.
Ce n’est certainement pas demain la veille que je vais me mettre à disserter sur Schopenhauer !
Dès lors, avec un autochtone, je parle forcément de choses très courantes et je m’aperçois que j’utilise souvent, très souvent, les mêmes expressions. Puisque la météo est cataloguée par tout le monde comme le plus futile des propos, elle revient souvent dans ma conversation étriquée. Sauf que moi, elle m’intéresse, la météo. A plus forte raison ici, où elle est exceptionnelle et quand elle est considérée par un natif.
S’exprimer dans une autre langue, celle-ci étant particulièrement ardue, demande, comme je l’ai déjà dit, que je dessine d’abord en français dans ma tête ce que je veux dire. Et j’ai de petites clefs qui ouvrent plaisamment le débat. Une de ces clefs m’a été donnée, une fois, par une vieille dame qui ne connaît pas un mot de ma langue et qui avait tout à coup entamé sa discussion par un à propos de, très bien prononcé. J’avais été estomaqué avant de comprendre que ce à propos de était une locution passée dans la langue polonaise, comme cul-de-sac, par exemple, est passé dans la langue anglaise. Et ce qui est plaisant, amusant, c’est que si j’entame avec un quidam une conversation par à propos de, celui-ci ne sait pas forcément que je suis sur ma langue et considère in petto que je maîtrise bien la sienne. Il en va de même pour une foule de mots tels amortisseurs, convecteurs, vétérans, bijouterie, et plein d’autres, même si l’orthographe polonaise en est complètement différente.
Mais on ne parle pas avec l’orthographe. Que vous disiez éléphant ou éléfant, votre interlocuteur n’en a cure. Alors… En revanche, on parle avec la grammaire, car il faut décliner et là, le tour de passe-passe apparaît au grand jour car je me perds évidemment dans la ronde infernale des génitifs, des vocatifs, et autres accusatifs.
De même pour le pluriel.
Le pluriel polonais a cette particularité d’être différent à partir de cinq. Je m’interroge souvent sur cette bizarrerie du pluriel-pluriel… J’ai demandé, on rigole, on dit qu'on ne sait pas, que c’est comme ça. Il est vrai que je ne saurais moi-même dire, comme ça, à brûle-pourpoint, pourquoi les hiboux et les poux prennent un x et les sous un s.
Donc, pour ce double pluriel, peut-être qu’à partir de cinq, la conscience polonaise fait une distinction et pénètre dans le grand nombre. Dans le superlatif.
On dira dès lors dwa, trzy, cztery bociany -deux, trois, quatre cigognes - mais on dira pięć, sześć etc.… bocianów - cinq, six, etc.… cigognes. Tout cela passe, à partir de cinq, du nominatif au génitif, lequel génitif change évidemment de couleur selon que le mot est féminin ou masculin. Souvent le contraire, d’ailleurs, histoire de compliquer la donne, de celui qu’il porte dans ma langue. Les Polonais, pour reprendre l’exemple ci-dessus, disent un cigogne. Ça change tout.
Si je pense une cigogne, je vais droit dans le mur…
Alors tout ça, dans la parole qui va vite, ça crée évidemment des entorses. Il faut apprendre par cœur.
Mais les Polonais sont très tolérants sur le sujet : du moment qu’on vient vers eux, qu’on parle leur langue et que le message est compréhensible, tout va bien.
Le verbe aller, aussi, n'est pas le même selon que l'on se propose d'aller à pied, en voiture, à cheval ou avec tout autre moyen de locomotion. Je connais les deux verbes. Mais j'arrive à me mélanger les pinceaux. Aussi ai-je voulu dire un jour à mon voisin que j'allais à Lublin dans l'après-midi. J'avais une chance sur deux. Pile ou face. Manque de chance, j'ai littéralement dit que j'allais à Lublin à pied cet après-midi... 130 kilomètres.
Rires.
Et comme j’aime le langage, la manière dont il est ciselé, je suis toujours admiratif quand le maçon, le menuisier, le paysan, parle à toute vitesse et décline tout ça sans une faute. C’est pour moi comme s’il analysait spontanément les mots, celui-ci est un complément d’objet direct, celui-là un complément du nom, cet autre un attribut du sujet…
Je suis admiratif, en fait, du berceau qui donne les réflexes, dans quelque langue que ce soit, d'une grammaire pourtant compliquée.
Et je mesure bien que tout vient de là, du berceau, de cette imitation fabuleuse, de cet écho, de cette répétition appliquée de ce que l'on a entendu.
De ce que j'appelais dans "Chez Bonclou et autres toponymes", la voix lactée.
09:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.10.2013
Résolution en germe
 Un jour, il y a huit ans déjà, d’un seul coup d’un seul, j’ai décidé dans ma tête : j’arrête de boire.
Un jour, il y a huit ans déjà, d’un seul coup d’un seul, j’ai décidé dans ma tête : j’arrête de boire.
Ainsi fut fait… et le monde y gagna en sympathie. Les joies furent enfin réelles, les déconvenues itou. Plus de médiateur. Affrontement direct.
Un jour, d’un seul coup d’un seul, je déciderai peut-être dans ma tête : j’arrête d’écrire.
L’idée en tout cas fait son chemin, comme l’autre avait fait le sien.
Si, il y a un rapport. Enorme, même.
Voyez le nombre d’écrivains, nantis d’un relatif succès, qui titubent sous l’effet de leurs quelques titres !
Et puis, qu’est-ce que l’écriture sinon l’ivresse permanente d’interpréter son rapport à la vie, faute, sans doute, de savoir donner vie à une interprétation ?
Et puis, noircir des pages, des écrans, des brouillons, pour se retrouver sans cesse avec la gueule de bois du nul et non avenu, comme l’ivrogne jeté à la rue par un tenancier chez qui il vient de noyer ses dernières illusions !
Quel plaisir peut-on trouver dans le rejet permanent, sinon celui du maso-paranoïaque, qui aime qu’on crache à la gueule de son plaisir ?
Et puis, et puis… Un tas d'autres choses.
Vous avez vu un buveur palabrer sur les choses du monde ? Oui ? Alors écoutez un écrivain. Vous entendrez la même musique décousue, généreuse ou hargneuse, dépitée ou suffisante… En tout cas toujours décalée de sa propre route.
L'ivrogne n'existe que dans sa représentation volant au secours de son sujet réel. Que fait d'autre l'écrivain ? Il arrive même, chez l'un comme chez l'autre, que le conflit entre le sujet et la représentation ne trouve résolution que dans le suicide.
Il faut penser sérieusement à tout ça.
Toutes les addictions se ressemblent : tentatives de conjuration de la fuite du monde.
09:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.10.2013
La Pologne, l'église et la loi des contraires

Des évêques aux moindres curés de campagne, le clergé polonais tient aujourd’hui le haut du pavé.
Il est souvent incontournable.
Il est, quoiqu’en disent les Polonais eux-mêmes, l’éminence grise du pouvoir.
L’église est riche. Décomplexée, elle se montre âpre au gain et, parfois, à la limite de l’intégrisme. Je sais, par exemple, qu’un curé, dans un village voisin, a refusé d’enterrer un pauvre bougre qui dilapidait tous ses sous dans la vodka, parce que sa veuve n’avait pas d’argent pour le payer. Je sais aussi que ce même curé, décidément obtus jusqu’à la furie obscène, a refusé de marier un jeune couple parce que la promise était en espoir de famille. Je connais un prélat débonnaire et replet qui, avec les travaux de luxe que je le vois faire chez lui depuis plus de quatre ans, a déjà acheté au moins quatre fois ma maison !
L’église a récupéré tous ses biens, immenses, que lui avaient retirés les communistes et elle met désormais son nez partout, dans les écoles comme dans la politique, et je défie un maire d’être réélu à la prochaine échéance, s’il n’accompagne pas ostensiblement tous les dimanches matins ses administrés à la messe.
L’emblème de mort, glorificateur de souffrances et de tortures du Nazaréen, partout pontifie, et même dans des endroits où on l’attend le moins, jusqu’au ridicule : à la poste, à la boucherie au-dessus des quatiers sanguinolents de cochon, au supermarché et jusque dans la salle de saillies du haras de Janow.
Des fois qu'un étalon viendrait à saboter son érection, peut-être !
Cet état de grâce insolent, l’Eglise le doit à ses pires ennemis : les communistes. C’est parce qu’elle a été plus ou moins persécutée - un rôle qu'elle affectionne particulièrement - qu’elle s’est retrouvée du côté des opprimés et ces opprimés-là lui en sont aujourd’hui reconnaissants. Si les communistes n’étaient pas passés par là avec leur matérialisme historique à la noix qui tentait de la plus ou moins nier, la soutane n’aurait pas repris du galon jusqu’à cette impudique fierté. N’oublions pas en effet qu’elle était très critiquée entre les deux guerres et que le refondateur de la Pologne, le nationaliste Józef Piłsudski, vainqueur des bolcheviques en 1920, n'était pas particulièrement enclin à l'encenser.
J’ai dit à quelques Polonais qui voulaient l’entendre que l’Eglise était sous le communisme du côté des opprimés parce qu’elle était elle-même opprimée. Sans quoi, ai-je rajouté, l’Eglise est toujours du côté de ceux qui la servent, c’est-à-dire du côté du pouvoir et se fiche alors comme de l'an quarante des opprimés.
Pour moi, natif du pays de la loi de 1905, du pays où l’Eglise a été démasquée par le siècle des Lumières puis par la Révolution et l’abolition des privilèges ; du pays où elle n’a plus son mot à dire sur tout, ce fut au début très déroutant. Dans ma tête, j'étais mal à l'aise et j’avais l’impression d’avoir fait un bond en arrière de plus de cent ans.
Jusqu’à ce que je comprenne vraiment pourquoi.
C’est-à-dire que je comprenne l’éphémère de cette hégémonie. Et c’est ce mot éphémère qui m’a fait sourire et m’a rassuré. Ephémère fait toujours sourire quand il s’applique à une institution qui croit détenir les clefs de l’éternité.
D’ailleurs, les jeunes générations en ont soupé du matraquage idéologique et le font savoir.
A tel point que le parlement polonais est le seul en Europe, peut-être bien au monde, à compter en son sein un élu transsexuel. Non pas parce que le parti sous l’étiquette duquel il s’est présenté était bon et sérieux, mais parce que ce fut là, pour une part de la jeune population, l’occasion d’exprimer son ras le bol et une contestation sans ambages des valeurs catholiques.
L’Eglise en Pologne est donc le fruit d'une logique historique et, comme tout élément d'une logique historique ayant atteint les limites de ce qu’il pouvait "gratter" de l'époque, elle a entamé son déclin.
Et que les libres penseurs de France - fiers d'un héritage à la pérennité duquel ils n'ont en rien contribué - qui toisent la Pologne pour son catholicisme exacerbé, se souviennent que la France, partout, fut le bras armé de l’Eglise et que cette Eglise y a régné sur tous les aspects de la vie intellectuelle, politique, artistique, morale, civile, législative et individuelle pendant plus de 10 siècles.
Qu’ils laissent donc à la Pologne le temps de vivre et de résoudre les contradictions de sa dramatique histoire et gageons qu’à la vitesse historique - équation entre l’état de développement des esprits à un moment donné et les évènements qu'il génère - la Pologne ne mettra pas dix siècles à en finir avec la supercherie.
Et puis, la valeur d'un pays, son charme, son intelligence, sa gentillesse, ne se résument pas, fort heureusement, aux mascarades ostentatoires de ceux qui prétendent y tenir la dragée haute aux autres !
Image : Philip Seelen
10:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.10.2013
Quand l'écriture ne vieillit pas d'un poil
On dirait du Darien. Du grand Darien. Celui du Voleur et de l’Epaulette.
La même ironie mordante, la même franchise du verbe et la même confrontation de la bêtise et de l’intelligence.
Mais ce n’est pas du Darien.
Je vous laisse donc deviner de qui est cette page admirable. « Mon oncle […] était un libre penseur comme il en existe beaucoup, un libre penseur par bêtise. On est souvent religieux de la même façon. La vue d’un prêtre le jetait en des fureurs inconcevables ; il lui montrait le poing, lui faisait des cornes, et touchait du fer derrière son dos, ce qui indique déjà une croyance, la croyance au mauvais œil. Or, quand il s’agit de croyances irraisonnées, il faut les avoir toutes ou n’en avoir pas du tout. Moi qui suis aussi libre penseur, c’est-à-dire un révolté contre tous les dogmes que fit inventer la peur de la mort, je n’ai pas de colère contre les temples, qu’ils soient catholiques, apostoliques, romains, protestants, russes, grecs, bouddhistes, juifs, musulmans. Et puis, moi, j’ai une façon de les considérer et de les expliquer. Un temple, c’est un hommage à l’inconnu. Plus la pensée s’élargit, plus l’inconnu diminue, plus les temples s’écroulent. Mais, au lieu d’y mettre des encensoirs, j’y placerais de télescopes et des microscopes et des machines électriques. Voilà !
« Mon oncle […] était un libre penseur comme il en existe beaucoup, un libre penseur par bêtise. On est souvent religieux de la même façon. La vue d’un prêtre le jetait en des fureurs inconcevables ; il lui montrait le poing, lui faisait des cornes, et touchait du fer derrière son dos, ce qui indique déjà une croyance, la croyance au mauvais œil. Or, quand il s’agit de croyances irraisonnées, il faut les avoir toutes ou n’en avoir pas du tout. Moi qui suis aussi libre penseur, c’est-à-dire un révolté contre tous les dogmes que fit inventer la peur de la mort, je n’ai pas de colère contre les temples, qu’ils soient catholiques, apostoliques, romains, protestants, russes, grecs, bouddhistes, juifs, musulmans. Et puis, moi, j’ai une façon de les considérer et de les expliquer. Un temple, c’est un hommage à l’inconnu. Plus la pensée s’élargit, plus l’inconnu diminue, plus les temples s’écroulent. Mais, au lieu d’y mettre des encensoirs, j’y placerais de télescopes et des microscopes et des machines électriques. Voilà !
Mon oncle et moi nous différions sur tous les points. Il était patriote, moi je ne le suis pas, parce que, le patriotisme, c’est encore une religion. C’est l’œuf des guerres.
Mon oncle était franc-maçon. Moi, je déclare les francs-maçons plus bêtes que les vieilles dévotes. C’est mon opinion et je la soutiens. Tant qu’à avoir une religion, l’ancienne me suffirait.
Ces nigauds-là ne font qu’imiter les curés. Ils ont pour symbole un triangle au lieu d’une croix. Ils ont des églises qu’ils appellent des Loges avec un tas de cultes divers : le rite Ecossais, le rite Français, le Grand-Orient, une série de balivernes à crever de rire.
Puis, qu’est-ce qu’ils veulent ? Se secourir mutuellement en se chatouillant le fond de la main. Je n’y vois pas de mal. Ils ont mis en pratique le précepte chrétien : « Secourez-vous les uns les autres. » La seule différence consiste dans le chatouillement. Mais, est-ce la peine de faire tant de cérémonies pour prêter cent sous à un pauvre diable ? Les religieux, pour qui l’aumône et le secours sont un devoir et un métier, tracent en tête de leurs épîtres trois lettres : J.M.J. Les francs-maçons posent trois points en queue de leur nom. Dos à dos, compères.
Mon oncle me répondait : « Justement nous élevons religion contre religion. Nous faisons de la libre pensée l’arme qui tuera le cléricalisme. La franc-maçonnerie est la citadelle où sont enrôlés tous les démolisseurs de divinités.»
Je ripostais : « Mais, mon bon oncle (au fond je disais : « vieille moule »), c’est justement ce que je vous reproche. Au lieu de détruire, vous organisez la concurrence : ça fait baisser les prix, voilà tout. Et puis encore, si vous n’admettiez parmi vous que des libres penseurs, je comprendrais ; mais vous recevez tout le monde. Vous avez des catholiques en masse, même des chefs du parti. Pie IX fut des vôtres, avant d’être pape. Si vous appelez une Société ainsi composée une citadelle contre le cléricalisme, je la trouve faible, votre citadelle. »
Alors, mon oncle, clignant de l’œil, ajoutait : « Notre véritable action, notre action la plus formidable a lieu en politique. Nous sapons, d’une façon continue et sûre, l’esprit monarchique. »
Cette fois j’éclatais. « Ah ! oui, vous êtes des malins !
Si vous me dites que la Franc-maçonnerie est une usine à élections, je vous l’accorde ; qu’elle sert de machine à faire voter pour les candidats de toutes nuances, je ne le nierai jamais ; qu’elle n’a d’autre fonction que de berner le bon peuple, de l’enrégimenter pour le faire aller à l’urne comme on envoie au feu les soldats, je serai de votre avis; qu’elle est utile, indispensable même à toutes les ambitions politiques parce qu’elle change chacun de ses membres en agent électoral, je vous crierai : « c’est clair comme le soleil ! » Mais si vous me prétendez qu’elle sert à saper l’esprit monarchique, je vous ris au nez.
« Considérez-moi un peu cette vaste et mystérieuse association démocratique, qui a eu pour grand-maître, en France, le prince Napoléon sous l’Empire ; qui a pour grand-maître, en Allemagne, le prince héritier ; en Russie, le frère du czar ; dont font partie le roi Humbert et le prince de Galles ; et toutes les caboches couronnées du globe ! »
Cette fois mon oncle me glissait à l’oreille : « C’est vrai, mais tous ces princes servent nos projets sans s’en douter.
- Et réciproquement, n’est-ce pas ? »
Et j’ajoutais en moi : « Tas de niais ! »
10:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.10.2013
Les mots de l'exil

Il se sensibilisera en quelque sorte.
C’est pourquoi j’avais nommé d’un oxymore, Exil volontaire, mon premier blog, ouvert de septembre 2005 à juillet 2007. Car je ne suis pas exilé. Je me suis exilé. Non pas pour me punir, mais, au contraire, pour tenter de changer à mon avantage le cours de ma vie.
L’écriture et un blog furent les premiers sémaphores lancés par l’éloignement parce que le premier effet de la solitude s’est exprimé par l’inutilité soudaine de la langue du berceau, c’est-à-dire du vecteur principal qui, socialement, relie l’homme aux conditions de son existence.
Or, l’exilé ressent d’abord qu’il est privé de la parole, donc de monde directement intelligible. Dans la rue où la signalisation, les enseignes, la publicité, la voix des passants, usent d’un autre code que celui qu’il possède et qui lui semblait être universel, - viscéralement je parle, intellectuellement tout homme sait bien la diversité culturelle et fondamentale du langage – l’expatrié prend de plein fouet la force matérielle de sa solitude.
Le schisme s’opère par la langue. Parce que le signifiant étant inaccessible à l’intelligence, le signifié perd soudain tout son sens, devient lui-même inaccessible et n’a plus pour être nommé et compris que la parole in petto et l’écriture.
Cette parole in petto s’exprime en deux temps. Si mon voisin me dit «będzie padać», j’ai du mal à imaginer, même si mon cerveau comprend le message, l’eau qui, en longs fils gris, va tantôt dégouliner sur les paysages. Pour voir ça, pour en avoir pleinement conscience, il faut que je me chante la musique qui dit cette réalité : il va pleuvoir. Là, je vois parfaitement. Et si je réponds « mam nadzieję że nie » je ne dis pas ces mots-là avec ma conscience parlée, je les dis en imitant un chant extérieur à mon être. En profondeur, je dis : j’espère que non.
Le langage de communication vulgaire est dès lors exercice interne de schizophrénie.
Cela peut vous paraître sot. C’est pourtant par ce conduit-là que j’ai ressenti ici mes plus grandes solitudes et que j’ai pris pleinement conscience que je vivais parmi d’autres hommes, hors de mon pays.
Il m’est d'ailleurs plusieurs fois arrivé, peu avant un départ programmé pour la France, de faire le projet de dire ceci ou cela à quelqu’un que je devais rencontrer et de chercher les mots polonais avec lesquels j’allais lui dire ce que j’avais à dire, d’hésiter, d’espérer qu’il me comprendrait bien, avant de réaliser soudain que je serais alors dans mon langage et que je n'aurais aucune difficulté à m'exprimer.
Le besoin d’écriture est sans doute venu d’un besoin de sauvegarder mon moi en moi, de promener avec moi ma propre constitution linguistique. Par l’écriture, je me suis penché sur cette constitution, j’ai revu plus profondément mes mots, ce qu’ils signifiaient en substance, en quoi j’étais indissociable d’eux et comment, depuis fort longtemps, ne comprenant pas tout à fait qu’ils étaient en même temps les signifiants d’un monde qui les signifiait, je les avais mis en exil.
Qu’on ne pouvait séparer sa vision du monde de l’art de la dire, "art de la dire" désignant ici la parole en général.
J’ai dès lors ressenti que nos mots étaient en exil parce que nous les possédions à fond, d'un instinct qui n'a rien d'instinctif, et que nous en usions comme des outils alors qu’ils forgent eux-mêmes l’artisan qui manie cet outil.
Sans tout cela, sans cet exil fondamental des mots qui m’est apparu alors qu’ils ne m’étaient, d'apparence, plus d'aucune utilité, sans doute n’aurais-je jamais ouvert de blog.
L’exil m’a permis de rapatrier mes mots.
Blog ou pas blog, j’ai toute ma vie consacré à deux velléités : l’écriture et la musique, sans pour autant réussir à devenir ni un véritable écrivain, ni un chanteur ou un musicien accompli. Encore faudrait-il préciser ce que peuvent être un véritable écrivain ou un chanteur accompli par-delà ce qui les définit socialement, c’est-à-dire par-delà l’audience et le succès.
J’ai donc écrit mon premier récit à l’âge de douze ans environ et, comme tous les collégiens-adolescents reclus entre quatre murs où une absurde discipline tenait lieu de morale de vie, j’ai noirci des cahiers entiers de poèmes où les vers tenaient lieu de subversion.
Plus tard, j’ai gribouillé des manuscrits, des romans, des nouvelles, des trucs qui se voulaient être des essais, toutes ces tentatives ayant pris le chemin qui mène directement à la poubelle.
Sans cette poubelle et sans l’exil, deux choses absolument sans aucun lien entre elles, aurais-je ouvert un blog ? Je n’en suis pas certain. Mais on ne peut rien affirmer de fiable quand on se fait apocryphe, qu’on imagine un passé autrement. Disons alors, pour tenter d’approcher la vérité au plus près, qu'eu égard aux dispositions d’esprit dans lesquelles j’étais durant les quelques années qui ont précédé mon départ de France, qu'il n’y avait aucune place pour le temps, l’envie et l’investissement personnel que réclame la tenue d’un blog.
L’ennui dû à une vie dont le seul défaut était d’être depuis trop longtemps la même, le prisme tantôt joyeux tantôt désespérant de l’alcool, les copains, la musique qui, les derniers temps, me donnait toute satisfaction, un travail – sens étymologique oblige -qui m’était devenu exécrable, tout ça avait expulsé de mon âme le désir et le besoin d’écrire.
L’écriture n’affronte jamais rien en temps réel. Elle entre en scène quand la messe est dite, du malaise ou de la joie. Parce qu’elle est décalée, elle est l’art de mentir tout en disant la vérité.
Et c’est quand j’eus tranché le nœud gordien qui retient prisonnière toute vie sécurisée sous le poids des habitudes, même bonnes, lorsque je me suis retrouvé dans un pays dont je ne savais pas grand-chose, dans un climat autre et une géographie nouvelle et, surtout, avec d’autres espoirs affectifs, que je me suis remis à écrire, tous les jours, avec délectation, avec acharnement, comme si cette écriture avait enfin trouvé, avec le déracinement, l’encre dans laquelle il était nécessaire qu’elle fût trempée.
L'écrivain Denis Montebello, avec lequel j’entretenais une correspondance régulière consécutive à une amitié de plus de vingt-cinq ans, me faisait la juste remarque selon laquelle j’avais attendu d’être coupé de mes racines et de mes amitiés pour écrire – quoique d’impure façon – mon archéologie personnelle avec Le Silence des chrysanthèmes. Comme si je voulais remonter le temps et, remettant au jour les tessons éparpillés de mon enfance, j’eusse voulu comprendre la direction d'un vent de départ qui m’aurait poussé sur les rives du Bug, à l’autre bout de l’Europe.
Puis ce fut Des plages de Charybde aux neiges de Scylla, puis, Chez Bonclou, puis Polska B dzisiaj, puis Zozo, puis Géographiques, puis des nouvelles, puis Le Théâtre des choses, puis deux autres livres actuellement en stand by désolé sur mon disque dur, Agonie et Le Laboureur.
Neuf livres en huit ans avec, entre temps, les quelque 800 textes qui constituent aujourd’hui L’exil des mots. Non, assurément, j‘imagine que je n’aurais jamais fait cela les pieds plantés dans ma glèbe natale et le nez dans un verre où scintillaient autant de désillusions fantasmées que d'espoirs mal définis.
C’est comme ça. Un hasard. Tout n’est qu’hasard logique.
Alors ? Aurais-je la prétention, l’outrecuidance, l’abominable orgueil de prétendre que mon blog est un blog à part en tant qu'épiphénomène du sentiment vécu de l'exil ? Il y a tant d’imbéciles heureux qui me jugent vaniteux, que je serais presque tenté de l’affirmer, histoire de rajouter un peu à leur imbécillité, d’amener de l’eau à leur moulin et de les enfoncer encore plus dans leur fallacieux jugement.
Mais cela ne satisferait pas du tout ma démarche. Mon blog est donc une goutte d’eau dans la mer inégale des milliers d’autres blogs et sites.
Alors, souvent, je me dis que, soit il y a autant de motivations qu'il y a d’archéologies intimes, autant de raisons d'écrire qu’il y a de gens qui écrivent, soit l’écrivant, le blogueur, est, tout comme moi, un être exilé de ses mots, à qui il manque un bout de monde constitutif et qui jette sa bouteille à la mer, espérant qu’elle atteigne à d’autres rivages et reçoivent enfin l’écho d’autres voix inconnues.
A la recherche des mots pour faire du monde et de sa vision une unité.
Pour rapatrier ces mots.
Dans l’illusion numérique du directement publiable– dont je me garderai bien de dire si elle est profitable ou non –, celle qui donne l’impression d’avoir enfin trouvé les sentiers de traverse qui évitent ceux menant tout droit à la poubelle.
12:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.10.2013
To lipa

On dit aussi to lipa si on soupçonne l’information de distiller perfidement de l’intox, à propos du changement climatique, de la crise, des civilisations qui se valent ou non, et tutti quanti. To lipa, c’est du tilleul, de la fumisterie… Autant dire pour une info sur deux, au bas mot, de celles distribuées par les canaux ayant officiellement pignon sur opinions.
Je vous propose d’ailleurs d’user de la métaphore avec un alliage polono-français pour embrasser en trois mots les centaines de bouffons qui écrivent vos lois dans les somptueux palais de la République : To vraiment lipa !
Mais pourquoi le tilleul, bel arbre, respectable, franc et généreux, me direz-vous avec juste raison ?
Parce qu’il est un arbre coquet : quand il prend dangereusement de l’âge, il sait ne rien en laisser paraître et s’avise ainsi de tromper son promeneur. Ses frondaisons resteront d’un vert chatoyant, ses fleurs continueront d’exhaler ce parfum si délicat qui monte légèrement à la tête dans les pénombres crépusculaires du mois de juin, ses branches se dresseront encore vigoureusement vers le ciel et salueront les nuages, quand l’intérieur du tronc se sera déjà vidé de toute sa substance ; sera devenu absolument creux, de telle sorte que la moindre saute d’humeur d’Eole serait bien en mesure de le jeter au sol.
Un colosse aux pieds d’argile.
To lipa s’inscrirait donc comme l’exact contraire de notre expression, c’est du chêne, c'est du solide, du rustique, du fiable… Lipa est pourtant inscrit au calendrier polonais, sur lequel juillet s’énonce lipiec, le mois du tilleul.
C’est donc d’un œil assez goguenard - sans toutefois aller jusqu’à la suspicion - que j’ai pris l’habitude de contempler les quatre tilleuls qui bordent l’allée conduisant à ma maison. Je les aime, ces arbres. Ce sont sur leurs branches encore vides que les grives litornes, à la mi-mars, chantent leur retour ; ce sont sur leurs fleurs que j’entends bourdonner les milliers d’abeilles de l’été ; ce sont eux qui, les premiers, m’avertissent de l’automne frappant déjà à la porte, avec leurs feuilles qui jaunissent et se recroquevillent vilainement dès la fin septembre. Ils sont la pendule de mes saisons et ils ont fière allure. Je ne puis décemment croire qu’ils me trompent sans vergogne et que leur intérieur ne soit qu'une catacombe !
Ils ont en vu, sans doute, des hivers à faire grelotter leur corps endormi ! Ils sont nés là, ils ont la culture de l’est…
Il y a deux ans, pourtant, l’un d’entre eux a craqué. Le plus gros, le plus beau. Les moins trente et les moins vingt cinq et les moins vingt en plein midi avaient eu raison de son histoire : son tronc s’était littéralement fendu en deux sous la morsure. Et je voyais alors ce que je n’aurais dû voir. Ce lipa-là, ce n’était vraiment pas du lipa ! Son intérieur était dur, filandreux, épais, sain. Eût-il été véritablement lipa, que, peut-être, le gel n’aurait rien eu à mordre, que je me dis.
Un jeune paysan m’avait assuré que le véritable responsable de cette blessure déloyale avait surtout été un début d’hiver anormalement doux et humide. L’arbre, rêveur, s’était cru un moment transplanté sous une autre latitude, avait remonté un peu de sève, en avait imprégné ses fibres et s’était fait surprendre en flagrant délit de non-respect du grand mouvement des choses.
Je connaissais bien sûr l’expression «geler à pierre fendre»…Je dis désormais, « geler à fendre les arbres ».
Je lui ai porté secours, à mon arbre. En colmatant la blessure. Il faut toujours porter secours, par respect de soi, aux grands rêveurs inopinément fauchés par la cruauté du monde.
09:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.09.2013
Une légende du Poitou
Début 2012, j’avais entrepris de réécrire certaines légendes du Poitou-Charentes, pour une commande qui s’était avérée ne pas être la bonne…
Parmi ces légendes figurait bien sûr celle de l’incontournable Fée Mélusine. Pourtant, si ce récit fabuleux a donné son nom à Lusignan, chef-lieu de canton de la Vienne situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, il était au Moyen-âge partout répandu dans le folklore européen.
La version la plus connue date de la fin du XIVe siècle, par Jean d’Arras. Mais de multiples versions existaient auparavant et lui ont ensuite succédé, avec de nombreuses variantes suivant les cultures et les époques.
Pas facile de réécrire de tels textes. Il faudait en même temps donner une pointe d’originalité tout en conservant tous les poncifs du conte et de la légende.
Pas certain du tout que j’avais alors satisfait à ces deux exigences.
LA FÉE MÉLUSINE
 Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait peu ou prou sa chaumière.
Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait peu ou prou sa chaumière.
Ainsi, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, villages et hameaux, aujourd’hui séparés entre eux par les terres et les routes, étaient-ils reliés, comme partout ailleurs, par les sentiers de la forêt ancestrale. Toute cette province et tous ces grands espaces forestiers appartenaient en ce temps-là au seul Comte de Poitiers, seigneur passionné de chasse et, en même temps, seigneur érudit, gourmand des livres de la science qu’il dévorait en latin ou en grec, et, principalement, ceux qui traitaient de l’astrologie.
Il savait, du moins sa cour le prétendait-elle, lire la course des étoiles. Pris d’une affection toute filiale pour son neveu Raymondin, jeune homme vigoureux et d’une superbe tenue, il lui dispensait tous les rudiments de son savoir et, partout, l’emmenait avec lui, quand il lui prenait fantaisie de forcer le cerf, le loup ou le renard dans les vastes forêts de son domaine.
C’est à cette époque que vivait également, aux lisières des futaies, une dame de sang bleu, du nom de Pressine ; une dame redoutée de toute la province et même au-delà, car elle était douée de pouvoirs capables de distribuer autant le bien que le mal. Elle avait trois filles d’une beauté hors du commun, qu’elle élevait seule et auxquelles chaque jour elle répétait :
- Votre père vit loin de nous parce qu’il a trahi sa parole et bafoué les lois sacrées du mariage. Ainsi, mes filles, pour ne pas suivre son déshonorant chemin, faites en sorte que dans votre vie, toujours vous restiez fidèles à la moindre parole que vous aurez donnée.
Ce discours ne manqua pas d’impressionner beaucoup les jeunes filles à la fleur de l’âge, qui fomentèrent bientôt le dessein de se venger de ce père ingrat qui les avait abandonnées pour suivre son plaisir. Elles se rendirent donc chez lui, à une dizaine de lieues de là, se firent introduire sous de fausses apparences et le rouèrent de violents coups de bâtons.
Mais quand elles lui racontèrent fièrement leur expédition punitive, leur mère rentra dans le plus vif des courroux.
- Qu’avez-vous donc fait, malheureuses créatures ? s’écria-t-elle. Suivant les lois immuables du ciel et de la terre, jamais un enfant, au risque d’être maudit pour l’éternité, ne doit porter une main vengeresse sur l’auteur de ses jours !
Et les trois filles subirent aussitôt la malédiction maternelle. L’aînée fut confiée à la garde d’un abominable géant, dans une forteresse humide et sombre des Carpates, la puînée dut couver un œuf d’aigle et toute sa vie durant nourrir l’insatiable aiglon, la benjamine, quant à elle…
Sur ces entrefaites-là, le grand veneur du Comte de Poitiers vint un beau jour avertir son maître qu’un redoutable sanglier, un vieux mâle épais, aux défenses cruelles, imposait sa loi parmi ses congénères et y semait la terreur. Le Comte de Poitiers fit donc sonner le rassemblement et, entouré de sa cour et de ses chevaliers en armes, se déplaça jusqu’à Coulombiers. Bientôt les piqueurs et les chiens débusquèrent en effet le vieux solitaire de sa bauge et les chasseurs, le Comte et son neveu en tête, donnèrent la charge à grands cris. Mais la bête était si puissante et si violente qu’elle éventra bientôt les chiens, évita les pieux et finit par disparaître à vive allure dans les halliers.
- Ce n’est tout de même pas un fils de truie qui va ainsi nous tenir la dragée haute ! s’écria le Comte, hors de lui et en s’élançant à la poursuite du fauve.
L’allure était cependant si vive que seul parvint à le suivre son neveu, tandis que tous les autres chasseurs se trouvaient distancés, empêtrés dans les fourrés épais et les breuils. Les deux hommes pourchassèrent ainsi le sanglier tout le jour, le repérant ici, le harcelant là, tentant de l’acculer plus loin, mais rien n’y fit. Les chevaux écumaient, étaient fourbus et la nuit tombait, quand ils se résolurent à mettre pied à terre et à bivouaquer autour d’un grand feu de bois mort. Ils étaient au cœur de la forêt, sans même savoir où exactement. Le comte se retira donc dans les sous-bois, hors du halo de lumière que faisaient danser autour d’eux les flammes, pour se repérer aux étoiles du firmament.
Il revint bientôt, l’air accablé, tant que son neveu s’en alarma.
- Mon, oncle qu’avez-vous ? Sommes-nous donc à ce point égarés que vous ayez si triste mine ?
- -Non, mon fils, nous ne sommes pas perdus, nous avons seulement beaucoup bifurqué vers le nord-ouest, mais j’ai lu dans les astres scintillants, une bien étrange chose. Il est écrit là-haut que celui qui tuera bientôt son Seigneur aura un destin hors du commun, parsemé de gloire et de richesses.
- Oh, mon oncle, l’homme capable d’accomplir un tel forfait ne mériterait rien d’autre que l’enfer et la damnation éternelle !
Mais comme ils étaient là à palabrer devant le feu, les broussailles autour d’eux se mirent soudain à frémir, s’écartèrent violemment, et l’énorme sanglier, sans doute intrigué par ce feu qui trouait l’épaisseur de la nuit, apparut en pleine lumière.
Le comte se rua sur lui, son grand couteau de chasse prêt à le mortellement frapper. La bête esquiva le coup et fit rouler le chasseur par terre d’une violente charge dans les jambes. Elle allait se ruer sur lui et lui labourer le ventre, déjà elle était dessus lui, quand Raymondin brandit son épée et voulut le transpercer. Mais l’animal esquiva encore le coup d’une roulade et l’épée du jeune homme alla se planter dans le corps de son oncle, le traversant de part en part.
Raymondin hurla de douleur. Il tomba à genoux près du gisant et se tint la tête dans les mains, pleurant toutes les larmes de son corps. Le Comte, quant à lui, vidé de son sang, agonisant déjà sur les mousses de la forêt, eut le temps de murmurer, avant de rendre son âme à dieu :
- Les étoiles, Raymondin…Le destin… Accomplis le destin inscrit sur les étoiles…
Au comble du désespoir, le jeune homme enfourcha sa monture, et galopa longtemps à travers la forêt. Cherchant une issue, il sauta des fossés, enjamba des broussailles, pénétra dans des halliers et se cogna cent fois le front aux branches les plus basses des arbres. Enfin, n’en pouvant plus, son cheval se mit à marcher et Raymondin le laissa faire, perdu dans ses pensées et ses remords. Il ne revint à lui que lorsqu’il sentit l’animal tirer fortement sur les rênes en baissant l’encolure pour s’abreuver à un ruisselet qui sourdait à la base d’une énorme roche. Raymondin regarda tout autour de lui. Le ruisselet s’épanchait plus loin en une nappe d’eau prisonnière d’un amas de rochers ; une eau claire, où se mirait la lune.
Il écarquilla les yeux, croyant être en proie aux hallucinations de sa souffrance : une jeune fille, très grande, très pâle, couleur de cette lueur lunaire qui descendait du ciel et inondait la fontaine, les cheveux lui ruisselant jusqu’au creux des reins, se baignait, fredonnait et dansait en tournant en rond, le visage levé vers la voûte des étoiles. Elle vit Raymondin et, sans cesser de tournoyer et de fredonner, vint à lui, l’eau de la fontaine aspergeant autour d’elle des cascades limpides :
- Raymondin, dit-elle, je sais ton malheur et je sais ton inconsolable chagrin. Tu viens de tuer bien malgré toi ton oncle et seigneur adoré… Les pas de ton cheval l‘ont ensuite guidé jusqu’ici, jusqu’à cette fontaine que l’on nomme dans tout le Poitou, la Font d’la sé, la fontaine de la soif. Je t’attendais, Raymondin, pour que s’accomplisse le destin que lut ton seigneur sur la course des étoiles. Je ferai de toi l’homme le plus riche, le plus puissant et le plus heureux de tout le royaume de France, mais il faudra auparavant m’épouser et me faire un indéfectible serment, Raymondin.
Subjugué, dans un état second encore, se souvenant aussi des dernières paroles de son oncle, le jeune homme murmura seulement :
- Et que me faudra t-il jurer ?
- Il te faut jurer maintenant, en levant la main et en la portant ensuite sur ton cœur que, lorsque nous serons mariés, jamais au grand jamais tu ne chercheras à me voir le samedi et, où que j’aille ce jour-là, tu ne chercheras à me suivre.
- Je le jure, dit Raymondin. Sois ma femme, console-moi de tous mes maux et de toute ma tristesse, et je jure devant dieu que jamais je ne chercherai à trahir ce que tu me demandes là.
Et Raymondin, sur les indications de la belle jeune fille, retrouva l’allée qui mène à Coulombiers, puis celle qui conduit à Poitiers, où il arriva bientôt et déclara que son oncle bien aimé s’était égaré lors de la poursuite du sanglier fabuleux et qu’il ne l’avait jamais retrouvé. Il pleura, sa peine était sincère, on le crut. On alluma des cierges immenses et tout le jour on pria pour le salut de l’âme du bon comte de Poitiers, disparu en donnant la chasse à un sanglier sorti des enfers.
Raymondin cependant brûlait de revoir la céleste jeune fille de la fontaine. Il y retourna donc et manqua de tomber alors de stupéfaction. Il n’y avait plus la roche d’où s’échappait une source, mais il y avait là une chapelle dorée d’où ruisselait une tendre musique. La demoiselle en sortit bientôt, toute vêtue de blanc, elle prit Raymondin par la main, le conduisit à l’intérieur où tous les deux, devant un vieux prêtre à la barbe si longue qu’elle balayait les objets sacrés de l’autel, s’agenouillèrent. Le saint homme les bénit et les maria, après que Raymondin eut sur la croix renouvelé son serment déjà fait à sa magnifique épouse.
Alors, heureux et légers comme le sont toujours tous les jeunes mariés de la terre, ils s’en revinrent à Poitiers dans un carrosse resplendissant tiré par quatre forts chevaux. Ils vinrent en premier lieu saluer le successeur du Comte, fils du précédent et cousin de Raymondin, pour lui faire allégeance.
- Cousin et cher Comte, lui dit le jeune homme, répétant en cela le discours que lui avait préalablement prié de dire sa jeune femme, voici mon épouse…Vois comme elle est belle et vois comme elle est jeune ! Etre riche d’elle, me suffit, mon cousin, alors je ne demande pour m’établir sur tes terres que la Font d’la sé et, autour d’elle, un territoire si petit qu’une seule peau de cerf serait capable de le recouvrir
- Tu es bien modeste, mon cousin ! Ta bonté et ta loyauté méritaient assurément bien plus que cela. Mais puisque tel est ton désir, va, Raymondin, ton étrange demande est accordée.
Mais la jeune et belle dame de la fontaine entreprit alors la nuit suivante de découper la peau d’un cerf en fines, très fines lanières, aussi fines que les fils de la toile que tisse une araignée. Elle les mit ensuite soigneusement bout à bout, de telle sorte que le territoire ainsi encerclé fut immense, englobant des forêts, des prairies, des villages, des vallons, des rivières, des champs et des villes.
Le Comte de Poitiers ressentit bien là comme une tromperie, mais comme il était un homme d’honneur et de parole, il accorda ces territoires à son cousin et enjoignit à ses tabellions et à ses commissaires d’enregistrer dûment les édits de propriété.
Aussitôt, un château superbe, avec ses donjons, ses tours, ses remparts et ses parcs, fut élevé au beau milieu de ce territoire. En une nuit seulement. Raymondin s’interrogea. Mais d’où vient tout cela ? Et sa belle épouse lui répondit en riant. Bientôt, lui dit-elle, je couvrirai toute la province de châteaux, de villes, d’églises et de places fortes. Il me suffira d’avoir une bouteille d’eau et trois tabliers.
- Mais comment ? s’inquiéta encore Raymondin. Et le même rire, gai, léger, cristallin, lui fut donné en guise de réponse.
Le château de Raymondin et de sa femme est élevé sur une colline déboisée. Raymondin, oubliant ses questions, fou de bonheur au milieu de ses richesses, de ses soldats, de ses gens, de ses serviteurs, voulut lui donner un nom mémorable, que retiendrait l’histoire.
- Ce sera le château de Lusinème, car il y a dans ce nom toutes les lettres éparpillées de mon prénom, lui déclara sa femme, toujours gaie, toujours rieuse.
En une nuit cependant, une ville sortit de terre tout autour du château, une ville avec ses places, ses étals, ses rues, ses maisons, ses marchés, ses églises et ses habitants joyeux qui choisirent de la nommer Lusinème, en hommage au château des maîtres des lieux. Mais comme ils parlaient vite, fort, tous à la fois et de sourde façon, on entendit et on transmit Lusignan.
Si vous passez par là, par Lusignan, vous apercevrez encore, sur la colline, les restes du donjon que le temps a effrité et puis, si vous êtes curieux, si cette histoire vous intrigue, vous approcherez encore, vous écarterez la broussaille et les ronces, et vous verrez à vos pieds s’ouvrir un souterrain.
Mais les prodiges ne s’arrêtèrent pas à Lusignan... Comme promis, la belle Lusinème - c’est ainsi que la nommait Raymondin en son cœur, faute de n’avoir su mettre les lettres dans un autre ordre, - sema en toute la région, villes, palais et monuments. A Melle, à Vouvant, à Mervant, à Taillebourg, à Fontenay, à Soubise, à Brouage, à Surgères, à Mirbeau…partout. Et puis, sur les rives de la Sèvre niortaise, un peu plus loin que Lusignan en partant sur l’océan, elle éleva une ville avec des tours, des châteaux, des hôtels, des promenades. C’est aujourd’hui Saint-Maixent et c’est l’œuvre de Lusinème.
Survolant bientôt la Vendée, elle construisit encore une abbaye majestueuse, à Maillezais…Et Raymondin, émerveillé, se disait toujours, mais comment fait-elle ? Comment ma femme, mon adorée, si frêle, si délicate et si fragile, construit-elle tous ces trésors aux charpentes si lourdes et aux pierres si volumineuses ?
Mais ces questions étaient vite occultées par son bonheur, d’abord, mais aussi par une autre interrogation, qui le plongea bientôt dans de sévères et douloureuses inquiétudes.
Sa jeune femme lui donnait en effet régulièrement un fils. Elle lui en offrit dix au total. Mais tous, hélas, souffraient d’une horrible malformation. Ils étaient laids, ils étaient même hideux, repoussants. Le premier, Guy, n’avait qu’un œil. L’autre, Urian, possédait bien ses deux yeux mais ils n’étaient pas placés au même niveau, ce qui lui donnait un air sauvage de dément. Odon avait des mains très fines, presque transparentes et couvertes d’écailles rugueuses et froides, Raymond disparaissait sous une épaisse fourrure de poils hirsutes, tel un ours, Geoffroy, le plus terrifiant, le plus brutal, le plus fort, anormalement fort, avait une défense de sanglier qui lui sortait de la bouche en lui déchirant les lèvres, et il écumait et il vociférait sans cesse. Thierry n’avait pas d’oreilles, seulement deux larges trous en lieu et place, Froimond était chauve et sa face était ronde, rouge, large, avec des yeux énormes, sans rétine, et qui semblaient lui sortir de la tête. Regnault, chétif, n’avait qu’une jambe et il sautillait comme un passereau, Antoine avait des griffes de lion, acérées et longues de plus dix centimètres à chaque doigt de pieds. Le dernier, enfin, était tellement difforme, tellement bossu, sans bras, sans nez, sans yeux, qu’on le tua au berceau.
Toutes ces monstruosités effrayaient leur père et le plongeaient dans un profond désarroi, surtout celles de Geoffroy, méchant, violent, et qui, malgré tout, était le fils préféré de la belle et douce Lusinème. Raymondin, lui, se consolait avec Regnault, l’unijambiste. Celui-là était d’un caractère doux, rêveur, attendri. Il voulait, disait-il à son père, se faire moine à l’abbaye de Maillezais, s’y retirer et étudier les livres.
Tous les autres garçons, en dépit de leurs atroces infirmités, épousèrent la carrière militaire et s’y couvrirent de gloire et de lauriers. Quand Geoffroy cependant apprit la vocation de son frère Regnault, il entra dans une colère terrifiante, frappa et hurla que dans une famille de guerriers, un moine était une honte. Revenu précipitamment d’une campagne militaire, il fonça donc à toute allure sur Maillezais, seul. Il y étrangla tous les moines, supplicia son frère et mit le feu à l’abbaye.
Raymondin fut au désespoir. Son fils préféré, tué par le plus horrible et le plus taré de sa descendance !
Il voulut exiger que sa femme répudie ce monstre difforme, qu’elle le chasse sur-le-champ. Et il se mit à la chercher partout, dans les cours, les donjons, les tours, les chambres…
Il ne la trouva point. Il l’appela, elle ne répondit point. Alors, il se souvint soudain qu’on était un samedi et il se souvint en même temps de son serment, deux fois donné… Mais la peine était trop grande, le chagrin trop lourd, il s’engouffrait déjà dans le souterrain du donjon, où il lui semblait avoir perçu une voix : une voix qu’il avait cru reconnaître comme étant celle qui avait fredonné, jadis, la mélodie entendue à la Font d’la sé.
Il marchait maintenant à pas de loup… Une faible lumière vacillait, là-bas, dans le noir lointain. Il approcha et il vit, horrifié : sa femme était nue, plongée dans une sorte de fontaine souterraine… Elle était nue, ses seins resplendissaient et se dressaient, sa taille était fine et, juste après cette taille… Raymondin poussa un cri de douleur.
Après cette taille, ce n’était plus une femme mais un serpent, un horrible serpent, avec une longue, une très longue queue qui fouettait avec violence et furie l’eau de la fontaine.
- Horreur ! Une fée ! s’écria Raymondin. J’ai épousé une fée !
- Lâche ! Parjure ! hurla Lusinème, tu viens de trahir ton serment. Sois maudit à jamais autant que je le suis et, soulevant la terre, la faisant craquer et jaillir en l’air en même temps que les pierres des remparts et du donjon, elle s’envola dans les airs, sa longue queue d’écailles ondulant derrière elle.
Alors un hurlement, une plainte épouvantable, démentielle, d’un désespoir sans nom, déchira les airs, plana longtemps au-dessus des villes et des forêts. On l’entendit, épouvanté, de Poitiers jusqu’à La Rochelle.
Car telle avait été la malédiction maternelle portée sur Mélusine, la benjamine de la fée Pressine. Malédiction terrible la condamnant à une métamorphose régulière, mi-femme, mi-grand serpent ; une métamorphose qui ne devait jamais être vue d’aucun humain, sous peine de malheurs et de désastres.
Et depuis des temps et des temps, maintes fois épousée, jamais Mélusine, n’a eu l’heur de rencontrer l’époux capable de tenir son serment de ne point assister à la monstrueuse mutation.
Alors, depuis des siècles et des siècles, la fée court les bois, les chemins et les fontaines, à la recherche désespérée de l’impossible époux.
Illustration : La fée Mélusine surprise par son mari, par Julius Hübner.
09:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.09.2013
Interview d'outre-tombe
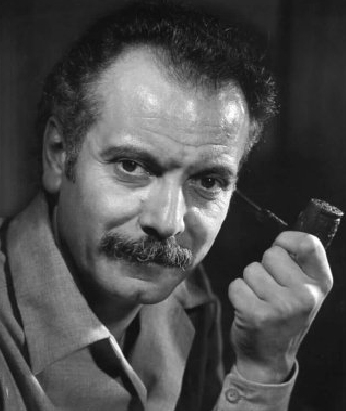 - Salut ! Allez, je te distrais cinq minutes de ton éternel sommeil car avoir ton avis sur certains aspects de 2013, ça doit être quelque chose ! Alors t’en penses quoi, vue du ciel, de l’alternance Hollande ?
- Salut ! Allez, je te distrais cinq minutes de ton éternel sommeil car avoir ton avis sur certains aspects de 2013, ça doit être quelque chose ! Alors t’en penses quoi, vue du ciel, de l’alternance Hollande ?
- Le temps ne fait rien à l’affaire,
Quand on est con, on est con !
- Oui, mais encore ?
- A gauche, à droite, au centre ou alors à l´écart,
Je ne puis t'indiquer où tu dois aller, car
Moi le fil d'Ariane me fait un peu peur
Et je ne m'en sers plus que pour couper le beurre.
- Bon, d’accord… Et son idée saugrenue d’aller faire la guerre en Syrie, qu'est-ce que t'en penses ?
- Qu’aucune idée sur terre n’est digne d'un trépas
Qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas
Que prendre, sur-le-champ, l'ennemi comme il vient
C'est de la bouillie pour les chats et pour les chiens.
Qu'au lieu de mettre en joue quelque vague ennemi
Mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami
Mieux vaut tourner sept fois sa crosse dans la main
Mieux vaut toujours remettre une salve à demain,
Que les seuls généraux qu'on doit suivre aux talons
Ce sont les généraux des p'tits soldats de plomb.
- La jeune parvenue de Lyon, là, la midinette Belkacem, t’en dirais quoi si t’étais encore avec nous ?
- Misogynie à part, le sage avait raison
Il y a les emmerdantes, on en trouve à foison
En foule elles se pressent !
Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées
Et puis, très nettement au-dessus du panier,
Y a les emmerderesses !
- Copé, Fillion, Le Pen, Mélenchon, tous ces clowns, ils doivent bien t’agacer, non ?
- Quand les cons sont braves
Comme moi,
Comme toi,
Comme nous,
Comme vous,
Ce n'est pas très grave.
Qu'ils commettent,
Se permettent
Des bêtises,
Des sottises,
Qu'ils déraisonnent,
Ils n'emmerdent personne.
Par malheur sur terre
Les trois quarts
Des tocards
Sont des gens
Très méchants,
Des crétins sectaires.
Ils s'agitent,
Ils s'excitent,
Ils s'emploient,
Ils déploient
Leur zèle à la ronde,
Ils emmerdent tout l'monde !
- Oui, j’te comprends. Je me demande bien ce que t’aurais dit du mariage pour tous, toi !
Moi, mes amours d'antan c'était de la grisette
Margot, la blanche caille, et Fanchon, la cousette...
Pas la moindre noblesse, excusez-moi du peu,
C'étaient, me direz-vous, des grâces roturières,
Des nymphes de ruisseau, des Vénus de barrière...
Mon prince, on a les dam's du temps jadis qu'on peut...
- Et le nouveau pape, t’as vu ?
C'est bête et méchant, je suggère
Qu'on en parle au prochain concile.
Dieu, s'il existe, il exagère,
Il exagère.
- Mais tu dois ben l'savoir, toi, maintenant, si dieu existe !
- Crosse en l'air ou bien fleur au fusil,
C'est à toi d'en décider, choisis !
A toi seul de trancher s'il vaut mieux
Dire "amen" ou "merde à Dieu".
-Bon. T’as raison. On verra ça plus tard… Et dis-moi, changeons un peu de registre, la rentrée littéraire qui s’annonce, un tas de bouquins, deux ou trois bons pour des centaines de torchons ?
- Moi qui pris mes leçons chez l'engeance argotique,
Je dis en l'occurrence, excusez le jargon,
Si la forme a changé le fond reste identique :
"Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons."
- Et les blogs, tiens, les blogs, ça n'existait pas de ton temps… T’en penses quoi ?
- Trompettes de la Renommée,
Vous êtes bien mal embouchées!
13:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.09.2013
Les pendules à l'heure

La lumière devient précieuse. Commence alors la longue nuit de l’hiver. Dans le creux de la vague, elle étendra son empire de silence seize heures durant.
Là-bas, au bord de l’océan, le soleil est encore vaillant sur le ciel quand la nuit ici a déjà englouti le monde, ses hommes et ses objets. Normal. Il lui faut le temps de faire son lit, à la nuit. Elle met plus de deux heures pour dérouler son drap des berges du Bug aux rivages de l’île de Ré.
De passage, une compatriote s’interrogeait l’hiver dernier : mais que font donc les gens quand il fait nuit au beau milieu de l'après-midi ? Question normale, que je me serais sans doute moi-même posée si je ne n’avais pas vécu là.
Car il ne faut que deux heures et demie en avion pour venir de Paris à Varsovie et j'habite à 200 km à l'est de Varsovie... Il n’y a pas de décalage horaire et la lumière est donc réellement décalée de ces deux heures et demie. Avec un fuseau artificiellement tracé sur le graphique terrestre, elle le serait aussi, bien sûr, mais la montre au poignet, avec un petit coup de pouce, lui donnerait un autre repère dans le cerveau. Et puis, à l’autre bout, la France a adopté l’horaire de l’Europe centrale - la fameuse heure allemande- en avance d’une heure sur son fuseau, alors, forcément à 15 heures en novembre-décembre, ce n’est plus l’après-midi ici mais le début de la soirée. C'est déjà la brune.
C’est donc la notion dans la tête qui doit changer. La lumière, elle, elle continue sa course régulière autour de l’inclinaison de notre boule bleue, en dépit des calculs et des décrets humains. De l’autre côté du Bug, à 15 km seulement de ma maison, en revanche, il fait nuit encore plus tôt dans l’absolu mais à peu près à la même heure aux pendules : je réside sur les lisières d'un fuseau après avoir passé ma vie sur le point zéro de Greenwich. Le Bug sert donc aussi à mettre les pendules à l’heure. Il sert à tellement de choses, ce Bug !
Alors, ce qu’ils font les gens ? Ils font usage de la nuit comme partout ailleurs dans le monde. Ils sont en avance le soir et en avance le matin, car la victoire de la nuit en milieu d'après-midi est compensée par sa déroute au petit matin. Cinq heures seulement quand les soleils laiteux clignent de l’œil derrière les brouillards, comme s’ils ne parvenaient pas à s’extirper d’une nuit trop longue et libertine.
Au début, je m’y faisais assez mal parce que mes pas avaient encore l’habitude de marcher selon la course océanique du soleil. Là, j’ai appris à emboîter ces pas sur ceux de la lumière.
Néanmoins, il m’arrive encore de sourire du dîner à 15 heures et de l’odeur du café à quatre heures du matin. J'ai déjà vu cependant des "amis océaniques" sourire un peu moins, certains matins du mois de juin, quand les premières lueurs venaient flirter avec les rideaux de leur chambre, alors qu'il était à peine trois heures !
Et puisque je parle ici de géographie humaine - la géographie humaine étant selon moi ce qu'on ressent d'émotion devant le grand mouvement des choses et non la distribution des populations sur les territoires - un grand merci à mon ami Tenancier pour sa lecture de Géographiques.
08:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.09.2013
Dispersion
 Elle s’est inscrite au club théâtre de son collège.
Elle s’est inscrite au club théâtre de son collège.
C’est bien, que je lui dis avec sincérité. C’est une excellente école, le théâtre, pour s’extirper de son personnage, pour apprendre à parler en public, pour éprouver le plaisir d’endosser un rôle et tout et tout…
Je suis un policier qui arrête un voleur et j’ai deux répliques à faire…
Bon, que je dis, un peu coupé dans mon élan. Faut un début à tout.
Mais quand même...
Elle photographie des araignées, des fourmis, des libellules, des grillons, des sauterelles, des mouches, des moustiques. De très près. Et elle travaille ensuite -avec bonheur je dois dire - ses clichés. C’est assez réussi.
Elle s’inscrit au club photo de son collège. Passe-moi ta clef USB pour que je montre mes insectes à la prof.
Bon.
Tu sais comment on fait une interview, toi ?
Oui, j’ai fait ça pas mal, du temps où j’avais un petit boulot de communiquant.
Bon, alors, faut que tu me dises tout ça. Je vais interviewer des gens. Tiens, Charlie Watts, quand il reviendra au haras de Janów, au mois d’août prochain, faudra que je l’interviewe…
- ???
-Oui, je me suis inscrite à la rédaction du journal du collège. Et c’est ce qu’on m’a demandé de faire.
-D’interviewer Charlie Watts ?
-Non, d’interviewer des gens ; mais là, pour la prochaine rentrée, ça pourrait faire un bon scoop, pas vrai ?
Sans doute.
Et puis, il y a la chorale. J’ai bien envie de m’inscrire. J’ai appris une chanson par cœur, le prof me fait une audition cet après-midi. Tu veux que je te la chante ? Tu me diras si c'est juste.
Heu… Tu ne trouves pas que ça commence à faire beaucoup, là ? Théâtre, photographe, journaliste, choriste… Tu sais qu’il y a aussi maths, histoire, polonais, anglais, géographie, biologie ?
Oui, mais ça, c’est obligatoire. C’est pas du tout pareil !
Il y a des moments où il faut faire semblant de ne pas comprendre ce que l’on a toujours su, voire revendiqué.
Bref, endosser un rôle.
12:41 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.09.2013
Les rêves à tiroirs
 Ce sont les plus terrifiants car les plus malins, au sens fort. Ils savent se tellement travestir qu'ils arrivent à se nier en tant que rêves et qu'ils s’introduisent ainsi chez vous par la porte du subconscient négligemment laissée entrouverte et pour y tout mettre à l’envers.
Ce sont les plus terrifiants car les plus malins, au sens fort. Ils savent se tellement travestir qu'ils arrivent à se nier en tant que rêves et qu'ils s’introduisent ainsi chez vous par la porte du subconscient négligemment laissée entrouverte et pour y tout mettre à l’envers.
Je ne sais comment les mécaniciens de l’âme les appellent, si tant est qu’ils les appellent.
Alors, je leur ai donné le nom de rêves à tiroirs.
Je suis un trouillard. J’ai une trouille bleue de la maladie, de celle qui ne finit qu’avec la vie. De la clause rédhibitoire qui signe la fin du contrat.
Il y a quelques nuits, donc, j’étais en consultation chez un médecin, un grand spécialiste. Mais, allez savoir pourquoi, ce bougre de médecin-là, tout spécialiste qu’il fût, me détestait au plus haut point de la détestation.
Ça arrive assez souvent, qu’on puisse me détester, et même que, parfois, tant il ne me déplaît pas de déplaire à certains, j'y mets même du mien. Je force le trait de ce qui est chez moi déplaisant, je donne un petit coup de pouce.
Mais là, ce n’était vraiment pas le moment ni le cas : j’avais besoin d’être rassuré. Ce médecin, donc, eut l’air fort désappointé d’être obligé de m’annoncer que mes analyses étaient excellentes et que le crabe n’était pas venu ramper jusqu’à moi…
Il me mit à la porte, fort mécontent. Mais, justement, ne soupçonnant pas encore le degré de son aversion à mon égard, ayant seulement conscience d’une vague antipathie, cela m’inquiéta beaucoup. En effet, pourquoi annoncer à un patient qu’il est sauvé du cercueil avec une tête d'enterrement ? Quel était donc cet Esculape au comportement ahurissant?
Je décide donc de consulter à nouveau quelques jours plus tard et demande des analyses plus sérieuses, plus approfondies. Bingo ! Le médecin est enjoué et m’annonce, triomphal, la gueule fendue jusqu’aux deux oreilles, que je suis perdu, que ce n’est plus un corps que j’ai, mais un abominable champ de bataille où ma vie est en train de succomber sous les coups de boutoir assassins de milliers de métastases.
Affreux désespoir ! Mais, aussitôt, l’effet inverse du précédent se produit. Non, que je me dis, c’est une plaisanterie, un médecin n’annonce jamais à son patient qu’il est foutu, perdu, à deux doigts du sapin éternel, en se tapant sur les cuisses ! C’était une plaisanterie, une galéjade - de fort mauvais goût, certes - mais une galéjade quand même ! De très loin, je préfère les canulars, fussent-ils ignobles, aux arrêts de mort !
Je me mis donc en devoir de ne pas le croire et en fut tout rasséréné. Pour peu, je me serais moi-même mis à rire aux éclats de la bonne blague ! Las ! las ! ma compagne était en larmes, elle avait lu les analyses, tout était vrai…Ma vie foutait le camp, ma vie avait commencé de brûler son dernier bout de chandelle ! J’étais effondré, je compris la haine du médecin, sans me l’expliquer.
La haine, c’est toujours trop long à expliquer, faut toujours remonter trop loin, digresser, pinailler.
Et puis, je retrouvai soudain le confort en me disant, en rêvant très exactement, que tout ça n’était qu’un mauvais rêve et que j’allais me réveiller, heureux et gai comme un pinson. Mais je me mis à rêver que je m’éveillais effectivement et la maladie mortelle était bien là, le cauchemar était réalité…Des larmes coulèrent…J’avais, avec ce réveil, détruit ma dernière planche de salut.
Je me réveillai en vrai et enfin. Mais pas bien du tout et même pas certain du tout que le rêve à tiroirs n’était pas en train de continuer ses sournoises facéties. Pour me persuader vraiment du contraire, il a fallu que je me lève, que je regarde par la fenêtre la nuit qui courait avec le vent sur la cime des arbres, que j’allume les feux, fasse le café et ouf, que je me mette in petto en rogne contre les funestes astuces du subconscient.
Et je me suis dit que peut-être, on peut devenir fou en dormant.
Inverser les pôles, balancer son conscient dans le subconscient et vice-versa. Vivre ainsi sa vie, communiquer, écrire, tout faire, avec le subconscient. Comme en rêvaient les surréalistes et, bien avant eux, Rimbaud. Et comme on roule avec une roue de secours.
Ce qui, peut-être, fit écrire à Chesterton le fameux paradoxe : un fou est quelqu’un qui a tout perdu, sauf la raison.
Vous êtes là ? Bon…Tout va bien : vous êtes en bonne santé, je vous le souhaite de tout cœur, la vie est belle et, si vous avez tout lu de ce petit texte, n’ayez crainte, vous êtes vraiment réveillés.
Illustration : Philip Seelen
11:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.09.2013
L'air qu'ils boivent ferait éclater nos poumons
 De Jean Richepin je ne connais que peu de choses.
De Jean Richepin je ne connais que peu de choses.
J’ai retenu une anecdote : Il remplaça à l’Académie française un écrivain des plus obscurs, connu des seuls jeunes gens qui ont fréquenté le lycée qui porte son nom à Civray, André Theuriet.
Mais revenons à Richepin.
Je sais donc ça et deux de ses poèmes, Philistins et surtout Les oiseaux de passage, allégorie magnifique de la bohème et des poètes, opposés à la vulgarité du commun. Encore un cependant qui doit une fière chandelle posthume à Brassens. Sans la magistrale interprétation de ces deux titres, pas sûr que Richepin eût connu les honneurs de la postérité.
Son œuvre est assez plate, cabotine, et l’auteur aimait en fait jouir de popularité et de reconnaissance par le biais du blasphème social et de la révolte, peu viscérale sans doute. Un peu comme les professionnels du scandale et de la radicalité à notre ère spectaculaire.
N’empêche qu’il eut un trait de génie en écrivant Les Oiseaux de passage - dont Brassens ne conservera que les meilleures strophes - dans le recueil La chanson des gueux, qui lui valut quand même quelques mois de prison.
Il eut ce trait de génie tout comme Antoine Pol, autre obscur versificateur que Brassens a embarqué sur les chemins de la mémoire, en eut un avec ses Passantes, œuvre tiré d’un recueil de poèmes tous plus pitoyables les uns que les autres.
J'eus l'heur de rencontrer un jour le petit-fils d'Antoine Pol...
En ces saisons de lumière oblique sur les premières gelées blanches, je le vois toujours passer au-dessus de nos têtes, le grand triangle des exodes permanents. Je l’entends avant de le voir. Les vers de Richepin et les accords de Brassens, chaque fois me reviennent sur les lèvres :
Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages,
Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts
Et bois et mers et vents, et loin des esclavages
L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons.
Il y a de la désespérance et du mythe de Sisyphe dans ces vols obstinément réguliers d’ouest en est, puis d’est en ouest, du sud au nord et du nord au sud.
Des êtres qui n’habitent nulle part et qui sont partout chez eux, d'un bout à l'autre de la terre.
Hier après-midi dans le froid limpide, les oies sauvages ont traversé mon coin de ciel. Je sais où elles vont, celles-ci : L’ île de ré. Ars en ré, son clocher à flèche noire et ses grands marais. Il me plait en tout cas de le croire.
Longtemps je les ai suivies des yeux et je me suis trouvé tout petit, avec mes billets d’avion et de train et mes horaires , mes dates et mon bagage…Elles seront là-bas en même temps que moi. Avant peut-être.
L'horizon, le mien, les a englouties. Elles en avaient déjà repoussé les limites, elles en voyaient déjà un autre et le vent gorgé de soleil leur était favorable. Elles caquetaient, elles semblaient discuter le bout de gras, le cou tendu vers les mers lointaines.
« Regardez-les ! Avant d’atteindre sa chimère,
Plus d’un l’aile rompue et du sang plein les yeux,
Mourra…. »
Les Polonais ne disent pas le triangle mais klucz, la clef.
La clef des oiseaux sauvages.
La clef d’une porte qui ne cesse de s’ouvrir et de se refermer.
La clef des grands espaces.
Celle qui, peut-être, manque à nos vies, aplaties sous les certitudes incertaines et la force des habitudes. Nous, avec une clef dans les mains, nous ne savons qu'ouvrir la porte d'un habitat.
Clefs en main...
Entre l’errance et la conquête identitaire, les hommes ont toujours opté pour les limites d’un territoire.
Aussi bien sous leurs pieds que dans leur tête.
Nous n’avons sans doute pas assez de force dans nos zèles, pour aller à la rencontre de ce que nous aimons en profondeur, en intime.
Nous ne peignons, sculptons, chantons ou n'écrivons que pour publier cet aveu :
Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve,
C'est l'horizon perdu par-delà les sommets,
C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève
Où notre espoir banal n'abordera jamais.
10:00 Publié dans Acompte d'auteur, Brassens | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.09.2013
Quand les bots bottent en touche
 Au début fut le minitel. Une trouvaille franco-française, fierté des télécoms, fleuron des nouvelles technologies de communication.
Au début fut le minitel. Une trouvaille franco-française, fierté des télécoms, fleuron des nouvelles technologies de communication.
Un fleuron qui fit cependant long feu et qui mourut avant même d’avoir existé, avant même que nous n’ayons eu le temps de saisir à quoi il pouvait bien nous servir.
C’était joué d’avance. Ce que nous ignorions en effet pour la plupart d'entre nous, c’est qu’il était une pâle imitation de ce qui existait déjà à l’état larvaire outre-Atlantique.
Et soudain surgit la toile et le modem, un petit appareil périphérique qui crachait et grésillait un peu comme le truc des flics quand, interpellant un contrevenant sur le bord de la route, ces messieurs de la maréchaussée s'appliquaient à interroger leur fichier, pour voir si le malotru n’avait pas d’autres délits sur la conscience, n’était pas un évadé de Cayenne ou un voyou ayant des comptes à rendre dans quelque autre coin de France.
C’était lent. Le modem, je veux dire. Les flics aussi, mais c’est une toute autre histoire…
Alors, supplantant l’affreux modem, survint le vrai web. Plus besoin de modem, le tout incorporé ! La classe ! Et, enfin, naquit ce que l’on a appelé le web.2, c’est-à-dire, en gros, le web ne demandant aucune compétence technique particulière à l’utilisateur, le web interactif, le web d’échanges, de communication, les boîtes aux lettres, les sites, les blogs, les déclarations d’impôts, les librairies et tutti quanti.
Mais, car il faut bien un mais temporisateur à tout cet étalage de performances, dans le même temps et dans l'esprit de ce qui fut dit la net-économie (car rien ne se créée ni ne se transforme si ce n’est sous-tendu par une vision économique des choses), avec ce web.2 dont nous sommes si friands et qui nous est devenu incontournable, se sont développés ce que le novlangue appelle les bots.
Les bots ? Qu’est-ce donc que ce machin-là, encore ?
Plutôt que de nous lancer dans des périphrases amphigouriques et des explications que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes, écoutons la sage et docte Wikipédia. Houellebecquisons en quelque sorte :
«Un bot informatique est un agent logiciel automatique ou semi-automatique qui interagit avec des serveurs informatiques. Un bot se connecte et interagit avec le serveur comme un programme client utilisé par un humain, d'où le terme « bot », qui est la contraction (par aphérèse) de « robot ».
On les utilise principalement pour effectuer des tâches répétitives que l'automatisation permet d'effectuer rapidement. Ils sont également utiles lorsque la rapidité d'action est un critère important, avec par exemple les robots de jeu ou les robots d'enchères, mais aussi pour simuler des réactions humaines, comme avec les bots de messagerie instantanée.»
Vous avez bien noté. La froide définition dit, l’air de rien : comme un programme client utilisé par un humain et pour simuler des réactions humaines.
On y est donc et, sans vergogne, on peut annoncer la couleur de la réification du monde !
Car figurez-vous qu’il existe désormais des blogs, des sites, avec aucun être humain derrière mais seulement un de ces fameux bots. Par exemple, un bot lit un blog de ceci ou de cela, et il est dès lors capable d’en retirer des éléments constitutifs pour ouvrir lui-même un autre blog. Plus : si vous marquez quelque intérêt pour le contenu de ce blog et que vous le faites gentiment savoir, l'auteur putatif répondra à vos commentaires et, en retour, vous gratifiera même de quelques-unes de ses appréciations sur votre propre site et ainsi de suite.
Et vous, là, devant votre clavier de la solitude et de la parole vidée de son origine cervicale, vous allez vous mettre à sympathiser avec un bot, échanger des avis, faire ceci ou faire cela. Ou bien vous engueuler avec lui. Ça dépend de comment il est programmé pour vous embobiner.
Si vous le trouvez tellement talentueux et sympathique au point que vous lui donniez rendez-vous sur une terrasse de bistro, là, ça peut se gâter. J’ignore ce qu’il vous répondra.
Peut-être vous posera-t-il un lapin.
En tout cas, sur les réseaux dits sociaux, un tas d'imbéciles, c'est certain, discutent avec une machine pendant des plombes ! Pendant ce temps-là, il y en a qui se remplissent les poches ! On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre...
Ce que j’appelle désormais le Web.3 des bots est donc une étape supplémentaire franchie dans la déshumanisation de la parole, dans la gestion assassine de la solitude, dans l’enfermement de chacun derrière les cloisons de son appartement.
Orwell avait beaucoup d’imagination. Mais quand même pas jusques là…
Et dans mes pires moments de doute, je me dis alors que peut-être Feuilly, Le Tenancier, Solko, Stéphane Beau, Philippe Ayraut n’existent même pas ! Qu’ils sont des bots super entraînés, performants, et que ma folie qui s’ignore les lit et discute avec eux.
Comme un dément dans une forêt redevenue primitive. Sur une planète où il n’y a plus trace d’hommes.
La planète des singes des bots.
Peut-être aussi que mes lecteurs qui se font connaître, Michèle, Alfonse, Anne-Marie, Otto, La Zélie ne sont que des cerveaux électroniques au service de mes angoisses existentielles !
Et moi ? Quelle preuve avez-vous donc de mon existence réelle ? En ai-je d'ailleurs moi-même une, de preuve, quand, sur tel ou tel blog, je réponds, en reproduisant des lettres déformées dans un petit cadre idiot, à l’injonction : veuillez prouver que vous n’êtes pas un robot !?
Misère ! J’éteins illico ce putain d’ordi et m'en vais la campagne courir !
11:42 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.09.2013
Septembre

Car septembre est une charnière et l’antichambre voilée des longues catacombes. Rien ne s’y passe, tout s’y annonce. Les paysages semblent au promeneur inattentif toujours habillés de l’étoffe des belles saisons, pourtant, depuis longtemps déjà le loriot a tu sa mélodie flutée et déserté à tire d’ailes, cap sur les tropiques lointains, les feuillages poussiéreux des grands bouleaux. L’hirondelle fait sa plume, fouille son aile comme pour y vérifier qu’y sont bien emmagasinées toutes les réserves nécessaires au voyage, le martinet est devenu muet, la caille et la perdrix piètent et s’agitent, inquiètes de ces grandes plaines ouvertes qu’aucune forêt d’épis ne vient plus protéger et qui les abandonnent aux cruels appétits des hommes et du faucon.
L’équilibre est fragile et silencieux. Rien n’est encore ni jaune, ni ocre, ni rougeâtre aux arbres des chemins. Il faudra pour cela attendre que la machine ronde bascule de l’autre côté de l’équinoxe, qu’elle perde totalement sa sève printanière, descende à petits pas vers l’abandon du jour, qu’elle abdique, qu’elle fasse allégeance à l’avancée des ténèbres et célèbre leur victoire dans la magnificence des camaïeux.
Cet équinoxe sonne le glas de la fête champêtre : les granges regorgent et les champs sont vidés de leurs graines. Sous les latitudes atlantiques, l’Océan bousculera tantôt ses écumes et chahutera plus nerveusement la coque des navires, des brouillards lascifs épouseront le cours des rivières et dessous leurs ouates en suspension endormiront les marais et les plaines. Sous les latitudes continentales, là où je promène mes jours, les vents prendront source plus à l’est encore, sur la morne platitude des steppes, aiguiseront là-bas leurs couteaux et viendront mordiller aux visages des hommes.
Tout cela n’est inscrit qu’en filigrane sur les jours encore bravaches de septembre, qui tente de donner le change, de résister, comme si l’été, emporté par son élan, ne trouvait plus son terme et décidait cette année de ne pas s’en laisser compter par l’éternel retour des mortes saisons.
Mais le temps tourne une à une les pages des climats, ne referme jamais le livre, passe de la dernière à la première ligne et ainsi de suite, dans une lecture en boucle du monde…
Jusqu’à ce que l’homme, qu’il soit des hautes marches ou du vulgum pecus, qu’il soit rustre ou poète, laid ou beau, arpente sa dernière saison, referme le livre et dans un dernier souffle mouche la chandelle sur la beauté des choses.
09:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.09.2013
Fuite
Je ne sais pas trop ce qui me pousse à publier cette photo que je viens de recevoir de la fille de mon frère aîné, récemment disparu… Elle date de 1972, je crois. J’ignorais jusqu’à son existence même… Un choc.
Est-ce un pied de nez au temps qui passe et nous tue que je veux publier ?
Mon frère jouait de l’harmonica, lui qui avait réalisé ma première guitare. Lui à qui je dois d’être musicien.
Quand je regarde ces deux photos que quarante ans d'une vie incertaine séparent, je me dis que, finalement, j’ai toujours vécu avec une guitare entre les bras...
Qu'elle aura été ma seule constance.
2012 :

Et...
1972 :

13:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.09.2013
Ce champ peut ne pas être renseigné
 Vous avez jusqu’à ce jour eu mille interprétations du monde, sans qu’aucune ne soit venue réellement satisfaire votre idée du monde. Votre besoin préconçu, plutôt.
Vous avez jusqu’à ce jour eu mille interprétations du monde, sans qu’aucune ne soit venue réellement satisfaire votre idée du monde. Votre besoin préconçu, plutôt.
Ne trouvez-vous pas ça curieux ? Comment peut-on voir de mille façons les choses sans trouver dans cet écheveau de considérations celle que l’on recherche ?
Qui ne trouve pas dans le vaste canevas matière à broder son propre motif porte sans doute en lui une incapacité à broder.
Certes, vivre sa vie n’est pas chose aisée dans un monde dont la survie dépend justement de la négation de cette vie. Quand tout s’applique à en servir la représentation en guise de réel. Le succédané en guise d'authentique.
Mais, sachant cela, ne savez-vous donc pas l’essentiel, c’est-à-dire n’avez-vous pas la résolution du mystère de vos insatisfactions ? Si, à un carrefour, il est vous indiqué d’un côté fausse route et de l’autre vraie route, pourquoi vous obstinez-vous donc à vous engouffrer dans la fausse ? Seriez-vous, par commodité, partisan de marcher sur le faux afin de mieux imaginer le vrai ?
Ah ! Je vois ! Vous aimez à faire mentir les contraires surtout lorsqu’ils vous sont clairement définis. Vous aimez la fiction.
Ce n’est donc pas l’énigme du monde que vous cherchez à résoudre mais votre propre énigme.
La clef ?
Ailleurs que sous les paillassons convenus.
10:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.09.2013
Pacifisme bêlant ?
 Le grand-père assis au bout de la table lapait entre ses lourdes moustaches blanches une soupe de vermicelles.
Le grand-père assis au bout de la table lapait entre ses lourdes moustaches blanches une soupe de vermicelles.
Il racontait.
Il disait l’horreur d’un massacre et la vermine de la fange, les ventres béants d’où suintaient les viscères, la mort et le sang. Il crachait dans le feu et disait encore que nous ne pouvions imaginer ça. J’ai vu des trucs que vous ne verrez jamais. Et puis, soudain, il divaguait, il évoquait un souvenir précis, plus atroce que tous les autres peut-être, en disant l’aut' jhour ou la s'maine dernière.
Plus il racontait et plus la mémoire enfouie sous plus de soixante années de retour à la normale se rapprochait de lui, envahissait son cerveau, frappait à sa porte et se muait en présent.
L’instituteur disait un nombre effroyable de cadavres, un nombre que nous ne savions pas écrire encore, montrait un autre grand-père, mais qui ne mangeait pas de soupe aux vermicelles entre sa moustache fière et neigeuse. L'instituteur disait Foch, ou Joffre ou Clémenceau. Il pointait sur la carte Compiègne, Verdun, Chalons sur Marne. Puis il regardait sa montre et commandait soudain de fermer les cahiers. Plus il racontait et plus l’horreur s’éloignait, devenait leçon, devoirs à la maison, bonne note à décrocher.
L’un avait vu, l’autre avait appris. Tous les deux disaient la même abomination, l’un avec ses tripes massacrées, l’autre avec sa tête offusquée.
Le jeune homme écoutait le premier et voyait l’horreur dégouliner sur la parole qui tremblait.
Ce soir, il noterait dans un cahier des phrases et des mots épars.
L’enfant écoutait le dernier et regardait par la fenêtre le calme automnal des vieux platanes.
Ce soir, il irait courir les bois et les champs.
Hier, dans l’immense forêt de Białowieża, je me suis rappelé l’un et l’autre de ces deux hommes, qui, chacun à leur façon, m’ont été chers. Il y avait au sol des rails étroits qui couraient sous les épicéas géants. Ces rails avaient été posés là par les méchants, ceux qui avaient fait du mal au grand-père et avaient provoqué le courroux ému de l’instituteur.
On ne m’avait pas raconté que, de l’autre côté de l’épouvante, sous la neige, dans le froid, dans la grande forêt ennemie, des hommes posaient ces rails parce que pour tuer tous les vieillards et tous les instituteurs d'un monde adverse, il leur fallait transporter du bois, beaucoup de bois, pour faire ceci, pour faire cela.
J’étais hier de l’autre côté du rideau infernal. Chez les méchants qui sont tous morts, qui n’ont laissé derrière eux que ces deux rails étroits, jetés dans la pénombre silencieuse des grands arbres.
Le vieillard aussi est mort. Et l’instituteur avec.
Et je me suis senti soudain fourbu à penser qu’un siècle après, d’honorables et bons imbéciles en étaient encore à vouloir tuer des méchants.
Que le chemin de Damas n’est pas encore trouvé sur lequel se révélerait enfin aux hommes une lueur d’intelligence primaire :
Car enfin, la Camarde est assez vigilante,
Elle n’a pas besoin qu’on lui tienne la faux !
Image : Philip Seelen
12:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.08.2013
A la française
 Quand nous avons le plaisir d’accueillir des amis polonais à notre table, nous essayons, comme ils en ont exprimé le désir, de «faire français», autant que faire se peut. Ça leur plaît beaucoup. Avec la plaisanterie récurrente cependant : à la condition qu’il n’y ait ni grenouilles ni cagouilles au menu !
Quand nous avons le plaisir d’accueillir des amis polonais à notre table, nous essayons, comme ils en ont exprimé le désir, de «faire français», autant que faire se peut. Ça leur plaît beaucoup. Avec la plaisanterie récurrente cependant : à la condition qu’il n’y ait ni grenouilles ni cagouilles au menu !
Les clichés culturels ont la vie dure, là comme partout ailleurs. Nous-mêmes en sommes bourrés.
Bref, D. cuisine français et je mets mon grain de sel, lequel grain se limite, hélas, le plus souvent, à quelques conseils de bon aloi, puisque je suis un piètre cuisinier.
Quand je m’aventure à faire un plat, j’en fais tout un plat. Qu’on déguste par courtoisie. En revanche, je suis préposé aux confitures, je suis imbattable pour faire des confitures, je suis le cordon bleu du confit et j’aime ça, ces fruits parfumés de soleil et qui se liquéfient sous le feu, que j’arrose de bon sucre, mirabelles, framboises et, surtout, prunes. C’est une de mes grandes et délectables occupations aux portes de l’automne : confiturer. Cette idée de mettre en cage des fruits que je dégusterai aux petits déjeuners, quand les matins d’hiver seront alors transis de vent et de neige, me plait beaucoup.
Je confiture donc à l’excès.
Quand j’aime, je fais tout dans l’excès.
Quand je déteste aussi, d’ailleurs. J’ai une grande admiration pour les pondérés, les modérés, les justes-milieux. Quoiqu’ils m’ennuient assez vite.
Mais revenons aux repas à la française dans ma maison polonaise.
Le premier bouleversement des habitudes autochtones consiste à servir les plats un par un. Car sur la table polonaise, comme sur la suédoise, tous les plats sont présentés à la fois. C’est une bonne idée à mon sens car cela permet aux maîtres de céans de vraiment partager le repas avec leurs convives, de discuter, d’être disponibles plutôt que d’être sans cesse levés pour offrir ceci ou cela, réchauffer, mettre en plat.
L’ordre est rigoureusement français : apéritif, hors-d’œuvre, viande, fromages, desserts, café. Pas d’entorse au protocole culinaire !
Les fromages cependant font figure de gâteries exotiques, les Polonais n’étant pas de grands amateurs de fromage, sinon en casse-croûte pris vite fait sur le pouce ou au petit déjeuner. Ils ont tort. Car ils en font d’excellents, notamment un qui accuse quelque parenté avec le Comté. Bursztyn, ce qui signifie l’ambre, dont il a peu ou prou la couleur.
Mais le clou, la cerise sur le gâteau de ces repas à la française, c’est le vin, fils sacré du soleil, végétale ambroisie ! Là, je suis l’incontestable (et incontesté) chargé de mission. Je les choisis, je les débouche quelques heures avant l'arrivée des amis, j’hume leur arôme… ça me rappelle beaucoup de souvenirs, des bons et des nettement moins bons. Mais j’aime toujours le parfum du vin, j’y vois des coteaux de soleil et des vignes alignées sous l’automne qui flamboie.
Les commensaux, toujours, goûtent du bout des lèvres. Je les exhorte gentiment à vider leur verre, pour resservir…. Je les trouve bien sobres, bien tempérés, peu enthousiastes. Hé oui, le vin, notre grande fierté, notre aristocrate des papilles gustatives, n’est guère apprécié. Les Polonais, hors quotidien, arrose leur repas de petits verres de vodka. Des repas criblés de trous normands, donc !
Alors, parfois, faisant fi de l’ambiance française, pris d’une grande compassion pour mes amis polonais, parce que je les aime bien, je sors les petits verres caractéristiques. Les yeux amicaux s’allument aussitôt, les sourires se dessinent, et je sers un petit verre de vodka… Voire deux.
Car l’amitié, c’est aussi un échange de bons procédés… culturels. Un panache et une alliance.
11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.08.2013
Brassens et l'écriture
On peut me faire, à propos de Brassens, le vaillant reproche d'être un inconditionnel. Et s'il y a au monde des gens particulièrement ennuyeux, en quelque domaine que ce soit, ce sont bien les inconditionnels.
Tant pis ! Je revendique... Je ne puis d'ailleurs que revendiquer. Ayant, comme tu le sais, lecteur, un goût prononcé pour l'écriture et, en même temps, des velléités d'écrivain, je ne puis, encore une fois, qu'être ému devant l'intelligence et la simplicité de ce que disait cet homme à propos de l'écriture, de la musique, de la vie, de l'inspiration poétique...
Et à propos d'inspiration, justement, je "connais" bon nombre de nos contemporains qui seraient bien inspirés de prendre dans ses paroles, dans sa façon de voir les choses, de saines et de profitables leçons de modestie.
Chapeau bas, donc. Encore et toujours.
09:35 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.08.2013
Enfermement - 2 -

J’avais alors pris cette habitude de marcher en sens inverse.
C’est mieux pour éviter la foule qui dit des bêtises intelligentes.
J’entamais donc ma marche sous le crépuscule des lunes naissantes et, les mains derrière le dos, je traversais des champs, des bois, de petites rivières et des halliers.
Mes plus belles balades étaient hivernales. Parce que c’est beau, l’hiver. On se sent chez soi quand les choses désemparées d’elles-mêmes sont vidées de leurs parures et dispensent le langage de l’essentiel.
C’est arrivé une nuit sans lune et froide, celle du mardi-gras.
Je venais de terminer la rédaction d’un livre et j’étais un homme apaisé.
C’est mon métier. Je suis un écrivain. Mais pas un écrivain marchand.
Je n’ai d’ailleurs jamais marché en marchand. Je n’ai toujours marché que pour moi-même. Sans méditer.
Car dès lors que j’ai franchi la frontière de la solitude quasi absolue - celle dont parlait un autre écrivain et qui disait que lorsque les rapports d’un être humain se limitent à ceux qu’il entretient avec son épicier et sa crémière, les choses commencent à devenir vraiment claires - je ne me suis plus posé les questions qui encombrent l’espace réservé au monde.
Toutes les questions sont vaniteuses, je l’ai déjà dit. La seule réponse à toutes les questions du monde se trouve derrière l’horizon flamboyant et c’est une inaccessible réponse.
Insurmontable frayeur, par tous chaque jour formulée sans jamais être dite.
Et tous ceux qui ont vu derrière cet horizon n’en ont plus jamais reparlé. Et les autres, les pieux, les philosophes, pire encore, ceux qui relèvent des deux catégories, se sont crus autorisés à parler à leur place.
Ils ont usurpé la parole des voyageurs passés de l’autre côté du couchant.
La nuit du mardi-gras, donc, il ne gelait pas très fort mais la terre était dure et noire des gels profonds des nuits précédentes. J’étais emmitouflé et j’arrivais bientôt à la fin de ma promenade, lorsque le sentier sort des bois et se glisse dans les villages, chez les gens qui dorment.
C’est là que j’abandonne. Toujours. Près du sommeil des gens.
Ce n’est pas leur sommeil que je fuis, vous l’aurez pressenti. C’est leur réveil.
C’était ma promenade Nord, de loin ma préférée, celle des bois sombres et des bruissements fauves.
Car, voyez-vous, j’avais quatre promenades bien définies par les quatre horizons de la terre.
La promenade Sud, à l’opposé, était celle des champs et des buissons courts.
Une promenade toute acquise au soleil pendant la journée, sans doute, et la nuit entièrement offerte aux souffles timides de la lune, ça c’est sûr. Une promenade sans ombre. Ouverte.
La Ouest, elle, suivait la rivière et traversait quelques taillis moussus, faits d’aulnes et de roseaux. Une promenade humide, un peu indécise et où le pas qui s’enfonce est parfois pénible.
La Est escaladait lentement un coteau et débouchait soudain, c’était à chaque fois surprenant, sur une sorte de plateau herbeux avec des arbres par-ci, par-là et du vent toujours dedans. La promenade des renouvellements de décor.
Pour l’heure, sur ma promenade Nord, la plus froide, le temps de faire demi-tour, de retraverser les bois de chênes et de châtaigniers suintant l'odeur mouillée des deux essences, d’arpenter un petit champ gibbeux, de pénétrer dans un autre bois encore par un sentier de brumes, il serait l’heure du premier aboiement des chiens et du premier soupir des loups.
Je me glisserai alors dans les draps.
Paisible.
Puis je travaillerai tout l’après-midi à mes corrections.
J’aime me corriger. C’est comme si j’étais deux hommes. Un passé et un présent. Tiens, qu’est-ce qu’il raconte là, ce gredin ? Et là, c’est bien ce qu’il dit… Je me corrige le plus souvent à voix haute.
Ça donne l’illusion des brouhahas de controverses, ce qui multiplie encore la solitude.
Ensuite, je dînerai en buvant du vin et je ressortirai à mon rendez-vous avec les ombres de la nuit.
Pour marcher.
Demain, serait la promenade Ouest.
Car mes promenades tournent en sens inverse des aiguilles de la montre. Elles tentent ainsi de remonter une idée, de conjurer une fuite. Elles cherchent à tourner le dos à l’horizon qui chute.
10:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.08.2013
Une nouvelle
NOCES D'OR

Les oreilles s’écartaient des têtes, même si ça n’était pas un Bovary que l’on mariait ce jour-là : on célébrait les noces d’or d’un couple de campagnards septuagénaires, monsieur et madame Eugène Démoisseau.
On était donc rasé de près, on s’était affublé de ses plus beaux atours, on avait même pour l’occasion astiqué l’automobile.
Les paysans, pour la plupart de la famille du couple champion de la longévité conjugale, et quelques amis, se tenaient raides, empêtrés dans leur habit du dimanche, quoiqu’ils affectassent d’offrir un visage gai et décontracté, celui qui sied au caractère convivial de ce genre de réjouissances. Ils piétinaient cependant sur l’espace herbeux tenant lieu de terrasse devant l’auberge, en attendant enfin l’heure du déjeuner, car on avait - et ça commençait à se murmurer de groupes en groupes -l’estomac dans les talons. Il était près d’une heure et demie et on baguenaudait depuis dix heures du matin !
On avait d’abord assisté à une messe, ce qui n’avait pas été du goût de tout le monde, certains hommes de conviction, de rudes gaillards, sanguins, aux bras puissants et velus, étant ostensiblement demeurés sous les tilleuls du parvis, les mains dans les poches, la cigarette au bec et en causant fort. Si fort que des femmes courroucées leur en avaient fait le reproche, parce qu’on les avait entendu, soi-disant, de l’intérieur de l’église dont le portail était resté ouvert.
Tout le monde avait ensuite été prié de venir admirer une exposition réalisée par le vieil époux. Une exposition de photos et de parchemins jaunis retraçant la vie du jeune homme, puis de l’homme marié, vaillant cultivateur, puis, finalement, la vie paisible du retraité et tout ça se terminait par un trait d’humour, ou d’angoisse, difficile à dire, les deux peut-être, l’un devant conjurer l’autre : deux points suspensifs fermés par un point d’interrogation. Le tout avait été placardé à la mairie sur les murs de la salle du conseil municipal, sous l’œil hautain de Mitterrand. L'époux était en effet conseiller et le maire - qui figurait d’ailleurs parmi les convives - lui avait gentiment octroyé ce privilège.
On s’était exclamé, on avait tapé sur l’épaule du père Démoisseau, on avait fait mine de se pencher pour mieux voir les détails des vieux clichés ou lire l’écriture emberlificotée des documents - extrait de naissance, certificat d’études, état des services militaires, actes de mariage, actes de propriété et tutti quanti - et on avait tout de même un peu brocardé l’artiste autobiographe du fait qu’on ne voyait pas beaucoup la présence de sa femme dans tout ce bel inventaire. Toute une vie s’étalait donc là et les photos, nombreuses, des deux jeunes et sémillants conjoints, debout sous l’ombre d’un chêne aux ramures abondantes, la mariée tout sourire arborant un gigantesque chignon et tenant dans ses mains fluettes un gros bouquet d’iris, accusaient cruellement la fuite lamentable du temps, quand on jetait vers le vieux couple un regard torve, comme pour vérifier l’authenticité de ce qui était montré là.
C’est ce qu’on disait, en tordant le nez, en reniflant fort et en haussant les épaules. On disait que les saisons de la vie filaient bien trop vite, qu’on était tous logés à la même enseigne et on affectait de faire le philosophe et de déplorer que ce n’est pas grand-chose de nous, si on y réfléchit bien !
Mais le clou de l’exposition, le chef-d’œuvre d’ingéniosité devant lequel pavoisait son auteur, en se dandinant et en donnant force explications, un sourire béat illuminant sa grosse figure, c’était un cadre sous verre, énorme, large de deux mètres au moins et haut d’un mètre environ, avec des cases de toutes les couleurs et des branches, et des ramifications et des brindilles : l’arbre généalogique de la famille Démoisseau. Eugène commentait qu’il avait fait des recherches obstinées pendant trois ans, que ça l’avait bien occupé et qu’il avait eu de la chance parce que depuis des siècles et des siècles, sa famille n’avait guère bougé de la contrée. Il avait en tout et pour tout fait une dizaine de communes et ça avait été parfois difficile parce qu’à la Révolution, des papiers avaient été détruits.
Ah, les révolutions, grommelait l’auditoire unanime, c’est jamais trop bon !
On sifflait cependant d’admiration, on notait avec grand respect que les premières racines de l’arbre puisaient dans les années 1670 et que les dernières ramures s’élevaient jusqu’en 1999. Oui, du bon travail, du travail de fourmi, qu’on disait en congratulant le chercheur minutieux et en pensant que ça ne servait vraiment à rien des conneries pareilles et qu’il ne fallait pas savoir quoi faire de ses dix doigts pour s’occuper à des choses de même.
Avec tout ça, donc, l’heure avait filé et on était maintenant pressé, sans en faire évidemment montre, de mettre enfin les pieds sous la table. D’autant que les deux époux avaient eu la curieuse idée d’aller dénicher une auberge au beau milieu des marais de Nuaillé – le bien nommé -, complètement retirée, qu’on avait eu mille peines à trouver, même qu’on s’était perdu, qu’on avait fait des demi-tours, et qu’on s’était un peu énervé dans l’intimité des voitures, ronchonnant que c’était de l’orgueil que de venir faire l’original là, plutôt que de manger tout simplement au café-restaurant du bourg, ou même à la salle des fêtes, où l’on aurait pu être servi par Gustave, le boucher charcutier traiteur de la commune.
Elle était effectivement fort difficile d’accès, cette auberge, et quelqu’un qui n’eût pas été prudent, aurait risqué, c’est sûr, de s’embourber dans un cul de sac fangeux, voire de tomber dans une petite conche. Au beau milieu des prairies que les mortes saisons inondaient et que séparaient entre elles des haies de frênes-têtards impeccablement alignés, des fossés, des chemins de halage ou de traverse, c’était une espèce de gargote à quatre sous, basse et longue, avec des murs d’un blanc approximatif, par endroits lépreux, surmontés d’un vieux toit moussu et passablement avachi. Elle n’avait pas de fenêtre. Juste au-dessus de l’unique et lourde porte vitrée, la tête d’un gros chef cuisinier surmontée d’une toque géante, la mine poupine, de lourdes moustaches noires qui lui dégoulinaient bien en-dessous du menton, un sourire amène en dépit de quelques dents manquantes, l’œil radieux, jouisseur et gourmand, se balançait inlassablement sous les coups de butoir des vents, en gémissant et en grinçant.
Son front était barré d’une flétrissure de rouille qu’on eût dit une affreuse estafilade.
Un menu manuscrit placardé sur la porte offrait de déguster ici des sauces aux lumas, des rôtis, des matelotes d’anguilles, des lapins en gibelotte, des coqs au sang et des huîtres farcies. Juste en-dessous de la vieille enseigne, était également disposée une planche retenue tant bien que mal par deux ficelles et qui annonçait à la peinture violette : A la tambouille tranquille.
Les convives des noces d’or, inquiets et affamés, lorgnaient sur l’aspect quelque peu délabré de l’établissement.
Pour le tranquille, certes, on ne pouvait guère mieux annoncer la couleur. Ça l’était tant que c’en était troublant pour un commerce ayant pignon sur rue. Pignon sur le silence des prairies, qu’elle avait en fait, la guinguette toute de guingois. Dans leur jargon charentais, des goguenards impatients murmuraient qu’o d’vait être ravitaillé par les grolles, y’a pas d’bon dieu ! En effet, aucune voie goudronnée ne conduisait là et pas la moindre signalétique alentour, ni sur les chemins vicinaux, ni sur la route départementale, ni sur la nationale 11, La Rochelle-Limoges via Niort, qui filait par-delà les peupleraies à quelque dix kilomètres de là, n’indiquait qu’il y eût dans les parages un restaurateur qui proposait de faire savourer les spécialités régionales : ceux qui venaient se perdre ici étaient assurément des initiés. Ils devaient, en outre, être de sacrés gourmands et la qualité de ce qu’on leur offrait répondait sans aucun doute aux exigences de cette gourmandise, pour qu’ils s’aventurent comme ça dans les marais, par des chemins boueux, mal aisés, au milieu des champs inondés.
C’est ce qui rassurait un peu les invités des noces d’or et c’est ce qu’ils se disaient entre eux, en se pourléchant les babines ou, pour certains, en se frottant même la panse, comme font les enfants quand ils disent miam miam.
Enfin, les maîtres de céans invitèrent tout le monde à pénétrer à l’intérieur de l’auberge. On s’y rua en meute, on s’y bouscula et on se chamailla quasiment pour trouver une bonne place. C’était là peine perdue : chaque couvert était nominatif et comportait une petite étiquette avec les nom et prénom de chaque commensal. Alors, on fit le tour des tables en se heurtant un peu, en se penchant pour lire, les myopes en ajustant leurs lunettes, les presbytes en les enlevant, et on se croisait, on plaisantait qu’on ne trouverait jamais où s’asseoir dans tout ce fourbi, on faisait demi-tour et on braillait, et on s’interpellait dans un inextricable brouhaha.
Enfin tout le monde se trouva installé. Un lourd silence se fit alors, avant que l’on ne serve les apéritifs, du pineau fait maison, ainsi que le claironna le patron des lieux et tout le monde en rigolant effrontément, et même en le montrant du doigt et en poussant du coude son voisin, reconnut en lui la réplique exacte de l’enseigne, la balafre de rouille en moins.
La salle à manger était étroite, démesurément longue, et ne présentait nullement l’allure négligée de l’extérieur. Bien au contraire. Deux tables rustiques, massives, épaisses, impeccablement cirées et chacune affublée de deux bancs du même tonneau, en occupaient toute la longueur. De part et d’autre de cette salle, de petits buffets, de plaisants confituriers, deux magnifiques vaisseliers en merisier et des placards astucieusement pratiqués dans l’épaisseur des murs en pierres délicatement jointées, servaient au rangement de la vaisselle. Tout respirait la propreté et la décoration de l’ensemble, rideaux de fines dentelles, quelques plantes vertes, des tableaux discrets suspendus ça et là, était sobre, de bon goût, si on arrivait tout de même à faire fi d’un goupil empaillé, le poil rêche, l’œil de verre ébloui, la dent agressive exhibée sur des gencives noirâtres, qui pontifiait sur un meuble bas, pourtant d’une très belle facture.
Pendant qu’on versait le pineau dans de petits verres de cristal, monsieur le conseiller municipal, Eugène Démoisseau, se leva et entama un discours, ce qui ne manqua pas d’inquiéter encore les plus affamés de l’assemblée. Bon dieu, c’est pas vrai, qu’ils se disaient ceux-là, on n’arrivera jamais à s’caler l’estomac ! Le vieux marié cependant, après s’être éclairci la voix par un petit raclement de la gorge, dit qu’il était heureux de réunir autour de lui et de son épouse, en ce jour mémorable, toute sa famille et ses plus chers amis. Il décrivit avec tendresse ce 25 mars 1949 où il avait convolé en justes noces avec Madeleine Dupuis - devant laquelle il fit une petite courbette en demandant qu’on l’applaudisse au passage - comme si, remarquèrent in petto quelques futés, le fait de l’avoir supporté pendant cinquante ans méritait effectivement d’être applaudi. Puis l’orateur se perdit en des considérations d’ordre météorologique sur ce 25 mars 1949 et que, à bien y réfléchir, le climat se réchauffe mais il est vrai aussi qu’à tout bien considérer si on va par là, il faudrait voir si…
Bref, personne n’écoutait plus. Il se rassit, un peu confus, on cria hip hip hip hourra, on lui fit la claque avec frénésie, on porta un toast et, sans plus d’ambages, on se jeta comme des loups enfin libérés sur les merlus froids couchés sur leur épaisse mayonnaise, leurs rondelles de tomates et leurs feuilles de salade.
On eût entendu une mouche voler à travers le cliquetis des fourchettes, des couteaux et des verres. On s’empiffrait, on buvait de l’entre deux mers, on réclamait par des signes en direction des jeunes filles déambulant entre les deux grosses tables, du pain, encore du pain, toujours du pain, pas assez de pain, du bon pain !
On s’empiffrait sans retenue. Vinrent les anguilles persillées. On les avala avec le même emportement en les accompagnant de grandes lampées de vin rosé, du vin de Loire. On se léchait les doigts, on torchait les plats avec de grandes bouchées de pain frais, on avait les commissures des lèvres et, pour certains, le menton, qui luisaient.
Les estomacs ainsi flattés, les conversations, d’abord éparses avant qu’elles ne se changent en un chahut où tout le monde parlait en même temps, purent reprendre alors, en attendant les gigots d’agneau accompagnés de leurs traditionnels flageolets. Et quand il ne resta plus bientôt que les os de ces beaux morceaux d’agneau, les trognes étaient rouges, violacées, et on s’interpellait, et on riait, et on criait, et on chantait, et on tapait sur la table en vidant des bouteilles de Côtes du Rhône.
Eugène Démoisseau se leva et hurla que madame Démoisseau allait chanter. C’était juste avant les plateaux de fromages. On se tut soudain et la mariée, petite femme toute fluette, avec un visage rieur encore fort agréable, entonna, très haut, Rossignol de mes amours, en faisant tous les trémolos et en tenant bien les longues notes, tant que des vieillards, l’émotion décuplée par les alcools, versèrent quelques larmes d’attendrissement.
On l’applaudit avec fougue, on se leva de table, parfois en renversant une chaise au passage, et on vint l’embrasser. L’exaltation était à son paroxysme. La fête, comme on dit communément, battait son plein.
Un observateur minutieux de tout ce charivari d‘ivresse eût cependant pu distinguer en son sein comme une sorte de brebis galeuse. Un homme très grand, énorme, le visage rond comme un ballon, rouge, était assis juste en face des héros de la fête, juste en face de sa sœur exactement. Il s’agissait en effet de Gaston Dupuis, de dix ans le cadet de Madeleine, vieux garçon et qui passait au village pour un original et un bougon. Alors que tous les visages étaient rieurs, hâbleurs, lumineux, le sien restait obstinément fermé et pendant les cinq heures qu’avait duré le repas, il avait dû supporter les discours de son beau-frère - comme d’ailleurs les trois ou quatre autres convives installés alentour - sur la façon dont celui-ci s’y était pris pour faire son gigantesque arbre généalogique, avec tous les détails, les maires qu’il avait rencontrés, les conversations qu’il avait eues avec eux, les archives perdues et retrouvées et tout le Saint-frusquin.
N’ayant personne à qui adresser la parole, isolé face à l’incorrigible causeur, soufflant comme un phoque, suant sang et eau, Gaston Dupuis, déjà de constitution fort sanguine, s’était réfugié dans l’excès. Il avait deux ou trois fois repris de tous les plats, il avait bu comme un chameau au terme du désert, il avait avalé un fromage de chèvre entier, avait englouti des pâtisseries, bu des tasses de café et s’était complètement anéanti avec de grandes rasades de cognac. Il n’entendait désormais plus personne. Il regardait autour de lui, l’air hébété et s’épongeait le front avec un grand mouchoir à carreaux.
Alors qu’un invité, à l’autre bout de la salle, s’était levé et racontait une histoire dont la chute se proposait d’être salace, il en avait préalablement prévenu ces dames, il fut subitement interrompu par un bruit sourd, mat, en même temps que par des éclats de verre qui se brise : Gaston Dupuis s’était soudain écroulé et avait piqué le nez dans son assiette, encore à demi remplie de larges parts de tarte Tatin.
On se précipita, on l’allongea sur le sol, on s’aggloméra autour de lui presque à lui marcher dessus et à finir de l’étouffer, un gars beugla qu’il allait passer l’arme à gauche, nom de dieu, qu’il fallait vite le saigner et déjà il brandissait un grand couteau. On eut mille peines du monde à s’interposer et à le maîtriser.
L’aubergiste était au comble de l’affolement. A une vitesse vertigineuse une foule d’emmerdements qui ne manqueraient pas d’arriver si le drame se confirmait, tournoyaient dans sa tête. Il joignit enfin le SAMU de La Rochelle, lequel SAMU se perdit dans les marais, rappela l’aubergiste, s’embourba encore dans un chemin de traverse et arriva à la Tambouille tranquille alors que le gros Gaston Dupuis était déjà étendu sur un coin de table débarrassé à la hâte et qu’autour de lui, des hommes et des femmes, atterrés, faisaient des signes de croix désordonnés.
La même assemblée, exactement, suivit le sapin quelques jours plus tard, toujours affublée de ses plus beaux atours et la mine franchement lugubre.
On murmura que si seulement on avait été au restaurant du bourg, avec le médecin tout près, là, à deux maisons exactement, hé ben, ce pauvre Gaston…
Enfin, on n’accusait pas, hein ?
On disait, on supposait. Faut bien causer.
Illustration : Albert Fourié
10:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.08.2013
Enfermement - 1 -

Avant d’être ici.
C’est un lieu commun, voire un sentier besogneux : l’homme qui veut aller au bout de son art de vivre ne peut échoir qu’ici.
L’art de vivre qui ne trouve pas ici son prolongement, son aboutissement peut-être, a composé.
Et c’est tant mieux.
Cet art aura vécu entre la chèvre et le chou. Un loup choisira toujours la chèvre. Que voudriez-vous qu’il fît d’un chou ? Je vous le demande bien. Les chiens, eux, se satisfont de tout. Le chou pour lever la patte, la chèvre pour la ramener sur les sentiers battus.
En lui lacérant les jarrets.
Et ça lui donne un métier, au chien. Une raison d’habiter parmi les hommes.
Moi, j’ai peur des chiens. J’ai toujours eu une peur bleue des chiens. Des caniches comme des molosses.
Ici, on n’est plus parmi les hommes et les chiens ne viennent donc jamais. On est entre loups débusqués du hallier.
Mornes arbres d’un morne parc. Allées balayées par des automnes liquéfiés de maussades.
Regards aux yeux morts, translucides, vidés, blanchis, par le tourment léthargique de la chimie médicamenteuse, en surface et en pyjama.
Car je marchais.
Joie initiale, et jamais égalée depuis, d’être debout dans l’espace. Aller à la rencontre du vide posé devant vous.
Marcher sous la pluie qui fait couler sa froidure dans le dos ou sous le soleil qui ronge la peau.
Marcher sans dire.
Surtout marcher seul.
Parce qu’on marche d’abord vers cet horizon courbé et qu’on ne sait pas ce qu’il y a derrière le dos rond de cet horizon. On ne le peut voir qu'en solitude.
Le soleil y plonge. C’est tout ce qu’on sait.
Encore que…
Vient un moment où l’on ne sait plus si ce soleil sort de la terre ou s’il va s’y enfouir, tant que l’on ne sait plus, non plus, à quel bout de sa promenade on en est.
Au début ou vers la fin.
A l'aube ou au crépuscule.
Initiatique ou testamentaire.
Une plaine ? Une colline ? Un fleuve ? Des bois ? Une vallée ? Un désert de sable et de vent ? Des animaux ténébreux ? Au pire d’autres hommes, qu’il y aurait derrière cette échine enluminée ?
On ne peut rien affirmer de cet horizon voûté. Ou alors des bêtises. Des plates ou des savantes. Ça dépend comme on marche. En tous cas ne pas écouter ; sinon son propre murmure.
A écouter les bêtises plates ou savantes qu’on dit de la courbe de l’horizon, forcément on dira soi-même des bêtises.
Plus affligeant : on les croira bientôt.
Comme si on avait déjà été voir là-bas alors qu’on voit à peine jusqu’au bout de ses pieds. Il n’y a pas plus présomptueux, plus répugnant même, que quelqu’un qui marche en faisant croire qu’il sait déjà le paysage de derrière la colline.
Un raseur, un imbécile, au mieux un fat, voire un philosophe.
Non. Marcher, c’est ça qu’il faut ! Marcher avec le vent qui vous pousse ou qui sort de devant, d’on ne sait où, et qui chahute les poils du visage.
J’ai marché sur la piste du loup. La plus solitaire.
Je m’y suis perdu.
Le chemin jusqu’à l’horizon semblait pourtant largement ouvert et puis il y eut ce mur.
Enfin, c’est ce que je crois, que je me suis échoué sur un mur.
Mais peut-être suis-je en fait passé de l’autre côté de la colline en feu et que c’est ça qu’il y avait derrière la colline en feu.
Simplement.
Des imbéciles errants et qui avaient perdu le sens des allégories.
10:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET

















