05.05.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
VINCENT
Tu avais un sacré « pet au casque », comme on dit familièrement, mon cher Vincent. Tu étais même parfois sérieusement inquiétant avec tes yeux fous et ton sourire figé. Je me souviens de cette fois où, avec deux infirmiers et un médecin de garde, nous étions venus chez toi pour te faire hospitaliser d’office. Tu voyais des lézards qui couraient sur les murs de ta cuisine. Tu nous les montrais du doigt : « là, mais si, là, regardez, il se sauve ! » Tu hurlais et tu étais tellement persuasif qu’involontairement nous retournions la tête pour regarder où tu nous indiquais. Tu ne voulais pas être hospitalisé car les « aliens » te recherchaient pour te voler le « grand secret français »… Quel cirque dans ton crâne ! Les lézards n’existaient pas, mais ta terreur était bien réelle. Et elle faisait mal.
Je me souviens aussi de cette fois où je devais t’accompagner chez le juge. Tu m’avais fait une scène : tu refusais d’y aller sans ton chien, un brave bâtard au regard doux. J’avais résisté mais tu n’en démordais pas, alors j’avais cédé. Je nous revois entrant dans le bureau du juge, une femme d’une quarantaine d’année, vêtue d’un tailleur gris clair. Elle nous avait toisés d’un œil sévère. Elle t’avait regardé, puis elle avait tourné la tête vers ton chien. Et quand elle avait lu tout l’amour qu’il y avait dans le regard qu’il posait sur toi, elle avait compris, peut-être, que jamais tes frères humains n’auraient à ton égard autant de bonté. Elle avait souri et nous avait invités à nous asseoir.
Tu avais 24 ans et ton avenir, jalonné d’innombrables séjours en psychiatrie, était déjà tout tracé…
Je ne t’oublie pas.
Stéphane
08:41 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.05.2011
Nouvelle
Cette nouvelle n'a pas été écrite pour le recueil Le Théâtre des choses, à paraître fin juin chez Antidata.
Elle a été écrite comme ça. Un clin d'œil au Front russe de Jean-Claude Lalumière, peut-être. En tout cas, toute ressemblance avec des personnnages existant ou ayant existé ne serait évidemment que pure et malencontreuse coïncidence, parce que c'est comme ça qu'on dit toujours.
UNE METAPHORE
 On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?
On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?
On le dit de l’écrivain mais on devrait le dire aussi du hâbleur, quoique pour de tout autres raisons. Le danger le guette en effet de se faire repérer dans des utilisations différentes de ses mêmes forfanteries. Tel est le conseil que je donnai en tout cas un jour à un de mes nombreux chefs de service, qui n’était pas écrivain pour deux sous, du temps où je m’étais fourvoyé dans une administration décentralisée, aux multiples compétences.
Mais comment m’étais-je donc retrouvé petit soldat dans cette armée de généraux ? Commençons par là si vous le voulez bien; juste pour dire que, y étant entré par erreur, je ne pouvais en sortir que par une porte dérobée et en m’essuyant le front comme quand on l’a échappée belle après avoir encouru un sérieux danger.
J’avais préalablement été un peu tout et rien, étudiant, chômeur, promeneur, ouvrier, délinquant plus ou moins actif et, en dernier lieu, bûcheron. Ce fut donc absolument éreinté, les mains abîmées par les intempéries et le contact rugueux du bois, las aussi de fuir les petits papiers blancs, puis roses, puis bleus, d’huissiers sempiternellement lancés à mes trousses pour me soutirer des arriérés de cotisations, des retards de TVA, des échéances d’impôts et autres persécutions légales, que je décidai un beau jour de déposer mes armes sur un bureau de la Chambre de commerce en y signant, dépité, la cessation de mon activité de bûcheron-négociant en bois, entamée quelque dix ans plus tôt.
Fin d’une complicité que j’avais imaginée possible entre une espèce de rousseauisme nigaud, la nature, les p’tits oiseaux, l’air pur et les matins clairets, et un gagne-pain. La faim, c’est bien vrai, fait sortir le loup du bois et je quittai donc l’ombre des allées forestières, des chemins creux et des parcelles boisées en laissant accrochées dans les branches, tels les oripeaux de la défaite, mes dernières illusions d’un travail librement choisi, non salarié et en dehors du convenu social.
Libre, les bras ballants, le nez en l’air, je réfléchis ainsi quelque temps sur la direction à prendre. Réfléchir, c’est bien beau, mais réfléchir à quoi au juste ? Je ne savais pratiquement rien faire, je n’avais jamais appris le moindre métier et il était désormais bien tard pour m’aventurer dans une vie de larron capable de m’assurer la survie : j’étais donc mûr pour tenter de me mettre au vert dans une administration quelconque. Ce que je fis, au grand amusement de mes amis les plus chers. Je passai outre leur gouaillerie, j’étais fourbu, je vous l’ai dit, et j’avais grand besoin de me reposer sur des lauriers putatifs pendant que bouillerait quand même sur mon maigre feu un semblant de marmite.
Je fis donc une dictée, un extrait de Madame Bovary. On me demanda ensuite d’expliquer l’expression faire le philosophe à propos de Bovary-père préconisant pour l’éducation de son fils qu’on le laissât courir nu dans la nature, puis je calculai deux ou trois pourcentages d’une somme empruntée par un quidam, je dégageai le capital, et le coût total du crédit, - ça j’avais appris à le faire à mes dépens -, je répondis enfin avec bonheur à quelques questions de droit - ça aussi, j’avais appris sur le tas car il n’y a pas plus fin juriste qu’un gars qui a longtemps cherché à vivre en contournant les lois -, et hop, je vis comme par miracle s’ouvrir devant moi les portes confortablement capitonnées d’un emploi de fonctionnaire.
Moi qui venais de traîner mes bottes par des chemins fangeux et qui avais besogné dur à soulever des bûches, scier des troncs et entasser des branches, je me retrouvai soudain au paradis quand on m’installa, au quatrième étage d’un immeuble massif, dans un bureau propret et bien chauffé, en compagnie de deux autres bonhommes. Seule ombre au tableau cependant : les fenêtres donnaient en surplomb sur les toits et le chemin de ronde de la prison de la ville. Je ne vis pas cela d’un très bon œil et me surpris à penser que ça n’était pas forcément de bon augure pour la suite des événements. Décidément, ma vie n’arrêtait pas de tourner autour de ces satanés lieux de pénitence, même dans ses résolutions les plus sages et les plus honnêtes.
Je passe sur mes débuts assez cocasses dans un service où il n’y avait pas grand-chose à faire, sinon se montrer poli avec tout le monde, ne jamais avoir l’air de bayer aux corneilles et toujours faire semblant de griffonner de la quelconque paperasse ou d’être absorbé par un écran d’ordinateur.
Je ne puis cependant faire l’économie d’un mot sur ce petit monde découvert derrière les portes de bureau, petit monde souterrain, replié sur lui-même, hors des réalités extérieures, prétentieux, affable avec la hiérarchie, méprisant avec la piétaille du dessous, car on a croit toujours avoir quelqu’un en-dessous de soi en ces lieux où le grade tient lieu de lettres de noblesse, ne serait-ce que la femme de ménage ou, à l’époque, un Contrat Emploi Solidarité. Petit monde aussi ignorant de tout, de la littérature, des arts, de l’engagement personnel, mais expert en tout ce qui ne sert à rien, comme par exemple savoir présenter un budget clair avec des recettes, des dépenses et des tendances, en trois couleurs et sous Power point animé, bien sûr.
En gros, on eût dit un monde inventé par Molière. En dehors des femmes savantes, toute l’œuvre du maître à peu près était en effet représentée ici, des malades et des cocus imaginaires, des précieuses ridicules, des misanthropes, des tartufes, des bourgeois gentilshommes, des étourdis et des fâcheux. Un vrai panel de farces plus ou moins burlesques. J’en eus souvent le souffle coupé.
Ce que j’ai vraiment mal vécu en ces territoires étranges - exception faite pour une vingtaine d’individus sympathiques enlisés là sur un faux-pas de jeunesse- c’est la malveillance. Malveillance à l’égard du joyeux, du différent, de l’original, du décontracté. Malveillance aussi envers le chômeur, l’alcoolique, le décadent, le Rmiste, le SDF, alors que la plupart de ces gens-là, incapables de voler de leurs propres ailes ailleurs qu’à l’intérieur de leurs murs, y avaient, pour les trois-quarts, trouvé refuge par le biais d’un misérable piston d’une vague connaissance, d’un cousin du cousin au beau-frère d’un quelconque hobereau de village. Sans quoi, ils auraient été assurément de ces traîne-savates qu’ils méprisaient avec tant de zèle. En fait, c’est une image refoulée d’eux-mêmes, une sorte de destin auquel ils avaient échappé de justesse, qu’ils vilipendaient chez l’exclu.
Un dernier mot avant de cesser ces vaines diatribes et d’en venir à mon hâbleur sans carnet, pour dire aussi que, aspirés par les rouages puissants, bien huilés, lents et silencieux de la machine administrative, tous ces inoffensifs gredins étaient devenus d’incorrigibles fainéants et, comme tous les fainéants qui n’assument pas leur fainéantise, ils voyaient du laxisme et de la paresse chez tout ce qui n’était pas eux.
Sur la foi d’une plume qu’on jugea en hauts lieux originale et alerte dans les quelques rédactions administratives que j’avais été amené à commettre, je fus cependant nommé rédacteur en chef du journal interne, une publication destinée à promouvoir la grandeur des compétences, des actions et des projets de l’établissement. Un outil de management et de culture d’entreprise pour développer le sentiment d'appartenance, ne cessait de me claironner dans les oreilles mon chef en se balançant sur sa branche, une branche intermédiaire de l’organigramme mais si élevée pour sa cervelle de moineau, qu’on eût dit qu’il était pris de vertiges permanents.
Moi qui n’avais eu à manager jusqu’alors que ma famélique entreprise forestière et gérer mes déficits récurrents avec le banquier, j’aurais bien voulu qu’on m’expliquât en quoi mes élucubrations sur ce satané journal pouvaient servir les autorités et, surtout, donner à tout ce petit peuple piaulant et caquetant, le sentiment d’appartenir à une respectable et gigantesque volière.
On organisa donc force réunions autour de la notion de communication interne. Des flèches multicolores se mirent à voler dans tous les sens sur un tableau, du haut vers le bas, décisions des dieux de l’Olympe, puis du bas vers le haut, remontée des infos vers l’Olympe, puis transversalement, dans les deux sens, ces flèches-là devant faire tomber les cloisons, résoudre les conflits d’intérêts, libérer les rétentions d’informations et mettre de sérieux bémols aux mesquineries dues, un peu partout sur l’organigramme, à l’exercice du petit pouvoir.
Voilà, me dit-on, la communication interne, c’est abolir les différences, créer la transparence et prévenir ainsi les risques de conflits. C’est aussi faire en sorte que chacun des mille cinq-cents agents de notre Collectivité - avec un C majuscule obligatoire - comprenne à quelle grande œuvre il participe et en soit d’autant plus fier et motivé.
Ite missa est.
Mais encore, hasardai-je ? Car si une mission d’une telle noblesse et d’une telle grandeur m’était pour partie dévolue - faire comprendre à tout le monde pourquoi il travaillait et à quoi - la condition sine qua non pour la mener à bien, était que je comprenne moi-même ce que je faisais.
On ricana, goguenard et bonhomme. Rire supérieur de la hiérarchie qui sait et qui du même coup se trouve légitimée par l‘impéritie intellectuelle de son subordonné. Pour un peu on m’aurait tapé sur l’épaule et remercié de faire montre de tant d’ingénuité.
D’abord, bannir le mot travail de mon langage. Ici, on ne travaillait pas, on œuvrait. Bien. Enfin quelque chose qui me plaisait, on prenait soin des mots, quoique je n’aie jamais vu personne dans tous ces bureaux et ces couloirs où dégoulinait une lumière jaunâtre, qui eût un tant soit peu l’air d’un artiste penché sur son œuvre. Mais passons. On œuvrait à un projet commun, grandiose, énorme, celui du confort des contribuables, qu’il était d’ailleurs préférable d’appeler des clients, par qui nous étions payés et, in fine, donc, pour la réélection des élus qui présidaient aux destinées de notre collectivité.
Voilà qui ne me plaisait pas du tout. Je me vis aussitôt dans la peau d’un vil collaborateur mais je repris aussitôt mes esprits et retrouvai tout mon amour-propre en recadrant tout ça comme ça devait l’être, rubrique blabla.
Mais pour faire comprendre sa fiche de poste à un abruti tel que moi, rien de tel qu’une bonne métaphore, n’est-ce pas ?
Ecoutez donc un peu, me dit-on, tout sourire et en se balançant de suffisance sur un large fauteuil. Hier soir, je lisais justement un article dans Le Mensuel du territorial à propos de la communication. On prenait l’exemple d’un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creusait un trou avec une pioche et à qui on n’avait pas dit pourquoi ce trou. Un promeneur venant à passer par là lui demandait ce qu’il faisait. Ah, qu’il geignait le bougre, je besogne, je besogne. J’en bave, j’en ai marre, c’est dur, c’est éreintant. Chienne de vie !
Puis on prenait un autre gars du même tonneau et qui creusait aussi un trou, mais à qui l’on avait préalablement expliqué que c’étaient les premières fondations d’une cathédrale, d’une magnifique cathédrale, qu’il creusait là. A la question du promeneur, le type se relevait, essuyait son front en sueur, se tâtait les reins et s’exclamait, un sourire radieux illuminant tout son visage : mais comment ? Vous ne savez donc pas ? J’œuvre aux fondations d'une prochaine et gigantesque cathédrale, monsieur !
Voilà, avez-vous compris maintenant ?
Oui, j’avais compris.
Seulement, quoique m’évertuant au cours des quelques années qui suivirent à écrire aux endormis qui constituaient mon public qu’ils étaient en train d’élever un monument considérable à la gloire de je ne sais quoi, qu’ils participaient à une œuvre collectif dont tout le peuple contribuable était fier, je ne vis jamais s’allumer dans leur regard l’éclair joyeux du créateur. En fait de trous, ils creusaient chacun le leur, juste aux dimensions de leur fessier, pour s’y caler confortablement et voir ainsi passer l’inutilité des choses.
J’abandonnai très vite l’inexprimable challenge, moi-même me sentant de plus en plus solitaire et schizophrène dans cet univers à l’envers de la vie. Je pris le parti de la désinvolture. Je finis même par passer plus de temps au bistro du coin que dans mon bureau. C’était ma manière à moi de ne pas rompre tout à fait avec la rue, les vivants, les désespérés, les enjoués, les rêveurs à l’élocution pâteuse et tous les désœuvrés qui, sachant bien qu’ils l’étaient, n’avaient cure de le dissimuler.
Quelques semaines seulement avant que je ne rende mon tablier, survint cependant l’anecdote bis du prolétaire bâtisseur de cathédrale. Je ne saurais dire le sujet de cette énième réunion dont étaient parsemés les jours, les semaines et les mois, toutes plus laborieuses les unes que les autres. Ce dont je me souviens très bien, c’est qu’un type demanda au chef de service si…ah, j’y suis, c’était à propos des horaires à la carte qu’on venait d’installer et le gars, sans doute inquiet que de plus futés que lui trouvent sans lui une combine pour détourner les pointages, demandait si on avait mis en place des moyens de contrôle sérieux, service par service. Un truc magnanime dans ce goût-là. En tout cas un truc qui n’avait absolument rien à voir avec le confort du contribuable et l’érection d’un grand monument.
Le chef sourit benoîtement et fit d’abord une assez longue introduction morale, du style, nous sommes des adultes, nous sommes des gens responsables, nous ne sommes plus des lycéens, avant de s’interrompre brusquement, de faire semblant de se souvenir de quelque chose de précis et d’annoncer, que, tenez, hier soir justement, il lisait un article sur les horaires variables dans Le Mensuel du territorial et qu’on y disait que des gens motivés dans leur travail ne cherchaient jamais à truander des horaires, parce que, par exemple, prenez un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creuse un trou et qui…Et ainsi de suite jusqu’au creuseur enjoué.
Cette fois-ci, ma soupape de sécurité trop longtemps mise à contribution n’y tint pas, se grippa soudain et lâcha la bonde. J’éclatai de rire, semant le trouble et la confusion dans la petite assemblée. On s’offusqua, on remua énergiquement la tête en signe d’une vive désapprobation et on murmura que j’avais sans doute encore bu et que c’était honteux à la fin ! Excédé par leurs clabauderies et leurs jérémiades, c’est donc à cet endroit que je conseillai gentiment au maître de la séance de noter sur un petit carnet ses brillantes métaphores, car ça lui éviterait de raconter les mêmes balourdises à trois ans d’écart et sur des sujets complètement différents.
Ou alors, rajoutai-je, c‘est qu’il lisait depuis des années et tous les soirs le même numéro du Mensuel du territorial. Ce qui était quand même fort inquiétant.
Aucune suite disciplinaire n’eut le temps d’être donnée à mon insolence. Je pris la clef des champs quelques semaines plus tard, abandonnant tous ces gens à leur cercueil matelassé de certitudes. Mais j’étais au bord de l’asphyxie, il me fallait de l’air, tant d’air que je courus, courus à en perdre haleine jusqu’à l’autre bout de l’Europe, d’où aujourd’hui je me souviens, sans colère ni rancune. Avec un certain amusement, même.
Car le monde est fait de mondes juxtaposés, parfaitement étanches, sans passerelle de l’un à l’autre. C’est ainsi. J’avais simplement franchi un mur pour pénétrer un territoire qui n’était pas le mien.
L’intrus c’était moi et le pénible quiproquo était de mon seul fait.
Mais j’ai toujours depuis lors un crayon dans la poche de mon veston.
Du papier rarement.
11:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.05.2011
Réformes spectaculaires de la grammaire et du vocabulaire
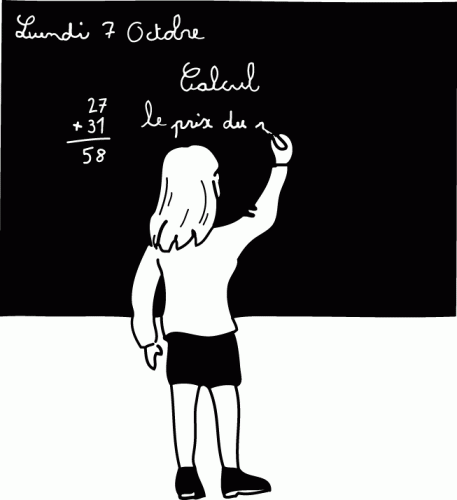 1 –VERBES
1 –VERBES
- Les verbes d’Etat sont : surveiller, mentir, voler, camoufler, falsifier.
- Tous les verbes d’action sont intransitifs.
2 – SUJETS
- Les attributs du sujet sont exclusivement réservés à la conservation de l’espèce.
- Les sujets sont tous des relatifs.
- Leurs antécédents sont sérieusement examinés avant introduction de toute proposition.
- L’inversion du sujet est fortement encouragée.
3 – PROPOSITIONS
- Les propositions sont toutes des subordonnées.
- Les propositions principales sont prohibées.
- L’analyse logique est supprimée.
4 – LES COMPLEMENTS
- Le complément d’objet direct est soumis à tergiversation préalable.
- Les compléments circonstanciels doivent être pleinement circonstanciés.
5 – LES PARTICIPES
- Le participe passé ne s’accorde avec son complément d’objet direct placé avant, qu’à la condition expresse de ne pas contredire le présent.
- Il est déconseillé de participer au présent.
6 - LES AUXILIAIRES
- Les auxiliaires de conjugaison deviennent : se taire, acquiescer, gagner, travailler, paraître.
- L’auxiliaire avoir ne s’emploie plus qu’accolé aux substantifs « travail et argent » et se conjugue le plus souvent au futur compliqué.
- L’auxiliaire être est remplacé par « avoir l’air de », beaucoup plus précis.
7 – LES MODES ET LES TEMPS
- L’impératif est le mode du législateur.
- Le conditionnel est forcément le mode des pauvres.
-Le lâche subjonctif du doute et de la probabilité est incorrect.
- L’indicatif ne conjugue plus rien.
- Le présent est décomposé.
- Le futur est réservé aux loups garous
8 - GENRE ET NOMBRE
- Tout ce qui est singulier est à employer avec précaution.
- Le masculin l’emporte toujours sur le féminin, même et surtout en cas de désaccord.
- Certains mots avaient mauvais genre. Il passe carrément au neutre : critique, pensée, enthousiasme, désir, etc. …
09:01 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.05.2011
Nouvelle
Seconde nouvelle ayant échoué à son examen de passage dans le recueil Le Théâtre des choses, à paraître en juin à l'enseigne d'Antidata.
Je ne la relis ni ne la remanie, laissant aux lecteurs de l'Exil des mots un texte brut de décoffrage, toujours dans le même esprit qu'ici.
L’ENTERREMENT
 Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.
Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.
De lointains bâtisseurs avaient dû considérer qu’une église digne de ce nom, ça ne devait pas être mêlé au quotidien des ouailles, que ça ne devait pas être mitoyen d’une épicerie, d’un café, d’une mairie, d’un marchand de chaussures, que le parvis ombragé et recouvert d’une fine couche de sable blanc n’était pas destiné à devenir le terrain de prédilection des joueurs de pétanque, mais que ça devait se tenir à l’écart de la vulgarité des préoccupations d’ici-bas, se montrer digne, respectable, hiératique même.
Aussi, pour accéder à cette église, fallait-il sortir du bourg par la rue principale et gravir bientôt un faible mamelon en empruntant une petite route fraîchement goudronnée, souvent maculée de bouses verdâtres, toute droite et qui, sitôt passé le point culminant de ce maigre relief, juste devant l’église, redescendait en de nonchalants méandres jusqu’à la forêt de Benon, chère à Rabelais.
Le saint édifice, élevé en grosses pierres taillées, jaunâtres, qu’enlaçaient par endroits le lierre et la viorne, surplombait ainsi le village et semblait de loin veiller à la bonne moralité des citoyens.
Peut-être même étaient-ils allés jusqu’à penser, les bâtisseurs avisés d’antan, que si on voulait se tourner un tant soit peu vers l’église – ne serait-ce que pour y lire l’orientation des vents qu’indiquait un coq au jabot avantageusement bombé– on serait obligé de se tordre le cou pour regarder très haut vers le royaume des cieux, dans la bonne direction, donc.
Créer une manière de réflexe, en quelque sorte.
Et tant qu’à isoler les abstractions spirituelles du tangible commun, on avait aussi construit là-haut le presbytère, qu’on avait accolé au côté sud du monument. Pour que le tout soit enfin à l’unisson, on avait également choisi d’établir sur ce tertre herbeux l’enclos des repos éternels.
Ce bel et digne ensemble était résolument tourné vers l’ouest et le proche océan. Il était ainsi battu par le grand vent des équinoxes, fouaillé par les brumes de novembre, mais aussi offert aux rayons incandescents des solstices de l’été, sans une once d’ombre pour le venir rafraîchir. Il régnait de fait sur ce modeste monticule une atmosphère de grave et lourde solitude. Trop grave peut-être. Si grave que les gens depuis longtemps ne prenaient plus guère la peine de le gravir pour les offices ordinaires du dimanche. Ils y consentaient encore, quoiqu’en automobile seulement, pour les grandes représentations de la liturgie, Noël, les Rameaux et les Pâques.
Cette lente érosion de la foi avait donc contraint la hiérarchie ecclésiastique à une bien prosaïque compression de personnel. Un seul curé présidait désormais au salut des âmes dispersées aux quatre coins des deux ou trois paroisses alentour et il avait été logé ailleurs, au centre de tout ça sans doute, sur Courçon d’Aunis peut-être, dans un souci évident — et bien de ce monde — de réduction des frais de déplacement, de sorte que le presbytère était inhabité depuis déjà une bonne décennie.
Ses volets de bois de chêne, épais, noirs d’intempéries, frappaient avec furie contre les murs et se disloquaient sous les coups de boutoir des vents, le jardinet était la proie des ronces et de la vermine, son allée avait été engloutie par les halliers, la clôture en était toute de guingois, effondrée par endroits, ce qui ajoutait encore à la mélancolie désolante, un peu mystérieuse, des lieux.
Il n’y avait plus guère que pour les enterrements qu’on daignait encore grimper à pied jusqu’au sommet de l’insignifiant relief, qu’on y accompagne un défunt qui passerait par l’autel ou un qui serait directement conduit en sa dernière demeure sans les lénifiantes fioritures de l’espérance. Une petite assemblée se regroupait alors en bas et y attendait la voiture funéraire, l’hiver en tapant du pied, en se frottant les mains et en soufflant dessus, l’été en cherchant l’ombre des noyers plantés au bord de la route ou celle des grands murs de la dernière ferme du bourg.
Un bref coup d’œil jeté sur ces hommes et ces femmes aurait pu d’ailleurs déterminer avec assez de justesse si le mort qu’on se proposait de suivre là-haut était bien à sa place de mort, dans le cours normal des choses, où s’il s’agissait d’une anomalie, d’une injustice et d’un drame.
Sans pour autant aller jusqu’à la désinvolture, si le groupe semblait décontracté et désordonné, si on y bavardait à son aise, si un ou une s’en détachait un peu pour appeler ou répondre sur son portable, si les hommes avaient les mains dans leurs poches et fumaient des cigarettes, si les femmes portaient des foulards qui n’étaient pas forcément d’une sombre couleur, alors on était, à n’en pas douter, à un rendez-vous prévisible, inéluctable et sans surprise. On enterrait aujourd’hui un ou une qui avait fait son temps.
Presque une formalité.
Si, au contraire, le groupe était absolument muet et compact, si les yeux étaient rougis, si on avait pris ses habits les plus noirs et si on baissait légèrement la tête, les mains croisées derrière le dos, immobiles, alors c’est que la Faucheuse avait frappé dans le désordre, à l’aveuglette, et que celui ou celle qu’on attendait là n’aurait jamais dû y venir de sitôt.
La mort reprenant alors tout son sens, qui est celui d’être un grand malheur, la tristesse et l’effroi imprégnaient les visages et enveloppaient les cœurs d’une austère compassion.
Dans les deux cas cependant, après avoir vu et entendu les lourdes mottes de glaise heurter le bois du cercueil, on redescendait toujours la colline par petits groupes de trois ou quatre, avec la mine fort triste et en hochant la tête de consternation impuissante. On commentait, toujours avec les mêmes mots, la fatalité et que tout ça, hélas, serait le lot de chacun, que c’était inévitable, notre tour viendrait, qu’il valait mieux ne pas trop y penser, mais que quand même c’était bien affligeant de s’en aller comme ça sous les ténèbres de la terre, et sans que personne ne sache vraiment où, et que ce « plus jamais » était absolument terrifiant.
On en avait des frissons. On hâtait alors le pas car on n’avait subitement plus qu’une idée en tête : s’engouffrer le plus vite possible au bistro pour y sentir à nouveau palpiter le chaud brouhaha de la vie.
Survint cependant une exception de taille dont tout le monde éprouva bien de la honte après coup et qui fit grand bruit à des kilomètres à la ronde, colportée peut-être par le prêtre au cours de ses différentes pérégrinations de clochers en clochers ou bien par les quelques derniers fidèles de la paroisse, outrés, à juste titre il faut le dire, par l’énormité du scandale.
On était le 28 décembre de l’année 1999.
La nuit précédente, la région avait été littéralement ravagée par un ouragan d’une épouvantable violence, on s’en souvient sans doute. Des toitures s’étaient envolées comme fétus de paille, des cheminées avaient été renversées, des granges s’étaient écroulées, les lignes électriques avaient été arrachées et jetées à terre en un inextricable désordre, celles du téléphone également, et on avait entendu, recroquevillé qu’on était dans les ténèbres en furie, les hauts peupliers des marais qui se fracassaient avec des craquements épouvantables, tels des coups de fusil tirés par-dessus les mugissements de la tempête.
Au petit matin on avait, les bras ballants, la gorge serrée, contemplé le désastre des paysages massacrés, les haies couchées, les fruitiers déracinés, les clôtures éparpillées, les peupleraies rasées, les chênes qui s’étaient répandus en travers des chemins et des routes, disloqués, lamentables, leurs vénérables troncs lacérés de longues et profondes échardes, comme sous la morsure enragée d’un monstre surgi des enfers.
On avait regardé, atterré, les horizons béant aux quatre coins du monde, écartelés, soufflés, pulvérisés par la terrible tourmente. On avait baissé la tête, on avait levé les poings, des yeux s’étaient humectés et on avait même (on n'avait : coquille corrigée par une lectrice), pour les plus désespérés, craché au ciel et insulté la terre.
Puis, le cœur lacéré, on avait retroussé ses manches et on s’était mis à l’ouvrage. Celui-ci tronçonnait, celui-là maçonnait, cet autre déblayait, un autre encore remettait tant bien que mal les tuiles du toit. On s’entraidait, on se prêtait des outils, on allait de chez l’un à chez l’autre, on se hélait, on se demandait conseil et tout ça en tempêtant, en jurant vilainement et en maudissant, bien sûr, le réchauffement climatique, les engins satellitaires, les Américains, l’aménagement imbécile du territoire avec ses autoroutes, ses rocades, ses ponts et, aussi, quoiqu’à voix plus basse, les irrigants de la plaine à maïs qui vidangeaient la terre de son sang, mais parmi lesquels on comptait quelques voisins.
Les femmes vidaient les congélateurs et cuisinaient des quantités effroyables de viandes, de poissons, d’escargots, de légumes, de fruits, car, c’était certain, ce ne serait pas demain la veille qu’on rétablirait l’électricité au vu des poteaux brisés sur les talus, des lignes enchevêtrées sous les ramures effondrées des arbres, et toute cette nourriture, qu’on avait soigneusement entassée pour l’hiver, allait se gâter et n’être bientôt plus bonne que pour la pâtée des chiens !
Vers le milieu de l’après-midi cependant, alors que le soleil vacillait déjà, très bas suspendu à l’horizon d’un ciel malade, bleu livide comme s’il ne s’était pas encore remis de ses épouvantes de la nuit, on se souvint soudain que la vieille Irène Bertholeau, née Soubise, 91 ans, avait paisiblement tiré sa révérence le 26 au soir, dans son lit, et que c’était aujourd’hui qu’on la portait en terre.
Elle avait été une brave et bonne voisine, elle était une ancêtre respectable et respectée, on l’avait toujours connue là, elle était déjà une vieille femme quand on était soi-même encore en culottes courtes et c’était un nouveau pan de la mémoire communale qui s’en allait aujourd’hui vers les ténèbres. Personne ne pouvait décemment, en dépit des circonstances dramatiques qui venaient de lui tomber sur la tête et en dépit de ses urgences, ne pas l’accompagner jusqu’à la tombe.
Les femmes enlevèrent donc leur tablier et abandonnèrent leurs ragoûts, leurs confitures et leurs rôtis, les hommes remisèrent leurs outils, firent taire les tronçonneuses et jetèrent sur les toits endommagés de larges bâches de protection, pour arriver bientôt par petits groupes silencieux, le visage fermé, au pied de la colline.
Pas un mot n’était échangé, les yeux étaient baissés, les poignées de main molles et distraites. Tout le monde avait manifestement la tête ailleurs, qui à sa grange effondrée, qui à son toit éventré, qui à ses arbres fracassés, qui à ses clôtures chambardées.
Le temps pressait. La nuit tomberait très vite et on allait devoir s’éclairer ce soir à la bougie, comme dans les temps reculés. Certains n’auraient même pas de chauffage ! Pour les producteurs de lait, il faudrait apprendre ou réapprendre les gestes antiques de la traite à la main, comme les générations d’un temps innommable ! Tous ces gens de la côte atlantique, en ces jours mémorables, se retrouvaient donc démunis et anxieux, presque handicapés, soudain privés du confort primaire auquel nous nous sommes tous évidemment accoutumés, quoique nous n’y prêtions plus la moindre attention dans le cours de nos vies quotidiennes.
Alors les regards torves guettaient l'arrivée du corbillard, les hommes tapaient du pied et hochaient la tête, nerveux et de fort méchante humeur, les femmes affichaient un visage hermétique, soucieux, et, de temps à autre, s’inquiétaient dans un murmure auprès de leur voisine la plus proche de l’heure qu’il était.
Bref, le trouble était trop profond pour qu’on gardât les extérieurs de la convenance la plus élémentaire. On s’impatientait sans vergogne.
Et ce fut quasiment au pas de course que le maigre cortège se mit bientôt à arpenter la hauteur derrière le cercueil enrubanné, car les employés communaux, eux aussi sans doute pressés de s’en retourner aux réparations domestiques avant la nuit noire, conduisaient la voiture à une allure peu convenable.
Tout ce beau monde s’engouffra donc dans l’église presque en courant, en se brûlant même la politesse, et s’installa en vitesse dans les stalles humides et froides, sitôt que le cercueil eut été déposé devant l’autel.
La distraite assemblée grelottait et de temps en temps levait ses yeux pleins d’angoisse vers une large déchirure du toit — signe que l’ouragan n’avait épargné absolument personne — et par laquelle on apercevait un bout de ciel de plus en plus sombre, tandis que le prêtre, un gros bonhomme tout de blanc vêtu, court sur ses jambes, tant qu’on n’apercevait quasiment que son visage rougeaud et fort sanguin derrière l’autel, psalmodiait et bénissait, un livre énorme, un vieux livre, grand ouvert devant lui. Les hommes et les femmes expédiaient les signes de croix et les prières à haute voix, quelques mécréants intraitables gardaient ostensiblement les bras croisés et, dans cette posture, tambourinaient nerveusement leurs avant-bras du bout de leurs gros doigts. De pieuses et vieilles femmes s’appliquaient néanmoins, d’un timbre haut et clair, à chanter avec le curé.
Et ce fut justement à la chute d’un de ces chants, alors que tout cela paraissait aux gens de plus en plus interminable et de plus en plus lourd, que l’abbé, les bras levés au ciel en direction de l’énorme brèche de la toiture, prononça la phrase par laquelle survint le scandale.
Dieu, prêcha le brave homme — ou Jésus, je ne saurais l’affirmer — est la lumière qui réchauffe les hommes et éclaire leur chemin.
Une voix puissante, railleuse, surgie de la pénombre des derniers rangs et qu’amplifièrent encore les hautes voûtes du sanctuaire, lui fit immédiatement écho et tonna : Hé ben, le f’rait pas mal de v’nir faire un tour à La Ceriseraie dans la soirée, vot’ citoyen, parce que de la chandelle et du feu, y’en ons pu chez nous autres!
Les nerfs des campagnards, mis à rude épreuve depuis vingt-quatre heures, se détendirent alors tels des ressorts trop longtemps retenus prisonniers et libérèrent tout à coup le tumulte incongru de leur énergie.
Tout le monde s’étant retourné vers le plaisantin, l’église ne fut plus soudain qu’un immense éclat de rire. On s’interpellait, on se tapait sur les cuisses, on se donnait de grandes bourrades dans les côtes, on était plié en deux, on avait des hoquets et des soubresauts frénétiques, on était rouge comme des pivoines, on répétait en hurlant à l’envi l’insolente répartie et on avait de grosses larmes de fou rire qui coulaient sur les joues.
Précipitamment descendu de son autel, le curé courait comme un perdu d’un bout à l’autre de la nef, se fâchait, admonestait, agitait les larges manches de sa chasuble, faisait tinter une clochette, bénissait le cercueil au passage, criait, fulminait, enrageait, se signait désespérément, levait en tremblant les yeux au ciel et tâchait (tachait : coquille corrigée par une lectrice) en pure perte de ramener à la raison tous ces gens brusquement pris de folie.
Quelqu’un prétendit même plus tard, beaucoup plus tard, des années plus tard, l’avoir entendu crier des noms étranges, comme Sodome et comme Gomorrhe.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.04.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
JONATHAN
Tu avais douze ans. Sylvie, ta mère venait juste de mourir, emportée par l’alcool. Je te revois dans l’église, chétif, vouté, caché derrière tes grosses lunettes de myope. Tu ne pleurais pas. Tu regardais tout autour de toi comme si tu te demandais ce que tu faisais là, comme si tu t’ennuyais. Tu l’aimais pourtant, ta maman. Mais tu avais dû souhaiter sa mort, aussi, quelquefois, lorsqu’elle t’envoyait, avec ton petit vélo, au supermarché, acheter les litres de vin blanc qu’elle s’enfilait ensuite et qui la rendaient mauvaise. Parfois, en revenant, du pinard plein les sacoches, tu croisais des gens de la mairie ou du Secours Catholique et tu sentais bien que le regard qu’ils laissaient tomber sur toi avait le poids d’un couperet, qu’ils te condamnaient tout autant qu’ils condamnaient ta mère. « Pauv’ gosse, c’est-y-pas malheureux… Qu’est-ce qu’il f’ra plus tard ? » Certains, froidement, t’avaient déjà énoncé leur pronostic : « tu finiras comme ton père ! »
Ton père ? Tu ne l’avais quasiment pas connu. Aperçu parfois, seulement, au café. Tu savais juste que l’alcool l’avait emporté, lui aussi, alors qu’il n’avait pas quarante ans. Et malgré toi, tu commençais à te dire qu’ils avaient probablement raison, tous ces cons -là, que c’était sans doute ton destin de finir comme lui… Toi qui, à cette époque n’avait encore jamais bu une seule goutte d’alcool.
La dernière fois que je t’ai vu, tu entamais, aux Orphelins d’Auteuil, un apprentissage pour devenir serveur. Tu aurais voulu t’occuper des chevaux, mais il n’y avait plus de place pour toi.
Je ne t’oublie pas.
08:49 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.04.2011
A paraitre fin juin
LE THEATRE DES CHOSES
10 nouvelles de France et de Pologne
 Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.
Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.
Et ce sera aussi l'aboutissement d'une belle connivence, entamée il y a plus d'un an, entre l'équipe d'Antidata et moi-même.
Sur les dix nouvelles écrites cet hiver et que j'ai proposées, huit ont été retenues. Le recueil incluera donc deux autres nouvelles déjà éditées, Souricière et La Faucheuse n'aimerait pas les aubades ?, respectivement parues en 2009 et 2010 dans les recueils collectifs, Capharnahome et Douze cordes.
Les lieux - les théâtres donc - des récits se partageront équitablement les pages du recueil, tantôt en Poitou-Charentes, tantôt en Pologne.
Première fois que j'écris en complicité préalable avec un éditeur. Si on y trouve un certain confort, celui du sentiment de ne pas travailler pour rien, on y éprouve aussi une grosse angoisse, celle de décevoir.
En tout cas merci à Olivier Salaün et à ses camarades. Je signale d'ailleurs au passage qu'Olivier est aussi musicien, auteur-compositeur dans le groupe de rock Cvantez et que vous pouvez écouter, si le coeur et l'oreille vous en disent, des échantillons de leur dernier opus, ici.
Belle création musicale.
13:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.04.2011
Stéphane Beau sur L'exil des mots
Tous les quinze jours Stéphane Beau me rend visite et me parle des pauvres gens qui ont jalonné sa route. Une façon de leur donner dignité dans la mémoire.
SYLVIE
Tu es peut-être un de mes plus douloureux souvenirs. La souffrance se lisait sur ta trogne. Une tête toute ronde, toute rouge, avec de gros yeux globuleux, jaunes, striés de fines veines. Ta maison s’écroulait de partout, mais elle était à toi : tu l’avais héritée de ta mère. Il aurait fallu faire des travaux, certes, mais avec ton RMI tu avais déjà à peine de quoi manger, alors la charpente…
Ton mari était mort quand tu avais trente ans : l’alcool avait eu raison de lui. Il t’avait légué le souvenir de quelques violents coups de poings, une palanquée de dettes, et un fils que tu aimais. Mais l’alcool t’avait alpaguée, toi aussi. Et ce qui devait arriver arriva : un matin le fiston a été placé dans un foyer de l’enfance et tu es restée seule avec tes bouteilles. Tu ne savais même plus qui tu étais. Syndrome de Korsakoff qu’ils disaient les médecins… Les neurones qui s’éteignaient les uns après les autres, comme des bougies livrées aux vents… Certains jours je te demandais si tu avais des nouvelles de ton fils. Ton visage s’illuminait soudain et tu t’écriais : « bien sûr que j’ai de ses nouvelles, puisqu’il habite ici ! Il va rentrer manger ce midi, après l’école ! » Tu n’avais même pas remarqué qu’il n’était plus là depuis plusieurs mois. Ou si : peut-être préférais-tu faire semblant, pour t'épargner ce surplus de souffrance.
Un beau jour (drôle d’expression car c’était un jour fort triste) ton aide ménagère est venue me voir : en prenant son service, elle t’avait trouvée, allongée sur le carrelage de ton salon. Toute ta vie tu t’étais battue seule, pointée du doigt par tous les braves gens de la commune. Tu avais vécu seule, tu avais élevé ton fils seule… Et tu étais morte seule…
Qui sait ce qu’aurait pu être ta vie si un peu plus d’amour t’avait été offert, lorsqu’il en était encore temps ?
Je ne t’oublie pas.
Stéphane
08:31 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.04.2011
La mémoire toujours en feu d’où dégoulinent des laves incandescentes
 Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.
Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.
Le 10 avril 2010, Smolensk. Outre le drame humain, cette hécatombe où périrent 96 personnes parmi lesquelles les plus hauts personnages de l’Etat, fut le couteau brutalement enfoncé dans la plaie Katyń, une plaie qu’on tentait pourtant désespérément de refermer.
10 avril 2010, Smolensk, 10 avril 1940, Katyń. La concordance des lieux et des dates fait que l’amalgame est devenu réalité très forte et les vieilles rancœurs envers la Russie ravivées au centuple.
10 avril 2011, commémoration - mais commémoration de quoi exactement ? - et la blessure encore qui se répand dans les têtes. Les Polonais déjà fortement divisés sur le sens à donner au drame de Smolensk n’en sortent maintenant plus sur le sens à donner à sa commémoration. D’autant qu’on recommence à murmurer, de l’autre côté du Dniepr, que Katyń fut bien l’œuvre diabolique des nazis.
Alors certains déposent sur les lieux de la catastrophe de l’an passé des plaques qui rappellent, en même temps, le génocide perpétré par les Russes il y a 71 ans. Les Russes d’aujourd’hui, indignés, font subrepticement enlever la plaque dans la nuit et la remplacent par une autre, à leur goût moins équivoque, évoquant uniquement Smolensk.
Censure de la mémoire ou juste recadrage du souvenir ?
Je n’en sais rien.
Courroux cependant de part et d’autre. Rien ne va plus dans le langage de la mémoire et dans la lecture de l'histoire.
Il faut sans doute être Polonais pour prendre toute la mesure de ces drames-là. Dans un monde préoccupé par des guerres multiples, guerres humanitaires tronquées, guerres de ceci et de cela, jeux politiques infâmes partout, le pansement des plaies polonaises et les rancunes envers les Russes, sorte de feu couvert et qu’un seul coup de vent peut embraser, apparaissent comme des broutilles passéistes.
Ce qui me peine pourtant, ce sont les diverses utilisations idéologiques qui sont faites des événements et surtout que cette nation, ces Polonais parmi lesquels je mène ma vie, et qui auraient tant besoin de se serrer les coudes autour d’une chaude fraternité, soient une nouvelle fois dressés les uns contre les autres et manipulés par des chefs et des prétendants jouant, tantôt la corde d’un sage apaisement, tantôt la corde toujours vibrante de la passion.
Le génocide de toute l’élite polonaise sauvagement assassinée d’une balle dans la nuque et cette catastrophe aérienne survenue autour de la commémoration de ce génocide, n’ont pas fini d’engendrer des anniversaires houleux, vindicatifs, obscurs, névrotiques, où, finalement, personne en Pologne ne reconnaît plus le respect dû à sa mémoire de Polonais.
C'est jouer avec un feu terrible.
Car les grands drames de l'Histoire, un jour ou l'autre, rejaillissent toujours d'une mémoire, soit fallacieuse, soit qu'on avait tenté d'étouffer.
Image : Philip Seelen
07:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.04.2011
A vos cerveaux... Prêts ? Votez !
 Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.
Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.
Pure coïncidence ou comme si elle lisait l'Exil : la science me traite ce matin de rigolo. Et elle a raison, la science : je suis vraiment mort de rire.
Oyez plutôt, là. Si, si, cher lecteur, lis jusqu'au bout, même si ton libre arbitre en prend un sale coup.
Les premières réactions cependant ne vont pas tarder à agiter frénétiquement le gotha.
Sarkozy trouvera que c'est pas assez marqué à droite, cette encéphale !
La Le Pen va se plaindre de ne pas voir le sien et va sans doute crier à l'apartheid.
Borloo qui vient de prendre une grande décision va se demander à quel cortex cingulaire de sa mécanique il a obéi et comment est strié le cerveau d'un centriste.
Et Ségolène, ravie, va enfin s'apercevoir que, même elle, en a un.
Image AFP, comme on peut voir.
13:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.04.2011
Le sentiment politique
Ou pourquoi on perd vraiment le peu de temps qui nous est imparti à se préoccuper de politique, stricto sensu. Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.
Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.
Une même logique, une lame de fond, que je me dis alors, doit présider au manque apparent de cohérence. Celle-ci aurait dû commander en effet depuis longtemps que les espoirs formulés au XIXe siècle par exemple, voire par les enragés de 1793, soient aujourd’hui satisfaits, dépassés, et que l’on regarde dans une autre direction.
Mais les puissants gouvernent toujours le monde, le peuple gueule, le peuple s’ébroue, les arts se rebellent parfois, pas souvent, et ces puissants continuent de mener la barque, à contre-courant de ce qui devrait être la poursuite du bonheur du plus grand nombre, voire de tout le monde.
L’histoire, même si on sait qu'elle est lente et surtout pas rectiligne, devrait en tout cas cheminer dans cette direction, au nom même du principe de civilisation humaine. Tous les missels marxistes le prétendaient. Sans la sinuosité cependant.
Le panorama de plus d’un siècle et demi d’histoire s’évertue donc à apparaître tel un gigantesque déni de l’intelligence humaine. Qu'une question, la plus élémentaire et la plus naïve des questions - celle du bonheur social enfin résolu, du bonheur pragmatique, presque élémentaire, afin que chacun soit disponible pour vivre son bonheur individuel, intime, intellectuel et affectif - soit sempiternellement posée aux hommes sans qu’aucun ne sache y apporter le moindre élément de réponse, en dit effectivement trop long soit sur la susdite intelligence humaine, soit sur le degré de civilisation, pour qu'on fasse l'économie du postulat selon lequel le pauvre est bon, juste et honnête et veut que les richesses produites par le travail et le génie humains soient au service de tous, équitablement distribuées, tandis que le riche est mauvais, injuste et malhonnête et veut s’accaparer la plus grosse part de la galette, se goinfrer, se bourrer le fanal et ne jeter que les miettes au pauvre.
Et là-dessus, sur le terrain politique, s’affrontent les idéaux en empruntant tous les dédales possibles et toutes les ruses les plus grossières !
Ah, si seulement elle n'était que ça, la problématique ! Et si la lutte des classes n’avait pas été ce leurre de la rhétorique hégélienne dans lequel se sont engouffrées toutes les idéologies et contre-idéologies sociales de l’époque industrielle et postindustrielle, longtemps que la contradiction dialectique aurait été renversée et qu’on aurait fait de la boule bleue un Eden de fraternité !
Nous sommes donc dans un vaste trompe-l’œil. Celui des idées. Or les positionnements politiques - j’entends maintenant par politique l’envie, le désir plus ou moins flou que l'on a de voir tel ou tel monde apparaître - ne sont pas des épiphénomènes de la conscience, mais du sentiment. On est dans l’affectif intime, dans la conviction fondatrice, dans la base fondamentale, et tous les raisonnements, tous les arguments, toutes les évidences mille fois prouvées, ne peuvent convaincre le sentiment constitutif d’un être. Au risque de le détruire.
On se sent à tribord ou à bâbord, non pas par la raison, par l’idée du juste ou de l’injuste, mais parce que c’est là qu’on est bien dans sa peau. L’opinion politique est un sentiment.
Or le sentiment n’admet pas le jugement de valeur.
Mais d’où naît ce sentiment ?
Je n’en sais foutre rien. Laissons-ça aux mécaniciens du subconscient, aux entomologistes des groupes sociaux, aux géographes de l’urbanisme.
Le fait est.
M’est souvent arrivé de discuter, de me disputer, de gueuler, d’affronter, de mener joutes verbales et même, dans des cas extrêmes, d’en venir aux mains, avec un d'un sentiment contraire au mien. Du point de vue de la raison, tout le monde avait raison. Venait même un moment où les arguments logiques avancés de part et d’autre étaient ridicules jusqu’au grotesque.
C’étaient là deux individus qui se battaient mais c’est une ombre inconnue d’eux-mêmes qui maniait les armes.
Je me sens. Tu te sens. Il se sent. Ma peau, ta peau, sa peau est mieux dans ce sentiment-là que dans celui-ci.
Les mêmes espoirs, fantasmes, oui, on peut dire ça comme ça, de joie universelle et de jouissance non usurpée pour tous m’habitent depuis que j’ai appris à m’habiter moi-même. Je n’ai pas dévié d’un iota dans mon sentiment du monde en dépit de tous les arguments qui me sont tombés sur la gueule et qui auraient normalement dû me ramener à de plus raisonnables rêveries.
Et je ne suis pourtant ni plus juste, ni plus bon, ni plus intègre, ni plus généreux, ni d’une intelligence plus accomplie, ni d’un savoir plus extraordinaire que la plupart des hommes que j'ai rencontrés jusqu'alors et qui m'ont apporté la contradiction.
Je suis. Point.
Né dans une famille pauvre, rurale et adorable à plein de points de vue.
Avec un sentiment général qui ne m’a pas quitté. Comment dire à qui que ce soit que le sentiment qui vous anime est le bon quand on ne sait même pas d'où on le tient ?
D'ailleurs, le bon pour quoi faire ?
La joie d'exister ne s’apprend pas ni ne se réclame aux pouvoirs : elle se vole.
A des millions d’années-lumière de l’idée politique.
Illustration : Les Danaïdes par John William, 1903
12:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.04.2011
Vases communicants : Cécile Portier
Le jour des vases communicants le cahier un peu bordélique sur lequel nous écrivons chacun notre page, s’élargit un peu. On croise la plume. Le clavier, oui. Voyez bien que c’est nul de dire tapuscrit…ça marche pas à tous les coups. Ce blog a un beau clavier ! Où ? Où ça ? Nulle part, je voulais dire une belle plume.
Donc, sans blague, on échange en ce 1er avril. Et je suis heureux de recevoir Cécile Portier sur mon bout de territoire. J’aime son texte. Regard posé sur la stupidité de la solitude dans un monde pourtant encombré par la foule. Déshumanisation des quotidiens.
Mais je vous laisse lire. Et je file poser quelques lignes sur Petite racine.

1 minute 4 secondes 99 centièmes
Les portes se referment. Toutes banquettes occupées : 2 fois 4 places de part et d’autre du couloir, répétées 3 fois, soit 28 assis. A ceux-là ajouter 5 personnes sur strapontins, chacune regardée de travers par une personne debout, ce qui fait 33 personnes assises et au moins 5 mécontents.
Et les autres debout? En moyenne 5 mains accrochées par barre, 8 barres par rame, soit 40 personnes, plus celles adossées aux 27 strapontins levés et à la portière du côté qui ne s’ouvre pas (disons une dizaine). Plus encore les 4 déjà engouffrées entre les sièges pour pouvoir s’asseoir à la prochaine station.
Ce qui fait un total de 114.
Sur ces 114, combien rentrent du travail? Disons, vu l’heure, 80%, soit 91 personnes, qui cumulent à elles toutes un total d’environ 684 heures travaillées aujourd’hui, ce qui, rapporté aux 33,16 € de coût horaire salarial moyen charges comprises, représente une masse de 22 681 € octroyée pour compensation de la peine, et pour quel part de PIB engendrée ?
Quant aux autres, qui sait ? Revenus d’une démarche emploi, de quelques achats, d’une visite à quelqu’un, d’une flânerie sans but. Et combien d’heures perdues aujourd’hui dans ce temps non travaillé, non quantifiable? Auquel il faut rajouter le temps de transport, 42 minutes en moyenne trajet retour, soit pour ces 114 personnes un total cumulé de 80 heures en cette soirée.
Mais pour chacun, maintenant, combien de temps encore avant d’arriver chez eux? Et combien, parmi ces 114, sont attendus ce soir par quelqu’un ? Une grosse moitié ? Disons 65. Et celui-là, cheveu gris, veste noire, penché sur son téléphone, écrit-il à celle qui l’attend pour lui dire qu’il sera là dans 20 minutes, environ? Combien de SMS partis de cette rame depuis le départ de la station ? Combien d’explications, de malentendus noués, et en combien de signes ? Combien de pensées émises et non exprimées, d’espoirs, de rêves déchirés ?
Et entre ces 114, combien de regards échangés? Combien?
Et si maintenant, entre ces deux stations, la rame s’arrêtait, au bout de combien de temps on entendrait le premier soupir d’exaspération? Qui lancerait la première réflexion sur le prix que ça coûte, un abonnement métro, et sur le temps qu’on y perd? Au bout de combien de temps lâcheraient les nerfs de celle-là, en face de moi, sourcils froncés, nez penché sur son pavé? Et quelles invectives poussées, envers qui ?
Et si ça durait, encore ? Si ça durait, et qu’il n’y avait pas moyen d’en sortir? De combien de degrés la température monterait, au bout de quelques heures, par toute cette chaleur de bête accumulée?
Et toi, tête rousse et grosses cuisses, qui mange un petit en-cas de carottes nouvelles calibrées à 70 mm de diamètre que tu pêches une à une d’un cellophane estampillé Monoprix, au bout de combien de temps aurais-tu vraiment faim, si nous restions ainsi, ici, plusieurs longues, longues heures ?
Et qui sera le premier à crier ? Qui sera le premier à pleurer ? Qui suppliera qu’on le laisse s’asseoir ? Combien voudront lui laisser la place ?
Qui sera le premier à se pisser dessus, dans ce temps qui n’en finira plus?
Et toi qui me regarde pendant que j’écris, parce que tu as senti que je te regardais, que je détaillais par écrit ton casque vissé aux oreilles, tes doigts agiles sur le petit clavier, tes lacets dépareillés, toi pour qui je n’ai aucune sympathie mais dont le regard me brûle, au bout de combien de temps passé ici mourras-tu ? Et que ferons-nous de ton corps ?
Les portes s’ouvrent, et tu sors.
__________________________
Les vases communicants, chaque mois, laissent leur adresse ici, sur une initiative de Brigitte Célérier, à qui j'adresse mon amical salut et mes remerciements
08:39 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
29.03.2011
Mon artiste prolétaire de frère prend un bide

Chaque jour, l'Aronde prenait la clef des champs. Des routes, oui. Plutôt. Voire des chemins vicinaux non encore goudronnés.
Les voisins, ceux qui n’avaient pas encore de voiture, mais surtout leurs épouses, saluaient avec un respect craintif l’audace de cette femme en pantalon, cigarette au coin des lèvres, cette Georges Sand de l’automobile, cette femme-précurseur qui pavoisait derrière son volant. Les hommes, eux, voyaient plutôt là un signe de débauche et de libertinage : la voiture, c'était une invention pour les hommes, pour les chefs, pour ceux qui ont de la tête ! Ceux qui étaient déjà motorisés, ceux qui savaient tout de la nouvelle époque et comment il fallait se servir d'une automobile, haussaient donc les épaules, narguaient, tordaient le nez et prédisaient que le moteur de cet engin - ils allaient même jusqu'à préciser pour bien faire voir qu'ils savaient de quoi ils causaient : le moteur Montlhéry de cette bagnole - ne ferait pas long feu, à ce régime de sorties quotidiennes.
Mais mon frère, apprenti mécano, veillait au grain. Maintenant que la voiture roulait, elle réclamait qu’il se penchât avec circonspection sur ses organes. Un beau dimanche, il demanda à ma mère combien elle avait fait de kilomètres. Il eût été tout aussi inspiré de lui demander la circonférence de la lune. Elle en resta bouche bée.
Tant d’ingénuité de part et d’autre déclencha chez moi un tel éclat de rire que ma mère se fâcha tout rouge. Elle me traita de foutu chanteur qui ne s’intéressait à rien. Elle montra mon frère en exemple. Lui, au moins, même avec ses questions stupides, s’intéressait à ce qui se passait dans cette maison, et surtout à son automobile ! On pouvait compter sur lui. Que je m’en retourne donc à ma saloperie de guitare et que je les laisse discuter sérieusement.
Evidemment, elle ne savait pas combien de kilomètres elle avait parcourus. Mon frère déclara que ça faisait quand même beaucoup et qu’il était grand temps de changer l’huile du moteur. Il enfila sa camisole d’apprenti prolétaire et se coucha sous l’auto. On l’entendit qui dévissait, qui tapait, qui cognait, qui se plaignait d’un gros boulon rébarbatif. Il devait avoir appris ça dans son atelier ; on ne dévissait pas un boulon sans se plaindre avec force jurons de sa résistance. Il nous montra bientôt l’huile noire qu’il avait récupérée dans un seau. Il en prit quelques gouttes entre le pouce et l’index, les faisant se frotter l’un contre l’autre et, avec une moue de connaisseur un peu catastrophée, nous dit qu’il était grand temps, qu’elle n’avait plus de viscosité, cette huile-là. Vis-co-si-té, hein, répéta t-il en bombant le torse, on connaissait pas le mot nous-autres ? Un mot de mécano, pardi. Comment l’aurions-nous su ?
Il changea l’huile avec les gestes circonspects du savant devant ses éprouvettes.
Nous étions tous autour, admiratifs quoique inquiets. Il cabotinait à son aise. Je ne saurais dire pourquoi mais j’avais l’impression que l’artiste en faisait trop, qu’il s’aventurait un peu loin dans son art et qu’il allait prendre un bide. Il fit pourtant tourner le moteur, en s’essuyant les mains avec un vieux chiffon, plus sale encore que ses mains. Il souriait béatement et donnait des petits coups de pied dans les pneus. Il dit aussi qu’il tournait comme une horloge suisse, ce moulin-là, et il crachota loin devant lui, comme un vrai homme. Ma mère souriait tout aussi béatement : il venait d'annoncer qu’elle était tranquille pour faire trois mille kilomètres ! Autant lui annoncer qu’elle était parée pour faire le tour de la terre.
Elle ne fit même pas le tour du village.
L’auto fit un vacarme épouvantable de bête mortellement blessée, cracha une fumée noire comme l’enfer, sursauta de douleur et fit silence, stoppée net, crucifiée au beau milieu du chemin. Elle démarrait encore, certes, mais elle refusait d’avancer, ma mère s’énervant, criant au secours et de désespoir, torturant dans tous les sens le levier de vitesse, qui finit par lui rester bêtement dans les mains.
Mon frère courait dans tous les sens, affolé, tournait autour de l’engin en levant les bras au ciel et en donnant encore des coups de pied dans les pneus, comme quand il était content.
Dépêché sur les lieux en urgence, le mécanicien, le vrai cette fois-ci, déclara qu’on avait vidangé la boîte à vitesse au lieu du moteur et que tout était en morceaux, là-dedans. Kaputt répétait-il, Kaputt, fier de son mot. Kaputt !
Dans cette pitoyable méprise cependant, la vocation de mon frère avait dû recevoir le coup de grâce. Kaputt. Plus jamais je ne le revis en bleu de travail.
Il se fit menuisier.
11:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.03.2011
Deux fois par mois, Stéphane Beau sur L'Exil des mots
Bienvenue Stéphane,
Nous avons tous croisé sur notre route incertaine des gens qui, vus sous l’angle trompeur et péremptoire de l’idéologie, ne correspondaient pas exactement à notre profil. Du moins exprimaient-ils complètement différemment leur soif de liberté et leur besoin de rêver. Des gens attachants, un peu fous, fantasques ou timorés, sans prétention.
J’en ai connu des comme ça, dans des bars interlopes où se passaient nos nuits, dans des bas-fonds, dans des endroits d’exclusion forcée, dans des hasards. Dans des fuites en avant.
Il arrive que ces paumés des petits matins reviennent habiter notre mémoire.
Alors, quand j’ai invité Stéphane à venir tous les quinze jours partager avec moi la plume et qu’il m’a proposé ses Humbles à lui, j’ai tout de suite été touché, parce que ces humbles-là, je les ai bien reconnus ! Ils sont universels pour qui a cherché à aimer le monde au-delà de sa surbrillance.
Faut dire aussi que je venais de lire la Semaine des quatre jeudis, le dernier opus de Stéphane. Comme je le supposais grâce à une complicité qui remonte à février 2009 avec les Sept mains, j’ai trouvé dans ses aphorismes et ses textes plus longs, un écho à mes propres quêtes et à mon propre désabusement. Parfois désarroi. Une réflexion commune de soi, au milieu de ce bastringue social à la dérive. Comme là :
Bien sûr que les médias ne disent pas la vérité. Et alors ? Quelle importance ? La vérité : quasiment personne ne serait en mesure de la supporter.
Ou encore :
J‘aurais tant aimé être un artiste maudit ! Hélas, il est plus facile d’être maudit que d’être artiste.

OUVERTURE
Un grand merci, tout d’abord, à Bertrand qui a généreusement proposé de m’ouvrir, tous les quinze jours, les portes de son Exil des mots. Je vais essayer d’être digne de son accueil.
Je vais profiter de cet espace pour rendre hommage à des hommes et des femmes que j’ai croisés et côtoyés, plus ou moins longtemps selon les cas. Ce sont tous des sacrifiés, des brisés, des vaincus de la vie, des exilés, eux-aussi, à leur manière : des victimes de cet exil républicain que l’on nomme « exclusion ». Et pourtant ils étaient tous des êtres exceptionnels, humains, dignes, exemplaires. Des hommes et des femmes qui m’ont beaucoup appris, beaucoup donné. Des hommes et des femmes que j’ai aimés. J’ai su le dire à certains, pas à tous : je le regrette. Le temps est venu pour moi de réparer cet oubli.[1]
JOHNNY
Johnny. Ce n’était pas ton vrai prénom, mais tu l’adorais tellement ce gars-là ! Tu possédais la panoplie complète du fan parfait : les disques, bien sûr, mais aussi le briquet, la boucle de ceinturon, la pendule, la caricature accrochée au mur de ta cuisine, mal dessinée, par un copain sans doute, un soir de beuverie. Et les tee-shirts, bien-sûr, aux couleurs criardes, représentant l’idole transpirante. Tu carburais à la bière à 11° et il fallait choisir son heure pour venir te voir : trop tôt le matin tu dormais encore ; trop tard, tu étais déjà dans le brouillard… Tu avais bien la gueule de l’ex-taulard que tu étais, avec ta grosse moustache, ton crâne rasé et tes traits bleus tatoués au coin des yeux. Au début, tu faisais peur à tout le monde avec ton blouson noir d’un autre temps. Il faut dire que tu aimais ça, jouer les durs. Lorsque tu rencontrais quelqu’un, pour la première fois, c’était systématique, tu alignais vacherie sur vacherie : un vrai festival. Si l’autre se vexait, c’était un con, et tu ne lui adressais plus jamais la parole. S’il avait le culot de te répondre sur le même ton, en soutenant ton regard, un large sourire – où manquaient quelques chicots – éclairait immédiatement ton visage. C’était dans la poche, il pouvait tout te demander.
La dernière fois que je t’ai vu, tu venais enfin de trouver un petit appartement, après des années passées à errer de squat en squat et de foyers sociaux en logements d’urgence. Je me rappelle qu’il y avait un noyer derrière chez toi et que, tous les ans, tu nous amenais un sac plein de noix. Tu grommelais en détournant la tête lorsqu’on te remerciait : pas toujours simple de jouer les durs quand on a le cœur sur la main.
Tu étais un chic type, Johnny, tu sais. Mais qu’ils sont rares ceux qui l’on su ! As-tu réussi à vaincre tes démons ou es-tu retourné partager le quotidien de tes ex - compagnons de trottoir ?
Je ne t’oublie pas.
Stéphane Beau
___________________________________________________________________________
[1] J’ai emprunté le titre de cette chronique à une revue intitulée Les Humbles, publiée dans les années 1920 par Maurice Wullens.
15:26 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.03.2011
Va-t-en-guerre et pacifistes bêlants
 Je crains - mais j’assume - que mon jugement ne soit quelque peu faussé du fait que je vive hors des frontières de mon pays. Je crains que ce jugement ne se fasse plus émotif que réfléchi.
Je crains - mais j’assume - que mon jugement ne soit quelque peu faussé du fait que je vive hors des frontières de mon pays. Je crains que ce jugement ne se fasse plus émotif que réfléchi.
Quand on est loin et qu’on ne rentre finalement qu'une fois l’an, forcément, le pays des racines, celui que, bon gré mal gré, l’on porte en soi comme une espèce de port d’attache, apparaît parfois à travers un prisme déformant et on nourrit à son égard des pensées et des sentiments qu’on n’aurait jamais eus, qu’on se défendait même spontanément d’avoir, quand on vivait avec lui.
Je me suis donc surpris à souhaiter que le monde, et en premier lieu mon pays, celui de Montaigne, Rousseau, Montesquieu, celui qui aux peuples étrangers donnait le vertige, intervienne contre un salopard sanguinaire qui se propose de noyer dans le sang une rébellion et qui, même, a déjà mis à exécution une partie de ses fantasmes assassins.
Humainement, ça coule de source. Mais il n’est quand même pas confortable d’être dans la position du va-t-en-guerre. D’autant que l’idéal humanitaire et démocratique n’est que très rarement la flamme qui met in fine le feu aux poudres. D’autres préoccupations, sans doute, président aux bombardements et à l’ultima ratio regum des canons.
Ce monde est trop compliqué et nous ne percevons que la partie la plus visible d’un iceberg dont nous avons depuis longtemps cessé de comprendre les dérives.
Et je me dis aussi que notre désastreuse incapacité, incapacité avérée, à changer ce monde devrait nous avoir guéri de toute prétention à vouloir l’interpréter sans risque d’erreurs grossières.
Mais il n’empêche que, d’ici, savoir que son pays est entré dans un conflit armé brasse les tripes. Mes tripes n’ont pas de cerveau ni de mémoire.
D’autant que je ne suis quand même qu’à 2000 km de Paris. Je ne suis pas au bout du monde, je suis au sein de cette fable à tétines qu’on appelle Europe. Quelles que soient les ambitions des pays engagés en Lybie, je n'en compte que cinq présents pour faire un effort, sur les vingt-sept qui, régulièrement, s’amusent pourtant à traire copieusement la vache européenne.
Et comme je suis dans un de ces pays-là, je constate une nouvelle fois qu’Europe veut dire dossiers de subvention mais qu’aucun cœur, aucun idéal, aucun intérêt commun n’anime la placidité du gros bovin.
Pire même. On est carrément opposé les uns aux autres.
Une Europe foutaise, donc, une Europe pêle-mêle, sans âme, sans individu et qu’il serait temps que des hommes de bonne volonté, soit l'entraînent vers l’humaine dimension, soit invitent tout le monde à rentrer chez soi afin qu'il y vaque à ses occupations domestiques.
On verrait bien. Mieux vaut être seul que mal accompagné, n’est-ce pas ?
Anti-européen ? Oui. Sous ces auspices-là, oui. Je ne me sens pas du tout de la même famille que la Hongrie d’extrême droite ni de celle du clergé polonais, par exemple, érigé en classe sociale riche et fourrant partout son sale nez de possédant arrogant.
Cette Europe, ce monstre à vingt-sept têtes qui regarde dans vingt-sept directions à la fois, j’en disais dans Polska B Dzisiaj - assis au bord du Bug - ce que j’en prétends encore aujourd’hui :
" Plus de frontières. Plus d’explosion d’artillerie lourde, plus de terreurs incendiaires, plus de sang dégouttant sur les rides de la terre et plus d’épouvante hurlée sous la mort en furie. J’ai devant moi, avec cette rivière qui musarde entre ses gorges sablonneuses, ce pourquoi se sont entre-tués les hommes depuis qu’ils sont des hommes. Tout le débat des tueries tourne autour de l’endroit exact où doit être planté ce poteau rayé blanc et rouge et sur lequel je me repose, les yeux dans l’eau. Ce poteau marque la fin d’une souveraineté et le début d’une autre. Il délimite le champ d’application des vérités et le moindre outrage à son égard ordonne réparation par le massacre. Ça me semble d’une désespérante simplicité.
J’ai pris appui sur la bombe qui a ensanglanté le monde.
Je suis de cette génération qu’on dit bénite des dieux pour être la première depuis que les temps sont humains à ne pas avoir vu déferler chez elle le fracas des armes. Puisque plus de vingt siècles n’avaient pas été suffisants pour déterminer l’emplacement exact de ces satanés poteaux, force fut bien de les mettre enfin au rebut.
De guerre lasse.
Génération bénite des dieux, depuis ta naissance on s’est pourtant égorgé et mis les tripes à l’air sans retenue en Indochine, en Algérie, au Vietnam, en Cisjordanie, en Palestine, en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, au Liban, dans les Balkans et, aujourd’hui même, en Géorgie sans qu’on sache jusqu’où la poudre parlera. Tout ça en soixante cinq ans. Autant dire sans relâche.
(…)
Ça n’est pas agréable à écrire et ni même à penser mais je ne suis pas de ceux qui bêlent à tout vent que l’Europe est à jamais sauvée des cataclysmes guerriers. Parce que derrière les poteaux qu’elles plantent pour marquer sa souveraineté, aussi loin qu’elle puisse étendre ses ailes, il y aura toujours un pays qui ne reconnaîtra pas ces poteaux comme plantés au bon endroit ou une nation qui s’en sentira bafouée. De plus, à l’intérieur même de son enceinte, et ce d’autant plus sûrement qu’elle ne cesse de s’élargir, longtemps des nations seront agitées par leur sentiment équivoque d’une adhésion forcée à une histoire usurpée, sentiment tellement nébuleux qu’il faudra bientôt le taxer de barbare. Peut-être, sûrement même, les générations d’un futur plus ou moins lointain aboutiront-elles à l’effacement de ce sentiment occulte. Lorsque la dissolution liquide des pays dans un même bocal sera devenue plus compacte et plus solide.
(….)
Prévoir que cette Europe est pour l’éternité à l’abri des guerres et des combats, c’est en outre juger que nous serions des hommes bien meilleurs, bien plus accomplis, bien plus intelligents, bien plus humanistes et bien plus généreux que tous ceux qui nous ont précédés.
Et ça, c’est d’une incommensurable vanité partout et fortement démentie par les réalités. "
14:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.03.2011
La frontière, la guerre et l’enfant

Sans le voir vraiment. Mais la fillette a montré du doigt.
- Papa, c’est un Russe !
- Ah oui, ma puce… C’est un Russe. Il arrive bientôt chez lui, le Russe, tu vois. Il doit être content.
- Comment i fait le Russe pour traverser le Bug ?
- Il y a des ponts sur les rivières. Et sur les ponts, il y a des routes pour les voitures et les camions.
- Alors, quand on ira en France, on traversera le Bug aussi, nous?
- Non, le Bug et la Russie, c’est devant nous. Là où va le camion. La France, c’est derrière.
- Oui, mais on traversera un Bug.
- Je ne crois pas. Nous traverserons toute la Pologne, puis toute l’Allemagne, puis toute la France pour aller jusqu’à l’océan, mais il n’y a pas de rivière là où nous passerons.
- Et entre Niemcy (1) et la France, il n’y a pas de Bug ?
- Si, mais c'est pas un Bug. C'est le Rhin.
- Et entre la Pologne et Niemcy ?
- Non. Ou alors un petit. L’Oder, que ça s’appelle.
- Alors, c’est le même pays s’il y’a pas de Bug… Prawda ?
- Prawda. C'est un peu le même pays.
- …
- Si c'est le même pays, y'aura plus de guerre chez nous alors ? Les pays, ils sont tous des copains maintenant.
- Non, plus de guerre. Tous les pays sont maintenant des copains, comme tu dis. Ça s’appelle l’Europe.
- Et les Russes aussi, ils sont en Europe ?
- Heu.. Presque oui. C’est des copains à l’Europe.
- Et pas l’Irak ? T’as dit une fois qu’ils faisaient la guerre en Irak.
- Ah, l’Irak c’est pas l’Europe ! C’est compliqué... C’est à cause du pétrole.
- Et qu’est-ce que c’est le pétrole ?
- Ben, tu vois, là, en ce moment on se promène en voiture, ça roule parce qu’il y a de l’essence dans le réservoir. L’essence, c’est fait avec du pétrole et le pétrole il est sous la terre.
- Et ça fait la guerre, le pétrole ?
- Non, pas vraiment, mais il y a des pays qui n'en ont pas, alors il faut qu’ils en achètent aux autres qui en ont et ça coûte beaucoup, beaucoup de złotys et il y a plein de pétrole en Irak. Tout le monde veut du pétrole parce tous les pays ont des voitures.
- Pourquoi, ils nous en donnent pas alors, du pétrole, s'ils en ont plein ? Nous en Pologne, on pourrait leur donner plein de pommes et des groseilles et des poires et eux, ils nous donneraient du pétrole... Prawda ?
- Prawda... Prawda... Ce serait pas mal, oui, comme idée.
-…
- Papa, roule à cent et double ce.... (2) Russe !
1 - "Allemagne" en polonais
2 - Mot censuré par égard pour le peuple russe
Texte de 2006
10:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.03.2011
Tristesse
 Neige doucement fondue, dernières pellicules de glace qui résistent encore à fleur d’étang, chants encore timides des premières grives, un vol de cigognes, ciel qui n’a plus la couleur attristée de l’hiver.
Neige doucement fondue, dernières pellicules de glace qui résistent encore à fleur d’étang, chants encore timides des premières grives, un vol de cigognes, ciel qui n’a plus la couleur attristée de l’hiver.
On aurait envie de laisser monter en soi toute cette sève des choses, comme à chaque passage à ce point précis du cercle. On aurait envie d’affirmer encore et encore que le temps qui nous est imparti de ce côté-ci des étoiles est un temps merveilleux, qu’on soit Paul ou qu’on soit Jacques, misanthrope ou incorrigible amoureux des hommes.
Mais le cœur n’y est pas. Le printemps a la tenue d’un décor posé sur un monde résolument dramatique.
De l’autre côté de la Méditerranée, tout un peuple que soulevait enfin l’espoir, est abandonné aux couteaux de son étrangleur. Sa gorge ne sera bientôt plus qu’une béance aux chairs pendantes. Honte ! Honte pour l’éternité jetée à la face des puissants ! Ce sont des frères qu’on assassine. Nous ne savons pas leurs vues, leurs sentiments, leurs idées d’eux-mêmes. Que nous importe : ils ont pris les armes contre leur dictateur et devraient mériter notre secours et respect fraternels. Qui qu’ils soient.
Ingérence ? Taisez-vous, abominables que vous êtes ! Taisez-vous ! Vous vous ingérez partout, sans morale ni éthique, sans crier gare et sans état d'âme, quand votre soif de domination, de profit et de puissance monétaire est à étancher !
Et puis, là-bas, sur l’archipel de l’Orient, la vieille terre qui s’est secouée, a tué, et le monde une nouvelle fois menacé par les manipulations scientifiques de l’infiniment petit.
Pour ou contre le nucléaire ? Question idiote s’il en est. Question d'imbéciles. Infantile. Question sans fondement. Question hors-sujet. Question pour faire voir qu’on a des choses dans sa tête alors qu’on est plat comme une limande, face aux complications du monde.
Le nucléaire est dangereux comme l’est - sur une échelle plus grande, plus frappante, plus apocalyptique parce que d’un coup d’un seul fortement meurtrier et qu’il hypothèque alors la santé humaine à long terme - la cigarette que j'ai au bec, la vitesse sur route ou autoroute, la consommation excessive d’alcools.
Je n’aime que modérément les chiffres. Ce qui, in fine, est en partie snob et légèrement débile. Donc : la voiture tue un million et demi de personnes dans le monde chaque année et en blesse quarante fois plus ! Depuis Tchernobyl, la voiture, votre voiture messieurs-dames, la mienne, a donc tué 37 millions d’individus. A titre indicatif, la Pologne compte 38 millions d’habitants.
Vous êtes pour ou contre la voiture ? Ridicule !
Le nucléaire est une énergie fondamentale. Au sens profond, étymologique. Pas grand monde pour se soucier d'ailleurs de sa dangerosité quand il allume au quotidien son convecteur, se branche sur internet, éclaire ses mouvements, se sert de ses outils domestiques, consomme des produits fabriqués par des machines électriques.
Le drame est ailleurs. Le drame est dans la maîtrise des hommes sur cette formidable énergie que leur cerveau a su arracher aux principes mêmes de la matière. Le drame est que la planète est elle-même une force que les hommes ne maîtrisent pas et ne maîtriseront jamais. La planète explosera quand, scientifiquement, elle aura vécu son temps. Qu’elle soit habitée par des hommes ou non.
Or, elle tremble régulièrement, s’ébroue, et les hommes, grimpés sur son dos comme le sont les puces sur celui des chiens, s’en trouvent forcément et fortement bousculés.
Le drame est dans l’instabilité permanente, vivante, de l' habitat humain.
Fallait-il donc construire des centrales nucléaires, plonger au fond de la matière pour en extraire la substantifique moelle et tâcher de doter l’humanité de réserves énergétiques inépuisables ?
Oui. Je dis oui sans une seconde d’hésitation.
A mon sens, ceux qui répondent non sont des babas cools attardés, qui s’ignorent, genre qui diraient qu’il fallait laisser les chevaux attelés aux diligences parce qu’un être qui leur était cher a trouvé la mort dans un accident de la circulation.
Des erreurs monumentales, des contradictions de l’intelligence, des négligences nées de la recherche exclusive du profit, ont-elles été commises dans la mise en place et le maniement de cette énergie ?
Oui. Sans aucune hésitation.
Ceux qui répondent non sont des puissants intéressés par le lucratif et aucunement soucieux du confort de l’humanité.
Reste la tristesse, la détresse, la compassion du cœur et de l’âme face au drame du Japon, drame de l’humanité, drame et catastrophe de la fusion des erreurs humaines, du génie humain et des caprices de la planète, voyageuse du cosmos.
J’habite à deux-cent-cinquante kilomètres, à vol de nuage radioactif, de Tchernobyl.
On m’a raconté un peu.
Je pense aux japonais meurtris dans leur vie.
Je pense aux Libyens bientôt vaincus.
Je ne pense pas au printemps.
10:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.03.2011
Scandale sur un titre
 C’était dans une auberge perdue au milieu des prairies et des marais de Nuaillé d'Aunis et c’était l’hiver.
C’était dans une auberge perdue au milieu des prairies et des marais de Nuaillé d'Aunis et c’était l’hiver.J'ai vraiment aimé ces concerts. Tout y était : un public sympa, sans prétention, du vin, le désert muet des campagnes et des nuits qui n'en finissaient pas d'être des nuits. Nous sommes venus deux années de suite.
Puis nous entrions. Les vitres ruisselaient de buée. Nous serrions des mains et nous nous préparions à jouer. Nous jetions aussi, toujours, un regard moqueur sur un affreux goupil empaillé, juste derrière nous, qui n'avait vraiment rien à foutre là.
Ce soir-là, un petit gars un peu bedonnant, la mine poupine et le cheveu bien cranté, était venu nous saluer et nous avait présenté sa jolie petite femme. Il devait l’aimer, sa femme, parce que tout de suite il s’était mis à faire le fanfaron avec les artistes.
- Ah, quel plaisir ! On va entendre du Brassens ! J’les connais toutes. Toutes ! Ça fait quarante ans que j’l’écoute, moi, le gars Brassens…
Sa petite femme acquiesçait et buvait des yeux son petit bonhomme de mari au ventre discrètement replet.
Mon ami est alors subitement monté sur la scène, il a récupéré sa grosse bible, les œuvres complètes du Maître, il a ouvert l’ouvrage vers la fin puis, étalant le livre sous le nez du couple médusé, à la page S’faire enculer :
- Et celle-là, vous la connaissez ?
La petite dame a rougi jusqu’aux deux oreilles, qu’elle avait d’ailleurs joliment duveteuses, mais elle a ri en même temps. D’un petit rire fripon, à peine étouffé.
Le petit ventre a froncé les sourcils, il a fait semblant de regarder la partition d'un air savant, en se triturant le menton, mais sans s’attarder sur le titre. Puis, grand seigneur :
- Non, celle-là, j’la connais pas.
Un taquin, mon ami.
Je l’ai vu après, au cours d'une pause, prendre un pot avec ce couple sympathique.
13:42 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.03.2011
Petites annonces
 . Recherche désespérément quelqu’un qui aurait lu Le Docteur Faustus jusqu’au bout afin qu’il me renseigne sur la façon dont il s’y est pris. Troisième fois que j’abandonne, vers la cent-cinquantième page, ce chef-d’œuvre (prononcer avec la bouche en cul de poule et en dodelinant du chef) de la littérature.
. Recherche désespérément quelqu’un qui aurait lu Le Docteur Faustus jusqu’au bout afin qu’il me renseigne sur la façon dont il s’y est pris. Troisième fois que j’abandonne, vers la cent-cinquantième page, ce chef-d’œuvre (prononcer avec la bouche en cul de poule et en dodelinant du chef) de la littérature.
Tel : 00 56 765 444 8000, aux heures des repas
. Ai reçu de nombreux faire-part qui m’annonçaient la mort du roman depuis La Comédie humaine et l’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second empire. Comme je ne m’étais aperçu de rien, ballot que je suis, et que me voilà donc avec un siècle et demi de retard sur le dos, je recherche avec frénésie toute personne susceptible de me renseigner sérieusement sur l’endroit d’inhumation, les causes réelles du décès et, si possible, le nom des fossoyeurs. Parce que j’ai lu aussi quelque part que ces derniers auraient pu être Marx et la sociologie, ce qui, de prime abord, m’avait fait croire à une grosse blague d'apprentis carabins avinés.
Tel : 00 56 765 444 800, aux heures des repas
. Je cherche un éditeur pour un roman vieillot, aux termes surannés, à la syntaxe classique, avec des personnages et des descriptions à la con. Bref, un roman chiant comme un jour sans pain. Un roman dont le sujet n’intéresse pas grand monde. Jugez-en plutôt : un groupe de paysans de la Vienne à la fin des années 60 face à un événement ponctuel, certes, mais surtout face aux chambardements causés par la nouvelle façon de penser les campagnes.
Discrétion assurée. Parole d’honneur.
Tel : 00 56 765 444 800, à toutes heures du jour et de la nuit
. Recherche pour conversation anodine - et plus si affinités mais ça m'étonnerait fort - un ou une auteur de tapuscrits pour ne pas mourir idiot et savoir enfin à quoi ça ressemble.
Tel : 00 56 765 444 800, aux heures les moins pénibles de la journée
. Annonce sérieuse : Aimerait rencontrer quelqu'un qui a tout lu - je dis bien tout - de A la recherche du temps perdu sans jamais avoir eu l'impression de perdre son temps.
Tel : 00 56 765 444 800, à des heures convenables
. L’Exil des mots recrute rédacteur en chef pour sa catégorie critique et contestation car grosse fatigue sur le sujet de la part du rédacteur en poste.
Pas sérieux s’abstenir. Rémunération très incertaine cependant.
Tel : 00 56 765 444 800, aux heures de bureau
. Enfin, alors que j'allais boucler ma rubrique, on me prie d'insérer ceci :
Cette bonne femme, souffrant d'inextricables névroses parmi lesquelles celle de la surenchère répugnante, recherche d'urgence un vétérinaire.
Contact : UMP, Assemblée nationale.

15:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.03.2011
Le temps des cerises en forme de poires
 L’hiver, c’est comme un tunnel dans lequel on s’engouffre aux premiers jours de novembre. Listopad en polonais. Littéralement, la chute des feuilles.
L’hiver, c’est comme un tunnel dans lequel on s’engouffre aux premiers jours de novembre. Listopad en polonais. Littéralement, la chute des feuilles.
C’est ce mot chute qui me plaît bien. Chuter. Les chutes sont toujours plus vertigineuses que les ascensions. Plus sûres de leur trajectoire aussi.
Pour ma part, je m’y glisse donc toujours le cœur léger dans ce boyau des mortes-saisons, plein de bonne volonté et d’idées d’écrire. Dans ma tête, c’est mythique. La décadence de la lumière va de pair avec l’envie d’écrire. Ça finit même par avoir quelque chose d’idiot, cette affaire que j’assume volontiers. Toute idiotie décalée s’assume d’autant mieux qu’on n’a de compte à rendre à personne et si, en plus, on trouve quelque plaisir à être idiot dans un monde d’idiots.
Quatre mois de neige et de gel et de verglas. Cette latitude sans altitude observe scrupuleusement le grand mouvement des choses. Vers la fin mars reviendront les premières cigognes et l’aube, ce trait rose de l'éternel sablier, bien avant cinq heures. Quelque chose change dans le grand basculement. Le tunnel sent comme un soupçon de lumière.
J’aurai bientôt traversé mon sixième hiver en Pologne. C’est ma pendule à moi. Mes douze coups de minuit. C’est là, dans ces traversées des catacombes gelées, que se mathématise ma vie. Mon avancée dans le temps, plutôt. Je ne consacrerai donc jamais à l’expression j’ai X printemps. C’est peut-être parce que je préfère les endormissements aux réveils.
Se réveiller sur quoi, d’ailleurs ? Sur l’état d’un monde qui ne m’inspire plus guère que le dégoût. Et si ce monde est dégoûtant, c’est bien parce que les hommes le veulent ainsi. Il n’y a plus de dialogue possible avec toute cette merde. Les grands de ce monde, portés par les nains affreux, cacochymes, prétentieux, minables, des chaumières du suffrage universel, nous ont volé nos vies. Qu’au moins ils ne nous fassent pas perdre notre temps.
Si je devais exprimer mon plus fort regret, mon immense regret, ce serait d’avoir vécu à une des époques les plus lamentables pour l’esprit humain.
Et je suis encore assez con pour le dire.
Tout ça ne sert strictement à rien.
Notre parole ne vaut que par sa propre logique autonome. Intérieure. Sans incidence aucune sur rien. Un peu comme ces mélopées de prisonniers qui dégoulinent parfois sur le crépuscule des barreaux. Quand il n’y a rien à faire, sinon compter les nuits.
Parfois même les hivers.
13:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.03.2011
La musique ça se conjugue au présent
A l'époque de la publication de mon bouquin sur Brassens, je recevais beaucoup de courrier. Par la poste.
Un monsieur québecois et médecin de son état m'avait ainsi fait parvenir une longue missive pour me dire tout le bien qu'il pensait de mon livre et aussi qu'il s'était acheté à Paris la même guitare que Brassens, chez le fameux luthier Jacques Favino, et qu'il s'évertuait à jouer exactement, au centième de mesure près, comme le bon Maître.
J'avais répondu - gentiment - que je n'en voyais ni l'utilité, ni le plaisir qu'on pouvait en tirer. Que l'éternité d'une oeuvre résidait précisément dans sa relecture subjective, affective, sensible, adaptée à soi.
Plus tard, beaucoup plus tard, comme pour faire écho à ma réponse, j'avais découvert ça. C'est simple et c'est beau et c'est juste.
Contacté, l'artiste m'avait donné l'autorisation de publier ici sa vidéo.
La musique, ça se conjugue vraiment au présent.
Quand on prend sa guitare, il n'y a pas de concordances des tons au passé, sinon décomposé.
14:14 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.02.2011
Au pied du mur
Je publie un récit que j'avais d'abord projeté d'inclure dans un recueil de dix, récemment terminé et qui sera proposé aux éditions Antidata.
Je m'étais fortement inspiré d'un texte entamé sur le blog Tempête dans un encrier.
Puis j'ai changé d'avis. J'ai supprimé ce récit de mon sommaire, ne le trouvant pas achevé pour traiter d'un sujet aussi casse-gueule.
Il n'aura donc d'existence que sur l'Exil et ce que n'a rien de restrictif, chers lecteurs.
_________________
 Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Si ce Grand Meaulnes-là est resté en nous comme l’ombre un frère, d’un compagnon, c’est qu’il trimballe avec lui quelque chose de notre universalité.
Ma fête étrange à moi, cette fête qui ouvre sur le possible et le désir de vivre, fut tout autre. Je n’en perdis jamais le chemin.
Je connaissais par cœur le sentier sous la forêt qui menait jusqu’à d’étranges décombres car cent fois depuis leur découverte j’avais repris ce layon, en quête d’une redite de mes premiers émois.
En vain. Ces ruines m’avaient pourtant dévoilé les premiers mystères du désir amoureux, en même temps qu’elles avaient été mon premier regard jeté sur le délectable interdit. A partir d’elles, sans que j’en prisse tout de suite conscience, ce regard s’était fait synonyme de plaisir de vivre.
Après bien des visites et des visites, j’avais donc fini par abandonner mes ruines à ses bois et à ses broussailles mais j’ai tenté, tout au long de ma route, de les reconstruire partout ailleurs.
Tout cela ne m’est bien sûr apparu que tardivement. Entre les vieux remparts assiégés de buissons et le présentement dit, il y eut l’histoire ravinée par les marées de la vie et l’enfouissement des premiers troubles sous leurs écumes.
Ecrire cependant, n’est-ce pas vivre deux fois ? N’est-ce pas revenir en amont, remonter l’écoulement du fleuve par lequel on est arrivé jusque là, se pencher sur son lit, le débarrasser des alluvions déposées sur l’inaperçu ou l’à peine entrevu et tenter de ramener en pleine lumière le cours qu’emprunta finalement la fuite du temps ?
Alors maintenant, à l’heure où décline la lumière, à l’heure indécise entre le chien et le loup, à l’heure qui approche et où il faudra se jeter dans les gouffres anonymes, indéchiffrables et chaotiques du néant - tellement qu’on est tenté d’éconduire en même temps le loup et le chien en tâtant du fantasme de l’immortalité par un message agrafé au dos des insomnies - elles ont resurgi, les vieilles murailles des grands bois.
À l’heure d’écrire.
Elles ont resurgi à l’envers. La première fois, elles s’étaient entrouvertes sur les portes de l’avenir. La seconde, aujourd’hui, elles se referment sur le passé.
Telles des parenthèses.
Le mois d’août était opiniâtrement bleu et depuis plusieurs semaines les vents soufflaient du sud-est. Quoique faibles, ils n’en bousculaient pas moins des fétus de paille qui s’envolaient haut, très haut en tournoyant longtemps au-dessus des chaumes à la faveur des courants chauds.
Les paysans appellent ce phénomène des sorcières et disent qu’il est annonciateur d’une sécheresse durable. Je ne sais évidemment pas si cette théorie de l’observation est infaillible, mais je sais qu’elle s’était vérifiée cette année-là. L’été n’avait été rafraîchi que par quelques menues ondées, la terre était poudreuse et les prairies, sauf celles qui bordent la rivière, jaunes comme le sable des dunes.
Mon père, tout endimanché et tout inquiet, était allé ce dimanche-là se promener sur les champs où s’alignaient ses gerbiers d’avoine, d’orge et de blé fauchés aux derniers jours de juillet. Il voulait s’assurer que les grains ne séchaient pas trop rapidement sous ce vent continental et si, libérés de leurs épis, ils ne s’éparpillaient pas au sol. Selon ce qu’il aurait vu, il prendrait alors la décision de rentrer rapidement toute la moisson ou la différerait. Car il était comme ça mon père : pour rien au monde, il n’aurait travaillé un dimanche. Son dieu le lui interdisait formellement. Alors, sous couvert de promenades, il allait, les mains ostensiblement enfoncées dans ses poches, constater ceci ou cela sur ses champs et repérer de la sorte ce qu’il était urgent de faire et ce qui pouvait attendre. C’est-à-dire que sa morale rudimentaire devait considérer que penser, anticiper, projeter, ça n’était pas travailler, du moment qu’on faisait tout ça sans un outil dans les mains.
Ma mère l’avait accompagné et je les avais vus, bras dessus bras dessous, descendre le chemin qui, de notre maison, menait jusqu’à la rivière. Ils avaient ensuite traversé le pont de pierres.
Quand je dis que je les avais vus, ça n’est pas tout à fait exact. Je les avais guettés. Et lorsque j’avais été certain qu’ils étaient maintenant sur les champs de l’autre rive, j’avais pris la poudre d’escampette.
J’étais parti dans la direction opposée, vers les grands bois de chênes qui s’étiraient sur cinq kilomètres au moins, selon les dires de mon père, en face de chez nous, sur le coteau de la petite vallée. Je n’y étais jamais allé que par lui accompagné, encore qu’en proche lisière, où il possédait quelques ares et où il prélevait chaque année notre provision de bois de chauffage.
L’ombre tiède et sans un souffle bourdonnait des mille insectes de l’été et je marchais prudemment en évitant les herbes sèches et les pierres, réputées pour être les lieux de prédilection des serpents. Par d’éphémères éclaircies du taillis, j’apercevais en contrebas la rivière presque mourante et, plus loin au-dessus, les champs accablés de lumière. Bien que je ne sois nullement en peine ni en proie à la peur, cela me rassurait d’entrevoir des lieux familiers et m’invitait à explorer encore plus loin un faible sentier forestier coupant les bois dans le sens de leur longueur.
Je le suivais depuis longtemps déjà, en quête de nids d’oiseaux perchés tout là-haut dans le branchage des chênes ou alors camouflés dans les sombres enchevêtrements du sous-bois, quand ...
Je m’arrêtai, tétanisé.
Devant moi se dressaient de hautes murailles de pierres partiellement effondrées et dévorées par une végétation de lierres luxuriants, de lianes, de viornes et de sureaux. Délabrées, antiques et étrangement retirées au beau milieu des bois, elles obstruaient complètement le sentier.
Mes premières stupeurs à peine estompées, je m’avançai doucement sur la pointe des pieds, comme attentif à ne pas réveiller quelque chose de ces décombres tellement inattendues, quelque chose de lointain, de souterrain et qui n’existait pas dans mon monde. Ces ruines m’apparurent incontestablement extravagantes en ces lieux. Elles étaient vivantes, elles étaient humaines, elles semblaient s’être déplacées là, tant elles n’étaient pas du même élément que les herbes, que les arbres, que les fleurs et que la poussière ocre du chemin.
L’enfant aux portes de son adolescence ne voyait sans doute pas ces vieux murs tels qu’ils étaient en vérité. Leur solitude, leur dégradation majestueuse dans tout le silence et le secret de ces grands bois, lui en imposaient. Il les voyait puissants qui coupaient autoritairement sa route. Ils avaient surgi. Et déjà n’avaient d’importance que ce qu’ils pouvaient bien receler. Dissimuler. Plus loin qu’eux.
C’est bien ce qui différencie foncièrement l’archéologue qui cherche de l’enfant qui trouve. Celui-là veut faire parler les vestiges au passé, celui-ci n’a d’yeux que pour l’éventuelle ouverture que pratiquerait ce passé sur un futur immédiat, qu’il s’approprierait aussitôt.
Ces grands murs sont restés gravés intacts dans ma mémoire d’homme. Je pourrais aujourd’hui dessiner et peindre leurs lézardes béantes d’où dégoulinait la terre rouge de la maçonnerie, leurs sommets ravinés, les plantes et les arbustes qui les broyaient de leurs étreintes, les lourdes pierres taillées, grisâtres et mouchetées de lichens. Je pourrais sans les trahir les reproduire tels qu’ils jaillirent devant moi, spontanément, comme des allégories de ce qu’il faut éviter de franchir, comme des signes, comme des prémonitions à la fois austères et dionysiaques. J’eus la terrible sensation que ces parois marquaient la fin de mon monde. Qu’il y aurait désormais un avant et un après leur rencontre.
Le layon se rétrécissait, pris en tenaille par des genêts, des genévriers et autres broussailles. Il descendait légèrement maintenant et ce n’est que parvenu au pied des murailles, que je constatai que seule la crête en était écroulée. Les bases en étaient encore saines. Je continuai lentement sur le sentier dont la déclivité s’accentuait et qui semblait vouloir contourner le vieil édifice. Il changeait de qualité aussi. Il était à présent revêtu de pierres que recouvrait une mousse bien verte et humide. Il y avait de l’eau par ici. Je le sentais. Et de la fraîcheur. Ça n’était plus la lourdeur bourdonnante, épaisse et poussiéreuse des sous-bois. Quelque chose avait changé, la température, le décor, presque la saison. Je mesurai tout ça d’instinct et en pris pleinement conscience en apercevant entre les cailloux et les herbes rampantes, les minces filets d’eau d’un écoulement limpide.
À force de prudence et de lenteur, je parvins bientôt jusqu’à l’angle de ce qui m’apparut dès lors comme étant des fortifications. Car à cet endroit s’élevait une grosse tour ronde et crénelée, à partir d’où les remparts s’enfuyaient à la perpendiculaire, accompagnés du petit sentier qui descendait encore plus abrupt, toujours pavé et luisant d’humidité.
Une tour ! Je n’en avais jamais vu que sur mes livres d’écolier. Une tour, ça signifiait dans mon esprit bataille rangée, flèches, arbalètes, lances, cris, feu et huile bouillante jetée sur des assaillants tout vêtus de fer…Je levai la tête. Elle était haute, en bon état et sans doute avait-elle été reconstruite car la pierre, quoique loin d’être neuve, était plus blanche et mieux taillée que celle des remparts. Un lierre géant avec un tronc tourmenté par de robustes nœuds, lourds comme des poings, l’escaladait, s’enroulait tout là-haut entre les créneaux avant de continuer sa conquête exubérante tout le long des sommets effondrés de l’enceinte.
Remparts, petit chemin dallé autour, source toute proche, tour. Tout cela désignait un château. Au bout de mon escapade, j’étais donc tombé sur une forteresse des temps anciens, secrètement recluse au fond des bois. Je n’étais plus apeuré ni inquiet : j’étais émerveillé et ma tête se mit à battre la campagne.
Ma maison, mes parents, les interdictions, les recommandations, les morales, étaient soudain à des siècles d’ici et continuaient de s’éloigner encore vers un brouillard irréel. Tout ça, déjà n’existait plus. Un souffle puissant surgi d’un temps révolu venait de balayer ma petite vie de garçonnet au rang des quotidiens moroses, sans rêve et sans issue.
Longtemps je suivis le layon de plus en plus étroit, le long des remparts que le soleil éclairait de jaune clair à travers la cime immobile des arbres, alors que moi j’avançais dans la pénombre verdoyante des arbustes et des broussailles. Impossible d’accéder tout à fait au pied des murs, cernés par la végétation au maximum de sa maturité et de sa densité, jusqu’à ce que mon sentier fût soudainement coupé par un chemin creux beaucoup plus large et nettement plus carrossable. Etonné, je l’examinai. Des empreintes de pneus de voiture en imprégnaient encore la poussière. Il filait à travers bois, droit sur le soleil couchant, pour en sortir bientôt sans doute, le long de la rivière en contrebas.
Mais de ce côté-ci, sous mes pieds, il finissait sa course sur une porte cochère fermée d’une lourde chaîne et que d’épaisses ferrures disposées en diagonale sur chaque vantail rendaient plus massive encore. Un cul de sac. L’accès des hommes au château en ruines. Je n’étais plus seul et les murailles perdaient quelque chose de leur enchantement. Je m’approchai doucement de l’énorme porte. Son bois battu par la pluie, les froids et l’ombre des intempéries, était noir et rugueux.
Je glissai un œil entre les deux battants, mal joints.
Alors je suffoquai littéralement tandis qu’un flot épais de sang tiède envahissait tout mon corps, me faisait ouvrir la bouche toute grande et basculait ma tête dans un vertige jusqu’alors inconnu, d’une violence délicieuse et qui ne devait plus guère me quitter.
Je vis d’abord la femme étendue sur la chaise longue. Elle était nue. Elle était absolument nue. Lascive, elle se prélassait au soleil telle la délicieuse divinité d’une légende antique et sa longue chevelure auburn, saupoudrée d'une lumière qui retombait en poussières scintillantes, se répandait en désordre sur la toile rayée blanc et vert de la chaise longue. Elle tenait un livre à la main et d’épaisses lunettes noires masquaient tout son regard. J’écarquillais mon œil désemparé dans le petit interstice de bois et je fixais, de profil, la touffe ombrée du pubis, les seins mordorés, ronds et lourds, et je frémissais de tout mon corps, en proie à l’extase. Cette beauté de statue, tellement parfaite, tellement limpide et tellement isolée au milieu de tout ce délabrement de pierres et de halliers, ne pouvait être que l’émanation immatérielle d’une déesse, que la manifestation d’un esprit fugitif et malin des bois et des forêts.
Qu'une créature momentanément égarée de ce côté-ci du réel.
Tout mon être tendu demeurait cependant chevillé à l’ombre délicatement crépue de cette étrange toison entre les cuisses et à la poitrine dressée tel un cri d’ivresse, jeté vers le soleil et le grand ciel tout vide et tout bleu. Les jambes négligemment croisées à hauteur du genou étaient longues, beaucoup plus longues que la chaise sur laquelle elles étaient étendues et de temps à autres, seul signe tangible de l’existence charnelle de cet être magique, la main se levait légèrement pour tourner une page du livre.
Elle repoussa bientôt les lunettes sur le haut du front, se leva, féline, éblouissante de souplesse, et se dirigea lentement par une allée de fins gravillons blancs, vers le corps de bâtiments situé juste en face de moi. Elle me tournait maintenant le dos. J’admirai là, l’œil collé contre le bois de la porte cochère à m’en faire mal, les premières fesses féminines de ma vie. J’admirai la réalité vivante de mes fantasmes naissants, j’admirai l’apparition devant mes yeux de toute cette métaphysique du désir qui devait plus tard me servir de phares et de sémaphores pour tracer ma route, et derrière lesquels, de villes en villes, de villages en villages, de routes en routes, d’années en années, de débauches en débauches, de joies en détresses, d’ivresses en ivrogneries, j’ai couru, couru à perdre haleine, comme le prisonnier de l’éboulement court après le soupçon de lumière qu’il a cru entrevoir au bout de sa prison d’obscurité.
J’assistai, médusé, à l’éphémère et première mise en scène d’une éternelle illusion.
Un homme cependant, le torse puissant et nu, était apparu qui venait à la rencontre de la jeune femme. Il sortait de l’aile aux larges baies vitrées située en face de moi, et je me retirai vivement comme s’il pouvait me voir à travers le lourd portail. Je restai quelques instants le dos plaqué contre la porte, effrayé, n’osant plus m’approcher ni faire le moindre mouvement. Lorsque je revins enfin, avec mille précautions, l’œil avide, comme aimanté à cette fente entre les vantaux, le cœur battant, les deux corps n’en faisaient plus qu’un, absurde amas de peau luisante, agité d’ombres et de lumières, et ils se roulaient dans l’herbe comme le font d’ordinaire les enfants et les jeunes chiens fous.
Les larmes aux yeux, la bouche ouverte, j’entendais depuis mon portail, gémir ces deux corps. On eût dit qu’ils étaient en lutte et en proie à la plus vive des douleurs.
J’essaie de retrouver - mais ça n’est pas très facile - le trouble qui m’envahissait. Il me semble que quelque chose d’irréel, de délicieux et de divin, s’était évanoui et, avec ces deux corps confondus, qui se multipliaient, qui se chevauchaient tour à tour, qui roulaient, se redressaient et se renversaient encore, l’adoration du merveilleux.
Je crois que j’étais accablé. Et pour s’être inscrite dans le réel, dans le charnel, l’apparition nue n’en restait pas moins aussi inaccessible pour moi que la lune ou les étoiles de la nuit le sont aux rêveurs éconduits. Mon âge - j’allais avoir treize ans- , l’homme qui pérorait, gloussait et se trémoussait comme un pantin sur ma déesse déchue, ma condition sociale, mes parents, le curé, l’école, le monde entier… Il y avait, entre cette beauté spectrale et moi, entre ce que je voyais se dérouler d’elle devant mes yeux meurtris par le mystère obscène du désir et de la vie, entre les étranges lamentations que j’entendais maintenant jaillir de sa gorge offerte aux immensités du ciel bleu, des abîmes effrayants, absolument infranchissables.
Il y avait tout le poids d’un incompréhensible et soudain désespoir.
J’éprouvai tout à coup une haine féroce contre tout ce qui était. Contre mon âge, contre les hommes, les réalités, contre tout ce qui pouvait m’entourer de tranquille et d’insignifiant bonheur.
Et je versais des larmes de douleur et de dépit quand, la pénombre descendant maintenant de plus en plus profondément sous la touffeur des sous-bois et les deux corps s’étant enfin désolidarisés pour rejoindre l’intérieur des bâtiments après être longtemps restés blottis l’un contre l’autre, inertes, comme terrassés par la violence de leur combat, je me résolus enfin à rebrousser chemin, anéanti.
Je venais de perdre les repères sur lesquels l’enfant guide sa navigation. Je venais d’engloutir dans une vision éblouissante, la foule des petits signes avec lesquels cet enfant se fraie un chemin, difficile et solitaire, entre les commandements, les écueils et les rochers du monde adulte.
À tel point que tout ce qui, jusqu’alors, avait nourri peu ou prou mon initiation au plaisir de vivre devint affreusement insipide.
Je sombrai pour un temps dans l’apathie et le dégoût même de mon existence.
11:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
22.02.2011
Autocritique

Je mets régulièrement en ligne les chapitres de Brassens, poète érudit, des textes qui ont donc été écrits en 1999. J’intercale entre ces mises en ligne de vieux textes publiés ici en 2008 ou 2009. Ce qui permet de les rafraîchir un peu et d’harmoniser la présentation de L’Exil, qui en a bien besoin.
Point de nouvelles élucubrations là-dedans. Je sors de cet hiver un peu fatigué quand même par ce recueil de dix nouvelles écrit d’octobre à maintenant. C’est une expérience que je n’avais jamais tentée, l’impression de devoir se renouveler toutes les dix pages et aussi, tâcher de satisfaire aux exigences de la forme brève, précision, travail d’épuration et tutti quanti.
J’ignore évidemment si j’ai mené mon projet à bien ou si je m’y suis lamentablement planté. Parfois, je me dis que c’est vraiment réussi. Parfois aussi, un parfois un peu plus têtu que l’autre, je me dis que tout ça ne vaut pas une queue de cerise.
Pas envie, donc, d’entreprendre de nouveaux chantiers, aussi menus soient-ils, d’autant qu’un éditeur que je connais bien me fait poireauter gentiment pour un roman depuis juillet dernier et que poireauter, c’est pas vraiment mon fort.
Las.
Et pas grand-chose à dire non plus sur l’état de plus en plus délétère du monde. Pour ça, un blog n’est pas nécessaire. Il est même tout à fait superflu. Suffit de regarder par la fenêtre et rabâcher ne sert qu’à la production de sa propre bile, sans aucun effet sur la détermination des organisateurs patentés de la misère humaine, parmi lesquels certains montrent des dents de loup et d’autres font reluire une peau d’agneau, chacun dans son rôle pour distraire la chaumière.
Je crois même, de plus en plus, que la critique du monde spectaculaire ne lui sert, in fine, que de panneau publicitaire.
Alors, prendre tout le sens de l’expression populaire et attendre le dégel.
Le dégel de quoi ? On verra bien.
Sous la glace, la plage, peut-être. J'en doute fort et je n'aime pas les plages.
Jamais rien n’est de toute façon achevé de ce qu’on a à peine commencé.
10:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.02.2011
Formica et Télé : la fin d'une époque
 (...) La bouteille de gaz emboîta le pas à l’eau et, suprême avatar, le formica fit son entrée triomphante.
(...) La bouteille de gaz emboîta le pas à l’eau et, suprême avatar, le formica fit son entrée triomphante.Des meubles d’une inestimable facture, des placards de merisier ou de chêne sculptés furent désossés et finirent leurs longs et nobles états de service en casiers à poules ou en portes de clapier.
Toujours experte dans ses observations du monde, ma soeur qui ne savait guère quoi dire de tous ces chambardements, trouva là une ouverture pour faire les louanges de son avocat d’employeur.
Celui-ci en effet ne voulait pas de formica, ni chez lui, ni dans son grand bureau. Sans doute par modestie, parce qu’il avait les moyens de s’en payer, du formica. Le brave homme ne s’était fendu d’un placard que pour sa chambrette à elle. Pour lui faire plaisir. C'était vraiment un beau petit meuble, pratique comme tout. Pour lui-même, il avait bien voulu, certes en rechignant un peu, débarrasser quelques-uns de ses clients de leurs gros meubles, en vieux bois vermoulu, un peu comme ceux passés chez nous par les flammes et par la scie. Ne sachant plus à la fin ou mettre toutes ces friperies, embêté mais incapable de vexer les gens, il avait même fait porter des lits et des buffets dans sa petite maison à la campagne, au bord de la rivière, à l’ombre des peupliers où il aimait à se retirer le dimanche avec sa petite famille. Il y taquinait la carpe ou alors il y recevait des amis, le docteur par exemple, ou bien le vétérinaire, quand ce n’était pas le notaire. Quelquefois, pas souvent, il y allait seul, avec des gros dossiers sous le bras, des dossiers tellement compliqués qu’ils demandaient à être étudiés dans le calme et la solitude champêtres. Interdiction formelle était alors donnée à toute la famille de le déranger, sous aucun prétexte.
A n’en pas douter, voilà un homme qui aimait rendre service aux gens. Ma mère ricana que c’était surtout un homme qui ne comprenait rien à rien. S’il n’achetait pas de formica, c’était normal mais surtout c’était bon signe. Le formica n’était pas fait pour des attardés et des nigauds pareils.
Je revenais d’une longue réclusion trimestrielle quand je pris de plein fouet les effets dévastateurs de cette orgueilleuse et stupide conversion des miens à la modernité. Ma maison ressemblait lamentablement à la salle de sciences du collège et à l’infirmerie. Je sentais bien qu’elle était en train de perdre son âme sous les coups de boutoir des faiseurs de mode et de pacotilles. Je m’insurgeai tout net que c’était laid, que c’était de la camelote et que c’était honteux. Je traitais mes frères d’imbéciles heureux pour avoir osé passer par la hache notre mobilier.
Avec la lumière qu’il ne fallait pas allumer, l’eau courante qui ne courait guère, la bouteille de gaz qui inspirait une peur bleue, le formica qui ne servait à rien sinon à injurier les murs, le clan glissait inéluctablement vers le factice de la corruption sociale.
C’était un homme très affable, les ondulations de ces cheveux bien tenues en place par la brillantine, une fine moustache, très fine, presque un symbole, impeccablement taillée. Il débarqua chez nous en sifflotant et en sautant prestement d’une petite camionnette jaune, haute sur pattes. Ma mère l’avait d’abord reçu en fronçant le sourcil, l’oeil guère encourageant, puis elle s’était laissée peu à peu séduire, par le discours ou peut-être par les vaguelettes brillantes des beaux cheveux, par le costume souple et par ce sourire à peine moustachu dont ne se départait pas le bonhomme.
Comme le formica, tout le monde en voulait. Il ne fournissait pas, il fallait en profiter, il ne pourrait pas en laisser longtemps comme cela chez les gens, à l’essai. C’était sans doute même la dernière fois où il pouvait se permettre cette fantaisie. Nous en avions de la chance !
Je trouvais que cela commençait à faire beaucoup de bonheur d’un seul coup. C’était gratuit, c’était formidable et nous avions de la chance. La fortune ne nous avait pas habitués à tant de sourires à la fois.
Ma mère écoutait, dubitative encore, mais néanmoins subjuguée. Ces dernières, mais bien molles résistances, s’écroulèrent quand la fine moustache, ayant négligemment promené son regard chafouin sur la pile des Nous-Deux qui traînaient devant la cheminée, dit qu’il y avait aussi des feuilletons qu’on pouvait suivre toutes les semaines ou même tous les jours, des romans-photos d’amour qui bougeaient et qui parlaient, quoi, si on voulait aller par là. Est-ce qu’on se rendait compte ?
De Gaulle nous sauva la vie.
Après bien de minutieux réglages, après bien des coups de petits tournevis de-ci, de-là, après bien des crachotements, des éclairs et des bruits sournois de machine infernale qui se propose d’exploser, la longue face et le long nez du Général apparurent à l’écran, tandis que les non moins longs bras, grand ouverts, battaient la mesure de cette voix si singulière et de tous tellement connue.
A ce timbre rauque et fortement ponctué, j’avais vu ma mère se renfrogner, incrédule. Elle avait interrogé le marchand d’images avec cet oeil que je connaissais trop bien et qui ne laissait présager rien de bon. Absorbé par ses boutons, le gars n’avait pas croisé ce regard.
Il était enfin parvenu à faire la synthèse entre le son et l’image.
Il avait dit vrai. Nous avions de la chance. Quant à lui, il ne pouvait pas tomber plus mal. Ma mère s’approcha du poste, regarda De Gaulle dans les yeux, se tourna vers le bellâtre qui avait retrouvé son sourire et, fidèle à elle-même, comme toujours avant la tempête, demanda qu’est-ce que c’était que ça.
Ce devait être un autodidacte. Le pauvre bougre avait dit exactement ce qu’il ne fallait pas dire.
Depuis, je n’ai jamais entendu, malgré tout ce que j’ai entendu sur le sujet et en dépit de tout ce que j’ai pu en dire moi-même, de critique plus radicale du pouvoir politico-médiatique.
Elle priait celui qu’elle traitait désormais de gaulliste de remballer au plus vite sa camelote, avant qu’elle ne l’explose elle-même d’un savant coup de marteau.
La télévision ne parvint jamais jusques à nous. Trop sûr de lui, le progrès arrogant avait voulu outrepasser la mesure.
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.02.2011
Michelet
 J’avais mis ce texte en ligne en août 2009 alors que je venais d'en terminer avec les quelque 4800 pages - texte, notes et annexes - de «Histoire de la Révolution française», de Jules Michelet, ouvrage qui couvre la période allant de la convocation des États généraux à la réaction thermidorienne.
J’avais mis ce texte en ligne en août 2009 alors que je venais d'en terminer avec les quelque 4800 pages - texte, notes et annexes - de «Histoire de la Révolution française», de Jules Michelet, ouvrage qui couvre la période allant de la convocation des États généraux à la réaction thermidorienne.
Je le publie une nouvelle fois aujourd'hui car, quand on voit dans quel ruissseau nauséabond s'est embourbée la République française, avec ses dirigeants amis des régimes les plus pourris et les plus brutaux de la planète, des dirigeants corrompus, vautrés dans leur sale fric et qui font voter des lois pour que le bon peuple aille au charbon jusqu'à 67 ans et tutti quanti, on est en droit - depuis bien longtemps, c'est vrai - de se demander si l'histoire a une quelconque utilité pédagogique face à l'abrutissement des hommes.
On est en droit de s'exclamer : tout ça pour rien, laissons tomber toute critique sociale et vivons en sauvages !
Et quand je pense, parmi tant d'autres choses, qu'un homme pourrit dans leurs sales prisons depuis 25 ans, sans que pas grand monde ne songe à s'en émouvoir, et que même une imbécile comme Ségolène Royal s'en réjouisse, le ressentiment dans mon coeur atteint le niveau du dégoût pour tout ce qui touche, de près ou de loin, à la politique.
Au cas où cela pourrait vous intéresser, je note d'ailleurs que le susdit prisonnier publiera le troisième tome de ses mémoires en septembre prochain, chez Argone.
De la lecture de Michelet, j'ai tiré un tel plaisir que j’aimerais que les gens pour qui j’ai de l’estime – et qui ne l’ont pas encore fait - se plongent à leur tour dans cet océan littéraire, en reçoivent la même jouissance et les mêmes perplexités.
L'admirable de cette lecture, c’est qu’on est en présence d’une œuvre historique, certes, mais en même temps profondément lyrique, étonnamment personnelle, enthousiaste ou désabusée. Engagée.
Derrière les faits transmis, le cœur et l’âme du poète, de l’écrivain, de l’homme de conviction généreuse, palpitent, regrettent, anticipent et souffrent.
Dit autrement, voilà une œuvre historique sans l’ennui décharné de la prose historique. Une écriture qui embrasse le sensible et fait appel aux émotions les plus humaines.
Je comprends alors beaucoup mieux pourquoi les historiens sérieux, les doctes, les scientifiques du décorticage de la grande aventure humaine, refusent à Michelet d’appartenir à leur collège.
C’est un bien grand service qu’ils lui rendent là, finalement.
Nous ne savons pas toujours situer notre écriture dans cette incommensurable prolifération de genres que constitue la littérature. Nous nous interrogeons, nous posons en filigrane les principes de notre esthétisme, de ce que nous portons en nous, de notre confrontation à un monde compliqué. D’aucuns, raccourci fulgurant, affirment que la littérature est morte, mais sans définir précisément la nature du cadavre et les auteurs du crime.
C’est un point de vue. Radical, désespéré peut-être, qui a sans doute quelque raison d’être mais qui a surtout l’affligeante présomption de renvoyer paître, sans les entendre, tous les amoureux de la lecture.
Nous n’avons pas reçu, en ce qui nous concerne, de faire-part.
C’est peut-être une blague style Quat’ z’arts… Une certaine littérature est morte. Sans doute. Disons plutôt désacralisée. L’écriture, quant à elle, est bien vivante.
Le roman est crevé lui aussi, assurent depuis longtemps, d’autres. Je trouve que ça fait beaucoup d’obsèques, tout ça, et que ça s’inspire beaucoup plus du champ de navets que de la salle des fêtes…Une expression du roman, sans doute veulent-ils dire ; Le Balzacien, le Stendhalien, le Maupassantien, que sais-je encore ? Mais c’est quoi un roman ? Un truc qui invente des personnages dans un réel réapproprié par l’écriture ou un personnage réhabilité, l’auteur, dans un réel qu’il s’invente?
Cette digression pour dire que la lecture de Michelet révèle une autre dimension de l’écriture : une transcription pindarique des drames et espoirs humains, la force de l’intelligence sensible prenant à bras le corps le matériau historique, bien documenté, et qui s’en empare pour parler le langage de l’universel, laideur et beauté dialectiquement confondues.
Du point de vue de notre positionnement d’hommes de la Cité, revient aussi cette obscure évidence que les révolutions – en particulier celle dont les acquis constituent aujourd’hui la clef de voûte de notre édifice démocratique et social - sont des cheminements tortueux, inaccomplis, difficiles, et qu’on ne peut nullement appréhender au travers le prisme déformant de l’idéologie, cette fabrique de la pensée prédigérée, ce soporifique de la douleur des faibles, cette bouillie servie pour chats fainéants, qu’ils se vautrent à droite, ronronnent à gauche ou miaulent à l'extrême gauche.
En lisant Michelet, c’est de l’intérieur qu’on lit les acteurs de l’histoire. J’allais dire de la Comédie humaine.
C’étaient pas des anges, c’étaient pas des démons et c’étaient même pas des révolutionnaires au sens enfantin où nous l’entendons.
Des hommes de chair, de passion, d’intérêts, des fourbes, des obscurs, des grands, des illuminés et des mesquins – comme nous tous - mis en présence d’une nécessité de transformation radicale des conditions de la vie.
Pour ne parler ici que des deux grandes figures, les deux icônes de nos premiers manuels d’histoire, Danton et Robespierre, Michelet les enveloppe d’une lumière nouvelle à mes yeux, quoiqu’on devine nettement chez lui le dantoniste, ce qui n’est qu’un reflet de son engagement personnel, dans son époque à lui, à l’aube du Second Empire.
A t-on déjà vu, dans œuvre présentée comme historique, un Danton en bonnet de nuit, à Sèvres, rêveur à sa fenêtre ouverte sur la nuit et uniquement préoccupé de sa jeune femme et de son jeune fils ? Un Danton écœuré du sang versé, peureux, dépassé par les événements, lamentable de contradictions, disant blanc le lundi et noir le mardi, ne sachant plus à quel jeu politique se prêter, et ce uniquement parce qu’il voulait vivre, simplement vivre plus longtemps sa vie d’homme aimant et aimé et qu’il sentait bien sur son cou, déjà, planer le froid et luisant couteau de la guillotine.
Le procès qu’on lui fit – comme celui de la plupart des grands esprits de ce temps - n’eut ni cul ni tête. Quelque cent quarante ans plus tard, Staline n’aura rien à envier au tribunal révolutionnaire de 1793. Parmi les jurés, l’un était un garde du corps de Robespierre - l’instigateur du procès selon Michelet - , un autre était sourd, un autre complètement idiot, tellement idiot qu’il ne comprenait ni les questions posées aux accusés, ni les réponses faites par ceux-ci et qui, du fond de son âme atrophiée, invariablement, demandait qu’on tuât !
La tête de Danton, comme des milliers d’autres têtes, tomba dans le panier d’une absurdité ensanglantée, avec cette logique implacable du crime érigé en institution.
Celle de Robespierre, l’épurateur, le névropathe paranoïaque, le timide et vertueux serial killer, père de Napoléon, de Thiers, de Staline, enfin de tous les putois sanguinaires de l'histoire contemporaine, suivra bientôt, victime de l’épouvante dans laquelle il aura plongé tous les acteurs, illustres ou anonymes, de l’époque.
Michelet assure que toute l’Europe couronnée, réactionnaire et pourtant coalisée contre la France, eut alors un profond respect pour cet homme adulé des uns, honni des autres, parce qu’il avait, par le jeu sournois de la politique, tranché les deux têtes majeures de 93, Danton et Desmoulins, et coupé ainsi le cou de la République, ouvrant un boulevard au 18 Brumaire, à l’Empire, aux Restaurations, à la Terreur blanche et vengeresse des émigrés.
Triste histoire que celle de tous ces hommes et de toutes ces femmes trahis par ceux à qui ils avaient confié leur enthousiasme de liberté.
Triste histoire parce qu’histoire éternelle.
Histoire de la profonde solitude des hommes, de leur inintelligence ponctuelle à comprendre les mécanismes de leur barbarie et les cheminements de leur destin.
Vraiment.
Photo : Wikipédia
10:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.02.2011
Les oiseaux sont-ils tenus à un devoir de mémoire,
là où dieu et les hommes ont, une fois pour toutes, cessé d'exister ? *
* Pierre Michon - La Grande Beune -
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.02.2011
Vases communicants : Philippe Nauher sur L'Exil
C’est avec grand plaisir que L’exil ouvre ses portes à Philippe Nauher, que je lis toujours avec délices.
Pendant qu’il est là avec vous, je file chez lui, bien sûr, comme c’est coutume dans ces vases communicants.
Et, je voulais dire que..Mais non, finalement. Je préfère le laisser parler. Il fera ça mieux que moi :
"Cher Bertrand,
J'ai hésité sur le texte que je voulais "exiler" mais pas vraiment, en fait. Il se trouve que je travaille depuis deux ans sur un roman dont le héros est un jeune français d'origine polonaise et qui, au début, est en exil au Portugal. Il sort de prison. Il m'a alors semblé singulier que ma première invitation à "vase-communiquer", la vôtre, ait pour territoire la Pologne justement, dont je ne suis pas encore sûr que ce personnage y mettra jamais les pieds. Comme vous êtes vous-même "exilé", je me suis dit que c'était singulier de réunir ainsi deux directions opposées par rapport à la France : la Pologne et le Portugal.
Je vous propose donc les premières pages des "Courbes de choses invisibles" (titre que j'emprunte à un album de Téléfax).
Amitiés
Philippe"
Des Courbes de choses invisibles
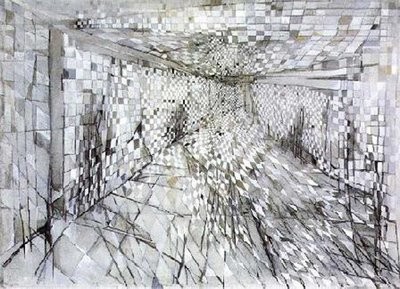 Demain, la levée des écrous aura lieu à dix heures.
Demain, la levée des écrous aura lieu à dix heures.
Il reprendra place dans le siècle. Ceux qu'il va laisser, qui en ont encore pour quelques années, parfois une éternité, l'envient en silence.
Son avocate se démenait pour obtenir sa libération. Il avait peur. Cela lui broyait l'estomac, enflammait ses boyaux. Il ne pouvait pas lui dire non, je ne veux pas quitter la prison. Personne ne peut le dire. Quatre ans d'incarcération il y a pire ; il faut aussi que cela cesse. La vie doit reprendre. Et quand elle lui a annoncé la nouvelle, il a senti que le tenia du dehors pointait sa gueule de feu. Mais c'était trop tard. Elle avait obtenu ce qu'elle désirait.
Au milieu de la nuit, alors qu'il jetait un regard oblique sur la cellule, le cube froid qu'il va quitter, auquel les petites affaires de chacun ne donnent qu'une illusoire humanité, et il vaut mieux passer sur les quelques photos décoratives, la silhouette de Jankovic s'est plantée devant lui. Il s'est accroupi à son oreille pour lui demander une dernière fois s'il était heureux, je devrais, et ce qu'il allait faire : partir au loin ou rentrer en France ? Sais pas. Il y avait réfléchi quand ce n'était encore qu'un vœu lointain, pas même un vœu, une hypothèse, puis tout s'est évanoui. Réfléchir, c'était un bien grand mot. Pour la première fois, Jankovic a posé sa main sur la sienne, sans rien dire, avec une petite pression pour signifier son amitié. Venant de lui, c'était inattendu, parce qu'il s'est fixé depuis longtemps la règle de l'armure.
C'est le matin. Paulhino est triste. Il veut rire une dernière fois : désormais, pour l'heure de sport du vendredi matin et la partie de foot, les étrangers gagneront moins souvent, et Jankovic en a rajouté une couche : sur le marché des transferts, le Polak, c'est une perte.
Ils blaguent. Ils sont démunis.
Plus qu'une heure.
Ils le regardent tous une dernière fois, le Polak.
Le Polak. Il aura fallu attendre la prison et Lisbonne pour qu'un inconnu, Marinho, Augustin Marinho, l'appelle du surnom qu'on donnait à son père dans la famille de sa mère. Le Polak. Il avait entendu sa tante parler à sa cousine. Quand on a trouvé qu'un Polak pour mari. Et veuve presque tout de suite.
Il sort de la cellule. Il redevient Komian. Bruno Komian. Dit Koko, Kom ou Bkom. Le Polak n'existe plus.
Ce qu'on lui devait a été rendu. Ainsi ferment-elles, les autorités et la justice, la parenthèse, en lui dressant procès-verbal des objets restitués, de ses avoirs, comme s'il ne s'était rien passé à attendre derrière les barreaux. Il a simplement serré fort dans le creux de sa main les courroies de son sac. Ils l'ont remis à la rue, à la vie civile. Il a longé un parc et débouché sur une place où les voitures font la ronde autour d'une colonne betonnée que surmontent, noirs, un lion et un aristocrate à perruque. Le trafic est infernal, et le trouble du monde à nouveau entre en lui comme une gigantesque ritournelle. Il prend la Liberdade large et feuillue. Ses compagnons lui ont dit : la Liberdade, tu vas descendre la Liberdade et là tu verras la vie autrement.
Il comprend désormais les enseignes, les titres des journaux. L'ancien puzzle de lettres est devenu matière. Portugais d'adoption.
Il a senti bientôt ses pas se dérober, comme un épuisement brutal devant ce qui file dans tous les sens et il s'est assis à une terrasse. À une jeune serveuse, prompte et souriante, il a demandé un jus d'orange. S'il vous plaît. Son regard tremblant a suivi la silhouette s'enfoncer dans l'ombre du café. Il a posé ses mains pleines de fourmillements sur la fraîcheur métallique de la table pour retrouver un semblant de respiration intérieure, quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps réel, son corps, mais qui lui demande s'il est encore en vie, s'il a encore envie, d'être là ou ailleurs. La jeune fille est revenue et dans l'attente qu'il paie, ils se sont fixés. Elle est la première personne libre, normale et étrangère à toute cette affaire, à qui il parle. À qui il parle en portugais. Langue du transitoire, à peine quelques jours avant d'embarquer pour l'Amérique du Sud, mais devenue son autre langue, langue de l'exil carcéral et dont il doit vérifier, comme s'il y avait un doute possible, qu'elle peut servir à autre chose qu'à la détention, à la violence entre détenus, aux histoires salaces, servir à des relations simples, anodines, peut-être impersonnelles mais calmes. Langue du reste de sa vie, en admettant, par exemple, qu'il ne revienne jamais en France, possible, et qu'au fil du temps, la langue maternelle perde une à une ses pièces, est-ce possible ?, déliée jusqu'à ce qu'il cherche ses mots, comme on cherche, parfois, ses souvenirs. Et peut-être qu'un jour, qui sait ?, il en aura perdu toute la trace.
Il parle portugais. Il pourrait en faire quelque chose, choisir une autre ville que Lisbonne, et tout oublier.
Il vérifie le papier que lui a laissé Freitas, d'une adresse, l'adresse d'un hôtel de l'ami d'une cousine. Freitas n'est pas méchant. Il essaie de se raccrocher à l'idée que quinze ans en tôle, si tu sais te faire apprécier, te faire des amis, il est possible d'en sortir sans trop de dommage, même si plus personne ne l'attend, sinon sa sœur. Sa compagne est partie, au Brésil. Alors il a voulu l'aider.
Adresse et plan sommaire sur une feuille quadrillée, d'une écriture enfantine, de quelqu'un qui n'a pas beaucoup usé du crayon. Il faut qu'il descende encore.
Il arrive devant la plaque. La rue est perpendiculaire à la Liberdade et avant de s'y engager il aperçoit de l'autre côté du terre-plein central l'enseigne du Hard Rock Cafe où on peut voir, lui a dit Jankovic, un pantalon porté par Bowie, son idole, accroché au mur. Il n'aura qu'à y aller et il pensera à lui en buvant une bière. Dis, Komian, tu penseras à moi. Il a dit oui pour lui faire plaisir. Mais oui, là, maintenant, il y pense, à Jankovic.
L'entrée de l'hôtel est située en haut d'un escalier droit, un peu raide, au bout d'un couloir orné d'azuleros. Lorsqu'il répond en français, comme une échappée involontaire, au bonjour de la femme à l'accueil, brune et charnue, tout de noir vêtue, il la voit se pencher vers une porte entrouverte pour appeler Lourenço, évidemment il comprend tout ce qu'elle dit, un Lourenço portrait de sa mère, un peu obèse, qui reprend la conversation en français, mais il répond un minimum.
On l'accompagne jusqu'à la chambre, à peine plus grande qu'une cellule. Le sommier est dur. Mais la fenêtre est là, qui s'ouvre, et les deux battants s'écartent pour un semblant de balcon qui lui donne le vertige. Les toits s'étagent en plaques disjointes. Il entend des cris de cours intérieures, d'enfants, rien d'agressif ou de malheureux, même pas la lamentation d'une mère après son fils.
Il a fait sa demande en français, comme s'il ne voulait pas tout perdre, ou passer pour un étranger, un passant, simple et inoffensif.
La douche. D'abord un bonheur, l'eau qui roule comme une pellicule douce, filant au bout des doigts, ou pisse du menton, pression maximale. Puis c'est le désordre soudain, quand il pousse la porte vitrée, de n'être vu de personne, d'être un corps seul réduit au loisir de pouvoir se regarder sans pudeur à la grande glace de l'armoire, de pied en cap, corps tout entier récupéré d'une privation de quatre ans. Il touche à un silence inhabituel. Il n'entend rien du dehors. Tout est suspendu. Il baisse le regard vers ses orteils, remonte vers les genoux, puis le sexe, le nombril, la poitrine, les épaules, les yeux enfin. Les yeux dans les yeux, essayant de deviner ce que ces yeux veulent signifier, mais ce serait jouer aux échecs alternativement les blancs et les noirs, seul, comme dans l'oubli impossible du coup précédent et adverse. Ses yeux. Savoir regarder, savoir observer, ne rien perdre.
Agnès Trégaro. Il voit son image furtive dans l'encadrement de la fenêtre, son souvenir. Elle est l'absente, le silence qui l'attendait au bout de sa détention.
08:47 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.01.2011
In vino veritas
 Alain Rey et Sophie Chantereau connaissent bien la langue et lui rendent d’incomparables services. Au point de la dispenser d’idéologie. Ils lui font dire ce qu’elle dit. Ni plus, ni moins.
Alain Rey et Sophie Chantereau connaissent bien la langue et lui rendent d’incomparables services. Au point de la dispenser d’idéologie. Ils lui font dire ce qu’elle dit. Ni plus, ni moins.Leur dictionnaire des expressions et locutions, première et deuxième édition, décrit l’origine des tournures, explique, compare, illustre et commente.
Commente ?
Donc suppute. Ah, alors peut-être, après tout, interviennent-ils, nos auteurs. Peut-être qu’ils s’interposent entre nous et le langage.
Mais j’aime beaucoup Alain Rey et Sophie Chantereau.
N’empêche…
Parfois, quand ils ne savent pas trop, ils font comme nous tous, ils terminent leurs phrases en queue de poisson, laissant l’interlocuteur sur sa soif.
C’est le cas de le dire pour les Polonais et leur légendaire ivrognerie. Ne dit-on pas, en effet, « saoul comme un Polonais » ?
C’est vrai que depuis que je vis parmi eux, j’ai vu des Polonais le soir le long des rues que le froid enveloppe, sur des trottoirs livides, qui titubaient sous le poids de la vodka ou celui de piwo.
Mais quand je vivais sous les cieux océaniques de mon pays, j’ai aussi vu pas mal de Français, à commencer par moi-même, des Allemands également, des Finlandais, des Irlandais, des Portugais et des Italiens, la démarche plutôt équivoque et le verbe sinueux.
Des Anglais aussi, beaucoup d’Anglais. Des Anglais gueulards, surtout quand ils sont loin de leurs pénates. Comme si l’ivresse, sur leur île puritaine, était inaccessible. Les Anglais adorent se saouler chez les Gaulois : « Quand t'es à Rome, fais comme les Romains ». C’est délicat.
Bref.
Donc, pourquoi les Polonais, ainsi ravalés au rang du cochon, de la grive, de l’âne, de la bourrique ou du pompier ?
Empressons-nous de consulter nos deux érudits :
« …Cette comparaison n’affecte pas le peuple de la Pologne, probablement moins buveur que les Français, bien qu’il ait partagé avec les Russes, aux XVIIIème et XIXème siècles, une réputation de brutalité dans les mœurs et de sensualité. Il doit s’agir d’une référence aux soldats polonais, mercenaires appréciés sous l’Ancien Régime (les cavaliers dits polacres ou polaques), puis après les guerres de l’Empire. »
Il y en a des choses dans ce bavardage policé !
D’abord, que viennent faire ici les Français ? S’ils sont probablement plus buveurs que les Polonais, pourquoi la conscience collective n’a-t-elle pas retenu « bourré comme un Français» ? Cette petite assertion ressemble plus à une formule de politesse courtoise, une pommade avant intromission, qu’à une explication sémantique sérieuse.
Hors sujet.
Si on veut dire à quelqu’un qu’il est con, il arrive qu’on commence par faire son autocritique, complètement hors sujet aussi, afin que le juron qui va suivre passe avec douceur.
La comparaison au service de l’euphémisme.
Ensuite, ce quoique, conjonction restrictive s’il en est et si parfaite pour semer le doute, insinuer, nuancer le propos…Les Polonais, mais pas seulement eux, les Russes, les gens de l’Est, disons les Slaves, ont eu, deux siècles durant, une réputation de barbares. Si le peuple polonais ne doit pas s’offusquer de la comparaison initiale sur l’ivrognerie, à quoi bon lui rappeler qu’il a eu une bien mauvaise renommée chez les latins, tellement raffinés, eux, comme chacun sait ?
Encore hors sujet…Une bise à droite, un coup de pied à gauche.
L’explication musarde, tarde à venir, balance, prend des précautions de chats de gouttière. S’il ne s’agissait d’aussi talentueux linguistes, on serait tenté de crier : Au fait ! Au fait !
Mais nous y voilà. Il doit s’agir des soldats mercenaires. Il doit s’agir. Comme disait Coluche « C’est même pas sûr ! ».
Bon. D’accord. Mais pourquoi ? Mystère et boule de gomme. Il doit s’agir de soldats mercenaires, polonais et appréciés. On ne voit pas trop la relation de cause à effet. Les soldats qui se saoulent sont-ils donc plus appréciés que les sobres pioupious ?
Au cœur du sujet, la lumière s’éteint.
Terminé.
Autant vous le dire tout de suite : Ma compagne polonaise, aux racines ukrainiennes, bref, une slave, en tout cas aux mœurs fort délicates, n’a apprécié qu’à demi la lecture que je lui fis de cette explication emberlificotée.
Alors elle m’a raconté. L’expression est en fait un éloge.
Napoléon ayant, je ne sais ni où ni quand, peut-être au cours de la campagne de Russie, ou alors avant une marche forcée, je l'ignore, donné quartier libre à ses troupes avant la bataille, celles-ci s’adonnèrent bien évidemment à d’outrancières libations.
A tel point qu’il fut bien difficile aux différents officiers de les remettre en ordre de marche le lendemain matin. Seules les escouades de Polonais étaient sur le pied de guerre à l’heure convenue, frais comme des gardons.
Rentrant en fort courroux, L’Empereur aurait alors lancé à ses soldats :
« Si vous voulez vous saouler, saoulez vous comme les Polonais ! »
Je vous l’ai dit.
Rien n’est plus subjectif que l’explication du langage, de ses tournures, de ses tenants comme de ses aboutissants.
06:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.01.2011
Métonymie natale

Elle désignait un coin de France, des marais et un océan, et, dans ce coin de France, vers ces marais et près de cet océan, surtout, des gens, une dizaine tout au plus, avec lesquels j’avais des liens affectifs.
Des liens ! Quel triste langage ! Je suis lié à…Je suis attaché à…Attaché ? dit le loup.
Il faut n’avoir jamais été réellement attaché, lié, pour se dire lié à ou attaché à quelqu'un qu'on prétend aimer.
Quand on a des liens et qu'on est en bonne santé, on n'a qu'une hâte : les briser.
Ma France métonymique était un long pointillé de mon histoire confuse. Un enjambement d’un vers à l’autre.
Difficile de se faire comprendre quand on emploie des métonymies sans avertir. Dire un pays pour dire « moi », ça prête terriblement à confusion quand on n’est pas Louis XIV. Il m’est arrivé dès lors de dire à un Polonais, par exemple : en France, il neige tous les quinze ans. Il me regardait avec des yeux incrédules. Lui, savait bien que la Lorraine, le Massif Central et le Mont Blanc, c’était la France.
Pas moi.
Ou alors de prétendre qu’en France on n'allait plus à la messe pour dire que je n’y avais jamais mis les pieds. Pour un peu, la métonymie devenant égocentrisme délirant, j’aurais bien pu affirmer que le baptême, ça n’existait pas chez nous-autres.
Trop penché sur mon nombril. Prisme déformant/déformé de l’exil qui réduit l’espace commun à son seul arrachement.
Mais que dire à présent ? Les émotions affectives se sont grippées, l’absence les a démolies comme de vulgaires châteaux de sable, vous savez, cette absence proverbiale dont on dit qu'elle embrase le grand et éteint le petit…
L’océan s’est éloigné en images, les marais aussi. Les images n’ont ni odeur ni rumeur. Je ne sais plus trop ce que je désigne par «La France».
La métonymie n’a plus la saveur exquise de la mémoire. Il me faut une autre figure de style.
La culture ? Les racines ?
Bien sûr. Poncifs, raccourcis, redondances du pédantisme pour dire un « je » dont on ne sait pas trop soi-même où il se trouve. Les chats ne font jamais des chiens, certes. Je serai toujours un Français. Je pense, j’écris et je parle en français. Un Français sans France. Un loup sur la plaine et qui ne sait plus quels sentiers mènent à la forêt.
Volontaire, l’exil prend tout son sens quand changent les figures de style du souvenir.
Parce qu’on ne vient pas d’un pays, en fait. On vient d’un endroit avec une valise fabriquée dans et par cet endroit.
La métonymie s’est alors faite prosopopée. Je fais parler une chose…
Il y a des échos bien sûr. Mais les échos ne réagissent que lorsqu’on parle à des parois ou à des murs.
Vient un temps où l’on se lasse.
L’écriture, là, comme en ce moment, de toutes façons, en est une, prosopopée. Elle fait parler une archéologie, un intérieur, un autre qui se tait, une émotion du monde qui n’est pas toujours tangible. Et versatile, en plus. Un écrivain qui ne parlerait que de lui - comme je suis en train de le faire mais qui le ferait mieux - aurait sans doute le prix Goncourt - ça s’est déjà vu il n'y a pas longtemps - mais est-ce que c’est vraiment ça, de la littérature ?
J'en doute. Je doute de tout.
La France est peut-être devenue littérature.
Et ces garçons de là-bas, que je lis avec bonheur, là, là et là, et plein d'autres encore, sont sans doute des exilés qui s'ignorent.
Ecrire c'est probablement être partout et nulle part chez soi.
10:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.01.2011
Zozo, chômeur éperdu : les brouillons
 François Bon vient de publier Paul Lafargue, Le droit à la paresse, ouvrage à relire si on est encore capable de se débarrasser des sédiments que l'idéologie a déposé dans nos cervelles, comme l'eau dépose dans les tuyauteries son calcaire.
François Bon vient de publier Paul Lafargue, Le droit à la paresse, ouvrage à relire si on est encore capable de se débarrasser des sédiments que l'idéologie a déposé dans nos cervelles, comme l'eau dépose dans les tuyauteries son calcaire.
De l'époque de Lafargue à la nôtre, les fondamentaux aliénants n'ont pas changé d’un pouce. Ne soyons pas, en plus d'être mal heureux, des fats imbéciles, des Priape de l'impuissance ! Nous ne faisons croire aux évolutions de nos sociétés que du point de vue de l'image et de l'apparence : le travail reste le frein le plus puissant opposé au cours joyeux de la vie et depuis le temps qu'il y a des hommes qui ont lu de Lafargue à Vaneigem, peu sont venus pour en tirer profit.
Que les politiques de toute confesssion le glorifient, ce travail, eux qui ne sont jamais allés au charbon sans leur costume, devrait nous débarrasser un peu de la merde que nous avons dans les yeux.
Bref, avec tout ça, j'ai re-pensé à Zozo...Si le texte était libre de droits, j'aurais bien proposé à François de le mettre en post-scriptum à Lafargue...
J’ai alors fouillé dans mes vieux fichiers et j'ai retrouvé les passages supprimés. Des passages que n'a jamais vus ni lus l'éditeur.
Ils sont un cheminement. Quand on écrit, comme ça, parfois on a l'impression qu'en amont quelqu'un a subrepticement fermé le robinet. On expédie une page, deux pages, puis trois dans les poubelles de la déconvenue… et on attend que le plaisir revienne ou ne revienne pas.
Joies du numérique aussi de faire que ces chantiers avortés dans l'ombre solitaire, qui n'ont pas eu droit aux yeux du public parce qu'ils n'avaient pas trouvé grâce aux yeux de leur auteur, soient remis au goût du jour.
Comme des fragments d'histoire qu'aucune mémoire ne réclamait et qui s'en seraient insurgés.
_____________
 Le sommeil de Zozo possédait, outre son caractère sacré, la régularité d’une vraie pendule astronomique. C’est dire qu’au mois de juin, à cinq heures, il était déjà à courir les chemins encore tout endormis, alors qu’à neuf heures au mois de décembre il était encore allongé dans son lit.
Le sommeil de Zozo possédait, outre son caractère sacré, la régularité d’une vraie pendule astronomique. C’est dire qu’au mois de juin, à cinq heures, il était déjà à courir les chemins encore tout endormis, alors qu’à neuf heures au mois de décembre il était encore allongé dans son lit.
Tout ça se savait, bien entendu, et on en rigolait l’été, qu’est-ce qu’un gars de même, qui n’a rien à faire de sa journée, traîne dans les chemins dès potron-jacquet, tandis qu’on en maugréait l’hiver, le traitant d’incurable feignant et de profiteur des lois.
_____________
 Zozo avait le style sensible d’un indien, en fait. Un des derniers Mohicans.
Zozo avait le style sensible d’un indien, en fait. Un des derniers Mohicans.
Un homme dont le voyage, sans qu’il en ait vraiment conscience, n’avait de plaisir que s’il collait au grand mouvement des choses de la terre, de la lune et de l’univers tout entier.
Dans sa tête chauve s’agitaient parfois de bien troublantes pensées. C’était surtout les soirées chaudes du mois d’août quand, rassasié de viandes en sauce et du pinard de la barrique, il était étendu dans l’herbe, les yeux perdus sur le peuple phosphorescent des étoiles. Quelques rudiments d’astronomie glanés de-ci de-là lui faisaient pressentir que la terre sur laquelle il était pour l’heure étendu bien à son aise, devait faire partie de cette toile céleste qu’il avait présentement devant les yeux, qui plongeait derrière les bois, tout près, et qui plongeait aussi derrière la rivière, là bas. Il lui semblait absurde qu’il fût là comme au théâtre, à l’extérieur de ce gigantesque fourmillement de clins-d’oeil.
Alors forcément, il en arrivait à penser qu’il était lui aussi en train de briller là-haut et même que peut-être, très loin dans ces hauteurs indéfinies, d’autres Zozo étendus dans l’herbe étaient en ce moment en train de contempler avec les mêmes interrogations, sa planète à lui qui se promenait au firmament.
Dans la chaude obscurité, il confiait parfois, de sa voix grasseyante, le fil de ses cogitations à ses fils étendus eux aussi dans l’herbe. Ceux-ci gloussaient alors et se poussaient du coude en se pinçant le nez, mettant ces divagations rigolotes sur le compte de du trop de vin…
Zozo se levait alors, s’époussetait, passait souhaiter bonne nuit à Pinder, lui disait un mot tendre sur les étoiles qu’un goret ne pouvait pas voir, et s’en allait dormir dans son lit.
_____________
De Raboliot, Zozo étudiait les ruses et s’essayait à son art, tendant des petits collets au lapin, des pièges à rat aux merles.
Des contes de la Bécasse, il lisait surtout le prologue dont il se pourléchait les babines se demandant si, un soir où la nuit tomberait sur les fourrés et les taillis silencieux, il aurait lui aussi la chance de descendre une bécasse.
_____________
 Juillet avait un à un égrené ses jours tout bleus sous une chaleur poussiéreuse et les premiers jours du mois d’août furent de même. Les poules baillaient du bec à longueur de journée, les lapins buvaient comme des pompiers, le jardin se desséchait et chaque soir, jusqu’à tard dans la nuit, Zozo arrosait, arrosait abondamment, soigneusement, ses légumes.
Juillet avait un à un égrené ses jours tout bleus sous une chaleur poussiéreuse et les premiers jours du mois d’août furent de même. Les poules baillaient du bec à longueur de journée, les lapins buvaient comme des pompiers, le jardin se desséchait et chaque soir, jusqu’à tard dans la nuit, Zozo arrosait, arrosait abondamment, soigneusement, ses légumes.
Allongé de tout son flasque corps, Pinder souffrait aussi et Zozo ne venait discuter le bout de gras qu’à la fraîcheur de la nuit bien tombée, inspectant avec minutie si des fois cette canicule n’était pas tout bonnement en train de lui faire fondre sa bounne graisse.
_____________
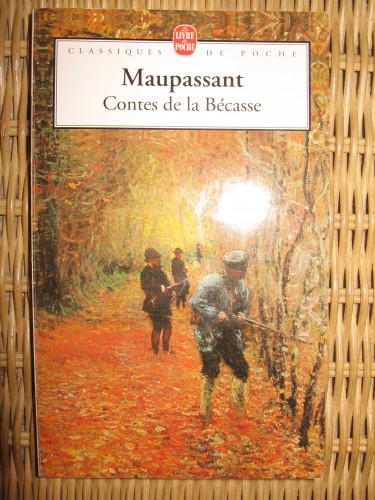 Quoi qu’il en dise et quoi qu’il n’en ait aperçu que les pieds, Zozo était hanté par le menuisier pendu à son chêne.
Quoi qu’il en dise et quoi qu’il n’en ait aperçu que les pieds, Zozo était hanté par le menuisier pendu à son chêne.
Aussi hésitait-il désormais à s’engouffrer dans les grands bois.
Il préférait fouiner les jeunes taillis, les buissons et les fourrés inextricables et éviter les futaies et les vieux bois, là où les branches des arbres sont assez solides pour supporter le poids d’un désespoir.
Longtemps il rentra de bonne heure aussi, angoissé par les pénombres incertaines du crépuscule.
Mais une fin de journée de février, alors qu’il s’était attardé à la croule, ayant ouï dire qu’il y avait un passage de bécasses, qu’il avait cru en soulever trois mais n’en avait évidemment pas tué une, trop difficile entre les branches, trop farouche pour le fusil de Zozo cet oiseau mirifique de son livre de contes, il se perdit.
Oui, aussi incroyable que cela puisse nous paraître, Zozo en quelque sorte s’égara dans son jardin.
Il était entré dans un épais taillis alors que le soleil déjà plongeait derrière le galbe légèrement brumeux des champs. Il s’était coulé comme un renard sous les jeunes noisetiers et les épines, s’était frayé un chemin dans la ronceraie, avait bifurqué à droite parce qu’il avait entendu un battement d’ailes, à gauche ensuite parce qu’il avait vu un oiseau énorme s’envoler, puis il avait filé tout droit. Ou plutôt il avait essayé d’aller tout droit parce qu’il n’y avait pas de passage bien défini dans toute cette débauche enchevêtrée et qu’il fallait donc improviser avec les quelques trouées naturellement pratiquées dans la végétation. Sans doute avait-il donc longtemps zigzagué. Enfin il avait reculé, sûr d’avoir à nouveau entendu un envol.
Alors il avait longtemps tourné en rond, courbé en deux, ne cherchant plus désormais qu’à sortir de cette pénombre encombrée des halliers.
Zozo s’était vu retenu prisonnier par un labyrinthe de broussailles. Il s’était affolé, allant en tous sens, traversant des monceaux d’épines et de genêts. Il pensait déjà à hurler au secours quand il avait débouché enfin sur un chemin inconnu, fangeux, creusé de profondes ornières et cerné par des bois inquiétants.
L’ombre maintenant était épaisse et au-dessus de Zozo se promenait la lune entre deux nuages encore roses. Loin de le rassurer cette lueur diffuse sur les arbres et les broussailles le pétrifiait. Il tenait son fusil à la hanche, comme un soldat à l’assaut, prêt à faire feu sur le moindre mouvement. Il resta là, planté et morfondu au milieu de ce chemin, ne sachant pas s’il fallait marcher à droite ou marcher à gauche. Alors il partit au hasard, oscillant douloureusement entre l’envie d’hurler à l’aide et le besoin de passer inaperçu, de se fondre totalement dans le décor obscur.
Il marchait à pas de loup, attentif à ne faire aucun bruit, la gorge serrée, le pouls en bataille, absolument paralysé par l’effroi et à l’écoute de tous les bruissements alentour. Il marcha longtemps et il désespérait de ne jamais apercevoir le bout de ce tunnel, quand soudain s’ouvrit devant lui l’étendue rassurante des champs. C’étaient des champs qu’il ne reconnut pas mais au moins, là, côtoyait-il des choses humaines, des clôtures, des platebandes de guéret, de jeunes blés en herbe. Zozo se sentit moins seul, moins perdu, comme s’il débarquait d’un monde complètement vierge des hommes. Et puis le morceau de lune accroché là-haut reflétait la froide pâleur des champs. Il devinait ainsi plus loin, à découvert : personne ne pourrait lui sauter dessus à l’improviste.
Il arpenta ces champs d’un pas moins minutieux et se retrouva aux abords d’un village qui déjà semblait s’être endormi. Des chiens aboyèrent et Zozo longea les murs, de peur d’être mordu ou surpris là avec un fusil, après la nuit largement tombée.
Il longea des jardins immobiles, traversa un chemin et reconnut, en face de lui, le vieux moulin à vent. Le Fouilloux ! Il avait donc traversé tous les bois du Fouilloux ! Il était à cinq kilomètres de chez lui, bon sang de bonsoir !
Mais il se situait enfin…Il prit la petite route goudronnée et rentra au pas cadencé, s’arrêtant pour reprendre son souffle le long des vignes, crachant, plié en deux et jurant - mais pas trop fort - que bordel de merde de bon dieu plus jamais, jamais de la vie, il ne mettrait les pieds dans ces putains de saloperies de traîtres de bois !
Aux siens inquiets et le nez collé aux carreaux à scruter la nuit, il dit qu’il avait trouvé à causer avec un gars du Fouilloux, qu’ils avaient bu un verre et mangé deux ou trois crêpes. Il avait pas vu l’heure passer, tellement ce gars était sympathique.
Mais il était blanc et, fait exceptionnel chez lui, inondé sueur.
La mésaventure l’avait terrorisé.
_____________
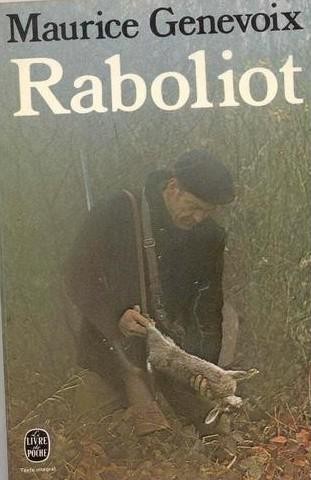 Jeté au panier, le précédent passage avait été repris en ces termes, pas plus satisfaisants sans doute, puisqu'ils avaient, eux aussi, subi les colères de la touche "suppr" :
Jeté au panier, le précédent passage avait été repris en ces termes, pas plus satisfaisants sans doute, puisqu'ils avaient, eux aussi, subi les colères de la touche "suppr" :
Madame Zozo avait fait deux énormes tartes aux poires d’hiver, mis à réchauffer le petit salé au chou, dressé le couvert et tiré le grand pichet de vin. Puis elle avait attendu, épiant au travers des carreaux, puis elle était sortie dans la cour, puis elle avait jeté un œil chez Pinder, puis elle avait appelé dans la nuit noire, puis, au comble de l’inquiétude, avait envoyé les fils alerter les voisins.
On avait maugréé, on avait bougonné que bon sang de bon sang cet insignifiant ferait mieux de rester chez lui plutôt que de galoper les chemins et d’emmerder tout le monde à l’heure de la traite des bestiaux, mais on se préparait néanmoins, torche en main, à battre la campagne tandis que de sinistres murmures rapport au pendu circulaient déjà de bouche à oreilles.
C'était idiot : s'il y avait au monde un gars qui n'avait absolument aucune envie de se suspendre à un arbre, c'était bien Zozo...
Essoufflé, titubant et, chose rarissime chez lui, inondé de sueur, Zozo fit son entrée et s’affala sur une chaise. Les quatre compères qui s’apprêtaient à partir à sa recherche, l’accueillirent avec des ah, ah, enfin, et ben alors, qu’est-ce qui se passe, nom d’un chien ? Il savait donc pas encore que c’était interdit de chasser la nuit !
Zozo offrit d’abord du vin et des bouts de galette. Pour le dérangement, précisa-t-il. Il caressa son héron, but deux grands verres et fit mine de vouloir raconter.
N’eût été la tarte aux poires bien chaude qui plaisait à tout le monde, qu’on se serait prestement défilé, parce que le vin et l’histoire, ça allait être du même tonneau, sortis des singulières alchimies de Zozo. On se prépara donc à écouter des balivernes.
Zozo dit qu’il s’était perdu en voulant poursuivre des bécasses.
C’était tout ? C’était tout.
On était presque déçu. Si c’était tout, on n'avait plus rien à faire ici et on lorgnait déjà sur la deuxième énorme tarte, dorée à souhait et qui embaumait la poire et le sucre chaud.
Perdu où, nom d’un chien ? Il connaissait tous les alentours comme sa poche à force d’y traîner ses bottes ! Il se foutait du monde ! Et on riait en engloutissant de larges morceaux de tarte et en marmonnant la bouche pleine des compliments à la cuisinière qui en bombait un torse pourtant déjà avantageusement mis en avant par la nature. Eh ben, non. Lui aussi le croyait, connaître tout des environs, mais il s’était glissé dans les fourrés, et hop, s’était retrouvé au Fouilloux !
Au Fouilloux ! s’exclama t-on d’une seule gorge. Mais comment il avait fait son compte ? Entre le Fouilloux et là, il y avait des bois, d’accord, mais aussi des champs. Zozo expliqua où il était rentré, là où commencent les bois sur le coteau des champs Ricaille, comment il avait été difficile de circuler là-dedans et comment il s’était retrouvé sur un chemin, puis dans les champs, et finalement au Fouilloux. Tout simplement.
L’imagination encore tétanisée par une longue panique, il ne lui vint pas à l’esprit de dire des choses mirobolantes qui puissent faire de sa mésaventure une aventure. Et alors que pour le pendu on ne l’avait pas cru parce qu’on était aguerri à sa manie des boniments, là, on ne le crut pas davantage parce qu’il rompait justement avec cette manie de bonimenter.
On le soupçonna dès lors de dissimuler quelque chose d’inavouable. Ce fut Louis, l’homme au verger rabougri, qui insidieusement dit qu’il était à lui, ce jeune bois, qu’il faisait pas plus de deux cent mètres de long pour une cinquantaine de mètres de large. Alors ? Alors quoi ? Qu’est-ce qu’il y avait au bout de son foutu bois de rin ? Des champs. Ah ? Et à côté. Le bois à la famille Marcireau. C’était vrai et après ? D’autres bois, mais avec des champs aussi. Non pas là. Il n’y avait plus de champs. Que de la broussaille après l’arrachage des vignes. Ah, ils voyaient bien, et de taillis en broussailles, et bien on arrivait au chemin terreux qui venait de la commune de Brux à travers bois et qui débouchait jusqu’aux champs du Fouilloux. Zozo avait fait le tour. Il avait tourné en rond. On avait peine à le croire parce que, à un moment donné, il avait forcément marché en lisière.
Pas vrai ? Sans doute, mais j’ai pas vu, tout à mes bécasses.
_____________

Les diverses tentatives de Zozo, contraint et forcé, pour participer un tant soit peu au développement général des années d'euphorie, avortaient à chaque fois, mais ces expériences douloureuses, pour brèves qu’elles fussent, ne lui prodiguaient pas moins le droit de s’occuper à ne rien faire sans être inquiété, pour de nouvelles et longues périodes.
14:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.01.2011
Barbara Miechowka et Philip Seelen : échanges sur la shoah et sur shoah
A l'attention de Barbara et de Bertrand, de la part de Philip Seelen,
A PROPOS DE MA LECTURE DU "LIEVRE DE PATAGONIE - MEMOIRES" DE CLAUDE LANZMANN.
 Il se trouve que je viens de lire ces jours-ci l'autobiographie de Claude Lanzmann, intitulée "Le lièvre de Patagonie - Mémoires" parue chez Gallimard. Dans cette prose riche et passionnante le réalisateur-producteur de Shoah raconte son rapport à la mort violente, à l'exécution physique généralisée à but politique et racial, dans l'histoire du cruel 20ème siècle.
Il se trouve que je viens de lire ces jours-ci l'autobiographie de Claude Lanzmann, intitulée "Le lièvre de Patagonie - Mémoires" parue chez Gallimard. Dans cette prose riche et passionnante le réalisateur-producteur de Shoah raconte son rapport à la mort violente, à l'exécution physique généralisée à but politique et racial, dans l'histoire du cruel 20ème siècle.
Il décrit son engagement comme lycéen et jeune adulte dans la résistance avec les jeunes communistes, le combat de son père dans la résistance comme chef départemental des Mouvements Unis pour la Résistance (gaullistes), dans la Haute-Loire. Il témoigne de la trahison, par le Parti Communiste, des accords passés, entre lui et la direction de ce même parti, pour rejoindre les maquis gaullistes, avec le groupe de combat qu'il dirigeait. Il voulait ainsi rallier les forces dirigées par Lanzmann père. Coupable d’avoir préféré la loyauté au père plutôt que celle au Parti, il est alors condamné à mort par le PCF. Des tueurs des brigades ouvrières des usines Michelin de Clermont-Ferrand sont chargés d'exécuter la sentence.
Après la Libération Lanzmann fera annuler cette sentence par la direction du "Parti des fusillés" et gardera de cet épisode une profonde blessure et méfiance à l'égard des communistes français. Il découvre Israël, découvre le Paris intellectuel et littéraire de l'après-guerre, devient l'ami de Jean-Paul Sartre et l'amant « attitré » de Simone de Beauvoir. Il entretient avec Castor une relation pour ainsi dire maritale, inaugurant cette triangulation amoureuse, devenue emblématique pour toute une génération, entre le couple Sartre- Beauvoir et le tiers-amant. Il devient journaliste, rédacteur des Temps Modernes, parcourt le monde, s'engage auprès des mouvements de la décolonisation, prend fait et cause pour le FLN pendant la guerre d'Algérie.
Il avoue sa fascination pour l'URSS malgré les avanies du PCF à son endroit, et malgré la face noire et sanglante du communisme réel. Il écrit à propos de l'URSS :
"Malgré tout ... l'Union Soviétique resta longtemps comme un ciel sur ma tête. Et sur celle de beaucoup d'hommes de ma génération. Cela tient à l'invasion allemande de 1941, aux sacrifices inouïs consentis alors par tous les peuples d'URSS, à la victoire de l'Armée Rouge à Stalingrad, qui marqua un tournant décisif dans le cours de la guerre. Nous devions à l'URSS une large part de notre libération, elle demeurait en outre dans nos esprits, et en dépit de tout, la patrie, la possibilité et le garant de l'émancipation humaine. (...) en finir avec l'utopie m'a pris du temps.
Je confesse avoir eu les larmes aux yeux à la mort de Staline, non pas à cause de la disparition du dictateur sanguinaire, qui me laissait froid, mais parce que je lus le récit de ses obsèques dans France-Soir et qu'une phrase, dans l'interminable litanie des regrets et de la déploration m'émut fortement. La voici . "Les marins militaires soviétiques inclinent leurs drapeaux de combat ..." Peut-être mon émotion est-elle due à l'allitération, peut être aux drapeaux de combat, je ne sais. Elle fut réelle et fugitive."
Extrait du "Lièvre de Patagonie - Mémoires" p.395-396. Gallimard. Paris. 2009.
Dans ses Mémoires Lanzmann s'étend longuement sur la genèse, la production, la réalisation, les projections, les sorties publiques, la diffusion mondiale de "Shoha" et ses relations avec la Pologne communiste, le parti communiste, la diffusion de son film en Pologne après la Révolution de 1989.
On y apprend comment Lanzmann mène son enquête et sa recherche d'acteurs et de témoins éparpillés à travers le Monde. Il nous fait revivre ces atmosphères des années 70 où il lui fallait à tout prix retrouver des "acteurs" encore vivants pour son film et les convaincre de témoigner. Il nous fait partager ses échecs, ses vagues d'euphories, d'accablement et sa solitude dans cette quête.
Nous découvrons sa chasse aux bourreaux nazis encore vivants et alertes, ses trésors d'imagination pour les faire parler et témoigner devant une caméra. Il nous explique l'utilisation des dernières techniques vidéo miniaturisées, permettant de piéger les nazis trop frileux pour affronter l'objectif d'une caméra, mais assez beaux parleurs pour accepter de témoigner devant un micro. Lanzmann invente en partie le document son-image obtenu grâce à une caméra cachée. C’est l’heure de gloire pour la Paluche, cette caméra miniature, invention française, utilisée par la suite par des centaines d'enquêteurs et de journalistes.
Puis c'est le long témoignage sur les derniers juifs survivants d'accord de parler devant une caméra et de revivre ainsi l'horreur. Les parcours impossibles pour retrouver les survivants des "Sonderkommandos" juifs, peu nombreux. La persuasion dont il fallait faire preuve pour les convaincre de parler devant une caméra et une équipe de cinéma. La rencontre avec Abraham Bomba, le coiffeur de Treblinka, découvert à New York dans son salon de coiffure pour messieurs dans un quartier du Bronx. Son immense témoignage littéralement arraché par Lanzmann :
"Qu'avez-vous éprouvé la première fois que vous avez vu déferler dans la chambre à gaz toutes ces femmes nues et ces enfants nus également ?" Abraham Bomba répond en esquivant: " Oh vous savez, "ressentir" là-bas ... c'était très dur de ressentir quoi que ce soit : imaginez, travailler jour et nuit parmi les morts, les cadavres, vos sentiments disparaissaient, vous étiez mort au sentiment, mort à tout."
Nous suivons sa rencontre avec le "Grand Jan Karski" aux Etats-Unis. Lanzmann nous raconte son admiration pour ce héros et le contrat d'exclusivité, moyennant rémunération, pour son témoignage passé avec le résistant polonais qui révéla aux alliés la réalité du génocide en 1943 déjà.
Lanzmann nous fait revivre le tournage des scènes polonaises à Treblinka et à Chelmno. De longs passages nous révèlent les relations entre l'équipe de tournage, la traductrice, le surveillant du Parti Communiste et plus particulièrement celles avec le conducteur de locomotive qui avait conduit les trains de la mort pendant toute la durée de l'existence du camp de Treblinka.
Henrik Gawkowski, le Cheminot polonais, engagé par les SS, habitait le bourg de Malkinia, à environ dix kilomètres de Treblinka. Lanzmann était le premier homme à l'interroger sur ces années terribles. Henrik Gawkowski ne cessa de témoigner et de répondre aux questions du réalisateur animé par un flot de paroles, visiblement soulagé d'enfin pouvoir raconter sa participation à l'organisation du terrible génocide.
Nous pouvons suivre l'esprit et la manière qui permirent la mise en place du tournage du voyage de Gawkowski et de sa locomotive à vapeur, du même modèle que celle de 1943-44, louée par Lanzmann aux chemins de fer polonais. Henrik Gawkowski se révéla alors être en vérité l'homme à tout faire des transports des suppliciés, de Varsovie, de Bialystock, de Kielce. Il conduisait les trains de la gare de Treblinka, où ils étaient divisés en tronçons de dix wagons, puis il poussait chacun de ces tronçons jusqu'à la rampe du camp et c'était la fin du voyage.
Henrik Gawkowski, lui qui n'avait plus conduit de train depuis la fin de la guerre accepta pour la mémoire des terribles événements, de remonter sur une locomotive identique à celle avec laquelle il emmenait à Treblinka les juifs déportés. Il était affolé par les supplications qu'il entendait monter des wagons derrière lui et ne parvenait à les supporter que par des triples rations, officiellement allouées, de vodka. Henrik a visiblement le corps accablé de remords, ses yeux fous, la réitération du geste mimant l'égorgement, son visage hagard et concentré de détresse donnent vie et réalité au train fantôme, tous ces signes captés par la caméra le font exister pour chacun des témoins de cette scène stupéfiante.
Shoah de l'aveu même du réalisateur est un film immaîtrisable et qu'il y a pour y entrer, mille chemins. Ce film n'est pas un film anti-polonais ou sur l'anti-sémitisme en Pologne. D'ailleurs la Pologne n'est en rien et jamais le "personnage" et le propos unique et essentiel du film. Les témoins polonais, les "acteurs" pour la plupart spontanés, volontaires et conscients de témoigner d'une histoire tragique, même avec leurs mots et leurs gestes ne sont pas des êtres manipulés de manière perverse par un agent consacrant sa vie à débusquer la figure de l'antisémitisme en Pologne.
Les attitudes, les histoires, les mots de la plupart des protagonistes polonais auxiliaires forcés ou volontaires engagés par les SS, apparaissant dans ce film, révèlent un antisémitisme historique et latent depuis des générations dans ces populations. Lanzmann ne l'invente pas, il le révèle, le met en scène, et après, que l'on soit d'accord ou pas, choqué ou convaincu par son œuvre, c'est une autre question.
Pour finir Lanzmann s'étend longuement et en détail sur ses relations tumultueuses avec le parti communiste polonais et ses dirigeants, dont Jaruzelski. La diffusion de Shoah en Pologne ainsi s'avère impossible sous le régime communiste comme sous la République qui lui a succédé. Cette histoire racontée par Lanzmann, dont nous avons sa version seule, mérite d'être un jour recoupée par une enquête journalistique, historique ou littéraire approfondie et sérieuse tant elle s'avère édifiante pour un lecteur lambda ou même avisé.
Personnellement, je ne peux réduire l'oeuvre de Lanzmann à sa seule partie tournée en Pologne. Elle représente bien plus pour la mémoire collective des Européens que nous sommes. Je peux comprendre la vision ou plutôt les visions qui traversèrent Lanzmann lors de ce tournage et de ce montage qui durèrent douze années. Sa position de progressiste, compagnon de route du communisme, admirateur mais aucunement agent actif de l'oeuvre sanguinaire du stalinisme, dans la plus pure tradition de la gauche moderniste et progressiste française et européenne de l'ouest, n'est pas source d'une interprétation falsifiée de l'histoire du génocide des juifs commis par les allemands.
Jamais, dans son film Shoah, le peuple et la nation polonaise pris dans leur entité, leur ensemble, n'apparaissent ou ne sont dépeints sous les traits de bourreaux antisémites et exterminateurs. Il appartient aux historiens et aux gens concernés de notre génération cependant de corriger les éléments qui seraient faux et contraires à la vérité historiquement établie ou encore à établir, selon les événements que l’on évoque.
Je suis ici un peu long, mais le sujet est tellement grave et implique tant de paramètres et de subjectivité qu'il me semblait important de vous faire part de ma lecture des Mémoires de Lanzmann et de mon point de vue sur son oeuvre qui n'est en rien comparable à un documentaire qui se voudrait objectif et impartial. J'ai vu Shoah en entier deux fois. A sa sortie en salle en 1986 et sur Arte en 2003. Il faut revoir Shoah. Je veux revoir Shoah. C'est enfin facile, il existe en DVD.
Je vous en reparlerai encore, mes amis, après ma prochaine "re-vision".
POUR MEMOIRE : VARSOVIE. AVRIL 1985.
La sortie de Shoah à Paris en avril 1985, déchaîna à Varsovie une terrible colère des plus hautes Autorités du régime communiste.
Le chargé d'affaires français en Pologne fut immédiatement convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Olchowski, qui au nom du gouvernement polonais tout entier et du maréchal Jaruzelski, demandait l'interdiction immédiate du film et l'interruption de sa diffusion partout dans le monde où elle était prévue.
Cette oeuvre était jugée par la dictature communiste comme perverse, anti-polonaise, visant la Pologne dans ce qu'elle avait de plus sacré.
Chaleureusement à vous, Barbara et Bertrand.
Philip Seelen
*****
Barbara à Philip Seelen
 Je viens de trouver sur le net un très long reportage d’Anna Bikont sur Lanzmann, qui a été publié en avril 1997 dans Gazeta Wyborcza à l'occasion de la sortie de Shoah en version intégrale sur la chaîne de télé polonaise Canal-Plus.
Je viens de trouver sur le net un très long reportage d’Anna Bikont sur Lanzmann, qui a été publié en avril 1997 dans Gazeta Wyborcza à l'occasion de la sortie de Shoah en version intégrale sur la chaîne de télé polonaise Canal-Plus.
En 1985 à la télévision polonaise, il y a eu une version abrégée de Shoah qui ne contenait que les scènes avec des Polonais. Cette version était soutenue par Jaruzelski contre Olszowski: bref un classique des conflits internes au sein du PC polonais dans lequel Olszowski représentait la tendance du "béton" patriotique, qui s'était déjà illustrée en 1968 avec la campagne dite "antisioniste" qui lui avait permis de placer ses fidèles sans perspectives de carrière, les postes intéressants étant en général occupés à vie dans le régime communiste, en poussant les communistes d’origine juive vers la sortie.
Lanzmann était opposé à cette version tronquée dont il dit à Bikont que c’était un « monstre » et a fini par céder contre le fait que l'intégrale a été diffusée au moins une fois dans plusieurs cinémas en Pologne. Mais enfin, le « monstre » n’est que ce que Lanzmann lui-même a choisi de mettre dans son film, dans les séquences où il présente des Polonais. Et c’était bien ce « monstre » qui a intéressé Jaruzelski. Car Jaruzelski, interrogé par Bikont, dit qu’elle lui apprend que le film dure neuf heures, mais que, même s’il avait su que le film avait d’autres contenus que ceux qu’il a vus, il aurait quand même vraisemblablement choisi de défendre la version courte présentée à la télévision polonaise. En 1985, de la part de Jaruzelski, ce n’était certainement pas un choix exempt de but politique. N’oublions pas que c’était en pleine période où le syndicat Solidarnosc était réduit à l’action clandestine par ce Jaruzelski dont Lanzmann faisait l’éloge en France en décembre 1981, au moment où il a proclamé la loi martiale en Pologne.
La confrontation entre l'article d’Anna Bikont qui interviewe Lanzmann, mais aussi beaucoup d'autre gens et votre résumé de l'autobiographie de Lanzmann montre une évidente tendance à l'auto-édification chez Lanzmann. Dans l'article de Bikont, les propos que tient Lanzmann font de lui une sorte de Dieu du jugement dernier qui met à sa droite les Juifs et à sa gauche les goys, curieusement réduits aux seuls Polonais dans le film.
L'article montre clairement que la volonté de Lanzmann était de ne parler que de Shoah et que selon lui 30 millions de Polonais (il augmente les chiffres pour les besoins du mythe, car les Polonais ne représentaient que les deux-tiers de la population de l’état polonais en 1939) étaient complices de la Shoah. Ce qui m’explique la présence de certaines séquences dans le film, notamment celle où il interviewe les habitants de Grabow, tout comme il aurait pu interviewer les habitants de n'importe quelle autre bourgade polonaise et poser les mêmes questions qui transforment en antisémites des gens extrêmement simples et sans aucune éducation. Ces gens racontent avec leurs mots de gens très simples les réalités de la vie quotidienne et de la hiérarchie sociale issue de phénomènes d'altérité culturelle pieusement entretenue dans ces bourgades par les Juifs qui n'imaginaient pas qu'un autre ordre du monde soit possible.
Selon moi, ces bourgades avaient une sorte d'organisation hiérarchique en deux tribus: celle des non-goys qui étaient maîtres et celle des goys qui étaient des employés ou des domestiques. C'est une organisation à laquelle Lanzmann ne comprend rien, car il est un juif assimilé, issu de la troisième génération des juifs assimilés en France, qui ont quitté la Biélorussie sans doute à la fin du 19éme siècle, si j'en juge par le fait que son grand-père a fait la guerre 1914-1918 en France. Et pour moi, la façon dont Lanzmann présente ces Polonais comme des spécimens exemplaires d’un antisémitisme polonais généralisé, ce n’est qu’une pure opération idéologique.
Par exemple, Lanzmann lui-même, dans cette séquence supposée illustrer de façon exemplaire l'antisémitisme polonais, n'a pas compris que, quand ces braves gens parlent du boucher qui vendait de la viande de boeuf pas chère, cela vient du fait que les morceaux de viande considérés comme impurs selon la stricte orthodoxie de l'abattage rituel n'étaient pas consommés par les juifs. Ils vendaient ces morceaux à bas prix soit aux goys soit à ceux des leurs qu'ils considéraient comme des juifs hérétiques. Il relance la question sur cette viande de boeuf pas chère sans obtenir de réponse. S’il avait interviewé des Polonais un peu éduqués, au lieu de rire comme des idiots de village, ils auraient pu lui expliquer le mystère de cette viande de boeuf pas chère et beaucoup d'autres phénomènes que seuls un regard d'ethnologue peut déchiffrer correctement.
Autre point très important. Du point de vue des Polonais, le fait que Lanzmann flatte Jan Karski en l’appelant le grand Jan Karski ne suffit pas. Car les Polonais qui connaissaient assez bien l’histoire de la résistance polonaise au moment où le film est sorti en France étaient très choqués du fait que le film n’évoque pas la mission dont la résistance polonaise avait chargé Karski. Cette mission était d’informer le gouvernement polonais en exil et tous les gouvernements alliés du fait que sur le territoire polonais, il se passait des choses inédites dans l’histoire de l’humanité, que les Juifs du ghetto de Varsovie étaient emmenés par trains à Treblinka où ils étaient exterminés dans des chambres à gaz. Rappelons qu’à l’époque, les gouvernements occidentaux considéraient que les informations envoyées de Pologne par dépêches cryptées n’étaient que de la propagande d’agités. Pour se préparer à sa mission, Karski s’est introduit dans le ghetto de Varsovie, puis il s’est introduit, ce qui était autrement plus périlleux que de s’introduire dans le ghetto de Varsovie par des souterrains, dans une sorte de camp de regroupement où arrivaient des trains qui venaient de diverses régions de Pologne et à partir duquel les Juifs montaient dans les wagons qui arrivaient directement à Treblinka. A Londres, Karski a eu un entretien avec Churchill, puis le gouvernement polonais de Londres a envoyé Karski à Washington, où il a été reçu par beaucoup de gens, dont Roosevelt en personne.
Tout cela, le film n’en dit rien. Et moi-même à l’époque où je l’ai vu, comme je ne connaissais pas la figure de Karski, j’avais compris qu’un monsieur x, courrier entre Varsovie et Londres comme tant d’autres, avait vu le ghetto de Varsovie. Rien de spécial, en somme : une affaire purement polonaise ! Pour les gens de la génération de mes parents qui avaient vu le film en entier à Paris, c’était une censure de l’information faite consciemment et une censure tellement grave que Jerzy Giedroyc, le rédacteur en chef des deux très grandes revues de l’émigration politique polonaise, Kultura et Zeszyty Historyczne, a demandé à Karski de s’expliquer de ce témoignage tronqué. D’après le résumé qu’on m’a fait de cet article, Karski n’était pas content que Lanzmann coupe la partie de son témoignage où il racontait la visite chez Roosevelt, mais que, en dernier ressort, il avait considéré qu’il devait malgré tout accepter de témoigner de ce qu’il avait vu et entendu dans le ghetto de Varsovie.
Dans l'article de Bikont, où elle lui demande pourquoi il a choisi que le spectateur de son film ne sache pas que la résistance polonaise s’était diablement battue contre l’incrédulité des occidentaux face aux multiples informations transmises, Lanzmann se défend de cette coupure avec des arguments qui ressemblent étrangement à une improvisation dont le but est de désamorcer une question gênante : selon Lanzmann, Karski lui-même parlait de son entretien avec Roosevelt comme d’une anecdote sans importance….. Est-ce une explication crédible pour qui connait un peu l’histoire de la résistance polonaise ?
Enfin, dans cet article de Bikont, j’apprends que Lanzmann accusait Wajda d'être antisémite dans les films "La terre de la grande promesse" et "Korczak" et qu’il est à l'origine de cette cabale qui a été conduite en France contre "Korczak". Pourquoi la cabale contre « Korczak »? Parce que selon Lanzman, seul un Juif a le droit de faire des films sur l'holocauste.
Je passe sur le fait que j’apprends dans l'article de Bikont que Lanzmann a publié en France vers 1985 , dans une revue de psychanalyse un article sur sa traductrice polonaise sous le titre "L'amour de la haine". Au début, Lanzmann a voulu une traductrice juive, mais celle qu'il avait trouvée n'étant pas à la hauteur de la tâche, il s'est rabattu, en désespoir de cause, vers une traductrice polonaise. Or cette traductrice dit que si elle a tempéré le péjoratif "Zydek" en "Zyd" quand il sortait dans la bouche des Polonais, elle a beaucoup plus souvent tempéré des questions de Lanzmann qui étaient extrêmement agressives et méprisantes pour ses interlocuteurs polonais.
*****
A Barbara de la part de Philip Seelen
Il est 1h30 du matin ce samedi, je viens de lire votre dernière correspondance, je crois qu'il serait vraiment intéressant de comparer les points soulevés dans l'article de Bikont avec les mêmes points soulevés par Lanzmann dans ses "Mémoires".
La diffusion à la télé polonaise et à Canal plus Pologne, ses relations avec Jaruzelski, les versions de Shoah raccourcies, la question de la traductrice juive et de la traductrice catholique, les relations entretenues par Lanzmann et son équipe avec les gens de Chelmno, la version du réalisateur sur ses rapports avec Karski, et son jugement sur "La terre de la grande promesse" de Wajda.
Je publierai ce commentaire plus tard dans le courant de cette journée de samedi.
Bonne fin de nuit. Philip Seelen.
*****
Barbara à Philip,
 Dans l'article de Bikont, il y a également des faits dont Lanzmann ne parle pas, dans le même paragraphe que celui où elle donne le témoignage de la traductrice.
Dans l'article de Bikont, il y a également des faits dont Lanzmann ne parle pas, dans le même paragraphe que celui où elle donne le témoignage de la traductrice.
Dans ce paragraphe, Karski dit : "Les parties les plus importantes de mon témoignage ont été sacrifiées au nom de la "construction rigoureuse" du film". Notons que les guillemets sont mis par Karski lui-même.
Toujours dans ce paragraphe Bikont cite Gawkowski, le fameux machiniste auquel Lanzmann attribue une posture d'éternel repentant dans son autobiographie. Gawkowski en voulait à Lanzmann d'avoir coupé cette partie de son témoignage où il racontait comment des Polonais ont aidé des Juifs qui se sont sauvés du train de Treblinka, les ont nourris et les ont aidés à passer de l'autre côté du Bug.
Des informations données par la traductrice, il m’apparaît que Lanzmann a manipulé Gawkowski, et bien d’autres témoins polonais de première importance pour le propos du film, car il leur avait promis qu’il les inviterait à la première de son film à Paris. Etait-ce le prix pour le faire monter dans une locomotive 35 ans plus tard et lui faire faire de façon obsédante des signes muets de gorge qu’on coupe, dont l’ambigüité est lourde de conséquences dans la façon dont le spectateur français comprend la séquence ? Personnellement, je trouve que Lanzmann a eu bien de la chance que personne en Pologne n’ait eu l’idée de lui faire un procès pour ces images. Car cet homme, à son insu, sert d’acteur dans une séquence de fiction et ne semble pas avoir été payé pour son travail. Or son image a servi d’affiche au film, elle est sur la pochette du DVD commercialisé en version intégrale, sert de couverture à l’édition Folio des dialogues et sert de preuve dans des commentaires particulièrement injustes envers les Polonais.
La traductrice raconte également que Simon Srebnik, l’homme que Lanzmann a ramené d'Israël à Chelmno et avec lequel s'ouvre le film, a eu la vie sauve parce qu'un paysan l'a trouvé dans un champ avec une balle dans la tête. Srebnik a demandé en vain à Lanzmann d'aller à Lodz pour essayer d’y retrouver la fille du paysan qui lui avait sauvé la vie.
Passons maintenant à un autre paragraphe où il est question de Wladyslaw Bartoszewski, ancien prisonnier d'Auschwitz et un des grands catholiques fondateurs de Zegota (Commission d’aide aux Juifs, financée par le gouvernement polonais de Londres). Lanzmann, à qui, à l'Intstitut des études polono-juives d'Oxford, on a demandé pourquoi on ne voyait pas Bartoszewski dans son film, a répondu qu'il avait vu Bartoszewski, mais que celui-ci s'est révélé "passer insuffisamment l'écran", alors que pour lui les critères artistiques étaient primordiaux.
Bartoszewski, interviewé par Bikont, dit que Lanzman l'a rencontré, lui a demandé s'il avait été témoin des l'exécution des Juifs. Réponse négative de Bartoszewski, à quoi Lanzman réplique : "Dans ce cas, nous n'avons rien à nous dire".
Autant dire que les catholiques ne l'intéressaient que comme figures de coupables de l'extermination des Juifs et qu'il a fait passer sa thèse en se servant des paysans polonais, dont il charge la barque, par le moyen de la séquence au sortir de l'église de Chelmno, même si un des interviewés qui fait figure d'"intellectuel catholique" de service, qui, lui, passe très bien l'écran pour les besoins de la démonstration, a ce petit échange avec Lanzman dans Shoah:
Lanzman : Donc il pense que les Juifs ont expié pour la mort du Christ?
Traductrice : Il... Il ne croit pas, et même il ne pense pas que Christ veuille se venger
Je pense que c'est ce tout petit détail dans cette très longue séquence qui m'a mis dans une telle fureur que je suis sortie du cinéma avant la fin de la séance, en pensant: "OK, je crois que ce n'est pas la peine d'attendre la fin de la séance pour sortir. J'ai compris le message: les Polonais sont coupables de l'extermination des Juifs. Merci Monsieur Lanzmann pour vos explications!". Le pauvre homme essayait ensuite d’expliquer, avec ses références religieuses, que, selon lui, le responsable de la mort du Christ est Pilate, mais comme il s’emmêlait dans ses explications, le pouvoir de l’image et les embarras de la traductrice ont pour effet d’occulter le sens de ce que cet homme disait. Je pense que Lanzmann savait très bien que le sens exact de ce que disait cet homme importait peu, puisqu’il avait orienté l’esprit du spectateur par sa question et que, coup de chance, les longues explications du « théologien catholique » de service devenaient confuses. Il a gardé cette séquence pour désigner du doigt un classique de l’histoire de l’antijudaïsme de l’Eglise catholique, quand bien même le contenu de ce que disait le bonhomme ne reproduisait pas le topos.
En somme, Lanzmann se servait des paysans polonais parqués de l'autre côté du rideau de fer et filmait une sorte de réserve d’Indiens très exotique pour servir une thèse qui permet de cultiver le cliché "Polonais = catholique, donc antisémite". Il aurait eu plus de difficultés à jouer à ce jeu d’accusations simplistes, s’il avait fait une traduction du manifeste de Zofia Kossak, la fondatrice de Zegota, qui, elle, était beaucoup plus rompue à l’exercice du maniement du raisonnement religieux, tel que pouvait le faire en 1942 un nationaliste polonais catholique, qui, avant 1939, était hostile aux Juifs et le rappelle dans le manifeste.
Désolée, cher Philip, de devoir tempérer votre confiance dans le propos de Lanzmann. J
e pense que nous arriverons à clarifier les raisons de ces divergences par la suite.
*****
Bertrand à Barbara et Philip
Voilà bien des précisons utiles et conséquentes.
Barbara, je partage votre point de vue quant à Lanzmann, aux moyens utilisés et aux buts poursuivis, indignes d'un artiste à moins qu'il ne se propose de falsifier son propos, ce qui l'exclut du domaine de l'art.
Je me souviens aussi de Télérama présentant cette photo lors de la diffusion de Shoah avec un commentaire on ne peut plus ambigu.
Je note simplement une phrase, Philip : « Lanzmann, admirateur de l’œuvre sanguinaire de Staline quoique pas membre actif.." ? ? ? ? ?
Mais, Philip, il en va de même de tous les communistes qui, longtemps après la mort du psychopathe du Kremlin, ont écrasé le monde de leur botte au service du « prolétariat. »
Amitié à tous les deux
Bertrand
*****
A l'attention de Barbara, de la part de Philip Seelen,
J'amène ici comme matériaux de débat, un certain nombre d'éléments de l'autobiographie de Lanzmann se rapportant à la création du film, à sa diffusion en Pologne, et aux réactions qu'il a suscitées.
LA GENESE DU FILM SHOAH PAR LANZMANN. (Le Lièvre de Patagonie - Mémoires)
 Début 1973, Lanzmann est à Tel-Aviv dans le bureau du directeur de département au Ministère des Affaires étrangères israélien, Alouf Hareven. Le directeur tient les propos suivants au cinéaste qui vient de promouvoir son film : "Pourquoi Israël".
Début 1973, Lanzmann est à Tel-Aviv dans le bureau du directeur de département au Ministère des Affaires étrangères israélien, Alouf Hareven. Le directeur tient les propos suivants au cinéaste qui vient de promouvoir son film : "Pourquoi Israël".
"Il n'y a pas de film sur la Shoah, pas un film qui embrasse l'événement dans sa totalité et sa magnitude, pas un film qui le donne à voir de notre point de vue, du point de vue des juifs. Il ne s'agit pas de réaliser un film SUR la Shoah, mais un film qui SOIT la Shoah.
Nous pensons que toi seul est capable de le faire. Réfléchis. Nous connaissons toutes les difficultés que tu as rencontrées pour mener à bien "Pourquoi Israël". Si tu acceptes, nous t'aiderons autant que nous le pourrons." (Mémoires p.429)
Lanzmann nous fait part alors de ses profondes réflexions suite à cette proposition. Comment réagir à cette idée qu'il admet ne pas être de lui. En même temps il doute de ses capacités à réaliser un tel monument de cinéma.
"En même temps, je m'interrogeais, me demandant ce que je savais de la Shoah. Rien en vérité, mon savoir était nul, rien d'autre qu'un résultat, un chiffre abstrait : six millions des nôtres avaient été assassinés.
Mais comme la plupart des juifs de ma génération, je croyais en posséder la connaissance innée, l'avoir dans le sang, ce qui dispensait de l'effort d'apprendre, du tête-à-tête sans échappatoire avec la plus effrayante réalité." (Mémoires p.430)
Puis Lanzmann nous décrit longuement sa découverte de la Shoah, à travers l'oeuvre majeure de Raoul Hilberg, "La Destruction des Juifs d'Europe" et la fréquentation assidue de la bibliothèque Yad Vashem dont la plupart des animateurs étaient des survivants du génocide. Il nous décrit ses essais, ses erreurs dans l'écriture du film. La Guerre de Kippour d'octobre 1973 entraîne une diminution drastique de l'aide de l'Etat israélien, et il se retrouve quasiment seul à assumer la complexité de la production de Shoah.
Le cinéaste passe des jours et des heures avec des survivants, des rescapés. Il écoute, il interroge. "J'apprendrais plus tard qu'il faut déjà posséder un grand savoir pour être capable d'interroger, je n'en savais alors vraiment pas assez." (p.437) Il recueille rapidement et avec une certaine aisance les témoignages sur les arrestations, les rafles, le piège, le "transport", la promiscuité, la puanteur, la soif, la faim, la tromperie, la violence, la sélection à l'arrivée du camp.
Cependant il lui manquait l'essentiel :
" Les chambres à gaz, la mort dans les chambres à gaz, dont personne n'était jamais revenu pour en donner la relation. Le jour où je le compris, je sus que le sujet de mon film serait la mort même, la mort et non pas la survie, la contradiction radicale puisqu'elle attestait en un sens de l'impossibilité de l'entreprise dans laquelle je me lançais, les morts ne pouvant pas parler pour les morts. (Mémoires p.437)
"Mais ce fut aussi une illumination d'une puissance telle que je sus aussitôt, lorsque cette évidence s'imposa à moi, que j'irais jusqu'au bout, que rien ne me ferait abandonner. Mon film devrait relever le défi ultime : remplacer les images inexistantes de la mort dans les chambres à gaz." (Mémoires.p.437)
Il était donc clair pour Lanzmann que les protagonistes juifs de son film devaient être, soit des membres survivants des Sonderkommandos (commandos spéciaux), qui avaient été, avec les tueurs, les seuls témoins de la mort de leur peuple, soit des hommes ayant passé un long temps dans les camps, et qui avaient fini par y occuper des positions centrales, les rendant particulièrement aptes à décrire, dans le plus grand détail, le fonctionnement de la machinerie de mort.
Lanzmann choisit alors de ne jamais montrer dans Shoah des archives, des photos ou des images tournées à la libération des camps encore en fonction à l'arrivée des troupes alliées et des troupes russes. Il s'interdit rigoureusement de raconter, de témoigner des histoires individuelles. Pour lui les vivants, les survivants, les revenants doivent s'effacer devant les morts, pour s'en faire les porte-parole. Dans son film, il n'y aura pas de "JE", de témoignage de soit, de témoignage d'un parcours de vie, d'un destin individuel.
Tout le film doit avoir une forme rigoureuse qui doit dire le sort du peuple tout entier et que ses hérauts, oublieux d'eux-mêmes s'expriment naturellement au nom de tous, considérant comme dépourvue d'intérêt, pauvrement anecdotique la question de leur survie. Ils auraient dû mourir eux aussi. Lanzmann les considèrent alors comme des "revenants" plutôt que comme des survivants.
Faire témoigner les bourreaux va être une entreprise presque impossible. Il s'agit d'abord pour le réalisateur et son équipe de retrouver les tueurs dans l'Allemagne de l'Ouest des années 70, il trouvera un certain appui parmi les Autorités judiciaires allemandes chargées de la recherche et du jugement des criminels de guerre. Il obtiendra des adresses qui s'avéreront toutes périmées. Lanzmann se transformera alors en chasseur de nazis. La traque et le tournage dureront plusieurs années.
Convaincre les tueurs de témoigner devant une caméra va ainsi s'avérer être une entreprise hasardeuse et de longue haleine. Sur les six bourreaux qui témoignent dans le montage final, trois témoignent volontairement face à l'équipe de tournage et à la caméra. Les trois autres sont filmés et enregistrés à leur insu avec une caméra cachée.
LA PLACE DE LA POLOGNE DANS SHOAH VUE PAR LANZMANN
A ce stade de l'écriture du film, il n'est pas question pour le cinéaste d'aller tourner en Pologne. Un refus profond lui interdisait d'entreprendre ce voyage. Il pensait qu'il n'y aurait là-bas rien à voir, rien à apprendre, et que si la Shoah existait quelque part, c'était dans les consciences et les mémoires, celles des survivants, celles des tueurs, et qu'on pouvait en parler aussi bien de Jérusalem que de Berlin, de Paris, de New York, d'Australie ou d'Amérique du Sud.
C'est en travaillant avec Simon Srebnik et Michael Podchlebnick les deux survivants de Chelmno, où 400'000 juifs furent assassinés par l'oxyde de carbone des moteurs des camions que Lanzmann commença à changer d'avis sur la nécessité d'un voyage en Pologne pour y mener l'enquête sur les lieux du crime des Allemands. Il manquait de la connaissance objective des lieux pour interviewer Srebnik. Ce dernier avait été déporté à l'âge de 14 ans avec sa mère à Chelmno. Elle fut gazée à son arrivée et lui avait été exécuté d'une balle dans la nuque dans la nuit du 18 janvier 1945, deux jours avant l'Arrivée de l'Armée soviétique. La balle, par miracle, n'avait pas touché les centres vitaux, il survécut.
L'obligation du voyage en Pologne s'imposait de plus en plus à l'esprit de Lanzmann. Il lui semblait impossible de comprendre Srebnik et de se faire comprendre de lui sans avoir vu Chelmno. En effet les bribes qu'il recueillait avec Srebnik étaient les souvenirs fragmentés d'un monde éclaté, à la fois dans la réalité et par la terreur qu'il lui avait inspirée. Le premier voyage ne permit pas de trouver une solution au blocage dans l'écriture. Mais de découvrir les lieux du supplice, le décor de l'horreur permet à Lanzmann de trouver un langage commun avec Srebnik.
C'est alors au cours de cette conversation, en Israël, à son retour de Chelmno et des échanges que permettaient les dessins des lieux que Srebnik lui livra l'histoire de la barque, du garde SS et du chant sur la rivière Ner. Lanzmann lui demanda aussitôt de chanter comme il le faisait alors et sa voix mélodieuse interpréta pour Lanzmann le chant qu'elle interprétait pour le bourreau SS. C'est à cet instant que le cinéaste nous dit avoir compris, avoir su que l'homme qui chantait là reviendrait avec lui à Chelmno, qu'il le filmerait chantant sur la rivière Ner et que ce serait là l'ouverture, la séquence inaugurale de son film.
Je stoppe ici ces notes de lectures sur la genèse et l'écriture de Shoah par Lanzmann et je livrerai mes commentaires les concernant après avoir rédigé la deuxième partie de mes notes de lectures sur les péripéties des relations entre Lanzmann et tous ses interlocuteurs polonais.
Tout de suite la suite.
Bien à vous, Barbara. Philip Seelen
*****
A l'attention de Barbara de la part de Philip Seelen

SUITE :
MES NOTES DE LECTURE DES MEMOIRES DE CLAUDE LANZMANN : "LE LIEVRE DE PATAGONIE".
Voici la suite de mes notes de lecture du chapitre XX au sujet des relations du cinéaste français avec la Pologne, son histoire, son peuple et ses contemporains, au cours du tournage de Shoah en Pologne et des péripéties de sa diffusion.
Mes notes sont prises en relation, entre autres, avec le compte rendu par Barbara de l'article d’ Anna Bikont paru en 1997 dans Gazeta Wyborcza, à l'occasion de la diffusion de Shoah en version intégrale sur Canal Plus Pologne.
1978, LES PREMIERS TOURNAGES EN POLOGNE
"""Ainsi je ne voulais pas aller en Pologne. J'y débarquai plein d'arrogance, sûr que je consentais à ce voyage pour vérifier que je pouvais m'en passer et de revenir rapidement à mes anciens tricots. En vérité, j'étais arrivé là-bas chargé à bloc, bondé du savoir accumulé au cours des quatre années de lectures, d'enquêtes, de tournage (...) j'étais une bombe, mais une bombe inoffensive : le détonateur manquait. Treblinka fut la mise à feu. (...)
(...) Treblinka devint vrai, le passage du mythe au réel s'opéra en un fulgurant éclair, la rencontre d'un nom et d'un lieu fit de mon savoir table rase, me contraignant à tout reprendre à zéro, à envisager d'une façon radicalement autre ce qui m'avait occupé jusque-là, à bousculer ce qui m'était apparu le plus certain et par-dessus tout à assigner à la Pologne, centre géographique de l'extermination, la place qui lui revenait, primordiale.
Treblinka devint si vrai qu'il ne souffrit plus d'attendre, une urgence extrême, sous laquelle je ne cesserais désormais de vivre, s'empara de moi, il fallait tourner, tourner au plus tôt, j'en reçus, ce jour là le mandat. """ (Mémoires, p.492-493)
Lanzmann raconte alors sa découverte de Treblinka et des villages alentours. "Mais de juillet 1942 à août 1943, pendant toute la durée de l'activité du camp de Treblinka, alors que 600'000 juifs y étaient assassinés, ces villages existaient !" (p.491) Le cinéaste se livre à un décompte du temps implacable : " (...) un homme de soixante ans en 1978 en avait vingt-quatre en 1942 et qu'un autre de soixante-dix était alors dans la force de l'âge. Un gamin de quinze ans atteignait aujourd'hui la cinquantaine."
"Il y avait là pour moi une découverte bouleversante, comme un scandale logique : je l'ai dit, la terreur et l'horreur que la Shoah m'inspirait m'avaient fait rejeter l'événement hors de la durée humaine, en un autre temps que le mien, et je prenais tout à coup conscience que ces paysans de la Pologne profonde en avaient été au plus proche les contemporains." (p.491)
"Treblinka existait ! Un village nommé Treblinka existait. Osait exister. Cela me semblait impossible, cela ne se pouvait. J'avais beau avoir voulu tout savoir, tout apprendre de ce qui s'était passé ici, n'avoir jamais douté de l'existence de Treblinka, la malédiction pour moi attachée à ce nom portait en même temps sur lui un interdit absolu, d'ordre quasi ontologique, et je m'apercevais que je l'avais relégué sur le versant du mythe ou de la légende. La confrontation entre la persévérance dans l'être de ce village maudit, têtue comme les millénaires, entre sa plate réalité d'aujourd'hui et sa signification effrayante dans la mémoire des hommes ne pouvait être qu'explosive." (p.491-492)
Lanzmann s'indigne, observe, déduit. La proximité des habitants avec le camp d'extermination le subjugue. Comment vivre avec les odeurs pestilentielles de la putréfaction des corps suppliciés et de l'incinération dans des fosses en plein air des corps extraits des chambres à gaz, comment vivre, aimer, faire l'amour, manger dormir avec ces odeurs monstrueuses ?
"Le voyage en Pologne m'apparaissait au premier chef comme un voyage dans le temps (...) le 19ème siècle existait là-bas, on pouvait le toucher. Permanence et défiguration des lieux se jouxtaient, se combattaient, s'engrossaient l'une l'autre, ciselant la présence de ce qui subsistait d'hier d'une façon peut-être plus aiguë et déchirante. L'urgence soudain me pressait incroyablement. Comme si je voulais rattraper toutes ces années perdues, ces années sans Pologne." (Mémoires, p.494)
Découverte des lieux du crime allemand, découverte des habitants polonais, découverte des manigances, des trafics et des complicités en tout genre pour s'approprier les biens et les richesses des juifs, découverte de vérités inimaginables. Les trains, les locomotives, les wagons, les voies, les aiguillages, les cheminots, les aiguilleurs, les rampes, les charniers, les stèles, l'approvisionnement des SS, des tueurs et de leurs auxiliaires par les paysans du coin. L'enrichissement d'une partie de la population locale grâce à la présence de l'économie et de l'usine à produire la mort.
Pour les autorisations de tournage en Pologne communiste Lanzmann s'adressa à Varsovie aux autorités concernées. Il rédigea un mémorandum dans lequel il exposa ses intentions, les lieux, le temps de tournage. """(...) il commençait ainsi : " La Pologne est le seul pays où l'on peut voir sur les routes des pancartes fléchées indiquant : "Obuz zaglady", ce qui signifie "camp d'extermination". Bref mon film serait à la gloire de la Pologne et ferait justice des mauvaises images et des préjugés anti-polonais. Je mentis quand il le fallait, comme il le fallait.""" (p.499)
" Je fus autorisé à tourner en Pologne, sous surveillance : une sorte de délégué espion du ministère de la Sécurité intérieure assistait à tout. Au début tout au moins car il se découragea assez vite, supportant mal les fatigues du tournage (...)" (p.500) Lanzmann le corrompt avec de l'alcool.
LE PROBLEME DES INTERPRETES
Marina Ochab, la première interprète était la fille d'Edward Ochab, ancien Président du Conseil d'Etat au temps de Gomulka chassé des hautes sphères du pouvoir communiste lors des purges de 1968. De mère juive elle était noiraude aux yeux très noirs, "" (...) et à l'instar de ma mère (c'est Lanzmann qui écrit) son nez la désignait immanquablement comme juive". (p.489) Marina était ignorante du sort des trois millions de Juifs polonais, elle ne connaissait pas Treblinka, Chelmno, Sobibor, Belzec, les hauts lieux de la mort juive en Pologne, ni même Auschwitz et les campagnes adjacentes à tous ces lieux. Elle ne connaissait que le sort des "victimes du fascisme", "catégorie très prisée dans le monde communiste" pour désigner toutes les victimes des camps nazis.
Marina était un obstacle dans ce que Lanzmann appelle la "recherche du vrai" en Pologne. " Je lui exposai avec une brutale franchise que son beau visage était trop sémite pour que les Polonais parlassent librement devant elle. Elle acquiesça. Je la remplaçais par Barbara Janicka, de vraie souche catholique, merveilleuse interprète qui me posa pourtant d'autres problèmes." (Mémoires. p.500)
A plusieurs reprises la nouvelle interprète voudra quitter le tournage, trop au fait sur les intentions réelles du cinéaste. Janicka doit rendre des comptes et elle ne saurait mentir à ses patrons de l'Autorité de surveillance polonaise. Lanzmann réussit à chaque fois à la retenir, plaidant la pureté de ses intentions.
Pour continuer, tout en apaisant les tourments de sa conscience, """elle prit le parti de tout adoucir, autant la droiture de mes questions que la violence, quelque fois incroyable, qui s'exprimait dans les réponses polonaises. Lorqu'ils parlaient des juifs, les Polonais disaient presque toujours "Jydki", à connotation péjorative, qui signifie à peu près "petit youpin". Elle traduisait par "juif", qui se dit "Jydzi" et qui n'était quasiment jamais utilisé.""" (p.500)
Puis Lanzmann la prit plusieurs fois (...) "...en flagrant délit d'édulcoration. Alors elle ne trichait plus et se laissait elle-même emporter par la violence de l'exactitude avec une sorte de joie mauvaise qui semblait affecter chacun des propos qu'elle traduisait d'un " Tu l'as voulu, eh bien voici !", y ajoutant comme un coefficient d'adhésion personnelle." (p.501)
LE CONTRAT AVEC KARSKI
Lanzmann nous parle longuement de ses rapports avec Karski. " J'avais accepté ce que Karski me demandait : selon la coutume américaine, il voulait être payé. Nous signâmes donc un contrat aux termes duquel il s'engageait à ne paraître dans aucun film (ni aucune émission de télévision) tant que mon film ne serait pas sorti. Il avait en revanche le droit de délivrer autant d'interviews orales qu'il le souhaiterait, d'écrire tous les articles ou livres dont il aurait le désir." (Mémoires. p.511)
Mais le tournage et le montage s'avéraient nettement plus longs que ne l'avait prévu le cinéaste. Karski ne comprenait pas pourquoi il s'était soumis à un contrat léonin, sans échéance précise. Lanzmann sut se montrer convainquant pour faire patienter ce témoin unique de l'histoire de la Shoah en Pologne. La tension entre les deux hommes alla en s'intensifiant. Mais la première projection à laquelle Karski assista à Washington, l'enthousiasma au point de ne cesser d'écrite à Lanzmann pour battre sa coulpe.
Karski fut un des plus fidèle supporter du film et de Lanzmann, les deux hommes passèrent 3 jours inoubliables à Jérusalem pour la première du film en Israël.
LES REACTIONS POLONAISES A LA SORTIE DU FILM
"Je n'avais jamais considéré Shoah comme un film anti-polonais, il y avait parmi les paysans protagonistes du film, des hommes que j'aimais et respectais, même si d'autres étaient de franches crapules. Quant à l'anti-sémitisme polonais, je ne l'avais pas inventé, les paroles proférées par certains villageois de Treblinka ou de Chelmno avaient de quoi faire frémir, mais je ne les avais pas sollicitées, ils s'exprimaient avec le plus grand naturel et j'avais beaucoup de mal à croire ce que j'entendais." (Mémoires,p.513)
Dès les premières projections Lanzmann doit faire face aux critiques qui admiraient son film, mais dans le même temps lui reprochaient d'être injuste envers les Polonais, de na pas montrer tout ce qu'ils avaient fait pour sauver les juifs. Dans le même temps le réalisateur est contacté par Lew Rywin directeur de l'Agence Pol Tel qui se porte acquéreur pour les droits de Shoah en Pologne. Mais il désire visionner le film et demande une copie video qui lui est envoyée par Lanzmann. Lew Rywin rappela le cinéaste français et lui fixa un rendez-vous confidentiel à Paris.
L'homme se présente comme le représentant personnel de Jaruzelski et se dit en son nom en mission officielle-officieuse. Il annonce à Lanzmann que la plupart des dirigeants communistes polonais sont violemment contre le film et exigent une enquête pour découvrir les complicités polonaises qui ont permis le tournage en Pologne même d'un film portant atteinte à l'honneur de toute la nation. Seul parmi les responsables, Jaruzelski soutient le film. "Il n'a pas vu le film dans sa totalité, mais lui a consacré plusieurs heures de la plus sérieuse attention . "Shoah ne ment pas, dit le général, c'est un miroir promené sur les routes de Pologne et il réfléchit la vérité." (Mémoires, p.517). L'agent spécial du général explique à Lanzmann le fin du fin des luttes de pouvoir entre communistes en Pologne et lui suggère d'attendre la réunion du comité central qui doit se tenir en octobre, et qui doit décider qui de Jaruzelski ou d' Olchowski devait sortir vainqueur du bras de fer en cours.
Lew Rywin avait préparé une version écourtée de Shoah, qu'il avait fait monter à Varsovie par ses propres soins, à partir des cassettes video fournies par Lanzmann, en prévision de la diffusion à la Télévision polonaise. Bien sûr ce montage trahissait complètement le film de Lanzmann et celui-ci furieux interdit tout usage public de ce montage ridicule.
Deux mois plus tard, Jerzy Urban, porte parole du gouvernement polonais tenait une conférence de presse pour annoncer qu'un accord avait été trouvé avec Lanzmann et que le film allait être diffusé à la Télévision. La proposition du gouvernement de Jaruzelski était la suivante : " Shoah serait projeté intégralement dans deux salles de la périphérie varsovienne. En échange de quoi, j'autoriserais la diffusion du film de Lew Rywin à la télévision polonaise, pour une date à discuter." (Mémoires,p519). Mis publiquement devant le fait accompli, lassé par toutes ces manoeuvres, ne possédant ni les moyens financiers, ni les outils légaux et juridiques pour s'opposer à cette manoeuvre, Lanzmann baisse les bras, ne donne aucune réponse et laisse la partie polonaise agir comme elle l'entend.
C'est le même Lew Rywin, qui en 1997, devenu directeur de Canal Plus Pologne, et co-producteur de "La Liste de Schindler" de Spielberg, négocia à Paris avec Lanzmann les droits pour une diffusion intégrale.
Barbara, je m'arrête ici, je ferai plus tard une note sur le jugement de Lanzmann abrupt et inexpliqué, mais justifié par le cinéaste français avec une anecdote sur le tournage de Shoah, impliquant le maire de Chelmno, jugement qui condamne l'antisémitisme qu'exprimeraient certaines scènes de "La terre de la grande promesse" de Wajda.
Mes réflexions sur ma lecture des mémoires de Lanzmann, sur Shoah et sur les questions que vous soulevez vont suivre. Bien à vous.
Philip Seelen
******
A Barbara et A Bertrand, de la part de Philip Seelen
A PROPOS DE SHOAH : MES CERTITUDES ET MON QUESTIONNEMENT.
Avons-nous vu, tous les trois, le même film ?
Telle est la question que je me pose en relisant nos échanges depuis qu'à leur début j'ai évoqué les scènes de Shoah avec les paysans  Polonais de Grabow, Chelmno, Treblinka et que la scène avec le mécanicien de locomotive a été évoquée alors par Bertrand, puis par Barbara.
Polonais de Grabow, Chelmno, Treblinka et que la scène avec le mécanicien de locomotive a été évoquée alors par Bertrand, puis par Barbara.
Faisons-nous la critique d'un film exceptionnel, extraordinaire par son thème et sa durée, Shoah ou celle d'un homme, écrivain, cinéaste, créateur, juif, français, résistant, progressiste, ami si proche des existentialistes, journaliste, rédacteur de Temps Modernes, anticolonialiste et défenseur de l'existence d'Israël ?
Je crois qu'il est impossible de mélanger les deux démarches bien qu'elles soient liées. Car Shoah est un film sur le génocide des juifs réalisé par un juif, du point de vue des juifs et celui-ci le revendique haut et fort comme tel.
Shoah n'est donc pas un documentaire qui se voudrait objectif, historique ou scientifiquement exact. Il ne peut être analysé et critiqué comme tel. Shoah est le film d'un auteur et cinéaste, Claude Lanzmann, sur l'assassinat de 6 millions de juifs. Les Mémoires du cinéaste, dont je vous ai apporté ici des passages que je juge comme essentiels pour bien comprendre la complexité du personnage, le film lui-même ne laissent aucun doute la dessus.
Personne ne critique ou ne met en doute les témoignages et les scènes qui impliquent les tueurs allemands et les survivants juifs des camps de la mort. Personne. Oui. Il y a ceux qui refusent de les voir, qui refusent d'être confrontés à nouveau à l'horreur, mais ce refus ne relève pas de la critique mais d'un choix intime et personnel d'être spectateur ou non de Shoah.
Quand Barbara a écrit qu'elle avait quitté la salle avant la fin des séquences tournées en Pologne, suite à certaines scènes, à certaines traductions, aux questions que Lanzmann posait aux témoins polonais qui avaient vécu cette époque, sans préciser si elle avait finit par regarder ce très, très long film en entier, j' en ai été sincèrement peiné. Bien sûr c'est son choix. Bien sûr elle explique plus loin dans nos échanges le dialogue qui lui a fait quitter la salle :
" Autant dire que les catholiques ne l'intéressaient que comme figures de coupables de l'extermination des Juifs et qu'il a fait passer sa thèse en se servant des paysans polonais, dont il charge la barque de façon démesurée, par le moyen de la séquence au sortir de l'église de Chelmno, même si un des interviewés qui fait figure d'"intellectuel catholique" de service, qui, lui, passe très bien l'écran pour les besoins de la démonstration, a ce petit échange avec Lanzmann dans Shoah:
Lanzman: Donc il pense que les Juifs ont expié pour la mort du Christ?
Traductrice: Il... Il ne croit pas, et même il ne pense pas que Christ veuille se venger
Je pense que c'est ce tout petit détail dans cette très longue séquence qui m'a mis dans une telle fureur que je suis sortie du cinéma avant la fin de la séance, en pensant: "OK, je crois que ce n'est pas la peine d'attendre la fin de la séance pour sortir. J'ai compris le message: les Polonais sont coupables de l'extermination des Juifs. Merci Monsieur Lanzmann pour vos explications!"
C'est cette "fureur" et sa cible, Barbara, que je ne comprends pas.
Comment ce film consacré à la Shoah, dont les éléments de preuves à charge contre les seuls et véritables bourreaux sont tels qu'ils sont irréfutables, comment ce film a-t-il pu provoquer chez vous une fureur contre le film lui-même, au point de refuser d 'en être plus longuement spectatrice, et non une fureur dirigée contre les bourreaux organisateurs du génocide.
Pourquoi les scènes des témoins juifs, des rescapés des camps de la mort, ces scènes qui provoquent effroi, horreur et compassion chez tous les spectateurs, pourquoi ces scènes là vous vous êtes condamnée à ne pas les voir ? Comment alors nos échanges pourraient-ils avoir un sens ?
Car jamais jusqu'ici dans nos échanges vous n'avez une seule fois évoqué les 6 autres heures du film.
Pourquoi réduire Shoah à une controverse religieuse, patriotique ou sociologique ? Ce que ce film est à mille lieux d'être.
Et toi Bertrand tu affirmes que :
" A ce titre, le film de Lanzmann m'était apparu, dès le début, comme entaché d'une certaine intention. Et il a frappé fort dans les consciences.
J’ai découvert, au jour le jour en vivant ici, encore plus l’affreuse inexactitude de certains témoignages distribués en pâture facile et sous l'étiquette bien sérieuse de "document historique". La fameuse image du conducteur de locomotive polonais manœuvrant son train à l’entrée de Treblinka, la tête démesurément extirpée de son engin, a participé, sciemment ou non, à une immonde confusion.
Tout ça pour dire combien ce peuple, en plus d’être martyrisé, a été calomnié, comme si l’ouest voulait se déculpabiliser d’une certaine et coupable défaillance à son égard.
L’horreur consiste, parfois et en filigrane, à vouloir amalgamer le bourreau et le billot, d’où le titre de mon texte.."
Plus loin Bertrand tu précises encore dans le même sens :
"Barbara, je partage votre point de vue quant à Lanzmann , aux moyens utilisés et aux buts poursuivis, indignes d'un artiste à moins qu'il ne se propose de falsifier son propos, ce qui l'exclut du domaine de l'art.
Je me souviens aussi de Télérama présentant cette photo lors de la diffusion de Shoah avec un commentaire on ne peut plus ambigu. »
Quant à moi, je ne peux partager tes propos unilatéraux et sans appel sur Shoah et sur Lanzmann et je me demande si nous avons vu nous aussi le même film ?
Bien à vous. Philip Seelen
*****
Barbara à Philip, en réponse à la suite du compte-rendu du livre de Lanzman,
Pour ce qui est de la projection du film en version intégrale à Varsovie en 1986, ce ne fut pas dans un cinéma de la périphérie, mais en plein centre ville au cinéma Muranow. A l'époque Le Monde avait publié l'information. Bikont, qui est allée le voir au Muranow, précise qu'il a été projeté dans plusieurs villes.
Très peu de gens sont allés voir l'intégrale: pour Varsovie, Le Monde signalait la présence des grandes figures de l'opposition de l'époque. Mais il faut préciser qu'à cette date-là, le public susceptible d'être intéressé par le film intégral était très occupé à survivre (on était toujours à l'époque des tickets de rationnement) et faire à tout le travail d'opposition clandestine.
Le fait que la première traductrice ait été la fille d'Ochab m'explique les raisons pour lesquelles, d'après ce que Lanzmann a dit à Janicka, elle avait peur de s'adresser aux gens dans la rue. Parce qu’on la reconnaissait comme juive en raison de son profil sémite, comme le suggère Lanzmann, ou en raison du fait qu'elle devait être consciente des luttes de pouvoir qui ont valu à son père d'être écarté après 1968 et des interdits politiques dont était entouré le sujet de l’extermination des Juifs dans tout le bloc soviétique, avec une rigueur renforcée après 1968 en Pologne ? Pour moi, le doute sur la sincérité de Lanzmann est permis. Précisons que Edward Ochab a, pour une fois, fait preuve de courage dans sa vie de dirigeant politique communiste, premier secrétaire du parti de 1953 à 1956 qui à l’époque s’était inventé une posture de distance à l’égard du stalinisme qu’il l’avait pourtant fidèlement soutenu jusqu’en 1953, et qu’il a sacrifié ses fauteuils d’homme de pouvoir capable de s’accommoder de tout, en protestant contre la campagne antisémite de 1968.
Je note la différence entre "question droite" pour Lanzman et "question agressive" pour la traductrice. Pour le "zydki", j'avoue que moi-même j'ai été très étonnée de l'entendre cet été, alors que j'essayais de trouver d'éventuels papiers familiaux, dans la bouche d'une archiviste d'une minuscule ville de province tout à fait typique de ces bourgades de marché paysan où, avant 1939, la moitié ou plus de la population était juive.
Mais il faut se rendre compte que la population juive se distinguait de la population polonaise par la langue et par la tenue, surtout pour les hommes d'après ce qu'on voit sur les photos, puisqu'il y a de plus en plus d'albums de photos publiés actuellement. Et le syndrome de la culture de l'altérité était sans doute renforcé par le fait que cette population juive était pour moitié une population de gens venus de l'Est: Biélorussie et Lituanie, à la fin du 19ème siècle et encore au début du 20ème siècle, après les décrets d'abolition du servage et d'émancipation des Juifs dans l'empire russe. De surcroît avant 1939, la Pologne rurale des territoires qui avaient été rattachés à l’empire russe était terriblement arriérée : dans les zones de l'Est, où ont été installés les premiers camps d'extermination des Juifs avant que les nazis ne mettent en fonctionnement Auschwitz, le taux d'analphabétisme chez les adultes était très important, car le vrai travail de scolarisation systématique des campagnes n’avait commencé que dans la période 1918-1939. L’appellation « Polska B », utilisée par Bertrand dans ses billets, est née dans la période 1918-1939 pour opposer l’Est (Polska B) à l’Ouest (Polska A) où l’industrialisation avait commencé.
Tout ceci explique aussi pourquoi les nazis ont pu trouver des clients polonais pour profiter des miettes du pillage qu'ils ont effectué dans les maisons juives. Quant aux trafics liés au fait que ces usines de fabrication de la mort avaient du personnel masculin à l'intérieur dont Lanzmann ne parle guère dans son film, la presse polonaise en a donné des échos, puisque l'extradition de Demaniuk, bourreau de Treblinka, a fait l’objet d’articles de fond sur la période de la guerre. Krzysztof Pruszkowski m'a signalé un article de Wyborcza qui traite de la nombreuse descendance que Demaniuk a laissé en Pologne. Je l'en remercie, car il avait échappé à mon attention.
Pour le silence de Lanzmann sur ces aspects-là des bourreaux des camps d'extermination, Bikont pense que la fascination de Lanzmann par l'URSS explique beaucoup de choses. Elle lui a demandé pourquoi il n'a pas cherché à aller à Babi Jar. Il a répondu par une pirouette: "on me cherche des noises". Et il refuse l'idée que les Polonais pendant la guerre étaient coincés entre deux totalitarismes.
Bikont, dont je précise que son grand sujet de reportages et interviews est la question juive en Pologne, nous présente un Lanzmann qui est un mixte de justicier juif qui rend la Pologne catholique responsable de l'extermination des Juifs et de personne qui en 1997 était encore loin d'avoir fait le deuil de ses illusions prosoviétiques. Elle donne quelques citations de sa discussion avec lui qui mettent en évidence une radicale impossibilité de rapprocher les points de vue. Et décidément la version que Lanzmann donne de ses relations avec Karski me donne à penser qu'il faudrait que j'aille vérifier ce que Karski écrit dans le texte qu'il a écrit pour Zeszyty Historyczne. Pourquoi une telle insistance sur les contrats de la part de Lanzmann ? S’agirait-il de détourner l’attention du lecteur du vrai problème?
Bref Shoah, un grand film assurément, mais qui ne manque pas de paradoxes et qui est bien révélateur de l’époque où il a été produit. En 2004, Guillaume Moscovitz a fait un film sur Belzec que les Polonais pourront voir sans avoir les mêmes réticences que face à Shoah.
*****
Barbara à Philip, en réponse aux questions qui me sont adressées
 Il est bien évident qu'après ma première fureur, j'ai vu le film en entier. Et j'ai trouvé que, au total, Shoah était un très grand film, malgré ses défauts.
Il est bien évident qu'après ma première fureur, j'ai vu le film en entier. Et j'ai trouvé que, au total, Shoah était un très grand film, malgré ses défauts.
Quant à ma première réaction, elle s'explique par le fait qu'avant d'aller voir Shoah, j'avais vécu l'expérience de ces questions rhétoriques sur le taux d'antisémitisme que contenait le lait maternel que j'avais sucé dans mon enfance, dans lesquelles on attendait de moi que j'avoue au moins les péchés de mes parents. Expérience un peu rude, quand on n'est pas dans la norme attendue et qu’on est écouté avec un air de profonde incrédulité.
N'oubliez pas qu'à l'époque où le film est sorti, la certitude que les Polonais étaient complices de l'extermination des Juifs et que la Pologne a été choisie comme territoire d'extermination pour tous les Juifs d'Europe en raison de ses sympathies pour les nazis était une sorte de dogme en France, pour les gens qui se posaient la question. Ce n’était que le résultat du fait que pendant des années et des années, il y a eu des combats d’arguments entre les Juifs des USA et les réfugiés politiques polonais. Mais comme les Polonais n’avaient pas d’outil de propagande bien puissant, ils ont été perdants dans la guerre des lobbies aux Etats-Unis pendant toute cette période. Ce dogme, Lanzmann était loin d'en être exempt à l'époque où il a fait le film. Il semble gommer cet aspect de son évolution dans son autobiographie. Mais c'est bien ce dogme qui explique qu'il y ait dans Shoah ces deux séquences: celle avec les habitants du village de Grabow qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Chelmno et ne présente d’intérêt que par l’architecture de la bourgade juive qui s’y est particulièrement bien conservée (pour ma part, j’ai vu la même architecture à Siedlce vers 1980), ainsi que la séquence à Chelmno, au moment une procession sort de l'église.
A l'époque de l'entretien avec Anna Bikont, on voit que Lanzmann en est à une période où il commence à tempérer légèrement, au point qu’Anna Bikont lui dise, alors qu'il émet un mot de compassion à propos d'un Polonais dont le champ jouxtait le camp de Treblinka: "Cela, vous ne l'aviez jamais dit jusqu'à présent." Or l'entretien avec ce paysan dans Shoah commence par un "Alors, donc, il était aux premières loges pour voir tout ça, là-bas?" dont l'agressivité ne m'avait pas échappé. Ce que Lanzmann n’avait jamais dit jusqu’en 1997 est le propos suivant : « Personne ne naît héros. Ces gens étaient impuissants. Si j’étais né paysan dans les environs de Treblinka, je me serais sans doute comporté comme eux.»
Pour la séquence du machiniste, personnellement, je ne l'avais pas ressentie comme agressive quand je l'ai vue, parce que je comprenais bien ce que disait Gawkowski et ce que pouvaient être les motivations personnelles d’un homme détruit par son affreuse expérience. Mais quand j'ai vu comment les spectateurs français lisaient cette séquence, j'ai été effrayée de ses conséquences.
Quant aux questions religieuses et sociologiques, elles sont extrêmement importantes pour le cas polonais dans l'histoire de la Shoah, car c'est près de la moitié des Juifs d'Europe qui vivaient en Pologne en 1939. Ceci s'explique par la présence juive séculaire, mais aussi par un mouvement de migration vers l'Ouest des Juifs de l'empire russe qui a été l'effet de l'émancipation des Juifs en 1863. Le résultat en a été que sur les terres polonaises, de 1863 à 1918, la population juive, dans les villes polonaises de l'empire russe (qu’elles soient grandes villes ou petites bourgades de marché paysan), a doublé, voire triplé. Au fur et à mesure que je progresse dans mes lectures sur l'histoire des Juifs de Pologne, je m'aperçois que c'est un point d'histoire extrêmement important, car les mouvements de migrations, qu’ils soient polonais ou juifs, ont été stoppés à partir de 1929 d’une part par l’arrêt de l’immigration aux USA et d’autre part par le fait que l’Europe de l’Ouest arrivait à grand peine à absorber les gens qui ont fui Hitler en Allemagne puis en Autriche.
Sur cette question, selon moi très importante, je n'ai toujours pas vu de livre en Français qui soit d’une objectivité satisfaisante. Il y a eu un colloque sur "Juifs et Polonais" en 2004 à la Bibliothèque Nationale qui a fait un peu bouger les lignes des représentations de l'histoire et dont le résultat vient d'être publié. Et quelle ne fut pas la surprise pour le public qui était venu nombreux d'apprendre que les Polonais avaient aidé les Juifs. Une vraie révolution dans les esprits des personnes dont les ancêtres étaient venus de Pologne avant 1939 ou après 1945 ! La Bibliothèque Polonaise de Paris organise également un colloque qui se terminera par une intervention du président du CRIJF ces jours prochains. Mais, à mes yeux, les publications actuelles en langue française n’ont pas épuisé toutes les questions qui me semblent devoir être traitées pour expliquer toutes les spécificités de la Shoah en Pologne, sans doute en raison du fait que les historiens polonais ne sont pas conscients du poids des ressentiments à l’égard de la Pologne d’avant 1939 qui se transmet dans les mémoires juives en France.
Si tout cela était connu, ni Krzysztof Pruszkowski, ni notre ami Zbigniew qui intervient dans les commentaires, ni moi, nous ne serions lassés par la nécessité d'expliquer, ré-expliquer et expliquer encore.
*****
A l'attention de Barbara de la part de Philip Seelen
Vos arguments, Barbara, développés dans vos deux dernières interventions me permettent de très bien comprendre vos critiques et votre attitude à l'égard de Shoah, même si je ne partage pas toutes vos formulations. Mais cette dernière remarque est dans le propos qui nous lie totalement secondaire. Les mémoires de Lanzmann apportent aussi des éléments illustrant la relation âpre, unilatérale et parfois méprisante, basée sur une vision préconçue et étriquée de l'histoire de la communauté juive de Pologne et des liens ancestraux de celle-ci avec le peuple et les élites polonaises que le cinéaste semble cultiver au-delà de l'histoire réelle.
Le cinéaste a entretenu et semble entretenir encore avec la Pologne, son peuple et son histoire, une relation basée sur certains clichés typiques d'une gauche européenne accrochée à une vision nostalgique, erronée et figée du socialisme réel, vision qui ne tient aucunement compte de l'histoire tragique de cette nation au 20e siècle.
Lanzmann maintient un silence radio absolu sur la longue dictature communiste dont nous nous sommes tous réjouis de la chute en 1989. Il ne parle jamais du pays réel qu’il visite et dans lequel il réalise son film. Il semble rester fixé sur une série de traits qui fige sa vision d’un monde transcendantal servant uniquement à illustrer son film, Shoah, ce qui est la seule chose qui lui importe alors.
C'est d'ailleurs cette relation unilatérale du cinéaste français avec le monde polonais qui provoque encore et toujours, et ce plus de 20 ans après la sortie du film, un profond malaise chez la plupart des spectateurs et des critiques, qu'ils soient polonais ou non, de l'oeuvre de Lanzmann.
Barbara, merci pour la qualité de vos échanges sur une question aussi sensible que celle sur laquelle nous venons d'échanger longuement.
Cordialement. Philip Seelen
*****
A Philip,
Pour moi, la composition sociologique de la Pologne de la période 1918-1939 était une structure sociologique porteuse d'un conflit ethnique potentiel, selon le schéma classique qui a généré les conflits ethniques dans le monde que nous avons connu après 1945. Or quand on invite Lanzmann à des colloques qui traitent de la Shoah sous l'angle de la recherche des analogies et des différences de la Shoah avec les conflits ethniques connus, il refuse, considérant que c'est une hérésie.
Il me semble que Lanzmann entretient une relation à sa judéité qui l'empêche de réfléchir. Et surtout, pour un défenseur d'Israël, il en connait fort mal l'histoire. Car les publications polonaises de l'après 1989 m'ont appris que c'est le Polonais Ksawery Pruszynski, un pilsudskiste dans la Pologne d’avant 1939 et un auteur de reportages qui méritent d'être lus par tous les historiens du monde qui étudient la période historique 1918-1939, qui présidait la commission de l'ONU qui devait établir la charte de constitution de l'Etat d'Israël. Le point sur lequel il travaillait était la recherche d'une règle de répartition des populations juives et palestiniennes qui permette d'éviter une structure sociologique analogue à celle qui avait existé en Pologne de 1918 à 1939 et dont il connaissait par expérience les effets désastreux. Malheureusement, les fondateurs de l'état d'Israël ont proclamé leur état avant que la commission n'achève ses travaux.
Et la conséquence est un pétrin inextricable. Si l'expérience polonaise avait pu porter ses fruits, qui sait?, le conflit israélien aurait peut-être été fortement atténué.
Je ne vous demande pas de préciser les justifications que Lanzmann donne à sa critique de « La Terre de la grande promesse » de Wajda, car ce que vous avez dit sur le lien qu'il établit avec le repas chez le maire de Chelmno m'a éclairée. En effet, Bikont précise que Lanzmann a été furieux de découvrir qu'à la sortie des ripailles chez le maire, on lui a présenté une facture de 100 dollars. Bref, ce maire était à l'évidence un communiste à la polonaise tout à fait dans la norme moyenne: un esprit étriqué bourré de préjugés, mangeant à tous les râteliers : celui de l'Eglise et celui du parti, et fasciné par l'odeur de l'argent. Mais en déduisant de cette désagréable expérience que tout ça nous conduit à l’antisémitisme de Wajda, Lanzmann se contente d’enfiler une succession de clichés qui ne peut que semer le doute sur la qualité de sa réflexion.
Car Wajda, dans « La Terre de la grande promesse », ne fait qu’une transposition d’un roman de Reymont, le Zola polonais, qui a eu le prix Nobel de littérature, après son roman « Les paysans ». Et ce que d’ordinaire le spectateur polonais retient du film de Wajda, c’est que le personnage le plus crapuleux des trois crapules qui se sont acoquinées pour faire fortune à Lodz n’est ni le Juif, ni l’Allemand, mais le Polonais ! Ce que montre « La Terre de la grande promesse » est le début d’une mutation de la société polonaise traditionnelle qui se poursuivait lentement jusqu’en 1939 et la transformation du hobereau polonais en industriel. Et il n’y a aucun doute sur le fait que les transformations économiques sont venues d’Allemagne en Pologne et que les Juifs vivant sur les territoires polonais s’y sont adaptés plus vite que les hobereaux polonais.
Certes, Lanzmann essaie de nous faire croire que son film n’est pas anti-polonais. Mais à la sortie de Shoah, Libération titrait : « La Pologne au banc des accusés ». Si bien que ces tentatives m’amènent à émettre l’hypothèse que Lanzmann a du être bien surpris qu’on lui retourne l’accusation. Dure expérience pour un individu qui se voyait en procureur à l’autorité morale incontestée et qui l’amène à faire flèche de tout bois, y compris de petites bassesses.
Moi aussi, je vous remercie de cet échange fort long qui nous a permis de préciser une question importante, étant donné le rôle qu’a joué le film de Lanzmann dans la naissance de l’intérêt que le grand public français a accordé à l’extermination des Juifs mais aussi dans la propagation des clichés sur la Pologne.
Je remercie également Bertrand de nous offrir cet espace de commentaires si précieux pour rectifier ces clichés.
*****

A Barbara et Philip de la part de Bertrand
Ces échanges minutieux, intelligents, admirablement documentés et d'une honnêteté remarquable honorent ce blog et éclairent mes textes sur la Pologne d’un tel jour, que c’est à moi de vous remercier, Barbara et Philip.
Je suis moins documenté que vous autres et, ayant lu avec précision, ce que vous avez écrit là, m’y étant instruit aussi, je vous ai proposé de publier en texte à part entière vos échanges.
Vous m’y avez autorisé et je vous en sais fort gré.
Ce projet a maintenant pris forme, après que je vous l’ai soumis par courrier privé.
Ce que j’écris sur ce pays naît de ce que j’y vis et de l’amour qu’il m’inspire à bien des égards.
Pour répondre sur un point précis à Philip je lui dis, avec l’amitié dont il me sait porteur, que ça n’était pas une bonne question, un bon procédé, que d’interroger si nous avions bien vu le même film.
Nous savons, qu’en fonction de ce que nous portons en nous de sincérité, de vécu, de joie et de tristesse, d’espoir ou de blessures, nous pouvons lire les mêmes pages d’un livre sans y recevoir les mêmes phrases.
Je ne dénie donc pas à Lanzmann ses qualités et le travail monumental qu’il a effectué. Mais vouloir transmettre la mémoire, surtout celle-ci, celle du crime scientifiquement organisé le plus redoutable et le plus répugnant de toute l’histoire humaine, demande qu’aucun propos ne puisse prêter à la moindre confusion.
Je sais. Plus facile à dire qu’à exécuter. Mais, je le répète, c’est un sujet qui n’admet aucune erreur, aucune médiocrité, aucune négligence, aucune ambiguïté..
Autant donc le savoir avant de l'aborder, qu'on réponde au nom de Lanzmann ou à celui de Dupont.
Et l'abordant, qu'on prenne l'entière responsabilité de son propos.
Donc, nous avions bien vu le même film.
Je me souviens parfaitement, à l’époque, sur La Rochelle, des réactions d’antipathie, certaines à peine voilées et d'autres carrément explicites, vis à vis du peuple polonais. Alors ?
D’où, ma relecture du film. Je me souviens parfaitement de tout ça et les réflexions de Barbara sont venues ici corroborer mes convictions d’alors.
Ceci étant dit succinctement, je voudrais dire que j’ai eu le même sentiment que le cinéaste en me rendant à Majdanek et à Sobibor….Je le dis un peu dans le texte initial Le billot des bourreaux. L’horreur avait désormais un lieu, une forme, une géographie, une bouleversante présence en même temps qu’un silence tellement lourd !.
J’ai eu aussi cette interrogation face à la proximité des faubourgs de Lublin, même si, en plus de 60 ans, la ville avait pris de l’ampleur, mais pas tant que ça au regard des anciennes cartes.
Des immeubles, à cent mètres tout au plus, sont là et chaque matin et chaque soir, les habitants de 2009 peuvent voir sans ne plus les voir, les stigmates du crime le plus sanglant de l’histoire de l'humanité.
Et ma gorge s’est nouée pour ce pays.
Je n’ai pas eu le premier réflexe, somme toute assez désobligeant, de Lanzmann, de dire : Mais…Mais les gens ne pouvaient pas ignorer, alors…
Non. Car enfin, la Pologne est un beau visage…Un visage à angle plat, boisé, placide, serein et qui ne demande qu’à aimer et à sourire ! Et ce visage porte à jamais les marques abominables, indéfectibles, d’un vitriol jeté par des assassins venus d'ailleurs !
Venus d'ailleurs et d'un autre système, Monsieur Lanzmann, et je revendique pleinement mon titre : Le billot des bourreaux.
Bon sang, qui a pensé aujourd'hui à ce fardeau que la géographie polonaise doit supporter au quotidien de mémoire ? !!?
QUI ?
Et la géographie n’est rien, sans les hommes qui sont là, avides d’y vivre !
Tous les matins et tous les soirs, Dorota et moi passons à quelques centaines de mètres du lieu du massacre de Łomazy d’août 42…
Je disais hier que je m’étonnais assez désagréablement que ce lieu de mémoire ne soit signalé que par une petite, une toute petite pancarte approximative.
Oui, m’a t-elle dit. Mais la Pologne est criblée de lieux marquant cette infamie…Se souvenir, oui, il faut se souvenir…Mais les gens veulent vivre aussi. Vivre ! Tu comprends ?
J’ai compris effectivement quelque chose d’essentiel et j’ai été d’accord avec elle. J’ai compris quelque chose qu’on ne comprend pas forcément quand on se souvient depuis Paris, La Rochelle, Zanzibar ou de Montcuq.
En tout cas j’ai compris quelque chose que Lanzmann n’a pas compris un quart de seconde.
A Sobibor, le sentiment était autre qu’à Majdanek. Presque plus terrible parce qu’il n’y a plus rien de l’horrible architecture des camps, détruite par les criminels eux-mêmes.
Reste le silence, les arbres, le ciel qu’on croirait qu’il gémit encore.
J'en avais écrit ce texte, ici.
Ce pays, le plus éprouvé du cataclysme nazi, a des raisons, d’immenses raisons de vouloir qu’on soit juste, très juste avec sa mémoire.
Mais vous savez déjà tout ça.
Chaleureusement à vous deux et merci encore pour ce débat, hautement mené, honnête et tellement primordial aujourd’hui encore.
Bertrand
Les images sont de Philip Seelen.
Qu'il en soit ici, encore et toujours, chaleureusement remercié.
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET



















