30.12.2011
Et d'une autre !

Je n’ai jamais trop su, voyez-vous, ce qu’on s’obstinait à fêter à la Saint-Sylvestre, si c’était bon débarras ou bienvenue ! Si on célébrait un enterrement ou une naissance, si on faisait valser dans les bulles du champagne - souvent frelaté- les draps d’un berceau ou les plis d’un linceul.
Optons pour les draps du berceau ou alors ne fêtons rien, me suis-je toujours dit. Car une année qui s’achève, même mauvaise, c’est toujours une année de moins à vivre et c’est profondément triste. Une enjambée supplémentaire, faite de trois cent soixante cinq petits pas, vers une date que seul précisera le hasard ou le destin. Les mathématiques de la vie sont comme les sots, qui sont implacables et rancuniers.
Privilégier le berceau et regarder devant, alors ? Pas sûr d’y voir trop clair pourtant. Le devant fourmille toujours d’espoirs, de projets, de surprises, bonnes ou mauvaises…Laissons venir. Tout ça viendra bien assez tôt ou ne viendra pas du tout, d’ailleurs.
Regarder derrière ? Oui, c’est peut-être mieux. Tournons-nous donc un instant vers l’enterrement, mais sans rien fêter. Mangeons notre lapin en silence, comme dirait le Tenancier. Derrière, au moins, on voit quelques traces laissées dans la neige et la poussière. Devant, la neige n’est pas tombée et la poussière pas déposée encore, alors dans quel discours inscrire sa promenade, sinon dans celui, toujours lénifiant des promesses faites à soi-même ?
En 2011, donc, j’ai mis ou remis en ligne 229 textes et, si j’en crois les chiffres de Hautefort (oui oui, pas de messe ! je sais qu’ils sont à prendre avec précaution mais ils indiquent au moins une tendance) vous seriez maintenant 3000 visiteurs sur l’Exil, alors que vous étiez à peine 2000 au début de l’année. Je vous en remercie, chacun individuellement, et, vous sachant gré de votre fidélité, je me félicite en même temps de la mienne à votre égard.
J’ai publié en juillet Le Théâtre des choses, recueil de 10 nouvelles, à l’enseigne des éditions Antidata, recueil qui, selon Philip Seelen est ce que j’ai fait de mieux jusqu’à maintenant en matière d’édition et, selon son compère JLK, recueil qui est «excellent». Plaisir, donc. Beaucoup de plaisir, eu égard à la qualité du jugement littéraire des deux camarades suisses. Vanité diront les fâcheux et je leur concéderai bien volontiers. Je dirais plutôt satisfaction et fierté personnelles, mais bon, on ne va pas chipoter.
D’autres échos sont venus, Elisabeth Legros-Chapuis, Marc Villemain, Solko (un peu mitigé), Stéphane Beau dans le Magazine des livres, Patrice Revert dans la Nouvelle République…Et des mails privés.
Le livre semble vivre sa petite vie de livre. Je saurai tout ça en fin d’année.
Voilà pour le chapitre des satisfactions. Passons à celui des déconvenues, qui risque d’être beaucoup plus long.
- Grosse déception en février lors d’une brouille violente avec un ami du net, suite à une entorse faite, à mon sens, à la déontologie du net, justement, par un étalage public à peine voilé d’un malentendu privé. J’ai réagi violemment, avec colère, et ce fut sans doute mon grand, très grand tort. Il eût mieux valu régler ça par mails privés. Erreur de ma part, donc, et rupture. Dommage. Il n’y avait pas mort d’homme et j’avais en estime le susdit internaute. Mais si je suis capable de reconnaître les dérapages de mes colères, je souligne que mon ex-copain n’a jamais su reconnaître, ne serait-ce que d’un petit mot, le caractère désobligeant de son intervention. J’ai essayé, beaucoup plus tard, de tendre la main. Sans résultat. Alors, si les coléreux sont des gens en proie à une courte folie, les calmes, eux, sont sans doute de sourds volcans de rancune, ce qui n’est pas beaucoup plus reluisant et même beaucoup moins transparent. Au moins, moi, on sait qui je suis.
Mais je regrette cette brouille.
- La deuxième brouille, plus grave, plus conséquente, et que je ne regrette nullement celle-ci, est celle qui est intervenue en juin entre mézigue et François Bon. J’en ai souffert. A deux niveaux. D’abord parce que la mise en évidence de la supercherie faisait s’écrouler en moi un espoir né en mars 2008 quant à la qualité revendiquée de ce monsieur. Ensuite parce que - même si une quarantaine de mails réclamant l’anonymat sont venus m’apporter, soit leur franc soutien, soit leur compréhension embêtée - le débat sur internet n’a pas été celui que j’espérais. Beaucoup, dont j’estime l’écriture engagée, ont tout simplement fermé leur gueule, alors que le problème soulevé n’était pas, à mon sens, un problème Redonnet/Bon, mais le problème plus général de la fourberie en matière d’édition et d’écriture, donc un problème où chacun, écrivant et lecteur, aurait dû s’engager. Comme quoi on ne s’engage bien souvent que pour des causes qui ne mangent pas de pain et la déception que j’en ai éprouvée est encore vive en moi. A tel point que je ne lis plus que d’un œil distrait les différentes critiques du monde faites par les bloggeurs et autres écrivains, et en chantonnant toujours in petto ces vers posthumes de Brassens :
J’ai conspué Franco, la guitare en bataille,
Durant pas mal d’années,
Durant pas mal d’années !
Faut dire qu’entre nous deux, simple petit détail,
Y’avait les Pyrénées
Y’avait les Pyrénées !
Dans cette brouille, je rends cependant honneur et amitiés à certains, au premier rang desquels Ard et Yves Letort, alias le Tenancier, qui ont opposé à François Bon la force d’arguments véritables, auxquels l’intéressé n’a su répondre que par une fuite honteuse ou des propos scandaleusement désastreux. Tout cela est conservé dans les commentaires, catégorie, «Publie.net, une étrange coopérative».
- Autre déconvenue : le refus par les éditions du Sonneur - seul éditeur à qui je l'ai présenté à part Monti qui n'a même pas daigné répondre - de mon roman, écrit fin 2009, début 2010. Refus motivé par «une lenteur un peu ennuyeuse du récit et une écriture quelque peu obsolète ». Juste critique sans doute, mais étonnante de la part d’une maison sérieuse, bonne, et dont le catalogue est principalement constitué d’auteurs anciens. Ceci étant dit, je rends fraternellement honneur à Marc Villemain - de ces éditions du Sonneur - Marc, qui, par ailleurs apprécie mon écriture - de ne pas avoir fait jouer le copinage, dont il a horreur et dont il sait que ce genre de pratique me révulse.
Pas certain que d’autres que lui ou moi auraient eu tant de scrupules. Mais bon...
Je viens donc de retravailler ce long roman, lent et obsolète…A qui vais-je le proposer ? Je n’en sais rien. Tout ça se fera sur un coup de tête, comme d’hab, ou ne se fera pas.
Mes engagements successifs pour une transparence dans l’édition où l’auteur ne serait pas méprisé par un silence dont il se fait complice, m’ont évidemment fermé pas mal de portes. Je ne suis pas de ceux qui font les omelettes virtuelles sans casser les œufs.
Sinon, ce roman, je vous l’offrirai peut-être gratuitement ici, tenez, si je n'ai pas le goût de fouiller dans les adresses d'éditeur ! Ah, sainte gratuité ! Générosité ! J’ai abordé, tout dernièrement, le problème de la gratuité des blogs. Je vous invite vraiment à lire ici, dans les commentaires, la réponse que vient de me faire Stéphane Beau. Très juste. Et nous, bloggeurs, n’avons pas à faire les fiers et à critiquer le monde avec notre pédanterie…Vraiment pas.
Voilà... Ah, j'allais oublié, la souscription. On se dirige tout droit vers un bide ridicule : 18 souscripteurs, que je remercie quand même. Une idée qui finira donc bientôt, très certainement, au chapitre des morts-nés. Coléreux, moué ? Oui, mais aussi et quand même indécrottable naif !
Que te souhaiter, cher lecteur, pour cette nouvelle année qui n’aura sans doute de nouveau qu’une parcelle nouvelle de la fuite du temps ?
Je te souhaite ce que tu souhaites, simplement, et si tu ne souhaites rien, si tu préfères sagement laisser et voir venir, au feeling, je te souhaite quand même ce qui, de plus en plus de façon négative constitue dans nos sociétés, le bonheur : l’absence de tourments et de souffrances, morales ou physiques. Qui que tu sois et quels que soient les sentiments que tu nourris à mon égard.
Amitiés
Stats du 31 décembre :
| Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) |
|---|---|---|---|---|
| 3086 | 10 204 |
29 863 |
963 / 9 824 | 329 / 992 |
10:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.12.2011
Quand ?

C'est là-bas qu'on s'en va. D'aucuns disent qu'il n'y a rien où on s'en va. D'autres disent que si, qu'il y a comme une blancheur qu'on appelle, faute de mieux, l'éternité. D'aucuns et d'autres disent des conneries. Parce qu'ils ne savent rien. Comme moi, comme toi, comme nous, comme vous. Et quand on dit des choses là où on ne sait rien, forcément, on dit des conneries, des bouts d'idéologie, des queues de convictions toutes faites, des trucs qui font intelligent, des récitations qu'on croit avoir soi-même composées.
Nous sommes comme les renards de la forêt de Benon. Nous pissons notre verbe sur tout ce que nous trouvons, attestant ainsi que nous sommes passés par là et que nous y étions chez nous.
Bon, d’accord, me diras-tu, ça je le savais déjà, mais le renard, lui, qui lève la patte sur les fûts forestiers, sait-il qu’il va mourir ?
S’il faut en croire Malraux, qui a fait par ailleurs, sinon écrit, pas mal d'âneries, non, le renard ne sait pas. Parce que l’homme est la seule créature qui sache qu'elle est mortelle.
C’est beau. Comme toute chose invérifiable et balancée gratuitement.
Mais le rat ?
Je me suis laissé dire que suspectant un relief empoisonné, les rats envoient d’abord le vieillard de la bande. Pour qu’il goûte. Un certain temps d’observation s’étant écoulé, si le vénérable patriarche n’est pris d’aucun vomissement, saignement du museau ou autres convulsions préfigurant la mort, alors le reste de la horde se met en appétit.
Il paraîtrait aussi que pour traverser des égouts, ce peuple, grand pontier s’il en est, construit une passerelle grouillante, les plus vieux au fond, servant de bases, puis, ainsi de suite, par ordre décroissant, les moins jeunes, les jeunes et les enfants invités enfin à passer sur l’autre rive, sur le dos des aînés. Si tout le monde se dépêche et s’il n’y a pas trop de cohue, même les premiers, au fond, les ancêtres, s’en sortent. Sinon.
Ce n’est jamais très rigolo d’être vieux. Mais ça le semble encore moins chez les rats.
Cet instinct de conservation de l’espèce est bien lié, sinon à une conscience, du moins à un certain pressentiment de la mort.
Non ? Bon.
Alors, laissons-là les rats et revenons-en aux hommes.
Claudel, pourquoi écrivait-il donc ? Il n’avait pas peur du trépas, celui-là. Il était même persuadé que c’était la porte ouverte sur la béatitude accomplie. Ou alors il faisait semblant, le fourbe. Comme Mauriac et tant d’autres, plus illustres et savants écrivains, révérence parler.
Si mon poncif de départ est juste, c’est que les hommes feignent de croire en Dieu. S’il est faux, alors, ils n’ont pas besoin d’écriture, ni même de tout autre forme d’art.
Je sens que tu m’en veux d’être aussi réducteur. Peut-être même me trouves-tu sot.
Pourtant, moi qui ne suis ni un rat, enfin je ne crois pas, ni Claudel, ça j’en suis sûr, si je n’étais pas un peureux, un peureux amoureux transi de cette belle terre et des hommes, je n’essaierais pas d’écrire, je ne composerais pas sur ma guitare, je n’arrangerais pas des chansonnettes.
Je m’en foutrais de pisser ma mélancolie sur le tronc des chênes. Enfin, peut-être que je ferais tout ça, mais je ne chercherais pas d’éditeur, je ne ferais pas de scène, ni même ce petit blog.
J’ai laissé un frère, en France. Il est aussi mon ami. Il fait des meubles, lui. Il joue à faire de beaux meubles, avec du vrai bois qui sent la forêt et les chemins fangeux. Quand ils seront vieux, ses meubles, ils ressembleront au buffet de Rimbaud.
Il ne cherche pas de vitrine où mettre ses poèmes. Ils sont pourtant fort élégants. Il doit savoir qu’ils vivront longtemps. Je crois qu’il a peur aussi.
Si je dis ça, c’est que j’ai regardé par la fenêtre, vois-tu. J'ai trouvé la forêt et la neige et le silence et le ciel au-dessus qui faisait le mélancolique, très beaux.
Je n’ai vraiment pas envie d’être privé de tout ça, un sale jour. Ce ne serait pas juste.
Je n’ai rien fait pour mériter de ne plus voir, de ne plus sentir, de ne plus aimer, de ne plus espérer, même ne sachant pas ce que j’espère.
L’exilé a toujours peur de crever trop loin de sa tombe.
Ne dis pas que je dis des bêtises, je te prie. Ou alors admets, à ce stade de notre page, que tu aimes lire des bêtises. Toi aussi, tu as peur, peut-être ?
Les hommes sont des prétentieux, tu sais. Ils ne brassent pas assez d’évidences. Ou alors pas les bonnes.
Si j’étais un rat, je serais encore plus rebelle.
Je déserterais sans vergogne tous les diktats de l’ordre social.
C’est que je suis un peu vieux, sans doute.
09:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.12.2011
Polska B dzisiaj - Extrait-

Le jaune des bouleaux, le vert des pins et le rouge des chênes se disputent la vedette. Une huile au couteau. Une palette épaisse et si rude qu’il faut prendre du recul, sortir un peu de soi pour en goûter tout le langage. Pas comme cette aquarelle subtile de nos rivages où les vapeurs océanes diluent les couleurs et liquéfient la lumière qui ruisselle dans l’espace vide d’entre les choses, mais aussi sur ces choses elles-mêmes et sur nous-mêmes. Les paysages de bords de mer fusionnent le spectateur et le spectacle dans un même flux réfléchissant le monde.
Les paysages continentaux, eux, sont plus extérieurs, modelés par la terre et par une intelligence rustique entre les arbres. Le bouleau est un pionnier. Il arrive le premier au gré d’une saute septentrionale du vent et il dit que c’est là qu’il faut planter une forêt, que le sol est riche et que le sable est assez stable.
Le Polonais est un forestier. Il sait lire entre les troncs. Il souscrit aux indications du bouleau et plante là les pins qui feront des maisons, des granges, des fermes et des clôtures. Les forêts de l’est sont des gisements pour bâtisseurs.
Mais le chêne rouge a observé tout ce manège. C’est un erratique, un apatride, on ne veut pas trop de lui ici, trop lent, beaucoup trop flâneur dans sa croissance. Alors il s’incruste, passager clandestin des essaimages, magistral parasite des sylvicultures, arbre de proie.
Tout ce muet panachage de l’éclaireur du nord, du pin de construction et du bel intrus sans papiers, accompagne de lumière la route où cahote un cheval. Il est attelé à une sorte de carriole étroite tout en longueur, avec deux essieux, celui de l’avant savamment articulé. Deux sacs de blé dur y bringuebalent. Ils s’y promènent exactement. Derrière la carriole, piaffe le Renault flambant tout neuf d’une société ouverte au soleil couchant, PTAC quarante tonnes, en route vers la construction des paysages nouveaux, un demandeur d’autoroutes, un qui n’aura que faire de la lecture des bouleaux. Les époques ici se côtoient sans s’agresser, ne se poussent pas du coude, se superposent comme les sédiments de la géologie, se font des signes, sans moquerie, sans marque de supériorité et sans dédain. On sait bien que tout ça, ça va, d’accord, mais que ça peut venir aussi et on a l’air de penser qu’on ne sait pas trop bien qui, du cheval ou du Renault PTAC quarante tonnes, est finalement à contretemps.
Les champs sont immobiles.
On dirait que personne ne vient les éventrer et les bousculer dans leur torpeur. Ils sont comme des trapèzes, c’est pas pratique, un trapèze. Ils sont comme des triangles, ça a des angles aigus difficiles à investir, les triangles. A des quadrilatères difformes et sans angles droits, qu’ils ressemblent parfois. Rarement, très rarement, ils sont ces rectangles pragmatiques des grandes cultures de l’ouest et qui, vus d’avion, dessinent si bien la terre en un jardin impeccablement entretenu, un jardin à la française.
Nous sommes en route pour Janow Podlaski. Par association d’idées contraires, un vieux copain oublié depuis quelque trente années déjà, surgit dans ma mémoire tandis que je regarde ces champs silencieux qu’on dirait bien que ce sont les arbres qui commandent ici et pas eux, les champs. La lisière des bois dessine celle des cultures. Pas l’inverse. Mon copain un peu agriculteur, raisonnablement écolo, passablement anar, résolument fêtard, superbement enjoué et terriblement humain, c’est au sud qu’il habitait, sur la plaine toulousaine bousculée par le vent d’autan, le vent qui rend fou.
Il cultivait le maïs sur des terres qu’il avait en location. Mais tout le monde ici cultivait du maïs. La plaine immense n’était qu’un affligeant tapis de maïs. Alors je lui demandai un jour comment il faisait pour retrouver ses billes dans cet océan monocorde, monochrome, monopoliste, monozygote, monotone, mono tout de maïs. Il dit que c’était simple : il semait et récoltait toujours le dernier. Quand tout le monde en avait terminé, quand cette vaste étendue enfin mise à nue sous les désolations de novembre ne présentait plus qu’une parcelle ridiculement isolée en son beau milieu, c’est que c’était forcément à lui. Ce qui restait. Je crois qu’il a fait faillite.
C’est ce que font forcément les hommes qui, sous nos cieux, n’entendent rien à l’hégémonie des vastes jardins.
A intervalles réguliers, nous doublons une vache attachée à un pieu. Elle broute l’herbe du fossé à grands coups de langue râpeuse. Elle a de lourdes plaques de bouse séchée sur les cuisses et deux os saillants de chaque côte de la queue. L’herbe du fossé est à tout le monde et les champs sont trop maigres. Ou alors le propriétaire de la vache n’a pas de champ. Toute sa richesse est là dans cette vache en fragile équilibre sur un talus. C’est sa crèmerie. Son lait, son beurre, sa crème fraîche et sa raison de vivre au quotidien quelques heures qui lui sembleront utiles. Je pense aux stabulations, aux productions industrielles du lait, aux quotas, aux politiques de Bruxelles, aux prophylaxies vétérinaires et aux farines carnées.
D me dit qu’il y a quelques-uns de ces grands troupeaux dans la région, les fermes d’état de l’époque communiste prestement reconverties en entreprises privées. Le plus souvent par un ancien directeur qui a mis son savoir-faire au service du nouveau vent. C’étaient de vastes coopératives, moins rigides quand même que le kolkhoze.
Je regarde ces champs silencieux, ces quelques vaches éparpillées une par une pour quelques litres de lait familiaux, des vaches du néolithique. Je regarde ces arbres en feu de la forêt panachée, ces maisons en bois exactement comme je m’imaginais les isbas et ces vieilles femmes accroupies devant qui nous voient passer d’un œil évanoui et je me dis que j’ai devant moi un monde qui a connu mes espoirs frelatés de jeune lycéen, un monde qui a vu le communisme et qui n’en dit pas plus que ça.
Ces vieilles femmes-là ont vécu Staline. Je me demande ce qu’elles en pensent, de leur jeunesse. Le dictateur disait que vouloir installer le communisme en Pologne, c’était vouloir mettre une selle à une vache. Se sont-elles laissées seller, ces vieilles dames ? Etaient-elles des rebelles ou des communistes ? Ou bien s’en foutaient-elles de tout ce charabia et qu’elles ont simplement vécu leur vie de femmes polonaises de l’est, à cheval sur deux mondes, la terre sous leurs pas encore tout tremblante et tout fumante des grands tumultes de l’histoire ? Que savent-elles de notre automobile qui passe et du monde qui leur a échappé ? Elles ne sont probablement jamais allées plus loin que le bout de cette rue ou la profondeur de ces champs, mais elles sont allées où je n’irai jamais.
En sont-elles vraiment revenues ?
J’ai souvent dit qu’ayant marché à l’envers, d’ouest en est, je goûtais ici les charmes succulents d’un retard accumulé sans avoir eu à en souffrir les désagréments, le pays bouclé derrière le rideau de fer et fermement bâillonné, les étalages quasiment vides, juste pourvus du strict nécessaire, même si je sais que la dérive communiste a été un peu moins tyrannique ici que dans les autres pays du pacte de Varsovie. L’agriculture, par exemple, n’y a pas été entièrement collectivisée. Les petits paysans y avaient gardé leur maigre lopin en propriété privée et ils y ont vivoté tant bien que mal. En autarcie, sans doute. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Norman Davies dans son histoire de la Pologne en donne quelques explications qui ne me satisfont pas entièrement. Il dit par exemple qu’on peut conduire un Polonais jusqu’à la rivière mais qu’on ne peut pas l’obliger à y boire de l’eau. Et un Tchèque alors, ou un Roumain ? Peut-être parce qu’on ne met, effectivement, pas une selle à une vache. La métaphore de Staline était pourtant à caractère on ne peut plus méprisant.
Je trouve donc cette campagne polonaise pas encore aplatie par le rouleau compresseur des productions hystériques, belle. Parce qu’elle ressemble à la campagne de mes premières années, à mon berceau, avec une agriculture vivrière, des petits champs clôturés de haies, des chevaux, des volailles à l’épave et des gens nonchalants. Je la ramène à moi, à mes nostalgies, à la recherche de mon temps perdu. C’est immoral peut-être. Mais à tout bien considérer, ça ne veut rien dire quand je parle de retard aux charmes désuets. C’est quoi le retard en économie ? Le retard sur quoi ? Sur des plaines réduites au silence des oiseaux par des fous furieux qui arrachaient il y a quelques années encore tout ce qui entravait d’un centimètre l’envergure de leurs semoirs et qui réclament aujourd’hui qu’on les paie pour replanter des haies ? Le retard sur une récolte faramineuse de tonnes et de tonnes de céréales poussées sur des engrais, tellement d’engrais que le sol n’est plus qu’un support relatif, qu’il pourrait tout aussi bien être du carton, du papier, du bois pourri, de la merde de chat, pourvu qu’il soit malléable ?
Mon voisin paysan dit qu’il récolte bon an mal an, trente cinq, quarante quintaux de blé à l’hectare. Il en cultive sept.
J’ai la bouche bée comme un âne bâté.
Quarante quintaux, c’est pas bien ? qu’il dit, mon voisin un peu vexé.
Je dis que les exploitants agricoles de France, du moins ceux de la côte atlantique, parviennent à quatre vingt dix, voire cent quintaux.
Il rigole. Il me prend soudain pour un hâbleur qui aurait la nostalgie de son pays et qui verrait tout en rose des choses de là-bas.
Je persiste et j’enfonce le clou : En plus, ils ont au moins chacun cent hectares à moissonner. Ça, j’en suis pas sûr mais j’annonce de gros chiffres pour qu’il mesure le schisme qui le sépare de ses soi-disant collègues de la famille européenne.
Mais qu’est-ce qu’i font de tout ça ?
Du savon, de l’huile, du rouge à lèvres, des crèmes.
Tes gorets en crèveraient de bouffer leur richesse.
Alors, en retard sur quoi ?
Du retard parce qu’il n’y a pas d’autoroutes ? Immoral jusqu’au bout, que je suis, parce que j’espère qu’il n’y en aura jamais, d’autoroutes. Ça fait hurler d’indignation Marian, un copain francophone et pourtant francophile convaincu. Un égoïste, que je suis ! Parce que, nous, à l’ouest, on a construit des milliers de kilomètres d’autoroutes qui ont détruit des bois, des vallons, des marais, des vallées, des écosystèmes, sans être emmerdés et maintenant qu’on a à peu près fini, on pond des normes, on pond Natura 2000 et on nous empêche de nous équiper convenablement !
C’est un peu vrai…
C’est une question d’arriver à l’heure ou pas au rendez-vous des grandes prises de conscience collective.
In petto, ça me fait penser, sur une échelle sans commune mesure, aux pays qui ont fait péter des bombinettes à tout va pour leurs essais nucléaires, un peu partout dans le monde, Mururoa pour la France, des pays qui ont bien empoisonné pour des milliers d’années leur coin de terre, et qui, une fois bien mises au point leurs armes apocalyptiques, ont tout d’un coup crié aux autres : Stop ! On arrête de jouer avec cette saloperie, c’est trop dangereux, vous ne savez pas faire, vous n’êtes pas adultes, vous en feriez mauvais usage !
Parce que nous, superpuissances nucléaires, c’est pour en faire bon usage ?
C’est pour nous défendre.
Ah ? Et les autres, ils peuvent pas se défendre ?
Personne ne les attaque.
Ah bon ? Et nous, on nous attaque ?
On pourrait nous attaquer.
Avec des fourches alors, ou des manches de pioches.
C’est ce qu’on appelle l’équilibre mondial.
Je ne réclame pas qu’on généralise l’arme nucléaire. J’aimerais que personne ne l’eût jamais eue.
Pour en revenir à l’indignation de Marian, je dis quand même que j’espère simplement que le développement sera ici plus intelligent que chez nous parce qu’il aura su lire nos erreurs. Farouche, il poursuit que nous avons eu le plan Marshall, nous autres. Eux, ils risquaient pas de l’avoir. Marshall reconstruisant Staline….La Pologne est pourtant le pays au monde qui a payé, au niveau de la destruction humaine et matérielle, le plus lourd tribut à la guerre.
Des autoroutes pour quoi faire ? Pour aller où ?
Il me semble que je suis déjà au bout d’un monde et il est trop tard pour être au commencement d’un autre.
Et puis le retard, il est ailleurs.
Il est dans les têtes et il surgit par les regards. Il est un retard de vaincu par les chaos de l’histoire. Plus grand-chose à attendre des hommes, ici. Alors on se tourne vers le ciel.
Qui en prend à son aise.
Qui aplatit lesdits hommes face contre terre.
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.12.2011
Souscription
 J’ai une idée. Deux plutôt.
J’ai une idée. Deux plutôt.
Elles trottent dans ma tête depuis longtemps. Et quand des idées trottent comme ça sous les cheveux, avant qu’elles ne se transforment en obsessions, de deux choses l’une : ou il faut tenter de les réaliser, ou il faut les abandonner.
Je vais donc me servir de L’exil des mots pour vous en dire deux mots, de ces deux idées.
Après avoir réuni tous les textes de ce blog dans un seul manuscrit, j’ai isolé dans un deuxième manuscrit les textes ayant uniquement trait à la Pologne : états d’âmes, paysages, événements, considérations, pérégrinations, culture, etc.
Je les ai retravaillés. Je les ai peaufinés. J’ai rajouté parfois, d’autre fois j’ai retranché. J'ai épuré.
Le manuscrit fait actuellement 160 pages, soit 400 000 caractères. Environ.
L’idée m’est donc venue d’inscrire tout ça dans la pierre et de faire de ce deuxième manuscrit, un livre.
En Pologne, les imprimeurs réalisent vraiment de très beaux ouvrages, méthode offset ou numérique, et le coût défie toute concurrence par rapport aux prix pratiqués en France. Un euro vaut entre 4 ou 4, 50 zlotys.
Impression offset, couverture cartonnée et les frais d’envois (envois individuels) s’éléveraient à 8000 zlotys à peu près, soit 2000 euros. Pour info, l'expédition d'un livre vers la France vaut 25 zlotys.
Je lance donc une souscription à 20 euros et si j’atteins les 100 souscripteurs, dont moi-même, j’y vais.
Et cette expérience me servira de tremplin expérimental pour l’autre idée. Mais sans souscripteurs, cette fois-ci. Cavalier seul et pignon sur rue.
Ce qui m’augmente le coût, c’est que je ne veux tirer qu’à 100 exemplaires, subodorant que je n’aurai, dans le meilleur des cas, pas plus de souscripteurs. Ce serait déjà énorme ! Si je tirais à 500 exemplaires, le prix serait à peu près identique, mais que faire de 400 bouquins dans des cartons ? Ma maison est petite !
Voilà, vous savez à peu près tout. Me donner, je vous prie, votre accord de principe, en privé, adresse de ce blog ou adresse perso pour ceux d'entre vous qui l’ont. Je dis accord de principe car la souscription peut être revue à la baisse si le devis réel pour 100 exemplaires s’avérait être inférieur à celui que j'ai déjà en mains, établi pour un manuscrit de 1 500 000 caractères. Car il va sans dire - mais je le dis quand même - que je n’entends produire absolument aucun bénéfice sur ce projet. Seulement un immense plaisir - que j’espère partagé -, ce qui serait déjà beaucoup, beaucoup… D'ailleurs chaque souscripteur recevrait, sous le même pli que son livre numéroté, la facture détaillée de l'imprimerie.
Peut-être le prix d'un exemplaire descendra-t-il autour de 15 euros. Oui je sais, c'est encore cher. Et si j'optais pour une impression en numérique, comme le font la majorité des éditeurs, je diminuerais le coût de moitié, mais c'est là une expérience unique et je voudrais bien une qualité irréprochable. A voir.
Et si ça n’intéresse personne ou pas assez de monde, hé ben, il n’y aura pas offense, j’abandonnerai l’idée - les deux idées même - et je passerai à autre chose. Au moins, j'aurai la satisfaction d'avoir essayé.
Ce que je puis vous assurer, c’est que le livre serait beau.
Je précise aussi que le nom des souscripteurs, soit serait imprimé en fin d’ouvrage pour ceux qui le désireraient, soit serait tu pour ceux qui m’en feraient la demande.
Mis en ligne le 17 décembre. A ce jour, 15 souscripteurs...La route sera longue.
10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.12.2011
La nuit du voyageur
Trouvé dans mes cartons un manuscrit, tapé à la machine, écrit en 1989, aux Contamines Montjoie. J’en extirpe ici le prologue. Le reste est écrit au vitriol et ne correspond plus vraiment à mes frictions au monde, parce que rien n’est venu en vérifier le bien-fondé. Une pierre abandonnée sur le chemin.
On reconnaîtra aisément de quelle œuvre la première phrase est un détournement. Mais que de temps passé à passer le temps !
LE PROLOGUE
Quand le voyageur atteignit l’âge de cinquante ans, il revint vers son pays natal et vers la rivière de son pays natal.
Le soleil devant lui plongeait derrière un horizon restreint par les mélancolies silencieuses des ormes géants. C’était au jour finissant, à l’heure où les ombres en s'allongeant commencent à trembler.
Un à un des vieillards, puis des hommes, puis des femmes, puis des enfants s’extirpaient des maisons basses et venaient en silence jusqu’au chemin empierré et, tous, de leurs yeux froncés par l’effort et le doute, tâchaient de deviner cette longue cape brune qu’un vent léger faisait flotter, ce large chapeau noir qui balançait au rythme de la marche et ce bâton qui frappait la cadence, par-delà la rivière, sur le coteau pentu, juste avant le pont.
Qui pouvait vouloir ainsi venir vers eux, à l’heure où les ombres en s’allongeant commencent à trembler ? D’ailleurs, la silhouette incertaine venait-elle vers eux ? Passerait-elle le pont ? Enjamberait-elle la rivière ou bien longerait-elle l’autre rive, pour disparaître dans les grands bois qui, plus loin, sur l’aval, avaient depuis longtemps englouti la prairie. Des bois où l’on n’allait jamais. Anonymes. Obscurs. Secrets. Mauvais.
Mais la fébrilité agita soudain les yeux des villageois. Car nul doute à présent : la forme brune, après avoir franchi le pont, montait bien vers eux, et le bâton qui soutenait sa marche frappait la pierre du chemin avec le tempo régulier de la direction préméditée.
Qui pouvait vouloir ainsi venir vers eux, à l’heure où les ombres en s’allongeant commencent à trembler ? Quelque bohémien en maraude ? Quelque chemineau, quelque voleur, quelque criminel fraîchement sorti d’un cachot de la ville et en quête d’un abri pour la nuit ? Pire : quelque illuminé porteur d’onctueuses pommades ?
Dans la petite foule, des poings osseux se refermaient maintenant et des coups d’œil cauteleux, tout empreints d’une sournoiserie peureuse, se tournèrent aussi vers les granges, où sommeillaient des outils contendants… Mais l’homme en noir s’arrêtait déjà à une vingtaine de pas, d’où son regard rencontra celui des villageois.
Un regard vidé de la substance même des yeux. Un regard anéanti. Un regard qui, dans une sorte de morosité sublime, ne semblait appartenir qu’à lui-même, comme s’il vivait en dehors du visage. Dans ce regard-là, qui fit frémir d’effroi, femmes, hommes, enfants et vieillards, se balançait le chaos tragique et muet des fous.
La petite foule, dans un murmure de stupeur, reconnut ce regard.
- Le voyageur est de retour…
Les enfants levèrent la tête vers les yeux morts, les femmes serrèrent plus fort le coude de leur homme, les vieillards baissèrent les paupières, en souvenir brutal du temps qui passe. L’un d’eux s’avança enfin et tendit une main qui ne tremblait plus :
- Voyageur, la rivière et le village de ton pays natal se souviennent.
Trente années après avoir franchi le pont, tourné le dos à la rivière, en ne te retournant qu’une seule fois pour nous couvrir de ton mépris, de quels horizons, de quelles contrées, de quelles aventures, nous reviens-tu ce soir ?
Vois comme nous avons passé ! Vois comme tes compagnons de jadis sont devenus des hommes de l’automne, qui donnèrent au village des enfants qui eurent à leur tour des enfants !
Et le bras maigre du vieil homme, d’un mouvement circulaire en arrière, montrait la petite foule agglutinée dans son dos.
- Voilà trente ans, répéta le vieillard, que tu déchiras les draps qui protégeaient ton enfance et insulta nos habitudes. Inexorables, les saisons qui passent t’avaient chassé de notre mémoire. Jusqu’à ce soir, au contact de ton regard désolant.
Le vieillard se tut et une saute de vent fit frissonner les banches d’un noyer.
- Dans ton accoutrement d’un autre temps, il y a quelque chose qui respire comme la mort.
- Ce ne sont ni mes vêtements, ni mon allure qui ressemblent à la mort, vieillard, ni même le souvenir qui s’agite en toi et te mesure la fuite du temps, mais la façon que tu as conservée de voir tout ce qui t’est étranger.
Tu souffres d’immobilisme,villageois, et ce n’est pas le noir qui t’effraie. C’est le mouvement.
09:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.12.2011
Saisons de la mémoire

C’était en septembre. En route, nous avions demandé sa direction dans une petite ville, sur une petite place, sous une petite pluie, avec un petit vent du nord. On nous avait indiqué en prononçant le nom comme on aurait dit Ruffec ou Mansle, ou Couhé-Vérac, ou Mauzé. J’avais imaginé qu’on allait trembler en prononçant ce nom. J’avais imaginé qu’on allait nous jeter un drôle d’air.
Nous sommes venus.
Rien dans du tout. Un vide par-delà le vide. Comme quand on voit beaucoup plus loin que ce qu’on voit mais qu’on ne peut pas dire ce qu'on voit.
- Pourquoi on est là ? demande l’enfant.
Je ne sais pas répondre. C’est ce qui m’a anéanti. Pas un mot qui veuille donner une explication. Nous sommes là pour trop de choses.
Pour la première fois, les paysages m’ont fait peur. Avaient-ils le droit d’être calmes, d’être beaux, de taire ce qu'ils avaient vu et entendu ? La forêt avait-elle le droit de pousser là ? Et cette clairière si jolie, si sereine...Je savais bien qu’elle était immonde. Une clairière qui a servi l'enfer peut-elle rester une clairière ?
L’enfant trouvait qu’elle était reposante. Elle aurait aimé y jouer un moment. Avec l’enfant, nous ne sommes pas à la même saison de la mémoire.
Et moi, auparavant, je pensais qu’il n’existait pas, cet endroit. Je pensais qu’il n'était gravé que dans l'Histoire, comme une métaphysique de la douleur et du pire. Qu’il n’avait pas de géographie. Qu'il n'y avait pas de géographie pour dire ça.
L'enfant me regarde, voit sans doute qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au fond des yeux. L'angoisse lui vient.
- Pourquoi on est là ? répète-t-elle.
Nous étions à Treblinka. Là où Dieu et les hommes ont définitivement cessé d'exister.
11:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.12.2011
Mais qui n'a jamais été compromis à être écouté par des imbéciles ?

Il est beaucoup question de vanité en ce moment, après l’intervention de Sophie sur mon initiative de souscription et avec le texte magistralement publié ce matin par Roland Thévenet sur son Solko.
C’est la raison pour laquelle, vaniteux comme un pou, j’ai cité une interrogation-affirmation du Zarathoustra de Nietzsche en guise de titre, citer Nietzsche étant depuis longtemps - depuis que la bêtise a force de loi - un trait majeur de la vanité intellectuelle.
Que je précise tout de suite que la citation vaniteuse ne s’adresse nullement aux gens qui se sont exprimés sur mon outrecuidance à lancer une souscription. Ceux-là ont dit sans me compromettre et même plus : en faisant évoluer mon point de vue.
La citation est donc un rempart, un vaccin, contre ceux, éventuels, qui trouveraient que je chipote souvent sur les sous et la rémunération des auteurs et qui, donc, pourraient être tentés d’en conclure assez vite que je ne pense qu’à ça.
Je leur oppose, d’emblée et plaisamment, que si je ne pensais qu’à ça, je serais vraiment le dernier des imbéciles, parce que ne pas réussir à obtenir une queue de radis en cinquante ans tout en ne pensant qu’aux radis, dénoterait quand même une certaine bêtise, voire un certain handicap à. Les sous, c'est un peu comme les champignons, si vraiment on veut se donner la peine d'aller les chercher là où ils se cachent, on en trouve partout.
De ces sous, donc, j’en ai pour assurer ma survie. Si j’en avais un peu plus, je voyagerais un peu plus et je ferais plus de cadeaux aux gens que j’aime, mais bon…J'ai passé l'âge d'aller aux champignons. Disons que le moyen n’est jamais rentré dans ma cervelle en tant que fin.
En revanche - et c’est toujours la même conversation - j’ai horreur, comme tout le monde sans doute, qu’on me prenne pour un imbécile et que, subodorant mon non-amour de l’argent, on en profite pour me voler le peu auquel je pourrais prétendre.
La question des droits d’auteur sur lesquels 80 pour cent des éditeurs font l’impasse et 99,99 pour cent des auteurs silence, me révulse donc et me révolte, non pas à cause de ces sacrés sous, mais à cause d’un jeu de poker menteur, où les cartes sont biseautées par tout le monde et comme une tricherie vis-à-vis du public lecteur.
En gros, le deal tacite se présente en ces termes : je te publie, t’es content, je ne vais pas, en plus, te récompenser d’être content ! Vous pensez que j’exagère ? A votre guise…Mais je parle là de vécu, pas d’hypothèses, et je défie quiconque de venir, preuves à l’appui, me contester la véracité de ce vécu.
Si vous avez à cœur de vérifier, posez donc à un auteur la question suivante : alors, tu en es où de ton livre ? Il vit bien ? T’es content ?
A de très rares exceptions près, vous vous entendrez répondre : j’en sais rien, j’en sais rien…J’ai pas de nouvelles.
Désastreux.
Mais il y a bien pire. On fustige, on méprise, on dédaigne, on vilipende, on prend de haut, on toise les publications à compte d’auteur. Suprême hypocrisie !
Car un éditeur, celui que j’avais par exemple, et non des moindres mais un des plus cotés sur la place, un des meilleurs et un des plus sympathiques, vous retire 300 exemplaires de franchise, sans aucun droit. Pour quoi faire ? Ben, pour payer la fabrication, en partie ou en totalité, du livre, tiens, benêt !
Et vous appelez ça être édité à compte d’éditeur, vous ? Et l’auteur, fiérot, en reniflant et en faisant une moue suffisante, vous dira : je suis édité chez machin. Ah, bravo !
Ben oui , mais bravo de ne pas dire la suite, surtout.
Et j’évoque là un des meilleurs cas de figure : celui où l’auteur a un contrat. Parce que si vous saviez le nombre d’écrivains qui acceptent, la tête basse et la queue entre les jambes, d’être édités sans contrat, vous tomberiez peut-être sur le cul ! Peut-être liriez-vous son bouquin avec d'autres yeux, même, à moins qu'il ne vous y dise, clairement, qu'il est un menteur.
Les dés sont donc pipés. Tout le monde falsifie, auteurs et éditeurs…Et quand vous entrez dans la librairie pour acheter un bouquin à 15 euros, demandez-vous donc deux minutes dans quelles poches vont s’éparpiller ces 15 euros. Une certaine éthique de la lecture commande qu’on se pose cette question. Surtout quand on sait que les petits éditeurs comme celui que je viens d’évoquer sont à la peine, que les libraires en voient de toutes les couleurs, que les distributeurs se plaignent d’une baisse tendancielle de leur taux de profit et patati et patata...
Oui, et alors, qu’est-ce que tu en as à foutre de tout ça ? que j’entends murmurer dans mon dos. Tu écris, c’est ton plaisir, tu es lu, et le reste, ma foi…
Juste un mot que je répondrais : on ne construit pas de jeu social plaisant et riche d’esprit sur des montagnes de falsifications. Et ce n’est donc pas les quelques misérables euros que je pourrais glaner ci et là, et qui ne changeraient rien à ma vie, qui me font défaut, mais la fausseté du rapport humain dans une activité qui m’est chère et que, naïvement, à soixante printemps, j’avais pris pour une activité noble. Retrouver dans cette activité les mêmes filouteries, les mêmes sournoiseries qui font une bonne part du mal vécu dans le travail salarié, me donne envie de gerber.
Est-ce qu’un ouvrier, un employé de bureau, un menuisier, qui aimerait son métier, qui, en l’exerçant trouverait du bonheur, travaillerait pour autant sans toucher un traître sou ? Allons, allons, soyons sérieux !
Et comme je suis en porte-à-faux quand je dis tout cela ! Car les arguments qu’on m’a opposés dans ma bagarre furent : ah, ces anarchistes, qui réclament des contrats ! Ben, oui…Facile…Moi je veux bien, au contraire, ne pas avoir de contrat, pas un kopeck, pas un relevé, rien. Mais dans une société organisée fraternellement sur les sentiments anarchistes. Pas dans une société bancale et de marchands pataugeant dans la merde ! J'ai donc répondu que "je n'acceptais les remontrances sur mon éthique anarchiste, que si celles-ci émanaient de gens moins compromis que moi dans un modus vivendi avec le bloc social."
Je ne vous ai pas parlé de François Bon. Je n’en ai que trop parler : avec lui, c’est la révolution de soie. On change de support, on appelle des porte-soie, et on pratique les mêmes âneries avec le contraire de ces âneries comme slogan…Il me doit toujours 75 euros, chiffre officiel. Ça va bientôt devenir mon Delenda Carthago.
Avec tout ça, hé ben voyez-vous, je me retrouve Gros-Jean comme devant. Je n’ai plus d’éditeur - Antidata n’édite que des nouvelles - et j’ai une flemme énorme, un dégoût même, à en chercher un autre. Le roman qui traîne dans mes tiroirs n’a été présenté qu’à un seul éditeur. C’est tout. Démotivé. Incapable de trouver l’énergie pour minauder avec mon chef-d’œuvre sous le bras. Mais ça reviendra, ça reviendra peut-être. Si je retrouve le goût de la vanité.
Et quand je me rase le matin en pensant à tout ça, je vois une gueule attristée, mélancolique même, qui se demande parfois si j’ai bien fait de mettre les pieds dans ce plat, que je me suis privé de beaucoup de choses que j'aimais, mais une gueule encore propre. La propreté, ça coûte très cher. Mais vous le savez aussi bien que moi. Je n’en doute pas.
Tout cela, donc, nous amène à une certaine gratuité acceptée par l’auteur. J’ai bien dit acceptée. Pas revendiquée. Si elle était revendiquée, ça changerait toute la donne.
Comme sur ce blog…Parce que les blogs, c’est gratuit. Et on y lit tous les jours gratuitement. De tout : des poèmes, des nouvelles, des critiques littéraires, des états d’âme, des analyses du monde en guerre ou des dénonciations de scandales financiers. Tout ça, sans débourser un centime. Générosité ?
Hum…J’aurais attendu le Grand soir pendant quarante ans, j’aurais même, des fois, essayer de le pousser au cul pour qu’il arrive plus vite et il serait arrivé, là, sous mes yeux endormis, sans que je m'en sois aperçu ?
Doit y avoir une erreur. Ou alors faut que je recommence à boire, histoire de voir plus loin... Cette générosité n’est peut-être en fait que l’expression d’un désespoir latent où nous ont conduits tous les acteurs dont je viens de vous dresser, en gros, le portrait. Cette générosité est peut-être un exutoire à la solitude où l’écriture a été plongée par les organisateurs des grandes parties de poker menteur.
Je me souviens aussi de l’époque où je faisais plein de petits concerts Brassens, pour des associations. Avec juste raison, les intermittents du spectacle m’avaient reproché de le faire souvent gratuitement. De quel droit allais-je faire le généreux alors que d'autres, beaucoup plus talentueux que moi, se faisaient payer ? Et un gars du métier m’avait dit : "dans nos sociétés, si tu ne demandes rien pour ton art, c’est louche. Dans l’esprit, si tu ne demandes rien, c’est que ça ne vaut effectivement rien."
J’aimerais que nous y réfléchissions tous ensemble. Que nous réfléchissions au pourquoi de notre gratuité. Que nous élucidions un peu, en tant qu’individus, cette notion de nous être embarqués dans un phénomène de société d’envergure. Oui, j’aimerais bien, sans me faire trop d’illusions. Et je vois des forums et des forums et des symposiums organisés partout sur le numérique sans que jamais, jamais, ne soit effleurée du bout des lèvres cette étrangeté de la gratuité dans un monde où même pour aller pisser il faut mettre la main au porte-monnaie. Car si nos blogs étaient payants, oh, pas beaucoup, un tiers d’euros de-ci, de-là, je ne doute pas que la courbe des statistiques accuserait soudain comme une espèce de déprime.
J’arrête là... Bon, qui n’est jamais à court d’arguments, dirait que je déprime, justement, et d'autres vont dire que je tends le chapeau.
Mais je n’ai pas de chapeau et je vais bien. Très bien même.
Mieux que lorsqu’on voulait me faire avancer à reculons.
Franc comme un âne qui recule, disait mon grand-père.
Image : Philip Seelen
13:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.12.2011
Souscription : réponse à un commentaire
 En optant pour le mode public pour me faire très franchement part de sa réaction à la souscription que j’ai eu l’impertinence de lancer, Sophie a fait un choix qui me donne donc le droit, presque le devoir, d’une réponse publique.
En optant pour le mode public pour me faire très franchement part de sa réaction à la souscription que j’ai eu l’impertinence de lancer, Sophie a fait un choix qui me donne donc le droit, presque le devoir, d’une réponse publique.
Qu’elle soit d’abord remerciée d’avoir exprimé ce qu’elle éprouve. Ça n’est pas si courant par les temps qui courent et surtout là, sur ces blogs où chacun vient exposer son talent - réel ou supposé - et où chacun a à cœur de lui dire que c’est bien et que c’est beau.
Il n’en reste pas moins vrai que, passant par là ce matin, j’ai quand même pris un coup en lisant Sophie. Parce que, contrairement à ce que beaucoup sans doute pensent, contrairement même à ce qui peut transparaître dans ce que j’écris quelquefois ici, je ne suis pas un individu sûr de lui, en matière d’écriture.
Marc Villemain appuyait sur ce côté-là dans sa critique du Théâtre des choses et je tiens Marc pour quelqu’un qui sait lire et ne prend pas les gants de la flagornerie quand il a quelque chose à dire sur un livre ou sur un auteur. Je le tiens pour un professionnel.
Il ressort donc du commentaire de Sophie que, subodorant une qualité littéraire à mes textes sur la Pologne qui leur donnerait une légitimité à être compilés dans un livre, je serais vaniteux.
Ça m’a brassé. Car si croire un peu, si essayer de croire plutôt, à ce que l’on fait, c’est être vaniteux, alors, oui, je suis un vaniteux et cela ne colle pas avec ce que je ressens profondément de moi, c’est-à-dire avec ce sentiment qui me prend souvent d’être dénué d’un talent littéraire digne de ce nom. Surtout après moult échecs, et non des moindres ces temps derniers...Mon entourage immédiat pourrait en témoigner. Ici, seule vaut ma parole.
Mais il y a une limite au doute. Un artiste, un écrivain, un chanteur, un peintre, s’il va au bout de sa logique du doute, ne présentera jamais rien au public. Si j’ai eu, par exemple, le plaisir de mettre Baudelaire, Villon, Apollinaire en musique, suis-je un vaniteux de travailler maintenant à monter un spectacle pour offrir au public en octobre prochain ? Suis-je un vaniteux de penser que cela vaut la peine d’être écouté ailleurs qu’en ma maison ?
La question est posée. Je n’ai pas la réponse. Seul le public la donnera, cruelle ou bien réconfortante. Mais, en tout cas, pour le savoir, il faudra bien que je lui pose.
Retirons maintenant la qualité de mes textes. Après tout, peut-être en sont-ils dénués. Reste alors ce plaisir que j’ai eu à lancer cette souscription et ce plaisir que j’aurais de voir ces textes inscrits dans un livre. Sophie dit qu’elle me donnerait bien 20 euros pour acheter du pain si j’en avais besoin, mais certainement pas pour me faire plaisir. Voilà donc, Sophie, une générosité bien populiste et très bien orientée ! Mais je te comprends et c’est là ton droit le plus élémentaire. Sache cependant que j’ai une autre idée de la générosité et de l’engagement personnel. D’ailleurs, demander à souscrire, n’est pas mendier. C’est associer des lecteurs éventuels à un projet qui ne se réalisera qu’avec eux et pour eux. Et je souris car je me rappelle, hors sujet, un jeune trimardeur à qui j’avais donné 20 francs pour qu’il aille s’acheter des clopes. Tu lui aurais donné, toi ? Moi, je ne regarde pas à l’utilisation qu’on fait de ce que je peux offrir. Quand je donne, je ne subventionne pas. Quand j’étais marchand de bois, j’ai laissé des chargements entiers à des familles qui n’avaient pas les moyens de se chauffer correctement. Par contre, ils picolaient oui, et la part du budget qui normalement aurait du être inscrite au chapitre «chauffage» était inscrite au sous-chapitre «alcoolisme». Donc, c’est un peu comme si je leur avais donné du vin. Tu te rends compte? Et pas 20 euros, Sophie. Mais 2 ou 3 mille francs...De quoi prendre de bonnes bitures !
Au début où j'étais en Pologne, avec un jean et un sac à dos, quelqu'un m'a aidé aussi. Spontanément. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, jamais rencontré. Et qui ne m'a pas demandé ce que je voulais faire des sous. Aider. Point. Aider sans philosopher sur son aide. Une main tendue. C'est resté et ça restera inscrit dans mon coeur et dans ma tête. Cette personne se reconnaîtra si elle vient à passer par là.
Mais je répète : chacun a bien le droit de porter l’idée qu’il se fait d’un être généreux. Et je répète aussi que demander souscription n’est pas mendier, mais anticiper. Je crois même que c’est un système qui devrait se généraliser afin qu’entre les lecteurs et les auteurs, il y ait vraiment complicité, avec court-circuitage des malotrus qui se trouvent entre eux. Le souscripteur achète le livre qu'il veut et que lui propose un auteur, pas un intermédiaire...
Le problème de ma souscription, c’est qu’elle est trop coûteuse, d’accord. Je ferais tirer à 1000 exemplaires que ça ne coûterait que 500 zl. de plus et que ça ramènerait le prix du livre, expédition comprise, à 2,50 euros environ. Mais d’ici à trouver 1000 souscripteurs, il y a l’eau d’un océan à passer sous les ponts.
Par contre, Sophie, je te conteste avec force l’affirmation selon laquelle mon plaisir résiderait à voir mon nom sur une couverture. Là, quand même, c’est un peu en-dessous de la ceinture, comme coup. Et ça n’est plus de la vanité que tu m’attribues, mais de l’orgueil et de la bêtise crasse. Et ça, c’est blessant, vois-tu.
J’ai lu…Je suis reparti dans ma campagne. J’ai joué un peu de guitare - on réfléchit aux coups reçus avec des accords sous les doigts, on s’isole - et j’ai décidé de revenir. Je crois que c’est pour ça. Pour cette assertion blessante.
Alors que dire qui soit autre chose que « non, non je ne suis pas comme ça !!! » Dire que j’ai déjà eu mon nom sur la couverture de cinq ou six livres et que je ne suis pas tombé en transe ni n’ai eu d’intempestives érections ? Dire que j’ai déjà vu mon nom sur plein d’affiches à l’époque où je tournais régulièrement avec mon répertoire Brassens, que ce foutu nom a été cité maintes fois par des journaux locaux, voire nationaux (Marianne(1), Chorus), et des radios locales à propos de mon livre sur Brassens ? Dire aussi qu’à une époque où j’avais encore le courage de croiser le fer avec le système, où je me frottais au monde autrement qu’avec des mots, ce nom a été inscrit, bien trop souvent à mon goût, dans les colonnes des journaux ? Alors, lancer une souscription pour voir mon patronyme une nouvelle fois gravé sur le papier, non merci. J’ai une autre idée, une autre estime, une autre dimension, plus humaine, de mon propre plaisir. Si on me demandait d’inscrire sur la couverture du livre pour lequel j’ai lancé cette souscription Gilles DUPONT, je n’y verrais aucun inconvénient.
Enfin, cette affirmation selon laquelle ce qui est publié sur blog est fait pour être éparpillé et non regroupé dans un volume…J’ai devant les yeux un livre que je feuillette souvent et que j’avais avalé d’un trait quand son auteur eut la gentillesse de me l’envoyer : RICHES HEURES, Jean-Louis Kuffer. Sans commentaires.
Et ceux qui te diront ce genre de sornettes d'une écriture à part, spéciale blog, éparse, courte, regarde-les bien dans les yeux si tu les as devant toi. Ils seront en train de mentir et de transvaser leurs échecs côté victoires. De théoriser la défaite. D'embaumer la fatigue. Surtout s’ils sont des écrivant du net.
Enfin pour conclure, tout ça était peut-être inutile. Si j’en crois le nombre de souscripteurs inscrits (tous écrivains publiés cependant) jusqu’à maintenant, cette souscription se dirige tout droit vers le bide. Un de plus…
Au moins ça fera, dans leur coin, plaisir à tous ceux qui me chérissent tant !
En tout cas, je rends une nouvelle fois hommage, avec sincérité, au courage de ton engagement ici.
(1) Même si c'était pour me démolir.
14:52 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.12.2011
Écriture et lecture au numérique : pratiques et pièges
J'avais écrit ce texte en juin 2009 et l'avais mis en ligne le vendredi 19, avant de me retirer dans ma campagne. Je le publie une nouvelle fois aujourd'hui car il donnait mon sentiment sur la pratique des blogs, à une époque bien identifiée, précise, et que certaines choses ont évolué depuis. Pas beaucoup. C'est la première raison pour laquelle, j'ai mis en italique ce que j'ai modifié de ce texte, réadapté à aujourd'hui.
La deuxième en est que je laisse les commentaires de l'époque, certains me semblant de nature à éclairer certaines choses, toujours d'actualité, un autre éclaircissant aujourd'hui ce qu'il advint par la suite... Il n'eût dès lors pas été honnête de laisser les commentaires et de modifier le texte sans le signaler clairement.
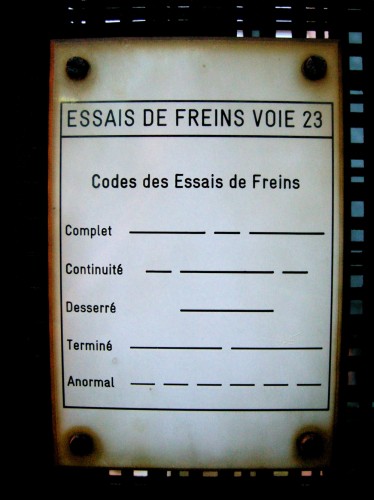 Il est des jours, comme ça, où il faut s’arrêter, poser son cul sur une vieille pierre et, peut-être à mi-pente d’un mamelon herbeux qu’on escalade, jeter un regard en arrière, sur le chemin en contrebas, évaluer aussi, devant, la pente à parcourir encore, puis prendre une décision ou ne pas en prendre.
Il est des jours, comme ça, où il faut s’arrêter, poser son cul sur une vieille pierre et, peut-être à mi-pente d’un mamelon herbeux qu’on escalade, jeter un regard en arrière, sur le chemin en contrebas, évaluer aussi, devant, la pente à parcourir encore, puis prendre une décision ou ne pas en prendre.
Peu importe. L’important est de n’être, un instant, disponible que pour soi-même.
Est-ce là réfléchir ? Le mot est trop vaste pour être noyé dans une simple pause de l’effort. C’est reprendre son souffle.
Soit pour continuer l’escalade d’un pas plus alerte et plus guilleret, regonfler le désir de contempler, de là-haut, le panorama des choses de la campagne, des clochers de villages, des troupeaux, des bois et des brumes, soit pour renoncer et regagner le bas de la colline, sur les berges de la rivière.
Y faire autre chose.
Blogosphère : immédiateté et assiduité
Depuis quatre ans, donc, que j’arpente de mes messages et de mes lectures quotidiennes la montagne internet, j’interrogeais mentalement ce matin le chemin parcouru et celui que j’aimerais y faire encore.
Et si tout ça avait un sens, lequel ?
En premier lieu : si cet espace n’existait pas, écrirais-je ainsi, quasiment tous les jours ?
Je n’en sais évidemment rien. Car rien n'est plus péremptoire que d’affirmer une position réelle dans une réalité supposée.
Je sais en revanche que la motivation est grande de savoir son texte tout de suite disponible pour des lecteurs, certains dont on sait bien qu’ils viendront, peu sans doute au regard des exigences de l’écriture quand elle voudrait être ou devenir une production artistique de l’esprit, mais beaucoup et d’une grande importance cependant quand on sait, et qu’on ose le dire, la solitude du jeteur de bouteilles à la mer.
Avant, le texte se languissait à l'intérieur d'une chemise bien rangée dans un tiroir. Puis, l’auteur prenant quelque hardiesse, il était donné à lire à un proche, à un ami, à un frère.
Verdict le plus souvent bon. Rarement critique. L’affection s’accommode assez mal d’une objectivité déplaisante. Il fallait que l’auteur, si tant est qu’il fût prêt à recueillir un avis, guette le regard fuyant, le poncif énoncé, le raclement de la gorge ou la brièveté de l’échange.
Le manuscrit cependant était porté un beau matin à la poste, en plusieurs exemplaires, avec sur les enveloppes, soigneusement portées, les adresses de maisons prestigieuses ou franchement plus modestes.
Après, c’était l’aléa jacta est, le Rubicon des gens sans armes ni bagages. On jouissait de quelques mois d’attente, campé sur les rives du fleuve. C’était là notre grande récompense. Tant qu’on n’avait pas essuyé le refus, même le subodorant très fortement, surtout après des années et des années d’une même expérience, on était quasiment un écrivain heureux. On attendait. On était en droit de dire et de penser qu’on était un écrivain, qui attendait certes, mais un écrivain quand même. Comme une femme pour la première fois enceinte attend sans doute l’espoir de son enfant et qui, dans sa tête et dans son cœur, est déjà une mère.
On était parturiente promise.
Ce bonheur cessait dès qu’une lettre estampillée par une édition tombait en retour dans la boîte. Avant même de l’avoir ouverte, le charme était rompu. On savait bien, allez, plus d’illusion, ce qu’elle véhiculait : du vide, du rien, du sans-écho.
Immanquablement en effet, c’était l’échec de l’accouchement, l’enfant mort-né. La lettre sans mot et sans audace.
Avec la "révolution internet", donc, le texte vit aussitôt sa vie de texte. In vitro ? Oui, in vitro. Mais au moins il respire, il vit. Et c’est là un certain humanisme des blogs, quels qu'ils soient. Mon propos n'est évidemment pas d'en discuter la qualité.
Pour ce qui nous concerne, la littérature supposée, spontanéité de la publication donc et c’est là, pour qui a bataillé avec les fantômes tentaculaires de l’édition, une grande motivation de l’écriture. Forcément, donc, une générosité nouvelle.
Car tenir un blog, c’est être aussi tenu d’écrire quasiment chaque jour. Et l’écriture se nourrit de beaucoup de choses, parmi lesquelles la continuité. Une bonne raison de ne pas écrire à celui ou celle qui en ressent le besoin ne manque effectivement jamais à personne. Le blog est là, tel un écritoire multifonctionnel, qui exige nourritures et mises à jour et, donc, qui forge, qui chauffe et transforme le fer intérieur. Une chance alors pour l’écriture, presque liée au blog par un contrat d’existence réciproque.
Un copain, lui-même écrivain publié, m’écrivait ceci : l’écriture est un fil ténu. Veiller à ce qu’il ne se rompe pas.
Pièges de l’assiduité
Mais le blog, dans sa générosité justement, représente ce redoutable danger de ne plus écrire que pour être immédiatement mis en vitrine.
Prenons une échelle : sur 500 blogs existants actuellement si, pour ces 500 blogs, les auteurs étaient régulièrement publiés par un éditeur ayant pignon sur rue, combien en resterait-il là, à écrire au quotidien ? Aujourd'hui, décembre 2011, je dirais cent. Et je serais peut-être généreux. Pour beaucoup, dont moi-même, le blog fut au départ l'ersatz, la consolation de l'échec.
L’écriture est un long travail de concentration sur soi-même, de collection d’émotions dans des situations données, de repères retrouvés, cherchés à tâtons, de choses qui voudraient dire l’immatériel enfoui au fond de l’âme, d'éclaircissements de nos confusions, de musicalité intérieure, d’espoir accumulé, de désespoir vaincu, de convictions entr’aperçues, d'archéologie remise au jour par le sentiment du temps qui fuit et qui bientôt ne fuira plus, etc.
Cette écriture-là est celle du loup solitaire. Longtemps, sur le métier sera remis l’ouvrage qui de bribes incertaines fera un tout. C’est l’écriture de l’ombre, la plume qui n’attend rien de l’immédiateté quotidienne, le travail longtemps inaperçu, la main invisible tendue dans des nuits opaques.
Le vent frappe à la fenêtre, le jour se meurt et les ombres grandissent. La page à l’écran reste soudain muette. Grande, grande est la tentation alors de découper l’amont que l’on croit achevé et de l’offrir, dès demain, par tronçons, à la publication sur blog. Ou alors de n'écrire que des textes lapidaires, sur une idée surgie comme ça, pas mûre encore, pas même totalement maîtrisée.
Exister. Écrire sur les murs de la ville. C’est là le piège du blog, la séduction, le miroir suicidaire tendue à l’écriture.
Cette angoisse existentielle nourrie de solitude, et parfois d'états d'âme plus prosaïques, peut même conduire à des aberrations. A des plagiats honteux ou à des textes vidés de leur sang. Parce que personne n'a chaque jour quelque chose à dire qui mériterait vraiment d'être dit. Et quand bien même ! Personne ne peut, à moins d'être un génie - mais ça se saurait par ailleurs - présenter quotidiennement à ses lecteurs un texte achevé du point de vue d'une littérature digne de ce nom.
Alors où est le hiatus ? L'écrivain offre-t-il des sous-marques à ses lecteurs en étant présent tous les jours ou trois ou quatre fois par semaine ? A-t-il dans l'ombre un réservoir travaillé et qu'il distille au numérique ? Et si la quantité risque de produire la pacotille, que dire des lecteurs qui prennent la parole et qui, à chaque fois, trouvent ça malgré tout et toujours formidable ? L'abondance des interventions pervertirait-elle la finesse d'esprit de la lecture ?
Je n'en sais trop rien...Mais j'ai quand même le sentiment, aujourdhui, en reprenant ce que j'écrivais il y a deux ans, qu'il y a dans tout ça, une sorte de décadence due à la générosité internet et, en même temps, une perte réelle de sincérité entre le lecteur et l'auteur. Quand on monte sur scène, par exemple, si on est mauvais, si ça ne passe pas, les applaudissements ne mentiront pas : l'artiste sentira bien, allez, qu'ils sont de politesse et de courtoisie, ces applaudissements. Il ne sentira pas ce chaud enthousiasme, cette amitié complice des soirs où ça veut rire !
Sur le blog, il en va tout autrement sans doute. Le mur du silence souvent mal contourné par le bavardage.
Le livre au numérique
 Des écrivains assidus, tel Jean-Louis Kuffer, ne seront pas d’accord, sans doute, avec cette vision de la fréquence présentée comme pouvant être un handicap sérieux à la qualité et fronceront leurs sourcils dubitatifs.
Des écrivains assidus, tel Jean-Louis Kuffer, ne seront pas d’accord, sans doute, avec cette vision de la fréquence présentée comme pouvant être un handicap sérieux à la qualité et fronceront leurs sourcils dubitatifs.
Les éditeurs, libraires, écrivants, écriveurs et écrivains les plus acharnés contre le numérique, en sont, aujourd’hui, à en supplier les secours. Qu’il les tire de l’ombre où la grande pagaille des lois du marché les a jetés.
Je suis toujours un grand amoureux du livre traditionnel et mon ambition d’écrivain était d’être publié à la fois en numérique et en livre papier, ambition que j'avais partiellement réalisée pour deux ouvrages. Je dis "partiellement" car il s'agissait de deux ouvrages différents et je verrais bien un livre mener double vie, en même temps numérique et traditionnelle.
Ça n'est plus le cas : Bon a supprimé mes livres parce que je lui demandais où j'en étais et que, devant ses mensonges, ses reculades et ses atermoiements, je me suis énervé beaucoup, comme les lecteurs de L'Exil des mots le savent. Je remercie d'ailleurs au passage, les lecteurs qui sont restés avec moi après que j'eus dénoncé les pratiques de cet aflligeant bouffon, comme ceux, nombreux, qui sont venus depuis. Quant à ceux qui ont fui, inutile d'en parler, puisqu'ils ont fui. Ce serait déjà leur faire bien trop d'honneur.
Je crois cependant que, sans la marmite internet, un livre, et à plus forte raison son auteur, n’arrivera plus jamais à être présenté convenablement au grand banquet des lecteurs. Les trois livres que j'ai publiés depuis trois ans m'en persuadent encore plus.
L’édition numérique, donc, quand elle trouvera des gens honnêtes pour lui mettre le pied à l'étrier, publiera des livres. Elle ne sera pas cannibale et ne se nourrira donc pas d’autres livres.
L’atelier de l’artiste
Le site est en même temps l'atelier, la diction du monde au quotidien, la prise de notes, l’accumulation de matériaux, l’esquisse de la réflexion, l'antre du Pygmalion.
Gloire alors aux pratiques ainsi définies de l’internet ! L’artiste a son atelier à ciel ouvert et le public visite, commente et, en amont de l’œuvre, en goûte tous les cheminements. J'ai dit "commente" et c'est un mot important...Lourd de responsabilité. Car si un passant vient régulièrement dans l'atelier et trouve toutes les ébauches formidables, l'artiste va finir par se croire achevé et n'en sera, du coup, déjà plus un. Pour peu qu'une foule d'éditeurs l'aient déjà refusé, il sera en droit de se dire : finalement, je suis meilleur en ébauches qu'en rédaction finie. Ce qui est quand même le monde à l'envers, à moins que cet artiste n'ait l'orgueil et la bêtise de penser qu'il est bon dans le spontané et nul dans le travail. En un mot comme en cent, voilà un fier grimaud !
Cette option de l’atelier suppose cependant que l’artisan/artiste ait d’autres lieux d’exposition, d’autres galeries à faire valoir. L’ébéniste jonchera l’atelier de copeaux et de sciures qui sentiront bon la forêt, qui embaumeront la résine, mais le meuble partira bientôt vers sa vie de meuble cousu main, vers sa destinée «sociale» d’œuvre humaine. Peut-être dans le salon coquet d’un autre artiste qui en sera tombé amoureux.
Mais quel plaisir, quelle délectation de l’avoir vu naître devant vous ! J’ai passé des heures à regarder travailler des artisans, des scieurs de long notamment. Un ravissement, de l’arbre brut à la pièce de charpente aux formes si pures, aux galbes parfois si étonnants, et parcourue par les arabesques des printemps successifs de la vie, immortalisés dans sa matière.
Générosité encore de l’internet. Travail à ciel ouvert. Mais il faut alors une clarté des rapports entre l’artiste et son public, d'autant que le public émet un avis que d'autres publics liront. Et c'est la raison pour laquelle je disais à l'instant que le passant avait une responsabilité énorme vis-à-vis de l'artiste, une responsabilité qui n'admet pas la frivolité. S'il veut flagorner, séduire, rencontrer un auteur plutôt qu'une écriture, il entraîne tout le monde dans sa triste erreur. Mais si ce "tout le monde" est un peu sensible et intelligent, alors le flagorneur passe, in petto, pour un imbécile. Ce qui n'est alors, ma foi, que du pain bénit, comme disait ma grand-mère.
Je suis donc assez heureux de voir le nombre des lecteurs de L'Exil des mots en augmentation régulière, alors que pratiquement plus aucun commentaire ne vient se poser sous les textes, si j'excepte l'ami Solko, Elisabeth, Sophie et quelques autres. Bizarrement - mais non ! ça n'est pas si bizarre que ça, dans le fond - je me retrouve beaucoup plus proche de mes lecteurs. Dans ma tête. Je vous sens proches et amis. J'aimerais quand même, parfois, qu'on me dise où ça n'est pas beau. J'attends beaucoup plus ce genre de contribution que des compliments. J'aime mieux le piment que le miel, moué ! Le piment fouette. Le miel endort.
Lecture des blogs et sites
Tout ceci nous amène à reconsidérer autant notre pratique d’écrivain que notre ambition de lecteur. Le foisonnement des envies d’écrire, la multiplicité de leurs motivations et la diversité humaine des émotions et conviction intimes - et je me réjouis personnellement de toute pluralité - font forcément qu’une sélection s’impose.
Farfouiller partout c’est aller nulle part. Au fil des mois et des années, un parti pris se crée donc. La lecture est ciblée pour chacun d’entre nous et, sur l’immense étang des blogs et des sites où nos barques voyagent à coups de clics, se créent les ronds concentriques de l’affectivité.
C’est le cloisonnement quasiment nécessaire de l’internet. La transversalité a ses limites si elle veut rester effective et qualitative.
Que dire alors de ma zone de navigation ? Six ou sept sites en tout, dont l'atelier cité plus haut, ici, là, ici et quelques autres encore. C’est à peu près le tour d’horizon permis au quotidien si l’on se propose, dans la journée, de travailler à sa propre écriture.
Au-delà, c’est la journée quasiment consacrée au voyage, la journée de congé qu’on s’octroie, la balade chez tous les voisins.
C’est bien, c’est agréable aussi, et c’est parfois nécessaire.
Bon, il faut que je lève mon cul de cette pierre.
Je n’ai pas pris de décision. Il n’y en avait d’ailleurs pas à prendre.
Le ciel au sommet de la colline est dégagé. J’ai repris mon souffle. Je vais aller voir là haut si l’air est frais et si les paysages sont prêts à me tendre les bras.
Nous avons tous nos Mythes de Sisyphe.
Images : Philip Seelen
17:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.12.2011
Idę do koscioła
 La nuit au dehors, que je vois par les vitres de la fenêtre, est noire et sans étoiles. Il est seize heures. Nous prenons le thé en grignotant des gâteaux tout chauds, faits maison. Délicieux, très fins.
La nuit au dehors, que je vois par les vitres de la fenêtre, est noire et sans étoiles. Il est seize heures. Nous prenons le thé en grignotant des gâteaux tout chauds, faits maison. Délicieux, très fins.
Je discute et plaisante avec le jeune homme. Vingt-cinq ans.
Quand je discute avec un autochtone, c’est toujours avec des phrases squelettiques, le verbe est le plus souvent à l’infinitif, les déclinaisons sont massacrées, la prononciation mise à rude épreuve, l’accent tonique rarement sur la bonne syllabe. Traduit dans ma langue, ça pourrait donner, par exemple :
- Hier, moi aller vers marché et acheter de la pomme très pas mauvaise.
Vous voyez le genre !
Mais les Polonais n’ont pas été habitués à ce qu’on vienne habiter sous leurs cieux - surtout des gens venant de l’ouest - et qu’on y parle, en plus, avec leurs mots. Ce sont eux, qui, au cours de l’Histoire, ont dû aller vers les autres et apprendre pour survivre un langage nouveau. Alors, ils sont d’une indulgence et d’une gentillesse exquises. Ils sont contents de l'effort fourni et ils savent bien que leur langue n'est pas facile. Ils ne vous interrompent donc pas pour corriger, ils vous disent pas de soucis, je comprends, et c’est très agréable quand on est un cancre de mon acabit.
Ça n’est pas comme avec ces Anglois perchés sur leur accent à la noix comme des coqs sur leurs ergots et qui vous toisent et qui rectifient et qui font minent de ne pas comprendre, et qui sourient sournoisement, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus dégoiser un son, retour immédiat à la case inhibition. Les Français, quoique un peu moins, sont un peu comme ça. Ils ne supportent pas bien qu’on massacre leur langage, eux qui ne sont pourtant pas de grands linguistes. Ce sont là orgueils des peuples qui ont eu, à un moment donné, la prétention d’être les maîtres du monde. Les pendules de leur cerveau ne sont plus tout à fait à l’heure !
En Polonais, donc, malgré les incorrections et les approximations, le message passe très bien. Humainement. On ne discute pas de Schopenhauer, certes, ni de La Métaphysique des mœurs, mais on discute de petites choses et on rigole, même. Surtout avec ce jeune homme que je connais bien, toujours souriant et que j’aime beaucoup.
Ce soir-là, tout en plaisantant sur la théière qui, selon lui, a des allures "Versailles"(nous sommes chez ses parents), il regarde fréquemment vers la pendule. Je me dis qu’il doit sortir, rejoindre quelques copains au bistro, à Wisznice. Ou alors, il a une petite copine qui l’attend, le coquin ! Il ne veut pas, aussi agréable que puisse lui être ma compagnie, louper son rendez-vous, et ce n’est pas moi qui lui en ferai grief !
Il se lève, me tend la main, me sourit et me dit :
- Idę do koscioła…Je vais à l’église….
Quoique je sois habitué au catholicisme prégnant des campagnes de l’est, la situation pour moi change radicalement. Et je reviens à la réalité : je suis un étranger, bien loin de mon pays, bien loin de tout ce que j’ai connu, bien loin de l’esprit dans lequel je me suis fait, bien loin de ma vision des choses du monde.
Le jeune homme ne m’en reste pas moins et ne m’en restera pas moins sympathique.
Une discussion s’en est suivie.
Je dis à D., vois-tu, c’est dans ces moments-là qu’on se sent vraiment un étranger. Je dis qu’en France, un jeune homme de vingt-cinq ans ne partirait pas, comme ça, à l’église…Alors on discute longtemps. D. a sur moi l’incomparable avantage d’être née ici, de tout comprendre, et de la langue et de la culture, et d’être en même temps très imprégnée par la culture française. Alors elle dit oui, mais tu viens du pays le plus laïc d’Europe et tu vis dans le plus catholique. Forcément, le décalage est abyssal.
Et nous parlons de l’histoire. De l’église polonaise située du côté des opprimés sous la dictature communiste, de l’originalité de ce pays, le premier pays slave à se tourner vers Rome, en 966, et des affrontements qui en ont découlé avec la Russie orthodoxe, du poids de l’église au niveau de l’Etat et dans la tête des gens. Oui. Tout cela est vrai. Indéniable. Sauf que je fais remarquer que l’église polonaise était du côté des opprimés parce qu’elle-même opprimée par le système collectiviste. Sinon, quand elle est du bon côté du fusil, les opprimés qui sont mis en joue, ça n’est pas vraiment son affaire…Au besoin même, elle appuierait volontiers sur la gâchette. Le sabre et le goupillon, etc.
Et j’évoque la France non pas en tant que fille aînée de l’Eglise, comme on se plaît à le dire, mais en tant que bras armé de l’Eglise dans la christianisation du monde. Je parle de dix siècles de servitude exercés sur le peuple, dix siècles de dîmes, de richesses, de spoliation, j'évoque les jeunes filles découvertes à la Révolution dans les couvents où elles avaient été enfermées pour servir de jouets aux perversions sexuelles de la hiérarchie ecclésiastique…Je parle de l’affreux Richelieu.
D. sait tout ça aussi bien que moi. Nous sommes d'accord depuis longtemps là-dessus. Nous ne discutons pas de Dieu. L’idée de Dieu n’a strictement rien à voir avec l’église. Nous discutons du poids historique d’une institution qui, pour moi, tout empreint d’éducation et de culture judéo-chrétienne que je sois, est une institution totalitaire.
Nous discutons de la même église, mais nous en évoquons une histoire différente, parce que déroulée sous une autre latitude historique et géographique.
Et de quel droit jugerais-je l’histoire des autres, ai-je pensé bien plus tard ?
Du haut de quelle vérité condamner ce jeune homme qui file à l’église dans la nuit froide et noire ?
Du haut de la vérité de ces intellectuels, ou pseudo intellectuels athées, qui trouvent leur religiosité dans d’autres espaces, dans d’autres mensonges, dans d’autres leurres, avec la copie conforme de l’esprit totalitaire de l’église comme mode d’appréhension inversée du monde ?
Le contraire d’un contraire revient toujours, tel un boomerang, à son point de départ initial.
Et combien de ces fiers athées, par ignorance ou complicité, ont donné leur caution morale et idéologique aux communistes de Moscou, assassins autant des anarchistes que des chrétiens, affameurs de peuples et briseurs de rêves ? Combien ?
Je suis athée. Je crèverai athée. Je n’ai pas dit matérialiste, j’ai dit athée. Je crèverai avec la détestation de l’église-institution. Mais je ne jetterai plus la pierre aux convictions et habitudes sociales qui ne sont pas les miennes. Qui se situent même aux antipodes de mes ressentis.
Car en fuyant cette erreur vieille de plus de deux mille ans, dans combien d’erreurs nous sommes-nous fourvoyés nous-mêmes ? A combien de menteurs, d’escrocs, d’usurpateurs, de voyous de la conscience, avons-nous, sinon fait allégeance, du moins foutu par faiblesse et lâcheté une paix royale ?
Aurons-nous le courage de dire que nous ne sommes pas plus avancés que l’obscurantisme que nous fuyons de nos belles ailes d’hommes libres et que nos mots ne sont en la matière que piaulements d’impuissants à faire cesser les aliénations ?
Alors va, jeune homme, dans la nuit noire et sans étoiles … Nous partagerons encore le thé et le gâteau et rirons encore de choses simples. Dans mon soi-disant propre camp, j'ai vu et je vois, j'ai lu et je lis encore tous les jours, des comportements et des truismes bien plus hallucinants et bien moins naifs.
Bien moins francs, tout compte fait.
Image : Philip Seelen
13:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.12.2011
Coup d'fil
 Un paysan chez lequel je travaillais régulièrement au ramassage du tabac, les mois d’été quand j’étais môme, m'a légué une expression bien étrange, bien irrévérencieuse aussi, et que je ne retrouve - sans doute pour cause qu’elle n’existait que dans sa bouche - dans aucun lexique des expressions.
Un paysan chez lequel je travaillais régulièrement au ramassage du tabac, les mois d’été quand j’étais môme, m'a légué une expression bien étrange, bien irrévérencieuse aussi, et que je ne retrouve - sans doute pour cause qu’elle n’existait que dans sa bouche - dans aucun lexique des expressions.
Un qui aurait donné du fil à retordre à Alain Rey, donc.
Si d’aventure il avait subitement envie de faire caca alors que nous étions au milieu des champs à nous échiner sous un soleil sans âme et qui nous tannait la nuque, il courait se planquer derrière une haie ou dans le bosquet le plus proche et immanquablement nous lançait son occulte métaphore :
- M'en va téléphoner au pape, les enfants !
Le brave homme avait le goût de l’intimité et la pudeur des grandes choses de la vie. Il ne voulait pas qu’on écoute sa conversation avec un personnage aussi auguste et se prenait sans doute, dans ces circonstances-là, pour le premier moutardier du pape. En tout cas, le coup de fil avait à chaque fois l'air de s'être déroulé de façon fort aimable, car l'homme en revenait béat et, saisissant la bouteille de vin enveloppée du chiffon humide qui la gardait au frais, s’en régalait d'une large lampée, s'essuyait la lèvre d'un revers de son gros bras poilu, se roulait une cigarette de tabac gris et se remettait paisiblement à l’ouvrage.
S’il n’était aujourd’hui parmi les Gentils, il lancerait à coup sûr :
- M'en va envoyer un mail au pape, les enfants !
L’homme n’était pas particulièrement anticlérical, du moins n’en faisait-il jamais montre, sinon, comme tout le monde, par une absence assidue aux messes du dimanche matin.
Alors ? Non...? Vous croyez... ? Ah bon...? Hé ben.. !!
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.12.2011
Hiver fantasmé
L’affligeante douceur de nos hivers, pour la plupart gris sous les vents humides de l’Océan, nous faisait, à nous enfants, toujours espérer une exception, une extravagance du climat qui ferait se durcir durablement la terre, emprisonnerait la rivière sur laquelle nous pourrions glisser, et recouvrirait de neige silencieuse les villages, les champs, les chemins et les bois.
Nous imaginions - en tout cas j’imaginais - un ciel noir prometteur d’autres intempéries sur les plaines livides, avec de sinistres corbeaux, comme sur les images de mon livre d’histoire, comme celle surtout où « Il neigeait, nous étions vaincus par nos conquêtes » et que « pour la première fois l’Aigle baissait la tête », sa longue armée défaite, en pointillés haillonneux derrière lui, sur les steppes glacées de Russie.
J’imaginais les gens consignés au coin des cheminées à raconter des histoires anciennes, le facteur et le garde-champêtre privés de leur vélo, les gendarmes de leur auto, le boulanger empêché de faire sa tournée, bloqué au fournil, obligeant les paysans à se regrouper autour du four commun.
J’avais lu cela dans des livres et dans des poésies. Ça arrivait dans des villages, près des montagnes, et même, c’était arrivé chez nous, racontaient les vieux avec cet air narquois, propre à ceux qui ont tout vu et que rien ne peut plus étonner. « Autfoué ». Pendant la guerre. Fait toujours très froid pendant les guerres.
Aussi nous, pour qui la guerre n’était que divagations séniles, chaque automne, cherchions-nous à dénicher les signes avant-coureurs d’un rude hiver.
C’étaient l’abondance de baies sauvages dans les buissons épineux, l’épaisseur des pelures d’oignons récoltés en août, la précocité du triangle des grands migrateurs cacardant haut dans le ciel, la multitude des bandes de passereaux erratiques tournoyant sur les champs récoltés.
Nos prévisions, à mi-chemin entre l’observation des tripes de poulet et le satellite météo, s’avéraient évidemment presque toujours fantaisistes et je passais alors mes hivers à lire et relire les récits pétrifiés de froid et haletants d’aventures de Jack London ou de Curwood, dans de vieux livres, verts dessus et jaunes à l’intérieur, empruntés à la bibliothèque de l’école.
Je n’abandonnais Mukoki, mes Iroquois, mes trappeurs et mes loups que pour mettre le nez face au vent, voir s’il s’était enfin décidé à passer à l’Est ou au Nord.
Mais il pleuvait et les arbres se voûtaient sous le souffle salé des tempêtes maritimes.
J’en ai gardé une rancune inextinguible envers ces climats océaniques, justement vantés pour la clémence de leurs saisons, pour leur molle tempérance, avec leurs hivers insipides et sans personnalité, mornes, avec des Noëls fangeux en bras de chemise, des jours de l’an dans le brouillard et des Mardis-Gras maussades. Des hivers qui ne ressemblaient en rien aux calendriers des PTT avec ses villages engloutis par la neige, aux cartes de vœux scintillantes de flocons et aux images de fête.
Entre l’Océan et moi, entre l’élément liquide et moi, entre les prétentions métaphysiques à l’infini de cette nappe chaude et agitée qui faisait fondre tous mes rêves et moi, la dichotomie est devenue viscérale.
Je promène ainsi un sentiment profondément anti-océanique, qui vient bien sûr de beaucoup plus loin que la frustration du froid et des hivers transis. Ce n’est là sans doute que la partie visible de l’iceberg.
Si entre l’eau et le poisson, l’amour n’est pas fusionnel que reste t-il à ce poisson pour vivre sa vie de poisson ? La détestation d’un environnement vital n’est que la détestation d’une condition confuse en proie au mal de vivre.
C’est bien étrange, mais tout ce qui venait de l’est ou du nord, me semblait plus beau et plus vrai.
Là, il y avait bien fusion amoureuse avec des éléments que je ne connaissais pas et dont les contours n’étaient dessinés que par l’imagination. Il me semblait ainsi que tout ce qui se passait dans les brumes chez nous était décadent et sans intérêt. Quand j’appris, dès mes premières années de collège, que les Pères-Noëls en istes de ma mère et de mon mauvais voisin étaient nichés là-bas, dans le froid lointain, du côté d’où ne venaient jamais les vents, mon être enfantin a savouré vaguement comme une sorte d’harmonie du monde.
Tout concordait, le froid, la neige, la glace, les soleils levants et les preux chevaliers, abolisseurs de pauvreté et bouffeurs de curés.
A cinquante quatre ans, il y avait déjà plus de trente ans que les messies avaient été dans ma tête démasqués comme des usurpateurs, et pourtant, abandonnant tout de ma vie, à l’heure où tout le monde, à commencer par moi-même, croyait mes ailes définitivement refermées et le consensus avec l’équilibre enfin accompli, j’ai marché vers l’est, jusqu’à une autre latitude, jusqu’à d’autres climats aux froids blancs et brutaux et sous lesquels on ignore à peu près tout de la mer et du vent d’ouest, des plages et des odeurs de sel, des bateaux aux ventres dégoulinant de poissons.
Déraciné, certes, mais dans les culottes courtes de l’éternel retour. A la recherche d’un Graal que semblaient me cacher les rideaux de pluie et qui, sans doute se trouve dans cet ailleurs si lointain qu'on le nomme communément nulle part.
Texte publié en novembre 2008
08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.12.2011
Bancale versification matinale
Il a neigé à gros flocons,
Il a neigé sur ma maison.
Il a neigé à gros flocons,
Adieu pelouse ! Adieu balcon !
La nuit l’hiver à pas de loup
A mis la terre sous ses verrous,
Accusée de délit de fuite
A l’autre bout de son orbite.
Il a neigé sur les chemins,
Il a neigé jusqu’à demain,
Où s’inscrira sur mon cadran
Couleur de craie un nouvel an.
A l’aurore allumant mes feux,
Ce poème à la six-quatre-deux
M’est tombé d’ssus sans crier gare
Et c’est pas vraiment du grand art.
Mon vieux, voilà que tu débloques.
Faudra écrire ça sur ton blog.
Ici la rime est imparfaite :
Ma muse n’est pas toujours en fête !
Il a neigé à gros flocons,
Il a neigé sur ma maison,
J’ai dérapé sur mon balcon,
Et m’suis ramassé comme un con...
11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.12.2011
Exil
 Il faudra un jour, bientôt peut-être, - je le sens- que j’écrive l’histoire de mon exil.
Il faudra un jour, bientôt peut-être, - je le sens- que j’écrive l’histoire de mon exil.
Six ans et demi que j’ai quitté mon pays, que je vis en étranger et six ans et demi que tous les jours, au moins une fois, le nez au vent, je me dis : pourquoi ?
Je me pense, je me vois et je me sens étranger. Je n'ai donc pris aucune de ces habitudes qui font qu'on ne se sait plus vivre, en tant qu'individu unique, parce qu'on est dans un élément qu'on ne voit plus.
Je n'ai pas pris l'habitude d'exister.
Sais-tu ce qu’est un étranger ? A l’intérieur, je veux dire. Par-delà la géographie ?
Il faudra sans doute que j’écrive tout cela pour tenter de ne pas mourir étranger à moi-même.
Car si je sais la cause première, tangible, évidente - trop évidente sans doute pour être la seule - de mon exil, je n'en sens pas moins quelque chose de plus profond qui m’aurait poussé à m’extirper des fleuves où trempaient mes racines. Souvent nous prenons de grandes décisions sur une cause précise, mais le vent qui nous pousse vient de beaucoup plus loin.
Je regarde les chemins de sable qui contournent la forêt ; j’entends les blizzards sur la cime des arbres, je regarde tomber la neige ou la pluie, j’entends cette langue chuintante, dansante, qui n’est pas la mienne, où les mots n'ont pas l'odeur du lait, je parle à des gens, par bribes, qui ne savent rien de mon histoire et n’en sauront jamais rien. Comme si j’étais une brindille d’un arbre mort qu’une tempête aurait fait voltiger jusque là.
Est-ce qu’on choisit sa solitude ? Je n’en sais rien. La solitude, c’est quand on la vit mal. Je suis seul et ne me sens pas si seul au fond ! Ma maison est en bois. Après cinquante ans de béton et de pierres, elle n’est pas vraiment une maison pour moi. Elle est bien plus. Elle est un bateau, une partie intégrante de la forêt et, comme elle, elle sent la résine de pin. Je ne m’y ennuie jamais. Je fais corps avec elle, elle fait corps avec mon voyage.
Et est-on toujours responsable de la solitude ? Mon exil a fait des ravages que je n’aurais pas devinés au départ : un à un, j’ai perdu tous mes amis et plus encore que mes amis, les membres les plus solides de mon histoire. Je suis même irrémédiablement fâché avec des gens que je n’ai jamais vus, des fantômes de la création, des sillons creusés par l’esprit, des gens dont je ne sais même pas le visage, ni l'odeur ni le timbre du rire ! La solution de facilité est de conclure que le désert sort de mes entrailles, que j’attire le néant, que je suis associable, injuste et, pourquoi pas, méchant. Ne remettre en question que soi, pour magnanime que cela puisse paraître aux yeux du vulgaire, toujours approximatifs, n’est qu’une infirmité supplémentaire de la capacité à saisir intelligemment les situations. Presque un refus. Une hypocrisie de plus pour s’estimer aimable. Une attitude pour ramener à soi les éléments perdus dans la bataille. Tout s’explique soudain par son propre nombril, avec une simplicité tellement simple qu’elle ne peut être que faussée ! Admettre alors que je suis responsable du désert, ce serait admettre être la seule erreur de la végétation, de n’être même qu’une erreur. Tant d’ingénuité m’arracherait volontiers un sourire !
Le désert qui s’est créé autour de moi ne vient-il pas plutôt d’une incompréhension mutuelle ? Ceux qui sont restés dans leur culture, dans les draps de leur berceau, pour intrépides voyageurs du libre esprit qu’ils se pensent être, ne comprennent pas les exigences, la sensibilité exacerbée, la mélancolie et la vision nouvelle du déraciné qui ne voit plus du haut de ses remparts, mais d'en bas... Et le déraciné ne comprend rien à leur logique, à leur liberté, à leurs tracas, aux chemins empruntés qui mènent, peut-être, à leur propre senti du bonheur. Il ne comprend rien à la résolution de leur exil à eux. Et les déserts alors, de par cette incompréhension mutuelle, n’ont pas de limites. Ils sont absolutistes : étranger sur la terre où je me promène, je le suis devenu sur la terre d’où je viens. Je n’ai alors plus qu'un poncif où porter mes regards : les étoiles. Le ciel est sur nous comme un drap, chantait Ferrat.
La beauté des choses n'est nullement altérée en moi. Seulement ce vide humain qui me donne parfois le vertige.
Mais ce vide est-il nouveau ? L’exil n’a t-il pas rendu seulement apparent ce qui était déjà essentiel ?
Si j’en crois le bonheur que j’ai à le contempler, ce vide, je dirais que si. Qu’une des réponses à mon exil est là : j'ai voulu savoir si le choix des solitudes détruirait le poids des habitudes; de celles qui sont tellement imprégnées qu'on croit qu'elles n'en sont pas.
Je cherche les clefs. Sans les clefs qui ouvrent les portes du pourquoi de soi-même, on vit en prison.
Combien d’hommes libres avez-vous croisés qui aient, sans mentir, ces clefs-là en mains ?
Moi aucun.
Pas même moi.
Il faudra un jour, bientôt peut-être,- je le sens- que j’écrive l’histoire de mon exil. Si l'écriture peut être une clef.
J'en doute fort. Elle farfouille tellement souvent dans des serrures qui n'ouvrent sur aucun secret qui vaille la peine d'être dévoilé à qui que ce soit, ni à l'écrivain, ni à ses lecteurs.
11:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.12.2011
Le langage et les chevaux
 Au pays et ses chemins de pierres où cahotaient mes premiers pas, vivaient aussi de fiers et robustes chevaux.
Au pays et ses chemins de pierres où cahotaient mes premiers pas, vivaient aussi de fiers et robustes chevaux.On les conduisait à la voix.
Alors les chevaux s’arrêtaient.
Ces chevaux avaient une langue.
Ces onomatopées d’un monde oublié me sont revenues en ce lointain pays et je les ai entendus, les conducteurs de ces plaines et des forêts, menant d’immenses chevaux rouges, masses impressionnantes de muscles et de force et qu’on m’a dit être ceux montés jadis par les effroyables chevaliers teutoniques, terreurs des villageois, exterminateurs incendiaires des campagnes.
Ils reculent aussi sur un vocable étrange Nazad.
J’ai voulu caresser le bout de leurs grands museaux où fumaient deux farouches naseaux plus doux que le velours.
Et au-dessus pérorait un pinson sur la branche en bourgeons. Je ne le voyais pas tant le ciel étincelait mais je savais que ce chant sortait du petit poitrail rose d’un mâle en parade.
Mais il est vrai que les hommes ne parlent pas aux oiseaux.
Alors, des plages de l’océan aux frontières de la steppe, ils pépient une chanson qui m’a semblé universelle.
L’exilé est partout à la recherche des sons qui le ramèneraient chez lui.
08:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : litterature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.12.2011
Le bonheur

Dans un monde où le malheur et le chagrin des gens sont planifiés comme chevilles ouvrières destinées à maintenir l'équilibre de l'ensemble, seul le bonheur primaire, sauvage et solitaire est subversif.
09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : litterature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.12.2011
Petite pause
 Me suis couché hier comme un vieil oiseau blessé. Un chasseur à l’affût m’a ajusté dans son tir et brisé les ailes.
Me suis couché hier comme un vieil oiseau blessé. Un chasseur à l’affût m’a ajusté dans son tir et brisé les ailes.
On laisse toujours derrière soi un chasseur à l’affût quand on regarde trop le brouillard des horizons incertains, sans promesses précises, et qu’on vole de ses propres ailes, par-delà les habitudes du commun.
L’oiseau qui vole comme ça a l’air d’un voleur de ciel. Le chasseur, en bas, lui en tient tant rigueur, au sol qu’il est cloué, qu'il fait bientôt jusqu’à lui voler sa mitraille mortelle.
Me suis blessé hier comme un vieil oiseau couché et la nuit sur moi s’est refermée. J’ai vu le premier croissant de lune entre deux arbres gelés et me suis endormi.
Je ne te dirai pas ma blessure, lecteur. Tu ne viens pas là pour ça et trop de fois impudique, j’ai laissé couler ici le sang de mes afflictions.
Tu ne viens pas là pour ça ; tu as toi-même tes blessures et tes chasseurs à l’affût.
Tu viens pour m’entendre écrire autre chose que l’intimité d'un être. La littérature, si tant est que ce blog soit littéraire, sait parler des choses les plus profondes de la vie, seulement quand ces choses se sont comblées avec du temps. Quand on a oublié qu’on a eu mal.
C’est un art à contre-temps pour lecteurs à contre-temps.
Un ou une qui vivrait une vie fabuleuse avec tous ses désirs et ses souhaits comblés, ses espérances, ses chimères aussi, n’écrirait jamais. Un ou une que le mal vient à terrasser songe à tout, sauf à écrire. Il accumule, si écrire est de son amour de vivre, la matière incandescente qui, un jour, peut-être, s'il guérit, se couchera, solidifiée, sur la page.
Pour l’heure, merci à toi, lecteur, d’être là…Vous étiez encore plus nombreux ce mois-ci à venir me lire.
Lire mes contre-temps.
12:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET



















