26.06.2013
Réclame et CD
 Mon projet d’inscrire sur CD des poèmes que j’’ai mis en musique - un Baudelaire, un Villon, un Apollinaire -, trois fables de La Fontaine, deux chansons posthumes de Brassens dont j’ai eu l'immodestie de réécrire la musique parce que celle proposée par Jean Bertola n’était pas à mon goût, plus deux compositions de mon cru, est toujours à l’ordre du jour.
Mon projet d’inscrire sur CD des poèmes que j’’ai mis en musique - un Baudelaire, un Villon, un Apollinaire -, trois fables de La Fontaine, deux chansons posthumes de Brassens dont j’ai eu l'immodestie de réécrire la musique parce que celle proposée par Jean Bertola n’était pas à mon goût, plus deux compositions de mon cru, est toujours à l’ordre du jour.
Je me rends donc régulièrement au studio d’enregistrement et voilà bien qui est tout à fait nouveau pour moi !
Insouciant et trop sûr de moi, pour tout dire ne doutant pas de ma dextérité, je pensais en effet que cela serait beaucoup plus facile, que j’allais me ramener avec ma guitare, salut les gars, m’asseoir devant un micro, accorder, gratter, entonner, et hop, dix morceaux, dix heures, et l’affaire était dans le sac !
Las, las ! Chanter et jouer en public ou pour soi-même n’a rien à voir avec le studio. Je le découvre à mon grand dam. Parce que là, en séance d’enregistrement, on est en situation de laboratoire où il n’y a pas d’autre écoute statique et muette que celle de l’exigence de la technologie qui entend tout et qui ne laisse rien passer. Un doigt qui s’accroche un tout petit peu sur un accord, une corde qui vibre un millième de seconde de trop, la voix qui faiblit ou qui commet une fin de phrase un peu douteuse du point de vue de la tonalité, une mesure en trop ou bien en moins et basta, tout est à refaire…
On en sue sang et eau. Du moins mézigue. Parce que le technicien et propriétaire des lieux, lui, au demeurant fort sympathique, est d’un calme olympien, perfectionniste jusqu’à m’en hérisser le poil, sérieux comme un pape, si tant est qu’un pape soit sérieux.
Il affirme à chaque fois qu’il aime mes mélodies, mes arpèges et mes accords, que le son de ma guitare est très doux, que ma voix éraillée est particulière et qu’il faut que tout cela soit absolument parfait. Il enregistre des groupes de renommée nationale, il a fait ses preuves, alors il veut un CD sans une entorse. Pour moi et pour sa réputation. Comme je suis un parano indécrottable, je me suis dit au début qu'il me chantait la messe pour faire durer et gagner du fric. Jai cependant appris par la suite qu’il était effectivement professionnel au point de refuser de continuer d’enregistrer des musiciens qu’il ne trouvait pas bons.
J’en ai un peu bombé le torse. Jusqu’à ce qu’il me foute moi-même dehors, peut-être….
Tout ça est bien. Parce que moi, un peu laxiste, beaucoup même, je laisserais volontiers filer quelques défectuosités … Comme sur scène, comme en live.
Ce qui est gravé est gravé, dit-il. Ben oui. Rien, en revanche, n’est plus éphémère que la scène, c’est là tout le contraire.
Le gros problème, c’est que, m’appliquant trop, je ne puis y mettre le cœur que je veux. Trop concentré sur la réalisation technique et la justesse de la mesure, j’en oublierais presque la force du texte et comment il doit être chanté selon moi. Or, reprenant en cela le mot de Brassens, j’aimerais bien que la musique soit accessoire, tout en étant indispensable, comme elle l’est au cinéma : qu’elle souligne mais ne relègue pas le texte au second plan.
Toute la difficulté est là ; chanter et jouer autant avec sa tête, son savoir, qu’avec ses tripes. La synthèse n’est pas toujours facile.
Alors, je me suis donné beaucoup plus de temps qu'initialement prévu. Sur dix morceaux, seule la musique de sept d'entre eux est sauvegardée, car nous avons décidé d’enregistrer sur deux pistes, d’abord la mélodie, ensuite les paroles. Ce qui oblige à être encore plus rigoureux et à travailler avec le métronome.
On verra bien. Je n’en vois, optimiste quand même, le bout qu’à l’horizon de l’automne prochain. En tout cas, expérience intéressante et qui remet fondamentalement en cause le peu de talent dont on croyait être pourvu.
Comme en écriture. Rien de tel qu’une bonne critique négative pour remettre les pendules à l’heure et la vanité de soi au diapason. C’est le cas de le dire.
Au cas, donc, où vous seriez intéressé pour écouter un jour mes sueurs artistiques, il faudrait me le dire gentiment par mail, que je sache un peu où je vais.
Le prix ? Ah, le prix !? Hé bien, je n’en sais pour l’heure foutrement rien, ne sachant pas encore combien d’heures il va me falloir travailler et de combien d'écus sonnants et trébuchants sera donc la facture.
Mais ça ne devrait pas dépasser, frais de port compris, 17 ou 18 euros. Et puis, si ça les dépassait et que ce serait trop cher, alors je n’en tirerais qu’un ou deux exemplaires, que je mettrais dans un tiroir, histoire de me dire que j’ai fait un jour un disque.
On s’amuse comme on peut, n’est-il pas ?
14:12 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.06.2013
Quelle conscience dans la conscience des hommes ?
 Le regard du paysan était bleu très clair et miroitait avec les ombres de l'après-midi déclinant. Il nous invita à prendre place sur deux planches à l’état brut, qui faisaient corps avec une table tout à fait sommaire.
Le regard du paysan était bleu très clair et miroitait avec les ombres de l'après-midi déclinant. Il nous invita à prendre place sur deux planches à l’état brut, qui faisaient corps avec une table tout à fait sommaire.
Le tout était posé sur un plancher bancal qui se voulait une véranda.
Le paysan parlait.
Ses parents étaient venus d’Ukraine après la guerre, des environs de Lwów. Poussés vers le nord-ouest, mais pas beaucoup, quelque deux cent kilomètres seulement. Il se mit soudain à évoquer les grandes plaines de l’Ukraine et ses yeux bleus vacillaient légèrement quand le bras tendu, pour illustrer le propos, montrait l’est, derrière son dos.
Tandis qu’il racontait, je le regardais beaucoup. Moi l’étranger, j’étais venu voir un autochtone et j’étais assis devant un gars qui ne se sentait pas chez lui, là, sous sa veranda de fortune. Un gars qui parlait de son déracinement à lui, avec une voix monocorde, toute empreinte de tristesse.
Il inversait joliment les rôles et sans doute avait-il raison. Car moi j’étais tout de même ici de mon pauvre chef, tandis que lui, c’étaient les chambardements frontaliers qui l’avaient échoué dans ce village, comme les tempêtes échouent sur les plages, les algues des fonds marins et les objets qu’on jette par-dessus bord des navires. Mais tous ces rejets, ça se ramasse, ça se conditionne, ça s’élimine. Lui, soixante ans après, il était resté tel qu’aux premiers jours, planté sur le même sable.
Il dit qu’avec les communistes, il avait trois vaches, un cheval, un cochon et des poules et, par-dessus tout, une paix royale. Personne ne venait fouiner dans ses affaires. Maintenant, il avait une vingtaine de vaches, une trayeuse électrique et il vendait tout son lait à la laiterie. Le lait devait être comme ci et pas comme ça, il avait fallu faire des évacuations, des aérations, des vaccins, des prévisions et il n’entendait rien à la paperasserie qu’on lui demandait. Et puis au final, il n’avait pas plus de sous qu’avant avec des tonnes d’emmerdements en plus. Alors ? A quoi ça avait servi tout ça ?
Il posait la question en se penchant en avant.
D. balbutiait liberté, droit des gens, démocratie…Il haussait les épaules, hautement moqueur, mais sans aucune brutalité.
J’ai appris beaucoup de cet homme. J’ai découvert en quoi, peut-être, résidait la force pérenne des dictatures. Pour ce paysan, comme pour bien d’autres de par le monde, - un discours similaire m'avait été tenu une dizaine d'années auparavant, sous d'autres cieux, par un autre paysan, très loin d'ici, dans les environs de Salamanque- le communisme tel qu’appliqué à l’est, c’était le droit de faire ce qu’il voulait dans son jardin. Pourvu qu’il ne s’y enrichisse pas de façon trop ostentatoire et ne fasse montre de ses opinions, on ne lui demandait rien. Il avait un gîte, de la pitance et la course du soleil pour éclairer les jours et compter les années. Le reste, la liberté d’écrire, de parler à voix haute, d’écouter, de lire des livres et des journaux, de voyager plus loin que la rivière, c’était affaires d’intellectuels, de penseurs et de gens des villes parce que leurs maisons, leurs rues et leurs usines étaient trop étroites.
Le petit paysan, lui, il s’en fout de ces libertés-là. On ne lui a jamais appris à s’en servir, alors leur privation ne le meurtrit pas. La muselière intellectuelle ne le gêne pas. La vie est ailleurs. Elle se mesure au jour le jour, saison après saison. Elle se joue au printemps avec les labours et les semailles, l’été avec les moissons, l’automne avec le ramassage des pommes de terre et l’hiver avec la lutte obstinée contre le froid, la neige et le vent. Ce qu’il y a par delà ces rideaux quotidiens, il ne faut pas s’en mêler. C’est de la politique et la politique…La politique, ça fait des guerres et des morts.
Je pensais à la Makhnovchtchina. Que des paysans, incultes de notre point de vue, et pourtant vainqueurs de Dénikine. Et s’ils n’eussent été par la suite crapuleusement égorgés par Trotski, qu’auraient-ils fait de l’unique expérience anarchiste au monde qu’ils avaient mise en place en Ukraine ? Jusqu’où les tsars les avaient-ils volés et jusqu’où avaient-ils été violés dans leur droit à l’existence, qu’ils aient pris une part aussi cruciale, intelligente et violente à la grande déferlante de l’histoire ?
Cet homme sec aux mains raboteuses, là devant moi, ce paysan d’origine ukrainienne, s’il était né seulement quelque trente ans plus tôt, aurait-il fait partie de l’épopée et été un compagnon de Makhno ?
J’étais sûr que oui, il me plaisait d’en être sûr, et je le regardais décliner ses phrases et ses mots nostalgiques et je me disais que l’histoire, les luttes, les trahisons, les échecs, les vérités, les morts, les prisonniers, les réussites, les idéaux, les tactiques, les alliances, les buts, les systèmes, tout ça, c’était les hasards du réel, les leurres d’un prisme déformant et que les hommes n’entendaient rien, absolument rien à la mise en scène de leur propre destin. Ils étaient des ombres. Des balbutiements.
J’en éprouvai une profonde tristesse.
Extrait( modifié) de Polska B Dzisiaj
13:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.06.2013
Exception culturelle ?
 Elle a dévoré le Comte de Monte-Cristo avant de se lancer à corps perdu dans les Trois Mousquetaires, pour enchaîner aussitôt avec Vingt ans après.
Elle a dévoré le Comte de Monte-Cristo avant de se lancer à corps perdu dans les Trois Mousquetaires, pour enchaîner aussitôt avec Vingt ans après.
Elle n’en sort pas, penchée sur ses lectures, absorbée.
Ses livres ne la quittent plus d'une semelle.
Elle les a même emmenés à l’école. "Pour lire pendant les pauses", me dit-elle, et ça me rappelle vaguement quelqu'un, au collège, il y a de cela plus de quarante ans...
Un groupe de copines cependant s’approchent, intriguées.
- Qu’est-ce que tu lis ?
- Les Trois Mousquetaires.
- Ah bon ?! Parce qu’ils ont fait un livre sur le film ?
Elle hoche la tête, soupire avec ostentation et disparaît derechef dans le sillage des Trois Mousquetaires qui, finalement, étaient bien quatre.
________________
Complètement hors de ce sujet d'apparence plutôt légère, je vous invite à lire ce texte mis en ligne par Feuilly et qui renvoie à un article qui fait froid dans le dos.
Qu'au moins ne soyons jamais de ceux qui pourraient dire un jour : Nous ne savions pas !
11:42 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.06.2013
L'intelligence des absurdités
 Les grands d’un monde de plus en plus petit se sont donc retrouvés quelque part en Irlande, où ils ont sablé le champagne et dégusté la langoustine.
Les grands d’un monde de plus en plus petit se sont donc retrouvés quelque part en Irlande, où ils ont sablé le champagne et dégusté la langoustine.
Ne nous en offusquons cependant pas outre mesure ! Car un vieux cantique d’inspiration libertaire - qu’ils ignorent sans aucun doute - dit que le ventre plein, l’homme peut discuter.
Et les grands étaient justement là pour discuter le bout de gras.
Quand des grands discutent, c'est bien connu, les petits, si tant est qu’ils aient reçu une éducation convenable, la ferment, même si c’est de la sauce à laquelle on se propose de les bouffer dont il est question.
Donc, discussions, discussions, et vous, là-bas, au fond de la classe, un peu de silence, s’il vous plaît !
A l’heure qu’il est, on ignore encore si, sur la Syrie, les grands ont trouvé consensus entre la poire et le fromage. On sait juste que le grand Français n’en démord pas : il faut armer les jihadistes jusqu’aux dents ! C'est son Delenda Carthago et c’est assez curieux. On se demande pour qui il roule, parfois, ce grand-là ! De qui il est le porte-parole.
Le grand Russe, lui, qui, du haut de son mètre cinquante quatre, voit toute cette tuerie devant sa porte, est d’un avis tout à fait contraire : il faut armer le camp d’en face.
On n’y comprend goutte, nous autres, parce qu’on est des petits.
Mais il n’était pas question que de la Syrie autour du festin des grands. 80 000 morts, qu’est-ce que c’est à côté de nos autres préoccupations ? Par exemple celles qui tournent autour du libre-échange ?
Selon ce que j’ai entendu dire au café du commerce, là, on semble à peu près tous d’accord. Faut lever toutes les interdictions, les protections, les tabous financiers, les taxes douanières d’un autre âge et il faut que la marchandise circule entre nous sans autre forme de peccadilles. Il en va de la santé du petit, tout ça, et c’est primordial… Parce qu’un petit en bonne santé, ça ne braille pas, ça ne réclame pas, ça joue peinard tout seul dans son coin et ça fait pas chier le monde. Circulation plus libre des marchandises, ça veut dire aussi plus d’argent pour les gros, amis des grands, plus d’argent pour les gros, ça veut dire plus de travail à donner aux petits et plus de travail aux petits, ça veut dire, encore une fois, plus le temps pour eux de s’occuper des affaires des grands, ça veut dire des vacances, une maison, un jardin, un nain de jardin, une belle bagnole… Bref toutes les joies du bac à sable quand on peut s’acheter plein de jouets.
Je suis d’accord avec tout ça. Mais je n’en suis pas moins perplexe. Qu’est-ce qu’ils y entendent au libre-échange, ces grands ? Car figurez-vous que pas loin de chez moué, sur la frontière de l’Europe donc, il y a un parc immense de plus de 25 hectares, remplis jusqu’à la gueule d’automobiles flambant neuves. Des bagnoles par milliers et par milliers, des fortunes et des fortunes en marchandises pures ! Mais qu’est-ce qu’elles foutent-là, ces bagnoles, japonaises, allemandes, françaises, américaines ; ces bagnoles de la mondialisation ?
Hé ben, elles attendent tout bonnement d’être désossées, pièces par pièces, méticuleusement, pour passer en Russie où des ouvriers s’appliqueront à les remonter, pièces par pièces et tout aussi méticuleusement.
C’est idiot, n’est-il pas ? Oui, mais il se trouve que les droits de douane sur les pièces détachées sont peu élevés alors que ceux sur une bagnole entière sont faramineux.
Alors, on démonte tout ça, des milliers de voitures vous dis-je, et on exporte ainsi, non pas des automobiles, mais des bouts d’automobiles. Astucieux, n’est-ce pas ? Et tellement intelligent !
Ne me demandez cependant pas pourquoi les exportateurs se font chier à monter les bagnoles en usine au lieu d’expédier directement tout ça en kit, dans des cartons, parce que j’en sais foutrement rien. Peut-être pour amuser la galerie. Ou alors des règlements, des astuces légales, amphigouriques, des raisons qui échappent à la raison des petits, car les voies des seigneurs sont impénétrables !
Hé ben, me suis-je dit quand même en tournant les talons au parc gigantesque où s’entassent toutes ces rutilantes automobiles, s’ils s’y connaissent autant sur les tenants et aboutissants des tueries en Syrie qu'en matière de libre-échange, les grands escogriffes de ce monde, je crains fort que ce ne soit pas demain qu’ils trouvent leur chemin de Damas !
Allez, sur ce, bon week-end au soleil à tous ! Et si d'aventure vous fomentez le projet de changer de voiture bientôt et que vous trouvez ça un peu trop sévère pour votre budget, demandez donc à votre mécano s'il ne vous serait pas loisible d'acheter un carburateur là, une porte ici, un phare ailleurs et un pneu je ne sais où... Peut-être ferez-vous quelques économies, même si ça risque de vous prendre pas mal de temps pour recoller tout ça...
10:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : écriture, littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.06.2013
Le début de la fin
Un compatriote de passage en Pologne me disait il y a quelques jours que certains petits paysans français et des Associations revenaient au travail de la terre avec des chevaux, par souci environnemental et préservation d'une certaine biodiversité, massacrée après plus de cinquante ans d'exploitation mécanico-industrielle.
Plaisante mais drôle d'idée, me suis-je dit ! Et m'étonnerait fort que les idéologues de la croissance, poussés au cul par les lobbies financiers, ne leur tordent le cou avant longtemps !
 Quand j’étais môme - il y a de cela déjà trop longtemps - notre plus proche voisin répondait au glorieux prénom de Louis, mais sans numéro de dynastie, sinon celle des pauvres gens un à un crucifiés sur l’autel de l’agriculture à bénéfices : Louis avait en effet été un des derniers à se résoudre à motoriser sa maigre activité de petit paysan.
Quand j’étais môme - il y a de cela déjà trop longtemps - notre plus proche voisin répondait au glorieux prénom de Louis, mais sans numéro de dynastie, sinon celle des pauvres gens un à un crucifiés sur l’autel de l’agriculture à bénéfices : Louis avait en effet été un des derniers à se résoudre à motoriser sa maigre activité de petit paysan.
Il avait pourtant eu de beaux et de robustes chevaux, dont il avait été très fier. Mais, lassé peut-être d’être en butte aux lazzi du voisinage, il lui avait un jour pris fantaisie d’acheter un tracteur, avec l’argent de ses deux chevaux prestement expédiés à l’abattoir, justement, augmenté d’un bien gentil petit coup de pouce d’un monsieur du Crédit qui, le cheveu gominé et bien peigné, était spontanément venu lui proposer ses services, en serrant sous son bras une sacoche noire, en sautillant sur la pointe de ses pieds vernis de cuir et en riant qu’il faisait bien mauvais temps.
Le tracteur de Louis flamboyait tout rouge. Un tracteur allemand avec un grand nez arrondi et deux phares globuleux au bout de deux longues tiges courbées comme des antennes, qu’on eût dit un grotesque grillon. C’était un Porsche, que Louis s’empressa de baptiser Popo, parce qu’il ne concevait pas qu’on puisse tirer une charrue ou une remorque sans avoir un nom. Il lui parlait d’ailleurs amicalement et pour le conduire se servait presque autant de la voix que des différentes manettes. Il regrettait cependant très amèrement que son nouveau cheval à gasoil fût allemand, lui que les Fridolins avaient fait prisonnier pendant cinq ans et qui avait maintenant des aigreurs d’estomac tellement qu’il avait mal mangé là-bas, une vingtaine d’années auparavant. Des racines, qu’il disait qu’il avait mangées et il avait bu l’eau croupie des ornières. Il se plaignait surtout du massacre de son anatomie à la fin d’une barrique, quand le vin était devenu un peu aigrelet. A cause de ces salauds de Boches, il finirait par être obligé de ne plus en boire, de son vin ! A moins de passer à deux litres par jour, progressivement, au lieu de quatre. C’était quand même malheureux de risquer de s’étouffer comme ça ! Il espérait, devant nous les enfants, qu’il n’y aurait plus jamais de guerre. Que c’était une saloperie, la guerre !
Au moins, cet estomac rebelle lui inspirait-il de généreuses pensées humanistes.
Je me souviens aujourd’hui d’un dimanche après-midi où le village somnolait lourdement sous le soleil au zénith. A moins qu’il n’y soit contraint par une urgence, une vache qui met bas, un orage qui menace d’éclater sur les foins encore entassés dans la prairie, le paysan se plaît à imiter Dieu et à se reposer le septième jour.
Louis, ce dimanche-là, ne l’avait cependant pas entendu de cette oreille. Dans le silence surchauffé, on l’entendit soudain démarrer l’engin, le faire hurler et péter, puis on le vit qui prenait la clef des champs, ne tractant pourtant aucun outil.
Interpellé par sa femme qui levait les bras au ciel, Louis justifia en criant au travers des pétarades et des soubresauts de la machine encore mal maîtrisée, qu’il fallait bien qu’il promène Popo, comme s’il se fût agi d’un animal domestique qui devait prendre l’air par ce bel après-midi d'été.
Louis et Popo devinrent ainsi la risée de toute la communauté villageoise.
Surtout que leurs marches-arrière étaient déjà légendaires. A la fenaison, quand le père Louis était vu avec une remorque de foin pleine à craquer, on venait de tout le village pour assister à la manœuvre de Popo se hasardant à reculer le chargement sous la grange. Car Louis n’avait jamais pu intégrer cette physique mystérieuse de la flèche de sa remorque selon laquelle il fallait braquer les roues à droite si l’on voulait reculer à gauche et inversement. Il fulminait, il enrageait, il tempêtait que ces conneries le faisaient vraiment trop chier et le tracteur se retrouvait immanquablement à l’équerre. Il avançait à nouveau, lâchait l’embrayage trop tôt, le grillon allemand se cabrait alors et... calait. Opiniâtre, Louis reculait encore, le public hurlait des stops qu’il n’entendait pas et les fourragères heurtaient alors violemment les énormes portes de la grange, et ainsi de suite, tandis que s’envolaient les bordels, les noms de dieu de merde et les putains de saloperie de remorque !
Louis consacrait plus de temps à reculer son foin qu’il n’en passait hier pour étrier son cheval, le faire boire, l’harnacher et l’atteler. De plus, quand la remorque avait été enfin vidée, si c’était l’après midi, il n’avait plus l’entrain nécessaire pour refaire un autre voyage qui aurait supposé un autre supplice à reculons. Deux marches arrière par jour l’auraient assurément tué. Alors il remettait au lendemain et s’allait faire une petite sieste pour se remettre de ses émotions, ponctuant sa sage décision d’une plaisanterie plus grosse encore que ses sabots, Louis dort.
Le gain de temps au bout du compte était négatif. Sans doute comme les chiffres que lui envoya un triste matin le gars à la sacoche noire et aux souliers vernis.
Louis prit alors son plus bel habit et le bus. Il revint de la ville, la tête baissée comme jamais et on vit bientôt un autre tracteur plus gros et plus fort que l’Allemand labourer, herser et ensemencer ses champs.
Louis n’était plus aux commandes. Louis allait maintenant à la pêche, sa blessure de guerre se faisait de plus en plus cruelle, mais il n’en parlait quasiment plus. D’ailleurs, il ne parlait plus de rien. Il semblait seulement attendre quelque chose de terrible, l’air accablé et les yeux rivés sur son bouchon inutile, qui dansait sur le fil de l’eau.
Bien d’autres après lui sont revenus de chez les messieurs aux souliers vernis tête courbée et contemplant sans les voir le bout de leurs godasses, même s’ils savaient reculer une remorque de foin et même si les Boches ne leur avaient pas supplicié l’estomac. Les plus jeunes d’entre eux ont ramassé femmes, enfants, armes et bagages et sont allés goûter aux délices des samedis libres et des horaires fixes sous les tôles surchauffées d’une usine.
Les autres, trop avancés déjà dans les saisons de la vie pour bifurquer sur une autre piste, se sont assis au bord de la rivière ou alors se sont allongés sous les tilleuls et les noyers.
Et ils ont attendu là, fatigués d'exclusion et marmonnant des mots soudain d’autrefois, le grand départ.
13:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.06.2013
Le Docteur Zola
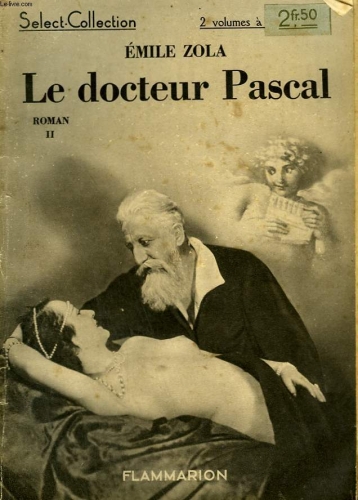 En situation d’attente, par désœuvrement, donc, beaucoup plus que par envie réelle, je lisais ce matin un texte sur la façon dont Emile Zola avait préparé son dernier roman de la série des Rougon-Macquart, le Docteur Pascal.
En situation d’attente, par désœuvrement, donc, beaucoup plus que par envie réelle, je lisais ce matin un texte sur la façon dont Emile Zola avait préparé son dernier roman de la série des Rougon-Macquart, le Docteur Pascal.
Comment faire un roman, qui par nature et tradition est une fiction, avec à l’esprit la prétention, sinon d’une démonstration, du moins d’une illustration scientifique ?
Zola consulte des amis professeurs de médecine, tous spécialistes de l’hérédité et de ses lois, relit des notes, découpe dans de vieux journaux des articles sur le sujet, compare, compile, peaufine l’arbre généalogique qui, depuis le début, lui sert de canevas, et en oublie bientôt qu’il lui faudrait quand même un semblant d’intrigue.
Il ébauche la rédaction, s’aperçoit qu’il a trop de personnages, délaye et en supprime, notamment une dénommée Marie, qui ne verra donc jamais le jour littéraire se lever sur son existence putative, supplantée par une certaine Clotilde, nièce et bientôt amante du Docteur Pascal.
Le romancier ne perd cependant pas de vue qu’il fait œuvre scientifique et la dernière note à son feuilleton fleuve doit aussi en être le point d’orgue.
L’écrivain hésite donc entre l’inspiration littéraire et la connaissance didactique qu’il prétend avoir de son sujet.
Tout cela se passe à Médan et tout cela se passe assez bien quand, tout à coup, patatras ! madame Zola découvre la liaison clandestine que monsieur Zola entretient avec Jeanne Rozerot. Un orage furieux secoue alors le couple, on s’en doute un peu si tant est qu’on ait vécu en couple et qu‘on ait voulu, furtivement, vivre un jour une liaison volée au quotidien et à l’ennui des jours. Le bon petit père Zola, on peut s’en douter aussi si l’on a bien lu son œuvre et sa biographie, choisit la fuite en avant, et, pour bien montrer qu’elle reste prioritaire, embarque sa légitime dans un long périple en Normandie, puis à Lourdes (espérait-il un miracle ?), puis à Aix-en-Provence, Marseille, Cannes, Nice, Gênes, Monte-Carlo, délaissant ainsi, ostensiblement, la maîtresse.
Voyager, c’est un peu guérir, sinon son âme, du moins les apparences de cette âme, n’est-ce pas ?
Mais le Docteur Pascal dans tout ça ? Hé bien le Docteur Pascal, lui, prisonnier dans la tête de l’amant pris la main dans le sac, tombe pendant ce temps-là amoureux de sa nièce, un amour impossible, à la limite de l’inceste, un amour de tragédie grecque.
Le romancier peut dès lors se remettre au travail, sublimer sa frustration d’avoir sacrifié son amour fautif au profit de la bienséance sociale, et découvrir le plan général de son livre.
Je dirais donc que sans l’aventure amoureuse de Zola et de Jeanne - la mésaventure plutôt - le Docteur Pascal aurait certainement suivi un destin tout à fait différent.
J’ai l’air de moquer, mais l’air seulement.
Car peu d’écrits au monde, même les plus peaufinés littérairement, peuvent en effet se targuer d’être pétris dans la pure fiction, nés, un peu comme les microbes de la génération spontanée de Claude Bernard à qui Zola emprunta la méthode et le mot "expérimental" en l'appliquant au roman, de l’imaginaire absolu.
A dire vrai, je ne me souviens plus très bien du Docteur Pascal, lu il y a quelque quarante ans. Mais, ce matin, en situation d’attente, par désœuvrement, donc, plus que par envie réelle, j’ai eu l’impression d’assister à sa véritable naissance et j'ai souri.
L’hérédité et ses lois, dans tout ça, me semblent bien n’avoir que l’importance d’un décor, voire celle d’un prétexte.
Et qu’est-ce qu’on peut ingurgiter comme fadaises, quand même, sur les bancs d’un lycée !
12:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.06.2013
Des branches branchées
 Dans un autre monde, dans un pays lointain, dans une structure honorable mais en des temps pas si reculés que ça, des esprits bienveillants m'avaient un jour choisi pour être un communiquant.
Dans un autre monde, dans un pays lointain, dans une structure honorable mais en des temps pas si reculés que ça, des esprits bienveillants m'avaient un jour choisi pour être un communiquant.
Un qui relaierait sur toutes les branches et brindilles de l’arbre de la susdite structure honorable, les messages des grands décideurs perchés tout là-haut sur les cimes azurées, trop haut pour être entendus de tous.
A moins qu’ils ne se soient mis en devoir de crier, ce qui aurait été quand même peu élégant et peu convenable en ces lieux réputés pondérés.
On aurait pu raccourcir l’arbre, certes, enlever des branches pour qu'il soit plus lisible, l’émonder quoi ...
Bien-sûr… Oui sans doute… C’eût été une solution… J'y pensais même souvent... Surtout qu'il y avait beaucoup de ces branches qui n'étaient que du vent : on ne les voyait que lorsqu'elles bougeaient.
Mais tel ne fut pas le cas, alors on me gratifia de cette grande marque de confiance qui consistait à être le haut-parleur des Olympes. Des esprits chagrins, des fâcheux, des qui n'sont jamais contents du sort des autres, allaient même jusqu’à dire « à être la voix de son maître ».
C'est malin !
Faisant fi de ces bas sarcasmes et bombant même avantageusement le torse, je m’étais senti investi d’un bien noble mandat.
Je fus en outre affublé du titre de chargé de communication et c'est ainsi travesti que je me mis d'arrache-pied au travail. Travail de réunion, travail de compilation d'informations, travail de synthèse et de rédaction.
Mais, tout chargé que je fusse, j’avais juste au-dessus de ma tête une branche plus chargée encore, à qui je devais pépier mes élucubrations, laquelle branche avait elle-même une autre branche au-dessus d'elle, une surchargée, à qui elle devait gazouiller l’avancée de mes travaux et dont elle recevait aussi des directives.
Pas facile, tout ça…Un qui pépie, un qui gazouille, l'autre qui siffle, arrivé là haut, ça finit par faire une belle cacophonie.
Bref, ces trois branches-là, dont moi, causèrent longtemps pour mettre au point une stratégie de distribution des messages.
Et là, je n’y entendis soudain plus goutte.
J’avais naïvement pensé qu’il s’agissait d’écrire, de bien écrire, clairement… Mais il était question de schéma directeur, de croquis barbares, de flèches qui montaient vers les cimes et qui en rencontraient d’autres qui chutaient comme des vertiges et d’autres encore qui fuyaient dans le sens transversal, de gauche à droite et de droite à gauche, et puis des outils qu’il fallait aiguiser, des trucs qu’il fallait dire comme ci et pas comme ça, à ce moment là plutôt qu’à tel autre, des cloisons qui s'écroulaient, en ne blessant personne, bien sûr.
Je suais sang et eau, je m’épongeais le front dans tout ce brouillard, tant que je finis par avouer à mes deux branches supérieures, que, moi, j’étais vraiment débranché, que ce travail n’était pas fait pour moi, que je n’étais pas compétent, qu’il fallait choisir quelqu’un d’autre, que je n’étais pas à la hauteur et qu'il valait peut-être mieux que j'aille me percher sur une autre branche.
On s’esclaffa, on brocarda, on se tint les côtes, on se tapa sur les cuisses en disant, les yeux rougis par le fou rire, quel ballot tu fais ! Nous non plus, on ne comprend pas vraiment ! En revanche, on sait que c’est comme ça qu’on doit parler de communication et de management quand on est posé sur un arbre moderne !
C’est-à dire, en ai-je conclu, qu’il fallait faire profession de comprendre ce qui, de propos délibéré, ne signifiait strictement rien.
Conclusion bien appliquée : Je fus, les quelques années que dura ma pause dans l'arbre, excellemment noté par toutes les ramifications supérieures.
Avant de prendre mon envol, à tire-d'aile et vers des cieux où les arbres, déjà alourdis par les givres et la neige, ne supporteraient pas le poids des ambitions.
Image : Philip Seelen
Janvier 2011
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.06.2013
Marrant
[...] et c'est en substance ce que je dis depuis le début de ce débat d'un autre temps où la calotte a largement fourré son museau, reniflant là une occasion de redorer son habit poussiéreux.
Mais il est vrai aussi que, lorsqu'on enseigne aux enfants et aux crédules qu'un homme-dieu est né d'une femme malgré tout restée vierge, il est un peu difficile de concevoir le côté multiple et humain de l'amour.

Emprunté aux naufrageurs charentais
09:03 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.06.2013
De l'espièglerie des étymons et locutions -3 -

Moi ? Je suis à. Je reste à. Je passe ma vie à.
Passer sa vie.
Voilà donc le verbe qui laisse enfin voir ce qu'il a vraiment dans les tripes, pour peu qu'on tire dessus comme un forcené, qu'on l'allonge au point d'en faire une périphrase dramatiquement translucide.
Passer sa vie.
C'est depuis ce coin de ciel-là, que j'appréhende le monde. C'est ce micro-mouchoir de poche de la machine ronde que j'occupe de ma présence assidue. C'est là que je passe ma vie.
Non. C'est là que se passe ma vie, plutôt. Moi, j'habite et la vie, elle, elle se joue, jour après jour. Elle va son plus ou moins petit bonhomme de chemin.
J'habite là. C'est à dire que j'y dors, j'y mange, j'y pense, j'y aime, j'y ris, j'y pleure, j'y baise, j'y lis, j'y écris, j'y tonds une pelouse, j'y allume le feu, j'y regarde des arbres, j'y reçois quelques amis, je m'y promène... bref, j'y demeure.
Ah, j'y demeure ! Verbe statique s'il en est, celui-là, verbe de l'anti-mouvement à l'intérieur même d'une foule de mouvements.
Verbe périlleux.
Il y a péril en la demeure à ce que ce monde de cinoques et de faux-monnayeurs demeure en l'état, par exemple. Il y a grand danger à prendre du retard à bousculer l'ordre des choses... L'expression est bien mal comprise aujourd'hui, la demeure n'y signifiant pas l'habitat, le logis, mais le retard, selon le premier sens latin. Demeurer, c'est bien prendre du retard, qu'on le veuille ou non. C'est reculer que d'être stationnaire, disait un vieux cantique anar. Tant et si bien que si, intellectuellement, on prend trop de retard, on finit, voire on demeure, demeuré.
Rien à voir avec habiter, cette demeure-là...
J'habite un pays froid comme le ventre du glacier l'hiver et chaud comme les entrailles d'un four de boulanger l'été. Il n'y a cependant pas péril en la demeure à ce que j'y reste.
C'est là que je suis. Et quand je dis ça, je ne réponds pas à la question tu es où ? Je réponds à la question tu es comment ? Il y a de l'habit étymologique là-dessous, même si la racine fondamentale de l'habit et d'habiter diverge... C'est quand même cousu de fil blanc. L'habit, au sens premier, c'est bien la manière d'être, avant de muer en vêtement d'ecclésiastique.
Un vêtement qui ne faisait pas le moine pour autant, à ce qu'il paraît.
L'habitat. Une façon d'être. Si on voulait vraiment se faire bien épouser le monde et ses mots - qui lui sont ce que la note est à la mélodie - on devrait faire du verbe habiter un verbe d'état, un verbe de l'essence.
Il habite à Lyon, il habite à Bruxelles, il habite à Nantes, elle habite à Tarbes... Lyon, Bruxelles, Nantes et Tarbes attributs du sujet «il». Car il n'y a pas d'action là-dedans, messieurs de la grammaire ! Le complément de lieu est révolu, il participe du passé, il était dans la décision, le déménagement, le trajet, la mutation, que sais-je encore ? D'ailleurs, quand on habite vraiment, on n'habite jamais un complément, voyons ! Ou alors un complément de soi.
J'habite... C'est une de mes définitions. Ça me qualifie. Je suis habitant, pas habité... Ah, là, ce serait tout autre chose !
Voyez que dès qu'on veut faire d'un verbe d'état un verbe d'état, il y a redondance fâcheuse. Il ne supporte pas la forme passive, alors il se rebelle et de son sujet fait un soumis, un aliéné, un irresponsable.
Je suis habité par l'angoisse, par le remords, par la honte, par le désir. Je suis aux prises avec ma névrose, je suis hanté par...
Dans les cas extrêmes hallucinés, par le Diable. Satan m'habite, disait plaisamment je ne sais plus qui !
Y'a vraiment pas d'quoi.
12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.06.2013
La dialectique des cons
 Je suis un con pour une foule de cons.
Je suis un con pour une foule de cons.
Voilà donc bien un gros mot à tiroirs. Une anguille. Un serpent de mer. Car qu’est-ce donc qu’un con si tout le monde revendique ne pas en être un mais affirme que le voisin, oui, lui, il en est vraiment un ?
C’est comme l’ennemi, c’est toujours, forcément, l’autre. Le con ne s'exprime donc que par confrontation des contraires et il a une définition négative : il est ce que je ne suis pas.
Mais de là à dire qui il est, il y a un monde. Il y a en effet un nombre impressionnant de choses que je ne suis pas.
Brassens chantait ainsi :
Qu'au lieu de mettre en joue quelque vague ennemi
Mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami.
Certes. Moi je veux bien, généreux poète moustachu ! Mais en quoi peut-on changer un con pour faire de lui une personne convenable ? Il apparaît, puisqu’il est con et pas moi, qu’il faut qu’il se change de telle façon qu’il me ressemble. Mais comment un con peut-il vouloir se transformer en con puisque, pour lui, je suis un con ?
Vous voyez, là, au moment où je vous écris, il faudrait que j’adopte la vision du monde de tous ceux qui me considèrent comme un con, c’est-à-dire que je me glisse dans la peau d’un connard pour enfin ne plus en être un !
Ce n’est pas facile, tout ça.
J’en conclue donc que les cons ne se parlent pas, ne se côtoient pas, ne s’aiment pas et n'échangent pas avec les cons. Que les cons ignorent le consensus. Normal, puisqu'ils ils sont tous cons dans les yeux du con.
Le con est un miroir sans tain.
Et c’est ce qu’écrivit, en substance, Mérimée à Stendhal, en 1831 :
Vous me croyez plus con que je ne suis, pour me servir d’une de vos expressions.
12:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.06.2013
Hasard et vanité
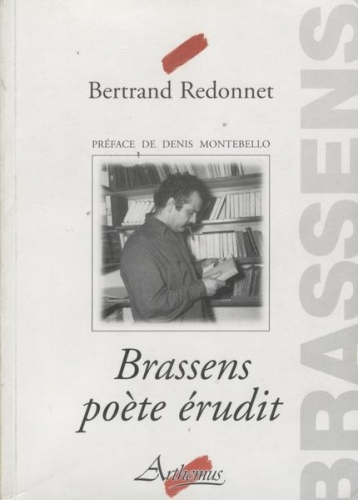 C'était il y a quelques jours.
C'était il y a quelques jours.
Lentement s’estompait la lumière sur les rives de la Krzna, charmante rivière qui coule ses eaux sur des prairies émaillées d’arbres et de maigres halliers.
Des hommes et des femmes, harcelés par de méchants moustiques sanguinaires, étaient assis autour d’un barbecue, sous un préau en bois, faiblement éclairé.
On discutait, on échangeait joyeusement, en polonais et en français, et les conversations régulièrement s’interrompaient pour laisser le temps aux interprètes de faire l’indispensable lien en brisant de leur verbe la fameuse barrière des langues.
C’était là un groupe d’ornithologues français venus observer, guidés en cela par leurs amis et homologues polonais, quelques rares spécimens de la gente ailée nichant dans la vallée du Bug et dans ses alentours.
Une fraternelle ambiance saluait cette fin de journée, passée à courir la campagne derrière les oiseaux. Les visages, quelque peu rosis par la bonne chère et - échange de bons procédés culturels oblige -par un ou deux verres de vodka et de pineau des Charentes - souriaient d’aise.
J’étais de furtif passage. Je venais de saluer tout le monde et j’allais me retirer quand un homme, d’une voix gaillarde, demanda à quelqu’un s’il avait sa guitare et s’il n’agrémenterait pas la soirée d’un ou deux couplets de Brassens.
Je me retournai, croyant, fort égocentriquement, que la voix s’adressait à moi, bien que je n’aie pas fait état ici de mon goût pour l’interprétation du poète sétois.
Mais l’homme interpellait ainsi un de ses camarades, lequel déclina gentiment l’invitation, assez timidement me sembla-t-il, en prétextant qu’il n’avait de toute façon pas son biniou avec lui.
Ce dont je lui sus gré. On peut en effet avoir envie de chanter pour souligner le caractère convivial et joyeux d’une soirée, mais rien ne s’y prête moins que les chansons de Brassens.
Elles n’y sont pas vraiment dans leur élément.
Mais comme je suis un curieux, je revins aussitôt vers le guitariste-chanteur sollicité et nous engageâmes une petite discussion faite de ces bribes récurrentes, convenues, qui sortent spontanément quand on parle du troubadour moustachu et de sa musique entre gens qui ne se connaissent pas et se rencontrent tout à fait par hasard sur le sujet.
Nous en vînmes néanmoins à évoquer quelques livres et le monsieur me dit alors :
- Je vous en conseille un, si je puis me permettre. Un ouvrage qui note des expressions et locutions diverses employées par Brassens tout au long de son œuvre et qui décrit de belle façon leur lien avec la mythologie, la littérature, etc. Il fait état, en quelque sorte, des références de Brassens et certaines sont étonnantes, je vous assure.
- Tiens ?dis-je, soudain intrigué. Et quel en est le titre ?
- Brassens, poète érudit. J’ai les deux éditions. Mais je ne me souviens plus, hélas, du nom de l’auteur. Peu importe, à vrai dire ! Si vous voulez, en rentrant, je vous enverrai les références par mail.
Que pouvais-je faire ? Un plus modeste que moi se serait-il tu ? Peut-être. Sans doute… Mais je trouvai cela assez cocasse et je suis un vaniteux qui, comme tous les vaniteux, n’a guère l’occasion de l’être.
Alors je lui dis en riant :
- C’est très gentil à vous, mais je les ai déjà, les références de ce livre.
- Ah bon ? Vous les avez ? Vous l’avez lu ?
- Oui, je l’ai lu et relu. Plus que ça, même : j’ai le nom de l’auteur inscrit sur mon passeport, pour tout vous dire.
- Votre..? Votre passeport ?
- Ben oui. Et je suis bien heureux que ce livre vous ait plu.
Il comprit soudain et écarquilla tout grand les yeux. Il me dévisagea, fit soudain le rapprochement en se rappelant le prénom sous lequel je lui avais été présenté en début de soirée et retrouva le nom de son auteur méconnu.
- Bertrand Redonnet ? C’est… C’est vous ?
- C’est ben moué.
Le brave homme n’en revenait pas. Il exultait, il disait aux autres, il prenait à témoin, il répétait et il s'exclamait qu’il lui avait fallu faire 2500 km pour rencontrer, dans une soirée consacrée aux oiseaux, autour d’un barbecue improbable, l’auteur d’un livre qu’il avait aimé.
Le hasard l’estomaquait.
Moi aussi.
Morale : Ecrivez, écrivez, écrivez donc ! Il arrive que vos bouteilles confiées à la mer atteignent aux rivages les plus inattendus.
09:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.06.2013
De l'espièglerie des étymons et locutions -2-
 Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !
Voilà bien encore un de ces vieux adages de la résignation de la parole, une sorte d'injonction à la boucler déguisée en principe de tolérance. C’est d'ailleurs souvent comme ça, les principes de tolérance : ça vous lie pieds et poings devant l’offense.
Je m’inscris donc en faux, par principe justement, mais aussi parce que, comme pas mal de gens sans doute, j’ai remarqué que lorsque que l’on veut m’imposer une chose qui ne me convient nullement ou que l’on me tient des propos qui ne sont pas du tout à mon goût, je deviens rouge. De colère, bien entendu. A moins que ça ne soit de honte.
Ou alors je deviens vert, ça dépend de la nature profonde du goût qui vient d’être heurté. Bref, je change de couleur et ai bien l’intention dès lors d’en discuter, jusqu’à en découdre.
Rouge, d'accord, on peut aisément comprendre. C’est physique, le sang qui empourpre les joues, la montée d’adrénaline, le visage qui change de couleur. Tout ça se voit comme le nez sur la figure…
Mais vert ?
Avez-vous déjà vu quelqu’un devenir vert ? Moi jamais. Ce doit être effrayant, quelqu’un qui devient vert.
Il faut donc, pour se le figurer, reprendre la couleur à sa racine et remonter la sève du temps qui passe. Le verbe latin virere, être vert, qualifiait initialement et exclusivement les plantes, jeunes, saines, regorgeant de chlorophylle, avant de donner, par allégorie, viridis, frais et vigoureux.
Est-ce à dire que, fâché par un insolent quidam, je deviendrais alerte et sémillant ? Hum… Si tel était le gars, je ne serais quasiment jamais abattu. En tous les cas, je serais le plus souvent en pleine forme. C’est donc plus loin, en aval du mot, qu’il me faut remonter. Car si le vert symbolise, fidèle à son histoire linguistique, la vigueur, le renouveau, la force, il s’est aussi glissé dans un autre sens, par la porte toujours féconde de l’argot des rues.
On a ainsi appelé, au début du XIXe et par métonymie, langue verte, la langue des tripots et des joueurs autour du tapis de même couleur. On a ainsi quitté la santé initiale du végétal pour rentrer dans la sémantique de la brutalité, celle des mots. Et on fait la synthèse, du végétal à l’humain, si on reçoit, ou si l’on donne, une volée de bois vert à quelqu'un. Avec des mots crus et acides, tout ce qui est vert étant acide.
Bon, d’accord, mais devenir vert ? J’avoue, quelque peu honteux, ne pas très bien saisir le rapport dans les explications des différents dictionnaires. Alors, comme en toponymie, j’outrepasse mes droits à l’interprétation, je laisse vaquer l’imagination en disant qu’être vert, finalement, c’est s’apprêter à le devenir par les mots. Et, au contraire du rouge, franc, honnête, incoercible, qui inonde tout de suite le visage et trahit l’émotion de l’âme, le vert, plus sournois et plus intelligent, ne monte pas aux joues afin que l’offenseur n’ait pas le temps de s'enfuir.
Rencontrant un jour, au hasard d’une conversation contradictoire, un homme qui soudain devient horriblement vert - un vert de peau, pas un vert galant - ne vous effrayez donc pas d’une éventuelle et intempestive réaction à votre encontre. Les causes n’en seront indubitablement que cliniques et, charitablement, appelez au plus vite les secours d’urgence.
Dans ce cas-là, oui, d'accord : le vert, ça ne se discute pas.
10:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.06.2013
De l'espièglerie des étymons et locutions -1-

Cinq heures d’une obscurité velléitaire : les hommes, forcément, ne peuvent plus suivre le rythme du grand mouvement et font sur la clarté déborder leur repos, soit qu’ils dorment encore quand le soleil est déjà haut perché sur l’échelle du matin, soit, comme mézigue, amoureux de l’aurore, qu’ils prennent congé bien avant les pénombres du soir.
Avec juin, se profilent aussi dans un futur proche, l’été et ses espoirs de grand soleil ; l’été et ses projets de villégiatures sous le ciel bleu, commandé à la carte.
On va prendre congé car on va prendre des congés. Mais, à moins d’un plan social fumeux, comme disent - l’adjectif en moins- les imbéciles du langage euphémistique officiel et spectaculaire, on espère bien ne pas recevoir son congé. Dans cette dernière acception, comme l’énonce avec plus de délicatesse que moi le Dictionnaire historique de la langue française, congé signifie tout bonnement «être viré comme un malpropre».
Congédier sine die, en quelque sorte…
Dans les deux autres cas, et bien que l’origine en soit la même, il y a, non pas une injonction de partir, mais une permission, sens qui nous vient du lointain latin commeare, «se mettre en marche, voyager.»
Durant la longue évolution phonétique et sémantique de la langue latine, un substantif comméatus s’était formé dans le langage militaire pour dire exactement «un ordre de marche». Un «ordre de partir», donc, qui s’est adouci au point de se transformer au cours des siècles en une «permission de partir», une autorisation de quitter son poste.
On voit que l’étymologie joue avec ses racines parce que le gars auquel je faisais allusion plus haut et à qui on donne son congé, lui, n’est pas autorisé à partir mais obligé. D’ailleurs, pour bien noter la différence, le langage des ayants droit s’applique à dire prendre ses congés, c’est-à-dire des congés souverains, exercices d’une liberté, faire-valoir d’un acquis.
On prend ses congés comme on prend sa chemise ou son vélo.
Nous ne sommes donc pas très loin du premier sens de voyager, de se mettre en marche. Dans la plupart des cas en effet, quand on prend son congé, on entasse dans un coffre les valises et quelques vivres, voire quelques livres, et on taille la route. A la conquête de quoi ? D’une illusion bien méritée, sans doute.
Mais c’est redondant ce que je dis là, parce que toutes les illusions se méritent...
Bref, on est autorisé à partir, alors on fuit. On accélère l’autorisation, tel l’oiseau cruellement retenu en cage et devant lequel s’ouvre brusquement une porte.
Remarquons par ailleurs, avec les auteurs du dictionnaire historique précité, que ce terme de congés s’applique surtout au droit privé. Et c’est historiquement logique car c’est en ce domaine que légiféra le Front populaire de 1936 sur les fameux congés payés, honnis et moqués jusqu’au sarcasme pendant des décennies par les milieux conservateurs qui, comme partout et toujours, n’appréhendent le monde qu’à l’aune de leurs intérêts, réels ou fantasmés.
En revanche, dans la fonction publique au firmament de laquelle scintille, telle l’étoile du berger, l’éducation nationale, on parle traditionnellement de vacances, pour dire exactement la même chose.
Est-ce à dire que, dans ladite fonction publique, on n’a nul besoin d’être autorisé à partir pour être absent ? Les fâcheux pourraient bien aller jusqu’à le prétendre ! D’autant que - voyez comme est malicieuse l’étymologie ! - ce temps libre des fonctionnaires leur vient alors de vacans, participe présent de vacare ; être vide.
Un vide dont on espère avec bonhommie et sincérité que les joies de l’été, avec ses embouteillages à l’oxyde de carbone, ses gares et ses aérogares encombrées jusqu’au tumulte poisseux, ses shorts, ses moustiques, ses chemins de randonnées solitaires piétinés par la foule, ses brûlures au soleil, ses plages dégoulinantes de sueur agglutinée, sauront le combler.
Mais je le sais bien, lecteur : j’ai là abusé les racines et, perfidement, les ai renversées cul par-dessus tête ! Car c’est à la chaise qu’on laisse au bureau ou à l’école que s’applique étymologiquement et stricto sensu ce vacans.
Qu’on me pardonne cependant la facétie !
Car, dans ma vie, j’ai rencontré tellement de gens qui se promenaient avec cette chaise vide dans la tête que j’en suis arrivé, par métonymie désabusée, à confondre et leur chaise et leur tête !
Ceci dit sans mépris aucun, mais avec l’ironie de la tristesse, ayant moi-même, une dizaine d’années durant, vaquer de vacance en vacances.
08:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
















