29.06.2010
Chemins patoisants
 Quoique dépourvue de toute instruction scolaire, Marie n’en parlait pas moins la langue des bons élèves, le latin.
Quoique dépourvue de toute instruction scolaire, Marie n’en parlait pas moins la langue des bons élèves, le latin.
Pas le latin marmonné sur les genoux tous les dimanches matins. Non. Celui-ci était réservé aux grandes élévations spirituelles et tenter d’en percer le mystère eût relevé de la profanation, comme de vouloir emprunter un raccourci, une tricherie, pour parvenir jusqu’au céleste empire.
En fervente bigote, Marie n’entendait donc goutte à ce latin-là, mis à part, peut-être, le rassurant Dominus vobiscum, et le Ite missa est, grossièrement traduit par les paroissiens par "vous pouvez reprendre vos vélos. »
Marie - la mère Marie comme on disait - parlait donc latin sinon couramment, du moins dans la vie courante. Langue dont on célébrait régulièrement les obsèques à grands renforts de déclinaisons entre les murs de mon collège et néanmoins bien vivante au village.
Du latin presque classique,
- Cur que tu fais tieu ? Pourquoi fais-tu ça ?
En passant par le latin populaire,
- Y’a pu d’eve au puais. Il n’y a plus d’eau au puits.
Jusqu’à l’ancien français du 16ème :
- L’a cheu. Il est tombé.
Voire celui du 11ème :
- Mes bots sont restés de fors. Mes sabots sont restés dehors.
On disait « la mère Marie » parce qu’on en était déjà au début des années soixante alors qu’elle arrivait, elle, de temps beaucoup plus reculés, presque fictifs. Mille neuf cent. L’âge du siècle. Toujours de noire vêtue quoique je ne sus jamais de qui elle portait ainsi le deuil.
Peut-être de sa propre vie ballottée du cul des vaches à l’auge du cochon en passant par le bourbier nauséabond de la basse-cour.
Pierre, son mari – je n’invente hélas rien des prénoms mais on peut tout aussi bien les rattacher à Curie et Skłodowska si on veut éviter à tout prix l’apôtre et sa vierge – ne parlait pas le latin. Ou alors beaucoup moins bien. En tout cas, il avait une sainte horreur de celui du dimanche matin. A aucun prix, il ne voulait l’entendre balbutier.
Sa passion était beaucoup plus raisonnable, moins ambitieuse et beaucoup plus tangible : les femmes. Celles du village.
- Vous m’avez fait grand pou, hier souèr, Pierre, derrière mes contrevents quand que y’allais m’coucha….
C’était dit avec une telle bêtise que ça ne pouvait être que vrai. Et ça venait d’Alice, une veuve, depuis si longtemps veuve qu’on n’avait jamais vu son mari et que ses habits n’avaient jamais été noirs.
- Et to qu’tu vas guetter Tié lé fumelles quand a s’couchant ? s’effarouchait la pieuse Marie.
- Ma foué non. I m’en souvindrais, qu’il ricanait, le Pierre.
Pour sûr qu’il faisait l’âne. Personne n’était dupe et sa réputation de coureurs de bonnes femmes n’était plus à faire. Á la tombée de la nuit, surtout l’hiver quand les gens désœuvrés se couchent comme les poules, il était en effet fréquent qu’un retardataire le vît traîner par les chemins en pluie et en vent, furetant derrière les volets mi-clos, à la recherche d’un coup d’œil polisson.
Il était aussi l’homme riche du village.
Á tel point qu’il était le seul à posséder une automobile. Une 203 Peugeot, grise et rutilante. Il ne s’en servait que pour aller au marché du lundi ou alors pour rendre service si d’aventure une bonne femme avait besoin de se rendre au chef-lieu du canton pour affaires.
Les mauvaises langues prétendaient alors que le prix du voyage se soldait par l’octroi de quelques caresses incongrues.
- I veut ben qu’vous m’conduisiez, mais t’chau cop, i veux payer l’essence, déclara un beau jour l’affligeante Alice, laissant entendre par là que l’autre fois, Pierre avait, sinon réussi, du moins tenté de se payer sur la bête.
La mère Marie ne devait plus savoir en dispenser, de telles caresses. Car jamais Pierre ne consentit à la conduire à l’église. Elle s’y rendait en vélo, que le temps soit clément, que les pluies en rafales cinglent la campagne ou que la pierre des chemins se fende sous la morsure du gel.
Je ne suis donc pas certain qu’elle ait été une seule fois passagère de la belle 203 de son bonhomme de mari puisqu’elle dédaignait aussi le marché du lundi. Quant au chef-lieu de canton, dix kilomètres, c’était le bout du monde et la pensée qu’elle puisse s’y aller fourrer ne l’effleurait sans doute même pas.
D’ailleurs, sur l’automobile émergente, elle nourrissait un sentiment des plus cruels. Un sentiment aux antipodes des enseignements dont le latin du dimanche matin était censé la nourrir.
Nous en étions, sinon au début de l’automobile, du moins au début de sa vulgarisation.
Sur la nationale 10, la grande route, la mythique grande route de la conquête de l’Espagne par Napoléon, celle sur laquelle passaient tous les mois de mai les forçats en vélo du Bordeaux/Paris, les premières DS, les 403, R8 et autres dauphines commençaient à rivaliser de prouesses techniques.
Il advint alors que des gens de très loin, de Paris peut-être, ou de Bordeaux je ne sais pas, ou de plus loin encore, donc pas vraiment de réels gens, s’écrasèrent sur le talus et y périrent cruellement. Une famille entière. Le drame fit grand bruit par les chemins perpendiculaires à la nationale et qui ramifiaient entre les haies jusqu’aux chaumières les plus antiques. Les hécatombes routières n’étaient pas encore entrées dans les mœurs, ni comptabilisées par un ministère.
Le jugement de la pieuse Marie sur son vélo qui n’allait pas plus loin que l’ombre du clocher, fut donc sans appel :
- N’aviant qu’à rester dans ieux cabanes….Ils n’avaient qu’à rester chez eux.
Pierre, le mari libertin donc, avait par ailleurs une drôle de façon de confondre le verbe se taire et le verbe s’écouter, si nous venions, nous les mômes ignares, à émettre le moindre avis sur quoi que ce fût.
- Qui’qu tu racontes, écoute te don…Tu connais rin…. et il se dandinait sur ses pattes ridiculement courtes, et il dodelinait du chef, qu’il avait chauve et toujours protégé d’un large chapeau qu’on eût dit celui d’un vieux cow-boy.
Quoi ou qui écouter si on se tait ? Si on se tait, on n’écoute que soi-même. A l’intérieur. C’était pas si bête dans le fond…Se taire pour mieux s’écouter.
Un jour, faudra que je réfléchisse à tout ça.
Que je me fasse une idée plaisante d’où ils tenaient tant de savoir oral. De quels flambeaux passés de chemins en chemins, de bois en bois, de champs en champs, de rivières en rivières, de berceaux en berceaux, ils détenaient usage de cette parole-là.
Les érudits, les linguistes, les historiens et les spécialistes de la sémantique, quand ils ne seront pas tout ça à la fois, ne manqueront pas de me faire plaisamment remarquer que je cherche tout bonnement à défoncer là des portes ouvertes. Ils voudront dire sans doute des portes que nous, hommes savants qui nous sommes penchés sur la question, avons ouvertes depuis des lustres et des lustres. Ils diront que la langue française prend racine dans le latin classique devenu bas-latin, puis latin populaire et médiéval, lui-même changé en vieux français et abouti à notre français moderne, jusqu’à plus ample transformation.
Le tout assaisonné d’un reste de racines celtes, de-ci, de-là.
Comme toutes les langues, la nôtre a donc son histoire, un chemin qu’elle s’est frayé à travers les âges. Ce chemin, il y a belle lurette, mon bel ami, que nous en avons débroussaillé tous les tenants et tous les aboutissants.
Certes. Certes, messieurs les érudits, mais là n’est pas exactement mon propos. Je sais bien l’importance et le juste fondé de vos travaux. Ils me sont d’ailleurs souvent précieux.
Mais ce qui me préoccupe, c’est l’inversion complète des rôles sociaux dans cette affaire de vieux français, de latin écorché des campagnes et vos doctes disciplines. Ce qui me préoccupe, c’est que justement, mon enfance sur les chemins de pierre et les hivers en bruines, a été bercée par ces sons, par ces signifiants spontanés qui disaient le monde et que, plus tard sur les bancs respectables de l'instruction publique, on m’a interdit de les prononcer, tous ces vocables, comme s’il se fût agi de vilenies, frappées du sceau de l’infamie.
C’est parce qu’ils étaient les marques de l’ignorance. Les marques d’une conceptualisation du monde qui aurait loupé une marche haute de plusieurs siècles, celle qui va du vieux français à notre langue soignée.
Je disais donc inversion des rôles parce que ce sont les marques d’une telle ignorance qui sont la matière même sur laquelle s’exerce votre érudition.
L’ignorance comme source de savoir. Un bel oxymore.
Vous moralisez, monsieur du poète ! Vous moralisez ! L’étude des langues et des jargons est scientifique et n’a que faire de votre attachement à des chemins patoisants. Voyez-vous, nous pouvons tout expliquer par la recherche tandis que vous ne pouvez effleurer votre propos que par l’émotion.
Nous ne parlons pas exactement la même langue, effectivement.
Je parle des nuages gris fuyant sous l’automne, d’un vent humide sur de sombres guérets et des grives en vols saccadés sur les vignes de novembre.
Je parle d’un monde condamné à mort et dont on a d’abord tué les mots.
Je parle d'un monde qui a fui sous ma vie.
Mais je le porte en moi, ce monde. Le deuil n’en est pas entièrement accompli et ne le sera sans doute jamais. Seuls les gens qui se renient par ambition d’épouser autre chose qu’eux mêmes, font deuil de leurs premiers mondes. Quoique en apparence seulement. Ce monde leur colle toujours à la chaussure, qu’il soit glèbe ou poussière. Ils secouent alors vainement cette chaussure, pour tenter de le faire tomber, de le laisser en chemin. Aussi claudiquent-ils le plus souvent et ne trompent-ils ainsi que d’autres trompeurs de leur acabit.
Ce qui me tarabuste, donc, c’est comment la transmission. Vous savez expliquer la genèse établie du langage mais ne sauriez décrire son cheminement vivant, comment il a su éviter les écueils d’une modernité conquérante.
De l’obligatoire parler.
Comment il a usé de ruses pour rester clandestin dans les campagnes, comment il a su se travestir en marques de l’inculture pour arriver, de bouches à oreilles, de la fin du Moyen-âge jusques à nous. Vous faites donc l’histoire d’une musique en occultant l’histoire de sa tonalité. La tonalité, c’est la transmission.
Je veux dire qu’un monde qui dit « mes bots sont de fors » a été transmis par un monde autre que celui qui a transmis « mes sabots sont dehors.»
Et à d’autres fins aussi.
Et alors ? Vous vous préoccupez de musique et nous de partitions, voilà tout. Marie, la fervente Marie dont vous nous parlez, disait de fors et vous trouviez sans doute ça tout naturel jusqu’à ce que l’instituteur et les livres ne vous enseignent dehors.
Vous connaissez les transmetteurs parce que vous avez vécu une transformation, une mutation de l’oral au graphisme. Je dis cela parce que jusqu’à ce jour, vous n’aviez sans doute jamais écrit ni lu de fors, n’est-ce pas ?
J’en conviens. Je découvre même. Ce linguiste latiniste est en outre un homme d’une exquise urbanité. Un pédagogue serein. Il arbore petites moustaches tranquilles sous un long nez pointu et ses yeux brillent comme des sourires humides.
Musique, oui. Les mots n’existaient qu’en musique. Des mots qui ignoraient l’écriture, des mots pour la voix seulement, des mots auxquels il manque une dimension. Des mots condamnés à mourir dés lors que la nécessité d’apprendre autre chose que des gestes adaptés à des saisons, des directions du vent, des profondeurs de labour, des couleurs de nuages, s’est faite incontournable.
C’était là le monde de l’immédiateté. De l’urgence. L‘immédiateté est toujours orale, elle est descriptive.
Tandis que l’écriture est prospective. Elle anticipe.
Vous l’avez dit : un monde qui meurt n’a plus besoin des mots qui le désigne. Vous les voulez vivants, ces mots, alors que nous en avons depuis longtemps terminé avec leur dissection.
Me voilà donc au fait.
Ecrire les mots, c’est anticiper le réel. Pas le décrire.
Mon écriture, pour une bonne part descriptive de mes paysages - car vivre sans paysages est indigne de vivre – est donc une écriture surannée.
Vouée aux silences des chrysanthèmes.
Texte publié en novembre 2008
09:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.06.2010
Dimanche net
 Cette semaine, c'était la fête de la musique : Lu avec plaisir, chez Brigitte, ce poème.
Cette semaine, c'était la fête de la musique : Lu avec plaisir, chez Brigitte, ce poème.
Et chez Dominique Hasselmann, à propos d'une toute autre et combien misérable affaire, ça.
Chez le toujours caustique Theatrum Mundi, ce petit texte avec plein de choses dedans...à ruminer sans modération.
Et parce que j'avais été parmi les cent écrivains "sélectionnés" pour répondre à ce questionnaire sur les agents littéraires, que j'y avais répondu parce que je suis un garçon poli, ce qu'en pense et ce qu'en dit François.
Enfin, comme rien n'a changé depuis la semaine dernière et que charité bien ordonnée etc...etc... J'ai reçu une bien belle lettre, là.
Cordialement à toutes et tous !
08:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
24.06.2010
Contes et légendes de Podlachie - 12 -
Le retour du chevalier
En Podlachie, on dit qu’à partir de la Sainte-Anne, le vingt-six juillet, déjà l’été se fait plus timide, que les nuits sont plus fraîches et qu’un léger brouillard peut même, très tôt le matin, danser sur l’herbe humide des plaines.
Pourtant, cette nuit-là du mois d’août était douce et suave. Sans les milliers d’étoiles au ciel, sans la course étincelante, çà et là, des astres lumineux qui semblaient vouloir tomber des firmaments jusque sur la cime des arbres et allumer la forêt, on eût pu se croire par une belle nuit du mois de mai.
Panachage subtil de résine des grands pins, de serpolet et de bruyère, les senteurs flottaient sur les lisières et par les sentiers obscurs des sous-bois.
Par cette nuit-là, délicieusement calme, un grand cheval noir, puissant, nerveux, s’arrêta devant le portail d’un vieux manoir retiré dans les profondeurs de la forêt, au bout d’une allée plantée d’ormes et de tilleuls antiques.
Le chevalier contempla longtemps la sombre masse du manoir. Tout était silencieux et endormi alentour. Seule une bougie vacillait, très haut posée dans la tour, au rebord d’une fenêtre fermée.
Enfin, s’extirpant de sa rêverie, le chevalier sauta à terre et vint frapper au lourd portail de bois, planté de clous énormes.
Qui vient là ?
Ouvrez, ouvrez, bonnes gens ! Ouvrez, Princesse aux yeux si bleus ! Je suis le chevalier qui jadis vous abandonna à votre solitude et qui revient aujourd’hui vous dire le monde.
Car nulle part ailleurs, il n’y avait de bonheur.
J’ai pourtant traversé des pays, des forêts, des montagnes et des fleuves. Nulle part, il n’y avait le calme de votre demeure.
J’ai même traversé le désert. Nulle part il n’y avait d’oasis. Et je reviens vers vous, ma princesse, pour vous aimer et vous dire que le bonheur est là, entre vos bras, derrière cette porte, et que tout l’inconnu du vaste monde n’est rien comparé à la douceur de votre voix, à la clarté de vos yeux, à la tendresse de vos baisers.
Chevalier noir, dit une voix que le chevalier ne reconnut pas, c’est que la porte est lourdement fermée et rouillée.
Je vais la briser avec mon épée.
C’est que les arbres sont hauts maintenant et obstruent le passage, Chevalier noir.
Je les abattrai avec ma hache.
C’est aussi que la rivière est profonde et tumultueuse à présent.
Mon fidèle cheval l’enjambera d’un bond.
Mais, Chevalier noir, c’est que la Princesse dort d’un paisible et profond sommeil.
Je connais les mots qui la réveilleront ; N’ayez crainte.
Alors la voix, une voix chevrotante et faible, murmura derrière le lourd portail. Chevalier noir, ne touche pas à la porte, ne coupe pas les arbres centenaires, ne franchis pas la rivière aux eaux profondes et ne dit surtout plus rien.
Car il n’existe plus de parole qui puisse réveiller la Princesse aux yeux bleus.
Elle a trop attendu cependant que vous couriez le monde et les déserts brûlants.
Elle a tant attendu qu’elle s’est elle-même, de lassitude et de désespoir, enfuie vers des pays plus lointains encore que les vôtres. Inaccessibles et froids.
Et la bougie qui vacille dans la nuit, là haut-sur la tour, veille depuis des années et des années, sur son voyage sans retour.
Á présent, va-t’en !
09:02 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.06.2010
Le plaisir des mots entrelacés
09:03 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.06.2010
Quand le doute croît
 Tu ne me crois pas ?
Tu ne me crois pas ?
Je vois bien que tu ne me crois pas, allez ! Ne fais pas semblant…
C’est pourtant la vérité vraie que je te raconte là…Enfin, du moins telle que je l’ai vécue. Parce que, en soi, la vérité, ça ne veut pas dire grand chose.
Pascal aurait mieux fait de nous laisser comme maxime de sagesse, vérité dans cette tête-là, fumisterie dans cette autre. Avec ou sans les Pyrénées. Pour donner crédit à d’immondes conneries qui sont pour les autres de lumineuses exactitudes, les hommes n’ont pas besoin d'être séparés par une montagne, voyons !
Une cage d’escaliers y suffit. Que dis-je ? Un palier tout court.
Si on y regarde de près, on passe finalement sa vie à croire. Donc, dans une large mesure, à nier l’autre du même coup.
Mais on dit aussi, plus innocemment : Il croit en lui, elle croit pouvoir être là à huit heures, tu ne crois pas en dieu, je crois en ses chances, je crois qu’il va faire beau et tutti quanti.
On voit bien que ce traitre mot, ce mot de l’affrontement, ce mot de l’idéologie pure, de la différence aussi, est double. Sournois comme pas un. On croit à dieu, par exemple, ça veut dire qu’on le suppose intellectuellement. Dans les cas les moins graves, bien sûr.
Croire en dieu, là, pas de détail, on est dans le spirituel, la morale pure, si j’en crois – et je n’ai pas de raison particulière de ne pas l'en croire – le Robert, dictionnaire historique de la langue française.
Voyez comme il chipote, ce verbe ! Pourtant, on ne dit jamais croire en Père-Noël… Les enfants seraient-ils des intellectuels intéressés ? C’est bien possible, après tout.
Plus intelligemment, on croit en ses chances, là, c’est de l’espoir, ou de la présomption, ça dépend du niveau qualitatif de l’erreur de soi-même.
Je le crois coupable, on verse ici dans le soupçon. Parfois dans le préjugé. Souvent même. Et quand on sait que c’est là où on sait le moins qu’on arrive à faire soupçonner le plus, comme ils disaient, ben, faut croire que ce verbe croire, c’est aussi l’antinomie même de la connaissance.
Je crois que je vais y arriver...On en vient à la conjecture, avec un grand aveu d’impuissance en filigrane. Du doute.
Et il peut faire horriblement peur, le verbe croire quand il enfile ce costume-là. Il y a quelques années, un copain ayant séjourné à Madrid et se proposant de revenir à Paris, me racontait qu’au départ de l’aéroport, l’avion avait dû faire demi-tour. Petit problème technique. Vraiment tout petit. Si petit que les passagers n’avaient même pas été débarqués pendant que les techniciens bricolaient au niveau de l’aile et qu’il les entendait palabrer entre eux. La réparation terminée, il y en a un qui a dit à l’autre, en rangeant ses divers clous : je crois que ça devrait coller…Décoller, en l’occurrence. Mon copain, il ne savait plus quel sens donner à ce foutu je crois. Il eût aimé qu’il n’exprimât qu’une franche certitude, presque un aveuglement, un fanatisme, et, à cause de ce mot malfaisant, ambigu, il a passé deux heures horribles dans les airs.
Non, vraiment, s’il faut lire ce foutu vocable sans les nuances, il est illisible. Il se mange d’ailleurs à toutes les sauces. Pire. Il peut servir à maquiller son exact contraire, un menteur faisant en effet tous les efforts du monde - ne faisant quasiment que ça d’ailleurs - pour qu’on le croie.
Par un bref coup d’œil jeté sur l’état du monde, on voit bien comme les grands menteurs, les champions de la dissimulation, y parviennent : ils occupent pratiquement tous les podiums de la cité. Ils sont même arrivés à vous faire croire que la lune était une crêpe ! Lorsqu’on croit fermement à son mensonge, faut croire qu’on possède donc une redoutable force de persuasion.
Il sert surtout à ça le « croire », en fait. Á persuader les autres de la justesse de ses propres erreurs ou du bien-fondé de sa duplicité.
La liturgie chrétienne, c’est dire, l’a même conservé dans sa forme première, latine, pour ne pas l’abîmer, pour le servir bien en l’état de sa dangerosité initiale, pour qu’il frappe encore plus fort. Qu’il frappe les hérésies, selon le Concile de Nicée. Le credo, la profession de foi, la certitude aveugle, l’anéantissement du sens critique, l’hallucination, l’étau meurtrier du dogme, la force hystérique de l’auto-persuasion.
Terrible, ce mot. Une épée aux multiples tranchants. Une épée à manier avec précautions.
Tu me crois. T’es un gars bien. Tu ne me crois pas. De deux choses l’une : Ou tu ne comprends rien ou t’es malhonnête.
Finalement, mieux vaut, comme moi, ne plus croire en (ou à) rien, tiens !
Ah, pas si vite ! Parce que quand je dis ça, me parant évidemment du désabusement philosophique, de celui qui sait tout parce qu’il ne sait rien, prenant la hauteur superbe du sage et l’attendrissant désespoir du romantique, le mot ne l’entend pas de cette oreille, lui. Il n’aime pas qu’on le manipule, qu’on inverse les rôles, qu’on lui vole la vedette.
Tel un serpent sur la queue duquel j’aurais marché, il se retourne alors et me pique sévèrement.
Je ne crois plus en rien. C’est-à-dire que je crois que tout est possible, que tout peut advenir. Je crois en tout, quoi.
J’ai connu une dame dans le temps jadis, comme ça. Elle croyait à tout et comme on l’en brocardait sans ménagement, elle s’est mise tout à coup à ne plus croire en rien.
Du coup, elle avait l’air d’une fausse sceptique.
Voyez comme il est vindicatif, méchant, ce mot !
Je crois bien que je le déteste.
16:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.06.2010
Dimanche Net
 Autant que faire se pourra, j'alimenterai chaque dimanche matin cette nouvelle rubrique, histoire de relayer deux ou trois textes de la semaine, parmi ceux qui m'auront le plus marqué.
Autant que faire se pourra, j'alimenterai chaque dimanche matin cette nouvelle rubrique, histoire de relayer deux ou trois textes de la semaine, parmi ceux qui m'auront le plus marqué.
Histoire aussi de vous en faire profiter, au cas où ils vous seraient passés sous le nez.
Je ne me fais cependant pas trop d'illusions sur l'étendue netgraphique du panel. Ça tournera sans doute souvent autour des mêmes auteurs, le foisonnement des blogs et sites (tant mieux !) faisant que beaucoup, de qualité sans doute, me passent moi-même sous le nez et que je me suis créé, comme tout à chacun, un réseau d'affectivité à l'intérieur duquel je me balade, trop à l'étroit peut-être.
Quoique...Pour commencer, un blog que je ne connaissais pas, dont je ne sais absolument rien, mais pour ricaner un peu sur les imbéciles partis défendre les couleurs de la Sarkozie en Afrique du sud, ce petit coup de patte.
Mais, sur un tout autre sujet, il y a d'abord ce texte-là avec ses vidéos, incontournable, ma propre archéologie également, tant je me rappelle que mon grand frère, alors féru de sport mécanique, nous avait bouleversés avec ça...Ma propre archéologie parce que je me rends compte également que je n'avais alors que cinq ans et que je découvre en même temps que mes souvenirs remontent donc bien plus loin que je ne le pensais.
Ce texte aussi et celui-ci. Deux textes fort intelligents. J'allais dire, comme d'habitude, mais les auteurs en rougiraient. J'les connais...
Et enfin, comme charité bien ordonnée...etc... Merci à Stéphane, alias le Grognard, de rappeler quand même que j'ai publié un livre au mois de mars.
Image : l'arrivée du courrier à Montpezat
08:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
18.06.2010
Ce champ peut ne pas être renseigné - 6 -
 Le grand danger est que vous vous isoliez maintenant dans la tour d'ivoire de l'orgueil blessé et de la paranoïaque.
Le grand danger est que vous vous isoliez maintenant dans la tour d'ivoire de l'orgueil blessé et de la paranoïaque.
De toute façon, paranoïaque, vous l'êtes depuis que vous êtes - et qu'importe ! - alors que, contradictoirement, vous vous montrez, dans vos relations affectives, d'une imprudence souvent coupable, offrant spontanément votre confiance à qui sait vous ouvrir les bras.
Cette tour d'ivoire, donc, est un refuge dangereux et serait de nature à compromettre un certain équilibre entre vous et vous, si elle n'était régulièrement visitée par vos doutes.
Si tant de gens que vous aimiez sincèrement vous ont tourné le dos comme un seul homme, n'ont pas défendu votre cause privée alors que vous en aviez, moralement et matériellement, tant besoin, c'est bien, vous dites-vous, que la cause était indéfendable et que vous ne pouvez décemment avoir raison contre tous.
Ce serait d'ailleurs un affront sans appel fait à votre discernement passé, car vous n'auriez jusqu'à présent aimé que des salopards.
Un seul de vos amis se serait fourvoyé, n'aurait pas levé le petit doigt pour vous éviter la spoliation que vous avez subie, que vous n'eussiez pas eu l'ombre d'une hésitation dans votre jugement. Mais deux, trois, puis quatre...Difficile à admettre ces comportements par la seule force d'une duplicité commune, sinon concertée, avec vous au milieu resplendissant de votre bon droit.
Vous voilà donc contraint de reconnaître que, peut-être, vous attendiez des gens que vous aimiez des choses qu'on ne doit pas attendre de l'amitié quand on sait se tenir.
Vous attendiez ce que vous auriez donné - vous en êtes absolument certain - le cas échéant. Ce en quoi, vous vous êtes trompé, dès le début, sur le sens même de l'amitié.
Et comment ne pas se tromper sur tout quand on se trompe sur l'essentiel ?
Fort de cet enseignement douloureux cependant, il vous faut également convenir que l'amitié n'est pas une valeur dont la réciprocité est inviolable et que, dès lors, elle ne vous intéresse plus. La camaraderie, la rigolade, l'éphémère, mais pas l'amitié.
Car même indéfendable - ce dont, quand même, vous continuez de douter très fort par le seul argument du bon sens primaire - une cause se défend aussi par affection. Si on ne défendait que les causes justes, on ne défendrait jamais rien de sa pauvre vie, une cause juste étant toujours injuste aux yeux de ceux qu'elle dessert et un engagement étant toujours armé par la subjectivité et la passion.
Votre tour d'ivoire n'est donc pas près de se fissurer, même en butte à vos interrogations. Vous avez été abandonné et peu importe que vous eussiez eu tort ou raison dans votre combat personnel. C'est là langage d'ensoutanés et de chats fourrés.
Le fait est.
Vous pensez aujourd'hui que, ne pouvant attendre de l'amitié qu'elle s'exprime clairement à vos côtés dans les moments les plus difficiles, vous êtes vraiment libre de vous être débarrassé à vos dépens de cette lénifiante illusion !
Et si un jour vous revenez vivre dans votre pays, vous saurez que vous y aurez des contacts, avec joie sans doute, mais point d'amis.
Même descendu de votre tour d'ivoire, l'ombre de son refuge s'accrochera désormais à l'ombre de chacun de vos pas.
Car on ne franchit pas deux fois les tourbillons d'un même torrent sur les mêmes planches pourries.
Image : Philip Seelen
09:57 Publié dans Apostrophes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.06.2010
Contes et légendes de Podlachie - 11 -
Le prince et le mendiant
Un jour de grande canicule - on était en juillet - un prince des Jadzvingues, un prince encore jeune, tout-puissant et escorté de ses gens, parcourait le vaste pays environnant son domaine.
L'ombre des forêts bruissait de milliers d'insectes affairés et les abeilles y butinaient dans un bourdonnement incessant, les tilleuls en fleurs. Les ruches disposées là, sur les lisières, ruisselaient d'un miel doré. L'air en était tout parfumé.
Une légère brise faisait onduler les épis de blé répandu sur la plaine, telles les vagues chaudes d'une mer blonde et lascive.
L'âme du prince se sentait alors pleine de vie en ces paisibles paysages et il chevauchait lentement, goûtant pleinement la beauté de son pays, muet d'une sorte d'attendrissement bucolique, tandis qu'une douce mélodie trottinait dans sa tête enjouée.
Au détour d'un chemin creux cependant, il aperçut, assis dans l'herbe épaisse du bas-côté, un homme qui tendait une main tremblante.
C'était un vieux mendiant, sale, recouvert de haillons tellement troués et tellement en lambeaux qu'on apercevait au travers son corps décharné, bruni par les feux du soleil, martyrisé par la soif et la faim.
Le prince descendit prestement de cheval, examina l'homme d'un œil humecté d'une soudaine compassion. Il prit dans sa main gantée de velours la main tendue, osseuse, longue, qui laissait voir les veines bleuâtres et gonflées, et qui tremblait toujours.
Holà, mes gens ! Qu'on apporte des habits brodés d'or et des fourrures ! Qu'on lave ce malheureux, qu'on le parfume et qu'on l'habille comme un homme de cour. Qu'on lui serve ici-même des viandes rôties choisies parmi les plus exquises et qu'on remplisse d'hydromel frais des coupes d'argent. Qu'on lui donne tout ce qu'il demandera et qu'on le conduise ensuite au château, qu'on lui réserve là-bas la plus belle chambre de la tour et qu'on attache à son service les domestiques les plus zélés.
On se précipita évidemment pour exécuter les ordres du puissant prince, lequel prince souriait aux anges, fier de son infinie bonté. Il s'approcha encore du malheureux et vit, à son grand étonnement, que des larmes abondantes ruisselaient de ses yeux et inondaient la barbe en broussailles.
Mais qu'as-tu donc à pleurer, pauvre homme ? N'es-tu pas satisfait du sort qui t'attend ? Te rends-tu seulement compte de l'avenir radieux qui s'ouvre à toi et que je t'offre ?
Et le mendiant hoqueta, presque tout bas :
Je pleure, Sire, parce qu'il n'y a pas plus grand malheur au monde que celui qui m'advient aujourd'hui de ne plus rien avoir à désirer !
08:00 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.06.2010
Le lettré et le douanier

Surtout si c'est toi l'étranger.
On s'y perd et c'est tant mieux. Parce que rien n'a jamais été sans doute aussi stupide que le concept d'étranger. C'est un concept ignorant de la dialectique, à tel point que l'étranger, c'est toujours l'autre.
Cette impression, donc, de sortir de toi. Comme si tu te regardais voir.
Tu dessines le monde avec un crayon difficile et qui t'est pourtant aussi naturel que l'odorat, l'ouie ou la vue. Tu ne croyais pas détenir tant de savoir parler.
Et l'élève te regarde. Admiratif, il dit que c'est beau, le sourcil cependant froncé par l'effort pour tenter de capter cette cascade bouillonnante qui sort de ta bouche, trop vite, trop vrai. Il faut alors prendre le temps de la faire s'écouler, la faire extérieure à toi.
En fait, tu asperges l'élève du lait dont tu as été nourri, et c'est là l'essence même de ton art.
Ton talent, c'est un berceau et une voix lactée.
Alors tu l'invites à boire avec toi ce lait. Qu'il raconte une histoire avec les mots de ta mère. L'aventure est risquée. Il lui faut se faire orphelin de la sienne. S'extirper.
« J'ai été en frontière rrrousse avec Pologne alentour quinze années passées...A Kaliningrad. Oui ? Bon. J'avais revenou de voyager à Saint Petersbourg...»
Mais les mots se cherchent et les conjugaisons trébuchent. Tu le corriges, bien sûr. Mais doucement, pas tout à fait, juste un peu, pour ne pas troubler l'accouchement qui s'opère et ne pas altérer ce plaisir évident qu'il a de jouer les premières gammes de cette musique baroque. Il chante une histoire et, avec tes mots atrophiés, il te la donne.
Toi, tu te fais soudain indulgent avec la grammaire, pardonnes les glissements de sens, laisses passer les synonymes intempestifs et les homonymies douteuses, ne relèves pas les pataquès.
Et l'histoire se sculpte. Devant toi, l'homme construit un château. Un château qui branle, certes, mais un château quand même, un château que tu vois, que tu entends, que tu comprends et, même, ô bonheur, que tu aimes.
Ta langue, tes mots, sont à lui.
Incorrigible natif, tu as rebâti cependant le château dans ta tête, au fur et à mesure qu'il l'élevait, pierre après pierre :
« Il y a une quinzaine d'années environ, je revenais d'un voyage à Saint-Pétersbourg, par Kaliningrad à la frontière russo-polonaise. C'était juste après la chute du mur, en 1992, je crois. Saint-Pétersbourg est une ville magnifique, une ville de rêveur, sillonnée par les eaux. Une Venise septentrionale.
J'avais fait le tour des librairies. Elles n'étaient hélas plus qu'un grotesque déballage de livres de science fiction américaine et de lamentables romans anglo-saxons à gros tirages. J'ai regardé, curieux et déçu.
J'attendais autre chose des vents de l'Ouest.
Le prix était aussi trop élevé pour moi. Beaucoup de roubles pour un seul de ces bouquins et je n'avais pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai musardé parmi les rayons obscurs de l'arrière boutique et là j'ai découvert, abandonnés, mis au rebut, de vrais livres, Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, Tchekhov. De vieux livres méprisés, abandonnés dans leur pousssière.
J'ai pu en remplir un plein sac à dos tant ils étaient bradés.
A la frontière, les douaniers étaient vigilants et fort soupçonneux de tout. Devant moi, ils ont arrêté un homme qui portait un sac semblable au mien. Ils ont ouvert ce sac qui s'est avéré receler beaucoup de vodka et de cigarettes.
J'observais leur manège. L'un d'eux surtout avait un comportement étrange, poussant du coude le contrevenant, plaisantant avec lui, goguenard.
En fait, il traitait une affaire. Quand il fut subrepticement payé en tabac et en alcool, e voyageur put enfin rentrer sans plus d'encombres en Pologne.
Vint mon tour.
Le fonctionnaire déjà se délectait à la vue de mon sac à dos aux coutures martyrisées, aux lanières douloureusement bandées par la surcharge. Et puis, il y avait ma gueule, cheveux longs, barbue. Une sale gueule de fumeur et de buveur.
La stupéfaction et le désappointement furent tels qu'il recula d'un pas et montra du doigt, révulsé, demandant ce que c'était que ça.
Je dis des livres.
Des livres ! Pour quoi faire ?
Pour lire, enfin.
Lire ? Pour quoi faire? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Les frères Karamazov, Anna Karénine, La Mouette, Raskalnikov et autres récits d'un chasseur....
Rien à fumer là-dedans. Rien à boire non plus. Que de l'ésotérique.
La colère avait succédé à l'étonnement. La vindicative botte du fonctionnaire dépité maltraita les livres. Il me fit violemment signe de déguerpir avec ma poubelle et sa bouche n'était plus qu'insultes et mépris. »
Epuisé, l'homme te regarde. Il voit que tu as compris son aventure. Alors il exulte.
Il sait parler.
Sans appeler le conditionnel passé deuxième forme à son secours, l'élève vient de te raconter l'universalité de la connerie humaine.
Texte publié le 1er juillet 2008
10:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
11.06.2010
Contes et légendes de Podlachie - 10 -
Le roi et le courtisan
Un roi, un roi des Yadwvingues, un jour s'étant cru offensé par un courtisan, ordonna à ses bourreaux que celui-ci fût tourmenté, qu'on le torturât cruellement, qu'on ne le tuât surtout pas, mais qu'on le chassât ensuite hors du palais et hors de la ville.
Les bourreaux - comme tous les bourreaux de la planète et de l'histoire - s'appliquèrent avec zèle à obéir à leur souverain. Ils coupèrent le nez et les oreilles de l'homme, puis, jugeant sans doute que c'était bien trop peu en expiation d'un outrage à Majesté, lui crevèrent les yeux et lui arrachèrent les dents.
Enfin, toujours en vertu des ordres royaux, ils le conduisirent aux portes de la ville et le jetèrent à terre, tout gémissant de douleur et tout sanguinolent.
Le pauvre homme réussit néanmoins à ramper, à se traîner dans les hautes herbes des fossés qui tenaient lieu de défenses, puis, titubant, à tâtons, lentement, chutant souvent lourdement, il rejoignit la vaste et sombre forêt.
Or, il advint que des années plus tard, ce bon roi à l'âme on ne peut plus raffinée - comme on vient de le constater - passa par hasard devant une cabane, au cœur de la forêt, alors qu'il forçait un cerf, accompagné de ses seigneurs les plus dévoués et de ses courtisans les plus en vue du moment. (Les pauvres ! ndlr)
Il vit là un vieillard aveugle, habillé d'affreux haillons et assis sur le seuil de la déplorable masure.
Oh, je sens que vous avez deviné, fins lecteurs que vous êtes ! Pas moyen de vous tenir en haleine sur le moindre suspens ! Ah, que c'en est décourageant, tenez, de vous raconter des légendes ! Moi qui avais fomenté le coup de vous surprendre et de vous faire tressaillir !
C'était donc bien, oui, l'ancien courtisan mutilé qui étais assis là, devant sa cabane toute de guingois.
Le roi le reconnut et eut soudain pitié de lui.
Un peu tardivement, il me semble...(ndlr)
Viens avec moi, je t'ai fait bien du mal autrefois et j'en ai des remords...Mais je veux réparer et que tu me pardonnes. Viens avec moi et tu seras à nouveau riche, puissant et heureux de vivre.
Il en a de bonnes, ce fichu roi...Riche et puissant, d'accord, mais le nez, et les oreilles, et les dents et les yeux ? Hein ? Mais il est vrai que les monarques, en cela imités à la perfection par les bourgeois qui leur succèderont un jour sur les trônes et dans les palais du monde, pensaient que tout pouvait s'acheter et être réparé par l'argent, le luxe et le pouvoir.
Mais je m'éloigne, je m'éloigne....
Ce roi-là cependant entendit sa victime lui répondre que la richesse et la joie de vivre, il les avait acquises ici, au coeur de la forêt et qu'il n'avait plus besoin de rien, ni des honneurs, ni du faste princier de la cour.
Ebahi, le roi s'exclama mais comment as-tu obtenu tout cela, solitaire et infirme que tu es, en haillons et vivant sous ce misérable toit ?
Loin du monde, j'ai trouvé le secret du bonheur. J'entends des mélodies que ton oreille n'entendra jamais, monarque ! Je vois des choses que tu ne verras jamais de tes yeux, des choses si belles que ton âme ne peut pas même les imaginer. Les plus suaves merveilles du monde, de ton monde, ne peuvent égaler celles qui parcourent mon rêve. Et tout ceci, monarque, en dépit de ta puissance, tu ne pourras jamais me le prendre : Car tu n'y auras jamais accès. Et ça n'est pas toi, dès lors, qui es mon débiteur mais moi qui te suis redevable de tous ces magnifiques songes qui habitent la nuit dans laquelle m'a plongé ta vengeance.
Et le vieillard se mit à raconter de si beaux contes, de telles légendes, que le roi subjugué, la voix éteinte, demanda : Où donc as tu appris tout cela ?
L''aveugle murmura alors :
Dans la souffrance que tu m'as infligée.
NB : Si je devais faire l'analyse, même succincte, de cette légende, je dirais qu'elle ne me plaît pas beaucoup ... Car la vieille rengaine, souffrance qui déboucherait sur le bonheur immatériel, les curés de tout poil l'ont trop rabâchée pendant des siècles et des siècles pour asseoir leur domination sur l'ignorance et protéger les riches des séditions du pauvre...
Mais je ne dis rien de tout ça, critiquer une légende n'étant pas de ma compétence....
12:12 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.06.2010
Ce champ peut ne pas être renseigné - 5 -

Que du vert, du vert partout et du bleu, du bleu serein, grandiose au-dessus.
Vous avez pensé que la journée allait être une fournaise, que le titre de votre manuscrit n'était peut-être pas très bon - mais qu'importe le titre -, puis vous avez soudain douté du manuscrit tout entier, et vite, vous vous êtes dit que l'Océan devait être bleu aussi, là-bas, et que c'est ce que vous écririez aujourd'hui sur votre blog, cette double couleur du monde devant vos yeux matinaux.
En fait, vous cherchiez peut-être un signe.
Vous êtes un homme qui cherche des signes et qui s'en défend le plus souvent, qui lutte pour ne pas leur prêter foi, auxquels vous opposez mentalement votre soi-disant matérialisme et les sages et ennuyeuses résolutions de la raison.
Or, vous êtes tout, sauf un raisonnable et un matérialiste. Et tout sauf un idéaliste.
Il vous est arrivé, au hasard, de compter les marches d'un escalier à gravir et de vous dire, tiens, le nombre de ces marches sera le nombre d'années qu'il me reste à vivre, ou alors de voir une bande de corbeaux sur les champs et d'effectuer la même ridicule opération...
C'est un peu la chaos sous vos cheveux, finalement. Ce chaos-là, est sans doute l'amour de la vie et cette présence constante de l'angoisse de mourir.
Elle est venue portant dans son bec une touffe d'herbe sèche.
Une grande cigogne sur ses pieds claudiquant.
Vous avez refermé la fenêtre.
Ce n'était qu'une cigogne. Quel signe aurait-elle voulu vous transmettre ?
Le café était bon et le soleil montait par-dessus la maison de votre vieille voisine.
Quand l'ordinaire est exceptionnel, quelque chose de subversif entre dans la tête des gens en même temps qu'un espoir indéfini, indicible, inaccessible y tremble.
En tout cas dans la vôtre.
12:58 Publié dans Apostrophes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.06.2010
Une grande dame polonaise au Panthéon
 Je parcourais, dernièrement et distraitement, une rétrospective de l’année 1995. En principe, quand on fait ça, on perd magistralement son temps. Pas la peine d'avoir sous les yeux ce dont on se souvient trop bien et sans grand enthousiasme.
Je parcourais, dernièrement et distraitement, une rétrospective de l’année 1995. En principe, quand on fait ça, on perd magistralement son temps. Pas la peine d'avoir sous les yeux ce dont on se souvient trop bien et sans grand enthousiasme.
Mais là, je n'ai pas regretté car un petit article m’a bien fait sourire et hausser les épaules.
Le 20 avril de cette année-là en effet, François Mitterrand, en même temps très proche de la sortie et de la tombe, faisait entrer Pierre et Marie Curie au Panthéon.
Oui, et alors ? Alors on se souvient que le gars Mitterrand avait commencé quatorze ans plus tôt son premier septennat par une visite aux grands hommes de la Nation et que donc, à la fin de son deuxième, il avait absolument voulu conclure aussi par le Panthéon. La boucle. Comme une sourde obstination.
Connaissant, quoique de très loin, l’oiseau, je subodore fortement que c’étaient-là deux signes forts, histoire de dire à l’Histoire de ne pas l’oublier et, dans quelques décennies, de le faire lui-même dormir aux côtés des illustres gisants.
Comme un gars qui tournerait la cuillère autour du pot, sans avouer son véritable dessein.
Mais revenons à Pierre et Marie Curie.
Ce qui m’a fait sourire, c’est qu’on mentionnait dans cet entrefilet, que c’était la première fois qu’on portait les cendres d’une femme en ce sanctuaire ….Et on disait aussi que cette dame avait élevé l’esprit scientifique français très haut vers les sphères du prestige…
Oui, c’est vrai, sauf que Marie s’appelait, avant d’avoir contracté mariage, Maria Skłodowska, qu’elle était polonaise - alors que la Pologne n'existait plus - et qu’au frontispice de ce célèbre foutoir est écrit : Aux grands hommes la Nation reconnaissante...
Et Maria, dans tout ça, Maria qui toute sa vie, en tant que femme et immigrée, a lutté contre les préjugés agressifs du sérail scientifique et politique, devra t-elle faire montre d'une dernière et posthume révolte indignée en soulevant les lourdes dalles de son tombeau pour demander qu’on mette au goût du jour la célèbre inscription ?
15:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.06.2010
Voleur de paysages

De ma fenêtre ouverte sur les champs qu’interrompt brusquement la forêt, je regarde juin aux déclins de lumière.
Et je me demande : Est-ce que ce paysage ainsi découpé par une seule ouverture, la mienne, pourrait être celui de mon pays ?
En quoi est-il une carte de voyage ? Un autre regard ?
En quoi est-il un paysage que je peux m'approprier pour être véritablement chez moi, quand il n’y a plus, pour le percevoir sous sa juste latitude, ni neige au sol ni glace suspendue aux branches telles les stalactites des grottes profondes ?
Mentalement, je gomme ce que je ne verrais pas d’une fenêtre au pays d’où je viens.
Je le lis avec les yeux d'un étranger.
Je dissèque.
Un champ de seigle, aussi vert que bleu par les bleuets qui s’y balancent au vent.
Pas de désherbant encore. Ou alors moins meurtrier que sous les fenêtres de France. Et puis ce seigle est épars, long et tremblant. La céréale des terres maigres et du sable.
Pas d’engrais miracle qui nient l’effort de la plante et de sa survie.
J’efface.
Des bouleaux. Beaucoup de bouleaux, de grands bouleaux blancs et plus loin, derrière eux, la tête toujours sombre des pins. Forêt déjà septentrionale.
Je raye.
Sur la prairie une cigogne, ses grandes pattes maladroites qui claudiquent, sa démarche de clown, sa silhouette gauche, elle qui traversera bientôt l’Europe et l’Afrique à la seule force de ses ailes. L’Albatros des continents. Point de marins ivres pour agacer son long bec.
Je supprime.
Me restent les nuages blancs, un bout de bleu, un ciel pas différent mais décalé. C’est la seule chose que les hommes partagent à peu près, que je me dis. Le ciel comme un mouchoir de poche. Chacun son bout. Une vision étriquée par la géographie.
Et le soleil qui s’en va d’où je suis venu.
Où mon amour d’aller s'estompe mais demeure.
Chapitre II, scène 2.
Bonheur d’être ailleurs quand on sait, in fine, n'avoir été nulle part chez soi.
Un port sans la mer, une ancre sans navire, une traversée sans cap.
Texte (légèrement modifié) mis en ligne il y a un an, jour pour jour
10:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.06.2010
Ce champ peut ne pas être renseigné - 4 -
 Voyager, c'est d'abord s'arrêter loin. Sinon, il faudrait dire errer.
Voyager, c'est d'abord s'arrêter loin. Sinon, il faudrait dire errer.
En changeant de latitude, vous avez eu un moment l'illusion de changer de monde.
Mais qu'entendez-vous exactement par monde ?
Si vous entendez les hommes, leurs sociétés, leurs systèmes de pensée, leurs comportements, leurs motivations, leurs constructions, leurs buts, leurs erreurs, leurs amours, leurs mensonges et leurs espoirs, alors c'était une bien pitoyable illusion, surtout avec plus de cinquante printemps inscrits sur le sable de votre parcours.
Ce monde-là est universel. On ne le quitte qu'en quittant la planète. Le plus tard possible parce que, malgré tout, c'est un monde qu'on aime.
Le seul qu'il nous sera jamais donné de vivre.
Mais si vous entendez par monde la course de la lumière et les paysages, le vent et les climats, le décor du théâtre, alors vous avez changé de monde et ce monde-là vous a changé.
Cette nuit même, vous vous êtes levé peu avant trois heures et le jour vous avait pourtant précédé, salué par les premiers oiseaux chanteurs, revenus, pour un temps qui sera court, de leurs quartiers d'hiver.
Vous avez regardé l'orient, rose et bleu, qui palpitait sous des brouillards indécis.
Vous vous êtes dit que derrière la frontière, un peu plus loin encore, sur l'autre rive du Bug, l'étoile de feu était déjà bien visible et bien ronde dans le ciel, alors que là-bas, dans l'autre monde d'où vous venez, c'était pour des heures encore la nuit noire et que les gens dormaient, les poings serrés sur des oreillers chauds.
Vous avez souri et pensé que, peut-être, un couche-tard de vos amis, penché sur son clavier, écrivait des lignes et des pages sur cette nuit qui n'en finissait pas.
Vous aimez maintenant ce que vous repoussiez jadis. Vous aimez la fraîcheur solitaire des aurores et la brièveté fuyante des soirées... C'est en cela que vous avez changé de monde et ne voulez pas en perdre une seule miette.
Vous avez changé votre façon de vivre la lumière, donc vos jours, donc les pointillés qui, un à un, conduisent au bout de la piste.
Pourtant..Pourtant...C'est toujours les mêmes choses qui palpitent en vous et que vous avez à dire.
Mais vous voulez les dire différemment et ne poursuivez plus de vos yeux imbibés les chimères au long cours.
Photo : Aurélien Audevard
03:00 Publié dans Apostrophes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
03.06.2010
Contes et légendes de Podlachie - 9 -
 La viorne
La viorne
L'homme venait de loin...De vraiment très loin.
Il venait de pays bien plus lumineux que ne le sont les plaines désertes de Podlachie. C'est du moins ce qu'il prétendait.
Il venait de par-delà les plaines, les bois, les forêts, les vallées, les montagnes, les fleuves et les rivières...Il venait d'aussi loin que peut venir le vent...Des rives inconnues d'une grande étendue liquide et mouvante, qu'il appelait la mer.
À l'autre bout du monde.
Il disait que là-bas, les hommes faisaient sur les tables des tavernes s'entrechoquer de lourdes pièces d'or ; Il disait qu'avec ces pièces, ils achetaient, ils construisaient, ils échangeaient des richesses et vivaient dans une joyeuse opulence.
Il disait que s'élevaient là-bas, à la gloire du grand Manitou, des bâtiments pharaoniques, à la pierre finement ciselée et dont les clochers en forme d'aiguille s'élevaient bien plus haut que les nuages en pluie. Et, ce disant, il montrait avec dédain les misérables huttes de bois et de chaume des Yadwvingues, les yeux écarquillés, bouche bée, transportés par les mots qui ruisselaient des lèvres magiques du voyageur.
Plus que tout autre, une jeune fille s'enivrait des paroles de cet homme. Son âme s'enfuyait vers ces contrées mystérieuses et ses yeux verts, ses grands yeux verts, obstinément rivés sur le voyageur, flamboyaient d'un espoir infini. Elle avait nom Kalina, comme d'autres s'appellent Marguerite, Rose ou même Narcisse, car Kalina désigne aussi la viorne, ce petit arbrisseau aux fines feuilles dentelées et aux baies rouges, qui mûrissent en automne près des ruisseaux limpides.
L'homme remarqua bientôt le regard de Kalina et la tendre silhouette de la jeune femme et ses longs cheveux bruns qui tombaient en cascades éparses sur ses belles épaules.
Il dit alors qu'il voulait l'épouser, qu'il lui montrerait ces pays paradisiaques d'où il venait et qu'il la couvrirait aussi d'or et de lumière.
Kalina fut aux anges et accepta, le genoux à terre, que le voyageur venu des antipodes devienne son compagnon.
On fit une fête énorme, tout le village dansa, s'enivra et chanta toute une nuit durant, et, au matin, le voyageur prit la jeune femme en croupe (du cheval, ho, ho, ho...attention ! ndlr) et l'emporta loin du village, des huttes et des forêts des paisibles et crédules Yadwvingues.
Les brouillards de la plaine les enveloppèrent bientôt, qui disparaissaient sur l'horizon humide.
C'est alors que Kalina déchanta...
C'est toujours comme ça, dans les légendes, nom d'un chien ! Les bons s'avèrent bientôt être des méchants et vice-versa...C'est à désespérer des uns et des autres ! Bref...
Car, au cours du long voyage, l'homme lui parlait durement, la rudoyait même, et lui donnait les ordres les plus abjects. Outre la préparation des repas, le cirage de ses bottes, le dépoussiérage de ses habits, l'étrillage du cheval, il lui fallait porter les bagages si le terrain était trop lourd et commandait que la monture fût ménagée.
Mais pire, il y eut bien pire...Il y eut l'irréparable meurtrissure. Dans des tavernes obscures, turbulentes, remplies du fracas des ripailles, l'homme, pour quelques pièces d'or, en vint chaque soir à vendre les beautés de sa jeune femme.
Kalina ayant réussi à tromper la vigilance de son bourreau, un soir qu'il était ivre et faisait bombance avec d'autres dépravés de son acabit, revint au village après un long, très long voyage.
Mais son cœur était humilié et sali à jamais...Elle pleurait et des larmes de sang s'écoulaient de ses paupières.
Elle dit que l'homme était le diable ; Que tous les hommes, là-bas, riches, vaniteux et braillards, étaient des diables car ils achetaient et vendaient tout, même la vertu des femmes.
Elle partit alors s'allonger dans la forêt, aux abords du village, et voulut mourir là, sur le bord d'une eau qui scintillait entre les herbes, tandis que des pleurs de sang, les pleurs de la honte et de l'infamie, dégoulinaient en silence de ses yeux épouvantés.
Et c'est pourquoi les forêts humides de Podlachie regorgent aujourd'hui de ce frêle arbrisseau, la viorne, qui, chaque automne, sempiternellement, jette au ruisseau ses gouttelettes rouge-sang...
08:00 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.06.2010
Jusqu'où l'impunité des crimes ?
11:27 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
Consultations mai
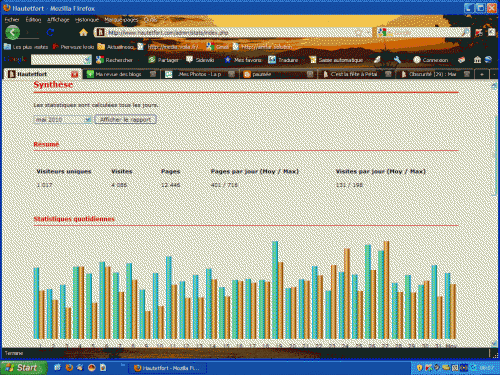
Quoique ...
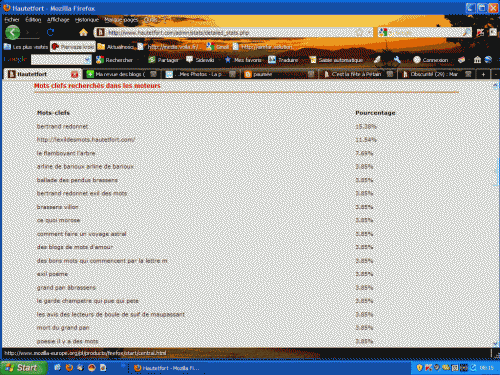
08:53 Publié dans Statistiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET




















