09.02.2018
Marcher
 Je marche sur et dans les campagnes enneigées.
Je marche sur et dans les campagnes enneigées.
C’est ce que j’ai écrit ce matin à mon ami des bords de mer, là-bas, du côté de La Rochelle.
Joie initiale, et jamais égalée, d’être debout dans l’espace. Aller à la rencontre du vide.
Marcher sans dire.
Surtout marcher seul.
Parce qu’on marche d’abord vers cet horizon courbé et qu’on ne sait pas ce qu’il y a derrière ce dos rond.
Le soleil y plonge dans la neige. C’est à peu près tout ce qu’on sait.
Encore qu’on n’en soit pas vraiment certain. On se demande toujours si, derrière la chute de l’horizon, d’autres horizons ne s’enflammeraient pas.
Car vient un moment où l’on ne sait plus si l’étoile incandescente sort de la terre ou si elle va s’y enfouir, tant que l’on ne sait plus, non plus, à quel bout de sa promenade on en est.
Au début ou vers la fin. Si elle est initiatique ou testamentaire.
Une plaine ? Une colline ? Un fleuve ? Des bois ? Un désert ? Des animaux ténébreux ? Au pire d’autres hommes, qu’il y aurait derrière cette échine enluminée ?
On ne peut rien affirmer de cet horizon voûté. Ou alors des bêtises. Des plates ou des savantes. Ça dépend comme on marche. En tout cas ne rien écouter, sinon son propre murmure.
A écouter les bêtises plates ou savantes qu’on dit de la courbe de l’horizon, forcément on dira soi-même des bêtises.
Plus affligeant : on les croira bientôt.
Comme si on avait déjà été voir là-bas alors qu’on voit à peine jusqu’au bout de ses pieds. Il n’y a pas plus présomptueux, plus répugnant même, que quelqu’un qui marche en faisant croire qu’il sait déjà le paysage de derrière la colline.
Celui qui dit qu’il est habité comme celui qui affirme qu’il n’y a là-bas que du néant.
Non. Marcher, c’est ça qu’il faut. Marcher avec le vent qui vous pousse ou qui sort de devant, on ne sait d'où, et qui chahute les poils du visage.
Je marche sur la piste du loup. La plus solitaire.
Et il arrive que je m’y perde.
Le chemin jusqu’au point de chute semble pourtant largement ouvert.
Mais peut-être suis-je en fait passé de l’autre côté de la colline en feu et que c’est ça qu’il y avait derrière la colline en feu.
Simplement.
Des imbéciles errants parce qu'ils avaient perdu le sens des allégories.
11:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littératur, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
06.02.2018
Où l'on reparle de la pomme qui du pommier ne tombe pas loin

Merci à Ghislaine-Antoine pour la lecture qu'elle fit de mon roman et pour l’article qu’elle lui a consacré.
Cela me fait d'autant plus plaisir qu'il m'arrive avec ce livre ce qu'il ne m’était jamais arrivé auparavant: il me manque.
Je me souviens de plein de choses de son écriture, la forêt de Białowieża, les villages, les repérages que j’allais y faire et où je m’imprégnais du souffle antédiluvien de l‘immense sylve.
Je m’étais attaché à Zbyszek aussi…
Comme à une ombre.
C’est ici..
17:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.01.2018
Latitudes - 1 -
J’avais autrefois, au-dessus de la tête, la douceur à peu près égale, sauf cas de crise, des climats de bord de mer. Des climats qui sentaient le sable, la brume et les algues de la marée.
Et puis, sous mes pieds, toute cette verdure des marais, des chemins de halage et des berges herbeuses le long des larges conches. 
C’était, dans mon esprit, un climat sans surprise, un climat dont la respiration était réglée sur celle du grand voisin Océan. La lumière y était d’ailleurs en perpétuelle réverbération sur une géographie façonnée par l’eau, le souffle du large et l’histoire des peuples de la mer. Les étés, sans être étouffants, chauffaient la peau et les hivers, sans être tout à fait confortables, ne cisaillaient pas le bout des doigts, ne statufiaient pas les paysages et ne gelaient pas les poils du nez quand on marchait dans le vent. Là-bas, quand on discutait météo, c’était pour se plaindre des longs crachins de l’automne ou des opiniâtres pluies de printemps, d’un orage qui avait éclaté sans crier gare et que, ma foi, on eût dit que tout le noir du ciel allait tantôt dégouliner sur les terres.
Occasionnellement, vraiment pas très souvent, un peu de neige venait saupoudrer la prairie mais, à la vue de tous ces paysages dont l’eau était l’architecte premier, elle se dépêchait de fondre en larmes, parfois même avant de toucher le sol.
J’ai connu là-bas de vieux maraîchins, descendants des huttiers, manants et hors-la-loi qui peuplaient jadis l’inextricable dédale des fossés, des canaux et des ruisseaux. Ils n’auraient pas su vivre leur sang ailleurs que dans cette végétation luxuriante et moite, ils n’avaient d’yeux et de passion que pour l’anguille des marais et, comme elle, ils semblaient lucifuges au point de ne pouvoir respirer que dans l’ombre épaisse des labyrinthes d’eau et de terre.
C’était une latitude, un climat, une géographie et une histoire : celle de la conquête des terres abandonnées jadis par l’Océan.
Les hommes étaient, comme tous les hommes du monde, inscrits dans le décor d’une destinée humaine.
Comme le sont, ici, les habitants du vent, des étés étouffants, de la neige et de la glace, sur une plaine de sable ouverte aux quatre horizons et déroulée, du Sud au Nord, des Carpates à la Baltique et, d'Ouest en Est, des modestes collines d'Allemagne jusqu'à l'Oural.
14:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.01.2018
L'humeur des lieux

Hier, j’ai traversé des plateaux enneigés, de petites vallées glacées, d’immenses forêts que la solitude rendait muettes, le tout scintillant sous un grand soleil d’hiver.
- C’est beau pourtant, ai-je dit, à D. assise à mes côtés…
Mais pourquoi ce pourtant ? Parce que ce n’était pas un voyage fait pour la gaité.
Un élan a traversé notre route, énorme, haut, très haut sur ses pattes… Sa nonchalance était noire sur la blancheur du monde.
J’aurais dû le trouver beau.
Je l’ai trouvé fort inquiétant. Lugubre même.
J’allais dans une ville magnifique, tellement, qu’elle a pris le surnom de Padoue de l’Est. Ou du Nord. Une ville endormie sous la lumière des neiges et du ciel inondé de bleu.
Zamość. La patrie de Rosa Luxembourg. Je le dis parce que l'Histoire a retenu qu'elle était allemande. C'est vraiment con, l'Histoire...
Mais je ne l’ai pas trouvée belle, cette belle ville
J’étais là pour des raisons qui n'aiment pas la beauté.
J’y retournerai.
Je retraverserai ces plateaux, ces forêts et ces petites vallées pour venir m’asseoir un moment sous les couleurs chatoyantes des facades.
Quand reviendra, s’il revient, le temps de ne plus avoir peur du temps.
11:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.01.2018
Le port des gueux
 C’est un nom de hameau d’une éloquence pathétique. Un port dans la campagne... L’image flotte en filigrane : il y a beaucoup d’eau et il y a des manants loqueteux.
C’est un nom de hameau d’une éloquence pathétique. Un port dans la campagne... L’image flotte en filigrane : il y a beaucoup d’eau et il y a des manants loqueteux.
En passant par là nous passons en même temps de l’autre côté des mots inscrits en italique sur le panneau indicateur. Le hameau se détache du présent, duquel nous avons soudain arrêté la fuite. Il nous fait signe et il décline son identité.
La marquise de Poléon n’avait, dit-on, cure de ces terres inondées, en proie aux végétations aquatiques inextricables et aux halliers. Terres sans rapport, terres maudites, terres impraticables de l’extrémité de son vaste domaine. Magnanime, elle en fit alors don à ceux de ses paysans qui vivaient à proximité, lesquels paysans, à force de digues, à force de petits canaux et de fossés creusés, en firent une zone cultivable, une enclave prospère du marais, un port, que la marquise s’empressa de baptiser « des gueux ». Le port des gueux a donc reçu ses lettres de noblesse et nous le visitons avec autant de respect que d’émotion.
Mais une autre biographie prétend à des temps plus rapprochés, plus palpables donc.
La région était, avant le phylloxéra dévastateur, une riche et grande région viticole. Le vin coulait à flots dans les auberges comme dans les tonneaux des Danaïdes. Pensez donc que Mauzé-sur-le-Mignon, à une lieue de là, cité prospère sur la route de Poitiers à La Rochelle, ne comptait pas moins de quinze auberges, relais de poste et de chevaux. L’Empereur lui-même, en partance pour la Roche sur Yon, y gîta une nuit.
De la vigne donc tout alentour, mais point de fumier pour en flatter la croissance. Il fallut donc en importer.
En remontant le Mignon on arrivera forcément à Bazoin, enchevêtrement d’écluses, confluent du canal et de la Sèvre qui poursuit sa flânerie en larges méandres à travers la Vendée, jusqu’à Charron, paradis des moules, où elle s’engouffre dans la gueule toujours béante de l’Océan.
Et la Vendée est un vaste pacage où ruminent les troupeaux de bovins. C’est donc jusqu’à notre petit port qu’était acheminé par d’énormes barques, tout le fumier produit là-bas et nécessaire à la culture du vignoble. Travail ingrat, travail malodorant, salissant, travail pénible réservé aux ouvriers agricoles, ceux qui n’avaient point de benasse au soleil à faire valoir, et le purin qui devait dégouliner sur les chemins alentour. Un travail de gueux, à tel point que le petit port a voulu s’en souvenir.
Mais peut-être les deux versions se rejoignent-elles en fait, les viticulteurs de la fin du 19ème mettant à profit l’ingéniosité et l’opiniâtreté de leurs ancêtres asservis du 16ème …
On n’y voit aujourd’hui que des pêcheurs nonchalants et deux cygnes qui flânent en couple et en rond. Plus de marquise, plus de vignes, plus de barques, plus de fumier et plus de gueux. Pas plus qu’ailleurs, je veux dire.
Seul demeure ce nom composé au génitif un peu désobligeant, comme un signal dans les brumes de la mémoire et qui l’obligerait à s’arrêter là.
Pour un moment de lecture.
15:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.01.2018
C'était hier
 J’ai marché hier sur des chemins improbables.
J’ai marché hier sur des chemins improbables.
C’étaient des chemins que j’avais inventés au travers des prairies neigeuses.
Et j’y ai croisé l’oiseau des grands hivers, celui qui vient chez moi quand il fait froid et blanc, parce qu’ailleurs, plus à l‘est et plus au nord, il fait plus blanc encore.
Il est le bel oiseau des biomes les plus froids de la machine ronde, la taïga et la toundra, mais hier il était près de moi, sur un buisson rabougri, le long de ma randonnée.
J’ai d’abord entendu ses piaulements continuels avant de le voir voltiger, de petites baies rouges en petites baies rouges.
Le vent me cinglait les yeux et des larmes en coulaient.
Autrefois, les invasions piaillardes du jaseur boréal – puisque c’est de lui que je parle - annonçaient de grands malheurs, tels que la peste ou la guerre. Lecture à tiroirs des manifestations de la nature en mouvement, quand l’épiphénomène est lu comme la cause : ces bandes invasives du jaseur étaient dues - et sont encore dues - à une surpopulation concomitante d’un froid extrême et soudain dans les régions les plus septentrionales de la Russie et de la Norvège.
Au Moyen-âge, elles précédaient alors le déferlement des neiges et de l’hiver sur l’Europe centrale, avec leurs corollaires historiques, la famine et, partant, les guerres et le pillage.
Jaseur, celui qui bavarde sans cesse et boréal qui nous vient du « vent de Borée », vent du nord énoncé par le grec ancien.
D’accord, mais qu’es-tu donc venu m’annoncer, beau parleur des mortes saisons ? Ne penses-tu pas que ma besace est pleine et déjà assez lourde à mon épaule ?
Autrefois, j’étais un chanteur, tu sais… J’aimais forcer la note et taquiner le trémolo. Moi aussi, je jasais de branches en branches.
Mais je n’annonçais rien. Alors les forces du destin m’ont éteint la glotte.
M'ont enjoint de me taire.
Es-tu venu maintenant me couper les ailes, que tu sois là, sur ma randonnée de blanche solitude ?
Je n’ai pas peur de la peste, tu sais...
Ni des guerres ; je m’en fous.
De la famine, un peu.
Alors va, mon bel oiseau, frère de la rencontre éphémère… Laisse-moi marcher encore un peu sur ces neiges silencieuses.
C’est le vent, et seulement le vent, qui me fait larmoyer.
Ce vent qui t’a chassé, ce vent qui t’a poussé.
Connais-tu un vent, toi de si loin venu, qui sécherait les larmes ?
Non. Tu ne sais que les vents que je sais
Celui des perpétuelles errances.
12:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.01.2018
Chanteloup
 Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi et comment les fresques qui ornaient les parois de la grotte d’Altamira, au nord-ouest de l’Espagne, ressemblaient tant à celles de Lascaux.
Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi et comment les fresques qui ornaient les parois de la grotte d’Altamira, au nord-ouest de l’Espagne, ressemblaient tant à celles de Lascaux.
Des hommes qui n’étaient alors nullement reliés par une organisation sociale, par une idéologie culturelle et un apprentissage de l’art, qui n’appartenaient pas, semble t-il, ni à une même religion constituée en église, ni à une même horde, qui sans doute n’avaient jamais échangé entre eux et qui, peut-être, même, ignoraient jusqu’à leur existence réciproque, peignaient avec les mêmes couleurs, leurs mêmes préoccupations du monde et le même désir d’en sublimer l'essentiel.
Peut-être est-ce mon ignorance, en tous cas, cela me laisse perplexe et me fait in petto échafauder moult théories, plus farfelues les unes que les autres.
Beaucoup plus près de nous, au Moyen-âge, mais de telle façon qu’elle autorise, non pas une analogie mais une approche voisine, des villages, des lieux-dits, des champs, des bois, des vignobles, éloignés entre eux de plusieurs centaines de lieues, ont été désignés aux quatre coins de France sous la très belle appellation de Chanteloup.
Animal de légende ou bien hurlant aux portes des villages, animal honni, animal adulé, craint, respecté, fui ou recherché, le loup représente quelque chose de profondément universel des peurs ancestrales et des angoisses de vivre.
Nous portons sans doute en nous une sorte d’atavisme obscur qui laisserait à penser que nous aurions été des êtres extrêmement ténébreux, des fauves redoutables et d’une cruauté inouïe. Il est des peurs en nous qui dépassent la notion même de peur. Le loup sans doute a servi a donné un nom à ces frayeurs de nous-mêmes, resurgies des ténèbres les plus profondes et les plus mystérieuses de la vie humaine.
Donner un nom, identifier, c’est entrer dans le réel, même par le biais de la légende, et c’est éviter ainsi les affres de l'épouvante qui conduisent assurément à la démence.
Dans toutes les civilisations qui l’ont côtoyé, le loup est ainsi au centre des mythologies et des légendes pour y symboliser la mort.
Chez des peuples aussi éloignés que l’étaient les grecs et les Gaulois, les démons sont pareillement revêtus d’une peau de loup.
Le dieu de la mort chez les Etrusques avait des oreilles de loup. C’est pourtant une louve qui maintint en vie Remus et Romulus en les nourrissant de son lait et qui donc, en dernière instance, se trouve à l’origine de la fondation de Rome. Le loup ici préside aux deux entités, vie et mort.
Chez les peuples nordiques de Scandinavie, les loups, érigés au rang des dieux, image terrifiante, dévorent les astres.
Le mythe du loup-garou, mi-homme, mi-fauve est une des paraboles les plus puissantes de l’Occident demeurée au niveau de la conscience collective, à tel point qu’elle définit cette maladie mentale qu’est la lycanthropie.
Nos paysages, donc, dépositaires et orateurs de la fuite du temps, fourmillent alors forcément de lieux qui inscrivent au présent l’existence révolue de la bête mythique, comme le fossile inscrit dans la pierre le passage d’un être du crétacé supérieur.
Au cœur même de Paris, Le Louvre, sur une place fréquentée par les loups du temps où ceux-ci entraient encore dans la ville, en est une illustration parfaite. Et quoi de mieux indiqué qu’un grand musée pour garder la mémoire ?
C’est sur ces mêmes racines étymologiques qu’est né le lycée, du nom d’un quartier nord-est d’Athènes, un peu secret, où Aristote dispensait ses leçons de philosophie et qui, en grec, qualifiait « l’endroit où il y a des loups. » Il est d’ailleurs plaisant de se rappeler que dans le Livre de la jungle, les loups y tiennent une conférence de grands démocrates.
Quant aux communes Chanteloup, elles se rencontrent dans pas moins d’une dizaine de départements, dont les Deux-Sèvres.
On ne saurait par ailleurs recenser exactement les hameaux minuscules, les champs, les carrefours, les ponts, les bois et les chemins où la hantise du loup a été immortalisée, sous forme de cabane au loup, pré au loup, brande au loup, Petteloup et autres Brâmes loup ou encore Jappeloup.
Parce qu’un loup ça pète, ça hurle ou alors ça jappe. Mais un loup peut-il chanter ?
La Pologne, comme toute l’Europe centrale, connaît le loup et la bête famélique des bois et des chemins y est encore présente, quoique extrêmement raréfiée.
Il y a donc quelques années de cela, un conducteur de traîneau me racontait qu’un après-midi de décembre où il promenait des touristes sur un obscur chemin forestier, son cheval s’était brusquement cabré, avait renâclé et s’était mis à hennir, le naseau frémissant, les membres pris de tremblements et refusant d’avancer plus loin sous le couvert de la forêt : l’animal avait éventé, avec cet instinct propre aux animaux face à la mort qui rôde, la présence d’un loup dans l’épaisseur neigeuse des sous-bois.
Voulant éviter à ses promeneurs, quoiqu’ils fussent en bons touristes à la recherche de fortes sensations, les désagréments d’une frayeur, le brave homme avait fait demi-tour sans leur fournir plus d’explications.
J’ai demandé alors si, parmi ces bois de pins et de bouleaux, dans ces vallées en broussailles ou beaucoup plus loin encore au pied des montagnes, il y avait quelque part des villages qui porteraient le nom de Chanteloup.
Avant même de réfléchir, l’homme avait froncé le sourcil, écarquillé les yeux et répondu que non, que les loups ne chantaient pas et que la juxtaposition des deux termes sonnait comme une burlesque incongruité.
Comme si nous avions à traduire, nous autres, Hurlepoisson.
J’ai réfléchi alors que ce bon bougre de Polonais avait spontanément mis le doigt sur une bizarrerie, ou alors c’était que les loups ne chantaient que morts, dans la mémoire et dans les endroits où on les avait méthodiquement et consciencieusement éliminés.
10:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
10.01.2018
Parole d'exil
 Qu’elle émane d’un autochtone ou d’un compatriote de passage, la question m’est souvent posée de savoir si mon pays me manque.
Qu’elle émane d’un autochtone ou d’un compatriote de passage, la question m’est souvent posée de savoir si mon pays me manque.
En soi, c’est une question profonde. Dite comme ça pourtant, elle semble posée sur le mode du comment ça va ? Une question de l’urbanité la plus élémentaire, dont on n’attend pas forcément une réponse, quand on ne s’en fiche pas éperdument.
Je me suis dès lors fabriqué une métaphore à quatre sous, que je ressers à chaque fois et qui, je crois, satisfait toujours mon interlocuteur :
- Je suppose qu’un marin isolé sur la mer, même amoureux de la mer, a parfois le mal de terre…
C’est une dérobade. Je n’ai en effet pas envie de dire en deux mots si mon pays me manque ou non. C’est beaucoup plus compliqué que cela et c’est un sujet qui, à mes yeux, après bientôt treize ans d’exil, mérite un développement en profondeur. Ne serait-ce que pour y voir moi-même plus clair.
C’est le genre de question auquel, peut-être, seule l’écriture peut répondre.
C’était donc en mai 2005.
Depuis un an déjà, la décision de larguer les amarres était ancrée en moi. C’était une décision qui m’effrayait et m’enthousiasmait tout à la fois. Je n’avais jamais rien fait de tel, évidemment, je ne savais ni la longueur, ni même le profil de la route sur laquelle je m’engageais. Je ne savais rien de tout cela car je ne savais pas, intérieurement, ce qu’était un pays affublé d’un adjectif possessif. Mon pays. Je n’avais jamais utilisé cette équation, je ne l’avais jamais ressentie, je la jugeais surannée, sans fondement, et même dangereuse. Être français ne faisait pas partie de mon identité, sinon pour les flics et la sécu.
Voyageant, en trimardeur ou en touriste, en Espagne, Italie, Danemark, Allemagne, Suisse, Angleterre, j’avais, comme tous les vacanciers du monde, mon pays dans mon sac et voyageais en parallèle et en boucle, certain que le point de départ, à moins d’un accident mortel, serait aussi le point de retour.
Voyager ainsi, c’est voyager pour voir et entendre seulement. Goûter un brin de culture comme on goûte un amuse-gueule exotique, avant d’en revenir à la saveur bien de chez nous du plat principal.
C’est bien aussi, mais ce n’est pas ce voyage que j’entamai en mai 2005. J’allais passer des frontières qui, peut-être, se refermeraient derrière moi, enjamber des ponts qui, peut-être, seraient coupés une fois la rivière franchie.
Je partais en exil.
Et le mot renferme dans ses gênes une connotation fortement punitive. On pense d’abord à une expulsion et à une interdiction brutale, présente dans la racine latine exsilire, «sauter hors de». Plus tard, vers la fin du XVIIe, le terme prendra un sens plus figuré englobant l’obligation de vivre loin de personnes ou de lieux en même temps que le regret de ces personnes ou de ces lieux.
Il se sensibilisera en quelque sorte.
C’est pourquoi j’avais nommé d’un oxymore, Exil volontaire, mon premier blog, ouvert de septembre 2005 à juillet 2007. Car je ne suis pas exilé. Je me suis exilé. Non pas pour me punir, mais, au contraire, pour tenter de changer à mon avantage un mode de vie.
L’écriture et un blog furent les premiers sémaphores lancés par l’éloignement parce que le premier effet de la solitude s’est exprimé par l’inutilité soudaine de la langue du berceau, c’est-à-dire du vecteur principal qui, socialement, relie l’homme à ses conditions d’existence.
Or, l’exilé ressent d’abord qu’il est privé de la parole, donc de monde directement intelligible. Dans la rue où la signalisation, les enseignes, la publicité, la voix des passants, usent d’un autre code que celui qu’il possède et qui lui semblait être universel, l’expatrié prend de plein fouet la force matérielle de sa solitude.
Le schisme s’opère par la langue. Parce que le signifiant étant inaccessible à l’intelligence, le signifié perd soudain tout son sens, devient lui-même inaccessible et n’a plus pour être nommé et compris que la parole in petto et l’écriture.
Dans ce monde sans l'oralité, la maladie a surgi qui m'a privé de la parole audible.
Mais je vivais depuis plus de dix ans déjà dans un murmure.
Celui de la parole exilée.
10:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.01.2018
Pomme
 Je connais par ici un village qui porte fièrement le nom de Jabłoń, Le pommier. On le traverse en descendant sur Lublin et de lourdes forêts jalonnent la route de leurs ombres silencieuses.
Je connais par ici un village qui porte fièrement le nom de Jabłoń, Le pommier. On le traverse en descendant sur Lublin et de lourdes forêts jalonnent la route de leurs ombres silencieuses.
A n’en pas douter, il y avait là des pommiers. Beaucoup de pommiers. Mais il est vrai que ce coin de la Podlachie est couvert de vergers aux branches et fruits retombants tel, en dépit des rudes frimas, le jardin des Hespérides.
Un peu plus loin, le monastère orthodoxe dont les toits dorés brillent de tous leurs feux sous le soleil gelé, est blotti sur la berge de la rivière frontalière, à la sortie, de ce côté-ci sans issue, du village de Jabłeczna.
On ne dit d'ailleurs pas que l’on va au monastère, mais à Jabłeczna.
Le mot a de la racine de pommier. Mais d’où sort cette racine ?
Certes, dans les jardins où butinent des colonies de ruchers, s’alignent bien des pommiers que les bras printaniers des ermites taillent avec grand soin, en espalier. Le champ lexical du site est bien respecté mais nous ne saurons pas pour autant d’où vient cette senteur de pommes qui embaume les mots.
Toujours est-il que le pommier slave est parfaitement lisible et que nul ne conteste que c’est lui, à Jabłoń comme à Jabłeczna, qui préside aux mémoires des lieux.
La lecture est plus ardue du côté de l’Atlantique et tout le monde n’est pas favorable à lui accorder l’insigne honneur de désigner des hameaux et des villages. La pomme de discorde réside dans Availles, dérivé du gaulois aballo, la pomme précisément, auquel serait venu s’ajouter le suffixe –ia qui indiquerait le territoire.
Les vents de l’ouest aux quatre horizons ont cependant dispersé le pollen. Availles a essaimé un peu partout dans les campagnes. Availles Limouzine, dans la vallée de la Vienne et dans ces tout premiers plissements du Massif Central que constitue le Limousin, Availles en Châtellerault plus au nord, Availles Thouarsais sur la plaine du même nom, Availles sur Chizé, à l’ombre de la forêt et enfin, plus loin en Ille et Vilaine, Availles sur Seiche.
Tous ces beaux pays furent des pommeraies et le cidre gaulois devait y couler à flots. On devait y percer force barriques en braillant des chants en l’honneur des divinités et les automnes devaient y humer ces arômes sucrés, tellement caractéristiques de la pomme bien mûre, jaune ou rouge, et suspendue à sa branche.
11:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
26.12.2017
Revanche

Tout n’est pas perdu cependant ! Car hier le susdit réel a pris sa revanche sur le virtuel ambiant.
J’aime faire de longues balades solitaires à travers la campagne, la forêt toute proche, les prairies, les chemins de sable.
Et si je m’y adonne à certaines rêveries, c‘est sans doute la faute à Rousseau.
Ce faisant, j’ai donc des parcours jolis, habituels, mais hier, j’ai voulu innover.
Il faisait gris, humide et venteux. J’ai pris par la forêt. Un sentier que je connais bien et qui, après trois kilomètres débouche dans un village du nom de Rowiny.
Sur ma gauche, une allée moussue, sombre, semblait me tendre les bras… Je ne m’y étais jamais aventuré, j’ai bifurqué par là, sous les grands pins que le vent chahutait.
Je pensais sortir bientôt dans les prairies et revenir ainsi vers ma maison.
Je marchais, distrait par les « labourages » pratiqués ça et là par des bandes de sangliers ; puis par les empreintes des chevreuils inscrites sur le sable humide… Je me suis surpris à chercher celles, énormes, profondes et beaucoup plus rares, d‘un élan.
Sans succès...
Je marchais donc sans jamais parvenir à l’orée de la forêt, m’enfonçant plutôt dans les sous-bois et n’apercevant plus bientôt, au travers des sombres troncs, la clarté des lisières.
Légèrement inquiet, je décidai de rebrousser chemin.
Mais tous les chemins se ressemblent dans une forêt exclusivement plantée de pins ! Et plus j’allais maintenant sur le retour et plus je pénétrais dans l’inconnu, ne reconnaissant rien de ce que j’aurais pu apercevoir tout à l’heure.
L’angoisse commençait à monter, qui refusait encore de dire son nom.
Enfin, une lisière ! Je m'y précipitai, mais c’était là une lisière inconnue, avec une clairière inconnue, une petite prairie solitaire. Rien que je n’eusse déjà vu.
Je regagnai le couvert des pins, courant presque. Je ressortis un peu plus loin, revins sur mes pas… Au galop maintenant.
Je ne savais plus du tout où j’étais, ni, surtout, comment j’étais venu jusque là… Les allées de plus en plus noires, de plus en plus moussues, de plus en plus semblables, tordues, presque ricanantes, fuyaient telles celles d’un labyrinthe. Voire d'un piège.
J’étais perdu.
Alors, je levai les yeux vers les cimes et je les vis se balancer tout là-haut sur le gris tourmenté du ciel.
Le vent ! Le vent, mon ami de toujours ! J’étais parti face à lui, le bravant, et les yeux m’en pleuraient… Il fallait donc pour rebrousser chemin vers ma maison que je lui tourne résolument le dos.
Ce que je fis et je traversai une autre clairière, pataugeai dans une tourbière, parmi des ajoncs gelés gisant au sol, arpentai un champ boueux, arrivai sur un chemin que je suivis avant d’apercevoir, au loin, les maisons du village.
Je soupirai et remerciai le vent. Un vent de l’Ouest. Un vent de chez moi. M’avait-il reconnu qu’il me tendit ainsi ses ailes secourables ?
Je me sentis soudain fier d’être resté dans l’âme l’enfant des champs et des bois que j’étais jadis.
Et c’est alors que je sentis soudain dans ma poche le smartphone que j’emmène toujours avec moi, pour avoir la distance parcourue, inscrite par endomondo.
Punaise, je l’avais oublié, celui-là ! Et ça marche avec le GPS, cette application ! Et un GPS, que je sache, ça sert d‘abord à ne pas se perdre !
Je ris, soulagé !
Allons, je n’étais pas encore complètement englouti par la connerie contemporaine.
Atteint, certes, mais un gars qui a le réflexe de regarder le vent plutôt que son GPS, n'est pas complètement irrécupérable.
10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.12.2017
Un conte de noël inédit...

Bref… Le vent soufflait. Ben oui, un vent qui ne souffle pas, que peut-il bien faire d’autre ? Quand un vent ne souffle pas, c’est qu’il n’y a pas de vent et personne n’en parle.
Zut alors ! La peste soit des redondances qui n’en paraissent plus !
Le vent cinglait le visage de l’homme qui allait par des chemins et des bois qu’engloutissait la neige épaisse. Voilà qui est nettement mieux. Le vent cinglait. Pas courant, ça, hein, un vent qui cingle un visage ?
Le susdit visage en était tout violacé et une épaisse sécrétion, jaunâtre, peu ragoûtante, pendait du nez, assez aquilin au demeurant.
Ça, ça s’appelle du réalisme - voire de la coquetterie littéraire - pour dire que l’homme qui allait lentement par les chemins et les bois était tout simplement enrhumé.
Parfois, il trébuchait, cet homme, car il n’était pas très en forme mais en haillons. (Sorte de zeugma à peine réussi.)
Fatigué et pauvre, donc, ce qui, dans un conte de noël comme partout ailleurs, va souvent de pair. Les riches, z'eux, sont rarement fatigués. Quand ils baillent, c’est souvent après avoir trop bouffé et qu’ils ont du mal à digérer, parce que, riches ou pas, ils ont un estomac humain qui n’en peut mais.
Je m’éloigne un peu, oui, j’ai vu…
La neige tombait drue. Le pauvre homme fatigué et enrhumé rejoignait sa chaumière, située à la lisière de la forêt. Il s'en revenait de l’épicerie du village voisin où il avait tenté de négocier un crédit pour s’acheter un hareng saur pour son réveillon et le crédit lui avait été refusé parce qu’il avait déjà une ardoise… La tuile, quoi !
Intéressant, non ?
Mais l’homme tout à coup crut entendre au-dessus de lui comme un doux froufrou printanier, comme un bruit d’ailes soyeuses à travers les branchages gelés et il leva les yeux pour voir. Ce faisant, il buta malencontreusement sur une pierre enneigée, et, badaboum ! il chut de tout son long et de tout son poids au milieu du sentier, la tête dans la poudreuse.
Le nez enrhumé prit un sale coup, du coup…
Alors, le bruit d’ailes soyeuses se fit plus perceptible encore, plus proche et une main pas très douce; velue même, se posa sur l'épaule de l’homme à terre, lequel tenta de voir qui venait ainsi à son secours mais ne put relever sa tête. Il ronchonna et, la bouche pleine de neige, demanda :
- Qui es-tu, Toi ?
- N’aie plus peur, pauvre homme… Je viens t’aider, répondit une grosse voix rocailleuse, discordante, à peine aimable pour tout vous dire.
- Mais qui es-tu, nom de dieu d’bon dieu d'merde ?!
- Doux langage à mon oreille ! Je suis l’Ange des chus.
10:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.12.2017
Matinale réification

Il est cinq heures à peine.
Je ne la vois pas, la nuit, les rideaux sont tirés.
Il y a des fleurs bleues sur ces rideaux.
Les grands poêles rallumés ronflent et les borborygmes du café gazouillent en cascades dans la cafetière.
Je suis au chaud dans mon réel, fait de tout cela, mais aussi d’angoisses, de peurs, d’incertitudes, d‘espoirs de lumière, de printemps et de bonheurs encore.
Et l’idée me prend, comme chaque matin, de consulter la météo de la journée sur mon téléphone.
En attendant que le café achève d’embaumer la pièce.
Cette idée fait partie de mes aurores. Elle participe de mon réel, sauf que là, ce matin, cette bourrique d'application météo, programmée sur le village voisin, Huszcza, autant dire dans ma cour, refuse de me renseigner.
Je tapote, je referme, je refais, je secoue, je m’énerve… Rien à faire. De guerre lasse, je finis par balancer l’ingrat smartphone un peu plus loin sur la table et, ce faisant, je réalise soudain qu’en soulevant un coin de rideau, je verrai mon vieux thermomètre, accroché au dehors.
Je saurai plus vitement le temps qu’il fait.
Effectivement : moins cinq ce matin.
L’application prend alors tout son sens, celui de toutes les applications du monde, qui est de réifier le monde par simple effet de substitution.
Et nous en sommes tous là, quel que soit le sujet de notre interrogation... Nous n'interrogeons plus la réalité, mais son reflet dans un objet marchand.
J’en ris, parce que là, c’est vraiment trop con ! C’est enfantin, même, et je pense à cette histoire de l’institutrice qui demandait à sa jeune classe si quelqu’un avait déjà vu un chevreuil galoper en vrai dans la forêt…
Un garçonnet enthousiaste avait alors levé très haut la main :
- Moi, madame, moi madame…
- Ah, bien ! Et où ça, Victor ?
- A la télé, madame…
Je suis donc ce Victor.
Mais j’ai passé, depuis longtemps déjà - depuis longtemps hélas -, l’âge de lever la main pour répondre à la question d’une institutrice.
Tout le drame est là.
13:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
15.12.2017
La littérature n'a pas horreur du vide
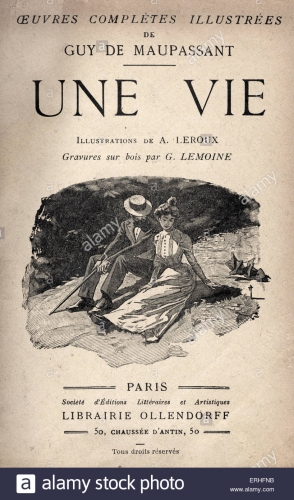 « Au trot inégal des deux bêtes, la calèche longeait les cours des fermes, faisait fuir à grands pas des poules noires effrayées qui plongeaient et disparaissaient dans les haies, était parfois suivie d’un chien-loup hurlant, qui regagnait ensuite sa maison, le poil hérissé, en se retournant encore pour aboyer vers la voiture…Un gars à sabots crottés, à longues jambes nonchalantes, qui allait, les mains au fond des poches, la blouse bleue gonflée par le vent dans le dos, se rangeait pour laisser passer l’équipage, et retirait gauchement sa casquette, laissant voir ses cheveux plats collés au crâne. »
« Au trot inégal des deux bêtes, la calèche longeait les cours des fermes, faisait fuir à grands pas des poules noires effrayées qui plongeaient et disparaissaient dans les haies, était parfois suivie d’un chien-loup hurlant, qui regagnait ensuite sa maison, le poil hérissé, en se retournant encore pour aboyer vers la voiture…Un gars à sabots crottés, à longues jambes nonchalantes, qui allait, les mains au fond des poches, la blouse bleue gonflée par le vent dans le dos, se rangeait pour laisser passer l’équipage, et retirait gauchement sa casquette, laissant voir ses cheveux plats collés au crâne. »
Ça arrive souvent comme ça : on est debout devant la bibliothèque, on prend un livre au hasard, on le feuillette par désœuvrement, on s’arrête sur un passage, on se souvient du tout, on s’assied alors, on revient à la première page et on lit pendant des heures.
On relit ce qu’on sait déjà mais avec l’œil d’un nouveau lecteur.
De ce livre publié en 1883, mais dont la rédaction commença six ans plus tôt, Flaubert se montra enthousiaste dès les premiers mots que lui en toucha son auteur. Il y avait en effet là matière à réaliser pleinement sa propre conception du roman : écrire sur rien.
Une vie, c’est le livre de la vacuité de tout, jalonnée d’événements qui ne débouchent sur rien. Servi par une écriture impeccable, il montre bien que tous les successeurs littéraires de Maupassant et de Flaubert n’ont rien inventé, sinon en reprenant à leur compte les exigences déjà formulées par les deux écrivains. « L'intrigue passe au second plan… »
Le Nouveau roman croyait avoir découvert les clefs de la révolution du genre ou du moins tentait de le faire croire.
Les post-Nouveau roman iront encore plus loin dans la niaiserie à bout de souffle : le roman est mort !
Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'après Thamus et le Grand Pan, Nietzsche et Dieu, les surréalistes et l'art, les situationnistes et le vieux monde, je me méfiais comme de la peste de tous ceux qui célèbrent les obsèques d'un mort sans en avoir vu le cadavre.
Dans Une vie, il ne se passe rien. Du moins ce qui s’y passe est tout à fait subsidiaire et ne fournit pas l’étoffe à une intrigue romanesque, stricto sensu. Tout y est néant surgi du néant et se dirigeant vers.
Et pour dire ce rien, point n'était nécessaire, comme le crurent bon les prétentieux d’une époque courant de la moitié du XXème siècle jusqu’à nos jours, de déstructurer le langage, de ne pas s’attarder sur les paysages ou de ne nommer ses personnages que par des initiales, en imitant pauvrement Kafka.
Toutes ces révolutions de chambrette en littérature n’ont, in fine, porter, et ne portent encore, que sur des formes, avec des phrases aussi tortueuses que les esprits, par impuissance à produire un nouveau contenu. Un nouveau sens.
Dans le rien tellement moderne de Maupassant, il y a l’odeur de la Normandie, la farouche étreinte de la Manche sur les terres, les vapeurs des brouillards, les gels de décembre, les semences et la sensualité des printemps, l’éclat d’un feu de bois, les côtes affaiblies d'un vieux chien de ferme. Dans ce décor rendu palpable par la magie d’une plume au zénith, le reste n’est que drame antique de la vacance universelle des êtres et des choses.
Par rapport aux Soirées de Médan, recueil collectif qu'écrasa devant la postérité la supériorité de "Boule de Suif," Maupassant avait déjà fait une révolution, sur les pas de l’art Flaubertien.
Que de temps perdu alors dans l'appauvrissement, pendant plus d’un siècle et jusqu’à l’heure qu’il est, à vouloir rénover la couverture du roman ou en essayant désespérément d'en creuser la tombe !
Que de poudre lancée aux yeux, aussi, à vouloir faire de la modernité avec du rien, avec ce qui avait déjà été énoncé en tant que rien et que des classiques comme Maupassant, plus modernes que tous ceux qui leur succéderont, avaient mis au jour sans l’écran de fumée des théories toujours pompeuses de la rénovation de l'art.
12:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.12.2017
La conjuration du sablier
 La plaine qui n’ondulait jamais était humide et la forêt, tout au bout, mettait brutalement fin à son destin de plaine.
La plaine qui n’ondulait jamais était humide et la forêt, tout au bout, mettait brutalement fin à son destin de plaine.
Elle dessinait un mur de pins sombres où bataillait du vent, et c’était vers ce mur que je marchais, cependant que le soleil tout pâle glissait sur des plaques de neige éparse. Derrière moi, il n’y avait rien. Que du souffle invisible sur le silence de mon histoire.
J’ai levé les yeux au ciel. Parce que j’y cherchais un oiseau, un voyage qui pût me rassurer sur le mien, me chuchoter : tu n’es pas si seul dans la désespérance, pas si perdu dans tes errances, regarde la blessure fatiguée de mes ailes, regarde l’immensité des nuages à l’assaut desquels me porte cette blessure, regarde le sang injecté dans mon œil par les vents assassins, vois l’impossibilité de mes chimères ataviques et vois la mort au bout sans qu’aucun vide, nulle part, ne s’inscrive sur la face du monde.
Mort anonyme.
Sépulture introuvable.
Néant dérisoire.
Mais le ciel était muet. Pas même un nuage en forme d‘allégorie, de ces nuages qu’on lit, comme des monstres ou comme des jouets, quand on a refermé tous ses livres.
Je marchais vers la forêt parce que j’y avais cru voir la silhouette chancelante d’un homme. On ne voit pas beaucoup d’hommes par ici. On ne voit que la plaine et sa toile de fond, le rideau des sombres pins.
Que viendraient faire ici les hommes ? Depuis longtemps mon pacte avec eux avait été rompu. A tel point que même là, sous le vent, sur la neige éparse et sous le ciel immaculé, la forêt semblait reculer devant moi, comme si elle refusait que je la rejoigne, comme si sous mes pas s’allongeait la plaine et comme si l’intrus échoué là bas, à la lisière, s’obstinait à repousser l’échéance d’une rencontre.
C’est alors que j’ai vu l’oiseau. Non. J’ai d’abord vu son ombre qui se déployait sur le sol. Après seulement, j’ai reconnu un corbeau. Un vrai corbeau. Pas une de ces corneilles ou autres freux qui habitaient là-bas, autrefois, sur les marais et les labours paisibles où couraient des brises océanes. Un grand corbeau. Un lointain consanguin des nettoyeurs d’Austerlitz.
Tellement noir qu’il m’en a semblé bleu.
Il a plongé sur la lisière et je me suis arrêté tout net. C’était un signe. Je devais m’arrêter là. Il y avait de la mort blottie sous l’envergure puissante de ses ailes.
La forêt est venue jusqu’à moi. Un nuage est passé et le soleil s’est tu, vaincu par la pénombre.
L’oiseau picorait avec force délectation les yeux de l’homme sur le sol étendu. Le mort n’était pas mort et se prêtait au jeu. Il embrassait le bec et caressait la plume à chaque lambeau de chair arraché à sa vie.
Quelqu’un a frappé. J’ai cru. C’était le vent qui secouait violemment les volets.
En sursaut, j’ai regardé par la fenêtre. La lune dormait encore entre deux branches livides.
Je me suis levé. J’ai allumé la dernière cigarette de mon histoire et je me suis mis à écrire.
Je n’ai depuis lors jamais cessé de tenter de remonter le temps.
Pour faire reculer la forêt.
14:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
07.12.2017
Le Cul
 Au sud du département des Deux-Sèvres se déroule la forêt de Chizé, peuplée de hêtres et de charmes. Puis, après un intervalle fait de petites plaines légèrement ondulantes, commence celle d’Aulnay, plus sombre, plutôt en chênes celle-ci et déjà sur le département de la Charente- Maritime.
Au sud du département des Deux-Sèvres se déroule la forêt de Chizé, peuplée de hêtres et de charmes. Puis, après un intervalle fait de petites plaines légèrement ondulantes, commence celle d’Aulnay, plus sombre, plutôt en chênes celle-ci et déjà sur le département de la Charente- Maritime.
Abandonnés en pâture aux paysages, ce sont là deux lambeaux déchiquetés de ce que fut jadis, très loin jadis, la grande sylve d‘Argenson, courant du pays angoumois jusqu’aux portes de la Rochelle…
Entre ces deux beaux massifs s’éparpillent bien évidemment de petits villages, dont un érigé sur une proéminence.
Le pâle horizon du ciel s’y élargit très loin, plus loin que Melle, mais à part ça, on n’en dirait strictement rien, de ce modeste hameau, on passerait même au pied de sa colline sans le voir, s’il n’était tout simplement remarquable d’homonymie.
On ne peut guère en effet, même en filant très vite, faire fi de ce nom exposé comme une galéjade, Le Cul.
Je vais au Cul, ai-je entendu dire un de ses habitants qui, ébéniste de son état et renversant le mot cul par-dessus tête, se faisait lui-même appeler Luc. Je suppose que les métaphores, les métonymies et autres syllepses ont alimenté et alimentent encore les allusions plaisamment égrillardes.
Il y a le feu au Cul ! Il y a le feu au Cul ! Impossible, si l’on veut rester décent et être pris au sérieux quand Le Cul brûle, de faire de ce l une lettre muette. D’autant qu’à quelques kilomètres de là – je n’invente rien - un autre hameau se fait gentiment appeler, en référence au dieu soleil peut-être, Ré.
Ré lès cul. Ré près du cul. Il y a là matière à nourrir toute sorte d’imaginaires grivois.
Pourtant Le Cul, nous explique un habitant, ne se prêterait guère à ses rapprochements intempestifs de bas étage, puisque c’est justement de sa hauteur qu’il tiendrait son nom.
La colline sur laquelle il a planté ses quelques maisons à tout vent est en effet le point le plus élevé de la contrée. Le Cul, le point culminant. De quoi faire taire tous les commentaires irrévérencieux même si, tenant à tout prix à se faire l’avocat d’une lecture croustillante, on est en droit de se demander pourquoi le mot aurait été coupé justement là, en son beau milieu de culmen, désignant le sommet.
Personne ne nous le dira... Alors nous accepterons la savante interprétation toponymique mais, pour pouffer sans vexer l’autochtone, nous nous retournerons et ferons mine d'admirer la lointaine ligne d’horizon, moutonnée de blancs nuages
Car nous sommes, il va sans dire, des visiteurs bien élevés.
12:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.12.2017
Le chien
 Comme je rentrais à la maison, il est soudain apparu dans le faisceau lumineux des phares et je l’ai tout de suite trouvé sympathique, superbe même, avec ses longues oreilles jaune et noir qui tressautaient au rythme de son petit trot.
Comme je rentrais à la maison, il est soudain apparu dans le faisceau lumineux des phares et je l’ai tout de suite trouvé sympathique, superbe même, avec ses longues oreilles jaune et noir qui tressautaient au rythme de son petit trot.
Ses yeux aussi avaient quelque chose de bon enfant et de bienveillant...
Il semblait nous attendre.
L’ordure qui l’avait abandonné, le jetant telle une poubelle du coffre de sa voiture, avait dû le faire là, devant mon portail. Alors sans doute s’était-il imaginé que c’était ici qu’il devait désormais habiter ; peut-être même avait-il monté la garde toute la journée.
Il s’est poussé un peu, il a disparu un moment dans le noir, je suis rentré et je l’ai quasiment oublié.
Comme chaque soir cependant, sombres soirs où la nuit descend du ciel dès quinze heures, je suis allé fermer la porte des gélines.
Stupeur ! Sur quatre, il n’en restait plus qu’une !
J’ai accusé le renard de la forêt toute proche et j’ai accusé l’autour des palombes.
Mais tout de même, trois d’un coup ! Un renard vraiment habile et féroce ou un autour grand virtuose de l’attaque en piqué, alors !
Le chien, nom de dieu ! Le vagabond !
Un amas de plumes blanches découvert le lendemain dans les halliers, le témoignage effarouché de deux voisins chez lesquels il avait d’abord tenté d’assouvir sa faim, m’en ont persuadé.
Un tueur…
Il est depuis invisible.
Le jour, il doit être tapi au chaud dans la paille de quelque grange, mais dès que tombe le crépuscule, il arpente le village, il renifle la nuit. Après son crime, il se sait désormais paria et il a appris à fuir les humains.
Alors, pour courir sa pitance, il attend qu’ils se soient retirés. Nous l’avons même entendu poursuivre un animal dans les ténèbres, de l’autre côté de la clôture.
Un chasseur… que j’avais tout de suite trouvé sympathique, superbe même, avec ses longues oreilles jaune et noir qui tressautaient au rythme de son petit trot.
Reste que mon poulailler est vide, qu'il le restera jusqu'au printemps et que tout mon courroux va au salaud qui l’a jeté ici, mon bouffeur de poules.
Un bouffeur de poules assez indélicat, du reste : je n’en avais que quatre, les voisins en ont une trentaine chacun. Au moins.
Peut-être l’animal a-t-il considéré qu’avec une basse-cour pareille, le propriétaire des lieux devait simplement s’amuser à avoir des poules et que le crime serait dès lors moins préjudiciable que chez les gens sérieux.
De toute façon, la faim justifie les moyens et, là comme ailleurs, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs.
11:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.11.2017
Pour se souvenir

Alors, nous autres, on a toujours préféré les mots. Du moins ceux qui, même lus en silence, parlent haut. «Les incorrigibles mots», que je les appelle. Parce qu’on ne peut, une fois qu’ils sont lancés, leur faire baisser pavillon, comme disait ma mère d’un quidam qu’on ne pouvait pas ramener à la raison. Enfin... A sa raison à elle, plus exactement.
Les ombres et la lumière de la mémoire jouent en trompe-l’œil sur les mots.
Et il me fait toujours un peu tiquer ce mot trompe-l’œil. On y sent comme une sorte de fourberie, une infidélité à ce qui est. Mais bon sang est-ce que tout, et fort heureusement, n’est pas en trompe-l’œil, justement ?
Et qu’en serait-il de l’œil d’un poète s’il n’acceptait d’être trompé en permanence dans sa vision du monde, s’il se faisait moraliste et n’acceptait de voir que du réel ?
Par-delà le réel, est le véritable réel. Sauf pour les obtus et les matérialistes, qui sont souvent les mêmes.
Le trompe-l’œil est l’ami du poète. Sa bouée de sauvetage.
Je vis, vous le savez, sur une terre qui ne m’a pas vu grandir. Qui ignore le jeune plant que je fus. Je m’y suis transplanté. J’essaie d’y prendre racine. Si on n’essaie pas de prendre racine, on meurt. On erre et on habite à l’envers et tout s’étiole de notre feuillage. Même les gens qui n’ont jamais bougé de leur coin savent ça.
Alors quand je dis aux autochtones, mes voisins paysans, qu’il est bien beau notre village sous sa neige qui le réduit au silence et l’aplatit face contre terre, ils ne le voient pas de cet œil.
Un œil qui refuse de se laisser tromper. Un œil sûr de sa rétine. Un œil adulte.
Ils frémissent du sourcil – qu’ils ont d’ordinaire fort velu -, haussent les épaules, penchent la tête de côté et reniflent. Exactement comme les maraîchins dubitatifs et goguenards de chez moi, quand je leur disais que le marais à bian* était magnifique, comme le fantôme de l’Océan resurgi des labours et des prairies.
Car la neige, pour mon paysan d’ici, c’est beau, d’accord, mais pour Wigilia** et Boże Narodzenie. **
De cet élément qui les accable, ils ont fait une légende enveloppée d’immaculé.
La légende une fois estompée, Dieu étant né, dûment adoré et cadré dans son destin de Dieu, ils parlent de la neige en białe gówno. La merde blanche.
Ils laissent tomber le trompe-l’œil auquel, un court instant seulement, ils s’étaient abandonnés.
* Inondé
** La Veille (jour du réveillon)
*** Noël
14:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
13.11.2017
Facéties des langues
 Nous sommes des êtres bien sérieux avec la langue : grammaire, étymologie, histoire des tournures, écriture stylisée, figures de style chères aux métalinguistes, etc.
Nous sommes des êtres bien sérieux avec la langue : grammaire, étymologie, histoire des tournures, écriture stylisée, figures de style chères aux métalinguistes, etc.
Comme en toponymie, j'aime cependant me permettre de temps à autres des rapprochements intempestifs et pratiquer des entorses fantaisistes. Faire parler le réel par-delà "l'établi", le ramener à moi seul, à ma propre histoire, au détriment de la vérité pure.
Jouer avec le hasard et la tonalité des mots.
Ainsi en va t-il pour le haricot. Le légume. Pas le vert, mais le blanc, le flageolet, Rognon d'Oise ou autres Pont l'Abbé. Bref, la mojette, celle que Rabelais, par la voix de Panurge, accuse de rendre le carême encore plus déplaisant.
C'était le plat avec un grand P - si j'ose - de mes étés d'adolescent passés dans les fermes aux divers travaux des champs, pour quelques francs à boire sans retenue au bal du samedi soir suivant.
Quand il n'y avait pas de mojettes au menu, il y avait des pommes de terre. Et vice-versa.
Ça limitait considérablement les horizons de l'apprentissage des papilles.
Par un doux euphémisme allégorique, le paysan nommait, en ricanant comme un benêt, le précieux légume "les musiciens", en évocation des flatulences qu'il provoque, frappées là-bas comme partout ailleurs d'un fort tabou social.
- Tu reprends des musiciens, gamin ?
Or il se trouve qu'en Polonais, le facétieux féculent se dit fasola.
Carrément une demi-gamme.
Comme quoi les mots, s'ils restent de la conscience parlée, sont parfois, avec un peu d'imagination, du pur et plaisant hasard.
14:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.11.2017
Kościeniewicze
 Dans la lecture des lieux, lecture de promeneur, s’arrêter c’est aller beaucoup plus loin que si on filait son chemin.
Dans la lecture des lieux, lecture de promeneur, s’arrêter c’est aller beaucoup plus loin que si on filait son chemin.
La conversation s’engage alors dans toutes les langues et partout.
Traversant les pays, nous traverserons leur histoire et leurs histoires. A l’autre bout de l’Europe, à l’est de la Pologne, des villages aux maisons de bois sont tapis sous les neiges. Champ de batailles de l’Europe en délire, porte des vastes Russies, région meurtrie par les guerres et la botte de bourreaux successifs, qu’ils fussent Autrichiens, Prussiens, Russes ou, en remontant plus loin jusqu’au milieu du XVIIe, Suédois.
L’entrée des villages silencieux est d’abord signifiée par la silhouette grise d’un hameau surplombé d’un clocher. Puis, sur fond vert, vient le nom aux consonances difficiles.
La plaine est endormie et les rues sont vides. Des arbres austères jalonnent le chemin qui va le long des maisonnettes. Nous sommes le onze novembre et nous lisons : Kościeniewicze.
Un long nom qu’il faut disséquer si l’on veut pénétrer les drames de la mémoire. Kości, les os, nie, non, wie, sait, cze (czyje), à qui.
Les os on ne sait de qui…
Et à la sortie du village, voie sans issue, là où le vent s’engouffre sur la plaine à l’horizon fermé par les bois de pins, un tertre abandonné des hommes est enseveli sous l’herbe galopante de l’été comme sous les neiges de l’hiver.
Une croix en pierre, grossière, démolie, chancelante, y indique une sépulture.
C’est que les champs qui se déroulent alentour ont été le théâtre d’un effroyable massacre. Jonchés de débris humains à l’heure de poser les fusils pour tâcher de reprendre la charrue. On ne peut y promener son regard sans voir ces os décharnés, éparpillés sur la terre.
A qui tous ces os ? Russes ? Ukrainiens ? Polonais ? Autrichiens ? Prussiens ?
A tous, mêlés dans l’horreur absurde des cataclysmes. Regroupés ici, jetés pêle-mêle sous ce tertre qu’aucune mémoire ne vient plus saluer, les squelettes des soldats inconnus, squelettes sans cause et sans drapeau, sont là.
Je vais à les os on ne sait de qui…. J’habite à les os on ne sait de qui... Je suis né à Les os on ne sait de qui..
Tant que ce nom s’inscrira sur une carte, tant que des gens seront obligés de le prononcer pour se situer, ces jeunes hommes massacrés, humiliés par l’anonymat, apatrides volatilisés dans l’horreur d’un charnier, ne nous quitteront pas totalement. Nous saurons que nous ne savons pas à qui sont les os.
Mais, au moins, nous saurons qu’ils sont et où ils sont.
Nous sommes bien dans l’oxymore d’une éternité temporelle. Le moment des faits et celui où nous en prenons connaissance en lisant un nom qui force notre investigation, s’effleurent, se juxtaposent, se confondent et en même temps, c’est ce que nous appelons la mémoire, ils sont dissociés par le temps qui s’est écoulé entre eux.
Nous ne nous souvenons que du passé. C’est une erreur de parallaxe. Nous avons bougé, mais pas l’objet de notre pensée. Car on ne peut se souvenir qu’au présent et ce n’est pas cet objet de la mémoire lui-même qui est attrayant, pathétique et humain mais l’activité de cette mémoire dans sa réalité, dans son actualité. Sans quoi il n’y aurait ni douleur, ni plaisir à évoquer et le mot nostalgie, nostos le retour et algos la souffrance, n’existerait pas.
C’est pourquoi en poésie toponymique, un fait avéré a le droit d’engendrer moult interprétations, c’est dire moult sensibilités au présent composé.
Tout comme telle vision du monde donne naissance à tel poème.
11:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.11.2017
L'île aux parfums ?
 On n’est jamais de passage quand on remonte le temps et il ne s’agit pas d’aller plus vite que la lumière, mais aussi vite que les mots.
On n’est jamais de passage quand on remonte le temps et il ne s’agit pas d’aller plus vite que la lumière, mais aussi vite que les mots.
Là-bas, par exemple, quand la mer fouette d’écume les rochers mugissant et qu’il fait froid sous le ciel gris. Le vent du nord prend l’île en enfilade, par le bout, l’enfourche, la chevauche, la traverse et les bois noueux des chênes verts se courbent sous la puissante haleine des embruns.
Oléron, plate bande de terre jetée sur la nappe océane et qu’on dit, qu’on murmure plutôt, sujette aux instabilités des plaques, en dessous. Car parfois Oléron se trémousse et les vieux placards dans les fermes sont pris de craquements sournois.
C’est toujours la nuit.
Les buffets ouvrent leurs portes disjointes, l’habitant se tapit sous sa couette, la remonte plus haut sur son nez et il entend bien, là-bas sur la plage, les cabanes des ostréiculteurs, bariolées comme les roulottes des bohémiens, qui frémissent tout à coup et qui ont peur et qui se plaignent.
Un jour, une nuit plutôt, elle sombrera dans des gouffres aux profondeurs abyssales, effrayantes de ténèbres, en enfer, Oléron.
Chassiron veille pourtant sur un océan tout vide. Aucun mât sur l’horizon creusé par la houle. Aucune âme à venir sauver que les tempêtes auraient fourvoyée jusqu’aux rochers. Alors Chassiron promène son œil morne sur la désolation solitaire de la houle.
Derrière lui, dans un dédale de venelles, les fleurs jaunes de février pavoisent en un moutonneux bouquet. Le déalbata fait la fête. Tempête ou pas tempête, c’est la position des étoiles qui donne l’heure et l’heure est venue d’inonder l’île des parfums qui ne craignent ni la mer ni ses souffles salés. L’arbre baigne sa racine dans des dunes de sable et on dirait tant la fleur est dorée que les cristaux de ce sable lumineux sont remontés discrètement jusqu’à la branche.
Mimosa, ça sonne comme une rivière qui coulerait en Espagne et ça gesticule aussi comme un mime. Le mime osa. L’arbre est un histrion qui donne l’illusion, qui fait croire aux douceurs du printemps. Au cœur même de l’hiver.
D’ailleurs, sa feuille en fines dentelles garde sa couleur de velours en toutes saisons.
Ici la poésie est libre, non assujettie à l’assonance. Dans toutes les langues, Oléron rime avec mimosa. Pas avec rond. Jamais. Car l’île est allongée, elle s’étire Nord-ouest, Sud-est, disgracieuse en son milieu avec un gros ventre qu’on dirait rempli de poissons frais. Elle n’est pas ronde sinon on eût pu dire qu’elle avait été baptisée par des païens patoisant. Olé rond, c’est rond. Si olé rond, olé pas carré, dit le paysan charentais quand il veut faire aboutir une évidence qui lui paraît indiscutable ou faire exécuter une décision qu’il juge irrévocable.
Non, ça ne lui colle pas à la côte, ce baptême-là. Il faut chercher plus loin, dans les arômes des parfums généreux. Dans les branches du mimosa. Eussions-nous été des inconditionnels de la versification, que la rime eût été riche, accouplant Oléron et jaune citron.
Mais l’odorat l’a emporté sur la vue. Insula olerum, l’île aux parfums. Oui, le mimosa lui colle mieux à la peau. Olerum. L’île n’est plus qu’une senteur sous les frimas en pluie de février.
C’est un beau nom, une belle histoire de Latins.
D’aucuns en prennent ombrage. Olé pas tcheu, c’est pas ça. L’histoire est trop embaumée et, bourrant sa pipe, le vieux pêcheur, pantalon et veste bleus, hausse les épaules, franchement goguenard.
Je vais vous le dire, moué. C’est que l’Oléronnais a de la graine de voyou dans les veines, alors il enjôle, il parfume. Apocryphe, qu’il est. Car des fortunes ont été ici construites sur le crime. Autfoué. Quand de fiers galions sillonnaient la côte, leurs cales regorgeant de richesses venues d’îles plus lointaines, aux antipodes de la machine ronde.
A Chaucres, au bout de l’île, là où la côte est hérissée de rochers pointus comme des dagues, aiguisés comme des couteaux flamboyants, guettaient les naufrageurs. Des feux s’allumaient dans la nuit tempétueuse qui guidaient des capitaines en perdition et les bateaux venaient s’éventrer là en un fracas pervers, abandonnant aux hordes de pillards leur cargaison de trésors.
L’île au parfum ? Allons, allons ! L’île aux larrons, voilà la vérité. Et voilà comment dans la marine, de capitaines en capitaines, d’armateurs en armateurs, de matelots en matelots, on avait pointé ce coin de l’océan où venaient brutalement s’échouer, sur la foi de signaux assassins, les plus habiles coureurs des mers. L’île aux larrons.
Olé rond, olerum, aux larrons…En tous cas, Oléron veut nous dire des choses.
Le monde que nous traversons, et qui nous traverse, le monde et ses lieux, sont muets si nous ne leur parlons pas.
Nous nous y promenons alors comme en terre étrangère, en juif errant, en orphelin et en âme damnée si nous ne tentons pas de remonter jusqu’à leurs fantômes, qu’ils soient parfums ou larrons. Mais si nous engageons la conversation, si nous tentons de lire le paysage des mots, les géographies, qu’on a tant accusées de n’être qu’au service de la guerre, sont des poésies.
Le livre fourmille de pages. Des pages qui disent ceci ou racontent cela, parfois le contraire de la précédente. On ne sait pas. Les suites d’erreurs font partie de l’histoire qui jamais n’est lue que par un seul oeil. La pâle sagesse des vérités, la froideur des certitudes, n’ont pas droit de cité ici. Nous sommes dans la chaleur du doute et la délectation de l’interprétation, tantôt dans l’imaginaire, tantôt dans l’histoire, tantôt dans la fantaisie, tantôt dans le drame, tantôt dans la liesse, tantôt sur le haut fait, tantôt sur le fait divers.
Dans tous les cas cependant, nous sommes dans la mémoire et en disant le nom de baptême d’un lieu, on en fait un lieu dit. Un lieu qu’on peut dire et pas seulement d’un simple vocable. On le sort des angoisses de l’oubli et du hasard de l’anonymat. On brandit son passé à la barbe du présent. On se fait son biographe, on lui tend la main, on le touche, on secoue son lourd manteau et ses maisons alignées en une longue rue grise deviennent bien autre chose que des maisons alignées en une longue rue grise.
Chez Bonclou et autres toponymes
09:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.11.2017
Des villages et des moines
 Me promenant, randonnant ou même partant vers de plus lointains voyages, je n’aime pas emprunter sur le retour le chemin de l'aller.
Me promenant, randonnant ou même partant vers de plus lointains voyages, je n’aime pas emprunter sur le retour le chemin de l'aller.
La boucle est un périple, l’aller-retour un trajet de chemin de fer.
Même quand je reviens en France, je prends, soit la route du nord par Varsovie, Berlin, Hanovre, Paris, soit celle du sud par Les Sudètes, Prague, Nuremberg, Strasbourg...
Mon imagination de lecteur de villages court ainsi où ont couru mes pas. Des bords de l’Océan à l’autre bout du continent, d’ouest en est. J’ai parcouru des yeux ces villages et ces lieux-dits comme un livre écrit par des toits, des chemins, des nuages et des arbres. Tant et si bien que la lecture dépend pour beaucoup de la position du soleil dans le ciel, quotidienne ou annuelle, de la direction d’où je viens, de ce qui m'a conduit là et du sens que je donne à mon voyage.
Car un lieu nommé vous parlera autrement selon que vous y soyez par hasard, que vous l’ayez préalablement choisi ou que vous vous proposiez ou non d’y séjourner.
Combien de temps importe peu. Seul le touriste, son budget et sa note d’hôtel savent la durée d’une villégiature.
Un voyageur jamais
Et je suis tombé au bout de ma course sur une rivière infranchissable.
Une large rivière qu’on dit comme la dernière en Europe à n’être point apprivoisée, domptée et régulée. Une rivière sauvagement belle avec des remous tels que vingt-sept pays rassemblés sont tombés d’accord pour en faire leur frontière commune.
Sur l’autre berge, si l’on venait à dépasser ces remous intrépides, la Russie blanche exigerait manu militari que l’on montrât aussitôt patte de même couleur.
Grise et bleue, la rivière semble s’ouvrir l'hiver un passage dans l’épaisseur des champs de neige. Son berceau est ukrainien, elle s’écoule vers le Nord et, après une balade de huit cents kilomètres, elle abandonne au nord de Varsovie son nom à la Vistule, qui se charge alors de porter ses eaux, ses poissons et ses rêveries jusqu’à la froide Baltique.
Des moines orthodoxes, leur longue barbe en broussailles et toujours marmonnant, y prélèvent la friture de leurs repas. Ils sont d’habiles pêcheurs. Ils sont aussi d’une hospitalité sans ambages et savent rire, plaisanter et parler de tout.
Je ne trouve pas chez ces moines orthodoxes la sévérité austère dont aiment faire montre les catholiques.
Mais c'est peut-être parce que je suis un étranger et que la religion orthodoxe participe alors d'un exotisme.
Les anachorètes se sont installés dans un méandre retiré de la rivière et quand des montagnes lointaines fondent les neiges en même temps que celles des champs et des bois alentour, alors l’eau à perte de vue encercle et isole encore un peu plus leur mystique phalanstère.
Au loin, vers le nord, l’imposante silhouette d’une basilique toute blanche ferme le ciel. On dirait qu'elle interdit aux prières gréco-latines de pénétrer plus avant dans le continent.
10:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
28.10.2017
On cause de la pomme et de son pommier
 Pan Feuilly vient de croquer mon livre et de s’en faire l’écho ici, sur son blog Marche romane.
Pan Feuilly vient de croquer mon livre et de s’en faire l’écho ici, sur son blog Marche romane.
Qu’il en soit vivement remercié
Depuis dix ans maintenant, lui et moi nous lisons.
Nous nous lisons, devrais-je écrire pour plus de clarté grammaticale, mais ce n’est pas beau à l’oreille silencieuse d’un lecteur… En tout cas pas à la mienne.
Bref, nous sommes des amis.
D‘aucuns penseront alors : oui, d‘accord, mais c’est là de l’entre-soi, du copinage, de la critique de complaisance.
On peut dire comme ça. Mais on devrait surtout dire que, petits auteurs que nous sommes, nous n’avons point l’heur de fricoter avec les grands et les moyens médias, que nous ne connaissons ni Onfray le philosophe vedette, ni Moix le méchant névrosé, ni le nostalgique Zemmour, ni le sympathique Naulleau, ni tout autre personnage chroniqueur portant loin la parole de l’écrit, et que nous sommes dès lors bien contraints de nous auto-publiciter.
Nous ne prétendons cependant pas forcément au talent. Nous disons simplement - et ce n’est pas rien - que l’occasion ne nous est guère donnée de prendre à témoin le grand public pour qu’il juge lui-même si nous sommes de lamentables grimauds ou de vrais écrivains.
Et nous sommes des milliers dans ce cas.
En nous fermant le bec, on gagne alors un temps fou pour promouvoir « les élus du sérail », qu’ils nous arrivent parfois de lire et dont nous pouvons dire alors, pour une bonne part d’entre eux, que nous leur sommes supérieurs à bien des égards…
Ceci étant dit, avec une pointe de dépit quand même mais aussi un soupçon de jubilation, je remercie ici publiquement Loïc Jouaud, qui préside aux destinées des Editions Cédalion.
Je le remercie pour le travail de diffusion qu’il fournit, sillonnant sans relâche les routes pour déposer en librairie, démarcher, faire connaître.
Il me disait ce matin encore : vous êtes dans la plus grande librairie de Tours "La boite à livres" et à Amboise "C'est la faute à Voltaire".
Je sais qu’il y a des tourangeaux parmi les lecteurs de L’Exil des mots. Cette nouvelle leur fera plaisir,du moins l’espèré-je.
Là encore les fâcheux et les fâcheuses, avec leur manie de donner un avis sur tout ce qu’ils ne connaissent pas vraiment, vont dire : Ben ! quoi de plus normal pour un éditeur que de distribuer son livre ?
Juste un mot de réponse : si les petits éditeurs comme Loïc Jouaud avaient les moyens de se payer un distributeur en abandonnant au passage 33 pour cent de leur chiffre, sans doute le feraient-ils.
Dont acte.
13:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.10.2017
Des paysages et des hommes
 L’automne flamboie.
L’automne flamboie.
Le jaune des bouleaux, le vert des pins et le rouge des chênes se disputent la vedette. Une huile au couteau. Une palette épaisse et si rude qu’il faut prendre du recul, sortir un peu de soi pour en goûter tout le langage. Pas comme cette aquarelle subtile de nos rivages où les vapeurs océanes diluent les couleurs et liquéfient la lumière qui ruisselle dans l’espace vide d’entre les choses, mais aussi sur ces choses elles-mêmes et sur nous-mêmes. Les paysages de bords de mer fusionnent le spectateur et le spectacle dans un même flux réfléchissant le monde.
Les paysages continentaux, eux, sont plus extérieurs, modelés par la terre et par une intelligence rustique entre les arbres. Le bouleau est un pionnier. Il arrive le premier au gré d’une saute septentrionale du vent et il dit que c’est là qu’il faut planter une forêt, que le sol est riche et que le sable est assez stable. Le Polonais est un forestier. Il sait lire entre les troncs. Il souscrit aux indications du bouleau et plante là les pins qui feront des maisons, des granges, des fermes et des clôtures.
Les forêts de l’est sont les gisements des bâtisseurs.
Le chêne rouge cependant a observé tout ce manège. C’est un erratique, un apatride, on ne veut pas trop de lui ici, trop lent, beaucoup trop flâneur dans sa croissance. Alors il s’incruste, passager clandestin des essaimages, magistral parasite des sylvicultures, arbre de proie.
Tout ce muet panachage de l’éclaireur du nord, du pin de construction et du bel intrus sans papiers, accompagne de lumière la route où cahote un cheval.
Il est attelé à une sorte de carriole étroite tout en longueur, avec deux essieux, celui de l’avant savamment articulé. Deux sacs de blé dur y bringuebalent. Ils s’y promènent exactement. Derrière la carriole, piaffe le Renault flambant tout neuf d’une société ouverte au soleil couchant, quarante tonnes en route vers la construction des paysages nouveaux, un demandeur d’autoroutes, un qui n’aura que faire de la lecture des bouleaux.
Car les époques ici se côtoient sans s’agresser, ne se poussent pas du coude, se superposent comme les sédiments, se font des signes, sans moquerie, sans marque de supériorité et sans dédain. On sait bien que tout ça, ça va, d’accord, mais que ça peut venir aussi et on a l’air de penser qu’on ne sait pas trop bien qui, du cheval remorquant ses deux sacs de blé ou du Renault tractant ses quarante tonnes, est finalement à contretemps.
Les champs sont immobiles. On dirait que personne ne vient les éventrer et les bousculer dans leur torpeur. Ils sont comme des trapèzes, et c’est pas pratique, un trapèze. Ils sont aussi comme des triangles, ça a des angles aigus difficiles à entretenir, les triangles. A des quadrilatères difformes et sans angles droits, qu’ils ressemblent parfois. Rarement, très rarement, ils sont ces rectangles pragmatiques des grandes cultures de l’ouest et qui, vus d’avion, dessinent si bien la terre en un jardin impeccablement entretenu.
Un jardin à la française.
19:29 Publié dans Acompte d'auteur, Statistiques | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
19.10.2017
Prendre le monde au mot

C’est le premier plaisir du promeneur, trouver son champignon, dans un coin secret déserté des hommes, le chapeau gras et luisant sur un talus moussu et sous un rai humide de fine lumière, comme s’il ne s’était appliqué à pousser là que pour ce chercheur, jusqu’à lui venu.
Le second plaisir est un plaisir de bouche, flatter le palais du fruit de la découverte, le secret de la cuisson étant à la discrétion du seul cueilleur. Un fait du prince.
Le dernier plaisir est de savoir s'arrêter devant les plus beaux, ceux que nous savons être mortels.
Il en va de même pour les mots.
Que seraient-ils si nous ne nous en faisions pas les découvreurs et ne les cuisinions pas selon notre appétit ? Des concepts purs, des produits, des récitations et des leçons, voilà ce qu'ils seraient ! Les mots ne sont plaisirs que s’ils ouvrent sur les paradis à jamais perdus de nos printemps en culottes courtes. Les mots doivent babiller, sentir le lait et le commencement de la grande aventure.
Ils doivent être dits avec la voix lactée.
Ecoutez bien quelqu’un qui parle avec des mots fermés, avec des leçons. Il vous dira des choses intelligentes, raisonnables, indéniables, vérifiables. Mais il ne vous dira jamais de belles choses, qui souffleraient sur l'âme.
Seuls les conteurs et les affabulateurs savent ouvrir les mots sur des horizons perdus. Un jour, ou une nuit, ils diront le mot « mort ». C’est toujours leur dernier mot. Le seul mot fermé. Le seul qui n’admette pas la métaphore.
Mais tant qu’il y a promenade sous les étoiles, nous filons la métaphore.
Une vie c’est d’abord pour moi cette figure de style souveraine dont dépendent toutes les autres et les mots que nous croisons de nos pas, les mots qui désignent nos espaces, sont d’abord des figures de style.
10:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.10.2017
C'est un village et son église
 Saint Sauveur.
Saint Sauveur.
Tout le monde sait qui est le Saint Sauveur. Un peu partout sur le sol de France, des hameaux, des villages, des bourgades, des cités sont désignés par l’insigne antonomase, tant on imagine mal un lieu-dit s'adjugeant le nom de Jésus Christ. Il y aurait là comme une forte présomption pour le blasphème.
Chacun de ces Saint Sauveur a cependant dû, pour être sauvé de la confusion, prendre un deuxième nom, comme notre état civil et ses deux, voire trois prénoms, afin que nous ne fussions pas associés, surtout dans des cas extrêmes, avec un homographe.
Saint Sauveur d’Aunis, Luz Saint Sauveur, Saint Sauveur d’Aix en Provence, Saint Sauveur en Puisaye, patrie de Colette, j’en passe et de tout aussi éloquents, la liste est longue. Et il en est un, particulier, qui eût pu se nommer Saint Sauveur en Deux-Sèvres, tout simplement, puisqu'il est construit dans le Bressuirais. Mais il s’y serait déroulée une énigme tellement extravagante que les deux, l'énigme et le village, en sont joliment passés à la postérité toponymique.
Sept cent trente-deux fait partie de ces dates qui se gravent dans nos cerveaux d’écolier et ne s'en effacent plus, on ne saurait trop dire pourquoi.
C’est donc cette année-là que Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers. Plus tard, on étudie plus sérieusement alors on dit les Sarrasins. On situe aussi plus précisément le théâtre des opérations, entre Poitiers et Tours, à Moussais exactement, d’ailleurs nommé depuis lors Moussais-La-Bataille.
Toujours est-il que les armées musulmanes ayant été défaites et leur commandant en chef Abd el Rahman ayant succombé au combat, un important groupe de Sarrasins et leurs familles, fuyards désemparés, s’étaient réfugiés en l’église de ce Saint Sauveur en Deux-Sèvres, à quelque quatre vingts kilomètres à l’ouest du champ de la fatale bataille.
Respectueux du Saint Lieu et des célestes lois qui le protègent de toute violence, les habitants les assiégèrent mais ne les attaquèrent pas. Ils promettaient aussi la vie sauve aux Berbères s’ils leur rendaient incessamment le lieu de leur culte.
Les vaillants guerriers Arabes, voulant faire savoir leur ténacité et leur ferme intention de résister jusqu’au dernier, transmirent un beau soir aux assaillants qu’ils ne se rendraient que s’il y avait du givre aux arbres le lendemain matin.
Or, nous étions au mois de mai. Les habitants reçurent donc le message comme une facétie, du style « quand les poules auront des dents », et donc comme une indéfectible volonté de ne pas abdiquer.
Ils se préparèrent ainsi à tenir un très long siège devant leur église.
Il advint alors ce miracle que le jour se leva sur une campagne toute blanche et que le givre brilla aux branches des arbres, comme autant de petits cristaux ou de poussières d’étoiles miroitant sous les premiers rayons de l’aube.
Hommes de parole et d’honneur, les Sarrasins médusés se rendirent, les assiégeants persuadés qu’il s’agissait là d’une intervention de la Divine Providence et les assiégés accusant sans doute une félonie du hasard.
Hommes de parole et d’honneur itou, les habitants laissèrent la vie sauve aux Sarrasins qui s’éparpillèrent alors avec leur famille sur les territoires alentour, où ils élirent pour la plupart domicile et où, qu’on me pardonne cet épilogue en conte de fée, s’établit aussi leur descendance.
Si vous traversez un jour ce bout de la Gâtine, vous ne pourrez qu’arrêter un moment votre regard sur cette périphrase, Saint-Sauveur-de-givre-en-mai, qu’on dirait avoir été écrite par le langage tout en allégories des Indiens de l’Amérique du nord.
13:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.10.2017
Un plus un, plus un autre
 Les feuilles à l'agonie d’un érable solitaire, jauni, se balançaient dans l’air, tout autour.
Les feuilles à l'agonie d’un érable solitaire, jauni, se balançaient dans l’air, tout autour.
Des feuilles lourdes, imprégnées de brouillard.
C’est toujours comme ça, l’automne. Avec un vent froid, pas encore coupant, juste menaçant et qui pénètre les vêtements. Qui fait frissonner l'intérieur, par anticipation.
Du silence aussi. Seulement ponctué, de loin en loin, par le croassement d'un grand corbeau qu'on ne voit pas, caché derrière des brumes.
Oui, c’est toujours comme ça dans les cimetières de l’automne. Du silence. Pas encore définitif, juste prémonitoire, et qui pénètre l’âme.
Le ciel était gris. Le ciel est toujours gris dans les brouillards d'octobre au-dessus des cimetières.
Devant la tombe recouverte de chrysanthèmes aux vives couleurs, une comme le sang, une comme le soleil, une comme la neige, trois hommes baissaient la tête.
C’est toujours comme ça dans les cimetières de l’automne sous un ciel gris devant une tombe, quand le vent est froid et qu’il y a du silence : des hommes baissent la tête. Pas complètement encore. Juste une inclinaison.
Le croyant priait, tout à sa douleur mêlée d’espoir. Douleur contradictoire, quand la conviction de l'esprit est vaincue par l'affliction du coeur. Il invoquait son Dieu et demandait pardon.
C’est toujours comme ça, quand on a un Dieu : on demande pardon.
Le croyant approximatif, le croyant social, priait aussi, plus ostensiblement que l’autre, et il joignait les gestes à ses murmures, se signait et se re-signait encore avec frénésie. Parfois, sa pensée trop libre s’évadait de son maintien, il songeait qu’il faisait froid, bientôt l'hiver, et que le monde était bien cruel d'avoir mis là son tendre ami… Puis il revenait à ce qu’il savait le mieux faire devant une tombe : il murmurait.
C’est toujours comme ça quand on est approximatif : on murmure. On vit tout, même la mort, en équilibre entre le silence et la parole.
L’athée, lui, ne savait quoi faire de ses mains, de ses pieds, de sa tête, de ce froid, de ce gris, de ce silence, de ces murmures. Son front était baissé, mais avec le secours de la volonté. Il fouillait dans ses poches, trouvait ça inconvenant, tapait du pied, se grondait in petto de n'être point décent, regardait ailleurs des oiseaux qui furetaient sur les allées désertes du cimetière, et revenait sur le nom de son ami gravé dans la pierre, entre deux branches de buis transies.
Il déplorait la fuite du temps. Fuite qui tue. Et cet horrible, cet inconcevable, ce terrifiant plus jamais tournoyait dans son cœur comme tournoyaient dans l’air les feuilles jaunies de l’érable mouillé.
Des larmes ruisselaient le long de ses joues délabrées qui tremblaient.
C’est toujours comme ça quand on est athée : on n’a rien à répondre à l’absurdité des choses.
Alors il arrive que des larmes ruissellent, suivent les rides des joues, mouillent le menton et tombent dans un inconsolable vide.
Celui du mort comme le sien propre.
14:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
30.09.2017
Le monde m'emmerde et la littérature
 C’est bien vrai, ça.
C’est bien vrai, ça.
Je l’aime néanmoins de toute ma vie, ce monde, parce qu’il a le seul mérite qui vaille : il existe et je vis dedans.
C’est la raison pour laquelle j’use à son encontre d’un doux euphémisme : il m’emmerde. Je pourrais tout aussi bien dire : il me fait chier.
Oh, mot malpoli ! Mot tabou ! Mot honni ! Mot que nous employons pourtant à tour de bras, tous les jours, n'importe quand, pour n’importe quoi, voire pour n’importe qui, mais que jamais, jamais - ou si peu - nous n’osons écrire.
Vieux comme le monde, ce vocable directement tiré du latin cacare, est l’orphelin répudié des textes "littéraires", banni par les classiques qui voulaient laver, comme on le sait, plus blanc que n'est le blanc.
Il avait pourtant ses lettres de noblesse dans toute la littérature médiévale et il était aussi l’ami de Rabelais et de Montaigne.
Le tabou est donc assez récent. Nous usons le plus souvent d’une langue épurée dont nous ne savons même pas les origines de la censure.
Même Brassens, après avoir demandé qu'on l'excusât pour avoir employé le mot "enculer" - J’suis désolé d'dire enculer - n’a jamais poussé la provocation langagière jusqu'à mettre les cinq lettres abominées en musique. C’est dire !
Faut-il donc rayer des dictionnaires les noms de Rabelais et de Montaigne ? Je dis cela, parce qu’Alain Rey et Sophie Chantreau*, à propos de chier, relèvent avec malice cette aberration :
« Sa vulgarité l’a fait négliger des dictionnaires usuels, qui passent discrètement sur ses emplois figurés et les locutions qu’il a suscitées. »
Et quelles expressions ! Se faire chier, ça va chier, chier du poivre - belle allégorie du voyou en cavale qui vient de fausser compagnie aux mouchards et aux flics - envoyer chier, chier dans les bottes de quelqu’un... J'en passe et de tout aussi salaces.
Je ne suis pas trop d’accord, en revanche, avec l’explication donnée par les susdits Alain Rey et Sophie Chantreau pour l'expression chier dans les bottes de quelqu'un : ennuyer, importuner quelqu’un, disent-ils.
Dans l’usage que j’en ai eu comme dans celui dont j'ai été témoin, l’expression signifiait, "faire un sale tour à quelqu’un", "lui être déloyal".
Céline a certainement, quelque part, réhabilité le mot. Je ne saurais dire de mémoire, je ne l’ai pas sous les yeux… Je me souviens tout de même avoir plusieurs fois rencontré chez lui le néologisme « chierie».
Rimbaud quant à lui, avec violence, avait réintroduit le tabou :
O justes, nous chierons dans votre ventre de grès !
A part ça, du moins à ma connaissance immédiate, silence radio à tous les étages.
Je ne l’emploie moi-même jamais, sinon oralement comme tout le monde.
Bon, j’arrête de vous faire chier avec ça.
* Dictionnaire des Expressions et Locutions - LE ROBERT - Collection "les usuels"
Image : Philip Seelen
15:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.09.2017
Rencontres

Le ciel s’obstine, soit à pleurnicher, soit à vraiment sangloter. Quelques rapides éclaircies, jaune pale, tentent bien de temps à autres d’essuyer ses larmes. En vain. La déprime règne sur tout l’espace céleste.
Cette grisaille cependant fait le ravissement des cueilleurs de champignons.
Il y en a partout. Des cueilleurs comme des champignons… Les premiers déboulent du moindre sentier herbeux, du moindre routin de sable et, le nez baissé, ils arpentent les sous-bois gorgés d’humidité. Les seconds envahissent jusque sous les tilleuls de ma cour, s’incrustent sous le vieil et bel ormeau, colonisent l’emplacement d’une vieille grange où, l’été, je laisse mon bois sécher.
Et je les vois revenir de leur quête, les ramasseurs ! je les croise au cours de mes balades sur la prairie riveraine, le vent déjà frais sur leur visage enjoué. Leurs paniers sont remplis de beaux bolets, bruns ou rougeâtres, qui luisent grassement et sentent toutes les senteurs des vieux fourrés. On échange quelques mots, non, ils n’ont pas de vers, ils sont jeunes et encore fermes, c’est vraiment une belle météo pour les champignons ! Grzybowa pogoda...
Ils me regardent gentiment, un peu étonnés de ce que, moi, je marche sans panier sous le bras et ne ramasse rien. Que l'air du temps qui passe.
Je me demande s’ils ne se demandent pas pourquoi. Avec bienveillance.
S’ils s’en inquiétaient, je leur dirais qu’il y a trop longtemps que j’ai fait ma révolution néolithique, que c’était loin d’ici, à l’autre bout du continent, et que je ne me souviens plus très bien comment on cueille les champignons.
Mais qu’avec des mots qu’ils ne liront jamais, je saurai raconter à des hommes qu'ils ne verront jamais que je les ai croisés et que nous nous sommes fraternellement salués aux portes de l'automne
Image : Marian Tomkowicz. Merci à lui !
19:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.09.2017
Les maquisards
 Régulièrement, comme tant d’autres petites mains anonymes, j’ouvre un nouveau fichier…
Régulièrement, comme tant d’autres petites mains anonymes, j’ouvre un nouveau fichier…
Et la première lettre, le premier mot, bientôt la première phrase d’une idée de projet s’inscrivent à l’écran.
La gestation sera plus ou moins longue. Des mois ? Des années ? La création littéraire n’a pas de lois biologiques qui pourraient la rassurer sur son destin.
De plus, elle compte dans ses poubelles une foule de morts-nés, brouillons inaudibles, fœtus difformes au verbe boiteux.
C’est ce que nous appelons « écrire ». Nous écrivons ! Diantre ! La belle affaire que voilà !
A qui ? Et qui donc nous lira ? Et puis, pour dire quoi ?
Ces jours derniers, une dame me disait par mail gentil : "Ce fut un ravissement de vous lire, monsieur Redonnet." Un monsieur, lui, renchérissait : "Quel régal que votre dernier livre !" Un autre, une autre encore : "Merci pour ces pages trempées dans une écriture que nous pensions définitivement jetée aux orties."
Je les remercie. Je devrais être flatté, content de ma Pomme, peigner fièrement mes moustaches dans le miroir, et me sourire en coin.
En lieu et place, j’en reste songeur.
Parce que si ce que disent ces quelques lecteurs et lectrices est vrai ; s’ils ne sont pas de pauvres fous, dans quel monde me suis-je donc fourvoyé qu’il y en a des milliers et des milliers d’autres qui n’en ont strictement rien à foutre de ce que j’ai pu écrire de la culture Campaniforme, de l’exil, des Soldats maudits et de la grande forêt primaire de Białowieża ?
Et je ne suis pas un cas isolé, loin s'en faut. Tous ceux qui écrivent dignement le savent bien.
En fait, en lisant ces quelques courriers, je comprends que nous avons pris le maquis.
Que nous sommes cachés dans des broussailles épaisses, guettant la survivance.
Pendant qu’autour de nous voltige l’accablante réalité d’une époque qui, sans être ni plus décadente, ni plus sordide, ni plus méchante, ni plus pourrie qu’une autre, n’a tout simplement plus besoin de notre écriture pour se penser, se comprendre et, même, se rêver.
Nous avons pris le maquis à l'envers : nous voudrions occuper une place qui n'est plus à nous depuis fort longtemps et qui est, on ne peut plus légitimement, habitée par d'autres.
Avant d’ouvrir un nouveau fichier et d’y inscrire une première lettre, un premier mot, une première phrase, nous devrions avoir ça à l’esprit.
Mais nous nous en garderons bien, le propre de la folie - et de sa vanité - étant de ne pas tenir compte des réalités.
Illustration : Soldats maudits en Pologne

10:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.09.2017
Tout le monde, il a bien sa pomme qui tombe pas loin du chausson?
 Bon, c'est bien...
Bon, c'est bien...
Il vous est aussi loisible d'aller faire un tour du côté d'Onuphrius... Pour un enterrement...
La nouvelle que j'y publie a l'air d'une galéjade... Pourquoi pas, me direz-vous avec juste raison ?
Pourtant elle dit aussi que de ce côté-ci du temps, on compte toujours le temps.
On le sème. Derrière ou devant soi. On en voudrait récolter du bon grain.
On le sème comme, côté face, la semeuse de nos anciennes pièces de 1 franc semait.
Et on est un peu effrayé de ce qu’il ne repousse pas très vite. Le sillon serait-il vierge au creux duquel nous le jetons ?
Ou alors, s’il repousse, ce sont uniquement des limites, toujours des limites.
Car son rôle est de fuir, nous dit le vieil adage depuis la nuit des temps.
Cela dépend pourtant. Cela dépend de la saison. Il y a des saisons où il musarde, d’autres où il trottine, d’autres où il se met à courir et d’autres encore, les dernières, où il s’enfuit littéralement.
Au moindre bruit un peu suspect du cœur ou de la poitrine, il détale et jamais plus ne revient.
Alors, de ce côté-là du temps, on ne compte plus le temps.
15:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
















