14.11.2018
Car tel est notre bon plaisir

Il y a quelques années déjà, j'avais lu avec délectation le Roman de Renart.
Je n'en avais jusqu'alors lu que des extraits, assez larges tout de même, et l’envie m’avait donc pris de lire ce maître-livre du Moyen-âge, d’un seul trait, dans sa totalité.
Car voilà bien un roman - au sens où il fut rédigé en langue romane - qui a bercé notre apprentissage littéraire sur les bancs de bois de la prime école et dont les célèbres animaux-personnages ont longtemps hanté notre imaginaire.
On y apprend beaucoup sur la langue et, en filigrane, sur une certaine société des XIIe et XIIIe siècles.
Bref, voyez comme, sur les susdits bancs de bois des écoles de notre enfance, on nous a gentiment gavés d’erreurs qui, par la suite, se sont accrochées à notre âme comme le chapeau chinois à son rocher.
Je me suis donc souvenu de cette phrase avec laquelle, selon nos bons vieux instituteurs républicains, les méchants rois de France motivaient leurs ordonnances et expédiaient leurs sujets sur la paille humide des cachots : Car tel est notre bon plaisir.
On nous la rabâchait, cette phrase de l'arbitraire motivé, pour nous bien montrer la cruauté des despotismes d'antan et, par contraste, pour nous éclairer sans doute sur cette belle République à la lumière de laquelle nous avions la chance de nous épanouir.
Je me souviens aussi du sentiment de révolte qui sourdait alors en mes juvéniles tripes devant ces dictateurs "emperruqués" qui, par plaisir, par jouissance perverse, se plaisaient à faire la pluie ou le beau temps.
Il en était peut-être un peu ainsi. Certes. Mais l’exemple qu’on nous donnait pour faire entrer dans nos jeunes caboches les abus de l’Ancien Régime, n’en était pas moins traîtreusement falsifié.
Dans le procès de Renart, deuxième livre, le chien Rooniaus est désigné comme justice. C’est-à-dire comme juge. Les Anglais ont d’ailleurs gardé ce sens primitif et désignent sous le nom de justice le Président d’un tribunal. Le plaids, c’est l’enquête, l’instruction, en même temps que la décision du juge motivée par cette enquête et cette instruction.
Et ce plaids-là apparaissait en latin dans le tale placitum, soit " telle est la décision prise par la cour."
Voilà la traduction exacte de notre fameux tel est notre plaisir.
Ne nous a donc pas dès lors enseigné un véritable contresens, la décision d’une cour après instruction étant censée être l’exact contraire de l’arbitraire et du plaisir pris à punir ?
Ah, combien de mots et combien de formules employons-nous ainsi, dans nos paroles comme dans nos écrits, à l'envers de leur véritable mission ?
J'en suis presque effrayé.
19:56 Publié dans Acompte d'auteur, Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.09.2011
Lettre à un ami - 8 -

Cher Gustave,
Merci de ta gentille lettre et pardonne-moi de n’y avoir fait écho plus tôt. Je suis - quand je ne suis pas, à l'approche de l'hiver, penché sur mes occupations de type néolithique - dans la sauvegarde intégrale de tous les textes de l’Exil des mots, textes qui jusqu’alors étaient dispersés un peu partout dans des fichiers eux-mêmes éparpillés, incomplets, difformes.
Tout relire ainsi ce qu’on a écrit depuis plus de quatre ans est un étrange voyage. Beaucoup à trier, de positif, de neutre et de franchement négatif. Je te dirai plus longuement, bien sûr, lors d’un prochain envoi.
Je voudrais te parler aujourd’hui des mots d’une langue à l’autre, sur le plan visuel, et de la façon dont ils peuvent s’imbriquer physiquement les uns dans les autres pour former des phrases.
J’ai récupéré, pour exemple, un dépliant de l’Office des forêts polonais, traduit en plusieurs langues, et me suis amusé à comparer la structure des différentes versions dans ce simple slogan :
Familiarise-toi avec les forêts de la Région de Lublin
Ah, je vois bien d’ici ta réaction : c’est plutôt lourd et long pour un slogan de dépliant.
Oui, un slogan de dix mots !
En Anglais, ce n’est guère mieux : familiarise yourself with the forests of Lublin region. Quant à L’Allemand, juge par toi-même : Mach Dich mit den Wäldern des Landes Lublin vertraut.
D’accord, mais écoute en Polonais, trois mots seulement et l’affaire est bouclée :
Poznaj lasy Lubelszczyzny
Point final. Concision grammaticale sans l’embarras, presque la lourdeur, de toutes nos particules. L’avantage de décliner grammaticalement les mots. Tu me diras, à juste titre, que pour un latin, c’est coton de prononcer ce szcz de lubelszczyzny. Oui, c’est un peu compliqué, effectivement. Tout est dans le chuintement, il y a là deux sons presque simultanés ch et tch. Comme dans szczur, le rat. Tu entends, en fait, ch’tchur.
Jagoda rigole évidemment de mes contorsions buccales, me dit que tout ça, c’est quand même facile à prononcer et, pour preuve de difficultés plus ardues, me montre son livre d’animaux avec un magnifique lew pòłnocnowschodniokongijski.
Ouf ! Tu es toujours là ?
Finalement, mieux vaut, pour moi du moins, prendre son temps et son souffle, et allonger tout ça en un lion du Nord-Est congolais.
Qu’en penses-tu ?
Tiens, je saute du coq à l’âne, par association d’idée quand même, tu sais que Tolstoï ne s’est jamais appelé Léon mais Lion ? Lion Tolstoï, Lew Tołstoj en Polonais qui traduit littéralement le prénom Лев. Толстой Лев.
En Français on a le culot de dire et d'écrire : de son vrai nom Lev Tolstoï. Une aberration car le v n’existe même pas dans l’alphabet russe.
Au final, je te joins cette image magnifique de notre ami Philip. Parce que pas de mots. La musique de la vie, la musique des sautes de vent, la musique des solitudes, des paysages, des envies de beau. Il y a, dans cette image, quelque chose de lointain, de farouche, qu'aucune langue ne saurait sans doute traduire exactement.
Porte-toi bien.
B
Image : Philip Seelen
15:12 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.09.2011
Lettre à un ami - 7 -

Suis un peu silencieux ces derniers temps, j’en ai bien conscience. Mais figure-toi que je me suis imposé une certaine discipline de travail, en préparation de la résidence d’auteur de l’année prochaine, en Deux-Sèvres, au cours de laquelle nous devons mettre au point un spectacle de mise en musique de différents textes, dont La Fontaine, Marot, Villon, Baudelaire, Apollinaire, et, évidemment, présenter ce spectacle.
Je t’en ai déjà parlé, je crois…
Voilà des textes que je chante depuis plusieurs années, que je connais par cœur, paroles mélodies et accords. Cependant, cela ne suffit pas pour les enregistrer convenablement. Ça demande, pour moi en tout cas, autre chose, un effort de concentration qui ne va pas du tout avec la poésie que sont censés « véhiculer », pardonne-moi pour cet affreux mot, ces textes-là. En plus, que ce soit au niveau du rythme mélodique ou de la diction, cette concentration excessive, ce désir d’intellectuellement bien faire au lieu de laisser tout ça couler de source, comme lorsque je joue pour moi seul ou le cercle restreint de ma famille, me font commettre de grosses erreurs. Chacun de ces textes me demande donc au moins vingt prises, tant je ne sais plus chanter, sinon faux, dès que je me sais enregistré. L’écoute est parfois pénible et décourageante, mais, à force de travail et de recommencements, on arrive à quelque chose qui tienne un peu la route... Tout cela est en effet destiné à ce que Jean-Jacques mémorise les quatorze textes et leur musique, se les approprie, et les joue ainsi avec sentiment. Tu comprends dès lors qu’il faut donc que ça ait une certaine tenue.
J’ai beau me rappeler, en souriant, l’anecdote de Brassens répondant à Jean Bertola qui lui disait, timidement, lors d’une prise de son, que peut-être, là, à un moment donné, il chantait un peu faux : « Hé, vous avez déjà entendu quelqu’un chanter juste, vous, quand il dit Je t’aime », cela ne me console pas beaucoup.
Me reste aussi l’écriture des partitions, car nous avons le projet de nous adjoindre les talents d’un camarade saxophoniste. Et, là, c’est pour moi un travail de fourmi, un travail d’un qui apprendrait l’orthographe et la grammaire, longtemps après avoir acquis l’art de s’exprimer. Tu sais que je compose spontanément, à l’oreille, en m’appuyant sur une suite d’accords. Mais tout ceci, que je le veuille ou non, s’appuie sur une théorie musicale hors-moi, et qu’il me faut transcrire. Je prends donc la guitare sur les genoux, écrit les notes au fur et à mesure et les inscris ensuite sur la partition. Après viennent les mesures et les différents signes, pauses, silences et tutti quanti. Pourtant, mes musiques et mes accords sont simples. Presque naïfs.
Dans ces moments-là, je me demande si l’écriture qu’avait proposée Rousseau dans son Projet concernant de nouveaux signes pour la musique - et dont j’ignore tout - était plus simple ou plus difficile encore.
Bref, je ne suis pas un musicien car, chantant avant d’écrire le chant, j’ai mis la charrue avant les bœufs.
Comme toujours, je t’entends dire d’ici, malicieusement.
Oui, cher Gustave, comme toujours. Et en écriture, c’est comme cela qu’on procède : on vit, on souffre, on aime, on arpente la vie, ses douleurs et ses grandes joies, on accumule un tas de vérités qui s’avèrent être des erreurs et vice-versa, avant d’écrire. Sinon on est un spécialiste, c’est-à-dire un cuistre et un jean-foutre. Au pire un Normalien.
Et à propos d’écriture, il faut que tu regardes absolument ce reportage édifiant, de 2009, mis ce matin en ligne par Marc Villemain. On sait ça, c'est vrai, mais honneur à Marc d’en parler sans tabou et quelle misère, ce monde politique et ce Sarkozy encore une fois pris la main dans le sac ! Comme récemment, paraît-il, dans celui de Bettencourt…
Porte-toi bien !
B
12:33 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
12.08.2011
Lettre à un ami - 5-
Cher Gustave,
Alors là, tu ne m’en voudras pas si je t’avoue avoir largement souri - et même pire - à la lecture de ta dernière lettre !
Quel misanthrope humaniste tu me fais ! Voilà que tu te lances, fort généreusement, dans une analyse assez fine du désordre dans lequel patauge le monde, mais, hélas, que tu conclus à l'envers, sur une espèce de note d’espoir, née de je ne sais quelle vision soudaine et optimiste des hommes. Sur cette pourriture que nous avons patiemment installée sous nos pieds, dis-tu, il est temps que surgissent les hommes nouveaux qui sauront creuser en profondeur, refaire le jardin à neuf et redonner le goût de s’y balader.
C’est joliment dit, certes, mais d’une naïveté, pardonne ma sévérité, déconcertante.
Je te dois donc la controverse et t’expose en deux mots ma vision des choses.
« La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. »
Première phrase du Capital - Karl Marx - 1867
« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. »
Première phrase de La Société du spectacle - Guy Debord - 1967
« Tout le dénuement intellectuel et moral des sociétés dans lesquelles règnent les conditions que nous savons s’annonce comme une immense accumulation de marchés. »
Première phrase d’un ouvrage improbable - 2067
Nous apercevons, avec ces trois phrases rapportées ici comme des raccourcis, l’évolution vers le néant suivie, et à suivre, par les sociétés : A la marchandise, concrète, lourde de ferraille, d’échanges, de biens de consommation et d’équipement des XVIIIe et XIXe siècles, avaient nécessairement succédé, à partir du milieu du XXe, l’inversion du réel et la prise du pouvoir par l’image dans tous les secteurs de la vie, le vécu n’ayant plus de prise sur ce réel que par la médiation de cette image souveraine. Ce que les situationnistes ont appelé spectacle. Ce spectacle n’était en fait que la forme encore adolescente du virtuel dans lequel nous vivons et qui prit son plein essor au début des années 2000. Echanges virtuels, jeux de bourses dominant tous les secteurs de l’activité économique des hommes, argent virtuel, économie virtuelle, vie virtuelle, conscience virtuelle du monde à tous les étages, affectivité virtuelle, conflits virtuels, rapports des hommes entre eux virtuels et, comme pierre angulaire de ce nouvel ordre social, comme justification a posteriori, les marchés.
La marchandise, tout le monde comprenait : le prolétaire qui avait les mains dans le cambouis, qui avait du mal à boucler matériellement les fins de mois, voire les fins de quinzaine, aussi bien que le gros capitaliste, gavé comme un porc, un cigare sous le groin et qui pétait dans la soie. Monde concret, âpre, misère concrète, matérielle, opposée à une richesse insolente, tangible, antagonismes concrets, luttes concrètes.
Toutes perdues.
Le spectacle, forme plus moderne de la marchandise, peu ont compris. Sur la vingtaine de pour cent de Français, pour ne parler que d’eux, qui ont lu La Société du spectacle, cinq pour cent, au mieux, ont entendu la critique qui était faite de la réification de leur vie. Par le spectacle-entremetteur, la marchandise déguisée et accaparant tous les secteurs de la vie, savourait sa victoire à la barbe même de ceux qui croyaient lutter contre elle. Monde compliqué et doucereux, monde d’apparences régnantes, monde du mensonge érigé en vérité définitive, politique de surface, misère qui, dans l’opulence matérielle - quoique inégale - des différentes strates du corps social, change de niveau et devient surtout intellectuelle, intime, morale, profonde, sexuelle. Jusqu’au désarroi.
Luttes pour la reconquête de la dignité de vivre.
Toutes perdues.
Les marchés, personne ne comprend, et c’était là le but. Comment s’opposer et détruire quelque chose qu’on ne comprend pas ? Le spectacle moribond - pas moribond, mais mutant à son tour comme la marchandise avait muté pour lui donner naissance - ne cesse d’ânonner : faut rassurer les marchés ! Les marchés ? Des fantômes rugissants, surpuissants, monstres dévoreurs, invisibles, occultes, inconnus…Les hommes de la planète complètement à côté de la plaque, ne comprenant rien, ni de leur organisation, ni de leur but, ni de leur raison d’être sur terre, ni de quoi il en retourne, ni où, ni comment, ni pourquoi, ni quand leur pauvre vie est jouée sur des écrans d’ordinateur. Une vie dénuée de vie. Aucun sens. Victoire totale d’un ordre économique désormais établi par-delà les frontières de l’activité pragmatique, monde achevé dans l’obscurantisme, consciences annihilées, visions tronquées, parcellaires, paroles désertes, réactions désordonnées, arts sans art.
Luttes sporadiques, hors sujet, sans enjeu et sans but puisque sans adversaire réellement identifié.
Toutes perdues.
A n’en pas douter.
Marchandise- Spectacle- Marchés. Une même dictature sous ses formes diverses, évolutives et indispensables à la pérennité de son règne.
Tu dis révolte, Gustave ?
Je te suis.
Tu dis révolution ?
Je te dis foutaises et gamineries séniles : les hommes n’ont jamais réussi une seule de leur révolution depuis qu’ils sont des hommes. Depuis le début, le sens même de leur vie - qui est tout bêtement de vivre pleinement la chance de vivre - leur échappe totalement et le fait de survivre ( de vivre l’illusion de la vie) sur un parcours virtuel leur suffit. Ils ont, nous avons, depuis belle lurette, lâcher la proie pour l'ombre.
Confusion dramatique. Ethnologique. Essentielle.
Si tu voulais faire une révolution, cher Gustave, il te faudrait quasiment repartir depuis le début. Aux alentours de Cro-Magnon.
Et, dès le départ, indiquer une direction vers où marcher, donner une définition propre du mot bonheur.
Contentons-nous donc, hors résignation, de cueillir ce qui est à notre modeste et égoiste portée.
Bientôt, trop tôt, viendront les ténèbres.
Porte-toi bien
B.
12:20 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.08.2011
Lettre à un ami - 4 -

Te remercie d’avoir abordé la question de ma position vis-à-vis du livre numérique, ce qui va me permettre, te l’exposant sans ambages, de clarifier pour moi-même certaines choses, que je n’avais pas forcément vues dans le feu de l’action.
C’est donc de mon expérience particulière dont je vais te parler, plus que du livre numérique en général, dont je me fous aujourd’hui comme d’une cerise.
Qui ne change pas d’idée n’en a pas, c’est bien connu, à plus forte raison quand la réalité est venue démentir certaines orientations et convictions que l'on tenait pour bien fondées.
Quand je suis arrivé en Pologne en 2005, j’ai tout de suite ouvert un premier blog, L’Exil volontaire, en septembre exactement, qui s’est transformé en juillet 2007 en l’actuel Exil des mots. C’étaient là mes premières expériences d’écriture numérique.
Lassé d’accumuler manuscrits et notes dans mes tiroirs - comme beaucoup d’autres - j’ai forcément été séduit par ce nouveau mode d’autoédition, immédiat, directement lisible, directement critiqué.
C’est sur ces entrefaites-là et dans cette disposition d’esprit-là que je suis entré en contact avec François Bon, que je connaissais auparavant, et qui m’encouragea gentiment à rester présent sur ce terrain-là car, je cite, c’est là que tout se passera dans les années à venir.
Il disait à peu près vrai, car il disait une réalité qui, depuis, n’a fait qu’aller s‘amplifiant : le phénomène blogs et sites, répondant à une demande, à un besoin, est devenu une pratique sociale de masse, envahissant la toile des velléités de chacun en matière d’écriture. J’ai donc tout naturellement applaudi des deux pattes quand le susdit François Bon a décidé de créer Publie.net en janvier 2008 et j’y ai participé avec enthousiasme dès le début.
J’y ai cru parce que l’édition traditionnelle me semblait une pratique en perte de vitesse et de crédibilité. Tous les arguments, parmi lesquels la fameuse et vertigineuse rotation des livres en librairie, ont été donnés. Tu les sais aussi bien que moi et je n’ai donc pas besoin de revenir là-dessus. L’émergence de l’édition numérique semblait être un remède, sinon la panacée, à tout ce qu’on peut rencontrer d’embûches, d’incertain, de non-dits, de non-faits quand on publie un livre.
D’autant que cette nouvelle forme d'édition était portée par un gars connu et en qui j’avais toute confiance.
Publie.net proposait aussi une transparence coopérative exemplaire, allant même jusqu’à promettre que chaque auteur pourrait suivre les téléchargements de ses œuvres, via un système qui reste encore à inventer. Je me souviens qu’il disait : trouvez un éditeur capable de vous offrir un tel confort !
Il est gonflé, le bonhomme !
Et puis les années ont passé…Jamais un écho. Jamais un traître relevé des ventes, jamais la moindre nouvelle. Pas de droits d’auteurs, bien entendu, ceux-ci étant pourtant régulièrement claironnés être versés à hauteur de 50 pour cent.
50 pour cent de zéro, ça fait toujours zéro.
J’ai rongé mon frein. Pas pour les droits d’auteur. Personne ne vit de ça, personne ne les réclame pour améliorer sa condition. Si on les réclame, c’est qu’on veut savoir si on est lu ou pas. Ce qui, édition traditionnelle ou numérique, est quand même le droit fondamental d’un auteur. La première reconnaissance d’un travail effectué en commun.
J’ai rongé mon frein et plus je le rongeais, plus je voyais bien que l’édition numérique naissait exactement avec les mêmes travers que toute autre forme d'édition. Sans la compensation d’avoir un vrai livre effectivement publié, vivant et distribué, cependant.
Ce Publie.net s’est donc avéré être le Guillot-sycophante de la fable, déguisé en berger et gardien du bon droit pour mieux avaler les brebis. La chute a été d’autant plus dure pour moi que l’illusion avait été forte.
Et ce qui m’a indigné fortement dans cette histoire, c’est le silence des agneaux. Le silence de ceux et celles qui publient chez Publie.net ou qui gravitent autour, qui se taisent, qui font les malins et les malines, qui ânonnent bêtement (pardon pour la tautologie) qu’ils participent à une aventure révolutionnaire alors qu’ils participent en pleine conscience à un truc vieux comme le vieux monde : l’enculage de mouches et la spoliation pure et simple pratiquée par un cheffaillon sur des ouailles infantilisées et crédules.
D’ailleurs, tiens, te souviens-tu comme François Bon m’a emmerdé, réclamant mon numéro de compte bancaire, faisant l’offusqué, la vierge effarouchée, se disant pressé d’en finir et de régler sa dette de 75 euros ? Oui ? Tu te souviens ? Hé ben, il y a plus de deux mois de cela et à ce jour, il ne s’en est point acquitté, de sa dette. Quel faux-cul, ce type !
Et puis il y a aussi ceci, cher Gustave : à Paris, j’ai rencontré un monsieur qui lisait tout de l’Exil des mots. Un monsieur que je ne connaissais pas, que je n’avais jamais vu, qui ne laisse jamais de commentaire, qui lit beaucoup, et qui a lu, entre autres, Polska B dzisiaj, dont il m'a fait grand compliment…Et bien je trouve drôle, statistiquement, que, par hasard, dans une librairie, dans une grande, très grande ville, je tombe inopinément sur un des 10 lecteurs qui a acheté Polska B dzisiaj ! J'ai vraiment de la chance, ne trouves-tu pas ? N’en reste plus que neuf, selon les chiffres de François Bon !
Hum…Hum…Tu vois ce que je veux dire…
Alors, chat échaudé craignant l’eau froide, je laisse désormais les « numéristes » à leurs illusions et leurs divers mensonges.
Je n’aurais pas été, en tout cas, partie prenante dans la conspiration du silence. Je me suis fait pas mal d’adversaires et me suis attiré pas mal d’inimitiés. On n’attaque pas un apparatchik patelin du net sans casser des pots. Qu’importe !
L’avenir me donnera sans doute raison. Le livre numérique viendra dans un avenir dont je me garderai bien de dire désormais s'il est proche ou lointain. Mais il ne viendra pas par ces chemins détournés et rusés qu'emprunte Publie.net.
Je terminerai sur une boutade : mon divorce d'avec l'édition numérique façon Publie.net est donc une affaire personnelle, mais une affaire qui ne devrait pas, si les gens avaient des oreilles et autre chose de conséquent un peu plus bas, n'engager que moi.
Porte-toi bien, cher Gustave.
B
08:21 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.08.2011
Lettre à un ami - 3 -
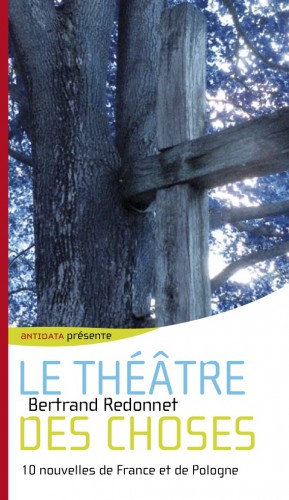 Cher Gustave,
Cher Gustave,
Suis ravi d’avoir reçu de tes nouvelles. Je te pensais parti vers quelque villégiature, comme la grande majorité des gens du mois d’août, mais je vois que tu as - encore - préféré rester en ton jardin, pour y cultiver - encore - ton insatiable misanthropie. Ceci dit plaisamment car, comme je t’ai dit souvent, la misanthropie n’est, en fait, que le dépit amoureux de celui qui a trop aimé les hommes et s’en est forcément retrouvé Gros-Jean comme devant.
Merci d’avoir lu Le Théâtre des choses. Je suis vraiment fier que tu y aies trouvé du plaisir et suis très sensible à tes compliments, que je sais être sincères.
Tu soulignes cependant la présence de cette croix sur la couverture. Tu dis avoir une interprétation que tu me livreras une fois que je t’aurai donné la mienne.
Bien. Tout d’abord, pour avoir publié plusieurs fois, tu sais bien que le choix de la couverture échappe généralement à l’auteur. Dans le cas présent cependant, j’avais fourni à l’éditeur tout un lot de photos prises ici, en Pologne, dont celle-ci sur laquelle s’est portée sa préférence.
Elle est extraite d’images que j’ai faites dans un vieux, très vieux cimetière orthodoxe abandonné, près du village de Gnojno. Un cimetière qui a dû être désaffecté en 1918, quand l’occupation russe a pris fin et, en même temps qu'elle, l’orthodoxie obligatoire en matière de religion. Ce lieu m’a fasciné avec ses tombes écroulées, étouffées sous le lierre et la ronce, ses croix aux deux branches vermoulues, ses bruissements d’insectes, sa touffeur, son inquiétant silence. Quand on marche ici, sur des sépultures qu'on ne voit qu'à peine, qu'on devine sous la végétation rampante, on est sur cette frontière ténue qui sépare archéologie et profanation. Seule la quantité de temps qui a ruisselé sur les mémoires, partout, distingue l’une de l’autre.
J’avais d’ailleurs écrit un texte sur ce lieu; texte que tu peux consulter ici, si ça n’est déjà fait.
L’éditeur du Théâtre des choses m’a donc dit que lui plaisait beaucoup, dans cette photo, le mélange entrelacé des choses humaines et des choses de la Nature. Ce qui est une constante des dix nouvelles du recueil.
Pour ma part, quand je regarde cette photo, avant comme après sa publication, j’y vois, naivement, l’expression symbolisée du retour du Grand Pan, finalement victorieux des religions monothéistes qui l'avaient expulsé, avec la violence que l'on sait, des poésies de l'esprit. Et cette vision des choses correspond bien, dans mon esprit, au Théâtre des choses.
Le grand Pan est mort. Une grande pensée de Pascal ! Le cri victorieux, aussi, de l'église chrétienne.
De toute façon, chacun lira sur cette couverture ce qui lui plaira de lire. D'aucuns ne verront que la croix sans voir l'essentiel : le chêne qui la dévore. Je m’attends donc aux réflexions de quelques fâcheux, promptement enclins au procès d’intention de surface pour éviter d'avoir à regarder plus loin que le bout de leur nez…Des fois que…
Cher Gustave, tu me demandes aussi comment je fais pour être aujourd’hui complètement remonté contre l’édition numérique après en avoir fait les éloges et comment je vis cette « apostasie », comme tu dis malicieusement.
Je te dirai tout ça dans une prochaine lettre.
Pour l’heure, je dois te laisser. Pendant mon mois d’absence, l’herbe abondamment arrosée par les tièdes orages de juillet, a envahi mon territoire et je dois profiter des quelques jours de beau temps que le ciel polonais nous accorde en ce moment, pour essayer de juguler ses ardeurs dionysiaques.
A très bientôt.
Porte- toi bien
B.
15:00 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
02.08.2011
Lettre à un ami - 2 -
Cher Gustave,
Le mensonge et la falsification désormais institutionnalisés dans les moindres détails de la vie, tel est le titre que je pourrais donner à mon envoi d’aujourd’hui.
Mais écoute plutôt.
Contraint, en France, d’acheter une carte SIM pour un portable, la nôtre étant polonaise et l’opérateur-voyou surtaxant de façon obscène les communications à l’étranger - allant même jusqu’à me faire payer une partie des communications que je recevais - j’eus la désagréable surprise de constater que la technologie marchande ne l'entendait pas de cette oreille et qu’on n’échappait pas aussi promptement aux mailles de son filet : le susdit opérateur-voyou avait pris la précaution de bloquer mon téléphone. Pas question de s’en servir avec un éphémère forfait acheté à la sauvette et à l’étranger !
Me voilà donc également contraint d’acheter un portable de pacotille (24 euros), ou de balancer à la poubelle cette carte SIM, nouvellement acquise dans une maison de la presse pour 15 euros.
Entre parenthèses, comprends aussi que je vis en zlotys et que ces sommes taillées dans mon budget sont à multiplier par 4. Bref…
Résigné, j’achète donc et me lance dans la lecture de la notice d’emploi…Un casse-tête chinois pour mézigue.
Et là, brave Gustave, j'en suis tombé le cul par terre ! Toute une rubrique était en effet consacrée à « comment faire croire à un quidam qui vous ennuie avec son bavardage que vous êtes obligé de le quitter sur-le-champ parce que vous avez un appel ? »
Tout est scrupuleusement expliqué là-dedans, la manœuvre frauduleuse bien détaillée. Très didactique. On irait presque jusqu’à te dire quelle expression il faut donner à ton visage, moue d'agacement feint et soudain, sourire d’excuse ou autres mimiques de tartufe.
Des détails, me diras-tu, toujours prompt, tel que je te sais, à ne t’alarmer de rien…Non, Gustave. Quand l’hypocrisie, la tromperie, la mystification, la dissimulation, la duplicité sont à ce point reconnues comme comportement social normal, qu'elles sont sociologisées, (et même utilisées comme arguments de vente), c’est que l’état des rapports entre les hommes a atteint le stade ultime de la putréfaction.
Ce n’est là, dans ce petit bout de papier, qu’une minuscule partie d’un iceberg gigantesque et monstrueux. Cet artifice marchand est une récupération très habile des perversités et il est aussi d’une redoutable intelligence quant au profit qui peut être tiré d'un état des lieux préalablement fait et, à juste titre, jugé lamentable.
Ah ! solitude, comme je ne te hais point !
Bien à toi
B.
15:23 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
01.08.2011
Lettre à un ami - 1 -

Mon voyage sur tes lointains rivages se termine et, n’ayant eu l’heur de t’y croiser, je t’en confie quelques bribes.
Côté ciel, ce fut à peu près constant dans la morosité. Je pensais pourtant qu’ayant à parcourir plus de 2500 km vers le sud-ouest et à travers quatre pays - la Pologne, le Nord de la Tchéquie, l’Allemagne et la France - j’allais rencontrer différentes humeurs atmosphériques et forcément découvrir quelque part un coin de ciel plus serein. Que nenni ! Parti sous une pluie battante, je suis arrivé sous d’opiniâtres crachins qui flottaient comme des vagues et suis revenu sous les orages brutaux du climat continental.
Les nuages partout m’ont poursuivi de leur morne assiduité.
Les Sudètes ruisselaient, et, plus loin, Prague, perle posée, selon Goethe, sur la couronne de l’Europe, était en bruine ; une bruine labyrinthique où je me suis carrément perdu.
L’Allemagne, enchevêtrement monstrueux d’autoroutes encombré des mille et mille non moins monstrueux camions du flux tendu de l’hystérie économique, s’était camouflée sous des brouillards que la Toussaint n’aurait pas reniés.
La France - exception faite pour l’Alsace où la plaine s’enivrait de lumière - la France qui depuis des mois se plaignait de trop de beau temps, m’offrit le visage maussade des jours de pluie. J’aurais pourtant bien voulu en goûter un peu, moi, de cette sécheresse honnie du laboureur !
Non, je n’ai vraiment pas eu de chance avec les nuages !
Mais foin des paranoïas météorologiques : je n’étais pas parti à la recherche d’un beau temps qui m’aurait bronzé la pia. J’étais parti respirer l’odeur de mon pays et toucher l’épaule bienveillante de quelques amis. Les paysages, qu’ils soient gris, qu’ils soient bleus, qu’ils soient humains ou qu’ils soient géographiques, sont les chambres d’écho des souvenirs et les repères immobiles du temps qui fuit.
J’ai donc vécu là-bas - ici pour toi- ce que, somme toute, je m’étais proposé de venir y vivre.
Et je me suis étonné de moi-même à Strasbourg : en passant le pont de Kehl, quand j’ai lu cette petite pancarte blanche «FRANCE», les yeux m’ont picoté et…oui, pour tout te dire, sont devenus humides. Ça remontait de loin. Emotion cachée. Insoupçonnée. On a, comme ça, en soi, de petits incendies qui brûlent à feu couvert et qu'un souffle fait crépiter.
Il faut quand même que je te signale une trouée impromptue dans la tristesse du ciel, avec cette journée passée sur l’île d’Aix : du bleu partout, de bas en haut et de haut en bas. Je ne sais cependant quel compte indécis j’ai à régler avec l’Océan. Je le trouve beau, puissant, énigmatique, envoûtant, mais, après une journée passée à le regarder bomber le torse, je m’y ennuie. Il m’ennuie. Je n’ai rien à lui dire de l’intérieur. Ses roulements, ses vagues, ses mouettes, ses algues, ses brumes lointaines, ses sables, ses rochers m’apparaissent très vite d’une affligeante monotonie. D’un décor convenu. L’Océan ne me fait pas rêver longtemps. Je ne l’admire pas. Son orgueil et ses prétentions à l’infini m’agacent. Je ne le respecte, je crois, que comme source première d’éclosion de la vie sur la machine ronde. C’est un respect tout intellectuel. Et ce genre de respect, tu le sais, ne suffit pas pour aimer durablement.
 J’ai parcouru des chemins qui m’étaient familiers. Des chemins deux-sévriens bordés de murailles englouties par les lierres et la ronce. J’aime la ruralité dispersée de ce département. On sent bien que des hommes de chair et d’os y vivent encore. A l’autre bout du pays, dans la région au sud de Paris, les paysages avaient été à vomir d’ennui avec leurs chaumes jaunes, déserts, silencieux, mornes, et leurs routes rectilignes, sans âme, sans arbre, sans mouvement. Des routes artificielles tracées pour ne pas avoir à égratigner un seul poil des immenses propriétés céréalières.
J’ai parcouru des chemins qui m’étaient familiers. Des chemins deux-sévriens bordés de murailles englouties par les lierres et la ronce. J’aime la ruralité dispersée de ce département. On sent bien que des hommes de chair et d’os y vivent encore. A l’autre bout du pays, dans la région au sud de Paris, les paysages avaient été à vomir d’ennui avec leurs chaumes jaunes, déserts, silencieux, mornes, et leurs routes rectilignes, sans âme, sans arbre, sans mouvement. Des routes artificielles tracées pour ne pas avoir à égratigner un seul poil des immenses propriétés céréalières.
C’est en Deux-Sèvres que je suis allé revoir Jean-Jacques - dont je t’ai déjà parlé -lire publiquement Zozo pour l’ouverture d’un festival au bien joli nom, Contes en chemin. La presse locale m’a fait l’honneur de quelques articles. L’un d’eux présente mon Zozo comme un anar des plus sincères puisqu’il s’ignore en tant que tel. Ma foi, ça n’est pas pour me déplaire. Ce livre continue donc sa petite carrière auprès des lecteurs, ce qui me réjouit.
Tout ce temps, je ne me suis pas approché d’internet. Pas envie, d’autres regards à porter. Ailleurs. Même si je sais bien qu’un écrivain - réel ou prétendu - ne peut guère aujourd’hui faire l’économie d’une présence sur le virtuel… Quoique…Me suis beaucoup amusé des angoisses de Jagoda qui me réclamait à tout bout de champ, à chaque arrêt, sans cesse, une connexion WIFI pour donner à manger à son lapin. Oui, un lapin qu’elle élève sur internet et dont il faut qu'elle nettoie la cage, qu'elle lui donne à boire et tout...…Me suis quand même demandé si on ne vivait pas tous, les enfants et les adultes, dans un monde de fous furieux. Dans un monde qui a réussi à abolir le monde. Nous aussi, on élève des lapins avec nos blogs et nos sites.
Qu’en penses-tu, toi qui vis très bien sans un blog ?

Je séjournais, à ce moment-là, en Normandie. A Balbec, exactement. A la recherche de je ne sais quel temps perdu.
Je t’en parlerai dans un prochain envoi.
Porte-toi bien.
Amicalement
B
11:27 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET


















