28.08.2016
Les fouilles et l'écriture
 L’écriture et ses mots sont à l’écrivain ce que la petite truelle et le petit pinceau sont à l’archéologue. Il s'agit de remettre au jour ce qui a été enfoui par les sédiments du temps, faire des débris épars un élément cohérent, qui donne au passé sa dimension et au temps perdu son lyrisme.
L’écriture et ses mots sont à l’écrivain ce que la petite truelle et le petit pinceau sont à l’archéologue. Il s'agit de remettre au jour ce qui a été enfoui par les sédiments du temps, faire des débris épars un élément cohérent, qui donne au passé sa dimension et au temps perdu son lyrisme.
Dans l’exercice de cette synthèse, il faut cependant prendre bien garde de ne rien casser et surtout de ne rien présenter comme étant de l’essentiel, du fondateur exclusif. Le chercheur qui trouvera sur le site d’une villa gallo-romaine, un morceau de fer rongé de rouille qu’il identifiera bientôt comme provenant d’un soc de charrue par exemple, n’en prétendra pas pour autant que les lointains habitants des lieux passaient leur temps à labourer et ne savaient faire que ça. En exhibant sa trouvaille et en la rattachant à une activité particulière, à une époque donnée, à des hommes et à un climat, il plongera plus loin son regard, embrassera tout un horizon et construira tout un monde.
Le bout de ferraille rouillé, rongé par les siècles, est un morceau de clef ouvrant les portes du temps, mais il n’est pas ce temps.
J’écris donc des éléments au fur et à mesure qu’ils se présentent à ma mémoire, le plus souvent par associations d’idées, une image ouvrant d’instinct sur une autre, sans lien apparent. Même en ayant l’air de parler de tout autre chose que de ce j’aurais pu tâter de mon être. Le roman que j’écris actuellement ne parle pas du tout de mon vécu. Dans sa deuxième partie, les personnages de ma fiction évoluent aux lisières de l’immense sylve de Białowieża ; ils ont leur histoire, leurs doutes, leurs croyances, leurs peurs mais ils ne peuvent exister que s’ils me volent quelque chose de mon histoire, de mes doutes, de mes croyances et de mes peurs.
Parce que l’écriture ne s’invente pas tout à fait comme une pure abstraction, elle est de la chair palpable, vivante.
Il m’arrive ainsi de lever les brouillards posés sur les yeux de l’enfant en les mesurant à mon regard adulte, de façon un peu désordonnée, forcément, mais le lecteur, à son tour archéologue puisque mis en présence de traces anciennes, saura reconstituer avec tout ça des paysages doués de paroles et d’acteurs cohérents. Et s’il ne reconstitue pas exactement les mêmes paysages ou les mêmes acteurs que ceux remis sous les feux du présent par mon travail de mémoire, l’importance en est nulle et c'est tant mieux.
En écriture, comme en archéologie, comme en toponymie, comme en géographie descriptive, il faut laisser des chemins individuels ouverts, de petites musses praticables et par où la poésie et l’imagination personnelles pourront voler de leurs propres ailes. Il n’y a pas plus ennuyeux qu’une œuvre où tout est balisé ! Il n’y a pas plus moche en littérature qu’un auteur qui enferme son lecteur, le tient en laisse et l’oblige à le suivre pas à pas.
J'en reviens donc à un court passage (Première partie, chapitre 6) du roman que j'ai actuellement en chantier, une discussion entre un néophyte et une jeune archéologue, car cela vaut pour l'écriture, selon moi :
- [...]
- Si je partageais votre vision des choses, je ne me passionnerais pas à fouiller l’histoire des hommes, à gratter sur les témoignages de leur cheminement. Je ne ferais pas ce métier. Vous comprenez ?
- Trop bien, Maryse.
- Que voulez-vous dire ? Elle sourit, mais eut un petit geste d’agacement.
- Que vous êtes une artiste de la mémoire, que vous savez dater, situer, faire parler des morts ensevelis sous notre terre depuis des millénaires, que vous êtes perfectionniste dans vos approches et vos conclusions, mais que vous ne savez pas penser par-delà ce que vous voyez, savez, croyez et touchez, bref, que vous êtes incapable de bâtir des légendes.
Les chemins creux du Grand Meaulnes, les bois et les rivières, les prairies, le bourg, l’école, le grenier et le vieux manoir de la Fête étrange, nous les avons construits en suivant les yeux portés sur eux par l’écrivain, certes, mais aussi et surtout en suivant nos propres chemins, nos propres prairies, notre propre école et les propres rêveries de notre adolescence. En faisant notre archéologie à nous.
Et c’est bien là toute la magie créatrice d’un livre et, peut-être, un des enjeux majeurs de la littérature.
18:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
27.08.2016
L'écriture et le Grand Meaulnes
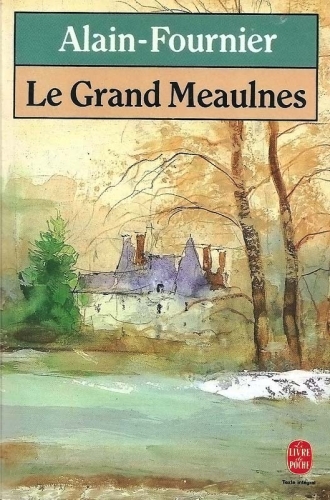 Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brouillards évanescents, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brouillards évanescents, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Le roman d’Alain Fournier peut dès lors être relu comme une allégorie d'une certaine écriture.
Cette écriture de soi-même, qui s’attache au passé, produit forcément des erreurs de parallaxe. Aussi restitue-t-elle difficilement l’heure exacte.
Car bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis que j’ai quitté les lieux de mon enfance et j’ai vu, visité, pratiqué, traversé et habité bien d’autres places qui en différaient fondamentalement. Ces lieux sont donc inscrits dans ma mémoire comme des morceaux de préhistoire. Mis en présence de l’orgueilleux présent ou confrontés à des passés moins obsolètes, ils se révèlent presque incompréhensibles.
En tout cas fortement décalés.
Pour vous les dire tels que je les ai vécus, c’est-à-dire directement et sans être l’objet de l’attention minutieuse que requiert l'écriture, il me faudrait abolir ce que j’ai dans la tête d’histoire accumulée, les dire avec les mots d’alors, ceux avec lesquels je les habitais et non avec ceux que j’ai appris par la suite et qui sont ceux que nous apprenons tous pour assumer l’exil des incontournables ailleurs.
Lorsque nous ne faisons plus corps avec les choses primaires.
Nos mots sont recouverts d’alluvions déposées sur eux par l’écoulement de la vie et la conscience qu’on eut de cette lente érosion. Ça s’appelle finalement la langue vivante. Villon, Marot et Rabelais ne nous seront jamais plus accessibles et fraternels que lus dans leur vieux langage. C’est donc une langue intermédiaire qu’il me faudrait. Une langue qui n’aurait pas encore eu à affronter les jungles et les amours, à déjouer les pièges du social, à riposter aux agressions et à mentir pour la survie.
Alors incompréhensibles ou banals vus d’ici, les paysages d’antan, mais de près, quand la question du sens à donner au voyage n’était pas encore explicitement posée, lieu d’apprentissage des chemins creux, des bois et des champs qu’enveloppaient les brumes de l’automne et lieu des premiers bonheurs d’exister sous les étoiles.
Les exigences de vivre viendront après.
Écrire, c’est un peu vouloir tenter la folle et désespérante expérience de vivre deux fois la même chose, comme Le Grand Meaulnes. C’est revenir en amont, remonter l’écoulement du fleuve par lequel on est arrivé jusque là, se pencher sur son lit, le débarrasser des alluvions déposées sur l’inaperçu ou "l’à peine entrevu" et tenter de ramener en pleine lumière le cours qu’emprunta finalement la fuite du temps.
Alors, à l’heure où vacille la lumière, à l’heure indécise entre le chien et le loup, à l’heure qui approche où il faudra tout de même se jeter dans les gouffres anonymes, indéchiffrables et chaotiques de l’océan, ils resurgissent souvent dans mes narrations, mes premiers paysages.
Ils sont la fête étrange dont je tente de retrouver le chemin…
17:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
23.08.2016
Le rat des champs

Jamais je n’ai su intégrer cette nécessité d’une organisation citadine, d’un quotidien de fourmilière, d’un espace forcément voué à la promiscuité et où la solitude physique - le corps confronté à l’espace disponible - ne peut s’opérer que sur soixante mètres carrés, payés le plus souvent à prix d’or.
Je vous vois déjà froncer le sourcil et soupirer que je m’embarque dans les ruelles éculées de la vieille dichotomie entre la ville et la campagne, que je vais mettre en vis-à-vis une beauté supposée et une laideur non moins supposée, que je vais opposer une poésie des lieux à une autre, les p’tits oiseaux mordorés des buissons aux pigeons merdeux, cacochymes et claudicants des places publiques, le parfum délicat des fleurs à l’odeur épaisse des fumées, l’air pur à la pollution et autres poncifs usés jusqu’à la corde.
Il y a peut-être un peu de tout ça – je n’ai, finalement, rien contre les poncifs - mais là n’est pas l’essentiel.
C’est ici la partie haute de l’iceberg.
D’autant que l’air pur est partout encombré, que les p’tits oiseaux mordorés depuis longtemps victimes de la destruction de leurs buissons se sont faits clochards citadins et, de granivores et d’insectivores, sont, pour beaucoup et suivant en cela l'évolution de l'espèce humaine, passés au stade de poubellivores, et qu’enfin le parfum du lisier n’est guère plus enjôleur que celui des tuyaux d’échappement ou des arrières-cuisines des restaurants huileux.
Mon sentiment serait plutôt organique. Ethnologique. Je suis né et j’ai vécu mes premières années d’illusions dans la campagne profonde des villages de la Vienne. C’est là que, pour la première fois, j’ai eu cette sensation indécise, délicieuse, et qui ne m’a jamais quitté, de la beauté primaire de la vie.
Cette sensation aussi d’une totalité, chacun étant le propriétaire absolu de sa chance de vivre.
Et si je suis alors à la recherche de mon temps perdu et de ma première forêt d’avant les mots pour la dire, c’est encore au milieu des campagnes que je les entends chanter le mieux, derrière tout le vacarme du monde.
Les paysages sont intégrés à mes émotions de vivre, qu’ils soient émaillés d’arbres nonchalants, qu’ils soient vastes champs nus déroulés sous la course du vent, vallons capricieux enroulés au creux des ombres, forêts aux fronts impétueux ou rivières décalquées sur une légère déclivité du terrain.
Les paysages ont des lumières qui indiquent l’heure et des couleurs qui disent les saisons. Ils sont capables de vous dire où vous en êtes. Dans leurs bras, je sais que je tournoie en même temps que le grand mouvement des choses…. Et je peux dès lors m’inscrire dans un projet, une envie, murmurer un échec ou saluer le retour d’un espoir.
Partout en ville je me suis senti à l’extérieur de moi-même, je me suis entendu penser, je me suis regardé marcher en quelque sorte, cherchant à régler ma marche sur la marche d’un monde, n’allant pas à mon pas mais au sien. Car la ville pour moi renferme cet affreux paradoxe de la multitude solitaire. Croiser des centaines et des centaines de gens par jour, gens qui, tout comme moi, ont leurs peurs, leurs espoirs, leurs chagrins, leurs bonheurs, leurs soucis, leurs secrets, leurs insomnies, leurs trahisons, leur sensation du bien, du mal, du laid et du beau, sans même leur dire «bonjour» participe, pour un sauvage de mon acabit, de l’absurdité première sur laquelle viennent se greffer toutes les autres.
Et je n’ai jamais pu me débarrasser tout à fait de cette première consternation : Tout jeune encore, vers cinq ans peut-être, ma mère m’avait conduit très loin, vraiment très loin, à Poitiers, c’est-à-dire à quarante-cinq kilomètres du village.
Il avait fallu se lever bien avant le jour, prendre son bol de lait à la hâte entre hypnose et réalité, aller à pied jusqu’à la Nationale 10, à travers les champs et les bois où dansaient des brouillards ruisselants de lune, attendre le car jaune des Rapides du Poitou, rouler longtemps dans la nuit, traverser des villages endormis, s’y arrêter, voir à travers le large pare-brise du chauffeur poindre enfin la première timidité d’une lueur avant d’être débarqués dans l’autre monde, grouillant de talons hauts et de fines bottines, sur des trottoirs plus larges que mes chemins d’école.
Ma mère me tenait par la main et se frayait un chemin entre tous ces gens empressés et muets. Elle me tirait et je sautillais pour suivre le mouvement et je souffrais d'avoir à tourner partout la tête, à droite, à gauche, derrière, en haut, pour faire exactement ce qu’elle m’avait enseigné et devait être respecté à la lettre sous peine de sévères représailles : dire bonjour madame et bonjour monsieur à chacun et chacune qui croisait mon chemin.
Fortement agacée par mon absurde civilité, elle finit par m’expliquer sans ménagements que la règle première de la politesse ne valait pas quand il y avait tant de monde !
La politesse, le commerce de la courtoisie, dont on me rebattait les oreilles jusqu'au dégoût, n'était donc qu'une question de nombre ! A plus de trois ou quatre, on avait le droit d'ignorer qu'on croisait des gens ; on avait le droit de n'en faire pas plus de cas que s'il se fût agi de pierres, de bouts de bois, de chiffons, de crottes de chien...
Cette affreuse découverte me fit sentir combien j’étais sur une autre planète, dans une sphère étrangère où les règlements n’étaient nullement semblables à ceux qui s’exerçaient au village.
De là à me convaincre que les tabous et les hommes n’y étaient pas les mêmes non plus, il n’y avait qu’un petit pas que je franchis allègrement.
Et ce fut assez lourd de conséquences et d'erreurs... De ces erreurs qui ont la vie dure.
13:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : écriture, littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
21.08.2016
Janów Podlaski - 2 -
 Un certain après-midi de la mi-novembre, j’avais décidé de venir photographier les chevaux lorsqu’on les libère et qu’ils jaillissent des écuries en troupeaux serrés vers les prairies, ceintes d’arbres antiques.
Un certain après-midi de la mi-novembre, j’avais décidé de venir photographier les chevaux lorsqu’on les libère et qu’ils jaillissent des écuries en troupeaux serrés vers les prairies, ceintes d’arbres antiques.
Une revue francophone éditée à Varsovie m’avait en effet demandé un article sur le célèbre haras et j’avais subodoré que quelques photos de ces ruées quotidiennes seraient très indiquées pour illustrer mon propos.
C’est en effet un beau spectacle que ces hordes de soixante à soixante dix pur-sang qui détalent au galop et qui, pour dégourdir leurs muscles impatients, ruent, hennissent, font des pétarades, sautent, cabriolent, se mordent et chahutent en faisant voltiger autour d’eux des mottes de pelouse ou des nuages de poussière, avant de se mettre tranquillement à paître, leur excédent d’énergie enfin consommé.
Mais les horaires sont stricts. Les chevaux sont sortis à treize heures pile et, poussés par les cris des palefreniers, rentrés à quinze heures non moins pile.
Il faisait déjà froid.
Une espèce de crachin bâtard, mixtion de neige et de pluie, hachurait la grisaille des campagnes quand je pris la route de Białystok, cap sur Janów. Je traversai plusieurs villages aplatis de silence et, à Zabrowiec, situé à une dizaine de kilomètres du haras, je dus soudain ralentir car tout un alignement de voitures, stationnées n’importe comment sur l’herbe du bas-côté, rétrécissait considérablement la chaussée, pourtant déjà réduite à la portion congrue. Je roulai donc au pas, craignant qu’il n’y eût là - comme d’habitude - quelque accident de la circulation. J’aperçus bientôt sur ma droite, à travers la bruine et la buée des vitres, des silhouettes bariolées qui zigzaguaient, allaient et venaient, se couraient les unes derrière les autres, se croisaient et se télescopaient parfois. C’était franchement jaune et c’était vaguement bleu. J’entendis aussi des cris et, soudain, un puissant coup de sifflet, décliné de toute évidence à l’impératif.
Je compris qu’on disputait là, dans le froid et la neige, un match de football.
Je rangeai donc tant bien que mal ma voiture parmi les autres, car ces joutes footballistiques inter-villages m’ont toujours beaucoup amusé et je n’avais jamais eu l’occasion d’en voir une en Pologne. Et puis, cela aussi me ramène à mes primes aurores, tout môme, quand mes grands frères jouaient à être de vaillants footballeurs. Je me souviens surtout des dimanches soirs où ils rentraient fourbus, l’échine en compote, les mollets tavelés de bleus ou le genou sanguinolent, quand ce n’était pas les orteils tuméfiés sur lesquels ils montraient, indignés, les stigmates douloureux d’un crampon adverse.
Dans une grande bassine d’eau bouillante, ils déposaient des lacets longs de deux mètres au moins, leurs maillots maculés, leurs chaussures crottées et, d’autant qu’il m’en souvienne, pestaient à peu près toujours la même chose : ils avaient perdu à cause d’un arbitre félon, auquel ils auraient volontiers cassé la gueule si les dirigeants du club, diplomates chafouins, ne les en eussent empêchés !
A Zabrowiec cependant, loin, très loin de mes vapeurs archéologiques, les joueurs couraient comme des dératés et des bouffées épaisses de vapeur s’échappaient par saccades de leur bouche entrouverte. On eût dit de petites locomotives énervées. On percevait le souffle court de leur respiration et le contact brutal de leurs crampons sur la pelouse gelée. Parfois même sur le tibia d’un gars qui, aussitôt, se roulait par terre comme un blessé mortellement atteint et en poussant des hurlements de détresse, immanquablement suivis des protestations vindicatives des spectateurs emmitouflés dans de lourdes pelisses, cigarette au bec, et qui tapaient du pied et qui gueulaient sans cesse, exhortant ou gourmandant, ceux-ci les jaunes, ceux-là les bleus.
Je ne m’attendais certes pas à un match de légende ! Mais tout de même à quelques belles phases de jeu, à une ou deux passes astucieuses et à un ou deux tirs au but qui auraient fait mouche ou qu’un gardien aurait bloqués d’une savante roulade. Je patientai longtemps et plus je patientais plus je sentais vaguement qu’il y avait quelque chose d’insolite dans la façon dont se déroulait cette partie.
Je jetai un coup d’œil alentour et pris soudain conscience que tout le monde ici, les joueurs, les arbitres, les spectateurs et moi-même avions le plus souvent la tête levée vers les nuages et les intempéries ! Je ne pus dès lors retenir un grand éclat de rire, qui fit à mon plus proche voisin faire une moue interloquée.
Le clou du spectacle était pourtant bien là : dans tous ces gens qui regardaient en l’air, comme s’ils bayaient aux corneilles, qui frétillaient du chef, en avant, en arrière, à gauche, à droite, comme des pantins, et qui allongeaient le cou, le cabraient, le rentraient et le faisaient pivoter d’un côté sur l’autre, le tout dans un ensemble parfaitement rythmé. On eût juré qu’ils suivaient des yeux, là-haut dans l’averse grise et blanche, un objet volant qui aurait fait des loopings et des acrobaties en risquant de leur tomber à tout moment sur le coin de la figure, et tout ça parce que, en bas, aucun des valeureux gladiateurs du dimanche, qu’il arbore tunique jaune ou tunique bleue, ne réussissait jamais ni à garder la balle au pied ni à la clouer au sol !
Elle s’obstinait donc à voltiger en l’air, la bougresse et, telle une baudruche gonflée à l’hydrogène, semblait refuser avec acharnement les lois de la pesanteur. Dès qu’elle avait quelques velléités de toucher la terre, on frappait dedans à la sauve-qui-peut, comme pour s’en débarrasser au plus vite, et elle s’envolait derechef dans les airs, elle tournoyait, elle voltigeait, elle toupillait, elle s’élevait très haut et elle retombait bientôt sur la tête d’un gars, voire sur son échine courbée, lequel gars, épouvanté de la voir déjà là, la réexpédiait aussitôt dans les airs, parfois d’une ruade absolument grotesque et ainsi de suite...
De toute évidence, on rivalisait ici d’ingéniosité à qui ferait la chandelle la plus lumineuse ! On en avait oublié que le but du jeu était de l’expédier au fond des filets, à droite ou à gauche, cette satanée balle !
On ne visait que les nuages enneigés.
Je restai longtemps là, à rêver et à ricaner comme un perdu. Bien trop longtemps.
Il neigeait vraiment quand enfin l’arbitre moustachu réussit, non sans mal, à s’emparer de cette foutue montgolfière et à expédier tout ce beau monde aux vestiaires. Il neigeait sans pluie et la route était déjà blanche. Le vent soufflait plus fort et les arbres noirs des talus s’agitaient sous des nuées de flocons épais, obliques et serrés. Je roulai donc très doucement et arrivai bientôt aux portes du haras…
Fermé !
Il était quinze heures, passées de quelques minutes ! J’hasardai un œil à travers les lourdes grilles. Les prairies ensevelies sous la neige étaient silencieuses et désertes et, de chaque côté des allées, les belles écuries blanches et vertes, posées sur toute cette immobilité gelée, étaient verrouillées à double tour.
Je me traitai de triple idiot et restai planté là tout un moment, les bras ballants, mon appareil-photo de reporter à la ramasse dans les mains, désappointé, sous la neige qui me picotait le visage !
Tristes et froides, rampaient déjà les premières ombres de la nuit : le bal grotesque de quelques bourriques du football m’avait privé du ballet princier des chevaux pur-sang.
Mais il est vrai que j'avais fait un long, un très long détour par les chemins qui musardent au pays des enfances, toujours pavés de mélancolie enjouée.
09:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
14.08.2016
Janów Podlaski
 A deux ou trois cent mètres environ des prairies riveraines du Bug, s’alignent de part et d’autre de la rue Piłsudski, les premières habitations, le plus souvent en bois, de Janów Podlaski, éponyme du premier évêque des lieux, Jean, Jean de Podlachie exactement.
A deux ou trois cent mètres environ des prairies riveraines du Bug, s’alignent de part et d’autre de la rue Piłsudski, les premières habitations, le plus souvent en bois, de Janów Podlaski, éponyme du premier évêque des lieux, Jean, Jean de Podlachie exactement.
La bourgade, qui compte aujourd’hui un peu plus deux mille âmes, fut autrefois une ville ; une ville florissante même, si l‘on en croit le torse légèrement bombé de quelques historiens locaux. C’est sans doute vrai puisqu’elle qu’elle fut donc un évêché, en témoigne, outre son nom, l’église dressée sur la place dite centrale et qui est, en fait, une cathédrale.
Mais il faut que ce soit le dit. Parce que de prime abord pas grand-chose, ni dans son architecture ni dans ses dimensions, ne la distingue d’une église paroissiale ordinaire. Cette mémoire-là est donc essentiellement catholique. Si vous arrivez ici en visiteur et si on commence par vous faire l’éloge de La ville de Jean, celui qui fut évêque et qui dota la ville d’une cathédrale, c’est bon, vous êtes en présence d’un pour qui l’histoire, c’est d’abord l’histoire de l’Église. Ce qui n’est pas faux du tout du tout et ce qui vaut, d’ailleurs, pour à peu près l’histoire de l’Europe toute entière.
Un autre cependant, tourné vers un passé plus récent ou animé de dispositions un tantinet plus laïques, vous parlera d’abord de la première constitution née en Europe et inspirée des idées révolutionnaires françaises. Mal gré qu’il en ait, il ne pourra cependant pas contourner Rome : Adam Naruszewicz en effet, philosophe, poète, historien, qui fit – c’est important de le souligner puisque vous êtes un visiteur français - ses études chez les jésuites de Lyon, était un évêque et participa, ici même, oui monsieur, ici à Janów Podlaski, à la rédaction de la constitution du 3 mai 1791, tellement importante dans l’esprit du peuple polonais que ce 3 mai est aujourd’hui notre 14 juillet à nous.
Une constitution clandestine, rédigée à la barbe du tsar, et réprimée dans le sang...
Votre hôte, ou votre guide, vous conduira alors, c’est quasiment certain, par un sentier de sable musardant sous de vénérables tilleuls plusieurs fois séculaires, devant un petit monument de pierres en forme de dôme, plus grand mais malgré tout comparable à ceux qu’on voit encore, quoique de plus en plus rarement, le long des vieilles routes de France, et qui jadis servaient d’abris aux cantonniers. Adam Naruszewicz avait fait bâtir là cette minuscule retraite pour venir y méditer, écrire et réfléchir aux malheurs de sa patrie asphyxiée, la gorge prise entre les serres du tsar de toutes les Russies. Janów était alors russe, vous renseignera votre guide, en montrant d’un geste vague la Biélorussie, de l’autre côté de la vallée du Bug, au-dessus de laquelle vous verrez sans doute tournoyer avec élégance quelques vanneaux huppés ou, avec un peu plus de chance, un aigle pomarin.
Mais peut-être tout ceci vous ennuiera-t-il un peu, alors vous réprimerez, par pure courtoisie, un petit bâillement. Car vous êtes venu jusque là, non pas pour marcher sur les pas d’une ancienne célébrité de Janów, mais pour rencontrer sa célébrité présente. C’est votre amour pour les chevaux de race, les pur-sang arabes aux galbes princiers, au port altier à nul autre comparable, qui vous a conduit ici.
Vous vous dirigerez donc bientôt par une fière allée bien ombragée, vers le haras le plus coté de Pologne et même d’Europe. Vous apercevez déjà, à travers le feuillage épais des buissons, un peu à l’écart de la bourgade en descendant vers la rivière-frontière, l’alignement des écuries blanches et vertes, les enclos et les prés où caracolent de superbes chevaux, l’encolure hautaine, la queue relevée en arc de cercle et d’un trot si léger qu’on dirait que leurs sabots ne touchent pas terre.
Janów est connu dans toute la Pologne, et bien au-delà, pour ce haras et c’est là qu’affluent, chaque année au mois d’août, les éleveurs et les amateurs les plus fortunés du monde, pour deux journées d’enchères, aux montants vraiment astronomiques. Le Président de la République en personne honore souvent la manifestation de son auguste présence et si Janów et sa cathédrale vous ont un peu agacé, trop tournés vers l’histoire religieuse à votre goût, vous apprendrez de la bouche de votre accompagnateur que le haras a lui aussi son pape, mais du rock and roll celui-là, en la personne de Charlie Watts. Chaque année, le célébrissime batteur vient en effet ici pour y acquérir, parmi les spécimens les plus élégants et les plus recherchés, quelques pur-sang arabes.
Je soupçonne d'ailleurs certains visiteurs de se rendre à ces journées d'enchères non pas pour les chevaux, aussi magnifiques fussent-ils, mais en nourrissant l’espoir d'apercevoir - ne serait-ce que de loin et très brièvement - dans la foule des connaisseurs ou sur les gradins réservés VIP du manège où toutes ces splendeurs chevalines sont présentées, la crinière blanchie sous le harnais du Rolling Stone, véritable icône des années soixante-dix.
Personnellement, je ne suis jamais allé à cette grande kermesse annuelle du haras de Janów. Charlie Watts, je le vois tous les ans en photo sur les catalogues édités immédiatement après la vente aux enchères, dans le journal local, sur le site internet du haras, et, toute l’année s’il m’en prenait fantaisie, je pourrais le contempler à mon aise sur les murs du restaurant où il a dîné, comme dans les couloirs de l’hôtel où il a dormi… Il caresse toujours les naseaux d’un splendide étalon ou il flatte une croupe. Et il sourit.
Les légendes sourient toujours quand elles sont occupées à leur entretien.
Je ne vais donc pas à la kermesse, parce que je n’aime ni l’anonymat tapageur des foules, ni les lieux de rendez-vous des grosses fortunes, ni les étoiles quand elles brillent ailleurs qu’aux firmaments… En revanche, j’aime les chevaux. Non pas que je sache les monter ou conduire un attelage, non plus que je sois un enthousiaste des courses ou des prouesses techniques des concours hippiques, encore moins un amateur de polo ! Non, rien de tout cela. Je les aime de loin, les chevaux, quand ils ne servent à rien, sinon à brouter un morceau de paysage. Par pur esthétisme. J’aime la puissance gracieuse de leurs mouvements, j’aime l’orgueil de leur maintien, surtout là, à Janów, où naissent et grandissent les plus raffinés d’entre eux. J’aime ce qui peut surgir d’impétuosité quand ils s’élancent au grand galop et j’aime aussi leur odeur, sauvage, l’odeur du foin, de la paille, du crottin, de la sueur animale. L’odeur des râteliers aussi, qui me ramènent très loin, vers les fermes poitevines de mon enfance, aux premiers matins du voyage…
Et c’est surtout l’hiver, saison où les paysages ne sont revêtus que de l’essentiel, que je viens rêvasser ici, parmi les chevaux, les allées, les prairies et les écuries d’une irréprochable tenue. Ce haras, en outre, est lié - même si c’est de façon peu glorieuse - à l’histoire de mon pays. La construction en fut en effet ordonnée par le tsar en 1817 car, après les invasions successives du conquérant au célèbre bicorne, l’est de l’Europe n’avait pratiquement plus un seul canasson debout. Et une région sans canasson, à cette époque-là, c’était une région ouverte, à découvert, sans défense, à la merci de la moindre agression.
A ce propos d’ailleurs, je suis assez perplexe devant les détours inopinés qu’emprunte parfois l’histoire : on voulait ici remonter une armée, s’occuper de défense nationale, et on en est venu à faire œuvre d’art, à soigner, bichonner, sélectionner, améliorer la silhouette et l’allure, jusqu’à la perfection, d’animaux qu’on destinait en premier lieu à être réduits en charpies sanguinolentes sous les coups de sabres et le feu nourri des canons.
15:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (14) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.08.2016
Comment on rate son éternité quand on a raté son temporel

Raymond avait pourtant tout, mais vraiment tout, pour jouir du bonheur de vivre. D'un bonheur sans grande prétention, certes, mais d'un petit bonheur quand même.
De ces petits bonheurs pépères qui font les hommes anodins, niaisement gentils, qui passent inaperçus, qui ne laissent pas grande trace sur leur époque et qui vont leur route sans embûches, à l’abri des soucis cuisants, sans drames profonds et sans joies trop immenses.
Jugez-en plutôt:
- une épouse généreuse, aux appas, ma foi, bien sympathiques, dont il resta toute sa vie raisonnablement amoureux,
- deux filles sans problème majeur, studieuses, sérieuses, ni mélancoliques, ni dévergondées,
- une maison coquette plantée au bord d’une rivière limpide, dans les eaux de laquelle on pouvait se mirer à loisir,
Ajoutez à tout cela un travail, sinon passionnant, du moins pas trop abrutissant, correcteur dans un journal local, Raymond ne présentait pas, vous le voyez, de traits particuliers qui méritassent qu’on lui consacrât une histoire.
Hé bien si ! Quoi donc ? Son nom ! Son nom ?
Oui, son nom : Raymond Formidable. Ce patronyme lui fit en effet endurer, on le sut bien après, un calvaire intime des plus insupportables.
Dès les premiers bancs d’école, qu’il commette une erreur ou qu’il donne la juste réponse :
- Ah, mais c’est Formidable, ça !
Entre copains :
- Qu’est-ce que tu fais de Formidable, aujourd’hui ?
Entre amis :
- Rejoins-nous au mois d’août, ce sera Formidable !
Au bureau :
- Ah, tu as déjà corrigé les épreuves ? Formidable !
A la boucherie :
- Cinq cents grammes de ce pâté aux fines herbes ? Vous m’en direz des nouvelles, Formidable !
Au téléphone :
- Oui, j’écoute…
- C’est Raymond.
- Ah, c’est toi ? Formidable !
Une fois, même - mais une petite fois seulement - au tout début de son mariage, un dimanche matin, en robe de chambre, au petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée et alors qu’il avait demandé, provocateur et coquin:
- Alors, c’était comment, ma chérie, hein, dis-moi…Hein ?
- Quoi donc, mon poulet ?
- Ben...Heu...Hier soir...C'était comment, ma biche ? Pas mal, hein ?
- Hier soir ? Ah, hier soir ! Ben...Oui, chéri, ça n'était que Formidable !
Raymond avait songé bien des fois à saisir le Tribunal de Grande Instance pour changer ce satané patronyme. Mais il répugnait aux formalités administratives, c’était long et c’était coûteux, et puis, sa pragmatique et généreuse épouse l’en dissuadait à chaque fois en badinant que ça n’était rien, mon pauvre biquet, que certains s’appelaient bien Bitaudeau, tu te rends compte, hein ? Bitaudeau..! Tu te vois, toi, affublé comme ça ? Bonjour, monsieur Bitaudeau ! Comme c’est vulgaire !
Et d’autres, même, Anus, qu'ils s'appellent. T’imagines t’appeler Anus, toi ? A demain, cher Anus… Il y en a même que c’est Cocu…Là, c’est le bouquet ! Tu entends ça ? Allô ? C'est bien toi, Cocu ?
Et là, c'était incoercible - allez savoir pourquoi ! - madame Formidable partait à chaque fois d'un grand éclat de rire ; un rire qui durait trop longtemps au goût de monsieur Formidable.
Non, chéri, tu te fais vraiment du mauvais sang pour pas grand chose…A côté, Formidable, c’est quand même un nom formid…
Soit. Il y avait peut-être pire en fait de noms désobligeants, mais Raymond n’en souffrait pas moins du sien. Et bien plus qu’il n’y laissait voir. Ces incessants quolibets lui pourrissaient littéralement la vie. Eût-il voulu se révolter contre les plaisantins faciles qu’il eût dû se fâcher avec tout le monde et rien n’était moins dans sa nature que le goût de l’affrontement (!)
Il intériorisait donc tout ça, ruminait sa tristesse et courbait l’échine sous les facéties verbeuses.
Alors il choisit de se venger de ce nom qui lui avait gâté son p'tit bonheur. En ne l’immortalisant pas, en le tuant, en le faisant disparaître avec lui, ses deux filles ayant pris la sage précaution de se marier et son épouse - trouvant sans doute que tout ça n’était finalement pas tout à fait formidable - ayant pris la clef des champs et s’étant remariée avec un type qui, soit dit en passant, avait eu le bon goût de s’appeler, lui, monsieur Gentil. Ben oui, ça ne s'invente pas, tout ça !
Vers la fin de sa vie, donc, sentant de plus en plus la fraîcheur de l’automne descendre sur ses maigres épaules, Raymond Formidable fit testament de ce qu’on n’inscrirait pas son patronyme sur sa pierre tombale et qu’en lieu et place on graverait une phrase, une phrase forte, une phrase exacte :
Ci-gît un homme qui n’avait pourtant jamais trompé sa femme
Et des années et des années durant, longtemps, longtemps après que toute la famille eut disparu sous les grands tableaux noirs du temps qui passe, quand la tombe ne fut plus même qu’une pierre ruisselante de mousse zébrée par les herbes sauvages de l’éternel oubli, ceux et celles - celles surtout - qui venaient à passer par là, sur cette allée silencieuse au bord de laquelle reposait Raymond depuis des temps et des temps, ne pouvaient s’empêcher de s’arrêter un moment, émus ou émues jusqu’aux larmes, et de s’écrier :
- Ça alors, c'est formidable !
Histoire écrite en février ou mars 2009
Image : Philip Seelen
11:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
05.08.2016
De l'idéologie comme idéologie
 Au cours de discussions diverses, il m’est maintes fois arrivé de me rendre compte que lorsque je prononçais le mot «idéologie», mon interlocuteur entendait bien autre chose que ce que je voulais lui dire.
Au cours de discussions diverses, il m’est maintes fois arrivé de me rendre compte que lorsque je prononçais le mot «idéologie», mon interlocuteur entendait bien autre chose que ce que je voulais lui dire.
Pour lui en effet, à chaque fois, idéologie signifie un système homogène d’idées, voire d’idéaux, une conviction éthique, morale, politique, humaniste ou non, mais guidant une action et présidant à une façon d’être.
Par exemple et pas par hasard: un jour, je dis l’idéologie socialiste dans le corps d’une conversation avec un camarade. Ce camarade m’interrompit et voulut me rectifier.
- Les socialistes n’ont plus d’idéologie.
- Hélas, si ! Ils n'ont même que ça ! que je m'esclaffai à sa grande surprise.
Ce camarade, comme bien d’autres, avait tout bonnement confondu idéologie et poursuite d’un idéal, alors que l'idéologie est une grille de lecture du monde, une grille établie une fois pour toutes par des idées et qui n’est plus adaptée à ce monde, sinon pour l’interpréter à l’envers.
Dès lors, ce n’est plus le monde qui est lu par la grille mais la grille par le monde, lequel doit donc, à coups d’erreurs, d’omissions et surtout de mensonges, venir corroborer coûte que coûte la justesse de la grille.
L’idéologie n’est donc pas une idée. C’est même tout le contraire d’une idée en ce qu’elle est une force matérielle qui, victorieuse d’autres idéologies, s’impose ou tente de s’imposer à tous comme mode de vie et comme mode de pensée.
L’idéologie est un raccourci dont le dessein est une justification a posteriori ou une condamnation a priori de l’état du monde.
C’est, à mon sens, Shakespeare qui la définit le mieux, je ne me souviens même plus dans quel texte : Si les faits disent le contraire, nous modifierons les faits.
Mais c’est un vieux débat, que j’illustrerai ainsi.
Être situationniste en 1970, c’était se sentir viscéralement concerné par la justesse et l’intelligence d’une théorie pourfendant l’idéologie. C’était la sentir vivre en soi, l’avoir éprouvée dans ses propres frictions au monde.
L’être en 2016 - alors que cette théorie n’a plus aucune complicité avec la réalité quoiqu’elle ait laissé derrière elle les stigmates toujours signifiants de sa tentative de destruction du monde spectaculaire, - c’est lire ce monde avec une grille de lecture qui a abandonné la recherche théorique pour se faire idéologie.
Quant à l’idéologie libérale, je ne vous en parle pas : vous la vivez tous les jours.
Elle se vit comme le syndrome de Stockholm: l’anormalité des choses est vécue comme une incontournable normalité et cette anormalité remet en cause, non pas les choses, mais l’individu qui les ressent comme anormales.
12:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
















