27.08.2016
L'écriture et le Grand Meaulnes
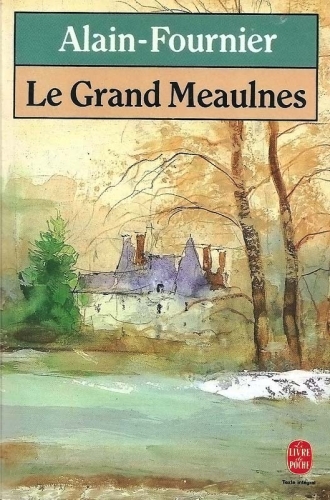 Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brouillards évanescents, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brouillards évanescents, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.
Le roman d’Alain Fournier peut dès lors être relu comme une allégorie d'une certaine écriture.
Cette écriture de soi-même, qui s’attache au passé, produit forcément des erreurs de parallaxe. Aussi restitue-t-elle difficilement l’heure exacte.
Car bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis que j’ai quitté les lieux de mon enfance et j’ai vu, visité, pratiqué, traversé et habité bien d’autres places qui en différaient fondamentalement. Ces lieux sont donc inscrits dans ma mémoire comme des morceaux de préhistoire. Mis en présence de l’orgueilleux présent ou confrontés à des passés moins obsolètes, ils se révèlent presque incompréhensibles.
En tout cas fortement décalés.
Pour vous les dire tels que je les ai vécus, c’est-à-dire directement et sans être l’objet de l’attention minutieuse que requiert l'écriture, il me faudrait abolir ce que j’ai dans la tête d’histoire accumulée, les dire avec les mots d’alors, ceux avec lesquels je les habitais et non avec ceux que j’ai appris par la suite et qui sont ceux que nous apprenons tous pour assumer l’exil des incontournables ailleurs.
Lorsque nous ne faisons plus corps avec les choses primaires.
Nos mots sont recouverts d’alluvions déposées sur eux par l’écoulement de la vie et la conscience qu’on eut de cette lente érosion. Ça s’appelle finalement la langue vivante. Villon, Marot et Rabelais ne nous seront jamais plus accessibles et fraternels que lus dans leur vieux langage. C’est donc une langue intermédiaire qu’il me faudrait. Une langue qui n’aurait pas encore eu à affronter les jungles et les amours, à déjouer les pièges du social, à riposter aux agressions et à mentir pour la survie.
Alors incompréhensibles ou banals vus d’ici, les paysages d’antan, mais de près, quand la question du sens à donner au voyage n’était pas encore explicitement posée, lieu d’apprentissage des chemins creux, des bois et des champs qu’enveloppaient les brumes de l’automne et lieu des premiers bonheurs d’exister sous les étoiles.
Les exigences de vivre viendront après.
Écrire, c’est un peu vouloir tenter la folle et désespérante expérience de vivre deux fois la même chose, comme Le Grand Meaulnes. C’est revenir en amont, remonter l’écoulement du fleuve par lequel on est arrivé jusque là, se pencher sur son lit, le débarrasser des alluvions déposées sur l’inaperçu ou "l’à peine entrevu" et tenter de ramener en pleine lumière le cours qu’emprunta finalement la fuite du temps.
Alors, à l’heure où vacille la lumière, à l’heure indécise entre le chien et le loup, à l’heure qui approche où il faudra tout de même se jeter dans les gouffres anonymes, indéchiffrables et chaotiques de l’océan, ils resurgissent souvent dans mes narrations, mes premiers paysages.
Ils sont la fête étrange dont je tente de retrouver le chemin…
17:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET

















Commentaires
Cher Bertrand,
Le grand Meaulnes
Un des livres de mon adolescence que j'ai beaucoup aimé
Fournier écrivait d'une manière remarquable
Bon dimanche
Écrit par : george | 28.08.2016
Eh ben voilà !
Un texte qui dit la littérature, l'écriture... C'est ça l'invention, la pensée qui s'invente sous nos yeux grâce à de l'écriture. Ce texte qui n'existe que sous la plume de Bertrand Redonnet, invention de la plus belle espèce, c'est pour ça qu'on achète des livres. Pour lire ÇA.
Et autant d'écrivains, autant de bonheurs, ça n'en finit pas. Et quand ça n'en finit pas, quand ce n'est jamais pareil, ça s'appelle de l'invention. (C'est Rouaud, encore lui, qui a écrit "L'invention de l'auteur". Comment ça s'invente un auteur ? lui, bien sûr).
Et moi qui n'avais jamais réussi à lire Erri De Luca, (ça ne m'attrapait pas, c'est comme ça, chacun ses chemins, comme il peut, quand il peut), je lis son dernier opus "Le plus et le moins", une écriture qui te laisse sur le c.., scotchée comme devant une peinture dont tu te demandes si c'est possible. Et ce n'est pas une écriture extravagante, ce n'est pas une recherche avant-gardiste, c'est des mots tout ce qu'il y a de plus simples, que tout le monde connaît, eh bien pourtant, c'est du jamais vu. Une émotion intense à se mettre ça sous les yeux, ça t'explose la cervelle :)
Écrit par : Michèle | 28.08.2016
Et ce dont il parle De Luca, c'est sa vie. Ce que tu dis dans ton texte. Il remonte lui aussi le fleuve. Il parle de son premier pantalon long qu'il a réclamé avec insistance, quand il a compris "l'inconsistance des autorités, des hiérarchies officielles" : pour son premier devoir "libre", à écrire en classe, inventer une fable -dans quoi il s'est lâché à corps perdu, et sa famille à qui il l'a lu a été estomaquée pas tant du contenu mais du débondage - le prof lui a mis une note en-dessous de la moyenne, estimant que l'élève, échappant à sa vigilance, avait copié dans un manuel de dissertation.
Dans un autre texte, (le livre est fait de textes), De Luca parle des ouvriers (qu'il voyait enfant depuis sa fenêtre, travaillant dans un chantier de démolition, -ainsi que de l'ouvrier qu'il a été) : mamma mia, tu lirais ça ! Tu te sens craquer de partout. Ta peau ne peut plus te contenir.
Écrit par : Michèle | 28.08.2016
Ce chapitre (ou texte) sur les ouvriers, intitulé "Les chapeaux en papier", il faut le découvrir le livre en mains, quand on est prêt, qu'on en a envie.
Mais il y a un chapitre que j'ai envie de recopier ici (il fait 4 pages), pour donner une idée, - je garde la mise en page du texte - :
Un livre et un mauvais sort
C'était l'hiver 1980-1981 dans la ville de
Naples désemparée après un tremblement de
terre, dans un chantier de l'urgence du bâti-
ment, une paie de 25000 lires (1) par jour. J'avais
trente ans et un sillage de compagnons perdus
derrière moi, une foule, des années de lutte, de
noms et pas de quoi revenir en arrière.
(1). 12,50 euros
Beaucoup de mes camarades plongeaient des
aiguilles dans leurs veines, parce que le vin tue
trop lentement et qu'ils étaient pressés. Moi, je
ne savais pas faire comme eux, mon corps était
trop fatigué le soir pour lui en demander plus.
J'avais besoin de pages à tenir en main comme
un verre et de m'y plonger la tête la première
jusqu'au terminus. Sur un drap par terre, une
vente de trottoir, parmi des livres d'occasion,
j'avais ramassé Céline, un salaud à prendre et à
flanquer au panier.
Voyage au bout de nuit,voyons un peu ce que
tu en sais toi, Louis-Ferdinand, de ce wagon à
bestiaux qui nous a pris en charge et qui nous a
dispersés et répartis en putains et prisonniers.
A trente ans, je croyais connaître déjà la vie,
je cherchais seulement un peu de compagnie.
Je pouvais la prendre dans les livres, je pouvais
m'en prendre à eux. Combien en ai-je jetés, en
quelques pas du drap à la poubelle, ils ne coû-
taient rien, je les ouvrais et au bout de quelques
pages : va-t'en donc. Quel paquet de pages pou-
vait résister à un lecteur qui voulait s'étourdir et
se battre avec les restes des écritures des autres ?
C'est ton tour, Louis-Ferdinand, voilà tes deux
cents pas, d'ici à l'arrêt où se trouve le tas de
déchets qu'on enlève quand on y pense.
Et en fait rien : je l'ai lu jusqu'à la dernière
ligne et alors seulement je l'ai jeté aux ordures,
mais par amour, pour ne plus avoir à partager
avec un autre moi-même, des années plus tard,
la tentation d'une relecture.
Je ne veux plus savoir pourquoi ce livre a sou-
tenu mon mauvais sort pendant l'hiver du trem-
blement de terre de 1980, sur le chantier et
dans les dysenteries de la ville qui se vidait dans
les rues. Je ne veux rien savoir du moi-même
d'alors, et un livre sert justement à ça, à effacer
les jours.
"Qu'est-ce que tu as dans ton sac, la Bible
des protestants ?" me demanda un vieil ouvrier
quand le livre tomba de mon sac à midi, tandis
que je prenais ma gamelle remplie de pâtes.
Pas de réponse, je n'étais pas capable de sortir
une maudite phrase entre bonjour et bonsoir.
Mais je me souviens encore de la voix un peu
ironique : " La Bible des protestants ? " Que
j'étais quelqu'un à laisser tomber, il l'avait
compris, il m'avait donc fait " protestant ". Et
puis, il y avait aussi un livre, un ouvrier avec un
livre devait être un subversif, alors il était clair
qu'il devait s'agir de la Bible de ceux comme
moi. Des années sont passées par douzaines, s'il
vit encore cet homme a dû oublier, mais pas
moi, je me souviens de lui à cause de cette
phrase. Depuis lors, dans ma tête, le voyage de
Louis-Ferdinand a comme sous-titre " la Bible
des protestants ". Céline ne protestait pas, il par-
lait de sa jeunesse échappée au massacre du
front allemand, échappée sans justification, non
par lâcheté, non par vertu, seulement par un
hasard écœurant.
Il n'avait plus ni paix ni place et il dérapait
entre l'Afrique, les malades, les femmes, avec
un fond de rancœur parce qu'il ne ressentait
plus de haine. Céline l'avait écrit et il avait
joué du fifre au groupe d'écrivains de sa géné-
ration, les entraînant tous à sa suite pour jeter
à la mer les livres des autres, comme Hamelin
l'avait fait avec les rats. Son livre résistait entre
mes mains sales, sommairement lavées, arra-
chant des pages en les tournant parce que ni
mes doigts ni mes paumes ne sentaient plus
rien. Seul Louis-Ferdinand me convenait ces
mois-là, seul son Voyage tenait compagnie à
mon va-et-vient. Et après, je n'ai plus rien lu de
lui qui vaille ce ton de vie empoisonnée, volée
aux autres du seul fait d'avoir survécu, une vie
restée au-dessus d'un amas énorme de jeunes
de vingt ans abattus dans les fossés par le gaz
moutarde et les éclats d'artillerie.
Écrit par : Michèle | 28.08.2016
Merci, grand merci ! Quel texte ! J'en ai la chair de poule !
C'est ça, être un écrivain un grand : s'arracher les tripes, les jeter sur la table et que chacun y lise ses propres auspices !
Écrit par : Bertrand | 28.08.2016
Bonjour George;
Oui l'adolescence, mais il faut relire après. Je ne m'en suis jamais lassé, à différentes étapes. La dernière fois, je devais avoir déjà passé la cinquantaine
Écrit par : Bertrand | 28.08.2016
Merci Bertrand
Chacun ou chacune sa passion
Et sa génération
Au plaisir de vous lire
IL fait plus frais chez nous un regain d'énergie peut être ainsi va la vie tout doux doucement comme l'air du temps
ET surtout sans i Hi! Hi!
Amicalement
Écrit par : george | 29.08.2016
"C'est ça, être un écrivain un grand : s'arracher les tripes, les jeter sur la table et que chacun y lise ses propres auspices" Là, je suis bien d'accord. Car on écrit pour dire quelque chose (et les grands écrivains ont de grandes choses à dire). On écrit pour dénoncer, pour hurler et le style, forcément, suit.
Écrit par : Feuilly | 30.08.2016
Les commentaires sont fermés.