30.04.2017
A bian
 Ce point posé sur le grand mouvement circulaire du monde et des choses, quelques semaines seulement avant le passage de l'autre côté de l’équinoxe, m’évoque toujours peu ou prou, avec un décalage de quelques mois cependant, les marais poitevins d’où je suis venu.
Ce point posé sur le grand mouvement circulaire du monde et des choses, quelques semaines seulement avant le passage de l'autre côté de l’équinoxe, m’évoque toujours peu ou prou, avec un décalage de quelques mois cependant, les marais poitevins d’où je suis venu.
Car c’est bien au cœur de l’hiver que Lacus duorum corvorum liquéfiait ses paysages. Des brouillards sommeillaient au dessus de l'eau, les frênes têtards alignaient leur élégance rustique dans ce miroir impromptu, les vanneaux huppés et les mouettes du large s'y donnaient de criards rendez-vous.
Le marais est à bian, disait le paysan, doctement. Comme toujours. En fait, je n’ai jamais trop su ce que signifiait ce à bian. A blanc, ça c’est certain, car c’est bien ainsi qu’est dit le blanc en patois poitevin. Une vache bianche. Une robe bianche. Le marais est blanc, alors, pour dire qu’il est recouvert d’eau et que le ciel livide des mortes saisons s’y reflète ? Un parler uniquement figuratif ?
Hum... Ce serait beau. Mais le paysan n'aime pas trop le figuratif. Il préfère nettement quand les choses ne l'abusent pas de leurs reflets.
Ou alors, le marais est exsangue, a été saigné à blanc, par allusion à une vieille expression du XVIe, «mettre au blanc», pour dire ruiner. Mais en quoi l’eau étalée sur son dos aurait-elle ruiné le marais ? Peut-être parce qu'il est une terre gagnée sur le vieil océan, une terre conquise par l’eau canalisée, domptée dans les conches et les fossés et que, tout à coup, cet océan reprendrait sa revanche et ses vieux droits, ruinant du même coup le travail des siècles et des hommes. Tiré par les cheveux ? Oui, un peu... En tout cas, le maraîchin avait sans doute d’ataviques raisons, des raisons de langage, des raisons de mots lustrés par la mémoire du monde, pour dire que les marais étaient à bian.
Les termes alors s’entrechoquent d’une longitude à l’autre. Ici, c’est précisément lorsque le blanc par excellence, celui de la neige, prend congé, que les paysages sont à bian. Sur les rives de ces lacs éphémères, j’imagine, amusé, qu’un maraîchin dise à un autochtone que les paysages sont à bian. Et que ces deux-là ne se comprennent que par le sens premier de leur musique respective…
Car sous ce bleu miroitant des équinoxes continentaux, sous cette nappe d’eau comme un point final écrit au bout de la morte saison, ce ne sont pas les paysages qui sont à bian. C’est l’hiver qui n’est plus blanc. Ruiné. Exsangue. Privé de son essentiel.
L'hiver blanc est à bian.
Comme quoi, on doit toujours retourner sept fois la langue dans son histoire avant de lui faire prendre le large. Avant de lui donner délégation à dire le monde.
15:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
25.04.2017
D'un bolchevisme à l'autre
 Autrefois, quand j’étais en colère contre les communistes – disons pour être plus précis et plus juste les staliniens - je leur conseillais avec véhémence de prendre un train pour Bucarest, Varsovie ou Moscou et d’aller de la sorte un peu rafraichir dans leur tête des idées qui, à l’évidence, en avaient grand besoin.
Autrefois, quand j’étais en colère contre les communistes – disons pour être plus précis et plus juste les staliniens - je leur conseillais avec véhémence de prendre un train pour Bucarest, Varsovie ou Moscou et d’aller de la sorte un peu rafraichir dans leur tête des idées qui, à l’évidence, en avaient grand besoin.
Depuis j’ai mis de l’eau dans mon vin, comme on dit, et, comme je suis excessif dans tout ce que je fais, j’ai même fini par ne plus mettre de vin dans mon eau.
Mais j’ai fait le voyage. Je vis depuis douze ans dans un pays où les communistes ont régné sans partage pendant cinquante ans.
C’est autre chose que de faire du tourisme historique, ça, coco…
J’ai donc écouté des centaines de témoignages et je vois encore, sur la campagne jolie, ces immondes immeubles, lépreux, bas, humides, désolants que l’État bolchevique avait construits et dispersés n’importe où, en guise de logement collectif pour les paysans de la société sans classe.
Des cicatrices, des plaies sur le paysage qui en disent long, très long sur la qualité de vie de l’époque.
Pour de multiples autres raisons, j’étais donc pas mal inspiré - et j’étais loin d’être le seul - d'inviter les communistes de mes colères de jeunesse à venir faire un tour ici.
Et maintenant que je suis vieux, je dis tout ça pour inviter ceux qui s’apprêtent à voter Le Pen à venir faire un tour au pays du populisme polonais.
L’histoire joue en boucle, décidément !
Alors venez, venez, braves gens, voir l’état de la plus belle forêt d’Europe tombée entre les mains des patriotes dont la mentalité allie la violence du chasseur à l’âpreté cupide du bûcheron !
Venez constater les dégâts, partout sur le territoire, hors Białowieża, causés par la politique de la tronçonneuse, celle-ci étant chargée d’alimenter par le saccage et la vente intensive des forêts les fonds nécessaires à la tenue de promesses électorales délirantes !
Venez constater combien les patriotes aiment leurs compatriotes… A tel point qu'ils envisagent d’élargir l’impôt sur la télé à ceux qui n’ont pas la télé parce qu’un citoyen normalement constitué, un citoyen qui ne passe pas ses soirées à réfléchir à de la subversion, a forcément la télé ou, s’il ne l’a pas, c'est qu'il la planque. De toute façon, il n'y a pas à discuter, il doit l’avoir à tout prix.
Même chose pour l’autoradio…Si vous avez une voiture, c’est que vous avez une radio dedans… ça sert à ça, l’automobile. A écouter le poste !
Et vous savez qui va être chargé de vérifier que vous avez bien une radio dans votre tire pour vous faire cracher une redevance ?
Le facteur ! Oui, le brave facteur qui n'en peut mais. J‘aimerais blaguer, mais hélas, non, je suis sérieux. Presque autant qu'un pape !
Et vous savez pourquoi tout ça ? Parce que la dialectique des mentalités a opéré en profondeur. Comme toujours. Les pires ennemis des populistes au pouvoir en Pologne, les bolcheviques, sont donc devenus, par renversement, leur modèle inavoué, leur fantasme…
Et il en sera de même avec Le Pen : la bolchevisation intégrale du pays.
Allez, bon vote, camarade !
Je ne te dis pas qu’il faille voter pour le dandy à la rouflaquette bien peignée, hein !
Je te dis simplement d’aller à la pêche, à l’ombre d’un frêne ou d’un peuplier, avec de la pelouse sous tes fesses et le vent qui jouerait dans tes cheveux tranquilles.
15:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : politique, écriture, élections | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
20.04.2017
Entre albatros et loriot

Non pas que vous soyez un poète émérite ou un grand oiseau blanc voguant par-delà les mers et les contingences, mais parce que vous ne saviez pas trop quoi en faire, de ce bec.
Eussiez-vous été un oiseau que vous auriez dédaigné le plumage de l'albatros pour celui du loriot. Parce qu'il est jaune, couleur de l'opprobre, avec du noir, couleur des pirates et de l'anarchie, et parce qu'il siffle remarquablement bien.
Les oiseaux possèdent cette insurmontable supériorité sur les hommes qu'ils savent chanter sans pour autant éprouver le besoin de s'auto-proclamer chanteurs ou artistes.
Ils chantent parce que c'est comme ça qu'on vit. En chantant sa vie et ses amours.
Vous avez pourtant vous-même chanté toute votre vie sans jamais être un chanteur.
Maintenant vous ne chanterez plus...Vous ne chanterez plus parce-que votre voix s'est tue, éteinte, massacrée, anéantie, assassinée par les brûle-gueule...
Et vous écrivez encore et toujours. Une écriture de muet pour réveiller les sourds. L'écrivain n'écrit pas la vie. Vous le savez bien : quand la vie le prend dans ses grands bras de passion ou de souffrances, il n'écrit plus rien. Il est à mille années-lumière de l'écriture.
C'est la vie enfuie qui l'écrit. Lui, il est sous la dictée d'une archéologie, parfois à peine entrevue.
D'ailleurs, à quoi bon tout ça ? A quoi bon redire tout ça ? Voyez plutôt l'avancée des ténèbres sublimes !
Est-ce qu'un oiseau s'évertue à être autre chose que ses chants et ses migrations, lui ?
Vous avez donc posé votre cul à la croisée des chemins et interrogé les quatre horizons :
L'un était brumeux et c'est là que sombraient les soirs honnis. Dans de l'eau salée. Vous n'avez jamais su nager.
L'autre était froid et gris. Vers l'île des fats avec leur humour que vous n'avez jamais trouvé subtil.
L'autre encore tremblait de chaleur. Vous n'aimez pas la chaleur.
Le dernier enfin rosissait le matin, aux heures où vous aimiez croire encore possible qu'on puisse prendre son envol.
C'est donc vers là que vous vous êtes enfui.
À la rencontre de vos chers matins. Remonter le temps. Tourner le dos aux jours qui s'effondrent.
Mais les quatre horizons ne sont que métonymies d'une même illusion !
Plus vous avanciez et plus le déclin vous poursuivait et plus devant vous s'évanouissait le rose bleuté de vos aurores.
Vous vous êtes aperçu un peu tard, mon cher, que la machine était vraiment ronde.
Parce que vous êtes un homme et que les hommes sont des vaniteux qui croient n'avoir plus rien à apprendre des évidences primaires.
Il eût fallu, pour métamorphoser votre condition au monde, marcher plus vite que la lumière.
Il est désormais bien trop tard pour apprendre ! dans votre dos n'entendez-vous pas le souffle des ténèbres sublimes ?
11:04 Publié dans Apostrophes | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
16.04.2017
Pour qui vos tétons ?
 Dimanche prochain, les Français de France iront voter. Ceux de l’étranger itou, sans doute, certains, mais pas beaucoup, car les socialistes chafouins ont décidé de leur ôter la possibilité de voter par internet, des fois que l’œil de Moscou viendrait mettre son grand nez dans la sauce électorale.
Dimanche prochain, les Français de France iront voter. Ceux de l’étranger itou, sans doute, certains, mais pas beaucoup, car les socialistes chafouins ont décidé de leur ôter la possibilité de voter par internet, des fois que l’œil de Moscou viendrait mettre son grand nez dans la sauce électorale.
A ce stade de la parano, ce n’est même plus de la connerie, c’est du génie inventif !
Bref… Pour ce qui me concerne, sollicité par le Consulat, j’avais bien voulu me prêter au jeu du test grandeur nature. Ma bonté citoyenne n’aura donc servi à rien, comme toujours et comme toute bonne bonté citoyenne qui se respecte.
Je n’en souffre cependant pas avec trop de rigueur, comme dirait le poète, et me déplacer à Varsovie, faire 400 kilomètres aller/retour pour aller pisser dans un violon, non, thank you very much, comme diraient les autres c.., là-bas, sur leur île brexitée.
Les Français de France, donc, iront voter. La main sur le cœur, longeant le pavé des rues, marchant tête baissée, échine courbée, comme marchent les veaux qu’on mène à l’abattoir.
Et pour qui votera-t-on donc ? Telle est la question. Il paraîtrait qu’ils ne le savent pas trop eux-mêmes, mes braves compatriotes, tant le rayon est bien garni et, surtout, tant toutes les étoffes proposées sont criardes et, au premier coup d’œil, font marchandises de pacotille. Certes, il y a bien quelques excités de l’imbécillité congénitale pour gueuler que tel morceau de tissu est plus solide, plus fiable, plus franc que tous les autres, mais, depuis le temps que sévissent de tels excités et qui braillent toujours les mêmes conneries, plus personne ne les écoute vraiment.
Le problème, c’est qu’on est quand même condamnés à les entendre…
Ils ne savent pas pour qui ils vont voter, les François, mais, moi qui suis loin, qui vois tout ça avec le recul nécessaire à l'objectivité, qui suis donc un excellent (et modeste, notez bien) sondeur d’opinions, je peux vous dire à 100% contre qui ils vont voter : contre eux-mêmes.
Car le lapin tout doux, tout mignon, qui sortira du chapeau de la mascarade aura vitement d’effroyables dents de loup, qui les prendront à la gorge et n’auront de cesse de serrer qu’ils n’aient rendu l’âme - non pas à Dieu -, mais à la grande foire libérale et à l’encensement de valeurs qui ne valent pas, justement, un pet de lapin.
10:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : écriture, élections, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
09.04.2017
Nouvelle
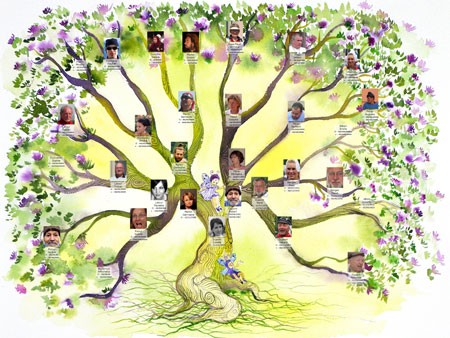
NOCES D'OR
Les oreilles s’écartaient des têtes, même si ça n’était pas un Bovary que l’on mariait ce jour-là.
On célébrait en effet les noces d’or d’un couple de campagnards septuagénaires, Eugène Démoisseau et Madeleine, née Dupuis. On était donc rasé de près, on s’était affublé de ses plus beaux atours, on avait même pour l’occasion astiqué l’automobile.
Les paysans, membres de la famille proche ou amis les plus chers du couple champion de la longévité conjugale, se tenaient raides, empêtrés dans leur habit du dimanche, quoiqu’ils s’efforçassent d’offrir un visage gai et décontracté, celui qui sied au caractère convivial de ce genre de réjouissances. Ils piétinaient néanmoins sur l’espace herbeux servant de terrasse à l’auberge, en attendant le déjeuner car on avait, et ça commençait à se murmurer de groupes en groupes, l’estomac dans les talons. Pensez qu’il était plus d’une heure et qu’on baguenaudait de-ci de-là depuis dix heures du matin !
On avait d’abord assisté à une messe, ce qui n’avait pas été du goût de tout le monde. Certains hommes de conviction, de rudes gaillards, sanguins, étaient ostensiblement demeurés sous les tilleuls du parvis, les mains dans les poches, la cigarette au bec et causant fort, tant, que des femmes courroucées leur en avaient fait le véhément reproche parce qu’on les avait soi-disant entendus de l’intérieur de l’église.
Tout le monde avait ensuite été prié de venir admirer une exposition réalisée par le vieil époux. C'étaient toute une série de photos et de parchemins jaunis qui retraçaient la vie du jeune homme, puis de l’homme marié, vaillant cultivateur, puis, finalement, celle du paisible retraité et tout ça se terminait par un trait d’humour, ou d’angoisse, difficile à dire, les deux peut-être, l’un devant conjurer l’autre : deux points suspensifs fermés par un d’interrogation. Cette exposition avait été placardée à la mairie, dans la salle du conseil municipal, sous l’œil goguenard de Chirac et à l’ombre des seins resplendissants de Marianne. Oui, l’époux était aussi conseiller et le maire - qui figurait d’ailleurs parmi les convives - lui avait gentiment octroyé ce privilège.
On s’était exclamé, on avait tapé sur l’épaule du père Démoisseau, on avait fait mine de se pencher pour mieux voir les détails des vieux clichés ou pour déchiffrer l’écriture emberlificotée des documents, extrait de naissance, certificat d’études, état des services militaires, actes de mariage, actes de propriété, diplômes agricoles et tutti quanti. On avait tout de même un peu brocardé l’artiste autobiographe du fait qu’on ne voyait pas beaucoup trace de Madeleine dans tout ce bel inventaire.
Toute une vie s’étalait donc là et les photos des deux sémillants conjoints, debout sous l’ombre d’un chêne aux ramures abondantes, la mariée tout sourire arborant un gigantesque chignon et tenant dans ses mains fluettes un gros bouquet d’iris, accusaient cruellement la fuite lamentable du temps, surtout si on jetait vers le vieux couple un regard torve, comme pour vérifier l’authenticité de ce qui était montré là.
C’est ce qu’on disait, en tordant le nez, en reniflant fort et en haussant les épaules. On disait que les saisons de la vie filaient bien trop vite, qu’on était tous logés à la même enseigne et on affectait de faire le philosophe en déplorant savamment que ce n’est pas grand-chose de nous, si on y réfléchit bien !
Mais le clou de l’exposition, le chef-d’œuvre d’ingéniosité devant lequel pavoisait son auteur en se dandinant et en donnant force explications, un sourire radieux illuminant sa grosse figure, c’était un cadre sous verre, énorme, large de deux mètres au moins et haut d’un mètre environ, avec des cases de toutes les couleurs et des branches, et des ramifications et des brindilles : l’arbre généalogique de la famille Démoisseau. Eugène commentait qu’il avait fait des recherches obstinées pendant trois ans, que ça l’avait bien occupé et qu’il avait eu de la chance parce que depuis des siècles et des siècles, sa famille n’avait guère bougé de la contrée. Il avait en tout et pour tout fouiné les états civils d’une dizaine de communes et ça avait été parfois ardu parce qu’à la Révolution, des papiers avaient été détruits.
Ah, les révolutions, grommelait l’auditoire unanime, c’est jamais trop bon ! On sifflait d’admiration, on notait avec grand respect que les premières racines de l’arbre puisaient dans les années 1670 et que les dernières ramures s’élevaient jusqu’en 1999. Oui, du bon travail, du travail de fourmi, qu’on disait en congratulant le chercheur minutieux et en pensant fortement que ça ne servait à rien des conneries pareilles et qu’il ne fallait vraiment pas savoir quoi faire de ses dix doigts pour s’occuper à des choses de même.
Avec tout ça, l’heure avait donc filé et on était maintenant pressé, sans en faire évidemment exagérément montre, de mettre enfin les pieds sous la table. D’autant que les deux époux avaient eu la curieuse idée d’aller dénicher une auberge dans les profondeurs marécageuses de Nuaillé – le bien nommé-, complètement retirée, qu’on avait eu mille peines à trouver, même qu’on s’était perdu, qu’on avait fait des demi-tours, et qu’on s’était un peu énervé dans l’intimité des voitures, ronchonnant que c’était de l’orgueil que de venir faire l’original là, plutôt que de manger tout simplement au café-restaurant du bourg, ou à la salle des fêtes, servi par le boucher-charcutier-traiteur de la commune.
Car elle était effectivement fort difficile d’accès, cette auberge, et quelqu’un qui n’eût pas été suffisamment prudent, aurait risqué, c’est sûr, de s’embourber dans quelque cul-de-sac fangeux, voire de sombrer dans une petite conche. Au beau milieu des prairies que les mortes saisons inondaient et que séparaient entre elles des haies de frênes-têtards impeccablement alignés, des fossés, des rus, des chemins de halage ou de traverse, c’était une espèce de gargote à quatre sous, basse et longue, avec des murs d’un blanc approximatif par endroits lépreux, surmontés d’un vieux toit moussu et passablement avachi. Elle n’avait pas de fenêtre. Juste au-dessus de son unique ouverture constituée d’une lourde porte vitrée, la tête d’un gros chef cuisinier coiffée d’une toque géante, la mine poupine, de lourdes moustaches noires qui lui dégoulinaient bien en-dessous du menton, arborant un sourire amène en dépit de quelques dents manquantes, l’œil radieux, jouisseur et gourmand, se balançait inlassablement sous les coups de butoir des vents, en gémissant et en grinçant. Son front était barré d’une longue flétrissure de rouille qu’on eût dit une affreuse estafilade.
Le patron des lieux ne devait pas, en outre, épuiser toute son imagination autour de ses sauces aux lumas, de ses rôtis, de ses matelotes d’anguilles, de ses lapins en gibelotte, de ses coqs au sang et de ses huîtres farcies qu’offrait à déguster un menu placardé sur la porte, car il avait, en-dessous de sa vieille enseigne, disposé une planche retenue tant bien que mal par deux ficelles, et qui annonçait à la peinture violette : Aux agapes du bout du monde.
On ne pouvait guère mieux annoncer la couleur. La solitude des lieux était telle que c’en était troublant pour un commerce ayant pignon sur rue. Pignon sur le silence des prairies, qu’elle avait en fait la guinguette toute de guingois et dans leur jargon charentais, des invités ,moqueurs maugréaient qu’o d’vait être ravitaillé par les grolles, y’a pas d’bon dieu !
En effet, aucune voie goudronnée ne conduisait ici et pas la moindre signalétique alentour, ni sur les chemins vicinaux, ni sur la route départementale, ni sur la nationale 11, La Rochelle-Limoges via Niort, qui filait par-delà les peupleraies à une dizaine de kilomètres de là, n’indiquait qu’il y eût dans les parages un restaurateur qui offrait de savourer les spécialités régionales.
Tout cela surprenait évidemment les convives des noces d’or, même si les avis étaient diamétralement opposés. Les pessimistes lorgnaient d’inquiétude chagrine sur l’aspect quelque peu délabré de l’établissement et sur ce traître mot d’agapes qui ne leur disait rien qui vaille. Ils tordaient le nez, se montraient bourrus et se voyaient déjà embarqués pour un après-midi des plus moroses. Les autres, les optimistes, se disaient que les Démoisseau n’étaient quand même pas assez fous pour les avoir aventurés dans des marais déserts, par des chemins boueux, mal aisés, au milieu des champs inondés, si le jeu n’en avait pas valu la chandelle et si ce qu’il y avait là à goinfrer n’était pas de taille à satisfaire leurs appétits.
Ceux-là, les plus impatients aussi, se pourléchaient les babines ou, pour certains, se frottaient même la panse, comme font les enfants quand ils disent miam miam.
Enfin les maîtres de céans mirent fin aux supputations en invitant tout ce beau monde à pénétrer à l’intérieur de l’auberge. On s’y rua, on s’y bouscula presque, on se chamailla, on se poussa du coude pour trouver une bonne place. C’était là peine perdue : chaque couvert était nominatif et comportait une petite étiquette avec les noms et prénoms des commensaux. Alors, on fit le tour des tables en se heurtant un peu, en se penchant pour lire, les myopes en ajustant leurs lunettes, les presbytes en les enlevant, et on se croisait, on plaisantait qu’on ne trouverait jamais où s’asseoir dans tout ce fourbi, on faisait demi-tour et on braillait dans un inextricable tapage.
Chacun finit néanmoins par trouver la chaise qui lui était dévolue. Un étrange silence se fit alors avant que l’on ne serve les apéritifs, du pineau fait maison, claironna le patron des lieux et tout le monde en rigolant, en se tapant sur l'épaule et en se le montrant effrontément du doigt reconnut la réplique exacte de son enseigne, la rouille sur la joue en moins...
La salle à manger était étroite, démesurément longue, et ne présentait nullement l’allure négligée de l’extérieur. Bien au contraire. Deux tables rustiques, massives, épaisses, impeccablement cirées et chacune affublée de deux bancs du même tonneau, en occupaient toute la longueur. De part et d’autre, de petits buffets, de plaisants confituriers, deux magnifiques vaisseliers en merisier et des placards astucieusement pratiqués dans la pierre apparente des murs, servaient au rangement de la vaisselle. Tout respirait la propreté et la décoration de l’ensemble, rideaux de fines dentelles, quelques plantes vertes, des tableaux discrets suspendus ça et là, était sobre, de bon goût, si on arrivait toutefois à faire abstraction d’un goupil empaillé, le poil rêche, l’œil de verre ébloui, la dent agressive exhibée sur des gencives noirâtres, qui pontifiait sur un meuble bas, pourtant d’une ancienne et très belle facture.
Pendant qu’on versait le pineau dans de petits verres de cristal, monsieur le conseiller municipal Eugène Démoisseau, se leva et annonça qu’il allait faire un discours, ce qui ne manqua pas d’inquiéter encore les plus affamés de l’assemblée. Il pérora qu’il était heureux de réunir autour de lui et de son épouse, en ce jour mémorable, toute sa famille et ses plus chers amis. Il décrivit avec tendresse ce 25 mars 1949 où il avait convolé en justes noces avec Madeleine Dupuis, devant laquelle il fit une petite courbette avant de demander qu’elle fût applaudie au passage, comme si, remarquèrent in petto quelques esprits malins, le fait de l’avoir supporté pendant cinquante ans méritait effectivement d’être enfin applaudi.
Puis l’orateur se perdit en des considérations d’ordre météorologique sur ce 25 mars 1949 et que l’année n’avait pas été bonne parce qu’il avait gelé tardivement et que, à bien y réfléchir, le climat se réchauffe, mais il est vrai aussi qu’à tout bien considérer et si on va par là, il faudrait….Bref, personne n’écoutait plus, il se rassit légèrement dépité, on cria hip hip hip hourra, on applaudit avec frénésie, on porta un toast expéditif et on se jeta sans plus d’ambages sur les merlus froids, couchés sur une onctueuse mayonnaise, des rondelles de tomates, des quartiers de citron et des feuilles de salade.
On eût dès lors entendu une mouche voler à travers le cliquetis des fourchettes, des couteaux et des verres. On s’empiffrait, on buvait à grandes lampées de l’Entre deux mers, on réclamait par des signes en direction des jeunes filles déambulant entre les deux grosses tables, du pain, encore du pain, toujours du pain, pas assez de pain, du bon pain !
Puis vinrent les anguilles persillées. On les avala avec le même emportement et en les accompagnant d’un succulent vin rosé, du vin de Loire. On se léchait les doigts, on torchait les plats avec de grosses bouchées de pain frais, on avait les commissures des lèvres et, pour certains, le menton, qui luisaient d’une fine couche huileuse.
Les estomacs ainsi flattés, les conversations, d’abord éparses avant de devenir un inaudible chahut, purent alors reprendre, en attendant les gigots d’agneau piqués d’ail et servis avec leurs traditionnels flageolets. Et quand il ne resta plus tantôt que l’os à ces beaux morceaux d’agneau, les trognes étaient rouges, violacées, et on s’interpellait, et on riait, et on criait, et on chantait, et on tapait sur la table en vidant des bouteilles de Côtes du Rhône, que les jeunes filles ne cessaient pas de disposer sur les tables.
Eugène Démoisseau se leva, tapa dans ses mains, fit tinter une bouteille vide en la frappant avec sa fourchette et, de guerre lasse, finit par hurler que Madeleine allait chanter. C’était juste avant les plateaux de fromages. Il se fit un silence relatif, disons une nette accalmie, et la mariée, petite femme toute fluette, avec un visage pétillant encore fort agréable, entonna, très haut, Rossignol de mes amours, en travaillant impeccablement les trémolos et en tenant bien les longues notes des refrains, tant que des vieillards, l’émotion décuplée par les alcools, versèrent quelques larmes d’attendrissement.
On l’applaudit avec ferveur, on beugla le refrain populaire quand une chanteuse a bien chanté, ses voisins, ses voisines doivent l’embrasser, et on se leva chacun de table pour venir l’étreindre. L’exaltation était à son paroxysme. La fête, comme on dit, battait son plein.
Un observateur minutieux de tout ce charivari eût cependant pu distinguer en son sein comme une espèce de brebis galeuse. Un homme très grand, énorme, le visage rubicond et rond comme un ballon, assis juste en face des héros de la fête, juste en face de sa sœur exactement, demeurait en effet obstinément taciturne. Il s’agissait de Gaston Dupuis, de dix ans le cadet de Madeleine, vieux garçon et qui passait au village pour un original et un mauvais coucheur. Alors que tous les visages étaient rieurs, hâbleurs et rutilants, le sien était obstinément fermé et pendant les cinq heures qu’avait duré le repas, il avait dû supporter les discours de son beau-frère, comme d’ailleurs les quatre ou cinq convives installés alentour, sur la façon dont il s’y était pris pour faire son gigantesque arbre généalogique, avec tous les détails, le prix que ça lui avait coûté en essence, en papier et diverses babioles, les maires qu’il avait rencontrés, les conversations qu’il avait eues avec eux, les archives perdues et en fin de compte retrouvées, et tout le Saint-frusquin.
N’ayant personne à qui adresser la parole, isolé face à l’incorrigible raseur, soufflant comme un phoque, suant sang et eau, Gaston Dupuis, déjà de constitution fort sanguine, s’était réfugié dans l’excès. Il avait deux ou trois fois repris de tous les plats, il avait bu comme un chameau aux portes du désert, il avait avalé un fromage de chèvre entier, avait englouti des pâtisseries, bu du café, éclusé plusieurs coupes de Champagne et s’était finalement complètement noyé dans de grandes rasades de cognac. Il n’entendait désormais plus personne. Il regardait autour de lui, l’air hébété, la bouche ouverte comme un gros poisson en demande d'oxygène, et s’épongeait le front avec un grand mouchoir à carreaux.
C'est alors qu'un commensal, à l’autre bout de la salle, qui s’était mis debout sur le banc et racontait une histoire dont la chute se proposait d’être salace - il en avait préalablement prévenu ces dames - fut subitement interrompu par un bruit sourd, mat, inquiétant, en même temps que par des éclats de verre qui se brise : Gaston Dupuis venait de s’écrouler et avait piqué le nez dans son assiette, encore à demi remplie de larges parts de tarte Tatin.
On se précipita, on l’allongea sur le sol, on s’aggloméra autour de lui presque à lui marcher dessus et à finir de l’étouffer, un gars brama qu’il allait passer l’arme à gauche, nom de dieu, qu’il fallait vite le saigner et déjà brandissait un couteau. On eut mille peines à s’interposer et à le maîtriser.
L’aubergiste était au comble de l’affolement. A une vitesse vertigineuse une foule d’emmerdements qui ne manqueraient pas de lui arriver si le drame se confirmait, tournoyaient dans sa tête. Il joignit enfin le SAMU de La Rochelle, lequel SAMU se perdit dans les marais, rappela l’aubergiste pour donner sa position et savoir où exactement il lui fallait secourir, s’embourba encore dans un chemin de traverse et parvint enfin Aux agapes du bout du monde alors que le gros Gaston Dupuis était depuis longtemps étendu sur un coin de table débarrassé à la hâte et qu’autour de lui, des hommes et des femmes atterrés faisaient des signes de croix en pleurs.
La même assemblée, exactement, suivit le sapin quelques jours plus tard, toujours affublée de ses plus beaux atours mais la mine cette fois-ci franchement déconfite.
On murmura que si seulement on avait été au restaurant du bourg, avec le médecin tout près, là, à deux maisons exactement, hé ben, peut-être que ce pauvre Gaston…
Mais on n’accusait pas, hein ?
On disait, on faisait des suppositions. C’était la fatalité…Fallait bien causer un peu, après tout...
09:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
















