26.01.2017
Chemin faisant
 Je ne cessais d’arpenter les bois et les campagnes. Je courais les chemins, comme disait ma mère.
Je ne cessais d’arpenter les bois et les campagnes. Je courais les chemins, comme disait ma mère.
Pour elle, cela signifiait que j’étais un chemineau. Un vagabond. Bref, un rêveur qui ne faisait rien de ses dix doigts.
Ces chemins qui montaient entre les haies de chênes ou d'ormeaux, oui, je les courais ! J’aimais ça, je n’aimais que ça. Je m’évadais, je prenais par les champs et les sentiers et, tout le jour, jusqu’à la prime brune, je marchais. A la rencontre et au hasard. Sous le soleil qui brûlait, l’averse qui inondait, dans le gel qui mordait les doigts ou sous les pluies silencieuses des feuilles mourantes.
J’y ai appris le renard, le geai, le corbeau, la fouine, la pie, les passereaux de toute sorte, les champignons, les nids, les mousses et les fougères, les fossés, les clairières muettes, le terrier du lapin, le gîte du lièvre, les glissements froids du serpent sous l'herbe sèche et la grande solitude.
Plus tard, j’emmenais même avec moi ma guitare en bandoulière en ces lieux de désert. Je m’asseyais sur l’herbe des talus et je jouais des accords mineurs sur des paroles naïves qui disaient amour, qui disaient vie, qui disaient voyage… Le vent m’empêchait parfois d’entendre même ce que je jouais, mais je jouais. Il me semblait jouer en même temps pour le monde qui m’entourait et pour un autre que je recherchais. Je savourais l’inutilité de mon chant. Sa petitesse mélancolique.
Plus tard encore, lorsque j’ai pris la route avec deux ou trois chemineaux de mon acabit, que je me suis retrouvé en Allemagne, en Espagne, en Belgique, j’avais déjà des poils au menton que je laissais fièrement s’exprimer, mon corps était torturé par des désirs effrayants parce qu’inassouvis, mais je faisais exactement la même chose. Je restais fidèle à mes premiers chemins, aux vagabondages, au hasard et à l’inutile.
Sauf qu’il fallait traverser des villes et que je n’aimais pas les villes. Qu’elles m’apparaissaient comme des trahisons. C’est en rencontrant les villes que j’ai commencé à boire. Pour les survoler.
On dit courir les chemins mais on dit traîner les rues. Oui. Dans les villes, on ne courait plus, on n’allait plus à la rencontre d’une force intérieure, à soi, on allait à la rencontre des autres. On se traînait dans la poussière tapageuse. On ne chantait pas pour le vent mais pour tâcher qu’on vous jette une ou deux pièces.
Je n’ai jamais aimé les villes. Qui grouillent de solitude.
Aujourd’hui, face aux paysages toujours nouveaux de la Pologne, je suis comme sur mes chemins d’antan. Comme si, malgré tout ce temps écoulé, je n’avais pas encore épuisé la joie d’aller à la rencontre, sinon de rien, du moins de ce qu'on ne voit qu'avec le recul.
18:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écrtiture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
17.01.2017
Le Grand Inquisiteur d'Ivan Karamazov
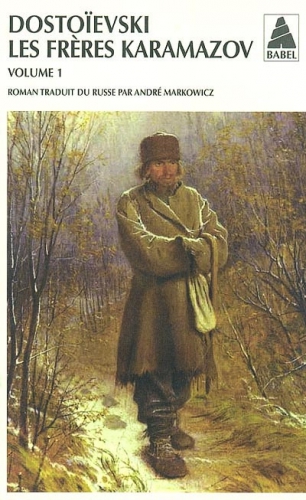 Beaucoup d’auteurs et de critiques, sans doute de bonne foi mais également grands fouineurs d’une quintessence inaccessible aux communs des lecteurs et dévoilée seulement à leur intelligence autoproclamée, se sont perdus en conjectures à propos d’un chapitre - au demeurant fort ennuyeux à mon goût - du livre de Dostoïevski, les Frères Karamazov.
Beaucoup d’auteurs et de critiques, sans doute de bonne foi mais également grands fouineurs d’une quintessence inaccessible aux communs des lecteurs et dévoilée seulement à leur intelligence autoproclamée, se sont perdus en conjectures à propos d’un chapitre - au demeurant fort ennuyeux à mon goût - du livre de Dostoïevski, les Frères Karamazov.
Ce chapitre s’intitule Le Grand Inquisiteur et se présente sous la forme d’une discussion, qui tourne très vite au monologue, entre deux Karamazov, Aliocha et Ivan.
A mon sens, pour bien saisir la nécessité de cette longue incise dans la trame du roman, tout comme l’opportunité de celle qui consacrera un livre entier au staretz Zosima, il ne faut pas perdre de vue Dostoïevski ; savoir qui il était, quels ont été ses tourments et quelles ont été, tout au long de sa vie, ses interrogations sur dieu, les religions et le libre-arbitre.
En partant de là, on sait que l’auteur des Frères Karamazov, ex-bagnard politique, slavophile, mystique et en même temps curieux du socialisme révolutionnaire au point de rencontrer et d’échanger avec Proudhon et Bakounine, avait besoin, à la fin des années 1870, de mettre au clair sa pensée philosophique et religieuse et qu’il a pour ce faire choisi Aliocha, le novice, comme son porte-parole et Ivan, l’athée, comme son antithèse.
Dmitri sera son mauvais ange, son double de l’ombre, sa part maudite.
Car si Les frères Karamazov est le dernier ouvrage de l'écrivain russe, le plus accompli, son chef-d’œuvre, il est aussi celui - excepté évidemment son Souvenirs de la maison des morts - qui porte le plus l’empreinte de sa biographie. L’idée même du parricide autour duquel s’articule toute la problématique, lui a été inspirée par un codétenu du bagne d’Omsk, finalement innocent et acquitté après dix ans de détention pour avoir été suspecté d'assassinat sur son père. C’est son dernier ouvrage, disais-je, mais pas son chant du cygne, pas non plus son testament littéraire et philosophique puisque, sa rédaction en étant terminée, Dostoïevski espérait sur une vingtaine d’années à vivre encore et pensait avoir le temps de construire une œuvre monumentale.
La camarde, hélas, comme toujours et comme partout, en décida autrement: l’auteur est mort à soixante ans, en 1881, tout juste un an après la fin de la parution de son roman en feuilleton, dans le Messager russe.
Quand, en 1878, Dostoïevski jette sur le papier les premières notes du roman, un drame intime vient de meurtrir sa vie. Son fils de trois ans est mort d’une crise d’épilepsie, maladie qu'il lui a transmise. On imagine dès lors le grand tourment de culpabilité qui assaille l’auteur et on comprendra mieux qui est Aliocha Karamazov quand on aura pris la peine de se souvenir que le fils prématurément disparu de Dostoïevski s’appelait lui-même Aliocha. L'auteur le fera donc revivre dans un des frères Karamazov, lui donnant jusqu’à son nom, et, entre multiples autres choses, le fera destinataire unique de la confession de son frère Ivan, au cours d’une rencontre fortuite dans une auberge. Cette confidence philosophique d'Ivan Karamazov se présente sous la forme d’un long poème qu’il se proposait d’écrire quelques années auparavant, qu’il n’a pas écrit et n’écrira jamais : Le Grand Inquisiteur.
N’en déplaise aux inconditionnels du maître - mais les intellectuels sont toujours, dans un sens ou dans l’autre, des inconditionnels de quelqu'un ou de quelque chose - cette scène est tout simplement artificielle et mal venue. On la ressent comme un passage off. Comme une mise en scène ad hoc. Car on sent bien que le grand romancier voulant exposer à tout prix l’antiphrase de sa pensée par la bouche d’un matérialiste athée, Ivan, il fallait que ce soit son héros, Aliocha, l’ombre de son fils tragiquement décédé, qui en soit le dépositaire.
D’où cette rencontre dans une auberge, dans laquelle est en train de déjeuner Ivan. Juste un décor, mais pas du tout un décor juste, même si nous savons que Dostoïevski, à la grande différence de Tolstoï, est d’abord l’écrivain de l’intérieur.
Brièvement, voici donc le sujet du poème avorté et imaginé par Ivan.
En pleine Renaissance et alors que l’Inquisition resplendit de toute sa furie meurtrière, en Espagne, Jésus redescend parmi les hommes, qui le reconnaissent et se prosternent aussitôt devant lui. Il ressuscite une enfant qui se lève de son cercueil. La foule autour de lui est transie d’amour et d’émoi.
Le cardinal, grand brûleur de chair humaine, Le Grand Inquisiteur donc, ne le voit cependant pas de cet œil. Il commande donc à ses gardes qu’ils se saisissent du fils de dieu et le jettent au cachot. Là, il expose à Jésus le reniement de l’église catholique quant à ses enseignements déjà vieux de 15 siècles et annonce à son prisonnier qu’il le fera brûler vif, dès le lendemain. Jésus ne dit absolument rien. Le Grand inquisiteur lui reproche essentiellement d’avoir laissé aux hommes la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de la foi, et de les avoir ainsi fourvoyés, animaux stupides qu’ils sont, dans un rêve qu’ils sont incapables d’atteindre et qui les tuent et les font s’entre-tuer. L’œuvre de l’Inquisition consiste dès lors à soumettre les hommes à une obligation draconienne d'avoir la foi, à être des esclaves sans âme critique, en échange du pain et, donc, à les rendre heureux, car enfin débarrassés du fardeau du libre-arbitre, bien trop lourd à porter pour eux.
Le cardinal inquisiteur dit ainsi à Jésus : Pourquoi es-tu venu nous déranger dans notre œuvre ? Nous sommes en quelque sorte en train de réparer tes erreurs.
Bien que mon résumé soit ici succinct jusqu’à l’outrance, on n’en voit pas moins que le message est lourd de conséquences dans la tête d’Aliocha, le croyant. Dieu étant renié, du moins sa parole sinon son existence, tout est permis. C’est là la philosophie d’Ivan, avouée sur l’interrogation pressante (scandalisée) d’Aliocha. Si on sait vraiment lire, il faut bien prendre ce fait en considération, car c’est ce Tout est permis qui pose a contrario la nécessité de dieu, qu’il ait créé les hommes ou qu’il ait été créé par eux. Peu importe, in fine.
Ce Tout est permis - à proscrire absolument selon Dostoïevski - ne pouvait donc être formulé que par antiphrase dans la bouche de son porte-parole avant d'être confirmé dans celle de son antithèse.
On voit dès lors combien les intellectuels de la quintessence et de la chose littéraire ont pu élucubrer à qui mieux mieux sur ce message dostoïevskien du Grand Inquisiteur.
C’est, à mon sens, faire tout bonnement fi de Dostoïevski, de l'homme, du slave, du slavophile, de l'orthodoxe. C’est chercher midi à quatorze heures et lui faire dire ce qu’on a envie de dire ou d'entendre soi-même. Car par-delà toute spéculation philosophico-religieuse, il ne faut retenir, selon ma propre lecture de ce poème putatif, qu’une violente diatribe contre Rome, l’église catholique et les jésuites qui, selon l’église byzantine, ont renié les enseignements du Christ.
Le génie du romancier est là : il fait dire sa conviction non pas par un orthodoxe - ce qui eût été une argumentation binaire quant au schisme qui s’est opéré dans la chrétienté - mais par un athée.
Et ce sont là, je l’avoue, les passages de ce grand livre qui m’importunent le plus. Parfois même jusqu’à l’ennui, la question de dieu ayant toujours été très mal posée par les hommes, c'est-à-dire en étant plus inquiète de leur existence propre ici-bas que de celle du royaume céleste, là-haut.
13:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
08.01.2017
Lire et lire
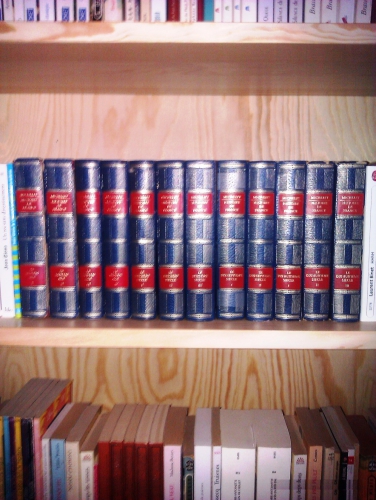
Entre deux turbulences, deux coups fourrés ou deux messes à Bacchus, je lisais les situationnistes, Debord et Vaneigem surtout, avec grand appétit.
Sanguinetti avec beaucoup moins de gourmandise, parce qu’il usait déjà d’une théorie au premier stade de son pourrissement et, partant, était contraint - surtout avec son Du Terrorisme et de l’État - de falsifier la réalité du présent historique.
Une théorie qui a perdu sa synergie avec le réel, qui n’y est plus connectée que par bribes, voire plus du tout, ça s’appelle tout simplement de l’idéologie.
Comme tout le monde aussi, j’ai lu Bakounine. J’ai lu les poètes anarchistes, les ouvrages consacrés à Makhno, le prestigieux Nettlau, Histoire de l’Anarchie. Victor Serge, Kropotkine, Cœurderoy etc et etc...
J’ai lu tout ça avec délectation parce que je portais tout ça en moi.
Sans doute.
L’idée précède toujours la lecture. Pas le contraire. C’est là le schisme qui sépare fondamentalement la culture de l'esprit du catéchisme. On lit surtout pour se retrouver entier et les meilleurs ouvrages à notre goût sont souvent ceux qu’ont aurait pu, ou tout du moins voulu, écrire.
Aujourd’hui, dans ma bibliothèque, il ne reste que quelques maigres vestiges de toutes ces lectures de la subversion. Comme des tessons d’une archéologie ancienne ; les autres ont été éparpillés, oubliés en France, prêtés, jamais revenus. Ceux qui restent, même, ne sont plus jamais ouverts. Ils dorment les uns contre les autres serrés. Ils soupirent l’inutilité.
L’époque, l’envie, le besoin, la saison inscrite à mon calendrier, les ont installés là comme des meubles anciens qu’on ne voit plus, comme de vieux compagnons, sans les renier toutefois.
Les deux seuls, peut-être, qui ont encore la page chantante, seraient Darien et Zo D'Axa...
Car je ne pense pas avoir changé de sensibilité. Je le sens bien. Le monde est toujours dans mon ressenti, de par son organisation, son discours, ses vues, une image renversée par rapport au sens de l'existence.
Le langage y est totalement spectaculaire, bien plus qu’à l’époque de Debord, langage tellement dénué d’essentiel et tellement revêtu d’apparence, qu’il est difficile de dissocier l’un de l’autre et facile de se piéger soi-même en toute bonne foi.
Plus que jamais la chose politique avoue chaque jour sa veulerie.
Nous sommes condamnés à la solitude.
Je n’ai plus dès lors besoin qu’on m’écrive, noir sur blanc, sans ambages, sans littérature, que ce monde est humainement mauvais.
Le savoir ne le fait pas meilleur à vivre.
Alors je lis… Et je relis.
Des contraires, quasiment, de tous ces hommes à la plume desquels se sont nourries mes convictions avérées.
Comme si ces plumes m’avaient empêché de goûter pleinement une autre encre.
Je lis Giono, Maurois, Bosco, Pérochon, Stendhal, Genevoix, Vialar, Balzac, Camus, Flaubert, Maupassant, Hemingway, London, Mérimée, Tolstoï, Dostoïevski, Michelet, Soljenitsyne et bien d’autres encore.
Que des réacs. Ou presque.
Que de la littérature du vieux monde.
Et j'écris du Redonnet. C'est dire !
14:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET
04.01.2017
Ça devait être une chanson
Du temps où je chantais encore...
C’est si loin ce que j’entends de Toi
C’est si loin de toi si loin de moi
Alors…
Je te chante ça m’enchante tu me hantes
Sous le vent
Je te chante ça m’enchante tu me hantes
Bien souvent
Qui es-tu maintenant ? Un là-bas
Une plage une brume un ciel bas
Alors…
Je te chante ça m’enchante tu me hantes
Dans le froid
Je te chante ça m’enchante tu me hantes
Bien des fois
Se quitter c’est nous deux qui le fîmes
Pas de pleurs ni de chagrins intimes
Même si...
Je te chante ça m’enchante tu me hantes
En silence
Je te chante ça m’enchante tu me hantes
Ô ma France !
10:35 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET
Facebook | Bertrand REDONNET

















